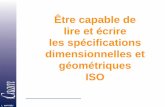Cours de sémiotique
-
Upload
univ-paris13 -
Category
Documents
-
view
4 -
download
0
Transcript of Cours de sémiotique
1DUT MMI 2, Sémiotique
Pascal Vaillant
Sémiotique : étude du sens
Grec σημειον (sêmeion) : le signe
Ferdinand de Saussure :
sémiologie : « science qui étudie la vie des signes au sein de la vie sociale »(Cours de Linguistique Générale, 1916)
Sémiotique
2DUT MMI 2, Sémiotique
Pascal Vaillant
Le signe
Un galet sur la plage n'a pas de sens
Le sens suppose une altérité : quelquechose renvoie à quelque chose d'autre(aliquid stat pro aliquo)
L'un des concepts fondamentaux (en tout cas fondateurs) de la sémiotique est le signe
Le signe est un élément qui fait sens.
3DUT MMI 2, Sémiotique
Pascal Vaillant
Modèles du signe
Aliquid stat pro aliquo :
mot chose
En quoi consiste le lien ?
Il manque quelque chose !
La rose ne « signifie » pas l'amour en vertu de ses propriétés naturelles ; elle signifie l'amour dans l'esprit de quelqu'un.
4DUT MMI 2, Sémiotique
Pascal Vaillant
Le modèle triadique du signe
Vox significat res mediantibus conceptibus :
mot chose
représentation
→ Conception très répandue : modèle triadique du signe (Peirce, Ogden & Richards, Morris)
5DUT MMI 2, Sémiotique
Pascal Vaillant
Le signe linguistique de Saussure
« Le signe […] unit non une chose et un nom, mais un concept et une image acoustique » (Saussure, Cours de Linguistique Générale)
signifiant
signifié
→ La linguistique ne s'intéresse pas à la chose
6DUT MMI 2, Sémiotique
Pascal Vaillant
Forme et substance
Une distinction fondamentale en sémiotique
Théorisée par Saussure, puis par Hjelmslev
Le signifiant n'est pas identique à l'objet physique du signe (signal sonore, trace d'encre sur du papier …) ni le signifié à l'objet physique du référent (l'éventuelle chose dont on parle)
Seule une partie des caractéristiques physiques de l'objet compte pour le signifiant
Seul un modèle abstrait compte pour le signifié
7DUT MMI 2, Sémiotique
Pascal Vaillant
Forme du signifiant
Exemple de la pièce pour la machine à café :
La pièce de 1€, en tant qu'objet physique présente une multitude de paramètres
Mais seuls comptent pour la machine à café : le poids, le diamètre, l'épaisseur de la tranche… parce que c'est cela seul qu'elle reconnaît.
Les autres caractéristiques (p.ex. le dessin côté face) ne comptent pas.
Le poids, le diamètre, l'épaisseur constituent la forme du signifiant (de l'expression).
8DUT MMI 2, Sémiotique
Pascal Vaillant
Forme du signifié
Je peux vous parler de mon vélo sans que vous connaissiez son poids exact ou sa couleur
(le signifié du mot « vélo » n'a pas de poids).
Ce qui fait partie du signifié est ce que vous comprendrez automatiquement du fait que j'emploie le mot vélo
(il a deux roues, une chaîne, un guidon …)
Les deux roues, la chaîne, le guidon constituent la forme du signifié (du contenu).
9DUT MMI 2, Sémiotique
Pascal Vaillant
Le modèle tétradique du signe
« [les] éléments nécessaires pour qu'il y ait signe […] sont au nombre de quatre » (Klinkenberg, Précis de sémiotique générale)
stimulus référent
signifiant signifié
10DUT MMI 2, Sémiotique
Pascal Vaillant
Le modèle tétradique du signe
Ce modèle distingue expression et contenu, forme et substance :
stimulus référent
signifiant signifié
FORME
SUBSTANCE
EXPRESSION CONTENU
11DUT MMI 2, Sémiotique
Pascal Vaillant
Des signes aux textes
En réalité les signes n'apparaissent (presque) jamais tout seuls.
Et quand les signes sont à plusieurs, ils s'influencent systématiquement les uns les autres au niveau du sens.
(comme les légumes dans la ratatouille)
On appelle texte une production réelle. Les signes sont le résultat de la décomposition des textes.
12DUT MMI 2, Sémiotique
Pascal Vaillant
Le goût de la sauce
Ex. 1 : « le commissaire aboie » (Greimas)
Statiquement (dans le dictionnaire),commissaire = fonctionnaire de police ( +⇒ /humain/).
Statiquement (dans le dictionnaire),aboyer = bruit que font les chiens ( ⇒ – /humain/).
Dynamiquement (dans ce contexte), le commissaire ne fait pas concrètement « ouaf ouaf » ( aboyer est devenu un peu moins canin) ; mais en lisant cette phrase, on comprend très bien qu’il « parle comme un chien » : très désagréablement, d’une voix forte et hachée (le commissaire devient du coup un peu moins humain).
13DUT MMI 2, Sémiotique
Pascal Vaillant
Cercle herméneutique
Ex. 2 : « le chat mange la souris ».
Pas le même sens si plongé dans le contexte d'un roman à l'eau de rose (avec un riche héritier qui emmène une jeune étudiante romantique pour un dîner sur son yacht au soleil couchant).
C'est ce qu'on appelle l'influence du contexte si l'on se place au niveau local ;
ou le cercle herméneutique si l'on considère le fonctionnement de l'ensemble.
Le global détermine le local, et inversement.
14DUT MMI 2, Sémiotique
Pascal Vaillant
Le global détermine le local
Le global détermine le local, et inversement.
Règle générale des productions sémiotiques
Cela vaut pour les textes (linguistiques) comme pour les compositions graphiques (affiches, tableaux), filmiques, théâtrales …
On parle souvent de texte (au sens général) pour un assemblage de signes, pas forcément seulement de mots (ex. texte iconique)
15DUT MMI 2, Sémiotique
Pascal Vaillant
Diversité des systèmes de signes
Les signes sont des éléments de systèmes plus complets : les systèmes de signes
Système de signes linguistique : une langue (ou une variété de langue) ;
Système de signes non-linguistique : un système de pictogrammes (le code de la route) ; une norme vestimentaire ; un ensemble de codes gestuels dans des danses traditionnelles ;
Systèmes de signes hétérogènes : cinéma, théâtre, bande dessinée, etc.
16DUT MMI 2, Sémiotique
Pascal Vaillant
Déploiement des signes
Les signes d'un même système de signes se déploient pour former des textes.
Ils se déploient sur un espace qui dépend des contraintes physiques du substrat (ex. le temps du discours pour la langue, la feuille de papier pour l'image, le temps et l'espace devant le locuteur pour la langue des signes, etc.)
Cet espace où se déploient les signes est l'espace extérieur du système de signes(PV, Sémiotique des langages d'icône)
17DUT MMI 2, Sémiotique
Pascal Vaillant
Syntagmatique et paradigmatique
Pour chaque position dans un texte où se trouve un signe, il y a eu un choix : on a mis ce signe-là à la place d'autres signes qui auraient pu être choisis à la place.
Chaque signe se définit donc relativement aux signes qui sont autour de lui (in praesentia), mais aussi relativement aux signes qui auraient pu occuper la même place (in absentia)
On appelle ces deux axes de rapport entre signes l'axe syntagmatique et l'axe paradigmatique
18DUT MMI 2, Sémiotique
Pascal Vaillant
Syntagmatique et paradigmatique
Ex. dans le cas de la langue :
Le petit garçon dé noue son lacet
garnement
Ø
Un homme fait mon fil
Ce un
grand re
gentil Ø
S
P
19DUT MMI 2, Sémiotique
Pascal Vaillant
Signes et figures
En décomposant un texte en éléments plus petits, on obtient des parties qui contiennent chacun une partie du plan de l'expression et une partie du plan du contenu (des signes)
À un moment, si on continue à décomposer, il n'y a plus analogie entre plan de l'expression et plan du contenu
Par contre, on continue à trouver des éléments qui n'existent que sur un plan à la fois, et qui ont un rôle distinctif (des figures)
20DUT MMI 2, Sémiotique
Pascal Vaillant
Frontière du signe (+)
Au-delà de la frontière du signe : si on découpe un morceau sur l’un des plans, et qu’on le remplace par autre chose, alors, sur l’autre plan, il y a aussi une partie qui change et une partie qui reste identique.
Le renard mange le poisson
Le loup mange le poisson
La partie qui a changé sur un plan permet d’identifier le correspondant sur l’autre plan.
21DUT MMI 2, Sémiotique
Pascal Vaillant
Frontière du signe (–)
En-deçà de la frontière du signe : si on découpe un morceau sur l’un des plans, et qu’on le remplace par autre chose, alors, sur l’autre plan, tout le bloc change.
chat
chou
La partie qui a changé a fait basculer l’ensemble correspondant, sur l’autre plan, vers une tout autre totalité.
22DUT MMI 2, Sémiotique
Pascal Vaillant
Double articulation
Dans la langue, on a une double articulation (selon la formulation de Martinet) :
les mots (qui ont un sens) se combinent en phrases (qui ont un sens plus complexe) ;
mais en interne les mots sont eux-mêmes constitués de phonèmes, qui n'ont pas de sens par eux-mêmes (ils servent juste à distinguer les mots les uns des autres : chat/chou …)
Cette double articulation permet de dire tout ce qu'on a à dire (1) avec une bonne économie de moyens (2)
23DUT MMI 2, Sémiotique
Pascal Vaillant
Figures du contenu
La définition de la frontière du signe est réversible.
⇒ Il est tout à fait légitime de parler de figures du contenu, tout autant que de figures de l’expression
⇒ Le signe se manifeste sur les deux plans à la fois; son versant sur le plan de l’expression est le signifiant, son versant sur le plan du contenu est le signifié
⇒ La figure du contenu (sème) est distincte de la figure de l’expression (phonème, iconème ...). La figure du contenu est l’atome de valeur du signe.
24DUT MMI 2, Sémiotique
Pascal Vaillant
Comment décrire le contenu ?
La sémiotique s'intéresse à l'univers du sens, donc les travaux de sémiotique appliquée portent sur la structuration du plan du contenu.
On cherche à connaître la façon dont s'articulent les différents éléments du sens :
dans la dimension paradigmatique(quels choix possibles) ;
dans la dimension syntagmatique(comment les structurer dans le message).
25DUT MMI 2, Sémiotique
Pascal Vaillant
Fondements perceptifs du sens
L'univers du sens humain (ce qui est concevable, intelligible) s'ancre dans le monde perceptif.
→ Les grandes structurations fondamentales du sens (et les plus universelles) ont leurs racines dans notre univers perceptif (avec le corps comme repère) :
haut/bas, gauche/droite, devant/derrière, intérieur/extérieur ...
et sensoriel :
chaud/froid, lumineux/sombre, plaisir/souffrance ...
26DUT MMI 2, Sémiotique
Pascal Vaillant
Axiologies
Puis sur des couches de sens plus culturelles, se construisent d'autres oppositions dans le monde du contenu :
bon/mauvais, bien/mal, heureux/malheureux, courageux/lâche, beau/laid, naïf/rusé, etc. (infini)
D'une manière générale, le plan du contenu est décrit sous la forme d'axes polarisés (axiologies) ...
sur lesquelles s'articulent le plus souvent des oppositions binaires.
27DUT MMI 2, Sémiotique
Pascal Vaillant
Contraire et contradictoire
Un sème (élément de sens fondamental) plein : chaud s'oppose à un autre sème plein, de sens contraire : froid.
Par ailleurs la simple absence de ce sème constitue son contradictoire logique (pas chaud).
Il ne faut pas confondre contraire et contradictoire :
si c'est chaud, c'est forcément pas froid (implication) ;
Mais si c'est pas chaud, c'est pas forcément froid.
28DUT MMI 2, Sémiotique
Pascal Vaillant
Carré sémiotique
Ces quatre termes sont décrits sur un carré, qui schématise les structures élémentaires de la signification (Greimas & Rastier)
chaud froid
pas froid pas chaud
CONTRAIRES
SUBCONTRAIRES
contraire
contradictoire implication
29DUT MMI 2, Sémiotique
Pascal Vaillant
Figures et glossèmes
Les figures elles-même s'opposent entre elles par un jeu d'oppositions élémentaires.
Dans le cas de la langue parlée, il s'agit des traits phonologiques (consonne sourde/sonore, voyelle ouverte/fermée, etc.)
Hjelmslev appelle ces oppositions élémentaires des glossèmes.
Les glossèmes se distinguent sur un espace qui n'est plus l'axe syntagmatique.
30DUT MMI 2, Sémiotique
Pascal Vaillant
Espace extérieur, espace intérieur
L’opposition figures/glossèmes (phonèmes/traits phonologiques dans le cas de la langue) recouvre une rupture de dimension
Les glossèmes sont encore des éléments distinctifs, mais plus des segments dans la dimension sur laquelle s’alignent les signes
(ex. dans la langue : espace des fréquences et non pas dimension du temps de la parole)
On peut parler d’espace extérieur et d’espace intérieur
31DUT MMI 2, Sémiotique
Pascal Vaillant
Différences entre systèmes (1)
Le point de rupture entre espace extérieur et espace intérieur a lieu à des niveaux très différents suivant les systèmes de signes
Dans des systèmes de signes relevant de l’image, la dimension du point est souvent trop minuscule pour être pertinente en termes d’analyse sémiologique
(la tache de couleur pour la peinture, le grain pour la photo argentique, le pixel pour l’image numérique)
32DUT MMI 2, Sémiotique
Pascal Vaillant
Différences entre systèmes (2)
Le point de rupture entre signes et figures,dans la langue, est au-dessus de la limite entre espace extérieur et espace intérieur ; ce n’est pas toujours le cas.
Ce point (la frontière du signe) définit la limitede principe entre ce qui peut être sémantisé et ce qui ne peut pas l’être
A priori, un phonème, en langue, ne peut pas (généralement) être sémantisé
Alors qu’une toute petite tache de peinture peut l’être
33DUT MMI 2, Sémiotique
Pascal Vaillant
Le sens dans la langue
Les unités lexicales (signes à la cohésion interne la plus forte) sont les foyers de sens : ils constituent des clés d’accès au lexique mental.
Le cerveau du lecteur les assemble quasi-instantanément et repère les renforcements de traits (isotopies) et les oppositions (allotopies)
isotopie : le chien aboie
allotopie : le commissaire aboie
34DUT MMI 2, Sémiotique
Pascal Vaillant
Le sens dans la langue
Les isotopies créent un fond contextuel sur lequel se distingue la forme de chaque nouvel élément ajouté.
Chaque élément prend sens sur ce fond, par sélection des sèmes pertinents et virtualisation des sèmes non-pertinents sous la pression du contexte.
⇒ le sens se construit par stabilisation et recherche d’équilibre entre global et local
⇒ les « points d’entrée » sont les mots
36DUT MMI 2, Sémiotique
Pascal Vaillant
Première approche : l'iconicité
● En première approche, le signe linguistique est arbitraire (le mot n'a aucun rapport avec la chose), alors que le signe visuel (de type « image ») doit ressembler à la chose.
● Cette relation (« ressembler à ... ») s'appelle l'iconicité (du grec εικων, image).
● L'auteur qui a introduit l'usage du terme icône en tant que catégorie de signes est Peirce.
37DUT MMI 2, Sémiotique
Pascal Vaillant
Insuffisance de la « ressemblance »
● Le fait de fonder une définition d'un type de signe sur la « ressemblance » pose cependant problème.
● La ressemblance est une relation symétrique ; or le fait de signifier est une relation asymétrique : la représentation (Goodman)(l'objet ne représente pas le signifiant !)
● La ressemblance est une « question de degré » (Morris) ; il y aurait donc des signes iconiques « plus ou moins » iconiques, ce qui conduit à une absurdité(où doit-on s'arrêter pour avoir un critère définitoire ?)
38DUT MMI 2, Sémiotique
Pascal Vaillant
Les codes du signe iconique
● En réalité il ne faut tout simplement pas oublier que le signe iconique est un signe.
● Donc (comme tout signe) il sélectionne une forme du contenu dans la substance du contenu, et une forme du signifiant dans la substance du signifiant !
● C'est ce qu'Eco décrit comme des conventions de reconnaissance, et des conventions de transcription.
39DUT MMI 2, Sémiotique
Pascal Vaillant
Les codes du signe iconique
● Les conventions culturelles décrites par Eco (La structure absente) :– Les conventions de reconnaissance sélectionnent
les traits du contenu par lesquels nous identifions l'objet (ex. les rayures pour les zèbres ; les positions canoniques) ;
– Les conventions de transcription définissent des relations entre un type graphique respectant les contraintes du support et une classe de percepts visuels (ex. le trait hachuré pour l'ombre ; les rayons de soleil pour la lumière).
40DUT MMI 2, Sémiotique
Pascal Vaillant
Que reste-t-il de l'icône ?
● Une fois qu'on a compris que le signe iconique comprend une bonne part de convention, on peut être tenté de se demander s'il reste quelque chose qui fonde l'icône.
● En effet certains signes dit iconiques sont très conventionnels.
(Le petit pictogramme « montagne » utilisé sur les appareils photos pour indiquer le réglage « photos de paysage » ; le sinogramme « montagne » ...)
41DUT MMI 2, Sémiotique
Pascal Vaillant
Caractère chinois« shān » (montagne)
Pictogramme poursélectionner le modepaysage (appareilphoto numérique Sony)
42DUT MMI 2, Sémiotique
Pascal Vaillant
Ratio facilis et Ratio difficilis
● Eco (Trattato di semiotica generale) clarifie la question en distinguant deux modes de production du signe.– Le ratio facilis est le rapport entre signifiant et
signifié qui existe lorsqu'on reproduit un code existant.
– Le ratio difficilis est le rapport entre signifiant et signifié qui se construit lorsqu'on n'a pas de modèle, au moment de l'invention d'un code.
43DUT MMI 2, Sémiotique
Pascal Vaillant
Du signe au texte iconique
● Les signes iconiques se combinent pour former des textes iconiques
● L'image est naturellement bien placée pour exprimer les relations spatiales puisque son substrat d'expression est bidimensionnel.
● Par contre elle n'est pas très bien placée pour exprimer des relations temporelles, causales, logiques …
● Cf. comparaison de la sculpture et de la poésie par Lessing (Laokoon).
44DUT MMI 2, Sémiotique
Pascal Vaillant
Pieter Brueghell’Ancien :
Le dénicheurde nids
Indices de l’action(personnagedu haut) :
- position instable- chapeau en mouvement (d’après les lois de la physique connues)
45DUT MMI 2, Sémiotique
Pascal Vaillant
L'expression des relations spatiales
● Si je dessine un homme sous un arbre, mon dessin « signifie » (au premier degré) : un homme sous un arbre. Si je dessine un homme sur un arbre, mon dessin « signifie » : un homme sur un arbre.
● C'est la « spatio-sensitivité » de l'image (Eco).● Si un texte visuel est interprété suivant le
postulat d'iconicité, le plus facile à représenter est donc la relation spatiale.
47DUT MMI 2, Sémiotique
Pascal Vaillant
Continuité entre texte et signe
● La disposition spatiale se manifeste à tous les niveaux de l'image (l'homme sous l'arbre ; la tête sur le corps de l'homme ; les yeux au-dessus du nez et de la bouche …)
49DUT MMI 2, Sémiotique
Pascal Vaillant
Continuité entre texte et signe
● La disposition spatiale se manifeste à tous les niveaux de l'image (l'homme sous l'arbre ; la tête sur le corps de l'homme ; les yeux au-dessus du nez et de la bouche …)
● En d'autres termes, il ne faut pas chercher dans l'image une double articulation comme celle de la langue !
● Il y a une continuité entre textes, signes, et figures (modèle de Palmer, représenté par le Groupe μ, Traité du signe visuel)
50DUT MMI 2, Sémiotique
Pascal Vaillant
Herméneutique de l'image
● Les grands éléments visuels narratifs ne prennent sens que par combinaison d'éléments plus petits.
● Les petits détails ne prennent sens que dans le contexte d'éléments plus grands.
→L'image manifeste à un degré encore plus intense la propriété de « cercle herméneutique » déjà évoquée pour la langue (le global détermine le local et inversement).
51DUT MMI 2, Sémiotique
Pascal Vaillant
Scène champêtre (homme sous un arbre près d’une maisonnette) 0
maisonnette ...homme arbre
murs nbras tronctoit tête jambes feuillage
n+1contour du visage yeux bouche
... ......
Configuration spatiale bonhomme
Configuration spatiale tête
52DUT MMI 2, Sémiotique
Pascal Vaillant
Foyers de sens
● Mais où sont les foyers de sens ?● Dans les textes linguistiques, ils résident dans
les lexèmes et les grammèmes (unités linguistiques — lexicales ou constructionnelles — au sens stabilisé).
● Dans l'image, ils résident dans les configurations visuelles élémentaires, celles qui sont reconnues en premier.
53DUT MMI 2, Sémiotique
Pascal Vaillant
Formes élémentaires (Gestalten)
● Certaines de ces configurations visuelles sont les formes (Gestalten) visuellement prégnantes identifiées par la Gestalttheorie.
● Elles sont spontanément reconnues par l'être humain de manière innée et émergent visuellement (distinction forme/fond).– Formes compactes : lignes horizontales ou
verticales, carrés, ronds …
– Formes distribuées : alignements réguliers, symétries, contrastes ...
54DUT MMI 2, Sémiotique
Pascal Vaillant
Types iconiques● D'autres sont des types iconiques appris :
– plus ou moins profondément ancrés ;
– acquis plus ou moins tôt ;
– plus ou moins universels ;
– plus ou moins chargés de conventions culturelles.● Certains types sont universels et quasiment aussi
prégnants que les formes de la Gestalttheorie car ils sont liés à des fondamentaux anthropologiques (ex. le visage humain)
● D'autres sont plus culturels (maison avec cheminée) mais peuvent se diffuser comme tout artefact culturel.
56DUT MMI 2, Sémiotique
Pascal Vaillant
Comment l'image fait-elle sens ?
● Ce qu'il faut retenir :– L'image est iconique, mais en disant cela on n'a
pas encore dit grand chose ;
– elle produit du sens grâce aux configurations visuelles élémentaires (Gestalten) ;
– et aux types iconiques appris ;
– puis à un processus d'interprétation globale ;
– qui met en jeu un principe de spatio-sensitivité ;
● … et pour finir elle fait appel à un grand nombre d'interprétants culturels → intertextualité.
57DUT MMI 2, Sémiotique
Pascal Vaillant
Intertextualité
Un segment de texte a généralement besoin, pour être compris, d'éléments de connaissance qui ne sont pas présents en lui-même.
58DUT MMI 2, Sémiotique
Pascal Vaillant
In præsentia / in absentia
Ces éléments de connaissance peuvent venir :
in præsentia :
(1) du contexte (ce qui a été dit avant dans le texte, qui est dans notre mémoire parce qu'on l'a lu peu de temps avant) ;
in absentia :
(2) plus généralement, de livres lus, d'histoires entendues, de films vus … bref de notre culture personnelle (dans notre mémoire à plus long terme).
59DUT MMI 2, Sémiotique
Pascal Vaillant
Interprétants
On dit rarement des choses totalement nouvelles.
L'interprétation du nouveau se fait sur un fond de connaissances communes antérieures.
Ce sont les « ilôts de confiance » de l'interprétation.
Ces connaissances communes dépendent du genre de texte.
On les appelle des interprétants.
60DUT MMI 2, Sémiotique
Pascal Vaillant
Culture(s) commune(s)
Les interprétants externes peuvent faire partie :
de la culture livresque (thèmes bibliques ou mythologiques, contes, grands auteurs, culture classique ...)
de la culture de l'époque (usages courants, actualités, chansons en vogue, tics de langage, citations fréquemment reprises pendant une certaine période …)
de la culture populaire (proverbes, locutions, 成語 [chéngyǔ] ...), ou plus généralement de la doxa (idées généralement répandues)
61DUT MMI 2, Sémiotique
Pascal Vaillant
Aire culturelle
Qui dit connaissances communes partagées dit
⇒ aire culturelle
⇒ époque
On s'en rend compte lorsqu'on lit un roman étranger, où beaucoup de choses doivent être expliquées dans des notes de bas de page.
Idem lorsqu'on lit un livre écrit il y a longtemps.
Pire quand c'est les deux.
62DUT MMI 2, Sémiotique
Pascal Vaillant
Reprise et réécriture
Lorsqu'un texte récent fait référence à un texte plus ancien …
Il le reprend en partie (mention à un nom propre, citation plus ou moins complète ou plus ou moins exacte, reprise d'une histoire connue …)
Il le réécrit en partie (il « retouche » à la marge l'élément thématique qu'il reprend ; le lecteur n'en aura plus exactement la même représentation après).
63DUT MMI 2, Sémiotique
Pascal Vaillant
Intertextualité
Au sens strict, il y a intertextualité lorsqu'un texte réfère à un autre texte, en le citant, en le plagiant, en y faisant allusion :
« l'intertextualité est [...] le mouvement par lequel un texte récrit un autre texte, et l'intertexte l'ensemble des textes qu'une œuvre répercute » (Piégay-Gros, 1996).
Champ de la poétique, de la stylistique, de la critique littéraire ...
64DUT MMI 2, Sémiotique
Pascal Vaillant
Intertexte
Plus généralement, tout texte est constitué de reprises de segments plus ou moins figés.
« Le texte redistribue la langue (il est le champ de cette redistribution). L'une des voies de cette déconstruction-reconstruction est de permuter des textes, des lambeaux de textes qui ont existé ou existent autour du texte considéré, et finalement en lui : tout texte est un intertexte ; d'autres textes sont présents en lui, à des niveaux variables, sous des formes plus ou moins reconnaissables : les textes de la culture antérieure et ceux de la culture environnante ; tout texte est un tissu nouveau de citations révolues » (Barthes, 1968).
65DUT MMI 2, Sémiotique
Pascal Vaillant
Intertextualité dans la langue
⇒ Continuum allant de :
la réutilisation de lexies plus ou moins complexes (« la fin des haricots ») …
… à l'insertion intégrale de passages entiers (exercices de style : Testimony de Reznikoff, Pierre Ménard auteur du Quichotte de Borges)
66DUT MMI 2, Sémiotique
Pascal Vaillant
Intertextualité dans l'image
Le principe d'intertextualité vaut bien sûr dans d'autres systèmes de signes que la langue
La peinture par exemple s'inspire souvent de thèmes classiques (récurrents), et les peintres s'attaquent souvent à la « réinterprétation » d'une œuvre d'un prédécesseur
69DUT MMI 2, Sémiotique
Pascal Vaillant
Deux tableaux du XXe siècle(Dali : Autoportrait en Mona Lisa, 1954 ;Botero : Mona Lisa à douze ans, 1959)
70DUT MMI 2, Sémiotique
Pascal Vaillant
Deux œuvres récentes(Cieślewicz : Mona-Tsé-Toung, 1977 ;
Liberge : La Joconde, 2008)
71DUT MMI 2, Sémiotique
Pascal Vaillant
Intersémiotique
L'interprétation d'un objet sémiotique peut aussi faire appel à des interprétants qui ne sont pas passés par le même système de signes ...
citation d'une autre langue
... voire : pas par la même modalité sémiotique
un texte sert d'interprétant pour comprendre une image,
une image pour comprendre un texte
etc.
72DUT MMI 2, Sémiotique
Pascal Vaillant
Intersémiotique in absentia
Une image sert d'interprétant à un texte.
« Je me souviens de cet homme et de cette photo qui porte le symbole de la liberté. Un homme seul debout devant un char, place Tien An Men ; mais si le fusil, le char, peuvent tuer un homme, il n'est pas en leur pouvoir de lui ôter sa dignité. (…) » (revue Empan, n° 58)
73DUT MMI 2, Sémiotique
Pascal Vaillant
Une image sert d'interprétant à un texte.
« Je me souviens de cet homme et de cette photo qui porte le symbole de la liberté. Un homme seul debout devant un char, place Tien An Men ; mais si le fusil, le char, peuvent tuer un homme, il n'est pas en leur pouvoir de lui ôter sa dignité. (…) »
Intersémiotique in absentia
74DUT MMI 2, Sémiotique
Pascal Vaillant
Intersémiotique in absentia
Un texte sert d'interprétant à une image.
(Jacoppo Bassano, Le Bon Samaritain,Venise, ca. 1560)
75DUT MMI 2, Sémiotique
Pascal Vaillant
Intersémiotique in absentia
Un texte sert d'interprétant à une image.« Jésus reprit : "Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, et il tomba au milieu de brigands qui, après l'avoir dépouillé et roué de coups, s'en allèrent, le laissant à demi mort. Un prêtre vint à descendre par ce chemin-là ; il le vit et passa outre. Pareillement un lévite, survenant en ce lieu, le vit et passa outre. Mais un samaritain, qui était en voyage, arriva près de lui, le vit et fut pris de pitié. Il s'approcha, banda ses plaies, y versant de l'huile et du vin, puis le chargea sur sa propre monture, le mena à l'hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira deux deniers et les donna à l'hôtelier, en disant : "Prends soin de lui, et ce que tu auras dépensé en plus, je te le rembourserai, moi, à mon retour." (…) » (Évangile selon Saint-Luc)
76DUT MMI 2, Sémiotique
Pascal Vaillant
Intersémiotique in præsentia
La circulation de sens entre modalités se fait bien évidemment, à plus forte raison, lorsque les deux sont présents simultanément sur le support sémiotique.
Mode de fonctionnement des systèmes sémiotiques « hétérogènes » (image légendée, bande dessinée, roman photo, théâtre, cinéma … et bien sûr conversation en face à face)
77DUT MMI 2, Sémiotique
Pascal Vaillant
Unité du plan du contenu (signifié)
Y a-t-il un « signifié visuel », distinct du « signifié linguistique » ?
Non, pas sur le plan de la forme du signifié.
(univers du sens)
« les signifiants de nature sensorielle différente peuvent recouvrir un signifié identique ou, du moins, équivalent : ainsi la langue orale et la langue écrite »(Greimas, Sémantique structurale)
78DUT MMI 2, Sémiotique
Pascal Vaillant
Inégalité des modalités
Cette unité de la forme du contenu permet à plusieurs modalités de se partager le même univers de sens (le langage est capable d'exprimer des concepts visuels, par exemple)Cela n'empêche pas par ailleurs qu'il y ait des chemins d'accès privilégiés de certaines modalités sémiotiques à certaines catégories de représentations mentalesL'image est un vecteur privilégié pour les représentations à fort contenu visuel.
79DUT MMI 2, Sémiotique
Pascal Vaillant
Interprétation intermodale
Un texte d'un système de signes hétérogène fait donc coexister, dans un espace syntagmatique de niveau supérieur, plusieurs sous-textes appartenant à des modalités plus élémentaires :
Textes visuels (plastique, iconique) ;
Textes linguistiques (langue écrite) ;
Idéogrammes
80DUT MMI 2, Sémiotique
Pascal Vaillant
Types de signes visuels
Signe plastique : formes, couleurs, textures, relations géométriques entre objets …(domaine du non-figuratif)
Signe iconique : textes graphiques reconnaissables par une relation de conformité à un type visuel du référent (cours précédent)(domaine du figuratif)
(Groupe µ, Traité du Signe Visuel ;Damien et Claire Gautier, Mise en page(s), etc.)
81DUT MMI 2, Sémiotique
Pascal Vaillant
Types de signes linguistiques(ou quasi-linguistiques)
Langue écrite :
Écritures alphabétiques
Écritures syllabiques
Écritures idéographiques
Idéogrammes non-linguistiques :
Pictogrammes(idéogrammes iconiques)
Autres idéogrammes
NB. Idéogramme = signe d'écriture ayant un sens
82DUT MMI 2, Sémiotique
Pascal Vaillant
Coexistence des modalités
Dans un texte hétérogène, les différentes modalités (texte, image) s'articulent selon les règles conventionnelles dans le genre considéré
(ex. : légende bien alignée en-dessous de la figure dans les livres illustrés ; séquence de cases assez formelle dans le « comic strip », plus souple dans la B.D. pleine page ; convention de la « bulle » [phylactère] dans le monde de la B.D. ; liberté quasi-totale [mais en connaissance des règles !] dans le monde de l'affiche ...)
83DUT MMI 2, Sémiotique
Pascal Vaillant
Règles d'articulation des systèmes de signes hétérogènes
Différents systèmes de signes peuvent être emboîtés les uns dans les autres
À chaque niveau, on peut identifier un espace extérieur (espace syntagmatique) sur lequel se déploient des signes
Des signes peuvent être minimaux à un niveau mais décomposables au niveau ultérieur
L'espace intérieur du niveau n peut être l'espace extérieur du niveau n+1
85DUT MMI 2, Sémiotique
Pascal Vaillant
Décomposition des textes sémiotiques hétérogènes
Exemple de Gaston Lagaffe :
- cases dans la page- images dans les cases (iconique)- texte dans les cases, relié aux images (conventions d’interprétation : bulle avec trait plein [parole], bulle
avec trait discontinu [pensée])- idéogrammes dans les textes (dessin de cochon)- onomatopées dans les images (« cranc ! »)- conventions du genre « bande dessinée » : traits droits
pour signifier le mouvement, ondulations autour de la tête pour signifier l’agacement ...
86DUT MMI 2, Sémiotique
Pascal Vaillant
Répartition du sens
Dans un texte multimodal :
Chaque modalité est porteuse de sens ;
Les différentes modalités véhiculent un sens différent (sauf cas de « dictionnaire texte-image », type imagier ou trombinoscope) ;
Les sens des différentes modalités interagissent.
En résumé :les modalités se partagent le contenu.
87DUT MMI 2, Sémiotique
Pascal Vaillant
Répartition du sens
Exemple texte/image
- L'interprétant d'un élément de l'image peut se trouver dans le texte
- L'interprétant d'un élément de texte peut se trouver dans l'image
- L'image et le texte « se répondent » pour créer un effet de sens qui ne serait pas possible avec un seul des deux
88DUT MMI 2, Sémiotique
Pascal Vaillant
Interprétation multimodaleExemple
Dessin de Sergueï dans Le Monde du 28 septembre 1996
89DUT MMI 2, Sémiotique
Pascal Vaillant
Plan iconique
(à gauche) :
homme + casque + fusil → soldat
(au milieu) :
homme + lance-pierre → combattant
(à droite) :
personnage avec chapeau
90DUT MMI 2, Sémiotique
Pascal Vaillant
Plan des symboles conventionnels
Idéogramme « étoile de David » sur le casque du personnage de gauche (symbole d'Israël)
soldat + étoile de David → soldat israélien
Idéogrammes « étoile + rayures » (stars and stripes) sur le chapeau du personnage de gauche (drapeau américain, symbole des É.U.A.)
Symbole du vieil homme avec la barbe à la Lincoln et le chapeau à stars and stripes : Uncle Sam (symbole personnifié des É.U.A. [prosopopée])
personnage de droite → Uncle Sam = É.U.A.
91DUT MMI 2, Sémiotique
Pascal Vaillant
Plan des symboles conventionnels
Foulard à carreaux sur la tête du personnage du milieu : symbole du combattant palestinien (« keffieh »)
combattant + keffieh → combattant palestinien
92DUT MMI 2, Sémiotique
Pascal Vaillant
« Grammaire de l'image »
« Grammaire » avec des guillemets (niveau de figement plus faible que dans la langue)
Certaines relations spatiales dans le signifiant ne sont pas interprétées de façon rigoureusement iconiques
Ex. du cours : gauche = avant / droite = après ;
Autre ex. : plus gros = plus fort / plus petit = plus faible (diagramme dans la terminologie de Peirce).
93DUT MMI 2, Sémiotique
Pascal Vaillant
Interprétation des relations spatiales
Suivant cette règle, en l'occurrence :
personnage de gauche plus grand que personnage du milieu
→/soldat israélien/ plus fort que /combattant palestinien/
94DUT MMI 2, Sémiotique
Pascal Vaillant
Métaphore (sur le plan du contenu)
Le personnage de droite tient les bras du personnage du milieu
tenir les bras (+concret) → empêcher d'agir (–concret)
(métaphore située sur le plan du contenu, donc valable aussi bien si le signifiant est une image que si le signifiant est un texte linguistique …)
L'Amérique empêche le combattant palestinien d'agir.
95DUT MMI 2, Sémiotique
Pascal Vaillant
Autres éléments graphiques
Trous dans le personnage du milieu
interprétés dans le contexte comme :
/impacts de balle/
Tache sous le personnage du milieu
interprétés dans le contexte comme :
/flaque de sang/
96DUT MMI 2, Sémiotique
Pascal Vaillant
Éléments linguistiques
« Je vous retiens avant que vous ne fassiez un malheur » :
Propos prêtés au personnage incarnant les É.U.A. (convention de la « bulle »)
Formule généralement utilisée dans un contexte où le locuteur empêche un personnage (en position de force) de faire du mal à un autre personnage (en position de faiblesse)
⇒ Signification (en principe) de l'élément linguistique : l'Amérique empêche le combattant palestinien (fort) de faire du mal à l'armée israélienne (faible)
97DUT MMI 2, Sémiotique
Pascal Vaillant
Interaction entre modalités
Incohérence entre texte et image :
Le texte dit : « l'Amérique empêche le combattant palestinien (fort) de faire du mal au soldat israélien (faible) »
L'image dit : « le soldat israélien est plus fort que le combattant palestinien ; l'Amérique empêche le combattant palestinien d'agir mais n'empêche pas le soldat israélien de lui tirer dessus ».
Cette incohérence volontaire devient le support d'un message politique sur l'attitude des É.U.A.
98DUT MMI 2, Sémiotique
Pascal Vaillant
Interprétation globale
En vertu des spécialisations supposées du texte et de l'image (topos : l'image reflète la réalité, alors que le texte reflète les discours) …
… ce dessin est interprété comme portant le sens :
« Alors que (dans les faits) l'armée israélienne est plus forte que les combattants palestiniens, et commet des crimes, l'Amérique tient un discours qui ne désigne pas le danger le plus grand pour la paix, et, au contraire, le laisse agir »