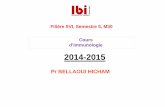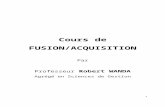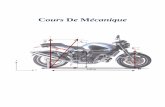Cours-de-Chimie-2.pdf - Talib24
-
Upload
khangminh22 -
Category
Documents
-
view
2 -
download
0
Transcript of Cours-de-Chimie-2.pdf - Talib24
Chimie Organique S2 SVTU
Responsables du t.2Y.!1: fil. A. BENNAMARA; A. ABOURRICHE M. BERRADA et,N. ~
A) Introduction à la cnimieorganique La chimie organique a de rombrel.lx clélx>Ld-és. La plupart des mécficaments sont issus de la ~ organique: l'industrie automobile
utilise des peintures et des vernis spéciaux, des carrosseries en plastq.Je, et surtout des élastomères, qui entrent dans la composition des pneus et de la plupart des j:>i1ts. Les sa'vOns, les détergents, de noml:reux parfums et colorants sont également à base de romposés organiques ~thétiques. Dans rroustrie du textie, les composés synthétiques ont sowent reml)a(é les produits naturels. En photographie, les films sont à base de composés
, organques synthét:ques. L'"industrie alirnentare fait a~ à des fims plastiques pour les emballages (pofy'éthylène, par exemple). La bblogie a également recous à la chimie p)ll" isoler, par er.emple, des composés qui parti:ipent à des phéromènes biobgques. Ainsi, la chimie organiqœ pennetd'expl'qœrun grand nombre de mécanismes biobgques.
1- Brefhistorique En 1ml, dans son rours de chimie, Nkolas Lémery introduisit la distirdbn entre la "chimie minérale", qui ne faisait intervenir à r époqœ
que des composés inertes, et la "chimie organque", dont les substances sont issues des animaux et des végétaux. Jusqu'au début du 19irre siède la chimie organiqœ avait IX)Ur ob~ rétude des Sl.bstarœs issues des êtres (ou organismes) vrvants (animaux et végétaux). Des composés comme le sucre, ru rée, r amaon, les cires et les hue; an males ou végétales étaient considérés comme organque, é est-à-dire que seuls les organismes vrvants IX)I.Naient les fabfGuer. Cette chimie se différerœit de la chimie màlérale (ou irorganqœ) qui avait pour ob~ l'étude des substarœs issues du morde minéral (La Terre, l'eau et ratmosphère).
Avant le début du·~ Siède a semblait iTIµ:>ssible de synthétiser (fabrqœrj au laboratoire des substarœs organiques à partir des substances minérales. Les chimistes pensaient qœ rïntervenoon d'une ''force vitale" i:ropre aux organisrnesvrvants était nécessaire à œs synthèses.
Friedrich Wëhler (18XH882) réussit en 1828 la premëre syntœse de l'urée (présente dans l'urine) et montre ainsi que !"Intervention d'une force vitale n'est pas nécessaire à cette synthèse. Cette première ~thèse organqœ a été réarlSée à partir du cyanate cf ammonium (réactifs . minéraux).
ï $ ] [ •• f . H"-·· ·t .. /H H-N-H c=N-g: ------- N-C-N
1 Chauffage / "-H H H Cyanate d'ammonium Urée
ll-Les élémentsprépondérantsdelachimieorganique
1-Les~wœso~quesnaturelles 1¾ LajJll11Jièse chlorophyllienn eJ ~ conséquences Grâce à la chbroprrylle, les végétaux sont capables, en ublisant l'énergie solaire, de transformer le carlx>ne minéral (venant du dioxyde de
c:aroone atrnosphérque) en carbone organque (dans les glucides) suivant la réaction suivante :
6 C02 (g) + 6 H 20 (1) -----
Ces gllri:les et en particurier le ~ entrent dans la formafun de molécules plus élal:x>rées telles que le saa:harose, ramidon et la œllùklse. Ces composés de base, oches en éërent caroone, entrent dans la chaîne afimentaire. Certains animaux mangent les plantes, les camM:>res rnaf'€entœsanmauxetenfin rhorrme mareede la viande. Le carooneestdorctrès présent tout au longdeœtte chaîne alimentaire.
1-b-Les ressources JON!es Olarlx>ns, pétroles et gaz naturels proviennent de la déromposioon d'organismes vrvants (végétaux et animaux) tomœs au fond des
mers.
2- Les éléments constitutifs desmolécules organiques
Les éléments coostitutifs des molécules~ 9J11t, i::er onlre de fréquence d~t :
❖ Les quatre éléments, C, H, 0, N
❖ Des non-métauxtelsqœ a, Br, 1, s, P, As, ...
❖ Des méta LO( tels qœ Na, Li, Mg Zn, Fe, C.O, Cu, Cd, Pb, Sn, ...
Prs. 8- BENNAMARA ~ 8, ABOURRICHE
1 Chimie Organique: Filière Sciences de la Vie de la Terre et de l'Univers SVTU S2
;,;
C
::
Chimie Organique S2 SVTU 2015 - 2016
Responsables du ÇQ.!!.[l : Prs. A. BENNAMARA; A, ABOURRICHE M. BERRAi:>A et ,N. fil:!Q!H!
Définition de la chimie organique :
3-Représentation des molécules 1
La ·chimie ccymqœ es. la chimie des caTIJXRS du carlme.
Le c:aroone JX)SSède une configuratbn électronque 'ls~2 et donc 4 électrons de valence sur sa rouche externe. Ceci mpfique qu'il auralaJX>5S1btlitédeformerjusqu'à46ensoovalents(liaisons)JX)Uramplétersarol.x:heextemeà8éledrons(règlederoctet).
La dlinie parti:ulière du carbone résulte de sa capacité à hybrider ses orbitales ('vOir les états d'rty'booatbn du carbone).
Les quatre raisons de ratome de caroone petNent être c:fistribuées de trois façons différentes dans respaœ (\Oir le tableau ci-dessous).
'j'', , \ ' I \ ', , \ '
I \ ' ,
, ' ' , \ ' I \ ',
,' ',,------, ,,, c--- \ :
1/~' , \ 1 , \ , ,:.• ___ ____________ ,,
.. Om:ne~: --c:=c--
On appelle c:hâine cartonée ou squelette cartx>né renchaînement des atomes de c::arl:x:>re ronstituant U1e molérule organque.
Rep-ésentation des roolérules E,œmp/e: {Ethanol)
1. Formule bruteCxI-JA Elle nous~ sur la nature et le nombre d'atomes présents dans la molécule.
2. Formule développée plane: Elle fait apparaître tous les atomes dans le rrême plan et toutes
les liaisons entre ces atomes. Les a~ entre les raisons!OOI: de ':1:1'.
3. Formule semi-développée : Elle dérive de la formule développée plane par suppresson des
liarons mettant en ~u l'hydrogère.
4. Formule de Lewis (ou représentation de Lewis) : Elle est du même type que la formuk développée plane à laquelle on a pute les doublets non liants.
S. Formule (ou représentation) topologique : La chaîne cartonée est représentée par une ligne brisée. Olaque extrémité de segment représente un atome de caroone 1Drtant autant d'atomes d'hyd~ène qu'a est nécessaire JX)llr satisfare à la règle de l'octet Les atomes autres que le c:artone !001: représentés~ les atomes d'hydrogène qu'ils portent
les bffi types dechaînES carbonéts.
H H
1 1 H-C-C-O-H
1 1 H H
H H 1 1 ..
H-c-c-o-H 1 1 ..
H H
~OH
Prs. 8, BEN NAM ARA; 8- ABOURRICHE
l Chlmie Organique : Filière Sciences de la Vie de la Terre et de l'Univers SVTU S2
Chimie Organique S2 SVTU 2015 - 2016
Responsables sty Ç.Q!ill: f.G. A- BENNAMARA ~ A, ABOURRICHE M.,_ BERRADA et _N • .K!':!QUZl
0 Remarque : La cnaîne carlxmée est dite saturée si elle ne présente que des liaisons simples C-C. Elle est d"rte insaturée si elle présente au rroins
une f0ison mutiple (double ou triple liaison).
B) Nomenclature
Dans les débuts de la dlimie organique, br.l:jue le rombre de romÇXJSés qu'elle avait recerœs était encore restreint, ceux-ci reŒ.'Vaient des roms paroculiers, rappelant souvent leur orw,e ("ment:rol'' retiré de l'essence de rnentœ ... ). Puis le nombre des romposés organques a~ntant très rapidement, il a fallu instituer une romendature systématique, c'est à dire fixer des règles assurant un la~ cnrnmun entre tous les dlimistes. Ces règles permettent d'associer à chaqœ formule dévebppée un oom qu ne ~ appartenir qu'à elle et, inversement, d'étabir sans [email protected]\é à partir d'un nom la stru:ture du CDmJX>sé qu'il désigne.
Généralement, les molécules organiques sont ronstituées d'une dlane d'atomes de carbone (dlaîne carlxmée) sur laquele viennent se fixer soit des atomes d'hydrogène soit des groupements d'autres atomes. Olacun de ces groupements permet de déterminer la forxfun organique d'une molécule. li peut y a'vOir plusieurs foncfuns JX>Ur une molécule.
Nom de Ill fonction Structure du ou groupement
Nom de la fonction Structure du du groupement
ou groupement ·o du groupement //
H H
Alcane 1 1 H-C-C-H
1 1 H H
H H
Ester R-c, .. .,,,R' R Q.
1 Amine N / .. '-...
::,- ·o: \ /
:,--Alcène C=C
~ I \ ... H H ?~ ::, :: Q.., li Alcyne u-c=c-u "' ..,
H H
Aromatique "*"
Nom de la fonction Structure du ou groupement
du groupement
H ::- ./ ....
Alcool R---'Q. ~::i... ?~ ·o: ,::, ..., ë"~ // :: .., .
Acide R-C, . . .,,,H ~ carboxylique Q.
~::.. // ~ ~ Aldéhyde R-C ~..., '\ c:, ~ H :: ..., ~ •o:
// Cétone R-C
'\ 1 R'
Ami.de R.__ /~'-c/
fi \ H H ·.Q.
Les règles de romerdature sont étabries par un organisme internaoonal, l'UIO'A (Union International de Olimie Pure et Applquée, 50\.Nent désigré par 9'.:>n terme a~is IUPAC). On utJTrse cependant aussi des noms parti::uriers, consacrés par l'usage, mais non cnnformes à la nomerdature systématique.
Principe général :
Le nom attribué à une molécule se ronstruit par la réunion, dans un ordre et sebn des règles d'éoiture stm:ement déterminées, d'éléments traduisant chacune une de ses particularités. Cette ronstructi:m s'effectue en deLD< étapes
-On établit d'abord le nom de la dlaîne carbonée qui cnnstitue la base du nom du cnmposé.
Prs. A· BENNAMARA ~ A- ABOU RRICHE
3 Chimie Organique: Filière Sciences de la Vie de la Terre et de l'Univers SVTU S2
5
Chimie Organique S2 ~ 2015 - 2016
Responsables du ,ÇQY!l : fr!. A- BENNAMARA l A- ABOURRICHE M. BERRADA et fi. KNOUZI
-On apute ensuite des préfixes et/ou des suffixes, ainsi que des inci:es m.rnéri:jLeS, roiquant la ratt.re et la posioon sur la chaîne des atomes ou groupes partx:uriers.
1-Alcanes Tenninaison -ane, formule générale : CJ-la,..2
Les ak:anes sont des hydrocarbures saturés. Les roms des 10 premiers alca'les liréaires sont donrés dans le tableau suivant l.ell'S racines révèlent le rombre d'atomes de carlxme présents dans la diaîne, excepté !X)Uf les 4 premiers qui ont reçu des roms sp§ciaux intégrés dans la romerdature SyStématique.
Nomlre Namlre
de Nom Formzie
ck Nom Fcnrrule
Catxne Bnie
Caixne Eme
1 Méthane m 6 Hexaœ CJ-114
2 E.thane Cil-~ 7 H~ C1Hi6
3 Proreœ c~ 8 Octane Ci818
4 BI.liane CJ-Iio 9 Nonaœ G,HJJ
5 Paitaœ CsH.12 10 . Décane C,oHn
Les groupes alkyles résultent de l'enMTJent d'un hydrogène à partir d'un alrane. Ils sont nommés en remplaçant la terminaison -ane
par-yie.
Comment nonvner les alcanes ramifiés?
lli1:k!f 1 Repérer et ncmmer la chaîne la plus longœ que l'on puisse ùr:xAff au sein de la molécule.
Si me molécule présente deux ou plusieLrs chaînes d'égale br@Rlr, on croisit cnmme substrat la chaûie qui p:>rte le plus grand nombre
de substituants. ------~ ..__
Exemple:
!Jig!g_!f J 4-Ethyl-3-méthylheptane
Nommertrus les grwpescrxbanés attcx:hésSl.T la pus lœguechaîneen tant que sub5tftuants akyles.
Si la chaûie du substituant est elle même ramiœe la même règle s'appl'que : on recherche d'abord la chaîne la plus br@JE! puis on nomme toutes les annexes.
Exemple:
Ei'Jig!f 1
2'
4-( 1-Méthylpropyl)octane
Numéroter les mrbones de la chaîne la plus longue en rommençant par l'extrém#:é la plus proche d'un substituant
Si deux substituants sont à égale distance des deux extrémités de la chaîne, on se base sur l'alphabet pour décider du sens de la numérot3tbn du substrat Le substituant à énoncer le premier d'après l'ordre alphabétique est mnsidéré mmme étant fixé sur le cart:one portant le plus petit chiffre.
Si~ y a plus de 2 substituants on numérote la diaîne dans le sens qui fournit le chiffre le plus petit au nNeau de la première différence entre les deux mcx:ies de numérotation possibles (j:Xirdpe de la romparaison terme à terme).
Exemple: 2 4 6
8 .
7
9
I ,
3-Ethyl-7-méthylnonane
Prs. !!,.. BENNAMARA l !!,.. ABOURRICHE
4 Chimie Organique: Filière Sciences de la Vie de la Terre et de l'Univers SVTU S2
Chimie Organique S2 SVTU 2015 - 2016
Responsables du Cours : Prs. A- BENNAMARA; A. ABOURRICHE M. BERRADA et ,!'i. KNOUZI
Eaire le ncm de /'alcane en arongeant tout c(atrrd tais les suŒtitr.x:Ints pa crck alplubétque (dnrun étant {Xéœdé, à raide d'un tiret, du numéro de l'atcrne de œrbone auquel il est attaché}, p;is en y adjdgnant le rian du substrat
Lorsqu'une molécule rontient un même substituant en plusieurs exemplaires, on fait précéder le nom de œlt.i-d par un préfixe tel que di, tri, tétra, et ainsi de suite. Les positbns d'attac:re sur la chaîne parent.ale sont indiqués sous forme d'une séquerœ qui p-écède le rom du substituant et ces chiffres sont séparés par des virgules (ces préfixes ne sont pas pris en compte dans rarra~nt alphabétque).
Exemple:
9
4, 7-Diéthyl-2,3 ,5-triméthy lnonane
Les Cydoalcanes: (hydrocarbw-es cycliques): préfixe-cydo, formule générale : CnHa, Le nom de falcaœ estprœédé du µ-éfixe cyclo.
Exemple: Cyclohexane 0 2-Alcènes
1 \ /
C=C / \
rugie 1 : Rechercher la ~ brgue chaîne qui cnnœnt la double liaison.
rugie 2 : Indiquer, à raœ d'un nombre, la loc:ar1SaOOn de la double liaison dans la chaîne principale, en commençant la numérotation par l'extrémité la plus proc:re de la double liaison.
Exemple: 2 4 6
~ 8 2
Hex-2-ène Oct-3-ène
rugle3: Les substituants et leurs JX)SÏOOnSsont aput:és sous forme de préfixes au nom de l'ak:ène.
Si la chaîne de l'ak:ène est symétrique, i faut mrnéroter ladite chaîne dans le sens qui donne au premier substituant rencnntré le plus petit. chiffre p::lSSible.
Exemple:
3-Méthyloct-4-ène
5-Bromo-6-méthylhept- l-ène Br
3-Alcynes
Il -c c-~ Des noms cnurants sont encore employés ix>ur de nombreux ak:ynes. lis cnmprennent le mot acétylène, qui est le nom courant du
plus ~tit ak:yne C2H2.
~ Les règles IUPAC de nomenclature des alcènes s'apprquent également aux akynes, étant entendu que le suffixe-ène est remplacé par -yne.
Prs. 8- BENNAMARA; 8- ABOURRICHE
5 Chimie Organique: Filière Sciences de la Vie de la Terre et de l'Univers SVTU S2
:
Chimie Organique S2 SVTU 201S - 2016
Responsables du Cours : Prs. A_. BENNAMARA ;_ A, ABOURRICHE M. BERRADA et tt. KNOUZI
Exemple:
4
--3
5-Bromo-4-méthylhex-2-yne 2-Méthylhex-3-yne
Br
~ En romerdat:ure IUPAC, un t-rydrocarbure contenant à la fois, une double et ure triple raison est appelé un alcényle. La chare est numérotée à partir de rextrémité la plus proche de l'un ou l'autre de ces groupes fordbnrels. Lorsque la raison double et la raison triple sont à des
distances égales au nweau des extrémités, on attnbue à la raison double le plus petit indœ.
Exemple:
6 5
5,7-Diméthyloct-5-én-2-yne Hept-2-én-5-yne 4- Composés benzéniques
~ Le benzère est considéré cnmme étant la molécule aromatique parentale. 01aque fois que le noyau benzénique est symbolisé par un cycle corn!X)rtant 3 doubles riaisons, on gardera à l'esprit qu'un tel cycle n'est qu'une structure parmi la paire de structures de ré9:>nanœ dont la mntributbn représente la molécule. Cest p:>urquoi le cyde benzénique est parfois dessiné sous la forme d'un hexagone régulier dans lequel est inscrit un cercle.
De nombreux clél'll.6 morosubstitués sont rommés en ajoutant simplement le nom du substituant sous forme de préfixe au mot
benzère.
~ Il y a 3 arral'€ements (X>SSlbles p:>ur les clél'll.6 disubstitués du benzène. Les substituants peLNent être adjacents, ce que l'on désigne par le préfixe 1,2- (ou errore ortho- ou o-), JX)Sioonnés en 1,3- (préfixe méta- ou m--), ou bien en 1,4- (préfixe para- ou p-). Les dits substituants sont énumérés par ordre alphabétique.
Exemple,: ~Cl
u 1,2-Dichlorobenzène
5- Halogénures d'alkyles o-Dichlorobenzène
R-X X=atomed'ltalogène(F, aBr,I)
~ A Uc, y 1,3-Dichlorobenzène
m-Dichlorobenzène
Cl
1,4-Dichlorobenzène
p-Dichlorobenzène
L'halogère est ronsidéré romme un substituant fixé au squelette de ralcare. Ces cnmp:>sés sont rommés en harmonie avec les règles qui ,; appliquent à la nomenclature des ak:anes, le substituant hak:>géné étant ronsidéré de la même manière qu'un groupe alkyle.
Exemple,:
* 1-Brornq:n:µme (Br-CH:r-CHz-Œ3)
* 2-Brorncr 1-chlcxq-entane (O--CHr-CI-ffir---Oir-Œ,-CH3)
6-Alrools R-OH aJcand
Le nom de l'alcool dérive de la chaire la plus bngue rontenant le substituant OH. Cette chaîre peut très ben re pas être la plus bngue
chaîne de la molécule. Pour k:x:aliser les p:>Sioons tout au brg de la chaire on numérote chaque atome de c:arbore en mmmerçant par l'extrémité la plus proche du groupe-OH. Ce sontdesalcanols.
Prs.,&. BENNAMARA; ,&. ABOURRICHE
6 Chimie Organique: Filière Sciences de la Vie de la Terre et de l'Univers SVTU S2
Chimie Organique S2 SVTU 2015 - 2016
Responsables du Cours : Prs. A, BENNAMARA; A. ABOURRICHE M. BERRADA et.!'!, KNOUZI
Exemples
\_ .. OH ~~~H OH r
Ethanol Hexan-1-ol Hexan-2-ol
Les nans des autres sulNibJanls qui soot fixés sur la chaîne sootajc:uiés au &Jbsbatalcanol en tant que µéfixes.
Exemples: 2-Méttrylhexan-2-ol, 2,4-0ibromooctan-3-ol, 1-0lbro-2-méthylronan-3-ol
Les alrools tyefques sont qualiœs de c,'Clœk:anols et, brsqu'lls sont substitués, sont numérotés de manière à ce que le porteur du groupe foncoonnel reçnr.ie d'offœ le N°l. ~
Exemples: 2-0ibrocycbpentan-1-<>I (ou 2-0lbrocycbpentarol), 2,3-()imétrrytycool
En tant que substitl.0nt, le grou~ OH est appelé hydroxy.
Exemples: OH 0
H
Acide 2-hydroxypentranoïque 3-Hydroxyhexanal
7-Aldéhydes et cétones
* Les roms systématxJues s'obœnnent en mnsidérant les aldéhydes amme des dérivés des alcanes, la terminaison (e) de ces derniers étant remplacée par-al. Ainsi, un alcane de.lient un alcanal.
On numérote la chaîre porteuse de substitl.0nts en attnbuant le N"l au c:aroone de rak:léhyde.
* Les cétones sont appeléés des ak:anones, la tem,inaison (e) du nom de l'ak:ane étant remplacée par-<>ne. On numérote la mare de manière à attribuer le plus petit rombre possible au c:aroone du groupement caroorf)'le, sans regarder à la présence d'autres substituants ou d'autres groupes form:mnels.
Exemples:
6
1 CHO
OH 0
.~ 5-Bromo-3-méthylhexanal 5-Hydroxyhexan-3-one
0 OH CHO
Il 1 'cHo 6~ 6
8-Addes carboxyliques 3-Hydroxy-5-oxohexanal Acide 3-forrny 1-4-méthy lhexanoïque
Comme cfautres comixres organiques, de nomlxeux acides carl:oxyliques ont reçu diver3=:5 3J1Jellations courantes que l'on retrouve frequemment dans la littérature.
Structure Nom IUPAC Nom courant Source naturelle
H--0:X)H Acide méthanoKJue Acide formique FOllllTiis
H~H Acide éthaooKjLie Acideaœrique Vinaigre
H~{XX)H Acide JIDPillOKjlle Acide propionique Prrx:luits laitiers
H~iCHJXX)H Acide butanoique Acide butyrique Beurre
H3C-(Œi)PX)H Acide p::ntandKJue Acide valérique Racine de valériane
H3C-(~CXX)H Acidehexanoique Acide caµtiKJue O:leurs de bouc
Prs. A- BENNAMARA • 8- ABOURRICHE
ï Chimie Organique: Filière Sciences de la Vie de la Terre et de l'Univers SVTU S2
,,
Chimie Organique S2 SVTU 2015 • 2016
Responsables gy ÇQY!i: fil. A- BENNAMARA ~ A. ABOURRICHE M. BER RADA et tf . .!ili.QJ8! ,,>:}:'..''
Le système IUPAC ronstruit les noms des acides carboxyliques en raputant le suffixe-oq.ie et en faisant précéder le tout par le rmt aci:le. La chaire de radde alcanoque est numérotée en asswant le n°l au carlx>re c:arlx>xyflque et en j:X)sioonnant tous les substituants tout au bi"€ de la plus grande diane c:artDnée incluant obligatoirement le groupe --coŒI.
Exemples: Br
Acide 5-bromo-2-méthylhex-3-énoïque Acide 3-bromopentanoïque Oassement des fonctions organiques: Dans le talleau d-dessous, les foncfuns sont classées par ordre de poorité décroissant de haut en
bas : ure formJn à priorité sur celles qui se trm..rvent au des.<i>us d'elle.
Fonction Pmritaire (suffixe) Non prioritaire (préfixe)
Acide carlxixyliqœ Aciœ alcaooiqœ Caiooxy(-CDif-1)
Nllrile Alcanenitrile Cy,ino-(--C==N)
Alddl)de Alcanalal F01TTiyl-(--CHO)
Cétooe Alcanooe Oxo--(=O)
Akrol Akaool Hydroxy-(-OH)
Amine Alkylamine Amro (-Nl-h-NHR,-NR.i)
Œrivé ba1ogéné - Halogéno-
Prs. 8- BENNAMARA ~ 8,. ABOURRICHE
Chimie Organique: Filière Sciences de la Vie de la Terre et de l'Un.ivers SVTU S2
Chimie Organique S2 SVTU 2015 - 2016
Responsables ID! t.Qyn: fu. A. BENNAMARA; A- ABOURRICHE M. BERRADA et N. KNOUZI
L'"ISOl11érie est la relafun qui existe entre cieux isorrères.
Des &>mères sont des rompŒ,és qui ont la même formule brute mais dont les atomes sont disposés différemment
L'"ISOl11érie de coostitutbn, appelée aussi isomérie plane ou isomérie stru:turale, correspond à une différerœ de la manière dont les atomes sont ana~ Dans cieux isomères de constitutbn, les atomes anabgœs sont cfisi:osés différemment. les su::œssions d'atomes obtem.es en suivant les liaisons sont différentes d'un isomère à l'autre.
1-Représentation des molécules o~ques La stéréoc:hinie est le domaine de la chimie qui s'ocrupe de la géométrie trrlmensoonelle des molécules.
La stéréoc:hinie est née de rexistence de stéréoisorrères, des isomères qui ne se disti~ que par une modiocaoon spatiale.
On cf~ la stéréochimie statique qui s'OCD.Jpe individuellement de rarrangement spatial des atomes dans les rnolérules et la stéréochimie dynamque qui regroupe l'étude des rnodiocationsde la géométfe des molécules au cours des réacfuns chimiques.
Pour étudier la stéréochimie des rnolérules, on utilisera, sebn les situaOOns, différentes représentations.
❖ La représentaoon proj:m.,e (représentation de Oam) est la plus utiisée pour mettre en é.loenœ les carbones asymétriques (carlx>re porteur de 4 substituants différents).
❖ La représentation de Newmam est ut:nisée poli" étud~ les équilibres ronformafurels de libre rotation autour d'une iaison carbonecarbone simple: C-C
❖ La I epréset 1tatiun de Fischer est utiisée essentiellement en oochimie pour représenter les sucres et les acides aminés.
]-a-Représenta.ion projedive
La représentaoon pro~ est la plus simple et la plus géométrque. A parti- d'un carlx>re on représente deux liaisons situées dans le plan de la figure, donc faisant entre elles un a1"'€1e de lœ", plus cieux autres riaisons II rors du plan"; l'une, située devant. est symlx>lisée par un triargle plein, l'autre, sitœe en arrière du plan de ~re, est symtorisée P3r des rayures ou point:ilés.
Exemple:
CHO
""~ Br CH3
Il faut bien roter que pour être lisible, cette formule doit être géométriquement convenable. Cest à dire que si la liaison verticale est dans le plan, les trois autres substituants sont au dessous du carbone. Si l'un de ces .substituants est dans le plan, les~ autres sont vus de l'autre coté (à gau:he ou à droite) de cet axe.
U>-Représenta.iondeNEWMANN On représente P3r un point le carbone situé vers l'observateur, donc de:.varit, et par un œrde, le carlx>re situé à ropposé de fo!Y.,ervateur,
vers rarrière. Les liaisons restantes sont alors vues selon trois segments de droite faisant entre elles un angle de 12cr.
4 ____ :~~,--ç:: ~:*:, H3 H5 H3
1-c-Représenta.ion de FISCHER (E,miJ FISCHER PrixNobd 1902)
9
On transforme la représentation de Cram classique en proj:cfun en auix.
Par convention, dans une représentation de Fismer :
~ Un traitverocal cooespond à une liaison dans le plan ou en arrière du plan de la feuille.
~ Un trait horizontal correspond à une liaison en avant du plan de la feuille.
~Très sot.Nent, la chaîne principale est dessinée vertx:alement avec le groupement de plus petit numéro en haut
Prs. (!,_. BENNAMARA; B_. ABOURRICHE
Chimie Organique: Filière Sciences de la Vie de la Terre et de l'Univers SVTU S2
..
;
"
•
Chimie Organique S2 SVTU 2015 - 2016
Resp0nsables du~: Prs. A. BENNAMARA ~ A, ABOURRICHE M . BERRADA et _N • .!iliQ!ill.
Exempe: D-alanine
Cram Fischer
On déduit le rom de fénantiomère en forctbn de la JX>sioon du substituant--OH (cas des sucres) ou du -NH2 (cas des addes aminés).
❖ Enantiomère L: le substituant est à gaucte.
❖ Enantiomère D : le substituant est à droite.
Les acides a.-arinés naturels appartiennent à la série L
2- Isomérieronfonnationnelle
2-¾ ümfonmtionsdesœmposésagdiques
Exemple!: Ethane
C.onsidérons r angle dièdre a. et examirons la murbe de r énergie JX)tenœlle de cette molécule quand a. varie de CJ' à 12cr. On ott,erve à raide de la représentaoon de Newman, deux mnfonnaoons édipsées et une mnfonnation décalée.
Sur '3fiJ' on observe trois mnformaoons décalées et trois mmonnaoons éclipsées. st c-On ~ ~ .-;--; ,'y-A~ ~
Exemple~:LeButane . G;r- . _o ~ H p-t.e:>C.-IA H3CCH3
~~/CH3 H-&.H ,kY N H ,Î:' H tup,ée ;,,
r\ 1 HC~H
1 Hfl ,1 3
j)~L~€e
:~: CH.3
H~CHa H,C$H H H H H
CH9 H H Anti I Gauche III Gauche V
oo 60° 120° 180° 240°
❖ Il existe une infinité de mnformaoons entre a.= cr et a.= '3fi1'.
❖ On passe cf une mnformation à une autre mnformation par rotaoon autour d'une liaison.
Forme Chaise Bateau
Forme Chaise
H,
1 H _,,
300° 360
On passe faolernent d'une mnforrnafun "chaise" à une autre mnformafun ""chaœ". Cela se fait plus de lCXHXX) fois par seronde à 25°C. Par mntre si l'on abaisse la température, la durée de vie d'une mnformaoon augmente sensiblement.
Prs. 8- BENNAMARA~ 8, ABOURRICHE
10 Chimie Organique: Filière Sciences de fa Vie de fa Terre et de l'Univers SVTU S2
---------------- ---- -
Chimie Organique S2 SVTU 2015 - 2016
Responsables dM Cours : f.[s. A- BENNAMARA; A- ABOURRICHE M. BERRADA et .l'j . .!lliQ!Rl
Forme Chaise
Forme Chaise
On a toupurs beaLKDUP de cfrfficultés à dessiœr un c:ycbhexane rorrect Le schéma d-rontre a1ustre comment le dessiœr à partir d\.ne grille.
,? _/ f- µ{_ "T/
,J. /
.t1 I'-.... /___. ---v';-IG H, __,)
ri r-
! 1 /',~
~ ' 1 1
2-,
~ -L
l
-~ ~ ;:- TT
./ ---- ~H
p., ~
Représentation de Newman
selon l'axe C1C1 et l'axe
C5C4
On regarde selon l'axe C1C1 et l'axe
C5C4
Si l'lnterrorrversbn entre 2 ronfonrères "chaise" est aisée, il en est tout autrement dans le cas où le ey,::le est substitué par un groupe \Ulumineux. Dans la ronformafun de gau::re ci-dessous, le groupe R est en pJSition axiale, les interacfuns diaxiales 1,3 sont importantes. La
conformation de droite est la ronformation la plus stable, le groupe Rest en pJSition équatoriale.
Pour le 0y00hexane morosubstitué, la tomie maise p;:,ur laquelle le substituant se trouve en !X)Sioon équatoriale est la pllfi stable.
Prs. ~- BENNAMARA;, 1!!-ABOURRICHE
1 J Chimie Organique: Filière Sciences de la Vie de la Terre et de l'Univers SVTU S2
•
Responsables du .to!m : fil. A, BENNAMARA; A. ABOURRICHE ~ BERRADA et N, KNOUZI
3- Isomérieœnfigurationnelle
3-a- Œira/ili etœrbone asymélrique
Chimie Organique ll svru 2015 - 2016
le mot chiral est délité du grec kheir, qui~ "main". Un objet powant e>àster sous deux formes, non supeiµJSables images l'une de l'autre, est chral (eYemple : une main, la coquille des escargots, une chaussure ... ). c.e genre d'objet n'a pas de plan de symétrie.
A réchelle moléculai'e, un comp:>sé ~ lui aussi exister sous deux structures différentes, mages rune de rautre par rapport un miroir.
Cest aux deLDC c:ITnistes du siècle dernier (1874) J. Vf#T 1-0FF et A LEBEL que ron doit cette œe. Ils prop::isèrent que les molécules étaient tridrnensonrelles et qu'elles powamt, de œ fait, se présenter sous cieux formes~ rune de rautre. A cette époque fldée était ré.wlutionnaire car on pensait que toutes les moléa.Jles étaent planes.
La molérule Aci-des!nus, dont les quatre groupes functionnels a, b, cet d sont différents, est ronstruite autour d'un centre asymétrque (o un caroone asymétrique: c:aroone ayant 4 substituants différents). Son mage (Ai par rapport à un mroir plan ne lui est pas superposable. Cette molécule est dore chirale.
La molécule A~ son image A' J!!!: rapport! un miroir
~ paires de molérules qui existent sous forme d'mages une par rapport à l'autre et qui ne sont pas superposables rorrespondent à des énantiomères.
A quoi CXll I espond le polMlir"rotatoirespédfique?
Prenons ure moléa..de chirale, mettons la en solution dans un solvant (cnrœnt:ratbn c en glmL) et introdurons cette soluoon dans une a.Ne d'épaisseur 1 (tra~ optique exprimé en dm). Faisons am.ter sur l'une des faces de œttE euve un fas::eau lumineux mooochromatque J:X)larisé plan.
~lluJe '
Un observateur placé de l'autre côté de la cuve pourra observer, à l'ade d'un anaryseur, une rotation a du plan de polarisation du faisœau lumineux.
Si la rotation optique a a lieu dans le sens des aiguilles d'une montre on dit que la substarœ est dextrogyre [on rote (d) ou(+}]. Si c'est l'inver5e dit qu'elle est~ [on note (1) ou(-)].
La substance ut lévogyre
La substance est dextrogyre
Prs. ~- BENNAMARA i ~- ABOURRICHE
12 Chimie Organique: Filière Sciences de la Vie de la Terre et de l'Univers SVTU S2
Chimie Organique S2 film.!. 2015 - 2016
Responsables du Cours : fil. A- BENNAMARA; A. ABOURRICHE Mi BERRADA et fi. !iliQ.YZl
le polNOir rotatoire spécifque se déduit de la bide BIOT:
a,= [at t°C
• I • C
Rotation optique observée
î Pouvoir rotatoire spécifique
~ Epaisseur de la Concentration
cuve en dm en g/mL
U rorresp:x,d à la rotafun optque observée pour un échantilbn de corœntratbn lg.ml placé dans ure cellule de ldm de ~r. Le pouvoir rotatoire spécifque s'exprime en deg.dm·1,g-1.mL
3-lr Règles séquentielles: Règles de Oihn, Jngold et Prelog (CLP J
cahn, lngold et Pre~ ont écrit des règles ix>ur ëlSS@1er la lettre (R) ou (S) pour détermirer une [email protected] absolue:
- (R) = rectus du latin (Droit)
-(5) = sinist:er du Latin (Gau:he)
• Les règles séquentielles (ou comment déterminer la poorité d'un atome ou d'un grou~ d'atomes).
~ Si le numéro atomique de ratome 1 directement fié au C' est supérieur au numéro atomique de ratome 2, 1 est prbritaire de.la nt 2.
C(3)
1
(2)CI /C~,, H( 4) Br(])
~ Si deux atomes identques sont attachés au stéréoœntre, on examine abrs dlacun des atomes \.Qisins sur les dlaînes.
2ème Rang . 4 4=•Rang
• • ,=r~ h 1er1e~: c, .ff /· ...._____,
1• :rer 2•m~Terme ff er I t-m
1 Th/2m 1 '--. -emJT , , ~ Y erme
: 2•nJ• Tem1e EJ -Ç-H :
1 1 1 1
• 11 • Ter111e , 1 1 1 I 1
H : 1 1 1 1 1 1cr:Terme 1 1
: H ·~· 1 1
1 °' Te 2•~• Terme
. Ç-H 2eme :Terfl)é: ~élj,• Tenne
1 / 2"'!Jerme ~
-Ç-tt : ·~· J , èn1e Ternie 1 1 I 1
1 tt' 1 1 1 1 1 1 1
Prs. ~- BENNAMARA ~ ~- ABOURRICHE
13 Chimie Organique: Filière Sciences de la Vie de la Terre et de l'Univers SVTU S2
•
..
"
Chimie Organique S2 ~ 2015 -~
Responsables du . ou : Prs. A- BENNAMARA ~ A- ABOURRICHE M. BERRADA et l'i- KNOUZI
' 1errg 1
,.L. 1 1
H H H H H H l 1 1 l • 1 1
3ème renne :fi ·~· 1 1 1 2èi~c Terme 1 1
-C-H ~!"Terme
H
H-c-c-c-c-c-c-H 1 1 1 1 1 H H H H H
H-C-H 1 H
1 1 1 1 1 1 1 1 N°2 N°1 ---11►► Cs: Relié à (C6, H, H) CiHs
N°2 ----11►- C 1 : Relié à (H, H, H~ N°4
Nol ,,,,,11 H
C3H1 CH 3 N°3
H H H H H H
1 1 1 1 . 1 1 H-C6-C5-C4-C3-C2-c1-H
(3):
1 1 1 1 1 H H H H H
H-C1-H
~ H
C7 : Relié à (H, H, H)
C 4 : Relié à (Cs, H, H)
C2 : Relié à (C1 H, H) '
.. N°3
}
On doit trancher entre (Cs et C 1)
~ Une raison double (ou tripe) rompte p:iurdeux (ou trois) iaisons simples ix>ur cnacun des atomes impliqués.
Détenninat:ioo de la~ absouedu centre asymétrique
L.esdifférentssubstitl0nts~ classés par ordre de protité décroissante sebn les règesde Cahn, l!lP~ et Prebg.
En regardant la rnolérule à r opJX>Sé du substituant ayant la priorité la plus faible (4) on détermine le sens de rotafun ix>ur passer de {l) à
~ Si le sens de rotafun estvers la droite le composé est R {rectus),
~ Si le sens de rotafun est vers la gauche le mm!X)Sé est S {sinister).
~ Si on tourœ dans le sens des aiguilles d'une montre alors la mnfigurafun absolue du C' est {R).
~Sion tourœdanslesensinversedesa~illes d'uœmontrealors la mnfguration absolueduC* est (S).
Prs. A- BENNAMARA ;_ 8- ABOURRICHE
14 .Chimie Organique: Filière Sciences de la Vie de la Terre et de l'Univers SVTU S2
Chimie Organique S2 fil[!Q 2015 - 2016
ResDOnsables du Cours : fil. A. BENNAMARA: ~- ABOURRICHE .M. BERRADA et fi. JlliQ!R!
Exemde ! : Cas d'une molérule cnmp:>rtant un seu cartone asymétrique.
Configuraœn aœolue 2ème 3ème
I'" Rang ~g
Rang • •
• 1
Q-H : /~-f{ / 1 1
-c::....... -t-o ~ ' "-• N°1 O : ù
1 1 1 1
C : Relié à (0, 0 , 0)
' ' N '/• 1 1
-è-N ,, 1 1 ' 1 : ~ 1 1
: ~ C : Rel ié à (N, N, N)
/ : -C-H . ": : li
1
Classement des différents substituants par ordre de prbrité déaoissante (sebn le N"atomique Z décroissant), le plus petit étant la référenœ. -Br > --0 > ~ > -H (réf.). En regardant la moléa.Jle à ropJX>Sé de la référence, on détermine le sens de rotaoon JX)Lir passer de -Br à ---013.
<t .. __ _
O~Q) _.,..,..OH C
NH2 <D
Alanine naturelle k-Représentotion de Frscher.
C : Relié à (H, H, H)
a~ t Br
·,& Br t Cl
Newmann Newmann CH3 = CH
2 Enan~mère~ _ .. ~ .,,,,,,,, H ~ ,,,,,,,,. <-··· .••. , - H
..A~'-' § Cl Br = Br
La représentaoon de Frscher est un mode standardisé JX)ur représenter un centre asymétrique.
Vue perspective
C E.,,,,,,,,.. ~ -.........._ B
D
~ Lignes horizontales= liens à ravant du plan.
· ~ Lignes verticales= liens à r arrière du plan.
A
1 E-1-B D
Représentation de Fischer
~- _ê.: Sem F&:her, la maîœ c:ari:x>née doit être ~rocale et le c:aroone d'indœ minimUTI doit être en haut et le c:ari:x>ne d'indœ maximum doit être en bas selon la nomenclature systématique.
Prs. A. BENNAMARA, A. ABOURRICHE
15 Chimie Oreanique: Filière Sciences de la Vie de la Terre et de l 'Univers SVTU S2
•
:
•
..
~
Responsables _gy Qll!r! : fil. A. BENNAMARA ~ A- ABOURRICHE M. BERRADA et rf. KNOUZI
Exemplet: cas d'un seul c:aroore asymétrqœ
Représentawn.de Fischer de (R)-{+)-g~raldéhyde [(RH+~2,3-dit-rytiroxypropanaij.
0~ /H C
j"o - 1 --H'"'"C -
î --..._CH 0~ - 1 2
C -H ......... ~,OH~
\ o.._H H
~2
On tourne dans ,::~~: ~~~~~:eH) -$CHO des aiguilles d'une montre, on lit ~ • OH
(S). Comme l'élément le plus petit (R) est en avant, alors on affecte (R).
Relié à (0 H Il) 3 CH20H
~ Exemple~:casd'unemoléculeprésentmtdeuxcarlxmesasyrnétrques.
• • Acide 2 ,3-dmbropentaooque: Ht:-G-½- Qi(O)- Qi(O)-cDzH
Chimie Organique S2 SVTU 2015 - 2016
.le rombre d'isorœres optiquement actifs est donné par la formule 2", avec n le nombre de carlxme asymétrique. 2n = i = 4 (2R,3R) ; (.ZS:3.5) ; (2R,3S); (2S,3R).
@cOH C02H . 2 l &
!. (2R,3R) , Ill (2R,3S)
H~/ '
[ !. (2R,3R) 1 Cl 1-1 H Cl , JV(2S,3R) {I l(2R,3R) , Il (2S,3S) I} (2S)
. Il '1 Cl Cl H [ II (2S,3S) , III (2R,3S) ] [ III (2R,3S) , IV (2S,3R) ]
(JR) (JS) [ II (2S,3S) , IV (2S,3R) ]
! C2Hs !! C2Hs Quatre couples de Deux couples
diastréoisomère d 'énantiomère
C02H l(2R,3R) ll. (2S,3S) C02H
l l Cl H H Cl (2R) (2S)
Cl H H Cl (JS) (JR)
III (2R,3S) IV (2S,3R)
lII C2Hs !Y C2H5 Relation d'énantiomérie .. ► Relation de diastréoisomérie
[ (!. ; l.D Deux composés Thréo ( III ; l'.'D Deux composés Erythro)
Prs. B_. BENNAMARA;, B_. ABOURRICHE
16 Chimie Organique: Filière Sciences de la Vie de la Terre et de l'Univers SVTU S2
Chimie Organique S2 SVTU 201S - 2016
Responsables du Cours : Prs. A- BENNAMARA L A- ABOURRICHE M. BER RADA et ,N. !iliQ.!Rl
ExempleJ: Repésentatim œ Frou à J'.llltrd'uœ œµé:allatioo i:rojective.
Pour la représentaoon de Rscher du 3-0ibrobut-2-ol on doit suivre les poûits suwants:
1 i La chaîne carbonée doit être dans le même plan.
2j La chaîne carbonée doit être roncave et constante.
4 Si la ooncavité est di~vers le haut, on la regarde d'en bas (les yeux doivent
être~ vers le carbone d'in:fœ minirn.rn sebn la rornerdature systématique).
3-Chlorobut-2-ol
HO
4 Si la concavité est di~ée vers le bas, on la regarde d'en haut {les yeux doivent être dq:és Vers le carl:x>re d'irdœ minirmrn sebn la
oornerdature systématique).
1 j Pour que la dlaîne carbonée soit plane, on fait des permutaoons paires au niveau du caroone 4 {Attenoon ! Une permuoon paire ne charge pas la ronfl5uraoon absolue au niveau du carbone asymétrique, abrs qu'une permutation mpaiœ charge la configuration).
2ème Permutation 1ère Permutation 2ème Permutation 1ère Permutation
OH
CD 2R,3S
CH3 •
Rotation autour de l'axe C2 C3 de 180°
~ Les riaîsons qui sont représentées en avant du plan de.tiennent des riaisons en arrière du plan.
~ Les liaisons qui sont représentées en arrière du plan deviennent des liaisons en avant du plan.
Exemple 3 : Représentation de Ftscher à partir d'une représent3ton tle Newmann.
HO H
/// ✓,,
3-Chlorobut-2-ol
CD
4
Quand la concavité est dirigée · vers le bas, on prend le carbone
Cl (de devant) et on le rabat vers le haut. Les substituants à droite
deviennent à gauche et les substituants à gauche deviennent à droite.
N.B. La romendatuœ (Ret.s) est îrdépendante du signe réel du poLM>îrrotatoire ~ue.
Prs. 8- BENNAMARAL 8- ABOURRICHE
17 Chimie Organique: Filière Sciences de la Vie de la Terre et de l'Univers SVTU S2
:-
..
=
Chimie Organique S2 SVT\J 2015 • 2016
Responsables du Cours : Prs. A. BENNAMARA • A. ABOURRICHE M. BERRADA et .l'f. KNOUZI
Exemde!: OH OH Acide (S)-(-)-Lactate de méthyle
Configuration absolue (S) Acide (S)-(+)-Lactique ~ Configuration absolue (S) Composé dextrogyre ,,
11111
H C-OH Composé lévogyre 3
C02H H3C
3-d- Isomérie géométrique H
Cestuœ wnérie liée àlasléréochimieœscomJxre5 dhyléniqœs.
La double liaison est dans un plan perpendiculaire au plan moyen de la molécule
Un com!X)sé éttry'lénique présente une isomérie géométrique si les cnnditions suivantes sont réunies : A* D et B * E
Deux types de con~rafun peU'v'ent se rré;enter:
~ relative (Cis / Tn:m),
~absolue~/ E).
La~ relative (as/ Tmns).
Cette nomenclature estvalal:le si lecnuple (A:;t:D) est identique du cnuple (B:;t:E).
Exemple:~ ---ot=Oi~ But-2-ène
1~ l'
~
1
~ §' c====è
'1--E!:_ ~" 2 H -----.J- 2'
Les substituants prioritaires selon la règle (C. 1. P) sont du même côté du plan moyen de la double liaison :
Le But-2-ène a une configuration relative (Cis).
La~ absolue~/ E). '
Exemple: HJ: ~~Hs-Pent-2-€ne
Pent-2-ène a une configuration absolue (Z). N.B_. : Z (Zusammen, de l'allemand : ensembles).
l'
Les substituants prioritaires selon la règle (C. 1. P) sont de part et d'autre de la double liaison :
Le But-2-ène a une configuration relative (Trans).
Pent-2-ène a une configuration absolue (f). _N. ~-: f (Entgegen, de l'allemand : opposés).
~.§.: Le rombrecl'isornèresgéométriqœsestdonné parlafonnule:
2dl. 2s dl est le nombre de double liaison
s est le nombre de simple liaison qui sépare 2 doubles liaisons_
Prs. 8- BENNAMARA i 8- ABOURRICHE
18 Chimie Ort!anique: Filièré Sciences de la Vie de la Terre et de l'Univers SVTU S2
Chimie Organique S2 SVTU 2015 - 2016
Responsables du Cours : fr!. A, BENNAMARA: A, ABOURRICHE M. BERRADA et _N. KNOUZI
Introduction
On oote deux types d'effets &:t:ronqœs, les effets irductifs qui sont rés à la JX)larisation d'ure liaison {cr), et les effets mésomères, qui
sont dus à la délocalisaoon des électrons (1t) ou n (ron partagés). Les cieux effets pewent exister ensemble dans ure même molécule. Un effet mésomère esttoupurs plus imp)rtant qu'U1 effet indlctif.
1-Effetinductif
l- Polarisation etélectronégativité
Deux atomes de même nature lës par ure liaison cnvalente se partagent équitablement leurs électrons de fiaisons {o). Cette f@ison n'est~ polarisée.
La densité électronque de la liaison est symétrque, il y a neutrarrté électrique.
H-H La molécule d'hydrogène
Exemples:
H3C-CH3
La molécule d'éthane
:c1-c1: La molécule
du chlore
Deux atomes de nature différente 6és par ure liaison cnvalente se partagent différemment leurs électrons de liaisons. L'atome le plus
électronégatif attire le doublet de la liaison. AJJ rontraire, ratome le plus électro('.X)sitif re('.X)usse le doublet de la liaison. (Cette 6aison est alors polarisée, apparition de charges partieles œ/ta (ô et6')
(AvecO< 181 < 1).
ô+ ô-
H-Ç,I: La molécule
d'acide Exemples: chlorhydrique
li- li+
H3C-MgCI
La molécule du chlorure
méthy lmagnési um
La molécule du chlorure
de méthyle
L' électronégativité sebn Pauing mesure la terdanœ qu'a un atome dans une molécule à attirer vers lui le nuage électronique.
Electronégativi relatives selon l'wlilg.
Il se crée sur les atomes des charges partielles: 6+-surratome le moinsélectroœgatif etô surratome le plusélectronégatif.
La ('.X)larisaoon cf une liaison cbnre naissarœ à un dpôle électrique caractérisé par un moment di('.X)laire :
µ=OxD
►
D
La molécule d'acide chlorhydrique
'·~• .., H-CJ·.
µ = ô x D ~ _ _ _ _ la distance entre le centre ~ " des charges positives et celui
1f des charges négatives. , , , , , o+ c5·
Moment dipolaire en Debyes
' La charge
► µ
Dans le cas et' une molécule ('.X)lyatomque, les moments dip::,laires s'additx:mnent romme des vecteurs.
Une molécule~ tMJir des fiaisons JX)lariséeset être gbœlement apolaire.
Prs. ~- BENNAMARA ~ ~- ABOURRICHE
19 Chimie Organique: Filière Sciences de la Vie de la Terre et de l'Univers SVTU S2
f
Responsables c!Y_ Cours : Prs. A- BENNAMARA. A. ABOURRICHE M. BERRADA et N- KNOUZI
Emn(ie:
Le rœthane est tre molérule cp:>laire µ = 0
-> ->
(Z)-1,2-dichloroéthene PE = 60,3° C µ= 2.95 D
-> -> µ= µ] + µI =2.95 D
.. ~:.
Fre;r,er'v,,, .: 7', · · e;f.~
/(! ~ -6 ~,, .i . e.«',fP~{i{
H
16" H-C-H
1 H
-> -> -> µ' + µ' = 0
(E)-1,2-dichloroéthene PE = 47,5° C
µ=OD
Chimie Organique S2 SVTU 2015 - 2016
Le phéromère de JX)larisafun a une grande inflœrœ sur la réactivité chimque des molécules.
Exemple: H20 ( ffi .. 0) H-CJ: ___ __,_ H
30 , :<;_I:
Rupture de la liaison
L'atome le plus électronégatif garde, en général, le doublet de la liaison ( cr).
2- Définition der effet inductif
La dis.symétrie de la répartition électroniqœ au niveau d'ure liaison peut se transmettre de proche en proche, le bng des riaisons ( cr), tout
en s'atténuant brsqœ Yon s' ébigne du centre "perturbateur" donneur ou attracteur d'électrons.
Prs. 8- BEN NAM ARA• !!!,. ABOURRICHE
20 Chimie Organique: Filière Sciences de la Vie de lu Terre et de l'Univers SVTU S2
Chimie Organique S2 SVTU 2015 • 2016
Responsables du tID.!!.! : ~- A- BENNAMARA ~ A. ABOURRICHE M. BERRADA et ,N • .!iliQlRl
Exemple: Soit un atome d'ha~ X (F, d ou Br) fixé sur une chaîne c:artonée.
1 1 1 1 1 18+ ~--c-c--C--==rC~C~C) ))) x:
16 15 14 13 12 11 ..
Ceci est possible puisque rhabgèœ est plus électronégatif que le carbone. La densité électronque sur C1 devient faire, fl se produit une attracfun des électrons de la iaison Cr-+-(2 \.€rs C1. La densité électronque surC2 devient faible à son t:ou', ce qui JX)larise la raison Cr-+---(:g et ainsi de suite.
l'ha~Xi:x>larise lesriai9:>nsX-H1,C:r-~--(2,C;r-+--½ ~ ...
Cettetransmissoode~ritéronstituereffetloou:tif(déplaœmentgénéraldesélectronsversratomelepluséectrorégatif).
N. B.: L'effet indu:tif peut atteindre 4ou 5 liaisons, au-delà il est praû:luement nul.
3- Effet irdciif (-I) Dans uœ roolécule crganiquetnutatare plus~ que le carbone exerce un effet attractif des &::tromE (-1).
Phl5 l'élément esté~ plus l'effet(-/) est irrµx1ant
\1;+ ?: Exemple : -c---,... X: E(-1) X= F >Cl> Br> l / ..
4-Effet inductif ( +I)
Un éëment plus électropositif (plus éedroJ:x)sitif = rroins électronégatif) que le rarlx>ne exerce un effet répulsif des électrons E {+I}.
1 1 1 1 1 1 s- s+/ Exemple: -C--C--C---,,-'-C~C~C > > > > Al E(+I)
16 15 14 13 12 11 \
N. R: Plus r élément est électropositif plus r effet inductif positif E (+I) est important
l'effet inductif {+I} est d'autant plus marqué que le radical est plus gros. (l'effet indtd:if est adclitffl.
Exemple: H3C~ ÎH3
H3C-rCH2.....,_ /'CH---r H3C---T""1~ H3C CH3
Ethyle lsopropyle t-Butyle
Prs. A. BENNAMARA ~ A. ABOURRICHE
21 Chimie Organique: Filière Sciences de la Vie de la Terre et de l'Univers SVTU S2
;
.,
Chimie Organique S2 filŒY 2015 - 2016
Responsables ID! Cours : fa. A- BENNAMARA ;_ A- ABOURRICHE M. BERRADA et f!. KNOU Z 1
5-Conséquenœs de f effetinductif
Cassement de qœlques groupements sebn leur effet irductif:
E (+/) croissant I -H
\ E (-/) croissant
-X
F>Cl>Br>I
L'ataned'hycrogène esta:nsidéréo:mne la référ81œdes effets rductifs.
Injluenœ de l'effet indu:Jif sur la forœ des acides:
- .e O-H H :C): ; ·· / Keq /
R-C + ~-
0 G,.p·
=O: -=::;:;;;::=-- R-C + \ ~ .
H e -~ ·
-NH -OR -SR
Métal
-H
Keq IRC00][H30] Ka=Keq[H20] = [RCOoj(H.30]
- [ RC0O ~ pKa = - Log Ka
[RC00}1 [H20]
Deux.Œt$~~ µé:artei ; 5-a- INTeJ :..A.~(-:.i..ll
Lfl.l• "...-..Y' '1/ ~ Casoù (R-)estdonneurd'électronspareffetinductif(+I).
·~/ , U< do,s;té électroa;q"' ,u ,;,ea,;, 1 • h étéco,tomea,gmoate. / /
La rupture de la liaison (H-O) est difficile ⇒ pKa => Jl<a⇒ 1'ac1did1 té ⇒ la basicité ⇒ pKb ⇒ Kb
\ \ \ 5-b-F!fet induciif (-1)
~ Casoù (R-) est attracteur d'électrons par effet indld:if(--1)_
'~/ · .,, L• deo,;té électroa;q"' au n;,ea, de l'hétécoatome d;m;""'·
?" l' ·d ·d · , / 1 b .. ' Kb/ Kb La rupture de la liai son (H-0) est facile ⇒ pK\⇒ Ka= ac1 1 1te ⇒ a as1c1te\⇒ p ⇒ \
N. B. : Un acide est d'autant plus fort que sa base ronjl€l,lée est plus stable.
Exemple~: Plu<; le sul:situantestélectronégptif plus l'acide est fat
Prs. 8- BENNAMARA ;_ A... - ABOURRICHE
22 Chimie Organique: Filière Sciences de la Vie de la Terre et de l'Un L"-..,ers SVTU S2
Chimie Organique S2 SVTU 2015 - 2016
Resp0nsab+es du hQY!t : fil. A. BENNAMARA: A- ABOURRICHE M. BERRADA et ,N. KNOUZI
y-
EN
pKa
Il-C.O~n-Résonanœ-Aromatiàté
1-C.Onjugaison - résonanœ 1-a- Conjugaison
-F -Cl
2,66 2,96
3,17 2,90
L'éaiture de Levvis im!X)Se ure p::>sition aux électrons. Dans œrt:ains cas, il est pJ$ible d' éoire plusieurs stn.rtures de Lewis JX>Ur la même molécule:
On passe d'ure formule à une autre par simple déplacement d'électrons 7t ou n (doublet litre ou ron liant ou ron partagé) sans dlar@er la di.sposioon spatiale des atomes.
-Br -1
3,16 3,98
2,87 2,59
(·o: //
00
(\. . . e
0: œ//
-N '\,9 :g:
1,68 1
.. e ·o· ;--~ o~
~ -. O ·
0 /,- -
0 ', \.. -
0
0 /.-.
0 ', .
\ "· 0
O)aque représentatbn est une struc:tue de résonance ou une funne mésol I à e. La molécule réelle est appelée hybride de résonance.
Le déplacement des électrons se fait sebn un recowrernent des orbitales atomiques. C.e recDt.Met'Tient ne peut se faire que si ces orbitales sont parallèles les ures aux autres dorx: si la molécule est plane :
Exemple: i.e lx!ta-2,3-<lièœ ~ 2-
.. .. 1 1
1-b-Roonanœ (Mésomérie) LeBem}ne
H H
7=<" H H
H H H H
~H
H
H
H H
.. . H Les quatre orbitales p peuvent se recouvrir;
H
il y a conjugaison et il est possible d'écrire des formes mésomères ou formes limites.
Le chef de fil des CDmposés aromatques n'est autre que le benzère. Il possède bien 4n+2 électrons 7t avec n=l et de plus tous ses électrons 7t sont bien dans un rnêrre plart Pour repœsenter le ~ène il existe plusieurs rotaoons. La première est la rotation de Kékulé, œtte notation permet de représenter les électrons 7t à l'aide de doubles liaisons. Il existe donc deux formes tautomères JX>Ur le benzène de Kékulé, tout
dépem de la JX)sition des insaturations. Une autre rotation consiste à représenter les électrons 7t à l'aide d'un 'œrde', œ qui met peut-être mieux en éviderœ le fait que les électrons nsont dék:x:arrsés surtous les cartones.
0-0=0 O -⇒~
Prs. A, BENNAMARA ;_ A· ABOURRICHE
23 Chimie Organique: Filière Sciences de la Vie de la Terre et de l'U11ivers SVTU S2
:;-
.. ---·---------------·· - -~---------
Chimie Organique S2 SVTU 201S - 2016
Responsables gy ~ : Prs. A- BENNAMARA: A- ABOURRICHE M. BERRADA et fi. JlliQ!Rl
1-c-Effet mésorœ.re
Le déplaœment des doublets d'électrons de liaison {7Q ou des doublets non liants crée au sein de la moléruledes sites riches ou pal.M'ES en électrons. C est r effet rné9:>mère
On [email protected] deux~ cf effet mésomères : r effet méson1ère donneur E (+1'11) et r effet mésomère attracteur E (~.
1-0-J-Groupements œnneurs (effetnmnère-tMJ
Les groupements saturés p:Jssédant un ooublet libre sontgénéralementdesclomelrs.
Le groupe A a un effetmésomèredonneur E (+1'11).
fc;a_- _Ce_n,.·- . f'.A. lilllllllll Le groupe Aa un effet rnésomère oonœur E(+M).
-H
·o· H .. ~- .. /
-X: -é/ -N
.. "·· " O-R R
L'atome d'hydrogène est la référence de l'effet.
Exemple!:
Oncbitéairelesformes fmitesà partir de rêlémentresp:Jl1Sclble de reffet E(+M)
E (+M) croissant
-o .. "
R
··Q (f) (f) tt,c--:~€':--:>-~::--)--~~e H H H H H H
Exemple~:
I
E(+M) et E(-1) ~ Forme limite 3 formes limites
3 formes limites
L'effet mésomère l'emporte sur l'effet inductif.
Plus r élément donneur est électronégatif plus la tendance à donner le doublet diminue plus r effet mésomère (+M) diminue ( un élément très éledronégatif attire les électrons par ronséquent il les donne plus diffcilement).
1-c-2-Groupements acœpteurs (effet attrocœur-M)
Les groupements aa::epteur.; fX)ssèclentgéné@lement des insaturatiJns.
\ E (-M) croissant -- ni
-c . ~)
O·
Le gra.ipe acétyle atm. effet IJm1lère attn:cœur E (-M).
(f) ;o: ,;o: ;o: -N -S -C
·o: // -c NC-
"' "9 " . . " . . .0. O-R _9-R "' :N-R I
H ,;o: -c
"' R
-H
L'atome d'hydrogène est la référence de l'effet.
Prs. B_. BENNAMARA i. B_. ABOURRICHE
24 Chimie Organique: Filière Sciences de la Vie de la Terre et de l'Univers SVTU S2
Chimie Organique S2 SVTU 2015 - 2016
Responsables mi_ t2YG : ~- A- BENNAMARA l A- ABOURRICHE M. BERRADA et fi. KNOUZI
Exemde: E(-M)
~ __ __,.,_ H3C~CH2 H3C Il, CHz 4 1 ,.__,,
-.o) \>0 t ✓,::;; e ~
H3c~CH2 ... ,. ___ .... .,_ H3C I;::?" eVCH2
·.9.:e ·.f!.:e 4 formes limites
lnjluen:edef effet mésomèresurf adcitéœsalaxisetœsphénols
Exemde!:
es~t plus donneu: d'électrons que le radical éthyle ( C2H 5---j donc l'acidité d_e l'éthanol est supérieure à l'acidité du cyclohexanol
,
f.Œ. 8.- BENNAMARA i 8_. ABOURRICHE
25 Chimie Orga11ique: Filière Sciences de la Vie de La Terre et de L'Univers SVTU S2
Chimie Organique S2 ~ 2015 • 2016
1- lntroduction Aput:er ou retrarcher une entité d'ure rrolécule est u,e réacfun chimique. Aputer ou retrard'er ure entité chimique cf une moléa.de
re peut se faire qu'à travers un rœcanisme.
Définition : Un mécanisme I éadion,,el est la façon dont se déroule une réacoon.11 rous rensegne sur:
~ Les i"ltermédiai"es de la réacfun.
~ Les étapes de la réacoon.
· 1-Rupture des liaisons et intermédiaires réactionnels
La rupture d'ure liaison ~ se faire de deux manières différentes:
1-a-Soit une rupture mT10tttique (romogène).
1-b-Soiture rupturehé~ue (hété~ène).
1 -0-Coupure homolytique: Formation des radicaux libres
x+v ----x + y
:ë1 _I:_ ci : ----. . . J .. :Cl· + ·CI :---11►► 2 -Cl:
Ces réactions sont initiées par du rayonnement Ultra VIOiet (l.N).
Les radicaux libres peLNent se wrnbiner à leurt:oU" JX)Urfonner ure fiaison:
X-Y x· + Y ~ Un radical est staolisé par un encombrement stérique ou par dékx:alisatbn de r électron ron apparé. (R1, R2 et ~ sont des donneurs
d'électrons). (Ri, R2, R3) Sont des donneurs d'e·
RI"~ l~H R2
Stabilité diminue
~ Un radical est déstabilisé par un encombrement stérique. (R1, Ri et~ sont des attractem d'électrons).
(Ri, R2, R3) Sont des attracteurs d'e·
RII'~ l~H R2
RII'~ l~H H H'!I H H
1-b-OJUpure hétérolJmque: Formation des ions Stabilité augmente
Anion Cation
8+ 8" ~ A _.l:_ B -----1►
I l: \ Electrophile Nucléophile
Nudéophile: [..A:]' c'est une entité margée négativement ou bien riche en électrons.
T ··e B
\ Nucléa(~
Prs. A_. BENNAMARA ~ A_. ABOURRICHE
26 Chimie Organique: Filière Sciences de la Vie de la Terre et de l'Univers SVTU S2
.---··
Chimie Organique S2 SVTU 2015 - 2016
Responsables du ÇQyrs : fn. A. BENNAMARA ~ A. ABOURRICHE J'!1. BERRADA et f'!. KNOUZI
Exemple: H R'
I I · o· ·o· . ,· . ,·
H 0 H H-O:
R' I
·o· . \ 0 R
R-O: e
: x:
R' R' / I
·s· R-N·. • \ \ R'
R 0 R" / N=C: R-c. 8
\ Eleçtrg::,hile : [ 8J é est une entité margée p:>Sitivement ou 001 pawre en électrons. R''
Eleçtrofuge : c'est une entité qui part chargée p:>Sitivement ou bien pat.Me en éectron.
Cation : c'est une entité chargée réellemert j:)C)SiTh,e.
Anion: c'est une entité chargée réellerœnt ~ -
1-b-1-Les auvocations
H
e
;;° R-C
\ .. e o: ..
Dans plusieurs formes~ rentité ~ apparaît. Cest un "caixx:ation" en général "non isolable". n intervient dans plusieurs mécanismes réacoonnels. Dans lXl c:arlxx:ation le carbone est isoélectrique du Bore (3 e 1 ~i est hybridé Sfl_
Un cartxx.ation est dore Sp2 et donc plan. li JX)SSède une lacune électronique, é est un électrophile.
Les cartxx.ations petNent être obtenus sebn les schémas suivants :
R1 ~ Œ) H Schéma~: ~-( _f~~ " 0 ,,,,,,,Rl
~ Ri"''''' R2 ~ ~
R2
.. e + :X:
~ Un c:artocaoon eststabiisé par un ercombrement stérique ou par débcalisaoon de r électron non apparié. (R1, Rz et Ra sont des donneurs d'électrons).
Exemple 1 : carlxx:atiœ stabili9é µn-eflèt indoctif dameur [ E ( +J) ].
Exemple 2 : cartxx:ation stabifisé pardéloc:alisafun des électrons ron appariés [n]. e
: ë~------~ExempleJ: cartxx.aoon stabiflSé pareffetrnésomèredonneur [E(+M)].
H 0,., (t)
,, H r -"
Stabilité diminue
Stabilité diminue
~ Un c:arbocation est déstabilisé par un ercombrement stérique. (R1, Rz et Ra sont des attracteurs d'électrons).
Carbocation allylique
Prs. A. BENNAMARA; A. ABOURRICHE
2 7 Chimie Organique: Filière Sciences de la Vie de la Terre et de l'Univers SVTU S2
..
Chimie Organique S2 SVTU 2015 - 2016
Responsables QJl ~ : f,G. A,. BENNAMARA .. A. ABOURRICHE M. BERRADA et N. K.rfQYII
(Ri, R2, R3) Sont des attracteurs d'e·
Exemple : Cart:xxaoon déstabilisé par effet irductif attracteur [ E (-1)].
H 0,.G;) )-H
H Stabilité augmente
..
f Cl: E(-1) •• EB
C II';"'
H
1-b-lr Lesœrbanions :ç:_1: E(-1)
Cest une entité de type :C 8 . Le c:art:x:>ne ~ s éectrons.
Il est isoélectrique de razote dans N~.
li est t?,,bridé Sp3 (forme i,vramdale).
Stabilité augmente
R~R,
R2
Les carl:mioos r,e,..rventêtre ol:mlus ~Ion le s:nélna ruivant: Carbanion L'ammoniac Structure pyramidale
Exemple:
H
. cl_--.........~ ~-c, ,,,,,.c--
:$' '-... ~,,, ~ Carbanion Trichlorométhane (Chlorofome)
5+ ~ H '- e EB
C1 : OH Na 5· ___ __ ·•-.c, · c1-- ,,• ...._ ..
· .. ··~ Cl: :Cl ··
Carbanion
~ Un carbanbnest déstabilisé par un ermml::rementstértjœ [E (+I)].
Stabilité augmente
Exemple: Carbanon déstabilisé par effet inductif donneur [ f ( +I)].
~ rn•ire: 'CH3
~CH3
CH3
e H C n•ire
CH 3 CH 3
Sta.bilité augmente
~ Un carbanbn est stabilisé par un encombrement stérique. (Ri, R.z et ~ sont des attracteurs cf électrons) [ E (-1)].
(Ri, R2, R 3) Sont des attracteurs d'e·
R t !/_,,,, ~ Ri ~",,, ~ rR3rH R2 R2
H 0,. e /"-H
Stabilité diminue
Prs. (!,.. BENNAMARA, (!,.. ABOURRICHE
28 Chimie Organique: Filière Sciences de la Vie de la Terre et de l'Univers SVTU S2
.-
- ---- - - - ·--·-------- ···••·•------- - - ·· • · ·· .. · - .
Chimie Organique S2 SVTU 2015 • 2016
Responsables gy ÇQyrs: fr_s. A- BENNAMARA< A- ABOURRICHE M. BERRADA et N, KNOUZI
Exemple : Carœnbn est stabilisé par effet irductif a~ [ E (-l)] .
.. . Cl: E(-I)
C IIPir~ '--;--;. -, ./
~ë-1:
:c1: E(-1)
Cl: E(-1)
~~ ~ 11••~
:ci: E(-I) E(-J)""
Stabilité diminue
:..
Prs. A. BENNAMARA; A- ABOURRICHE
29 Chimie Orga11ique: Filière Sciences de la Vie de la Terre et del ' Univers S VTU S2
.)
Responsables ID! Cours : Prs. A- BENNAMARA ~ A- ABOURRICHE M. BERRADA et !'j. ~
SOMMAIRE
Chapitre 1 Introduction et Nomenclature A) Introduction à la chimie organique 1- Bref historique Il- Les éléments prépondérants de la chimie organique 1- Les ressources organiques naturelles 1-a~ La synthèse chlorophyllienne et ses conséquences 1-b- Les ressources fossiles. 2- Les éléments constitutifs des molécules organiques 3- Représentation des molécules B) Nomenclature 1- Alcanes Terminaison -ane, formule générale : CnH2n+2
Les Cycloalcanes: (hydrocarbures cycliques): préfixe -cyclo, formule générale : CnH2n 2-Alcènes 3-Alcynes 4- Composés benzéniques 5- Halogénures d'alkyles 6-Alcools 7- Aldéhydes et cétones 8- Acides carboxyliques Chap.itre 2 Stéréochimie 1- Représentation des molécules organiques 1-a- Représentation projective 1-b- Représentation de NEWMANN 1-c~ Représentation de FISCHER 2- Isomérie conformationnelle 2-a- Conformations des composés acycliques 2-b- Conformations du cyclohexane 3- Isomérie configurationnelle 3-a- Chiralité et carbone asymétrique 3-b- Règles séquentielles: Règles de Cahn, lngold et Prelog {C.I.P.) 3-c- Représentation de Fischer: 3-d- Isomérie géométrique Chapitre 3 Les Effets Electroniques Introduction 1- Effet inductif 1- Polarisation et électronégativité 2- Définition de l'effet inductif 3- Effet inductif (-1) 4- Effet inductif (+1) 5- Conséquences-de l'effet inductif 5-a- Effet inductif(+/) 5-b- Effet inductif(-/) Il- Conjugaison - Résonance - Aromaticité 1- Conjugaison - résonance 1-a- Conjugaison 1-b- Résonance (Mésomérie) 1-c- Effet mésomère Chapitre 4 les Mécanismes Réactionnels 1- Introduction 1-Rupture des liaisons et intermédiaires réactionnels 1-a- Coupure homolytique : Formation des radicaux libres 1-b- Coupure hétérolytique : Formation des ions 1-b-1- Les carbocations 1-b-2- Les carbanions
Chimie Organique 52 SVTU 2015 - 2016
Prs. 8- BENNAMARA ~ 8- ABOURRICHE
30 Chimie Organique: Filière Scie11c~sde La Vie de la Terre et de l 'Univers SVTU S2