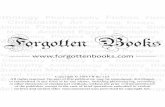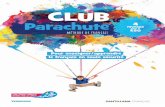Rythme prosodique et contact des langues dans le français ontarien
Transcript of Rythme prosodique et contact des langues dans le français ontarien
SANKOFF Gillian et Suzanne Evans WAGNER (2006). «Age Grading ln RetrogradeMo;ement: The lnflecled Future in Montréal French", Selected PapersfromNWAV34: Penn Working Papers in Lingllistics, vol. 12, n' 2, p. 1-14. [MichaelL. FRIESNER el Maya RAVfNDRANATH (dir.)]
THlBAULT Pierrette (2008).« How local is local French in Quebec?", dans MiriamMEYERHOFF et Naomi NAGY (dir.), Social Lives in Language: SoclOllI1-.gllistics alld Mliiti/ingliai Speech Comlllllllities. Celebrating the Work ofGillian SankojJ, Amsterdam/Philadelphie, John BenJamms, p. 195-219. .
THIBAULT, Pierrette et Diane VINCENT (1990). Un corplls de.Iançals p~r1e,
Québec, Centre interdisciplinaire de recherches sur les actlvltes langagleres,Université Laval, coll. « Recherches sociolinguistiques", 145 p.
WAGNER, Suzanne Evans et Gillian SANKOFF (sous presse 20 II). «Age Gradingin the Montréal French Inflecled Future. Under Review», Language Varlanonalld Change, vol. 23, nO 3.
ZIMMER, Dagmar (1994).« "Ça va tu marcher, ça marchera tu pas, je lesais p~':
(71 : 15). Le futur simple el le futur périphrastique dans le françaIs parle aMontréal ", Langlles et/ingllisliqlle, n' 20, p. 213-226.
354
RYTHME PROSODIQUE ET CONTACTDES LANGUES DANS LE FRANÇAIS ONTARIEN
Jeff Tennant, University of Western Ontario
1. INTRODUCTION
L es lecteurs des articles rélmis dans ce volume n'auront pas de difficultéà constater que la morphosyntaxe ct le lexique du français ontarien ont
fait l'objet d'une analyse importante du point dc vue de la variation sociolinguistique, grâce notamment aux études menées par Mougeon et ses collaborateurs (Mougeon et Beniak 1991 ; Mougeon et Nadasdi 1998, el biend'aulres). Quant aux travaux portant Sur la phonétique et la phonologiesegmentales de cette variété, ils sonl moins nombreux, mais Join d'êtrenégligeables (p. ex. Thomas 1986 ; Léon et Cichocki 1988; Tcnnant 1996 ;Poiré, Kelly el Williams 2006). Cependanl, nous notons une lacune considérable dans la littérature en ce qui concerne les caractéristiques prosodiquesde celte variété. En effet, bien que nOus puissions recenser des travaux portanl sur la variabilité intonative (Cichocki et Lepetit 1986 ; Tennant 2000 ;Tremblay 2007), à J'exception de l'étude de Robinson (1968) qui exploiteun corpus d'émissions radiophoniques du sud de l'Ontario, à notre connais-
355
sance il n'existe aucune étude publiée portant sur le rythme du français parléen Ontario.
Nous nous proposons donc de combler en partie cette lacune en présentantles résultats d'une étude initiale sur le rythme prosodique du françaisontaricn. L'objectif de ces recherches est d'arriver à une description de lavariation dans le rythme de cette variété, en prenant eil considération le statutlocal minoritaire ou majoritaire de la langue, ainsi que le niveau dc contactavec l'anglais dans le répertoire linguistique et la pratique communicativedes locuteurs individuels. .
Le français ontarien est généralement considéré comme une variété defrançais laurentien et, par conséquent, nous nous attendrions à ce qu'il partagedes caractéristiques prosodiques avec le français québécois dont il est issu.Cependant, nous pourrions également penser que le français ontarien, étantdonné son statut minoritaire en contact avec l'anglais presque partout dansla province, montrcra des différences par rapport à la prosodie du françaisquébécois, différences potentiellement attribuées à l'influence des patronsprosodiques de l'anglais. En effet, Cichocki et Lepetit (1986), Tennant (2000)et Tremblay (2007) suggèrcnt que c'est le cas pour l'intonation. Nous nousproposons, dans cette étudc, de déterminer s'il cn est de même pour le rythme.
Un autre objectifde cette recherche cstd'évaluer différentcs approches,pour l'étude du rythme cn français, et notammcnt dc déterminer l'utilité dcsindiccs rythmiques conçus a~ cours de la demière ~écennic pour la cOI~pa
raison des variétés de françats. Le mieux connu, 1 Indice de vanabllIte parpaire (Pairl'l'ise Variabilily Index) ou indice PVl (Low 1998 ; Law, Grabe etNolan 2000 ; Grabe et Low 2002) est proposé pour situer les langues et lesdialectes sur un continuum entre les pôles de rythmicité syllabique et derythmicité accentuelle, à partir des mesures des durées de se~nents et d~syllabes. Le français a été classé d'abord comm.e une langue a rythmlc.ltesyllabique, montrant peu de variation de durée entre les syllabes maccentueescontiguës, mais un certain nombre de chercheurs, comme Wcnk et Wloland(1983), di Cristo (1999) et Astésano (2001), ont contesté ce classement.L'anglais, par contre, est généralement placé dans la catégone des languesà rythmicité accentuelle, en raison du contrastc entre la durée des syllabesportant l'accent lexical et celle des syllabes inaccentuées réduites. En parlantde la présomption que la dichotomie entre rythme syllabique et rythmeaccentuel aurait une certaine validité, et que les patrons prosodIques pourraient être « empruntés », nous pouvons avancer l'hypothèse que, dans unesituation dc contact linguistique intense tclle celle du français avec l'anglais
356
en Ontario,lcs valeurs de l'indice PVI seront intermédiaircs entre celles pourl'anglais et celles pour les variétés de français étrangères à une telle situationde contact. En effet, le français ontarien présente un tcrrain idéal pour testerune telle hypothèse, et pour évaluer en même temps l'utilité et la pertinencede ce type d'analyse pour la description du rythme prosodique des variélésde français, en particulier les variétés cn contact.
Comme Thomas et Carter (2006 : 332) le font rcmarquer, la prosodieest unc dimension qui a souvent été négligée en sociolinguiSlique :
(u.] we argue that the hegemony of a finite set of morphosyntaclic and phonological features, along with the concomÎtant marginalization of non-segmentai features, severely scales down the descriptive power ofsociolinguistics and, correspondingly, distorls our overall understanding oflanguage variation.
Cette étude constitue une réponse à "appel de ces auteurs à plus d'études sociophonétiqucs sur les faits prosodiques.
2. RECHERCHES ANTiORIEURES
2.1 Classes rythmiques
Lc classement dcs langues cn fonclion de leur paIron rythmique générai, notion attribuée à Pike (1945) el développée par Abercrombie (1967),est bien connu. Selon la dichotomie traditionnelle décritc dans la citationci-dessous, les langues comme le français cl l'espagnol sonl classécs commesyllabiques, puisque nous Irouvons une régularité dans la durée des intervalles entre les syllabes, landis que j'anglais et l'allemand sont considérés commedes langues accentuelles, en raison d'une distribution régulière des intervalles entre les accents dans l'énoncé:
1Which is the 1train for 1Crewe, 1please.
We can see that which is separated from Ir~jn by two unstressed syllables,train from CrelVe by one, and Crewe from please by none; yet Ihe intervalof time separaling them is Ihe same in each case. The raie ofsyllable succession has thus ta be coolinually adjusled, in order 10 fit varying numbers ofsyllables ioto the same time-imerval. In olher words. there is considerablevariation in syllable-Iength in a language spoken with.a stress-limed rhythm,whereas in a language spoken wilh a syllable-limed rhythm the syllables lendID be eqllal in length.
357
On lhe other hand in French, a language with a syllable-timed rhythm, lheconslant rate ofsyllable-succession means that stresses separated by differentnumbers of unstressed syllables will be separaled by different intervals oflime [...] (Abercrombie 1967 : 98).
Abercrombie ajoute une troisième catégorie, la rythmicité moraïque(mora-timed), pour représcnter le patron rythmique distinctif du japonais.Nous savons bien aussi que cette catégorisation des langues d'après l'isocbronie des syllabes ou des accents n'est pas universellement acceptée, etque plusieurs chercheurs l'ont contestée, dont Dauer (1983) et Nolan et Asu(2009).
Wenk et Wioland (1983) mettent en question la catégorisation dufrançais comme langue à rythmicité syllabique, et ils proposent le terme«Irailer-litned» pour son patron rythmique, en raison du statut de la syllabefinale du groupe rythmique.
Clearly, French is nol « syllable timed ». Far from being turned out withmachine gun equality, French syllables are produced and perceived in rhylhmie groups,just as lhose ofEnglish or, doubtless, lhose ofany other language.However, what serves to eSlablish rhylhmic groups in French is a lengtheningof what is perceived as the final syllable in each group, whose vowel is generally unmarked by any intensity increment. For this renson, and because of anumber of related effects, il is proposed 10 characlerize French as beingtrailer-timed (Wenk el Wioland 1983 : 214).
En effet, il est difficile de caractériser le rythme du français sans tenircompte du statut de la dernière syllabe du groupe rythmique (GR). Léon(1992: 1.11) rejoint les autres phonéticiens et phonologues en caractérisantle groupe rythmique du français de référence comme une séquence de syllabes inaccentuées d'une durée plus ou moins égale, suivie d'une syllabeaccentuée à durée double, par rapport à la syllabe inaccentuée. Bien évidemment, cette description du patron rythmique de base du« français standard»laisse de côté des phénomènes comme l'accentuation initiale de groupe (àfonction d'accent d'insistance, entre autres) ct, quand nous considérons lavariation régionale, nous constatons que ce ne sont pas loutes les variétés,ni même toutes les variétés hexagonales, qui se conforment à ce patron. Lestableaux 1el2 illustrent le phénomène pour les groupes rythmiques de qualresyllabes, le premier tableau donnant les durées moyennes en centièmes deseconde ct le deuxième représentant les durées comme un pourcentage de ladurée de la syllabe finale du groupe rythmique. Pour le français européenstandard, nous voyons que les syllabes inaccentuées qui précèdent la finalesont d'une durée plus ou moins égale, et que la durée de la dernière syllabe
358
aeee~tuée est au moins le double de celle d'une syllabe inaccentuée. Danslesresultats que Robmson (1968) a obtenus avec un corpus dc locutcursréSIdant dans le Sud-Ouest de l'Ontario enregistrés pendant une émissionradtOphoDJque et qui pariaient une variété plutôt standardisée de françaiscanadIen, nous remarquons que la différence de durée entre la pénultième etI~ finale est moins' imp~rtante. Nous observons que, dans les variétés aeadlen,nes d7la N?uvelle-Ecosse et de 1'Î1e-du-Prince-Édouard, la longueur dela penultIeme s approche de celle de la syllabe finale. Lcs résultats obtenuspar Tennanl et Kmg (2007) suggèrent que le patron rythmique du françaisde Terre-Neuve et celut de la vanété ontarienne étudiée par Robinson seressemblent.
TABLEAU 1Durées syllab.iques (en centièmes de seconde) dans les groupes
rythmIques à 4 syllabes de 6 variétés de français
4'positIon 3'posltion pénuJtlème fina.français standard (léon 1992: llll 13,1 14,5 16,3 25,7français méridional (léon 1992: lll) 17,4 13,9 19,7 18,4français ontarien (Robinson 1968: 166) 12,7 14,9 15,0 20,3français a,adien NE (Ci'ho,ki 1997 :66) 16,1 17,4 20,7 22,7français acadien IPE (Tennant et Kin9 2(07) 13,2 14,0 17.1 21,5français a,adien TN (Tennant et King 2(07) 14,9 16,7 17,7 24,2
TABLEAU 2Durées syllabiques (comme' pourcentage de la durée
de la syllabe finale) dans les groupes rythmiques à 4 syllabesde 6 variétés de français
4'positIon 3'position pénultlèllMl fina.français standard (léon 1992: lll) 51,4% 56,4% 63A% 100%français méridional (léon 1992: lll) 94,6% 75,5% 107,1 % 100%français ontarien (Robinson 1968: 166) 62,6% 73,4% 73,9% 100%français a,adien NE (C;'ho'ki 1997: 66) 70,9% 76,7% 91,2% 100%français a,adien IPE (Tennant et King 2007) 61,4% 65,1 % 79,5% 100%français a,adien TN (Tennantet King 2007) 61,6% 69,0% 73,1% 100%
359
Depuis la fin des années 1990, nous assistons à un renouveliement del'intérêt pour l'étude du rythme prosodique. En effet, l'un des développementsles plus importants dans ce courant de recherche est l'emploi d'indices rythmiques conçus pour situer les langues et les variétés sur un continuum entreles deux pôles de rythme syllabique et de rythme accentuel, en fonction dudegré de fluctuation dans la durée des syllabes et des segments qui se succédent dans la chaîne de la parole. Ainsi, Ramus, Nespor et Mehler (1999:272) proposent un certain nombre de mesures des intervalles:
• %V: la proportion d'intervalles vocaliques à l'intérieur d'unephrase, c'est-à-dire la somme des intervalles vocaliques diviséepar la durée totale de la phrnse Çmultipliée par 100) ;
f:J. V : l'écart type de la durée des intervalles vocaliques danschaque phrase;
f:J.C : l'écart type des intervalles consonantiques dans chaquephrase.
Low, Grabe et Nolan (2000), en développant plus loin les idées programmatiques présentées pour la première fois dans la thèse de Low (1998),proposent de représenter le rythme en variabilité de durée entre les paires desegments contigus: «This index captures the degree ofdurational variabihtyin a set of acoustic data, measured sequentially, and it allows us to expressnumerically a tendency towards stress- or syllable-timing in one languageor variety relative to another >l (Low, Grabe et Nolan 2000 : 378).
La version du PVI adoptée pour cette étude, nPVI-Y, mesure la variabilité de durée entre des paires de segments contigus sur la tire des voyelles.Il s'agit de l'indice PVI qui est le plus utilisé dans les recherches menéesrécemment Sur le rythme dans le cadre variationniste (Carter 2005 ; Thomaset Carter 2006 ; Vaugho 2008) et, selon White et Mattys (2007), il s'agitd'une mesure efficace pour distinguer les langues en fonction de la classerythmique. Le calcul de l'indice est effectué en prcnantla valeur absolue dela différence entre chaque paire de voyelles contiguës et en la divisant parla moitié de la durée totale des deux voyelles. La tendance centrale de cesquotients pvr (et on tend à préférer la médiane au lieu de la moyenne) est lenPVI-V pour l'échantillon de parole analysé. Nolan etAsu (2009: 66) simplifient ceUe définition:
One useful w~y 10 conceptualise what the PYI does il to think in lerms oftheprominence of successive syLiables. There is a tendency for prominence lO
360
alternate ; indeed, in arder to be prominent, to « stick out », a syllable reallyneeds to have more of the properlies which Jend prominence than do thesyllables on eilher side, or al leasl one side.
Le ta,bleau 3 illustre les valeurs PVI tirées de Grabe et Low (2002)pour une selectIOn de langues et de dialectes, par ordre décroissant de lavaleur PVI, c'est-à-dire en allant des variétés à rythmicité plus accentuellevcrs celles à rythmicité plus syllabique. Nous pouvons prendre note de laplace de l'anglais britannique et du français (on présume qu'il s'agit dufrançats européen standardisé) dans ce tableau qui, en l'absence de donnéespour. l'anglais canadien et pour le français québécois, serviront d'étalonsproVISOIres pour la comparaison des valeurs du PYI de nos locuteurs francoontarIens.
TABLEAU 3Valeurs de l'indice PVI pour une sélection de langues
Langue nPV"Vtha',landais 65,8néerlandais 65,5allemand 59,7anglais britannique 57,2tamoul 55,8malais 53,6anglais de 5inqapour 52,3
1grec 48,71gallois 48,2roumain 46,9
.polonais 46,6estonien 45,4catalan' 44,6français 43,5'aponais 40,9luxembourqeois 37,7espagnol 29,7mandarin 27,0
Source: Grabe el Low 2002.
361
2.2 Le français ontarien
Les deux communautés franco-ontarienncs choisies pour cette étuda.Hawkeshury et North Bay, fournissent un bon exemple du contraste entre lusituation majoritaire et la situation minoritaire pour le maintien du françaisen Ontario. Hawkesbury, selon le survol historique de Mougeon et Beniak(1991), a été fondée à partir de la « deuxième vague» de Canadiens françaisà quitter la vallée du Saint-Laurent pour s'établir dans l'Est de l'Ontario ilpartir d'environ 1830. Le recensement de 2006 situe la population locale il12 267 personnes, dont 78,5 % sont des francophones natifs (82,9 % en 200 1).et dont la vaste majorité (76,9 %) emploie le français comme principalelangue de communication au foyer. Quant à North Bay, Mougeon et Beniak(1991) la placent dans la « troisième vague )> de peuplement français del'Ontario, qui a commencé vers 1885. En 2006, les francophones constituaient16,9 % de la population totale de 63 494 personnes (en 200 l, 16,4 % de lupopulation totale), mais moins de la moitié de ces francophones (7,9 % dola population totale de la ville) ont le français comme langue d'lisage.
Cette réduction de l'usage du français dans lés municipalités ontarien·nes où les francophones constituent une minorité locale·a des conséquencesobservées dans l'étude d'un certain nombre de variables linguistiques. Mou·geon et Beniak (1991) démontrent que les fonnes grammaticales simplifiées.telles que le nivellement des fonnes verbales de la troisième personne duprésent de l'indicatif, par exemple ils vient pour ils viennent, sont plus fré·quentes dans les milieux minoritaires que dans les milieux majoritaires. Parailleurs, ces fonnes non standard sont corrélées avec la fréquence d'emploidu français; les francophones minoritaires dont l'usage du français est res·treint (c'est-à-dire qui communiquent en anglais dans la plupart de leursactivités quotidiennes) montrent le taux le plus élevé d'usage des fonnessimplifiées. Une autre conséquence du contact observée par Mougeon etBeniak est la réduction sociolectale, une fonne de dévernacularisation (Mougeon 2005), qui se manifeste dans la sous-utilisation des variantes vernaculaires comme à possessif panni les locuteurs adolescents dont l'emploi dufrançais est peu fréquent en dehors du contexte nonnatifde l'école de languefrançaise. En plus de ces conséquences de la restriction dans l'usage dufrançais, nous trouvons des exemples d'influence de l'anglais, comme laconvergence avec un item lexical anglais qui mène les locuteurs vivant dansun milieu de contact intense avec l'anglais à sous-utiliser la préposition chezet à préférer les fonnes du syntagme à la maison, qui ressemblent à l'anglaisrat) home, pour exprimer la 10caiisatioD dans le lieu de résidence ou le mouvement vers celui-ci. Finalement, nous trouvons un élément lexical noyau
362
tel que le connecteur so, comme synonyme d'alors et donc, qui est rarementemployé, ou pas du tout, par les Québécois et les Franco-Ontariens en situation majoritaire, et qni est employé dans les milieux minoritaires le plussouvent par les locuteurs semi-restreints. Nadasdi (2005 : 113) résume entennes géDéraux la dynamique de la variation dans le français ontarien :
Le statut minoritaire du français en Ontario et la distribution des francophones dans la province font en sorte que certains locuteurs utilisent le françaisrégHlièrement, alors que d'autres ne l'emploienl qu'à l'école. Le français deslocuteurs non restreints ressemble au français québécois pour toutes lesvariables que nous avons considérées. Le français des locuteurs semi-restreintsconnaît quelques particularités qu'on peut attribuer au fait qu'ils emploient"anglais et le français à des fréquences similaires, ce qui constitue un terrainfertile pour les phénomènes issus du contact entre langues. Quant aux locuteursrestreints, ils emploient les variantes vernaculaires/informelles moins souventque les autres francophones; ils font aussi un emploi plus élevé de certainesstructures régularisées. Toutefois, l'emploi qu'ils font de ces formes est trèsdifférent de ce qu'on trouve pour les appreoants du français langue seconde.On voit donc que les Franco-Ontariens constituent un groupe relativementhomogène, dans la mesure où le français canadien demeure leur languematernelle.
À la lumière de ces cas d'influence de l'aDglais sur le fraDçais là où lecontact entre les deux langues est intense, il serait raisonnable de considérerla possibilité d'une influence anglaise sur la prosodie du français CD Ontario,du moins en milieu minoritaire. Plus spécifiquemeDt, nous pourrions demander si le rythme prosodique de l'anglais, langue à rythmicité accentuelle,pourrait exercer une influence sur le français, langue souvent considéréeconune ayant une rythmicité syllabique, et dont les recherches ont montréqu'elle a des valeurs plus basses sur l'échelle de l'indice PVI que l'anglais.En effet, Tennant (2000) CODstate que le patron intoDatif de la montée àfréquence élevée, un emprunt probable à l'anglais, était fréquent parmi lesadolescents franco-ontariens de London à la fin des années 1990, et Tremblay(2007) a observé UDe tendance semblable dans son mémoire de maîtriseportant sur le fraDçais de Windsor. Une autre étude portant sur l'intonatioD,celle de Cichocki et Lepetit (1986), a montré qu'un patron de déclinaison deFO, vraisemblablement un effet du contact avec l'anglais, est plus fréqueDtchez les locuteurs franco-oDtariens les plus bilingues (les « bilingues équilibrés »). Si OD présume que l'indice PVl constitue un outil fiable pour distmguer des tendances dans le rytlune prosodique des langues et des dialectes,on peut avancer l'hypothèse que, si une telle influence existait pour cettedimension de la prosodie aussi, OD s'attendrait à observer un rythme moins
363
« syllabique» : 1) davantage dans un contexte minoritaire que dans uncontexte majoritaire; 2) davantage chez les locuteurs « restreints» que chez
les locuteurs « non restreints ».
3. CORPUS ET MÉTHODOLOGIE
Les échantillons de parole utilisés pour étudier le rythme du françaisontarien dans cette étude sont tirés du corpus d'entrevues semi-dirigées queRaymond Mougeon et ses collaborateurs ont recueilli dans les écoles secondaires francophones en 1978. lei, on compare Jes patrons rythmiques de deuxlocuteurs de Hawkesbury (milieu majoritaire) ct de deux locuteurs de NorthBay (milieu minoritaire), une femme et un· homme de chaque localité. Lesdeux locuteurs de Hawkesbury, à qui on a attribué les pseudnnymes Yvetteet Paul, sont des locuteurs non restreints ayant un indice d'usage du françaisde 1,00. Yvette et Paul sont tous les deux de la classe ouvrière et étaient en12' année des études lors de l'entrevue. Les locuteurs de North Bay incluentune locutrice « semi-restreinte », Gisèle, qui a un indice d'usage de françaisde 0,77 (classe moyenne, 12' année), et un locuteur restreint, Jean, dontl'indice est de 0,06 (classe moyenne, 9' année). Ces locuteurs ont été choisisparmi ceux dont la qualité de l'enregistrement se prêtait le mieux à uneanalyse acoustique, de façon à représenter (le mieux possible à partir d'unéchantillon initial à dimensinns réduites) le contraste entre le milieu majoritaire et le milieu minoritaire, avec deux degrés de restriction chez leslocuteurs minoritaires (le locuteur restreint, Jimmy, étant celui du corpus deNorth Bay qui avait l'indice le plus bas).
L'analyse a été effectuée sur les extraits d'une durée de 60 à 120secondes par locuteur, avec un minimum de 200 quotients PV] par locuteur.Les extraits ont été sélectionnés de manière à représenter des tours de paroled'une longueur significative, eontenan\ des types de discours comme lanarration, l'expressinn d'opinions et la description des activités de loisirs.
Ces échantillons ont été segmentés à l'aide de Praat, en excluant del'analyse les pauses remplies, les faux départs et d'autres phénomènesd'hésitation, ainsi que les alternances codiques. Les durées des segments ontensuite été extraites ct les données importées dans un fichier Exeel pour le
calcul des indices rythmiques.
Après le calcul des indices, une analyse de la durée des syllabes et desvoyelles en fonction de leur position dans le groupe rythmique a été effectuéepour deux des locuteurs. Pour la détermination des frontières entre les grou-
364
pes ry~miques, les critères décrits dans Poiré (2006) pour J'identificationdes proe.mnenees perçues ont été suivis.
Afin d'obtenir des données sur le rythme de locuteurs anglophonesauxquelles nous pourrions comparer celles des Franeo-Ontariens nous avonse:npl~Yé la méthode décrite ci-dessus pour calculer des indices 'PV] à partird un echanlillon de lecture à haute voix poUl' deux locuteurs anglo-ontariens,un homme et une femme dans la première année de leurs études universitaires. ~es an~lophon~s, Alan et Lisa, ont fait leurs études secondaires dansune eeole ~ ImmerSIOn, et on remarque chez eux des caractéristiques segmentales d un accent anglophone (p. ex. aspiration des occlusives sourdesa~pendlce consonantique suivant les voyelles nasales). Pendant ces séanee~d enregIstrement, qUI ont eu lieu dans le cadre du projet Interphonologie dufrançaIS comemporam (lPFC) (Detey et al. 2010 ; Tennant, Shapiro et Taylor2010;, les locuteurs ont lu le passage « Le Premier ministre ira-t-il à Beau!Jeu. »du protocole du projet PhonologIe du français contemporain (pFC).
4. RÉSULTATS ET DISCUSSION
Les résultats de l'analyse PVI se trouvent dans le tableau 4. On constatetout d'abord que la médiane générale des PYl de 44,2 situe ces locuteursfraneo-ontanens dans la zone de la rythmicité syllabique du continuum prèsde la valeur de43,5 donnée par Grabe et Low (2002) pour le français (sansdoute. le françaIS européen standardisé) et assez loin du chiffre de 57 2 qu'ilsfournIssent pour j'anglais (britannique). '
TABLEAU 4
Valeurs de l'indice PVI chez quatre locuteurs du françaisontarien
~r Movon. nPVI-Y 1 MédIa.. PVJ·Y 1 NOuotltnts PVIHawkesburvYvette 1 489 425 218Paul 567 496 206North BavGisèle 504 457 207.Jean 468 391 209Movenne Howkesburv 528 460Movenne North Bov 486 424Movenne Tous 507 442
365
TABLEAU 5
Valeurs de l'indice PVI chez deux locuteurs anglophones qui ontacquis le français comme langue seconde
En effet, avant de pouvoir tirer des conclusions à propos des effets dcl'anglais, il nous faut des données représentant le rythme français de locuteursqui ont l'anglais canadien comme langue maternelle (L 1) et qui ont apprisle français comme langue seconde (L2). Nous avons alors cffcctué une analysc de l'enregistrement de la Iccture à haute voix d'un passage par deuxlocutcurs du nouveau corpus rPFC décrit dans la section 3. Lcs valeurs PYIpour ces deux anglophones sont présentées dans le tableau 5.
Par ailleurs, en réfléchissant à l'interprétation de ces indices PVI, ilfaut considérer les caractéristiques spécifiques du français canadien, en serappelant que l'allongemcnt de la pénultième syllabe est très répandu, particulièrement pour les voyelles qui sont « longues par nature », et qu'il y ad'autres fluctuations dans la durée des syllabes qui précèdent la finale, commel'ont constaté Robinson (1968), Boudreault (1970), Wal!<er (1984) et Cichocki(1997), entrc autres.
Afin d'explorer davantage les patrons rythmiques dans notrc corpus,nous avons mesuré les durécs syllabiques moyennes en fonction de la position dans le groupe rythmique pour les deux locuteurs masculins, qui sesituent aux pôlcs opposés de l'échelle de l'indicc PYI. Cela nous fournit desdonnées qu'on peut comparer avec celles des autres variétés présentées dansles tablcaux 1 et 2. Ces données se trouvent dans les tableaux 6 et 7.
Pour les groupcs rythmiques à deux syllabes, le locuteur de Hawkesbury, Paul, montre un contraste de durée plus important entre les syllabesinaccentuées et la finale quc le locuteur de North Bay, Jcan. Nous observonsune tendance semblable pour les groupes à trois et à quatre syllabcs, aveccncore unc fois une différence de durée plus impOltante entre la pénultièmeet la finale chez Paul que chez Jean, qui semble montrer plus d'allongementde la pénultième que Paul. Les groupes rythmiques à cinq syllabes montrentun patron di fférent, mais ces groupes sont moins fréquents dans le corpus.JI scmblerait alors qu'un contraste plus élevé entre la syllabe finale du grouperythmique et la pénultième pourrait être un facteur expliquant l'indice PYlplus élevé observé pour le locuteur Paul de Hawkesbury. Il faut toutefois serappcler que ces tableaux montrent les durées des syllabes, avec les consonnes et les glissantes, tandis que l'indice nPYI-Y est basé uniquement sur lesdurées vocaliques.
367
Comme nos locuteurs franco-ontaricns, ces deux anglophones ont desindices PYI qui se situent dans la zone de l'échelle qu'occupe le françaisselon les données de Grabe et Low (2002), assez loin de la valeur pourl'anglais (français 43,5 ; anglais 57,2). Ces données posent un autre défi ànotre hypothèse initiale dc l'influence de l'anglais, puisque, si des anglophones qui parlent le français comme L2 ne révèlent pas d'influence du rythmeaccentuel de leur LI sur le rytIune de leur français, on voit difficilementcomment le rythme anglais aurait une telle influence chez des francophones,même en milicu minoritaire.
224227
• QuIliIelS l'Yl
46,240,0
...... l'YI-V47,951,2
AlanLisa
366
Quand on regarde les valeurs de l'indice PYI pour les individus, onvoit une variabilité considérable, le locuteur de Hawkesbury, Paul, s'approchant de la limite entre la rythmicité syllabique et la rythmicité accentuelle,et celui de North Bay, Jean, montrant le patron rythmique le plus syllabiquede tous les quatre. Les femmes, Yvette de Hawkesbury et Gisèle de NorthBay, se situent entre les valeurs de locuteurs masculins.
Rappelons ici qu'on a avancé l'hypothèse que, s'il y avait une influencedu rythme anglais, le français ontarien en milieu minoritaire aurait un rythmeplus accentuel que dans un milieu majoritairc, en raison du contact avecl'anglais dans le premier contexte. Il est clair que ces résultats n'appuientpas celle hypothèse, puisque les locuteurs majoritaires de Hawkesbury nemontrent pas des valeurs de PYI sensiblement inférieures à celles des locuteurs de North Bay. En effet, la moyenne de PYI des deux locuteurs deHawkcsbury cst supérieure à celle des deux locuteurs de North Bay.
11 s'agit donc d'un résultat inattcndu. Est-ce que le rythme anglaiSinfluencerait le rythme dcs locuteurs de Hawkesbury plus que cclui deslocuteurs de North Bay? Une telle explication de ce résultat nous paraîtdifficile à appuyer, comptc tenu de la dynamique de contact linguistique qucl'on obscrvc dans les deux communautés en question. Une explication plusplausible scrait que le rythme accentuel de l'anglais n'cst pas en train d'influencer le français de ces locuteurs, et que les différenccs que nous observonsentre lcs indices PYI refléteraient des variations individuelles.
TABLEAU 6Durées (en centièmes de seconde) des syllabes de groupes
selon la position dans le groupe rythmique
2syllabes se position 41 position 3'position pénultième finale
Paul 14,26 25,85
Jean 13,27 21,33
3syllabes S'position .'position J'position pénultième finale
Paul 15,73 17,48 29,51
Jean 13,88 17,47 23,16
4syllabes S'position 4'position 3'position pénultième finale
Paul 15,23 14,47 15,41 24,13
Jean 12,76 14,81 19,23 11,60
Ssyllabes S· position 4'position l'position pénultième finale
Paul 15,56 14,07 13,34 13,91 25,94
Jean 15,01 20,78 17,79 13,98 29,18
TABLEAU 7
Durées (exprimées en proportion de la durée de la syllabe finale)des syllabes de groupes selon la position dans le groupe
rythmique
2syllabes S'position 4'positlon J'pos"lon pénultième finale
Paul 55,2% 100%
Jean 62,2% 100%
J syllabes S' position 41 position j'position pénultième finale
Paul 53,3 % 59,2% 100%
Jean 59,9% 75,5% 100%
4syllabes S' position .1 position l'position pénultième finale
Paul 63,1 % 6OM6 63,9% 100%
Jean 59,1 % 68,6% 89,0% 100%
Ssyllabes S· position 4' pos"1on l'position pénultième finale
Paul 60M6 54,2% 51,4% 53,6% 100%
Jean 51,4% 71,2% 61,0% 47,9% 100%
368
Étant donné ces résultats et compte tenu du rythme « lrailer-limed )}du français, selon le terme de Wenk et Wioland (1983), nous pourrions nousdemander dans quelle mesure l'indice PYl est en fait capable de révélerl'influence de l'anglais sur les variétés de français en contact avec l'anglaisau Canada.
Des recherches futures portant sur un plus grand échantillon, qui donnera une représentation plus robuste des trois groupes établis selon la réstriction (avec des locuteurs de Pembroke, communauté dont 8 % de lapopulation est francophone), et qui appliqueront d'autres indices rythmiques,comme ceux proposés par Ramus el al. (1999), permettront d'apporter plusd'éléments de réponse à cette question.
S. CONCLUSION
Les résultats de cette étude initiale ne sont pas concluants en ce quiconcerne l'influence de l'anglais sur le rythme du français ontarien. Celaveut-il dire qu'une telle influence n'est pas présente, ou simplement que laméthode d'analyse employée ne permet pas de détecter l'influence? En effet,la première explication n'est pas forcément à écarter si rapidement. En écoutant ces quatre locuteurs, nous n'avons pas l'impression immédiate d'un fortaccent anglophone. Par ailleurs, nous avons trouvé que le rythme, mesuré àl'aide de l'indice PVI, de deux locuteurs anglophones du français L2 nediffère pas de celui de nos locuteurs franco-ontariens. En effet, la confirmation d'un tel résultat négatif pour une influence du rythme sur un plus grandéchantillon serait une découverte fort intéressante, dans la mesure où celasuggérerait qu'une dimension de la prosodie, l'intonation (Cichocki et Lepetit 1986; Tennant 2000; Tremblay 1987), est sujette à l'influence de l'anglais,tandis que le patron rythmique général résisterait à une telle influence. Lesrésultats obtenus récemment dans une autre étude (Kaminskaïa, Tennant etRussell 2010) vont dans lemême sens en suggérant que le rythme du françaisde Windsor (milieu francophone minoritaire) ne se distinguerait pas de celuidu français de Hearst (milieu francophone majoritaire) par des valeurs dePYl montrant une rythmicité plus accentuelle.
Il est certain que le français ontarien restera, dans les années à venir,un terrain idéal pour les recherches sur les conséquen~es du contact linguistique pour la prosodie. Et il faut reconnaître que c'est en grande partie grâceaux contributions innovatrices de Raymond Mougeon au cours de plus de
369
trois décennies que de telles recherches peuvent se fonder sur des hypothèseset des points de comparaison dans un vaste corps de recherche sociolinguistique. En faisant cette modeste contribution à ce volume édité en son honneur,je tiens à lui exprimer ma profonde gratitude.
BIBLIOGRAPHIE
ABERCROMBIE, David (1967). Elements of General Phonetics, Édimbourg,Edinburgh University Press, 203 p.
ASTÉSANO, Corine (2001). Rythme et accentuation en frallçais. Invariallce etvariabilité stylistique, Paris, L'Harmattan, 338 p.
BOERSMA, Paul et David WEENINK (2010). Praat .- Doing Phonetics by Computer ; http://www.praal.org.
BOUDREAULT, Marcel (1970). « Le rythme en langue franco--<:anadienne », dansPierre LÉON, Georges FA URE et André RIGAULT (dir.), Prosodic FeatureAnalysis 1 Allalyse des faits prosodiques, Montréal, Didier, coll. « Srudiaphonetica », n' 3, p. 21-31.
CARTER, Phillip M. (2005). « Quantifying Rhythmic Differences BelWeen Spanish,English, and Hispanic English », dans Randall S. GESS et Edward J. RUBIN(dir.), Theoretical alld Experimental Approaches ta Romallce Linguisties .Selectedpapersfrom the 34'h Linguislic Symposium on Romance Languages,Amsterdam/Philadelphie, John Benjamins, coll. « Current Issues in Linguislie Theory », n' 272, p. 63-75.
CICHOCKl, Wladyslaw (1997). « Observations préliminaires sur le rythme enfrançais acadien », dans Lise DUBOIS et Annette BOUDREAU (dir.), LesAcadiens e/leur(,) langlle(s) : qualld le français esl millori/aire, Moncton,Éditions d'Acadie, p. 63-73.
CICHOCKl, Wladyslaw et Daniel LEPETIT (1986). « Intonalional Variabiliry inLanguage Contact. FO Declination in Ontarian French », dans David SAN·KOFF (dir.), Diversity alld Diachroll)', Amsterdam, John Benjamins, p. 239247.
DAUER, Rebecca M. (1983). « Stress-Timing and Syllable-Timing Reanalysed »,Journal ofPhonetics, vol. Il, p. 51-62.
DETEY, Sylvain, Isabelle RACINE, Yuji KAWAGUCHI (pilotage) ; JacquesDURAND, Bernard LAKS et Chantal LYCHE (supervision) (2010), ln/erphonologie du français cOII/emporaill (IPFC) ; http://cblle.tufs.ac.jp/ipfc/index.php?id=6.
DI CRISTO, Albert (1999). « Vers une modélisation de l'accentuation en français:première partie )', Journal ofFrench Langllage Sludies, vol. 9, p. 143-179.
370
--- (2000). « Vers une modélisation de l'accentuation du français (secondepartie) », Journal ofFrelJch Language Studies, vol. 10, p. 27-45.
GRABE, Esther et Ee Lin LOW (2002). « Durational Variability in Speech and theRhythm Class Hypothesis », dans Natasha WARNER et Carlos GUSSENHOVEN (dir.), Papers in Labaratory Phonology 7, Berlin, Mouton de Gruyter, p. 515-546.
JUN, Sun-Ah.et Cécile FOUGERON (2000). « A Phonological Model nf FrenchIntonatton », dans Antonis BOTINIS (dir.), lntimation.- Analysis, Model/ingand Tee/mology, Dordrecb~ Kluwer Academic Publishers, p. 209-242.
KAMINSKAïA, Svetlana, JeffTENNANT et Alexander RUSSELL (2010). « LePFC en O~tano. Ryth~e et français en contact », communication présentéeaux Journees PFC, Pans, décembre.
LÉON, Pierre R. (1992). Ph(J/létisme et prononciatio/lS dufirançais Paris Nathan192 p. ' , ,
LÉON, Pierre et Wladyslaw CICHOCKI (1988). « Bilan el problématique des études~nclophonetlques franco-omariennes », dans Raymond MOUGEON etEdouard BENIAK (d~.), Le Fonçais canadien parlé hors Québec. Aperçu
, soclOlmglllslJque, Quebec, Les Presses de l'Université Laval, p. 37-51.
LEON, :ierre R. et Monique L~ON (1980). « Obse~ation sur l'accent des françaisreglOnaux ", dans Ivan FONAGY et Pierre LEON (dir.), L'accen/ enfrançaiseOll/emporain. Montréal, Didier. coll. « Studia phonetica », n° 15, p. 93-107.
LOW, Ee Ling (1998). Prosodic Prominence in Singapore English, thèse de doctorat (Ph. D.), University ofCarnbridge.
LOW, EeLing, Esther GRABE et Francis NOLAN (2000). « Quantitative CharactenzatlOns of Speech Rhythm: Syllable-Timing in Singapore English »Language and Speech, vol. 43, n' 4, p. 377-401. '
MOUGEON, Raymond (2005). « Rôle des facteurs linguistiques et extra-linguistiques dans la dévernacularisation du parler des adolescents dans les communautés francophones minoritaires du Canada », dans Albert VALDMAN, JulieAUGE~ et D~borah PISTON-HATLEN (dir.), Lefrançais en Amérique duNord.- etat presell/, Québec, Les Presses de l'Université Laval, p. 261-285.
MOUGEON, Raymond et Édouard BENIAK (1991). Linguis/ic Consequences ofLanguage Contact andReslriction .- The Case ofFrench in On/aria. CanadaOxford, Oxford University Press, 256 p. '
MOUGEON, Raymond et Terry NADASDI (1998). « Sociolinguistic DiscontinuityIn Mmonty Language Communities )). Language, vol. 74, nO l, p. 40-55.
NADASDI, Terry (2005). « Le français en Onlario )', dans Albert VALDMAN, JulieAUGE~ et Deborah PI~TON-HATLEN (dir.), Lefrallçais en Amérique duNord.- elal présent, Quebec, Les Presses de l'Université Laval, p. 99-115.
NOLAN, Francis et Eva L ASU (2009). « The Pairwise Variability Index andCoexlstmg Rhythms 10 Language », Phonetica, vol. 66, n' 1-2, p. 64-77.
371
PIKE, Kennelh Lee (1945). The Intonation ofAmerican English, Ann Arbor, University of Michigan Press, xi-200 p.
POlRÉ, François (2006). « La perception des proéminences elle codage prosodique »,dans Anne Catherine SIMON, Geneviève CAELEN-HAUMONT el ClaudmePAGLlANO (dir.), Bulletin PFC, n' 6: Prosodie du français contemporain,Paris, Nicole Sema, p. 69-79.
POIRÉ, François, Claire GURSKI et Stephanie KELLY (2007). « L'analyse phonétique à panir de petits corpus de parole spontanée: le cas des glissantes enfrançais de Windsor, Canada », dans Sylvain DETEY et DomllllqueNOUVEAU (dit.), Buffetin PFC, n' 7 ERSS, UMR 5610, Toulouse, CNRSIUniversilé Toulouse Le Mirail, p. 341-358.
POIRÉ, François, Svellana KAMIN SKAÏA et Rémi TREMBLAY (2010). « Conséquences du contact avec l'anglais sur la réalisation de la liaison et du schwaen français de Windsor, Canada », dans Marie ILlESCU, Heidi SILLERRUNGGALDlER et Paul DANLER (dir.), Actes du XXI' Congrès international de linguistique et de philologie romanes, tome l, Berlin, Walter deGruyter, p. 365-374.
POlRÉ, François, Slephanie KELLY et Darcie WILLIAMS (2006). «La réalisationdes voyelles nasales en français de Windsor », Parole, vol. 39/40, p. 259-284.
POPLACK, Shana (1989). « Statut de langue et accommodalion langagièr~ le longd'une frontière linguistique », dans Raymond MOUGEON et EdouardBENIAK (dir.), Le français parlé hors Québec: aperçu sociolinguistique,Québec, Les Presses de l'Université Laval, p. 127-151.
RAMUS, Franck, Marina NESPOR et Jacques MEHLER (1999). « CorrelaIes ofLinguistic Rhylhm in the Speech Signal », Cognition, vol. 73, p. 265-292.
ROBINSON, Linda (1968). « Étude du ryt~e syllabique en français canadien eten français standard », dans Pierre R. LEON (dir.), Recherches sur la structurephonique du français canadien, Paris/MontréalfBruxelles, Didier, coll.« Studia phonetica », n' l, p. 161-174.
TENNANT, Jeff(1995). Variation mo,phophonologique dans lefrançais parlé desadolescents à North Bay (Ontario), thèse de doctorat, University ofToronto,
347 p.___ (1996). « Variation rnorphophonologique dans une langue en situation
minoritaire: le français à Nonh Bay», Revue du Nouvel-Ontario, vol. 20, p.
1-136.___ (2000). « Language Contact and Intonational Variability : High Rising Ter
minais in Ontario French », communication, Ne.w Ways ofAnalyzing Variation(NWAV) 29, Michigan Slale University, octobre.
TENNANT, Jeff et Ruth KJNG (2007). « Le rythme dans le français parlé de TerreNeuve el de l'Île-du Prince-Édouard », communication présentée aux JournéesPFC, University of Western Ontario, London (Ontario),juillel.
372
---(2008). « Rhylhm in the Spoken French ofNewfoundland and Prince EdwardIsland », affiche présentée à NWAV 37, Houston, TX, novembre.
TEN ANT, Jeff, Jade SHAPIRO et Nerissa TAYLOR (201 0). « PFC Anglophonescanadiens: Protocole el contexte », communication présentée aux Journées1PFC, Paris, décembre.
THOMAS, Ajain (1986). La variation phonétique: cas dufranco-ontarien, Montréal,Didier, coll. « Studia phonetica », n' 21, 174 p. .
THOMAS, Erik R. et Phillip M. CARTER (2006). « Prosodic Rhythm and AfricanAmerican English », English World Wide, vol. 27, n' 3, p. 331-355.
TREMBLAY, Rémi (2007). La réalisation des contours mélodiques dans deuxvariétés dufrançais en contacl avec l'anglais, thèse de maîtrise, Universityof Westem Ontario.
VAUGH ,Charlotte (2008). « Effects of Discourse Factors on Prosodic Rhythm:Evidence From Lnter- and Intra-speaker Variation in Hispanie English »,NWAV 37, Rice University, Houston, TX, novembre.
WALKER, Douglas C. (1984). The Prommciation ofCanadian French, Ottawa,Presses de l'Université d'Ottawa, 148 p.
WENK, Brian, J. et François WIOLAND (1982). « ls French Really SyllableTirned? »,Journal ofPhoneJics, vol. 10, p. 193-216.
WHITE, Laurence et Sven L. MATTYS (2007). « Calibmting Rhythm: First Language and Second Language Studies », Journal of Phonetics, vol. 35, n' 4,p.501-522.
373