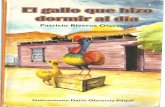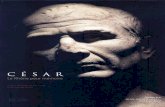RIVET (L.), La céramique, dans FIXOT (M.) (sous la dir. de), Le site de Notre-Dame d'Avinionet à...
Transcript of RIVET (L.), La céramique, dans FIXOT (M.) (sous la dir. de), Le site de Notre-Dame d'Avinionet à...
CE:'-iTRE :"O.-\TIO~AL DE LA HECHERCHE SCIE:-"TIF'rQL"E Ce mre de Hecherches Archeologiques
LE SITE DE NOTRE-DAME D'AVINIONET
A MAl'lDELIEU
.llonograp h ie du CR...\ 1/ ' J
:;:''''''' '' ',':~R.S .-,,. ~ ".«,., H " K..: · . fC'-' :'< .. "",,,,c. ~ ~ , .. , .\Iu :> • . r,~·.«. ;~ :~·l P~n .
:'o lichel FLXOT ::::Uôd~
La couche 14 (fig. 30 à 35, 106, 107 et 110). état 1 (L. Rivet)
La fouille des terres qui correspondent aux couches profondes des pièces X, XI, XIII et aux
Amti'Ores
" o
Ampnorenes
Cè,. com. P. Claire
Cét. culinue mICa.
Cer. com. p. brune
CM. com. p. Orlse
CAf. com. engoDée
lampes
Rouge pompéienne
ParOI' fines
Plombier.
Camparuenne
Sud de fa Gaulo
Ame. da CUISIne
Sig. CI. A
Cla"e B
Sig. CI. C
lu~nle
Sig. CI. 0
Siv. Esl Tard. (OS.P.)
LE SITE ANTIQUE 03
:'f!'D ~~ ~ ., ..
- ,
x "
d4 LE SITE DE NOTRE-DAME D'AVINIONET A MANDELIEU
-1
(
r - le J~\
i
! / 1
1
1 1 / ,
/ '. ' , , , , ,
/ ' ' , ' , , ' ,
, , , ' , '
" 1
2
Fig. 31.-Amphorettes de la couche 14.
, ., "'. ----r-- ;/Q ~ - r
5
2 ~8
"\ 12
17
15
19
.- f--( 16
~==---- Fig. 31 . s de la couche 14. . 35 - Céramlque FIg. •
remblrus sous-jacents à la couche d'argile plastique et stérile constituant la terrasse a permis la récolte d'un très abondant mobilier céramique"" ; c'est le lot le plus important fourni par le site (19560 fragments, cf. tableau de comptage, fig. 30). D'un sondage à l'autre la concordance de la couche estconfortée par un certrun nombre de collages de tessons.
Les amphorettes dominent cet ensemble, avec plus de 53 % des tessons. Deux types de formes ont été reconnus et publiés par ailleurs"" :
- une amphore de très petite taille (type n, haute de 58 cm sur pointe et d'une contenance de 3,25 litres (fig. 31, n° 1) ;
- une amphore à panse ovoïde (types IIA et lIB), haute de 47 à 50 cm sur fond plat et d'une contenance de 13 litres environ (fig. 31, n° 2 et fig. 32).
La couche 14 recèle en abondance ces trois types de conteneurs ainsi que quelques tessons surcuits de cette production. Sur l'ensemble de la fouille, et toutes couches confondues, il a été rassemblé une quantité importante de ratés de cuisson et de blocs d'argile surcuits qui attestent qu'un atelier a produit ces petites amphores, sinon sur le site, du moins aux abords. Par rulleurs, j'ai déjà clairement lrussé entendre que cette production de petites amphores éWt à mettre en rapport avec l'activité économique de la vil/a, et qu'en particulier l'exemplrure de 3,25 litres pouvait être destiné au garum si toutefois les bassins de tuileau étaient effectivement destinés à la salruson.
LE SITE ANTIQUE 69
Les tessons d'amphores, en fruble proportion (à peine 7 % de l'ensemble), donnent essentiellement les formes suivantes: des Dr. 2/4 de Tarraconaise etde Campanie (fig. 33, nO 10et 11), des Dr. 20 (fig. 33, nO 4 et 5) et des Dr. 7/11 (fig. 33, nO 8 et 9). Il faut y ajouter quelques autres exemplaires de petites amphores de production locale ou régionale (fig. 33, nO l, 2 et 3).
Dans la catégorie des céramiques à pâte clrure (près de 20 % de l'ensemble), ce sont les coupes! mortiers« à listel. qui dominent (fig. 34, nO 1 à 10) ; un exemplaire de mortier à double lèvre est également attesté (fig. 34, nO 11). Le reste est représenté par des cruches (fig. 35, nO 9 et 10), des pots à deux anses (fig. 35, nO 11 et 20) runsi que par divers récipients à lèvre en bandeau (fig. 35, nO 13 à 19).
Avec la céramique commune à pâte brune (7 %) on trouve des objets destinés à la conservation ou à la cuisson, comme des marmites à marli ou des ol/ae avec ou sans couvercle (fig. 35, nO 7 et 8) et des jattes.
Les productions en pâte grise (1,5 %) fournissent également des vases de réserve ou des marmites à lèvre pourvue d'une gorge et munies d'une seule anse (fig. 35, nO 6). Les tessons se rapportant à la cruche à bec trilobé de forme Goudineau 1 sont fréquents.
La céramique à pâte clrure engobée (5,3 %), à côté de quelques fragments de balsamrures ou de cruches, est presque exclusivement constituée de
(94) Avertisscmen18 généraux concernant. l'étude du matériel céramique: - Sauf mention Spéciale, tous les dessins de céramiques sont. redui18 au 1/3. - Seules lcs formes de céramique les plus significatives et lcs mieux ooDservéea 80nt dessinées. - La plupart du temps, lcs œramiques telles que lcs sigillées, qui se défmiasent par dea numéros typologiques, o'ont pas été dessinées. - Pour une raison qui tient exclusivement au souhait. de ne pas alourdir le texte, on ne fait pas référence aux publications clas. siques et. supposées connues de céramologie ; on limite ccs réf6renœs à certains ouvrages relativement récents ou de notoriété locale ou régionale. - Les comptages recensent tous les tessons avant recollages. Remerciements: l'css.entiel des dessins de céramique a ét.é réa1isé par N. Rivet·Rohmann et M. SciaHano. (Les mises au nct sont de L. Rivet.) Pour les classements, les recollages, la gestion et l'élude de ce mobilier œramique, 00U8 aVODJ bénéficié de l'aide constante et patiente de N. Rivet-Rohmann.
(95) L. Rivet, Un atelier de potiers du lU siècle de notre ère à Mandelieu (A.-M.), dans Documenl8 d'archéolop müidionah, t. 9, 1986, p. 119.134.
70 LE SITE DE NOTRE-DAME D'A VINIONET A MANDELIEU
coupes hémisphériques (issues du catalogue de la campanienne, fig. 35, nO 1 et 2), produites dans la région de Fréjus ou à Lorgues"", et de coupes carénées à anses (dont les analogies sont évidentes avec les productions en parois fines, forme Mayet X de Campanie d'époque augustéenne, fig, 35, nO 3, 4 et 5). D'autres tessons, se rapportant à des cruches ou à des« pots à membrane., trop fragmentés, n'ont pas été dessinés.
Les lampes sont assez bien représentées, tant pour les formes à bec plat (Deneauve II et III) que pour les becs ronds ou triangulaires ornés de volutes (Deneauve IV et V). On remarque, en particulier, parmi les premières, un exemplaire à tètes d'oiseaux de type Dr. 4 (fig. 107, n° 1) dont on peut dater la production entre 20 avant notre ère et 10 après"". On relève quelques fragments isolés de médailions décorés: singe attrapant une grappe de raisin (fig. 107, n° 2)"", amour (fig. 107, nO 3), personnage debout (fig. 107, nO 4), cerf courant à droite (fig. 107, n° 5) et ours courant à droite (fig. 107, nO 6).
Les produits en parois fines tiennent égaiement une place non négligeable, essentiellement d'origine espagnole et avec des décors variés: sablé, réticulé, feuiile d'eau, mamelons et écailles de pomme de pin (rare). Quelques fragments du type coquille d'œuf ont aussi été récoltés.
La campanienne, sans être absente, constitue un ensemble mineur (8 fr.).
S'il fallait, au vu de ce seul matériel, fournir une datation, on pourrait dire qu'il couvre, dans sa plus grande majorité, la fin de l'époque augustéenne : les formes de parois fines, d'engobée, de
pâtes grise et brune et de pâte claire se rattachent, en effet, largement à ces années 5-15 de notre ère. Les lèvres d'amphores Dr. 20(9" tendent â rajeunir cette chronologie dans la fourchette 20-40 ; il en va de même pour les lampes, en particulier avec le médaillon décoré d'un singe qui s'inscrit dans les années 40-70.
Pour tenter de confirmer cette datation, voire de l'affiner, on dispose d'un lot assez important de sigillées: 455 fragments d'arétine et 82 de Gaule du Sud (soit respectivement 2,3 % et 0,4 % de l'ensemble).
L'arétine offre un certain nombre d'objets qui se rapportent aux différents services de Haltern rassemblés dans la typo logie de Goudineau, avec les formes 2 (3 fr.), 7, (!fr.), 17 (!fr.), 19 (1 fr.), 25 (2 fr.), 26 (18 fr.), 27 (17 fr.), 28 (2 fr.), 32 (9 fr.), 34 (2 fr.), 37 (5 fr.), 38 (4 fr.), 40 (2 fr.), 41a (1 fr.), 41b (2 fr.) et 42 (2 fr.). Les calices sont attestés avec 24 fr. de décors (non dessinés car très fragmentés) ; l'un d'eux illustre, peut-être, une scène de banquet (fig. 110, nO 1). Les éléments du service IV, représentés à plusieurs exemplaires, ne permettent pas d'assigner à cet ensemble une date antérieure à 25 de notre ère, ce qui est largement appuyé par les marques:
- XANTHI (CN. ATEIVS XANTHVS, cf. Oxé Comfort 177), dans un rectangle central, pour un plat Goud. 26 à pied large (fig. 106, n° 1) ;
- ATEI (ATEIVS rétrograde avec palme, cf. Oxé Comfort 144), dans un rectangle central, pour une petite coupe (fig. 106, n° 2) ;
- S.M.P (SEX. M<VRRIVS) P(RISCVS?), cf. Oxé Comfort 1059), ill pla lita pedis, pour une coupe (fig. 106, nO 3 ) ;
(96) M. Pasqualini, Un atelier de potiers sur la commune de Lorgues (Var), dans Documents d'archéologie méridionale, t. 8, 1985, p. 175-180.
(97) M. Ricci, Per una cronologia delle lucerne lardo-repubblicanc, dans Revue d'éludes ligures, 2-4, 1973, p. 168·234, plus spécialement p. 200-206 pour le type 4.
(98) K. Goethert·Polaschek. Katalog der romisc1um Lampen des rheinischen LAndesmuseums Trier (Trierer Grabungen und Forschungen. BandXV), Mainz, 1985, p.127, n° 541 el pl. 58, datable de l'époque Claudc·Néron.
(99) cr. le lype 3 de S. Martin-Kilchcr, U!S amphores romaincs à huile de Bétique (Dr. 20 el 23) d'Augsl (Colonia Augusta Rauricorum) el Kaiseraugst (Castrum Raurcuense), dans Producci6n y comercio dei aceite en la antigaedad, Madrid, 1983, p.337-347.
_ (P)RISC (PRISCVS, cf. Oxé Comfort 1405), in planta pedis, pour un plat à pied large (fig. 106,
n' 4); _ (C)RESTI (CRESTVS, cf. OxéComfort425),
dans un rectangle central, pour une petite coupe (fig. 106, n° 5) ;
_ ZOI (CN. ATEI ZOILI, cf. Oxé Corn for 180), dans un rectangle central, pour une coupe (fig. 106, n' 6) ;
_ L. MARI (L. MARIVS, cf. Oxé Comfort 976), dans un rectangle central, pour une coupe (fig. 106, n' 7).
La présence de deux plats à pied large, de deux marques in planta pedis, dont une correspondant à un potier vraisemblablement tardif(S.M.P) n'autorisent pas à placer ce lot avant les années 40-50 de notre ère.
La sigillée du sud de la Gaule renvoie aux formes Ritt. 8 (2 fr.) et 12 (1 fr.), Drag. 15/17 (1 fr.), 1s/31 (16 fr.), 24/25 (5 fr.), 27 (6 fr.), 30 (5 fr.) et, peutêtre, Hermet 25. Un fond de Drag. 24/25 porte une marque SEN( ... , trop fragmentée pour que l'on puisse préciser le nom du potier (fig. 106, n' 12). La plupart de ces formes commencent à être diffusées dans les années 20-30 de notre ère; l'assiette Drag. 1s/31 reporte, cependant, cette chronologie aux années 30-40 et la coupe Ritt. 12 aux années 40·50. Il reste le problème, que l'on ne peut résoudre, du tesson d'attribution douteuse à la forme Hermet 25 (il pourrait se rapporter à une forme différente), qui requiert une date plus récente, autour de 80. Si l'on veut bien faire abstraction de ce tesson (d'une part parce qu'il est douteux, d'autre part parce qu'il est isolé et qu'il peut s'agir d'une intrusion) et en tenant compte des données fournies par l'ensemble du matériel, et en particulier par l'arétine et la sigillée du sud de la Gaule, c'est donc à une date qui ne peut être antérieure à 50 qu'il faut situer la constitution de cette couche.
La fouille semble montrer que les constructions attribuées à l'état 1 surgissent sur un site vierge d'une occupation structurée antérieure. La
LE SITE ANTIQUE 71
couche 14 ne correspond pas à un niveau d'occupation mais semble le résultat d'apports ou d'épandages liés à l'amplification du bâti. Elle ne donne donc d'indications chronologiques que sur la fin d'une phase d'utilisation du site dont, en l'absence de couches d'occupation, les origines peuvent être attribuées à une période à laquelle la céramique apparaît en quantités significatives et abondantes, c'est-à-dire vers les années 20-40 de notre ère. On doit se demander d'ailleurs d'où vient cette très importante quantité de tessons, en particulier de tessons d'amphorettes, présents dans ces terres en proportion très majoritaire, avec quelques ratés de cuisson : quelle partie du site, aux abords de cet établissement, produit et fournit ces conteneurs?
La couche 12 (fig. 36 et 37), état 3a (L, Rivet)
Un niveau 12, reconnu sOus les pièces XIII et XV, fossilise la crête du mur de l'enclos primitif. Il donne un terminus pour la disparition de cette limite et situe le moment de la construction de l'aile sud de la galerie selon le projet monumental correspondant à l'état 3.
Les 733 tessons recueillis dans la couche 12 (cf. tableau de comptage fig. 36) proviennent des pièces XV, X, XIII et XIV et fournissent quelques éléments de chronologie.
Les amphorettes de production locale, toujours abondantes (14 % de l'ensemble), sont représentées par les types 1 et II.
Avec les amphores (18 % de l'ensemble) on trouve la forme 4 des amphores gauloises (fig. 37, n° 9 et 10)"·" tandis qu'une Dr. 20 presque compIète, mais sans col, a été récupérée.
En céramique commune à pâte claire (25 %), les coupes/mortiers. à listel. sont toujours nombreux, de même que les pots à anse(s) (fig. 37, nO 8) et lesol/ae sont toujours dominantes en pâte brune (fig. 37, nO 6 et 7), en particulier avec un exemplaire
(00) F. Laubcnheimer, La production des amplwres en Gaule Narbonnaise, Besançon, 1985.
72 LE SITE DE NOTRE·DAME D'A VINJONET A MANDELIEU
S <ONW ~ <.0 r::n ID 0 N ,.... ..... .....
Amphores ~~m ~
... 1
CM. com. p. claire 1 m 0 ~ gJ N m " ; ,
1 ~ m Cét. culinaire mica.
1 ,
1 ~';!. m :: Céf. com. p. brune
Ger. corn. p. grise , m <0 ~
1
1
o W " :: Céf. corn. engobée ~ - -, i ~ N W
lampes 1
i <0
Rouge pompéienne 1
<;0 U') L/l W Parois fines
PIombilèr8
Campanienr.e
Arétioe W N
" - on Sud de la Gaule
1
Ame. de cuisine 1
- -Sig. Cl. A i ,
Claire B i
Sig. Cl. C ,
Luisante i
Sig. Cl. 0
Sig. Ell Tord. (OS.P.) 1
N
;; > == ~ X X X X
" " ~
;1,
1 -
1
on :'
~
1
N
N
0 <0
~
<0
~ N
1
1
1
<0 N
1
m
1
1
N
1
1
~ « b t-
1
! , , !
i 1
,
1 1
!
! 1
i , 1 ,
1 1
i
pratiquement entier (nO 5).
La catégorie à pâte brune micacée offre les rares fragments recueillis sur le site qui se rapportent à des ol/cre"o" .
Curieusement, la céramique à pâte grise livre des urnes dites augustéennes, à épaulement marqué et encolure lissée.
La céramique engobée est représentée par des coupes dont certaines basses et à bord rentrant (fig. 37, nO 1 et 2), ou par des coupes carénées à anses, déjà rencontrées dans la couche 14. Un bord avec lèvre en amande (fig. 37, nO 3) annonce la tendance que prend cette céramique dès la fin du lH siècle/début du Il' siècle. On note un col de cruche (fig. 37, nO 4), avec lèvre finement striée.
L'arétine (près de 4 %) fournit des formes Goud. 27 et 32 et la sigillée du sud de la Gaule (un peu plus de 1 %) les formes Dr. 24/25, 29, 35 à feuilles d'eau et 37. Ces deux dernières formes assignent une date nécessairement postérieure à 70 pour la constitution de cette couche.
La présence de sigillée claire A des formes Lamb. 10A / Hayes 23 (un fragment de bourrelet à la liaison panse/fond) et Lamb. 2a/ Hayes 9 (un fragment de bord), toutes deux appartenant à la première période de production, conforte cette datation et pourrait tendre à la rajeunir à la fin du lu siècle.
La couche 11a (fig. 38, 39, 106 et 107), état 3b (L. Rivet)
Enfin au niveau 11, un sol noir de terre battue correspond au moment de la première utilisation du cellier (pièce XIII) et de l'aUe sud de la galerie non encore cloisonnée (pièces IX, X. XI).
Le matériel collecté rassemble 1 821 fragments (cf. tableau de comptage, fig. 38). Plus encore
(101) L. Rivet, La céramique culinaire micacée de la région de Fréjus (Ver), dans Revue arcMologique de Narbonnaise, t. XV, 1982, p. 243-262, formes 17 ou 20.
)
7
"\ i ,
LE SITE ANTIQUE 73
\_~====:;3
-- -- - - -----------------'-\
1
1
) 5
" .-. -"', \~
, , ... ? ~
9 , , ~ : , , , , " : , , : '
10
8
Fig. 37.- Céramiques de la couche 12.
74 LE SITE DE NOTRE·DAME D'AVINIONETAMANDELIEU
~ ~ ~ i N a a a ~ ~ ~ ~
" '" '" , a
" N ~ ~ N "
Amphores
N a " ~ ~ ~ '" ~ ~ n Amphorettes
'" " :;; N N N Ji N Cer. corn. p. claire
i Cer. culinaire mICa.
Cer. com. p. brune ~ ~ ~ ~
'" '" ~ ;"
'" " ~ ~ N Cér. corn. p. grise
" " ~ " Cer. com. engobOO ~ ~ '"
h ~ ~ , ~ N
N Lampes
N " Rouge pom~enne
'" '" N a N Parois fines
N
Sig. CL C
luisante
Sig. CI. 0
,
Sig. Esl Tard. (OS,P.ll 1
~----------~----~ 1
que dans les couches 11c et 11b, on trouve ici une proportion importante de céramique résiduelle que nous ne ferons Qu'évoquer.
Les amphores (20 % de l'ensemble) sont iIIus· trées par des lèvres de Dr. 20 (une du type 5 de S. Martin·Kilcher, à situer dans la première moitié du 1" siècle, une autre du type 6, datable du milieu du 1" siècle). On relève une lèvre, vraisemblable· ment de forme Pascual l, à pàtejaune clair, micacée, pulvérulente (fig. 39, n° 10), une lèvre d'amphore gauloise 4 et une pointe de forme Dr, 2/4 ; ce sont ces dernières qui sont les plus fréquentes (fig, 39, n° 7, 8 et 9).
Les tessons d'amphorettes sont toujours présents (plus de 32 % de l'ensemble) et correspon· dent aux types 1 et II. L'exemplaire dessiné pour la couche 14 (fig. 31, n' 2) provient de cet ensemble.
A côté des coupes/mortiers « à listel " des cruches (dont on ne dispose, le plus souvent, que d'une partie du goulot), des mortiers ou des vases fermés avec ou sans anse (fig. 39, n° 3 et 5), la céramique commune à pâte claire (27,5 %) livre une petite coupe à marli (fig, 39, n° 2) et un bord de grande jarre (fig, 39, n° 4).
La céramique commune à pâte sombre (près de 11 %) est représentée par une grande Dl/a sans anse (fig, 39, n' 6) qui montre des traces de feu et conserve, à l'intérieur comme à l'extérieur du fond, des dépôts charbonneux.
La céramique commune engobée, peu abon· dante (3,5 %), fournit des tessons de deux coupes hémisphériques et de deux coupes carénées à anses (cf, des exemplaires semblables, fig, 35, n° 1 à 5, provenant de la c. 14),
22 des 24 fragments de lampes appartien· nent à un objet de grandes dimensions, à bec rond orné de volutes (fig. 107, n° 7), fabriqué selon la technique de la glaçure plombifère (inuetriata), La provenance de cette lampe est, vraisemblablement, la Campanie.
La céramique arétine (un peu plus de 1 % de
'-1
1
( (
L
: ~
\
J /
: '~v
\ 1
,
3
4
---==-;-( 1 L , ' , ~
d la couche lIa. . es e Fig. 39.- Céram.qu
5
6
76 LE SITE DE NOTRE·DAME D'AVINIONET A MANDELIEU
l'ensemble) donne des formes Goud, 27 (un bord et une carène guillochée), 38 (un fr, de panse hémi· sphérique avec filet saillant et départ de rebord vertical guilloché, un bord non guilloché et un fr. de fond) et 42 (une variante de bord). On remarque également un bord rectiligne oblique, un bord se rapportant à la forme Drag. 24/25, un pied pointu et un autre pied, massif et plat, appartenant à un grand plat, On note les marques suivantes:
- ATE (ATEIVS, cf, Oxé Comfort 144), dans un rectangle central, pour une coupe Coud. 38 (fig. 106, n° 8) ;
- ATOOILI (CN, ATEI ZOILI, cf. Oxé Corn· fort 180), dans une croix centrale à quatre branches en queue d'aronde, pour un fond de coupe Oediamè· tre inférieur du fond, parfaitement plat, est de 7,4 cm) (fig. 106, n° 9),
Les sept fragments de sigillée du sud de la Gaule (moins de 0,4 %) livrent un bord de forme Drag, 24/25, un de Drag, 27, un de Drag, 29, un fragment appartenant à un bas de panse d'une grande coupe, un fond d'assiette et un fragment in· forme décoré d'oves qui correspond, vraisemblable· ment, à une forme Drag, 37.
Avec ce dernier élément, la datation de cet ensemble ne peut donc être antérieure au début de l'époque flavienne, Cette chronologie est nettement confirmée par la récolte de deux autres tessons.
Le premier (fig, 39., n° 1), un bord de cérami· que africaine de cuisine (forme Atlante CVI·7jIO", d'une forme connue à Ostie dans un con texte fla· vien, appartient à la première vague d'importation de ce type de céramique et se rencontre, sur notre littoral, dès les années 50/60.
Le second, un fragment de carène de sigillée claire A (peut·être de la forme Lamb. 1/ Hayes 8), fixe le terminus après les années 80/90, qui carres· pondent à la construction de l'aile sud et du cellier adjacent.
La couche llc, le contrefort de la future pièce XII : (fig. 40 et 41) (L. Rivet)
L'instabilité du sol, sur cette pente méridio· nale de la butte, conduisit à renforcer l'angle inté· rieur formé par les deux ailes de la galerie: comme on l'a vu, un massif de maçonnerie vint raidir l'articulation entre les deux ailes, alors que le cel· lier (pièce XIIn et les deux niveaux superposés de galerie étaient en service (fig, 22). Il fallut aussi conforter, de l'extérieur, le mur sud de la galerie (mur 28) dans l'angle qu'il formait avec le mur ouest de la salle XIII (mur 45), Il s'était considérable· ment déformé dans son tracé et s'était aussi dé· versé vers l'extérieur, de l'ordre de 0,20 m pour une hauteur de 1 m dans l'état dans lequel il a été retrouvé, Un contrefort, assez médiocre, fut alors conçu, Il a été conservé sur une hauteur de 0,60 m environ, avec un arasement cote à -2,60. De plan très irrégulier, approximativement trapé· zoïdal, il occupait 1,90 m d'est en ouest et 1,20 m du nord au sud. Ses parements extérieurs n'étaient même pas rectilignes. Localement parementé vers l'intérieur, et encore liaisonné à la terre selon la marque de toutes les campagnes de construction les plus anciennes, il contenait un blocage de terre et de débris de céramique commune accumulés là, en gros fragments de jarres, d'amphores ou d'amphorettes, Il s'agit de rebuts de la production locale identifiée sur le site, qui à eux seuls ne pero mettent pas une datation très précise, mais ren· voient cependant aux premiers moments de l'occupation. Il est donc probable que ce contrefort fut réalisé avant même l'époque de la construction des thermes méridionaux avec des déchets de produc· tian de l'atelier de potier, déchets pris à peu près sur place,
Le remblai qui constitue la couche llc (rem· blai du contrefort nord·est de la pièce XII) a livré un matériel peu diversifié (3101 fragments, cf, tableau de comptage, fig, 40),
(102) A. Carnndini et oW, Atlmlte delle {orme ceramÎche, l, Ceramica fine romana oùl badno meditcrrnnco (media et tarda impcro), Suppl. à Enciclopedia dei Arre Antica, Rome, 1981.
Amphores
o M
00 o N
~----------
Amphorettes
Cer. corn. p. claire
----------cer. culinaire mica.
Cer. corn. p. brune
Cer. corn p. grise
Cer. com. engobèe
lampes
Rouge pom~enne
ParoiS fines
Plombifère
Campamenne
Aretlne
Sud de la Gaule
Alflc. de cUISine
Sig. Cl. A
Claire B
Sig. CI. C
luisante
I----------! 1 • 1 !S\9.CI.D !
Sig. Est. Tard. (OS.P.) !
r x • u ." cc ~
u ] c
Li 0 u
LE SITE ANTIQUE 77
La très grande majorité de ce lot est constituée de tessons d'amphorettes (87 % de l'ensemble) ; un comptage effectué sur les éléments de formes donne une nette supériorité au type 1 (506 éléments de formes, soit 68 %) sur le type II (235 éléments de fonnes, soit 32 %). Nombreux sont les fragments qui montrent des traces de surcuisson.
Les amphores (6,5 % de l'ensemble) ne sont représentées que par des fr. deux Dr. 2/4 (fig. 41, nO 1 et 2) et une Gauloise 5 (fig. 41, nO 3). Cette dernière ne peut autoriser une datation antérieure au milieu du 1" siècle de notre ère, voire au début de l'époque flavienne.
Le reste du matériel n'apporte aucune information notable, puisque cette couche ne contient pratiquement pas de céramique fine. Compte tenu de la pauvreté de ce matériel, la datation peut, bien entendu, être nettement plus récente que le terminus ante quem non suggéré des années 70/80. Ces indices semblent cependant en faveur de l'interprétation selon laquelle ce contrefort fut d'abord un contrefort extérieur avant de se trouver englobé à l'intérieur de la pièce XII.
78 LE SITE DE NOTRE·DAME D'A VINlONET A MANDELIEU
/~.
(-' -. \CJ '-..
'-......-.J
2
3
Fig. 41.- Amphores provenant de la couche l1e.
1/
(/
\,
88 LE SITE DE NOTRE·DAME D'AV1NIONET A MANDELIEU
Fig. 49.- Le bassin froid dan."! son premier état (pièce XV!).
La couche lOb (fig. 50 et 106), état 4 (L. Rivet)
Cette couche, reconnue uniquement dans la pièce XV, contient une forte proportion de matériel atypique (361 fragments, cf, tableau de comptage, fig. 50).Les amphores (28 % de l'ensemble) ne li· vrent que trois éléments identifiables d'une Gauloi· se 5, tandis que les amphorettes (un peu plus de 26 %) sont toujours représentées par des types 1 et II.
La céramique commune à pâte brune est représentée par un bord de cruche à bec trèflé et un bord à marli d'un grand pot modelé.
Parmi les rares fragments de céramique commune à pâte grise, on note quelques tessons de cruche Goud. 1.
La céramique engobée se limite aux coupes hémisphériques et aux coupes carénées à anses,
Ni les lampes ni les parois fines ne donnent d'éléments notables.
L'arétine est attestée par un fragment de bord du service II de Haltern, tandis que la sigillée du sud de la Gaule fournit sept fragments d'une même coupe Drag, 29 (à panse godronnée, la frise étant constituée de panneaux à imbrications hori·
i! ;;; 0
M
~
Amp>1ores 0
~
Am~rettes m
M Cé,. corn. p. claire ~
~
Cé,. culinaire mica
'D Cer. corn. p. brune M
m Cer. corn, p. grise
q
Gêr. corn. engobée M
N Lampes
Rouge pompeenne
~
ParOIS fines
Plombifère
Camp.&nlenna
Aretine
i Sud de la Gaule L _________ _
AlfloC. 00 CUISine
Sig. CL A
Clrure B
Sig. CL C
luisante
1 SigeLO --1 c'--------~
Sig. Esl Tard. (OS.P') 1
,
1 ,
1
@ 1 > o x
LE SITE ANTIQUE 89
zontales ou d'une palissade de bâtonnets inclinés alternant avec des panneaux presque carrés ornés d'un chien courant à gauche) et, surtout, un petit tesson de décor de coupe Drag. 37 (où l'on distingue un fragment de feston et une grappe de raisin). Un fragment de fond d'assiette montre une marque de :\lASCLVS-BALBVS (fig. 106, n° 13) attestée à La Graufesenque pour la période flavienne(!061.
La datation de cette couche est mieux cernée grâce à un bord de sigillée claire Ade la forme Lamb. 2a 1 Hayes 9, qui n'autorise pas à situer sa constitution avant la fin du 1" siècle.
(106) F. Oswald, Indexa! Potiers' stamps on Terra Sigillata (Samian Ware), Margidunum. 1931, p. 193.
94 LE SITE DE NOTRE·DAME D'AVINIONET A MANDELIEU
La couche 10a (fig. 55 et 107), état 5 (L. Rivet)
La réunion des couches de même nature provenant des espaces et pièces XII, XIV et XX fournit, à nouveau, un matériel très fragmenté (689 tessons, cf. tableau de comptage, fig. 55). On ne peut guère plus que pour le contexte qui précède s'attarder sur les objets en céramique commune.
Signalons pourtant: - une lèvre d'amphore gauloise 5 ; - en pâte claire (plus de 40 % de l'ensemble)
un fragment appartenant à un vase à dépressions récupéré en différents espaces etque nous étudierons infra (couche 8, fig. 80, nO 10) ;
- en pâte brune, des fragments de couvercles ou d'ollae ;
- en pâte grise, une cruche de forme Goud. 1 ; - et en engobée, des coupes.
On constate également que la céramique du type culinaire micacée est relativement abondante dans cette couche (plus de 5 %) ; on a uniquement reconnu des ollae .
Trois des cinq fragments de lampe correspondent à un corps ovoïde réalisé en pâte claire (fig. 107, nO 8). Le bandeau est décoré de larges stries grossières ; le médaillon, ouvert vers le bec par un large canal, est orné d'un motif difficile à lire. Cet objet est
1 AmphOres
1 :~~:~ ... Cér. culinaire mICa.
1 1 Cer. corn. p. brune
;Ji !
1 Cc,. <om. p. g'"''
1 ~i l ' M ! Cér. corn. engobee
>-----~"'-l Lampes i
ri _Ro_ug_._",_m_".._,",_ne_~:_l
ParoIs f,nes
1 ca~~_n_.e_n_n. _____ _
Métlne
Sud de la Gaule
Mric. de CUIS''''' N 1
e-------~-, - 1
1 ,
! , M
1 , C:a,re B 1
i 1
, i Sig Cf C
, 1
Luisante
Sig. CI. 0
Sig. Esl Tard. (OS.P.)
t---
• ;' 0
LE SITE ANTIQUE 95
vraisemblablement produit localement.
La sigillée du sud de la Gaule fournit une carène de Drag. 27, un filet saillant de Drag. 24/25, un bord de Drag. 18131, deux bords de Drag. 37 etsix fragments décorés d'un même vase (festons, séparés entre eux par des flèches, dont les plages sont ornées de fleurs. mystica • symétriques).
La sigillée claire A est représentée par un seul fragment guilloché dont on ne peut préciser la forme.
Les trois tessons de sigillée claire B se rapportent à deux formes: Lamb. 41 Desbat 1 (un marli guilloché d'assiette) et Lamb. 9AI Desbat 2 (un fond d'assiette pourvu d'un petit pied de section carrée). La première ne semble pas être attestée avant 1301 140 et la seconde avant 150/160 (mais on ne dispose pas de sites ayant fOurni des datations convaincantes\i.07) •
La mise en place de cette couche paraît donc postérieure au milieu du II' siècle.
(107) Sur ce sujet, cf. A. Dcsbat, Les ctromiques fines rhodaniennes à vernis argileux dites sigilUes claires n et luisantes, Thèse de 3-cycle, dactylographiée, Lyon, 1980, p. 249-252 ; id., Ln sigillée claire B : ~tat de la question, dans SFECAG, Actes du congrès d'Oronge, 1988, p. 91·99.
La couche 9b (fig. 57, 106, 107), état 4 des thermes sud (L. Rivet)
Cet ensemble de matériel, relativement peu abondant (362 fragments, cf. tableau de comptage, fig. 57), est composé, en grande partie, d'objets résiduels, particulièrement en céramique commune.
Seule, en pâte claire, està signaler une coupe! mortier" à listel» décorée à la roulette, dont la plu· part des fragments qui la composent proviennentde la couche 9a (cf. fig. 59, n° 8).
LE SITE ANTIQUE 97
98 LE SITE DE NOTRE-DA.\!E D'A VGlONET A MANDELIEU
------------
Amphores
Amphorone5
Cér. com. p. claire
Céf. culinaire mlC3.
Cer. com. p. brune
COf. corn. p. gll56
,
N
M M N
o M
--------,
Cér. com. engobée
Lampes
Rouge JXlmpéienne
Parois fines
Plombifere
Gampamenne
! Aretine
Sud de la Gaule
Alric. de cuiSine
Sig_ CL A
Clrure B
r-------------
gJ
j Sig. CL C
1-----------· 1 luisante ,1
Sig. CI, 0 i 1
Sig. Est Tard. (OS.?) i
1 1 ?:
I~ '------_----'~ 1 ~ 1
La catégorie des parois fines, outre l'~ fond gris à pâte compacte granuleuse (une proQuction locale ou régionale ?), livre quelques fragments de décors à feuilles d'eau.
Parmi les tessons de lampes on observe un exemplaire (fig. 107, n° 9) assez bien conservé (7 fragments) ; la pâte est claire, très tendre, et la surface ne conserve que quelques traces d'un engobe brun-rouge. La forme se rattache parfaitement aux Firmalampen (le sillon faisant communiquer le bec avec la cuvette du médaillon). Comme souvent sur les exemplaires décorés, le médaillon de celle-ci porte le décor en relief d'un masque tragique, entre deux trous''''''. Le bandeau de bordure est pourvu de trois boutons saillants percés. La facture générale de cette lampe renvoie à une production locale ou régionale dont les prototypes ne peuvent apparaître avant l'époque flavienne. Un fragment de fond, non jointif mais de mêmes caractéristiques, porte la marque en creux CATILC .. (fig. 106, n° 17), sans doute CATILVESTo09'.
On peut identifier trois des quatre tessons d'arétine : un bord de la forme Goud. 28, un bord du service II/IV (proche de Goud. 36) et un fragment décoré de bâtonnets, sans doute de la tarda-italique.
A côté d'un bord de Drag. 18/31 et d'un fragment de frise orné de rinceaux de Drag. 29, la sigillée du sud de la Gaule est représentée par de la vaisselle d'époque flavienne : un marli décoré de feuille d'eau de Drag. 35 et trois fragments de décors empâtés et peu lisibles de Drag. 37 qui correspondent à une production de l'extrême fin du lu siècle ou du début du II'.
(lOB) S. Locschkc, Lampen (lUS Yindon issa, Zürich, 1919, pl. XVIII, nQ 987 ; L. Lernt, Catalogue des collections or· chéologiques de Besançon, I. Les lampes antiques, dans Annales littéraires de l'uniuersilé de Besançon, l, 1954, n° 144 ; H. Mcm~el. A'ltike Lampen im Romisch·Germa· nischen Zentralmuseum zu Mainz. Moinz, 1969, fig. 49, n Q 5et6.
(l09) B. Bailly, Essai de classification des marques de potiers sur lampes en argile dans la Narbonnaise, dans Cahiers ligures de préhistoire et d'archéologie, 11, 1962, p. 86, qui ne relève œlle marque qu'à Vienne ct à Sousse.
Cette datation est confortée par un bord de sigillée claire A de la forme Lamb. la / Hayes 8, qui ne peut se rencontrer avant la fin du 1" siècle, qui semble ainsi le repère chronologique pour la construction des thermes nord, dont l'apparition semble ainsi contemporaine de celle des thermes sud.
La couche 9a (fig. 58, 59, 110), états 5 et 6 des thermes sud (L. Rivet)
Le matériel de cette couche (535 fragments. cf. tableau de comptage, fig. 58) n'a été récolté que dans la seule pièce x,'IU, dans les cendres du praefumium. A l'inverse des couches 10 et 9b précédentes, des formes nouvelles apparaissent dans ce contexte, mais la plupart du matériel semble résiduel, comme on peut le constater avec les quelques exemplaires présentés.
On a retenu trois lèvres parmi les amphores: l'une correspond à la forme Dr. 2/4 (fig. 59, n° 11), avec une pâte rouge, l'autre vraisemblablement à une Dr. 7/11 (fig. 59, nO 10) avec une pâte beige incluant des grains de dégraissant blancs et noirs; la troisième (fig. 59, n° 12), à bandeau, avec une pâte jaune clair micacée, est, peut-être, d'origine marseillaise"lO'. Une pointe de Dr. 20 est également présente.
En céramique commune à pâte claire, on retrouve de grandes coupes; une d'elles (fig. 59, n° 9), à bord élancé, semble être une évolution de la coupe/mortier. à listel. très fréquente dans les couches antérieures, que l'on retrouve encore avec cet exemplaire grossièrement décoré à la roulette (fig. 59, n° 8). La coupe à marli/collerette (fig. 59, n° 7), en revanche, paraît être une nouveauté, ce qui n'est pas le cas du pot à lèvre en bandeau (fig. 59, nO 6) muni d'un!, (ou deux ?) anse(s) à poucier ou de ce col de cruche (fig. 59, n° 5) à lèvre triangulaire (connu à Vindonissa ou sur le site des Aiguières, à Fréjus, avant le milieu du 1" siècle). Notons enfin
1110) G. Bertucchi, Fouilles d'urgence et ateliers de potiers sur la bUlle des Carmes à Marseille, Les amphores, dans Reuue archtologique de Narbonnaise, t. XV, 1982, p. 135· 160.
AmphQres
Amphoreft6S
M '0
"-Ur, corn. p. claire 0,
cer. culinaire mlC6.
Cer. corn. p. brune
Cer. corn p. grise
Cêr. corn engobée
Lampes
Rouge ~mpèienne
ParOIS fines
Plombifère
Campamenne
Arêtine
Sud de la Gaule
Afne. de CUISine
Sig. CL A
CIMe B ,--------
Sig. CL C f--- -----
luisante
Sig. CI. 0
,
LE SITE ANTIQUE 99
Sig. Est. Tard. (DS.P.) i --'--1
1 ,
;; , x 1 '---____ . __ ~~.J
100 LE SITE DE NOTRE·DAME j)'AVlNJONET A MANDELIEU
,=t:-------.,. r 11111 IlitllIt"lItu"'" Il IIh. ,,,,, IUll III
1111 111111 Il 8
L _________ J
Flg. 59.- Céramiques provenant de la couche 9a.
cette anse décorée à Cru d'une tête de lion en bas· relief (fig. 110, nO 2) qui provient, sans doute, d'un pot. Sa fabrication locale est vraisemblable.
En céramique commune à pâte sombre, on relève que les ollae en céramique culinaire micacée, très fréquentes sur les sites du littoral durant tout le 1" siècle, ne sont pas absentes, de même que les productions en pâte brune : pots divers, ollae et couvercles.
En pâte grise on peut noter cette ol/a à lèvre de section ronde et à épaulement marqué (fig. 59, n° 4).
La coupe carenee en céramique engobée (fig. 59, n° 2), à bord légèrement rentrant, apparaît pour la première fois dans cette couche. Cette forme,
simple, est peu fréquente: on ne la connaît que sur le site des Aiguières, à Fréjus, dans un contexte daté de la première moitié du 1" siècle. Le fond plat pourvu d'un faux pied dégagé par une gorge (fig. 59, n° 3) renvoie vraisemblablement à une cruche.
En ce qui concerne l'arétine, on reconnaît un bord de forme Glud. 27 et un autre du service III de Haltern.
Parmi la sigillée du sud de la Gaule on iden· tifie deux bords de Drag. 18131, un bord et deux carènes de Drag. 15/17, deux fragments de panse de Drag. 35, trois bords de Drag. 37 dont les oves sont empâtés et trois fragments de fond de la même forme. Ces dernières productions, d'époque flavienne ou antonine, ne fixent qu'un terminus très approxi· matifpour la datation de cette couche.
Un bord de céramique africaine de cuisine en patina cenerognola (fig. 59, n' 1) de la forme Hayes 193, diffusée dans nos régions à partir des années 50/60, ne permet pas d'affiner cette chronologie, se rapportant à l'utilisation des thermes nord.
LE SITE ANTIQUE 101
102 LE SITE DE NOTRE·DAME D'AVINIONET A MANDELIEU
La couche llb (fig. 61) (L. Rivet)
Le matériel contenu dans la couche 11b pro-
Amphores
Amp/1oretles
Cèr. corn, O. clalfe
Cêr. Culu"Ialre mica
Cêr. COrn. D. orune
Cer. corn D. grise
Cêr. corn, erçobee
Lamoes
Rouge oompélenne
Parois "r~s
Plombl'ère
Carnpanlen'1e
Arétlne
Sud de la Gaule
AfrtC. oe CUISI!"e
S'9 CL A
S'9 Cl. C
lUisante
Sig. CI. 0
~---~_.
,
! Sig Est Tard. (OS P l
u x ~~~-
vient exclusivement des terres coffrées dans ce contrefort X et constitue un lot très réduit (73 fragments, cf. tableau de comptage, fig. 61).
Les quelques fragments d'amphorettes des types I et II et un tesson de parois fines ne permettent pas de préciser une datation nécessairement postérieure au milieu du IH siècle de notre ère.
La couche 8 (fig. 76 à 81, 106 à 108 et 110), état 7 (L. Rivet)
La couche 8, telle qu'elle est présentée ici, regroupe les terres de décombres fouillées dans les pièces XII, XV, XXI et XVII, XIV, XX et XIX. Si ces différents ensembles sont bien synchrones du point de vue de l'évolution chronologique de la villa, au plan du matériel une grande disparité apparaît d'un espace à l'autre. Dans la plupart des cas les objets sont très fragmentés, incomplets et d'un médiocre intérêt. Une pièce cependant, la pièce XX, livre une quantité appréciable de vases entiers, ou
Fig. 75.- Tuile écrite prm'enant de la destruction des thermes sud,' cliché CNRS, CHÊNE.
presque entiers, qui dénotent, sans nul doute, une couche d'occupation avec céramiques (( en place J),
Ces faits sont en partie confortés par la série de collages réalisés d'une pièce à l'autre: ils sont relativement nombreux mais concernent peu les tessons provenant de la pièce XX ; entre XII et XV (4 cas), entre XII et XIX (1 cas), entre XIV et XIX (4 cas), entre XIV et XX (3 cas). D'autres raccordements impliquent des espaces qui ne sont pas pris en compte pour cette couche: entre la pièce XII et son contrefort nord-est (10 cas), entre XVI-XVII et
XVIII (3 cas), entre XIV et XIII (4 cas), entre XX et XIII (1 cas) et entre XVIII et XIX (3 cas). On a décompté 6 010 tessons dans l'ensemble de la cOuche 8 (cf. tableau de comptage, fig. 76).
Les amphores (25 % de l'ensemble) fournissent une lèvre, une anse et une pointe de Dr. 20. Les Dr. 2/4, également par morceaux isolés, comptent une lèvre, un col et cinq anses. Les productions gauloises sont quantitativement plus importantes et leurs formes mieux conservées, comme cette G. 4
] ;:: n ~ M 0 " ~ ~ 0 c. ~ ~ ~ ~ S' 0
w o
; ~res '0 m ~ ~
~ " Ol P- ro m " N ~ q ~
w ~ N '" q q m
" ~ ~ N ~ M ~ ~ M N M ~
Cê(. com. p. claire m ~ m w ::! U; ~
" ro ~ ro N ~ N ro ~
;' ~ ro N q ro ~ ro
CM. culinaire nllC8. __________ 0 ___
COr. corn. p. blune
ro w 0 :; ~ ro ro M ~ N m q m
N
ce,. com. p. gnse N N q ~ w w q
N M q M
'" -----_.,
~.com_ engobée ~ ~ :'C N q " ~
M ;' ro ~ N
~ q ro m N N "
, ..... 0 <t ....
Rouge pompéienne
ParoiS fines
P\ombifète
Arérine
Sud do la Gaule
.~-------
..... N .- N <.Cl
Afnc. do CUISine
---------m CI) N 0) N O'l
1 Sig. CI. A N q
-------,
Cj&Jro B ,... (") ~ :;:; ;!
-------+I----~~-~ 1 ..... <:0 ""
Sig. CI. C 1 1
:l lUÎ$8nte ! ,
i 1
Sig. CI. 0 1
i ,
,
Sig. Est Tard. (OS.P.) 1
1
, 1 1
1
~
fO 0
ro > ;; > x x r-U x x x xx x
I.E LIEU DE CULTE DE L'ANTIQUlTÉ TARDIVE ]·i7
(fig. 77, n' 1) ; on totalise neuf autres lèvres de lu même forme; la forme G. 5 est attestée parsix lèvre, (fig. 77, n° 2). Une amphore, enfin, de forme Dr. 71
Il (fig. 78), à pâte blanchâtre, est pratiquement entière (provenant de la pièce XV).
Les amphorettes des types 1 et Il représentent 26 % du matériel.
Outre un nombre important de tessons informes, la céramique commune à pâte claire (près de 30 %) livre une grande variété de vases décorés de quatre manières différentes: J'incision qui orne lourdement ce cratère extraordinaire (fig. 79, n' li aux anses tarabiscotées (provenant de l'espace XX, à moitié complet et reposant, sans doute, Sur un piédouche) ; l'impression au doigt, qui s'applique exclusivement aux filets saillants de grands récipients de formes très incomplètes (fig. 79, n' 2 et fig. 80, n° 13, 14 et 15), provenant tous de la pièce XX; la roulette, qui oblitère des coupes (fig. 80, n'Il et 12, même provenance) ; les dépressions très régulières réalisées sur cette coupe très évasée (fig. 80, n° 10), par esthétisme peut-être et sans doute, aussi. pour imiter la vaisselle métallique.
Un oiseau modelé en céramique commune à pâte claire se rattache sans doute à cette production un peu particulière (fig. 110, n° 3) ; la trace d'arrachement qu'il présente sous le ventre permet de l'assimiler à une préhension de couvercle.
On ne sait comment dénommer ce vase aux parois épaisses (fig. 79, n° 4), à la base duquel on a fortement imprimé le bout du pouce ou d'un doigt à quinze reprises (entier, provenant de la pièce XX également).
Les productions plus classiques sont re· présentées par ce grand pot à marli horizon· tal (fig. 79, n° 3) ou par des cruches à fond plat (fig. 80, nO 8 et 9), l'une en pâte sableuse et à panse trapue, sunnontée d'un col court avec lèvre de section triangulaire (provenant de la pièce XX), l'autre à panse piriforme. Une petite coupe hémi· sphérique (fig. 80, n° 7), pourvue d'un fond sur pied annulaire obtenu par évidement de la pâte, sem· ble imiter les productions de céramique engobée
148 LE SITE DE NOTRE·DAME D'A YINIONET A MANDELIEU
î
2
Fig. 77.- Amphores de la couche 8,
déjà abondamment rencontrées dans les couches antérieures, Une série de bords rectilignes et ren· trants (fig, 80, n° 1 à 6) et des fonds associés de même facture (les uns et les autres provenant de la pièce XX) permettent de restituer, graphiquement (avec une certaine marge d'erreur), des petits pots de forme très originale (en forme de tulipe, à la manière de nos verres à cognac) ; cette forme ne se rencontre sur nul autre site de la région (ni même ailleurs).
On relève, enfin, des coupes à bord légère· ment rentrant (fig, 81, nO 16 et 17) et un petit pot à une anse (fig, 81, nO 15),
Les tessons de céramique culinaire micacée, plus nombreux que dans les couches déjà abordées (près de 1,5 %), livrent quelques éléments de formes correspondant à des oline,
Les tessons en céramique commune à pâte
ln ID, :,'
" " :'
":''u~/I
8
9
-, -",- \
'. 1:
, 1 /
'b~1:::::r!/ 2
l , 10
i'Hllliliilliiiiih'"'U"""""'"7
lu."-",·",-",,,·t'i iiii ..... "',"ltl., JlI ..... IIII., t " IIU ....... IfIl .... ~
~ iii il ;;i i iMi" i;l; 1 i Ho;", IW;;; 1 i HI;;;;;; i, ."" ............................ , .... ,. ... ~fllII"'''"''''''''',''''II'''''''':7.. Il , ...... " ............... " .... , .... u ... "
.:n::::H~n:::::I: ::aln.
14
15
Fig. 80.- Céramiques de la couche 8.
n If 'II 2
3
9
7
& , ! =t
'1-:EI10 13
~/ 14
-e 11
15
I~ 23 16
12 t=r: ) 17
Fig. 81.- Céramiques de la couche 8.
brune (5 %) fournissent, en particulier, à côté de fragments d'ollae, le bord d'une grande marmite à marli (fig. 81, n° 13) et celui d'une autre, de taille plus réduite, à lèvre pendante rabattue vers l'extérieur (fig. 81, n° 14) : la pâte, brun orangé et non micacée, est bien cuite et dure; la surface extérieure cie la panse présente une couverte cendrée proche cie celle que l'on observe sur certaines productions culinaires africaines.
En pâte grise (un peu plus de 2,5 'fo) l'inventaire se réduit à un bord d'olla (fig. 81, n° 11) et à un corps de cruche (fig. 81, n° 12) en pâte gris clair presque blanche et dont ne subsiste que l'attache de l'anse; le fond plat est découpé à la ficelle; la paroi in térieure porte des concretions calcaires (caracteristique systématique des cruches de forme Goud. 1).
Les formes en ceramique engobée (plus de 4 %) sont plus diversifiées, même si les coupes hé-, mi sphériques demeurent omniprésentes, comme en témoigne cet exemplaire entier provenant de la pièce XX (fig. 81, n° 6); l'engobe est parfois brun ou brun-rouge, peu adhérent (fig. 81, nO 7). Certaines de ces coupes sont à bord rentrant, déterminant une ligne de carène en haut de la panse (fig. 81 nO 8) : ;'exemplaire présenté est en pâte jaune clair, assez grossière et très micacée, à la surface duquel on ne distingue plus que quelques traces d'un engobe peu adhérent; d'autres ont un bord pourvu d'une lèvre en amande, comme cette coupe de grande taille (fig. 84, n° 9), à pâte également assez grossière et très micacée dont l'engobe brun est peu adhérent (le dessin donne la restitution graphique de deux tessons non jointifs). En règle générale, la production èst bien moins soignée que celle des objets rencontrés dans les couches antérieures, du fait de la mediocre qualité de la pâte et de l'engobe.
Dans la rubrique des lampes figurent trois objets entiers ou presque.
La première lampe (fig. 107, nO 10), intacte (provenant de la pièce XlV), est réalisée dans une
LE LIEU DE CULTE DE L'ANTIQUITÉ TARDIVE 153
pâte ocre brun, recouverte d'un engobe orange qui a presque entièrement disparu; le réservoir, parfaitement circulaire, est prolongé par un petit bec rond (proche du type Deneauve VIIID) ; le décor est peu lisible, la lampe étant sans doute le résultat d'un surmoulage; le bandeau porte une guirlande végétale et le médaillon semble représenter une Victoire conduisant un bige (dont on ne voit pas la roue ... ).
La deuxième (fig. 108, nO 11, reconstituée à partir de quinze fragments provenant de la pièce XX), est en pâte jaune clair; les parois sont très épaisses, et la facture générale est très grossière; la cuvette du médaillon, non décorée, est reliée au bec rond et allongée pai- un canal.
La troisième (fig. 108, n° 12, incomplète, constituée de cinq fragments provenant de la pièce XX) est en pâte ocre-jaune; le bandeau, très effacé, a peut-être reçu le décor d'une tresse végétale; le décor du médaillon, incomplet, n'est pas identifiable. Le fond porte, en creux, la marque ANNISER (fig. 106, n° 18), connue à Bouc-Bel-Air (Bouchesdu-Rhône) et attestée, sous la forme ANNI SER, à Marseille, Arles et Vienne""'; cette marque est égaIement connue en Tunisie sous la forme ANNI SE(l38},
Un médaillon isolé (fig. 108, n° 13), couvert d'un engobe brun orangé, représente un animal courant vers la droite.
L'arétine livre un bord de Goud. 37 et, sur le fond d'une petite coupe (Gaud. 27 ?), la marque (fig. 106, n° 10) de XANTHI (XANTHUS, cf. Oxé Cam fort 177), dans un rectangle central.
En nous limitant aux formes de sigillées du sud de la Gaule dont la production ne peut être antérieure à l'époque flavienne, on compte quatre marlis décorés de feuilles d'eau de forme Drag. 35/ 36 et treize éléments de Drag. 37 dont trois bords; les décors identifiables montrent des impressions
(137) B. Bailly, op. cit., p. 81 ct 82, qui situe l'existence de cct Annius dans la seconde moitié du II' siècle plutôt qu'au début du III', fl38) J. Dcncauve, Lampes de Carthage, Paris, 1974, nO 365, sur une lampe de type IVA.
154 LE SITE DE NOTRE·DAME D'AVINIONET A MANDELIEU
très empâtées dans un panneau coupé (un cas).
On a illustré (fig. 81, n° 4 e(5) les deux coupes Hermet 23 (sans bec· verseur conservé) dont la fa· . brication est également postérieure à 70, pour montrer, avec l'une d'elles, le profil peu commun du pied, large et plat. Toutes deux présentent une surface mate et non lissée.
Les fragments d'africaine de cuisine se répartissent comme suit: trois de patina cenerognola l Hayes 197), deux d'orla anllerito (Hayes 196) et un de Lamb. 10/ Hayes 19.
Les fragments de sigillée claire A sont relativement peu nombreux. On a pu identifier vingt-etun tessons de la forme Lamb. lOA ou BI Hayes 23A_ ou B (mais dix-sept de ces fragments permettent de reconstituer la moitié d'un Lamb. lOB IHayes 23A, provenant de la pièce XII), six bords de Lamb. 21 Hayes 9, un marli à feuilles d'eau Lamb. 41 Hayes 213, cinq bords Lamb. 3b1 / Hayes 14/15 et un marli Lamb. 23 / Hayes 6.
Plus abondants sont, en revanche, les tessons de sigillée claire B. On relève, san s compter les fragments informes, sept tessons de vases fermes et une anse. Les autres ont contribué il reconstituer trois formes:
- La première (fig. 81, n" 1) est une assiette à fond plat (en fait, légèrement concave) de forme Lamb. 9B / Desbat 3 (neuf fragments provenant de la pièce XX) dont la production ne semble poU\'oir être antérieure à 160(139),
- La deuxième (fig. 81, nO 2) est une assiette, à fond pourvu d'un petit pied de section carrée, de forme Lamb. 9A / Desbat 2 (vingt-sept fragments, dont treize proviennent de la pièce x..'{, treize de la pièce XIV et un de la pièce XIII) qui ne semble pouvoir être diffusée avant 150/160(1·,,,,-
(139) A. Dcsbat, US céramiques filles rhodaniennes ... , p. 25:1-040) A. Dcsbat, op. cit., p. 25L
- Le troisième objet est une coupe hémisphérique décorée, du type Drag. 37 (fig. 81, n° 3 et fig. 110, n° 4). Elle est reconstituée à partir de sept fragments provenant de la pièce XX et d'un fragment provenant de la pièce XIV. La pâte est jaune orange clair, fine et tendre; les surfaces intérieure comme extérieure sont revêtues d'un engobe orange foncé non grésé assez bien adhérent. Le décor de la frise représente une course où alternent le lion et le chien, courant vers la gauche; ces motifs, comme les oves ou la 1 igne de bâtonnets, sont nettement imprimés. En l'état actuel des connaissances, rien ne permet de rapporter sûrement cet objet à la sigillée claire B (il n'existe aucune comparaison pour les motifs décoratifs) - ni à aucune sigillée du sud ou du centre de la Gaule; tout, cependant (forme -Lamb. 37/ Desbat 14 -, pâte, engobe, type de décor) le rattache aux productions rhodaniennes du III' siècle,:·ol.
Quelques fragments de sigillée claire C permettent de préciser la datation de cet ensemble. Un tesson, informe, provient de la pièce XII ; sept autres, de forme Lamb. 40/ Hayes 50, proviennent de la pièce XIV. La présence de cette céramique interdit de dater l'ensemble de cette couche avant les années 230/240"">'
(141) A, Deshnt, op. cit., p, 267-268; sur ce sujet, cf. l'gaIement A. Vernhet, Les dernii"fCs productions de ln Grnufesenque et la question des sigillées claires n, dans Figlina, t. 2, 1977, p. :13-49.
(142) J. W. Hayes, Late Roman Poitery, Londres, 1972, p. 69-73.
156 LE SITE DE NOTRE. DAME D'A VINlONET A MANDELIEU
La couche 5a (fig, 83) (L, Rivet)
Le matériel de cette couche provient exclusi· vement de la pièce XVIII et renferme une forte proportion de céramique résiduelle.
Seuls les cinq tessons de sigillée claire D pero mettent de mettre cette couche en rapport avec la couche 5. On trouve un fragment de carène qui doit correspondre à la forme Hayes 58 ; un fond plat à gradin (impossible à rattacher à une forme) est également représentatif des productions de la pre· mière génération, comme le marli à gorge Hayes 67, forme commercialisée à partir du milieu du IV' siècleC I43).
La disparition des bâtiments nord
Les thermes nord avaient également dispa· ru, dans une limite de temps comparable à celle qui est indiquée pour la désaffectation des thermes sud, Les données sont ici plus sommaires en raison de l'arasement complet de l'élévation et de l'absence d'une véritable couche de destruction, Un mince niveau noir, continu, recouvrait les sols de tuileau des hypocaustes et les murs arasés. Elle ne fournit pas une datation très sûre, Une monnaie d'Aurélien (cat, n' 24) donne seulement une approximation dans la datation,
Le problème essentiel reste de savoir si, dans ce contexte, le bâtiment d'habitation subsistait et dans quel état, Rien de très concret ne permet d'imaginer ce qui se passait alors au sommet de la butte, La permanence d'une occupation profane est vraisemblable, C'est sans doute une des lacunes les plus regrettables pour l'étude de ce site que l'on soit incapable de déterminer très précisément dans quel environnement s'effectua l'aménagement du lieu de culte. Quelques arguments seront explicités incli· nant à penser qu'il n'était pas isolé et se rattachait à un habitat qui existait encore sur la butte,
(143) J, W. Hayes, Late Roman Pottery, Londres, 1972, p, 112· 116.
~ ,
1: g ~ ! ~ 1
l ' ________ • __ 1
, 00 1 1 (\, ,
Amphores
------·--1 ~
Amphorettes
~
Cér. corn. p. claire ~ i 1
~i Cilr. culinaire mica.
! 1
Cér. com. p. brune ~ !
- 1
Cér. com. p. grise
M ,
Cér. corn. engobée --_ ..• --'._,
Lampes
Rouge pompéienne
Parois floos
Plombifère
Campanlonne
Arétine
N ;
Sud de la Gaule
Alric. de cuisine
-------.----. _. -9
Sig. Cl. A
---. ---------+---'
Claire B
Sig. CI. C
;; x
LE LIEU DE CULTE DE L'ANTIQUITÉ TARDIVE 169
La couche 7 (fig. 91) (L. Rivet)
Cette couche contient une faible quantité de matériel (241 fragments, cf. tableau de comptage, fig. 91).
On ne repère, parmi les tessons d'amphores, que deux lèvres de Gauloise 5.
Les amphorettes, habituellement toujours présentes en proportions importantes, sont quasiment absentes,
Les céramiques communes ne fournissent aucun tesson d'un réel intérêt.
C'est la catégorie des céramiques à parois fines qui se distingue, et pour deux raisons, D'abord parce qu'elle est quantitativement très importante (20 % de l'ensemble du matériel !), avec des fragments décorés de feuilles d'eau ou de fins guillochis; ensuite parce qu'elle livre un gobelet entier (reconstitué à partir de 17 fragments), de forme Mayet XXXVII, décoré, à la barbotine, de feuilles d'eau; ces importations ibériques sont très répandues sur le pourtour méditerranéen durant la seconde moitié du 1" siècle.
En arétine n'a été recueilli qu'un seul fragment, sans doute un élément de panse de forme Gaud. 27.
La sigillée du sud de la Gaule livre deux bords de Drag, 37 et deux tessons portant un décor, l'un d'eux très empâté, vraisemblablement de la période de décadence.
Un bord de sigillée claire A, de forme Lamb. 2a / Hayes 9, confirme que cette couche ne peut avoir été constituée avant la fin du 1" siècle, voire beaucoup plus tard,
Mais la date de J'utilisation la plus ancienne du lieu de culte est cependant mieux suggérée par
"" ..., 0
'.',
-
~I
If '"
'" -~
-I
'" "
>
'" >
"
" >?
~
" "
" "
" >
>
f.j
",
. 10
"
'" .-
~
c ;;;.
0-
• •
~
~
o·
~
•. 3
3 ~.
~
il
c 3
~
.'
[J)
m
p "
" p
~
3" 3
;;
~
&
n n
n n
n §-
".
~ ·
~ .-
1< 0
0 li
" •
0 0
0 c
0 0
~
" '"
>
.. "
'" ~
1l
· 3
3 ?
~.
? "
;;; -<
0
n 0
" ;:
~
• •
c C
l ,
· 3
0
" "
~.
" ~
Cl
B-iO
• ,
~ .
.3
n lO
IAi
'" ;:
c •
0 ~
,,-3
" .-
~ c
Z
ô ~
~ ,
~ "
'" ,
0 0
C.7
:0
0
;;l
..
1 25
1 24
1 1
'" X
III
2 4
8
22
31
85
1 2
43
b L
--.
1 1
~ --
--_
.. _-
Cl
Fig
. 9
1.-
Nom
encl
atu
re d
e la
cér
amiq
ue
pro
vow
nt
de
la c
ouch
e 7
; co
mpt
age
pa
r te
sson
s.
;.; ~ 0 ~ '" :>- '" ~ '" r t;l
c::
1-----
--1
---"
'" ~
~
~
" if
>
>
if>
>
" ~
" lJ
~
" "
" "
" >
>
.o
' c
.-", .
if
c
;;;.
• •
0 •
• 0
o·
o·
o·
3 3
~.
" ~
S 3
3 il
c 3
~
, .-
, ,
'§-".
m
"
" ;;;
~
g ;;
~
a: n
n n
n n
• ~
~ ~
'" ~
1< 0
0 "
• 0
0 0
c 0
0 ~
0 "
>
.. 2
if
~ 1l
•
3 3
3 5
3
" ;;;
-<
n 0
0 3
• *
• •
c C
l ,
• 0
" "
0 ii
" l'
, ~.
.3
~
;;; n
1 T
OT
Al
• 0
cr
Ô
.-~
0
" 2
3 ,
~. 0
, "
;;; on
, 0
• C
.5
:0
0
----
---
---_
.
X
2 3
20
17
': 1
105
53
76
296
XI
48
3 3
9 8
2 17
13
9 7
25
26
4 X
III
3 23
7
2 1
3 13
8
7
3 56
3 3
237
947
Terr
asse
sud
3
3 6
4 2
10
32
10
1 8
171
Terr
asse
cen
tre
4 8
12
27
6 40
10
12
7
71
36
18
3 4
5
692
5 3
62
15
22
TO
TA
L
111
21
31
1---·'
',-;-r--
;~
6 52
15
17
6
.~~ _. __ =
-__ ~ __ .~. 5~ _
~600J
__ 6
81
70
S 1
3200
-
.. _-
----
----
----
----
----~
Fig
. 9
2.-
Nom
encl
atu
re d
e la
cér
amiq
ue
pro
ven
an
t d
e la
cou
che
5;
com
pta
ge
pa
r te
sson
s.
le matériel issu du premier sol d'occupation de l'allée centrale.
La couche 6 (fig. 114, tableau récapitulatif) (L. Rivet)
Sept fragments de céramique seulement ont été collectés dans la couche 6.
Deux fragments informes de céramique commune à pâte brune, un de céramique engobée et un petit tesson de lampe ne fournissent guère d'infonnation.
Trois fragments de sigillée claire C, en revanche, donnent un butoir chronologique. Il s'agit de trois minuscules (le plus grand mesure 16 mm de long sur 10 mm de large) rebords de marli d'un vase très fin (2 mm d'épaisseur) ayant un diamètre de 10 cm environ (fig. 110, n° 5). Chacun de ces rebords porte un élément de décor moulé qu'il est impossible de lire. Une telle production ne peut apparaître avant le dernier quart du III' siècle""'-
Par ailleurs, le moment de la transformation liée à l'ultime utilisation du lieu de culte ne semble pas très éloigné du moment de son abandon définitif.
La couche 5 (fig. 92 à 94, 106, 108 et 110) (L. Rivet)
Une proportion importante (peut-être plus de la moitié) du matériel céramique rassemblé dans cette couche est résiduelle (3 200 fragments, cf. tableau de comptage, fig. 92); un certain nombre de formes nouvelles apparaissent cependant, outre
LE LIEU DE CULTE DE L'ANTIQUITÉ TARDIVE 171
celles de sigillées sur lesquelles nous insisterons.
Le matériel provient des piècesXl,XnI,XVIn, XXI, XXII. Des collages ont été réalisés avec d'autres pièces, XVIII etXVI (1 cas),XVIII etXlX(3 cas), et entre XXI et les terres de la couche 14 sousjacentes â la terrasse argileuse (1 cas).
Les amphores (22 % de l'ensemble) livrent quelques tessons de Dr. 2/4, deux lèvres de Dr. 20, dont une (fig. 93, n° 4), sans doute, du n' siècle""', six lèvres de G. 4 et quatre de G.5. L'exemplaire ie plus récent, non antérieur aux années 230/250, est, sans nul doute, une lèvre d'amphore à huile Mricano piccolo (fig. 93, n° 6j1<6'. Un col â pâte beige micacée, sans dégraissant visible, se rapporte peutêtre à la fonne Pompéi VII (fig. 93, n° 7). Un autre (fig. 93, nO 5) reste non identifié: la pâte est bien cuite, cassante, de couleur brun-rouge, l'âme étant grise: on discerne facilement de grosses inclusions blanches et de nombreuses paillettes de mica.
La seule observation à faire à propos des amphorettes est que les fragments recueillis sont très peu nombreux dans ce contexte (à peine plus de 2 %).
La céramique commune à pâte claire (exactement 50 % de l'ensemble) fournit des vases de réserve (fig. 93, n° 1,2 et 3) à bord droit ou à marli. Certains tessons (fig. 94, nO 25) laissent supposer des constructions très élaborées. On retrouve égaIement quelques objets décorés soit à la roulette (fig. 94, n° 22 et 23), soit d'incisions (fig. 94, n° 24). Tous ont des pâtes nettement micacées, et les formes ne peuvent être confondues avec les productions de l'Antiquité tardive""'.
La céramique commune à pâte brune est
(144) Les auteurs s'oœordent à faire npparattre ces formes décorées un bon dcmi-sibde après les formes lisses, cf. J. W. Hayes, op. cit., p. 75.78, pour la forme Lamb. 35/ Hayes 52B el, pour le mOrne type de forme, cf. Atlante, p. 156-163, plus spécialement p.162.
(45) Cf. S. Martin-Kilchcr, Les amphores romaines à huile de Bétique .... n° 21/29. (146) C. Panclla, Le anfore nfricane della prima, media el tarda elà impcriale : Tipologin e problcmi, dans Actes du colloque sur la
céramique antique (Carthage 23·24 juin 1980), CEDAC, Dossier l, 1982, p. 173·174. (147) Cf. M. G. Fulford, D. P. S. Pcncock, Excavation at Carthage: the Bn"tish mission. The Avelllle of President H. Bourguiba,
8alambo, Sheffield, 1984, p. 217-224.
172 LE SITE DE NOTRE-DAME D'A VINlONET A MANDELIEU
1------,''' - ". ".
, 1 , , 1 , ,
1 1 , , , 1
1 . , ,
1 1
, ) , , 1 1 , ,
" , , 1 1
5 , 1 1 1
, 1 1 , 1 1 Il 1
6
Fig. 93.- Céramiques de la couche 5.
3
/' ( ~.
Je, \ ; 1 , , 1 , , 1 , , , ,
1 , \ \
1 1 1 1 1 1
1 1 1
1 , 1 \ 1 ,1
, \
1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1
7
17
19
25
18
22 =-1'. =w ........ . f ? ..
. '. ."- 21
, ~"""t .. -.:7 23
Fig. 94.- Céramiques de la couche 5.
174 LE SITE DE NOTRE·DAME D'AVINIONET A MANDELIEU
abondante (un peu plus de 10 %), Un bord de plat à oreilles, qui est issu des productions locales (des ratés de cuisson ont été récoltés dans les couches du 1er siècle°.(S), est présent dans cette couche; nous en donnerons le dessin dans la couche 4 (fig. 96, n° 5, 6 et 7), Les autres objets se rapportent à des vases à pâte micacée, ol/ae à épaulement (fig, 94, n° 17 et 18) ou mannites à panse carénée (fig. 94, n' 19),
On ne remarque pas, dans la céramique culi· naire micacée, de productions nettement différen· tes de celles du 1" siècle; un plat de cette époque, aux trois quarts complet (fig. 94, n° 16), a été recupéré, Était·il encore en usage à la veille de la constitution de cette couche?
Tout à fait résiduels sont les tessons d'ol/ae ou de cruches (fig, 94, n° 15), comme ceux de forme Goud,l (16 fragments), que l'on retrouve en cérami· que commune à pâte grise,
Les coupes à lèvre en amande, produites en céramique engobee, sont à placer à la suite des objets de même type, déjà rencontrés et qui sont issus du Il' siècle: une est réalisée en pâte finement epurée, revêtue d'un engobe mince bien adhérent (fig, 94, n° 13); l'autre, avec une pâte pius grossière, présente un engobe mal conservé (fig, 94, n' 12) ; la dernière, enfin, est en pâte grossière, très micacée, l'engobe étant peu adhérent (fig, 94, n' 14),
A côté d'un fragment de bec à volutes et d'un médaillon représentant un lapin UÏg, 108, n" 14)" ''', on repère dans les lampes un fragment de fond marqué (fig, 106, n° 19), en creux, ",) ORVRS ; il s'agit de C(aivs) COR(nelivs) VRS(vs), connu aux Pennes·Mirabeau (Bouches·du·Rhône), à EI·Djem, Thina et Pouzzoles'lSo),
Le bord droit légèrement évasé d'un petit pot en glaçure plombifère est trop petit pour être ratta-
(148) Cf. L. Rivet, Un atelier de potier .... p. 121.122.
ché à un numéro de fonne (fig, 94, n° Il) ; l'inclinai· son et le diamètre sont, d'ailleurs, imprécis. La glaçure est verte à l'intérieur comme à l'extérieur,
Seul tesson de ce type ayant été récolté sur le site, un bas de panse de gobelet moulé dit de Corinthe: la pâte est jaune clair, et l'engobe orange est parfaitement conservé à l'intérieur, à l'état de traces à l'extérieur; le décor, très fragmentaire, est très effacée et figure, peut·être, une scène de chasse (fig, 110, n° 6), On situe ces productions entre ie milieu du Il' siècle et la fin du III''''''.
En arétine on reconnaît un bord du service II et deux fragments de carène de forme Gaud, 28, ainsi qu'une marque centrale (fig. 106, nO 11) sur fond de petite coupe, LNP : L,N(OVNIVS) PO sans doute (cf, Oxé Comfortl074),
Sans insister sur les fonnes préflaviennes en sigillée du sud de la C ,uie, on compte onze éléments de Drag, 37 (tous les décors se rapportent à la période de décadence) et deux exemplaires de Drag, 35/36, dont une assiette à moitié entière (! avec 9 fragments), Surun tesson de fond d'assiette (fig, 106, nO 14) se lit la marque .,,) RDA(", : vraisemblablement ARDACVS (et non l'association SENISERVSARDACVS), compte tenu du centrage des lettres conservées),
Il est un peu étonnant de trouver dans ces niveaux une forme assez bien conservée (4 frag. ments donnant le bord, la panse et l'amorce du fond, fig, 94. n' 10) d'africaine de cuisine de la forme Hayes 193, a strisce, relativement précoce puis· qu'elle est présente à Pompéi \1521,
La sigillée claire A, très fragmentée, donne les fonnes suivantes: un bord de Lamb. lb ou c / Hayes 8B (non guilloché), deux bords de Lamb. 2a,' Hayes 9A, deux bords de Lamb. 3b1/ Hayes 14115
(149) Décor semblable dansJ. Deneauve, Lampes de Carthage, sur une lampe à bec orné de volutes, pl. XLI, nO 355, et sur une lampe à bec rond, pl. LXXll, n° 769.
(150) Cf. B. Bailly, Essai de classification des marques de potiers ... , p.B7, qui date celle production plutôt du II" siècle que du nI" siècle. (151) Cf. Atlante delle fonne œrnmiche, p. 255 el pl. CXXIX4. (l52) J. W. Hayes, Laie Roman Pattery, p. 207.
(dont une coupe à demi-entière avec48 fragments '), un marli à feuilles d'eau Lamb. 4/361 Hayes 3, trois bords a strisce Lamb. 9a2 1 Hayes 181, un bord de Lamb. 101 Hayes 19, deux carènes de Lamb. 10AI Hayes 23B, ainsi qu'un fragment informe de vase fermé.
Plusieurs formes de sigillée claire B doivent être mentionnées: le bord (4 fragments, fig. 94, n° 7)
d'une coupe hémisphérique Lamb. 81 Desbat 15 (fin II' siècle-III' siècle), un bord à gorge (fig. 94, n' 8) de vase fermé Darton 14A 1 Desbat 66 (sans doute produit dès le milieu du JI' siècle) ainsi que deux fragments de panse de vases fermés, dont un guilloché, une assiette (4 fragments) de forme Lamb. 9B 1 Desbat 3 (forme déjà rencontrée dans la couche 8), largement brûlée, un fond d'assiette à pied (5 fragments) Lamb. 9AI Desbat2 (fig. 94, n° 9) (forme déjà rencontrée dans la couche 10) et un infime fragment de décor moulé.
Un tesson décoré n'a pu être identifié avec aucune production àctuellement connue du sud ou du centre de la Gaule (fig. 110, n° 7l.
La sigillée claire C est uniquement représentée par la forme Lamb. 401 Hayes 50 (quatre objets différents) ; une de ces assiettes, au tiers conservée (avec 23 fragments, fig. 94, n° 6), s'identifie nettement au type Hayes 50A des premières productions(l53l.
Deux fragments seulement, informes, se rapportent à la luisante.
Plus variés sont les éléments de formes identifiables en sigillée claire D : un bord Hayes 182 (fig. 94, nO 1), forme produite dès la seconde moitié du II' siècle, un bord (2 fragments, fig. 94, nO 2) et,
(153) J. W. Hayes, op. cil., p. 69·73. (154) J. W. Hayes, op. cil., p. 93·96. (155) J. W. Hayes, op. cil .. p. 96·100. '156) J. W. Hayes, op. cit., p. 100-107.
LE LIEU DE CULTE DE L',u'ITIQUlTÉ TARDIVE 175
peut-être, une carène (fig. 94, n° 3) Hayes 58, forme produite à partir de 290/300"5<', un bord Hayes 59B (fig. 94, n° 4), forme produite à partir de 320 environ(1"'. un bord Hayes 61A (fig. 94, nO 5), forme produite à partir de 325 environ''''', et un fragment informe guilloché sur la face interne correspondant, ,ans aucun doute, à la forme Hayes 91, connue dès la fin du IV' siècle'''7).Toutes relèvent de la première génération de production de sigillée claire DO"'- Des doutes pèsent, à mon sens, sur la forme Hayes 91 (dans la mesure où il s'agit des variantes A et B, à l'origine de la forme), dont la production pourrait être plus précoce que la fin du IV' siècle(lS9),
L'ensemble de cette céramique, et en particulier la sigillée claire D, nous fixe donc une datation pour la mise en place de cette couche qui pourrait être vers la fin du IV' siècle; on n'observe pas, en etfet, de formes plus récentes de sigillée africaine, celles de la deuxième génération. On est pourtant étonné non seulement de l'absence de sigillée luisante, pourtant abondante dans cette région dès la fin du III' siècle, mais surtout de DS.P. (paléochrétienne), que l'on devrait récupérer en nombre, en principe, dans un tel contexte.
La couche 4 (fig. 95 à 97,106 à 111) (L. Rivet)
Cet ensemble regroupe exclusivement le matériel recueilli dans la pièce XIII (869 tessons, cf. tableau de comptage, fig. 95).
Les amphores (11 % de l'ensemble) recèlent très peu de fragments identifiables, et tous sont largement résiduels: Dr. 2/4 et 20, Gauloise 4 et Gauloise 5.
fiS7) J. W. Hayes, A supplement w Late Roman Pottery, Londres, 1980. p. 515. (158) Association CATHMA, La céramique du haut Moyen Âge en France méridionale: éléments comparatifs et essai d'interpréta
tion, dans La ceromica medievale nel mediterroneo occidentale (Siena·Faenza, 1984), Firenze, 1986, p. 27·50, plus spécialement, p. 36.
(159) Cette chronologie ayant déjà subi. par Hayes et l'ensemble des céramologues, une sensible réévaluation dans le même sens.
176 LE SITE DE NOTRE·DAME D'A VlNIONET A MANDELIEU
Amphores
AmphorClles
C!!r. corn p. claire
Cêr. cullNure mica
a a ~
.. ~ --------_ .. _--;----
Cer. corn. ;) brune
Cer. con1 P. grise
Cèr. corn cn(]obee
lampes
nougc pofT'ooenne
----- .----.
ParOIS 111'(>5
Camp.an;erf1e
Sud de la Gaule
Affle. de CUlSIf'e
Claire B
'" ,~
M
a M
._----.;....-......-.-, 1 -
! Luisante
Sig. CL 0
Sig. Est. Tard. (DS.P.)
1
i
__ ~.JJ
Panni les nombreux tessons (46 %) de céramique commune à pâte claire, on relève quatre objets entiers, vraisemblablement en usage à la veille de la constitution de la couche: une petite coupe maladroitement modelée, intacte (fig, 97, nO 9), une coupe haute carénée (20 fragments, fig, 97, n" 8), une cruche à une anse et bec pincé (fig, 111, na 11) et, surtout, un grand cratère, intact (fig, 96), Un curieux objet a été récupéré: il est modelé, en pâte claire, creux et pourvu d'une languette plate sur le côté (fig, 110, n' 8), Peut-il s'agir d'un fragment d'instrument de musique?
La céramique commune à pâte brune est illustrée par une petite ol/a à anse (14 fragments, fig, 97, n' 2) et des marmites à bord déversé verS l'extérieur et lèvre en bandeau (fig, 97, na 3 et 4),
Par ailleurs, cette couche renfenne trois exemplaires de plats à oreilles (fig. 97, nO 5, 6 et 7, ce dernier étant h .• e restitution graphique) produits sur le site ou aux abords'lf'ô, : les ratés de cuisson récoltés sont particulièrement parlants. On peut s'étonner de ne rencontrer les objets commercialisés que dans les niveaux plus récents des couches 5 et 4.
Les éléments de lampes sont nombreux ; certaines de ces lampes sont représentées par des fragments, d'autres sont intactes. On recense:
- Un bec rond, massif, grossièrement façonné (de production locale ?), en pâte claire et non engobé.
- Un fragment de lampe, en pâte ocre-jaune, recouvert d'un engobe orangé qui a presque totalement disparu; le bandeau (fig, 108, na 15) est décoré d'une guirlande nouée, un thème très fréquent sur le type VIIIB de Deneauve (seconde moitié du II' siècle) ; ce qui subsiste du bec laisse supposer une forme ronde.
- Une anse et une partie de médaillon (3 fragments), en pâte claire revêtue d'un engobe brun. Un
(160) L, Rivet, Un atelier de potiers ... , fig. 4 ct 5.
LE LIEU DE CULTE DE L'ANTIQUITÉ TARDIVE 177
Fig. 96.- Cratère provenant de l'allée celltrale du lieu de culte à mystères, couche 4.
ove est imprimé de part et d'autre de l'anse, sur le bandeau, Le décor du disque (fig, 108, n' 16) represente, peut-être, un amour marchant vers la gauche, Le fond, incomplet (fig, 106, n° 20), présente une marque en creux, :rv1A(. .. , encadrée, au-dessus et au-dessous, par un ove. Il s'agit, à coup sûr, de la
marque MAFR, connue à un seul exemplaire et découvert à Puig des Molins, à Majorque""',
- Un exemplaire presque entier(7 fragments, fig. 108, n° 17), en pâte ocre clair, pourvu d'un engobe orangé peu adhérent, possède un médaillon
'161) J. H. Fernandez, E. Manern, Lucernos romonas dei rnllseo arqueologicode Ibiza, dans l'robajos dei museoarqueologico de Ibiza, l, Ibiza, 1979. p. l:J, nO :17 cl pl. VI. n° 37 ; les auteurs attribuent celte lampe au type Dcnc~nuvc VrrB de la seconde moitié du II' siècle ou du début nI- siècle. Une marque identique cSlégalcmcnt signalée à OSlie, cf. D. M. Bniley, A Calaloglle of the Lamps in the British Museum, vol. n, Roman Lamps made inlloly, Londres, 1980, p. 337.
178 LE SITE DE NOTRE.DAME DA VINIONET A MANDEÙEU
.~
~ \
\ , 1 1 /
! - / ~~~2
8 '<J7 Fig. 9ï.- CéramiqueH de la couche 4.
décoré d'une rosace: le bandeau est plat: la forme est incomplète. Le fond (fig. 106, n' 21) présente une marque, en très faible creux, dont on ne lit que IVe .. ; s'agit·il de IVNI ALEXI, marque fréquente sur le type Deneauve VIlA""'. ou de (Cai) IVN(i) DRAC(onis), connu sur lampe africaine'i6"? En fait, compte tenu de la position des lettres, l'impression que l'on peut ressentir, à la lecture, fait pencher pour une troisième ou quatrième solution: CIVN· DRAC ou CIVNBIT""'.
Les quatre lampes qui suivent sont entières ou pratiquement entières:
- Lampe en pâte jaune clair, non engobée (fig. 112, n' 18); le réservoir est parfaitement rond; anse non perforée; bec cassé mais sans doute rond; médaillon inorné ; bandeau décoré d'une double rangée de globules. La forme pourrait s'intercaler entre le type VI liB de Deneauve,,65', de la seconde moitié du Il' siècle, et le type XlA,,66', du III' siècle.
(62) J. Bonnet, Lampes céramiques signœs, dans Documents d'Archéologie Française, t. 13, 1988, p. 96. (163) B. Bailly, Essai de classification des marques de potiers .... p. 89. (164) Cf. J. Bonnet, Lampes céramiques signées, p. 98, 99 et 108. (65) Par exemple, n° 999. (66) Par exemple, na 1118 ct 1119.
- Autre lampe de mêmes caractéristiques et même description que pour la précédente, la forme du bec rattachant cet exemplaire au type VIllA de Deneauve (fig. 109, nO 19).
- Lampe entière mais fragmentée (fig. 109, n° 20); pâte ocre recouverte d'un engobe orangé partiellement conservé; médaillon inorné ; bandeau décoré d'une triple rangée de globules; bec rond dont le dessin s'engage dans le bandeau. La forme s'apparente plutôt au type VIIlB de Deneauve. Le fond (fig. 106, n° 22) porte une marque, en creux, très empâtée mais lisible ; Al'lNISE (potier déjà rencontré, sur lampe, dans la couche 8f1671; la production est située (mais sur quels critères ?) dans la seconde moitié du II' siècle ou au début du III'.
- Une lampe entière (fig. 109, n" 21), en pâte africaine; forme oblongue ; médaillon circulaire concave, portant Wl décor peu lisible (une tête tournée à droite?); bandeau nettement galbé, orné d'une palme incisée (stries) de chaque côté de l'an se non perforée. Cet exemplaire correspond au type Hayes IN"". La datation s'étend du début du IV' siècle au début du V,()69,.
L'arétine fournit un bord guilloché de Goud.27.
Dix-huit des trente fragments de sigillée du sud de la Gaule permettent de reconstituer une moitié de coupe Drag. 37 décorée d'une scène de chasse, sanglier et chien courant à gauche, séparés par un arboréide flexueux. Une coupe Drag. 27, entière (9 fragments), porte la marque centrale OF VIRIL! (fig. 97, n° 1 et fig. 106, nO 15) ; au fond de cette coupe, tout autour de l'estampille, se développe en grandes lettres un graffita, non lu (fig. Ill, n° 12). Un autre fond de Drag. 27 porte la marque
LE LIEU DE CULTE DE L'ANTIQUITE TARDIVE 179
IVLI.OF de IVLlVS (fig. 106, n° 16).
Les tessons de sigillée claire A, peu nombreux, montrent un fragment strié de forme Lamb. 10A / Hayes 23.
Les cinq tessons de sigillée claire B (à tendance" luisante » ... ) répondent à un même pichet Desbat 67()''', forme typique du III' siècle.
En sigillée claire D, quatre fragments constituent un bord de plat Hayes 59B dont la période de production est à situer à partir de 320. Huit autres fragments participent de fonds plats à gradin (non attribuables à une forme précise) de la première génération de cette même vaisselle.
On note, une fois encore, l'absence totale de sigillée tardive estampée dite DS.P.
Tout autant "'ue les fragments de sigillée claire D, une des lampes entières permet de préciser un terminus ante quem non; la lampe africaine donne également comme butoir les années 300/ 320 ; mais cet objet, fortement usé, a, peut-être, été utilisé pendant une assez longue durée; cela inciterait à placer ce fait archéologique un peu plus tard, vers le milieu du IV' siècle.
(67) Cf. B. Bailly, Essai de classification des marques de potiers, p. 81 et 82. 06B) Pour un type très proche, cf. Allante delle forme œramiche, pl. XCVI--6 avec cet exemplaire provenant de Rnqqadn ; autre
exemplaire semblable dans C. Lyon·Cnen, V. Hoff, Lampes en terre cuite grecques et chrétiennes du muste du Louure, Paris, 1986, p. 97, n° 27, provenant de Sbeïtln.
(169) Cf. J. W. Hayes, Laie Roman Poltery, p. 313. (170) A. Desbat, Les céramiques filles rhodanienlles ... , p. 306.
:88 LE SITE DE NOTRE·DAME D'A VINIONET A MANDELIEU
(181) C. PancHa, Le anfore ofricane ... , p. 176·178.
La couche 3 (fig. 102, 103, 110 et 112) (L. Rivet)
Les 2628 fragments de céramique contenus dans cette couche (cf. tableau de comptage, fig, 102) corresponden t à la fouille des terres d'effondre men t et de destruction des pièces XIII et XIV, Comme souvent dans ces couches de l'Antiquité tardive, la céramique résiduelle tient une grande place. Les amphorettes, certes en faible nombre (5,5 % de l'ensemble), en donnent l'image: non seulement on retrouve les différents types en usage durant la seconde moitié du IH siècle, mais les fragments surcuits et les ratés de cuisson abondent dans ce contexte.
Rares sont les formes d'amphores(18 %) identifiables, mème parmi les conteneurs du haut Empire: quelques tessons de Dr. 2/4 et 7/11. Un fragment de lèvre (fig. 103, nO 9) correspond à une amphore africaine (pâte orange, feuilletée etgranuleuse, surfaces blanches), vraisemblablement une amphore cylindrique de • moyenne dimension .(1'1), dont on peut situer la production dès le IV' siècle.
li ~ N ro 0 N
N ~ w f2 N
~ ro ~
'" '" ~
Amphores '" ~
N ~ W
~ ~ ;': Amphorettes
Sl '" '" Car. com. p. claire ~ ~ N
;: ~ N ~ N
Cér, culinaire mICa.
~ '" '" m ~ ~
Cêr. com. D. brune '" ~
------------_. ~ ~ ~
'" ~ '" Cê, corn. p_ grise
~.
~ 0 ~ , • N W
CA, corn engooee
~ ~ ;: LarPPes
N !
N
Rouge plmpélE1Of1e
:' ~ N N
ParOIS fines
Plombdére
Campanienne
~ ~ ~
Arétine
;: N
i ~ Sud de la Gaule
Aine. de CUISine
~ N W i Sig. CI. A i
l------i ~ ~ ! :;;
, •
1 Claire B i ,
~,
~ ~ ::: Sig, CI. C
luisante ;: ;:
'!! ~ ~ Sig. CI. 0
Sig. Est. Tard. (OS. P.) 1 m '" ~
, 1
i 1
i ~
1 " >-0 1
'" > >- J Li x x
LE LIEU DE CULTE DE L'ANTIQUITÉ TARDIVE 189
A une exception près, rien dans la céramique commune à pâte claire (46 %) ne semble représentatif du contexte tardif de cette couche: coupesmortiers' à listel., coupes à marli, vases fermés avec ou sans anse(s) renvoient clairement aux IH et n' siècles; une coupe à collerette (et versoir?) fait, cependant, exception (fig. 103, n° 8) : un tel profil n'est pas étranger à la sigillée claire D, à la DS.P. ou à la céramique commune à pâte sombre du V' siècle(182). De même rencontrons·nous, toujours, des objets décorés à la roulette. Certains grands vases, pourtant, aux parois épaisses et aux formes louràes, pourraient indiquer une production plus récente. A l'une ou l'autre de ces phases appartiennent ces deux fragments portant un graffita tracé à cru, CCML (?), pour l'un (fig. 110, nO 9) sur une oreille de préhension d'un grand vase (diamètre intérieur à l'ouverture: 34 cm), EDE, pour l'autre (fig. 110, n° 10) sur un marli.
Comme pour la couche 4, on retrouve, en céramique commune à pâte brune (17 %), quelques bords de jattes ou d'ollae qui se rattachent aux morphologies de l'Antiquité tardive; c'est le cas, en particulier, pour ces bords à lèvre pendante(fig. 102, nO 5 et 6)'''''.
Tous les tessons de céramique commune à pâte brune micacée sont résiduels, ce qui est étonnant car il existe (du moins à Fréjus ou aux proches abords) des productions spécifiques au IV' siècle; tout autant résiduelles sont les formes de céramique engobée, comme le sont également les quelques fragment de lampes identifiables.
On retrouve, en arétine, un bord de forme Coud. 38. et une carène de calice et, en sigillée du sud de la Gaule, un marli décoré de feuilles d'eau de forme Drag. 35.
La sigillée claire A est représentée par un bord de forme Lamb. 2a / Hayes 9A, un bord Lamb. 3b1 / Hayes 14, un marli Lamb. 23/ Hayes 6 et un fragment informe strié Lamb. 10MB / Hayes 23.
(182) ASMciation CATIIMA, La céramique du haut Moyen Âge ... , fig. 11, n" 4 ou fig. 12, nO 13.
(183) Cf. Association CATHMA, op. cit., fig. 11, na 3 et 8.
190 LE SITE DE NOTRE-DAME D-A VINlONET A MANDELIEU
~3~~1.~)~ d \
8
1_-L5 4
Jt:=====:::::J:T1
lIa...--------r ...... - ~
5
6
Fig. 103.- Céramiques de la couche 3.
Les formes de sigillée claire B sont, en partie, celles que l'on a déjà rencontrées dans les couches précédentes, 5 et 4 : pour la forme Lamb. 9A 1
Desbat 2, 13 fragments, pour la forme Lamb. 9B / Desbat 3, 20 fragments (auxquels s'ajoutent 10 fragments indifférenciables de forme Lamb. 9A OlI B); on retrouve, également, un fragment de bord Desbat 67 et 4 fragments d'une forme fermée_ Seule nouveauté, un bord Lamb. 2/ Desbat 8 ou 12 (mais, quand le bord se limite à la lèvre en amande, comment le distinguer de la forme Lamb. 1/3 de luisante?) qui appartient aux formes précoces (milieu du II' siècle) de cette vaisselle.
Un bord de forme Lamb. 40/ Hayes 50 représente la sigillée claire C ; les autres fragments, informes, se rattachent sans doute à cette même forme.
La sigillée luisante est attestée par cinq tessons: un bord de forme Lamb. 1/3 et quatre éléments de carènes ou de panses, parfois guillochés, de cette même forme.
(184) Cf. Atlante delle forme ceramiche ... , p. 70·73. (lB5) Cf.l't5tude de J. et Y. Rigoir, infra.
Plusieurs fragments de sigillée claire D correspondent à des fonds plats à gradin des productions de la première génération; ils peuvent appartenir aux deux types de formes récoltés dans la couche: Hayes 59A (1 fragment de panse incisée) et 59B (2 bords). On décompte également une lèvre de cou verele Hayes 182 et, surtout, un fragment courbe de panse se prolongeant par un départ de marli redressé dont la forme et la qualité (surface mate et légèrement alvéolée) renvoient, très vraisemblablement, à une production du type C3, c'est-à-dire aux formes Hayes 71 ou 73, diffusées à partir du dernier quart du IV' siècle ou au début du V'("". Un fragment informe guilloché sur la face interne renvoie à la forme Hayes 91 (déjà rencontrée en couche 5), traditionnellement datée de la fin du IV' siècle.
Dans cette couche apparaissent les premiers tessons (tous gris) de sigillée estampée tardive ou DS.P_(U,). On reconnaît un bord guilloché, vraisemblablement de la forme Rigoir 18, et le fragment de panse d'un grand vase, sans doute une cruche: la
surface intérieure est gris clair, brute de tournage, la surface extérieure est engobée, gris foncé, et montre les traces du broutage de l'outil. On rencontre un autre fragment, décoré de palmettes, appartenant à la panse d'une coupe. On a classé ici huit fragments qui restituent un bord de coupe carénée (fig. 103, n° 1) :
la pâte, micacée, très tendre, a une âme brun rosé et les surfaces sont gris foncé; la forme imite nettement la coupe Rigoir 15b ; un décor (ou un graffito ?), tracé après cuisson, semblet-i1, occupe deux espaces distincts et limités de la surface extérieure.
La sigillée claire D fixe un butoir pour la datation de cette couche, qui ne peut être antérieure aux années 400. L'extrême fragmentation du matériel incite à placer le terminus sensiblement au-delà de cette date, peut-être autour du milieu du V' siècle.
Les couches 1 ct 2 (fig. 104 et 113) (L. Rivet)
Le matériel regroupé ici provient de la fouille des terres superficielles et remaniées des pièces IX, X, XI, XlII, XIV, XX, ainsi que des terres recouvrant la terrasse d'argile (couche 13). Le nombre de tessons ne doit pas faire illusion (14 018 fragments, cf. tableau de comptage, fig. 104) : il s'agit, pour la plus grande majorité, de céramiques résiduelles; parmi les éléments d'amphores, par exemple, on ne note qu'un objet susceptible d'être mis en rapport avec la période tardive! Les sigillées, en revanche, sont plus abondantes, tant pour les importations africaines que pour les productions gauloises en DS.P. ; la liste et l'inventaire de ces tessons ne sont pas inintéressants: ils permettent de dresser un tableau de la diffusion de ces vaisselles Sur le site. Sur le plan chronologique on peut également tirer quelques conséquenc~s, même si, dans certains contextes, ce maté~ riel est mélangé avec des céramiques médiévales provenant de la couche fréquemment remaniée de la nécropole.
1
LE LIEU DE CULTE DE L'ANTIQUITE TARDIVE
~ a w '" ~ ~ ~ "' '" :; '" "' w '" w '" "' m w ~ " >- '" W M ~ m N ~ ~
0 ~
>-~ "' m N :; '" M S ~ 5 Amphores M ':2 S ~ '" '" M .- ,
~ '" '" '" ~ M '" '" , g Amphorettes ~ m '" ;" m a M -'" '"
m :; m ~ ~ a ;; R " Cêr. corn.
w ~ "' "' v " '" p. claire ~ ~ w " "
'" '" Cêr. culinaire mICa. ~ , :::
':2 ;" c w a ., ro , " co w "' '" -
Cer. com. p. brune .~
~ ;:
"' '" "' a ~ ~ ;; -Cer. corn.
.4 c p. grl$6 -
~ m S "' ~ "' '" ~ .. -Cer. com. engobée
~ '" w =
~ --lampes
'" '" '" .. .. Rouge pompéienne
m ~ ~ "' ParOIS fines
M - -
Plombifère
Campanlenne
'" M '" Aretlne ~ -
m ~ ~
~ ~ .-
S'Jd de la Gaule ~ -
Afric. de cuisine
~ ~ ~ ~ -Sig. Cr. A
'" ~ m
'" .-Claire B
~ '" Sig. Cr. c _.
m M .. ~
luisante
'" ~ m '" ,
" Sig. Cr. 0 '" "
'" ~ ~ ~ ~
Sig. Esl Tard. (OS.P.) N
1
1 .~
'0 ë 0 • " u
• • ':\ <' ~. " " ,
"! > • ~ ~ - x e x x 5 • " x x x x x >- >- x x '-'
191
" :.
1 ;; ~
1 ..,:
'" ~ ~
~ ~ ~ ~ > t
f ~
192 LE SITE DE NOTRE·DAME D·AVlNIONET A MANDELlEU
Comme on vient de l'évoquer, seule la rubri· que amphore (un peu plus de 12 % de l'ensemble) livre les fragments (cinq) d'un conteneur éventuel· lement tardif: un goulot conservant une anse de la forme LRA 3'''''. Ce type d'amphore orientale, mo· noansé, est connu dès le III' siècle. Tous les autres tessons d'amphores correspondent à des formes ré· siduelles (essentiellement Dr. 2/4, 20 et Gauloises).
La céramique commune à pâte claire, large· ment majoritaire (plus de 52 %l, ne reflète que des productions nettement antérieures à l'Antiquité tardive.
Même en céramique commune à pâte brw:'e (plus de 18 %) on ne trouve pas d'objets spécifiques de cette période (alors que quelques formes appa· raissaient dans les couches 3 et 4).
Passons sur le reste des céramiques commu· nes ou demi·fines, de même que sur les sigillées des 1" et II' siècles.
Les tessons de sigillée claire B correspondent aux formes déjà rencontrées dans les couches anté· rieures : cinq fragments se rattachent à la forme Lamb. 9A 1 Desbat 2, et 24 fragments à la forme Lamb. 9B 1 Desbat 3, trois autres à l'une ou à l'autre; un fond renvoie à un petit vase fermé.
La sigillée claire C est très majoritairement représentée par la forme Lamb. 401 Hayes 50 (39 tessons identifiés). Un seul bord correspond à la forme Lamb. 351 Hayes 44 ou 52.
Les tessons de luisante, relativement peu nombreux, se rattachent exclusivement à la forme Lamb: 1/3 (bords ou fragments de carènes guillo. chées).
Sur les 84 fragments de sigillée claire D, 32 fragments peuvent être rattachés à une forme:
- 3 bords de la forme Hayes 58A ; - 1 bord de la forme Hayes 59A, 4 fragments
de panses incisées et un fond décoré de palmettes et de rouelles;
- 2 bords de la forme Hayes 59B ; - 3 bords de la forme Hayes 59A ou B ; - 2 bords de la forme Hayes 61A ; - 1 bord de la forme Hayes 67 ; - 2 bords de la forme Hayes 73 ; - 1 bord de la forme Hayes 76 ; - 1 bord de la forme Hayes 81B : - 3 bords de la forme Hayes 91A ou B, l coi·
lerette, 2 fragments guillochéS et 4 tessons infor· mes;
- 1 bord de la forme Fulford 38·2"87'. Un bord n'a pu être identifié sûrement (proche de la forme Hayes 63).
On relève 5 fragments de fonds décorés de rouelles etJou palmettes qui s'identifient au style A de Hayes: la rouelle (fig. 112, n° 11) est du style A (ii) et du type 44B ; le croissant (fig. 112, n° 2) est du style A (ii).(iii), fréquent sur les formes Hayes 61A et 67 ; les palmettes (fig. 112, n° 3, 4 et 5) sont du style A (i).(ii) et des types 1 ou 3 que l'on rencontre généralement sur les formes Hayes 59A, 61A, et 67. Ces décors sont employés durant la seconde moitié du IV' siècle et le début du V'.
L'idée d'ensemble se dégage: toutes ces for· mes sont représentatives de la première génération de production, surtout si l'on note que tous les fonds récupérés (et inclassables) sont à gradin, en accord avec la typologie de cette période, IV'·début V, siè· cie. Aucune des formes qui apparaissent vers le milieu du V, siècle ne sont attestées sur le site. C'est donc un indice important, non seulement pour la date d'abandon des structures, mais également pour leur fréquentation. Le matériel recueilli dans cette couche ne permet pas de proposer une chrono· logie plus récente que celle que suggère la couche 3 : milieu du V, siècle ou un peu après.
(186) J. A. Riley, The pottery from cistcm, 1977 -l, 1977·2 ct 1977·3, dans Excavations at Carthage, 1977, conduct.ed by the Uniuer ... it)'
of Michigan, Ann Aroor, 1981, p. 85.124 etM. Bonifay, ObservAtions sur les amphores tardives à Marseille d'après les fouilles de la Bourse (1980.19S4), dans RevlU Arch~oJogjque de Narbonnaise, 19, 1986, p. 269·305, plus particulièrement p. 279·28l.
(lB7) M. G. Fulford, DP.S. Pcacock, Excauation at Carthage .... p. 61-62.
Associés àcetteproduction africaine, on trouve plusieurs formes et décors de sigillée tardive estampée ou DS,P, (cf, l'étude détaillée de J, et y, Rigoir, infra, fig, 105 et 112) :
- 5 bords de la forme Rigoir , : - 1 assiette de la forme Rigoir 6 : - 2 bords de la forme Rigoir 18 : - plusieurs fragments de panses de crucnes
et de nombreux décors de roueUes, palmettes et arceaux.
LE LIEU DE CULTE DE L'ANTIQUITÉ TARDIVE 193
;96 LE SITE DE NOTRE-DAME D-AVINIONET A MANDELIEU
12
,//-----
/CI\llV
~' 17
2 J 4 5 6
7 3 9 '0 Il
13
1 B
\9
~
14
",..--/' '
, ,
,,/~
. !V\ !V 20
"s.aw 16
~,
\A NN\ÇDJ "~/
22
Pig. 106.- A{arques sur sigillées et lampes,' ]-11 : arétine,. 12·16,' sud de la Gaule,' 17-22; lampes " écho 1/1.
U ne récapitulation des données les plus éparses, celles, donc, qui concernent la céramique et l'histoire du site, semble mainte
nant nécessaire. Préalablement cependant, il faut tout de même rappeler que l'ensemble de la surface couverte par l'occupation antique n'a sans doute pas été découverte, même si la prospection dans la grande parcelle encore plantée d'arbres fruitiers qui s' étend vers l'est, se révèle totalement négative. En revanche, en ce qui concerne l'occupation médiévale, il n'y a pas de raisons pour penser qu'elle fut jamais plus étendue que le sommet de la butte.
La céramique (L. Rivet)
L'étude de la céramique issue des fouilles de la villa de Mandelieu a permis de situer chronologiquement, avec plus ou moins de précision, dix-sept contextes stratigraphiques que l'on peut regrouper en huit grandes phases (fig. 115) :
1. c. 14: vers 50-70 de notre ère; 2. c. 12, 11c, 11b, 11a et lOb: vers fin 1" siècle; 3. c. 10a, 9b et 9a: seconde moitié du II' siècle; 4. c. 8 et 7 : milieu III' siècle; 5. c. 6 : fin III' siècle;
CONCLUSIONS
6. c. 5, 5a et 4 : seconde moitié du IV' siècle; 7. c. 3 : début V' siècle; 8. c. 2 et 1 : milieu V' siècle et médiévale.
Les contextes de ces phases ont livré un matériel d'inégale importance (fig. 116). Les productions locales, au moins au rH siècle, donnent une large place aux céramiques communes et aux petites amphores, souvent avec des formes bien conservées.
La phase 1 est, de loin, celle qui, quantitativement, à fourni le plus grand lot de céramique (près de 36 % de l'ensemble du matériel du site). us céramiques communes et, SUT'tout, les amphorettes, produi tes à proximité, y tiennent une place prépondérante. Dans les céramiques fines, les tessons d'arétine (généralement de production tardive) sont plus de cinq fois plus nombreux que ceux de sigillée du sud de la Gaule, de production précoce. Ces sigillées, comme l'abondance des fragments de lampes, témoignent d'une occupation humaine significative.
La phase 2, qui livre un matériel en moindre quantité (11 % de J'ensemble), est à placer à la fin du 1er siècle avec quatre fragments de sigillée claire A et quelques tessons de production flavienne en sigillée du sud de la Gaule. La vaisselle sigillée occupe une faible part dans l'ensemble du contexte. Les amphores etamphorettes, en revanche, détiennent le pourcentage (71,5 %) le plus important rencontré pour les différentes périodes.
La phase 3, avec un matériel qui constitue moins
"" '" 0 f;; Cl)
~ t)
t'l
.-.-
~,--~--~
._--
_.
'" $
r :t
"
'" >-
g>
1.-"
if
c
" ",
.
;î •
~ <>
i
3 m
Q
p
" Q
:r
• 2
'" :r
l r
0 •
" >-
• -<
0
• ~
c C
l ,
.. ~
• "
Ci
~
'" ~ 1
C.1
4 82
45
5 8
C.1
2 2
9 28
1
C.l
le
1
Z
~ ."
1l
r
~ ~
~ ~
~ ~
~ 0
• •
~ 3
il
c
~ n
} !
• ~
0 0
0 0
OC
• ~
~ ~
c ~
b '"
~ <1
• i
" "
~
• ~
• 3
• "
" ;.
" ~
1 .g
"" "
"-TO
TAl..
~ ~
c 3
•
" ~
" ~.
;
'" :> 30
21
': 1
15
21
10
37
1
301
1364
3
4081
10
423
1334
19
560
~ 11
2 0
24
12
80
21
16
185
101
134
733
~ 1
9 18
2 26
99
208
3101
...,
C.1
1b
1 1
31
18
22
73
:>-C
.lla
1
1 7
23
2 C
.10b
1
15
1 C
.l0
a
3 1
2 31
1
C.9
b
1 17
4
C.9
a 1
29
4 C
.8
9 74
49
6
65
6 1
20
3 24
63
25
18
4 1
502
595
370
1821
~ 6
? 34
9
36
6 53
96
10
1 36
1 11
0
3B
16
34
37
280
115
113
689
t'l
12
11
29
8 30
23
3 2
14
362
~ 6
6 8
37
31
59
17
274
63
535
c: 57
22
42
25
5 16
4 29
8 8
a 17
85
1569
15
20
6010
C
.7
2 7
1 48
22
3
25
85
2 43
24
1 C
.6
3 7
12
C.5
11
2
31
19
80
6 52
15
17
1 61
17
1 92
71
33
6 68
16
00
68
708
3200
C
.a
5 4
2 3
12
133
627
2 21
8 10
07
CA
12
1
1 5
4 30
4
C.3
12
19
"
17
51
6 1
13
5 C
.1·2
35
8
4
15
74
46
53
" 69
66
t-
TOTA
L 47
13
1 29
13
5 19
8 20
41_
28
428
612
14
-~--
rf "l"
",. .0
0."
86
9 22
2
11
65
84
44
8 22
12
18
146
475
2628
6
2
9 42
2
57
16
0 25
00
71
7345
13
06
1733
14
018
~._~L~~._~_~ 2
025 _~
~._
583~
_. 3
32
18
88
1_
'71
78
~_
~==-
5S22
O
Fig
. 1
15
.-T
able
au r
éca
pit
ula
tif d
es c
éram
iqu
es p
ar
cou
ches
.
MA
ND
EliE
U
Pha
ses
1. v
ers
50-7
0
2. f
in /
'"
3.2
"m.l
t-
4. m
ilieu
1I~
5. f
fillÎt
:u H~
6.
2" m
. IV
4
17~~
~.
~ mi
lieu
V·
$ m • ~ -< • !l- Cl '" :0
:; p o
r c ~ , ô
---1
--+
---'
--
-T--
----
-
$ p ()
1 3
.5%
4.5
%
1 2
,0%
() . , '"
1
on
.;5'
Q
>
2,0
%
> ~ l!- n c " ~
g>
~ :t " Cl • " • 1,
5 "1
"
6,0
%
~ . ' ~
3,0
%
1,5
%
2.0
%
0.5
%
1,0
%
() • 3 ~ • , , •
l1 3 g '€' •
'U • a " ~ • 1
.5%
1,0
%
3.0
%
2.0
%
no
n !>
igr1
lfian
le
1 O
,S%
1,0
%
0,5"
1...
'l1 c ~ • '8 3 ~, ~ •
:;
~
~
~ ~
~ U
> ~
~
~ ~
~ ~
1.0
%
~,5"
'1 ...
0,5
% 1
3.0
"1"
-1' 1~"
: ~5%
j 10
%)4,5
% i
0.5
%1
2,0
%
Fig
. 1
16
.-T
ab
lea
u réc
apit
ultl
.Lif
de.~
cà
am
ùlw
.!s
pa
r pJ
rù}(
!t's
.
()
~ .
n ~ c s: c il 9,0
%
7.0
%
14
,5 %
9.0
%
17.0
%
21
.0 %
20
.0 %
~ ~ ~ ~ 3 ~
~ ~ " !l • ~ 1
20,0
O/~
15,,,j
4~.~
-J 3~,~
O/~
~ } " œ ~ ~ " •
1
1>0.
0 ... ,.
]
71
5 "1 :::1
52,0
,/1
22
,0 '/1
46
S 0j
23
S 'i
'
52,S
'/ 1
21
,5 '/~ 1
0lA
l
10
0%
10
0 v
I"
10
0 "
lu
10
0%
10
0 "
1 ...
10
0 u
/ u
10
0%
1
o o ~ t'"
c: UJ ~ UJ '" '" ~
232 LE SITE DE NOTRE·DAME D'AVIN10NET A MANDELIEU
de 3 % de l'ensemble, est datée par crois tessons de sigillée daiTe B. La nature de cette couche explique peut-ètre les pourcentages inversés entre céramique commune à pàte claire (49,5 %) et amphores/amphorettes <19 %). Les rejets de tessons de sigillées représentent, dans cette phase. la pius forte proportion (près de 6 %) rencontrée pour les différentes périodes.
La phase 4 (également Il % de l'ensemble) livre neuf fragments de sigillée claire C, permettant de fixer le terminus ante quem non un peu avant le milieu du III~ siècle. Les pourcentages entre céramiques communesl39 %)et amphores/amphorettes (50 %) redeviennent confonnes au faciès du site.
La phase 5 est une couche vide de céramique que seuls trois petits fragments de sigillée claire C permettent de situer, au pius tôt, vers la tin du Ille siècle.
La phase 6 (un peu plus de 9 cie de l'ensemble) est parfaitement bien daté-e par la présence de certaines formes de sigillée claire 0 (et l'abandon du mithraeum, par un lot monétaire). Quelques pièces intactes de cé,ramique montrent, à côté d'autres objets, quel était l'équipement de ce lieu. A partir de ce stade, les amphores! amphorettes passent sous la barre des 25 %.
La phase 7, avec l'app311tion des 0( sigillées paléochrétiennes ", est une phase de désaffection, vraisemblablement de délabrement et d'efTondrement, de tout ou
- phase 1 prad. gaul 15,00 %
- phase 2 : prod. gaul. 33,75 %
- phase 3 : prod. gaul 82,00 % (dont résiduelle ?
réelle 94,00 %
- phase 4 : prod. gaul. 66,50 %
(dont résiduelle 32,75 %
réelle 53,00 %
- phase 5 : prod. gaul
- phase 6 : prod. gaul. 39,00 %
(dont résiduelle 29,50 %
réelle 31,00 %
- phase 7 : prod. gaul. 64,50 % (dont résiduelle 47,50%
réelle 39,00 %
- phase B : prod. gaul. 36,50 % (dont réSIduelle 26,50 %
réelle 37,25 %
Pour la sigillée du sud de la Gaule, l'approvi· sionnement est exclusivement assuré par l'atelier de La Graufesenque. L'anecdote relative à l'utilisa·
partie des bâtiments; la céramique y est très fragmentée et représente moins de 5 % de l'ensemble récolté sur le site,
La phase 8, qui correspond aux terres de surface et aux niveaux d'installation des tombes, contient une part de céramique de l'Antiquité tardive (parmi les tessons qui représentent 25 % de l'ensemble), permettant de mieux situer la fin de la fréquentation du site, vers le milieu du Ve siècle.
La vaisselle en sigillée, toutes phases confon· dues, donne des pourcentages écrasés, bien entendu, par ceux des céramiques communes.
(Ces pourcentages sont calculés sur l'ensem· ble des sigillées, sauf pour la notion de céramique " nielle ", où l'on exclut les catégories que l'on peut considérer comme résiduelles. Il faut entendre par céramique ( réelle ), les productions commercialisées à l'époque considérée et comme céramique " résiduelle» celles qui l'ont été à une époque bien antérieure).
La part des productions gauloises et des importations, par phase, est à souligner:
: import
: import
: import
: import
: import
: import
: import
: import
85,00 %
66,25 %
18,00% 9,50% 6,00% )
33,50 %
3,50% 47,00 %)
61,00% 40,00 % 69,00 %)
35,50 %
9,00% 61,00 %)
63,50 % 45,00 %
62,75 %)
tion, dans les années 390, d'une coupe Drag. 27 dans le mithraeum est lourde de conséquences pour ce que l'on apprécie habituellement comme céramique
résiduelle ... : d'où le terme d'. anecdote. pour un fait qui est nécessairement extraordinaire.
En toute logique, les céramiques communes à pâte sombre (grise et brune) indiquent des propor· tions croissantes au fil des siècles: entre 9 % et 15 %
aux 1" et II' siècles, entre 17 et 21 % pour les IIl'V' siècles. Cette logique préfigure la place qu'occu· peront, aux V,· VII' siècles (et, peut·être, plus tardl, les objets cuits selon cette technique. En pâte grise, cet habitat de Mandelieu ne manque pas de s'appro· visionner en cruche de forme Goudineau 1 d'origine « vaisonnaise. (pour leurs contenus ?). Le reste du répertoire, d'ailleurs très peu " vaisonnais », est surtout constitué d'ol/ae ou de jattes.
On notera que la céramique culinaire micacee à pâte sombre n'occupe qu'une très faible place sur le site (0,6 %), ce qui est un peu étonnant: cette céramique régionale, particulièrement abondante dans les régions de Toulon ou de Fréjus, est également bien attestée à Vintimille: sa très faible représentation à Mandelieu serait à confirmer par une enquête sur ce que l'on peut connaître des sites voisins.
Les chiffres des céramiques communes à pâte claire montrent cependant le poids des objets résiduels: entre 49,5 % et 15,5 % aux lH et II' siècles, entre 52,5 % et 46,5 % pour les m'-v' siècles. Il ne nous a pas été possible de déterminer de façon catégorique, autrement que pour le lH siècle, l'espace chronologique de certaines productions de cette catégorie de céramique: on a pu pressentir pourtant, sur le site ou aux proches abords, une fabrication substantielle de récipients que l'on peut individualiser, en particulier, par des formes originales simples (les. pots à cognac", cf. fig. 80, n° 1 à 6) ou compliquées (fig. 79, nO 1) ou par des décors de médiocre qualité (par exemple à la roulette, cf. fig. 80, n° Il et 12 ou fig. 94, nO 22 et 23). Certaines de ces productions locales se singularisent par un répertoire typologique parfaitement inconnu ailleurs, sur tout autre site.
Ce poids des objets résiduels est, cependant, en partie démenti par les proportions d'amphorettes (dont on est pratiquement sûr qu'elles ne sont
CONCLUSIONS 233
produites qu'au 1" siècle (et au Il' siècle ?) : elles donnent des proportions entre 57,5 % et 7,5 % aux 1" et II' siècles, entre 25 % et 2 % pour les III'V, siècles.
Le même sens se litdans les pourcentages de céramiques que l'on peut qualifier de demi-fines comme celles qui sont à engobe interne rouge pompéien ou comme les parois fines.
L'arétine, à ce titre, constitue une trame standard fiable : entre 2,5 % et 0,5 % aux 1" et II' siècles, entre 0,5 % et 0,25 % pour les lII'V, siècles.
Les chiffres des céramiques communes à pâte claire engobée vont également dans le même sens: la production couvre, exclusivement, les 1" et II' siècles (6,56 % à 2,94 %), et leur présence, audelà, correspondant à du matériel résiduel (2,47 % à 1,83 %).
Pour les lampes, on ne peut parler de proportions, les exemplaires intacts (ou presque intacts) recueillis dans le mithraeum faussant les chiffres. On notera la faiblesse, à toute époque, des exemplaires importés (on ne constate, véritablement, qu'une importation africaine) et, donc, la vitalité des productions (par surmoulages?) et des approvisionnements régionaux (dont une étude sérieuse reste à réaliser pour établir les secteurs de diffusion et, éventuellement, déterminer les zones de production).
Autres remarques, sur les sigillées claires africaines: l'approvisionnement, quantitativement, paraît faible, en tout cas beaucoup plus pour la sigillée claire A que pour la sigillée claire C ou, plus encore, pour la sigillée claire D, si bien que ce faciès se démarque nettement des proportions que l'on retrouve sur d'autres sites couvrant une même période d'occupation : le nombre négligeable de céramique africaine de cuisine renforce encore cette singularité.
Cette faiblesse des importations ne se traduit pas, pour autant, aux II'-V' siècles, par une plus grande fréquence de produits gaulois: comme un
234 LE SITE DE NOTRE-DAME D'A VlNIONET A MANDELIEU
peu partout sur les sites de la côte provençale, la sigillée claire B et la luisante n'atteignent pas de fortes proportions (encore que la B soit, ici, bien plus abondante que dans les sites fouillés dernièrement, à Fréjus par exemple). Les formes attestées se limitent aux objets habituellement les plus diffusés dans la région. Les chiffres de • sigillée paléochrétienne. n'appellent pas de commentaire particulier,