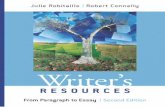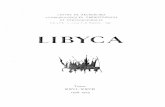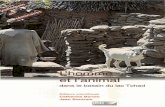Revue des sciences de l'homme et de la société, N°2, Université Biskra-Algérie
-
Upload
univ-biskra -
Category
Documents
-
view
3 -
download
0
Transcript of Revue des sciences de l'homme et de la société, N°2, Université Biskra-Algérie
022012
2
كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة
14332012: 02العدد
14507000
0021333501260
3
15
Microsoft Word RTF
Simlified Arabic
12 21 Simplified Arabic 14 Gras Simplified Arabic
12Gras Times New Roman 12
022012
8
02 –
203
03
227
01
253
01
16- 18
جامعة ،جامعة خميس مليانة ،3الجزائر
285
02
315
03
331
01 511349
9
،علي زيان
01 Les « révolutions 2.0 » des facebookiens dans
l’espace arabe, Dr. Daoud Djefafla
UFR de Communication – Université Paris XIII
3
15
:
–
Abstract:
The University professor is one of the most valuable professional takes. He is one of major components of such a university. Admittedly, there appeared a controversial issue what professor should focus his duty on researching or educating students. But the best way is to do well both: teaching and carrying out research as well as publishing and supervising students in their thesis and dissertations.
So, by reading and giving opinions to student’s studies,-and not according to their administrative superiors -, professors are indirectly developing their researching skill, which helps them promoting to higher positions and not lag behind. Thus, they not only educate their students but also enhance their knowledge, in order to reach further in their career and keep a best academic position. So that is what this article will be focusing on, with other professional elements.
33
1 1989197.
2 topic-http://assps.vourformlive.com/t288
3 2008
168PDF
4 2009 55
5 )20/04/2011-19 :00 (www.drsmy.com/adaa-doc
6 http :www.alaqsa.edu.ps /ar/
aqsa_magazine/files/25-pdf
7 2004242.
8
9 doc-www.drsmy.com/adaa
10 200747.
11 47.
12 2008235236
022012
34
13 kharboush.com/ar/arti/tm3htfj.doc22/04/2011-20 :30
14 http://www.najah.edu/thesis/5172110
15 www.cheqedu.org/studies/st16.doc
16 www.damascusuniversty.edu.sy/mag/edu/images/stories/533-573.pdf
http ://
17 22009
106،107
35
Résumé :
La morphologie est l'étude de la forme et la structure, et dans cet article nous allons essayer d'étudier la forme de la société civile algérienne et analyser ses différentes structures, afin de comprendre la nature de cette société et les dimensions de l'ordre structural, et pour saisir le niveau de performance de ses fonctions et les rôles qui lui sont confiées, et les défis stratégiques qui deviennent existant à cause des changements dilemmes sociaux et politiques en Algérie sur l'impact de la mondialisation et le développement résultant de la sensibilisation de la communauté et l'augmentation et à la citoyenneté en tant que peuples du monde, d'une part, d'autre part dans le contexte des exigences croissantes de la réforme et le changement et la transition vers une société plus démocratique, de liberté et de justice, en prévision de ce qui se passe dans les pays arabes des événements appellent d'autres "printemps arabe".
022012
62
1 Roger Gerard schwartzenberg: Sociolologi politique, éd5, Montchrestien, Paris
cedex15,1998, p73.219191962
19986 3
1995185 4
2002155 5
20112005186 6174 72009135 83
1983180 9
2001158 10159 11
182012-02-22
www .pogar.org/publications/civil/…/algeria-a.pdf
63
12 172005116
13 201082
14
15
1998105 16–
2599200067 17
2007153 18200201 19
8 2086 2184 2286 23
19 2430
022012
64
25 50
19542004 202122 2004 crasc200875
2674 (27)
http://www.interieur.gov.dz/Default.aspx?lng=ar (28)
2008212 (29)227 (30)
200765 (31)233 (32)
141620014 (33)
199506 (34)
1992354357 (35)74
65
Résumé :
Cet article a pour objectif d’aborder les notions de statut et de rôle sociaux , ainsi exposé les principales caractéristiques de ces derniers dans l’institution familiale arabe, surtout tout ce qui concerne les principaux facteurs qui déterminent ces statuts et ces rôles au sein des groupes primaires .
Ainsi que l’impact causé par ces facteurs sur les comportements et les relations que mènent les individus à l’intérieur des ces groupes.
022012
86
)1( 197949 2
198420 3
19973536 4
2000283 5283 681
161 7
1999140 8 - Genet .L, Remond, R- Le monde contemporain-librairie Hatier, Paris-France,
1962, P:658.9 2
1984166 1053 1165 122122 )13138 14
1970104 15 2
1981299 1634
87
17 1996137 18
90 19
1967116 (20)- Genet.L, Remond.R ,Op.Cit, PP: 658-659.
21 1981197
22 198144
23197957
24286 2578 26283 27
1998344 28134 29327 30211 312
1979180 32 2
1977717 (33) Mathéa Gaudry -La société féminine au Djebel Ammour et au Ksel- Etude
de sociologie rurale Nord Africaine,-Société Algérienne d'impression Divers, Alger, 1961, P: 126.
022012
88
34104 35120121 3652 37263 38105 39261 40121 41261 42
1989150 43115
44 Mathéa Gaudry -Op-cit, P: 132 4599
* P.C. Dodd -:"Family honour and the forces of change in arab society", International journal of Middle East studies, 4(1973, PP: 40-54).
46298 4778 48150
(49) Mostefa Boutefnouchet -La famille Algérienne, evolution et caractéristiques récentes, SNED 2éme édition, Alger, 1982, P:63.
(50) Ibidem.51116117 52
1997140 53180181 54129
89
55128129 56
198226 572627 58
1981130 59
1996181 601994141 6199 62
1991204 63118 641998279
65 Guy Rocher -Introduction à la sociologie générale, l'organisation sociale.
Editions HMH, Paris, 1968, PP:66-67. (66)- Ibidem
67186
68118 69279 70134
91
Résumé
Face à la crise, l’Algérie s’est engagée depuis les années quatre vingt, dans un vaste chantier de réformes afin de rétablir les grands équilibres au sein d’une économie administrée marquée par sa particularité disproportionnelle basée en majeur partie sur les produits tirés de la rente des hydrocarbures et leurs dérivés, et de regagner une économie de marché.
Le recentrage actuel du rôle de l’Etat dans l’économie, se traduit par un désengagement progressif du secteur productif qui se concrétise dans la privatisation graduelle de la quasi-totalité de son portefeuille (secteur public marchand plusieurs entreprises toutes activités confondues).
La privatisation permet alors le développement du secteur privé en générale ainsi elle incite au démembrement des grandes entreprises publiques (restructuration) mais aussi à travers ses différentes formes, vente des actifs, la reprise par les salariés ainsi que les formes diverses de partenariats avec d’autres entreprises.
022012
102
01
1998
%
%
524.5368 31.27 137.711 01.16
10028 02.38 121.5610 59.82
525.9170 14.46 886.294 09.30
391310 26.33 856.9 00.08
514.2135 11.49 79165 06.45
429.4165 14.03 907 3632 23.17
103
5848117 100 884 0181 100
199419982931999
31.27%
14.46%26.33%11.49%
84%3333557%
2554943
%16%1998
19941919
111
(1) Benissad (M.E.H.): Algérie restructuration et réforme conomique(1979- 1993) ,OPU, Alger,p189. (2) Bouzidi (A.), « La privatisation des entreprises publiques industrielles en Algérie », revue, Reflets Et perspectives de la vie économique, tome XXXII, déc. Alger,1993, p455.
3 174 1991
Tabou
(4) Ghiles (F.), L’armée a-t-elle une politique économique ? Chronique de
douze années de compromis incertains, in Pouvoirs. Revue Française d’Etudes constitutionnelles et Politiques, n° 86, Seuil, Paris, 1998, pp85-106.
(5) CNES, Préliminaire sur les effets économiques et sociaux du programme
d’ajustement structurel, 12ième Session plénière, novembre 1998,Alger, p60. (6) Andreff (W.) : Le Secteur public à l’est : Restructuration industrielle et
financière, l’Harmattan, Paris, 1995, p236. (7) Le nouvel accord de facilité de financement élargie (FFE) signé entre le
gouvernement de Mokdad Sifi et le FMI daté de mai 1995.
(8) L’ Ordonnance n° 95-22 du 26 août 1995. (9) L ’Ordonnance n° 97-12 du 19 mars 1997, et décret n° 97-329 du 10 septembre 1997. (10) L’Ordonnance n° 95-22 du 26 août 1995, Article 4.
11 171996
022012
112
(12) Ordonnance n° 95-25 du 25 septembre 1995- l’article 24 stipule que «Le patrimoine des entreprises publiques est cessible et aliénable ».
13 stand-by0306199110 31031992.
(14) Lakehal (M.) :,L'Algérie de l'indépendance à d''urgence, L'Harmattan, Paris,1992,p239.
15 9522 261995
16 311993 (17) Bennoune (M.),Esquisse d’une anthropologie de l’Algérie politique, Illustre par, une stratégie algérienne de sortie de la crise (Acceptée, puis abandonnée par un pouvoir inapte), Ed.Marinnor, Alger, 1998, p208.
18 19931999
19 20
:
(20) Sadi (N-D.),La privatisation des entreprises publiques en Algérie. Objectifs, modalités et enjeux, OPU, Alger, 2005, Chapitre5, p 392.
(21) Stora (B.) et Ellyas (A.) ,Les 100 portes du Maghreb. L’Algérie, Le Maroc, La Tunisie, Trois singulières pour allier islam et modernité, Les Editions de l’Atelier-Editions ouvrières,Paris,1999, pp136-137.
113
summary
The progress and effectiveness of any organization depends on its ability to achieve its objectives, and most important of these goals to increase their work efficiency and productivity, this goal is based on the optimal use of different materials " technical, technological, human. "Become the object of rational behavior in organizations is a large area of modern management culture, organizational sociology, which is a fundamental pillar for the success of any organization, depending on the degree of understanding of the organization of these behaviors, Prediction and control and developed on a scientific basis. And entering the human element in the interactive process between the organization and external environment as a whole, as one of the pillars of organizational and administrative
development within the organization.
022012
128
Hawthorne
E. Mayo
1954 L. Warner
Chicago Gardner Davis Harbison Hoges W.F Whyte
Warner
Warner Yankee sity
Yankee
022012
138
1199245
2 198417
3 73
)4( Durant (C) : Le travail enchainée ,ed le seuil, Paris, 1978, p47 .
574
)6( Etzioni (A: Modern organisation, N.Y : England chefs, prentice halb,
1964.p21.
7 1989139
)8( Terry George, Principales of management, C F H ed (home wood richard)
D.Trwin, inc, N.Y 1992, p239.
91991110
101993166
(11)19999091
(12)199646
1391
139
)14( Roethlis (J.F) and Dickson (J.W) : Management and the worker
Cambridge Mars. Harvard university press 1959, p20.
(15) Mayo. (E) : Human problems of industrial civilisation, New York the king
Press ,p241.
(16) Bendix (T) : Bureaucracy : International encyclopaedia of social sciences, vol
(1-2), N.Y, the Macmillan press, 1972, p206.
17 150
18199564
1970
(20) Garry Dessler, Organisation theory : Integrating structure and behaviour,
(Englewood cliffs : prentice, Hall, tnc, 1986, p30.
)21( Mouzels, (N.P) Organisation and bureaucracy,an Analysis of modern theory
(Chicago, Aldine, 1989), p15.
)22( Gouldner (A) :" Organizational Analysis" In Merton et. AL, Sociology
today : Problem and prospects. (N.Y, Basic books, in publication, 1959 p.406.
)23( Crozier (M), On ne change pas la société par decret, Paris Grasset. 1979,
p20.
141
Abstract:
In view of the fact that development is a comprehensive, guided and complicated operation of change. It contains all the living sides, with its complixity and its accumulation. It aims at creation of constructional and functional change in the society, and to realize a very important of welfare for the men. Therfore many thinkers pay attention to present approachers, theories and conceptions with their analysis in order to discover the machinaries of change and ways of development .
This study is an attempt for presenting Malek Ben Nabi ́s opinion
and his conception about the development. Who gives a theoritical
contribution and takes into considiration the idea of civilisation,and starts
from man himself before all.
022012
152
0 0
العالقة الجدلیة بین اإلنتاج و االستھالك في شكلھا
.األخالقي
كفتي استھالكھ أرجح عن :إنتاجھ
ھو .و ھو مجتمع ینھار .مجتمع ال یصعد و ال یستقر
:كفي میزانھ متعادلتان
ھو مجتمع راكد مجتمع ال .یصعد و ال یھبط
فائض اإلنتاج عن ھو مجتمع : االستھالك
النامي یستطیع المجتمع استثمار فائض إنتاجھ في
022012
174
1 2196423
2 2197043
3 196027
4 27
5 6200680
6 3197836
7 4 14
8 153
9 5166
10 70
11 74
12 74
13 77
14 198453
15 91
175
16 96
17 6200627
18 38
19 42
20 1995151
21 67
22 6200660
23 125
24 78
25 6200683
26 101
27 89
28 79
29 96
30 105
31 17
32 9695
33 108
34 112
179
4 06
.
Abstract :
The aim of this search is to discover the level of the use of the evaluation by teacher in learning positions inside didactic process to build the indicator of competence and basic competence. To realize this purpose; we chose the observation card to estimate the performance of the teacher in all learning positions. The search applied on sample of teachers of primary and middle stages; presents four teachers, and then we notice their performance in six subjects. We find that the level of the use of teacher to the estimation in all learning positions presents low percentage and this is not explained the absence of teacher’s training of requirements of teaching competence only but the absence of didactic, psychic, and pedagogic training too.
022012
186
Contextualisé
9
– 10.
11.
12.
1
قاالنطال وضعیة
مهام التعلمات بناء وضعية
المكتسبات استثمار وضعية
مؤشرات
الكفایة
التعلم وضعيات الدرس سيرورة
022012
194
2
83.33 05 16.66 01 1
66.66 04 33.33 02 2
66.66 04 33.33 02 3
50 03 50 03 4 83.33 05 16.66 01 5 100 06 0 0 7 100 06 0 0 8 100 06 0 0 9
13
201
1
199421
2 2004598
3 79
4 200403
5 23
6 2829
7 82
8 69
9 200713
10 36
11 2005 08
12 200585
13 231
14 2007386
15 176
022012
202
16 391
17 158
18 8384
2020 faculty.ksu.edu.sa/otaibibjDocLib1/19
20 http://rcweb.luedld.net/rc4/08_TZI%20Boukerma_A_Ok.pdf-
20112120
2216
2324
2421
25198754
203
–
/
:
Résumé :
L'analyse de l'écriture (graphologie) n'est pas moins importante que l'étude de l'empreinte (dactyloscopie) qui distingue un individu d'un autre, et ce, en raison de la singularité de l'écriture de chacun. En suivant la méthode scientifique de l'analyse de l'écriture, nous constatons que l'écriture permet de déduire la personnalité et ses caractéristiques.
L'écriture de chaque personne détermine les talents et les qualités dont elle jouit ainsi que les fonctions qu'elle pourrait occuper. A travers l'écriture nous pouvons juger ses émotions et humeurs et prévoir les maladies q'elle risquerait de contracter .
Cet article se propose de connaître les débuts de la graphologie et de savoir comment elle est apparut ? Quels sont ses intérêts, ses domaines d'utilisation et comment à partir de l'observation de l'écriture manuscrite nous pouvons déduire les caractéristiques psychologiques de la personnalité d'un individu.
022012
204
1
2
Allport & vernon1933
Harvey1934 Bobertag1937 Eysenck1947Livenson & Zubin1951
Lorr & Lepine & Golder1954
205
1
Allen edgar
AutographeryAllen edgar
Camilio baldo
1622 3
Abbé Michan
Graphology18724
Abbé FlandrinAbbé
022012
206
Gene
Graphology
5 Alfred Binet
preyer1895Jorge Mayre1901
Ludwing Klages
GraphologyChracterology6
Kripieks
Ludwing klages
1980
022012
222
1199554
2 1980378
3 Charlotte P . Leibel: Change your handwriting change your life , New york ,
Stein and day , Pulbishers ,1972, p 3 .
4 Claude, santoy: The A B Cs of handwriting analysis , London , Robert hale ,1989,
p ix .
5 Charlotte P . Leibel , Op.Cit , p 3 .
637856
7200471
8 Charlotte P . Leibel , Op.Cit , p 3 .
. 378 9
10197970
1161 1255
223
13200410
1455 159 1610 17
24202007http://www.alriyadh.com/28/08/2006/article182300_s 1810 1925042007
http://www.alargam.com/mumbers/ragm198.htm 2085 2114032007
http://www.alhashemih.com/vb/showthread.php?s=1480 22214
23 Baggett , Bart A: The secrets to make love happen . US , presse publishing,
2002, p 30 .
24 Delachaux . S et Bousqet . L: La graphologie et l'adaptation au travail
(Orientation et sélection professionnelles) , éditions delachaux & Niestlé , France ,
paris ,1960 , p 26 .25 Bunker , M . N: Handwriting analysis , Chicago , U, S, A , Nelson hall . co ,
publishers ,1959 , p 82 .
022012
224
26–14032007
http://www.alhashemih.com/vb/showthread.php?s=1783
27 Robert , Holder: Handwriting talk how handwriting reveals what people are
really like .. and how you can use handwriting analysis as a way to personal power
and profit , New york , Fransworth publishing company inc rockville centre ,1974,
p 2 .
28 McNichol , Andrea: Handwriting analysis putting it to work for you . US ..
Published by contemporary boocks a divisio of NTC / contemporary groub , Inc,
1994 , p 306 .
2914032007http://www.alhashemih.com/vb/showthread.php?s=695
30221–223 31 Imberman , Rifkin: Signature for success . Kansas city .. Andrews mcneel
publishing, 2003 , p 354 .
32 Hayes , reed: Between the line , USA , Destiny books , 1993, p 23.
33 14032007 http://www.4uarab.com/vb/showthread.php?s=60839
34117118 35–14032007
http://www.alhashemih.com/vb/showthread.php?s=1783
227
Le résumé :
Dans toutes les sociétés humaines, la question du choix
conjoint ou de la conjointe revêt une importance extrême pour les
jeunes désirant de se marier.
Cependant, les critères et les méthodes à même de fixer ce
choix et garantir un ajustement entre les partenaires diffèrent
selon les individus, les groupes et les sociétés en fonction de
plusieurs facteurs psychologiques, sociaux et culturels.
022012
250
1 1983149-154-159-160
2 2425.
3 20052533-
4 2 2003
5 1 4 –2005
6 200092
7
2009 66
8 21996838586
9 2–20081920
253
Résumé:
Cette étude se veut une tentative de réflexion autour de la
dualité alimentation / identité dans la société tunisienne à partir de
l’exemple du couscous, plat ancestral chargé de mémoire et de
symboles.
En se basant sur une approche anthropologique diachronique,
l’analyse de la pratique sociale de ce repas, nous a permis de relever
son aspect identitaire complexe : culinaire, historique, rituel et
symbolique.
279
)1( 1996290291 Dozy (R.), Supplément aux Dictionnaires Arabes,
Beyrout, 1968, p.476. (2) Lévi-Strauss (Claude), L’origine des manières de table, Paris, 1968, p.
397. (3) Lévi-Strauss (Claude), « Le Triangle culinaire », revue L’Arc, (Aix-en
Provence), n° 26, 1965, p.20. )4(
)5(
(6) Gobert (E.-G.,), « Usages rites alimentaires des Tunisiens, leur aspect
domestique, physiologique et social », Archives de l’Institut Pasteur de Tunis, XXIX, 1940, p. 33.
(7) Ibid., p. 5. (8) Bouby (Laurent), « De la récolte au stockage », dans Le traitement des
récoltes, un regard sur la diversité du Néolithique au présent, (Collectif), Editions APDCA – Antibes, 2003, pp. 21-43.
(9) Hamzaoui M’layah (Sonia), Fonctions symboliques et nutritionnelles des plats rituels dans deux communautés rurales ; Makthar et Kesra, Mémoire de D.E.A ; Faculté des Sciences Humaines et Sociales, Tunis, Juin 1997, pp. 40-41.
(10) Jouin (Jean), «Valeur symbolique des aliments et rites alimentaires à Rabat », Hespéris, Tome XLIV, 1957, p. 305.
)11( 1983
37.
022012
280
)12( 51997258.
)13( 1983253
(14) Gsell (S.), Histoire ancienne de l’Afrique du Nord, t.VI, Paris, Hachette, 1927, p.7.
)15( 1315
1988283 )16( )17(
19848788 (18) Magazine Notre temps, mensuel français, n° 253, avril 2006 (19) Ferchiou (Sophie), « Conserves céréaliers et rôle de la femme dans
l’économie familiale en Tunisie », in Les techniques de conservation des grains à long terme, Gast (Marceau) et Sigaut (François), Paris, Centre National de la Recherche Scientifique, 1979, p. 193.
)20( Les abats
(21) L’imaginaire maghrébin, étude de dix contes pour enfants, Maison
Tunisienne de l’Edition, 1977, p.79.(22) Najar (Sihem), Pratiques alimentaires des Djerbiens : une étude socio-
anthropologique, Université Paris V, René Dé cartes, Sciences Humaines - Sorbonne, 1993, p.191.
(23) Babès (Leila), « Le couscous comme don et sacrifice », Revue Mauss, n°8, 1996, pp. 267-276.
(24) Melliti (Imed), « Récits de vie et pratiques alimentaires ; origines, identités et biographies », in Milliti (Imed) et Najar (Sihem), Se nourrir en Tunisie, traditions et dynamiques actuelles,), Beyrouth, Entreprise Universitaire d’Etudes et de Publication, 2008, p. 67.
281
)25( 200742
(26) Ferchiou (Sophie), « Différenciation sexuelle de l’alimentation au Djérid (Sud tunisien) », revue L’Homme, n°2, volume 8, 1968, p. 76.
(27) Lévi-Strauss (Claude), L’origine des manières de table, op.cit, p.400. (28) Moreau (Jean) et Ardry (Robert), « Un aliment nord-africain : le couscous,
composition, fabrication, préparation », Archives de l’Institut Pasteur, Tunisie, 1942, p. 310.
)29( Bachelard (Gaston), La terre et les rêveries du repos, Tunis, Cérès Editions, 1996, p.272
(30) Corbeau (Jean-Pierre) et Poulain (Jean-Pierre), Penser l’alimentation, Entre imaginaire et rationalité,Toulouse, Privat, 2002, p. 42.
(31) Mauss (Marcel), « Les techniques du corps », in Sociologie anthropologie, Quadrige -PUF, 1983, pp. 365-386.
(32) Douglas (Mary), « Les structures du culinaire », revue Communication (Canada), année 1979, volume 31, n° 31, p. 165.
(33) Ibid., p. 150. (34) Najar (Sihem), Pratiques alimentaires…, op.cit., p. 174
)35(
200820.
(36) Gobert (E.-G.,), op.cit., pp. 15-16. (37) Mahfoudh (Dorra), « Rites alimentaires, rites matrimoniaux dans la société
tunisienne », revue Ibla, Tunis, n°170, 1992, p. 221. (38) Kaufman (J.-P.), Casseroles, amour et crises. Ce que cuisiner veut dire,
Paris, Armand Colin, 2005, pp. 134-135. (39) Bourdieu (Pierre), La distinction, critique sociale du jugement, Tunis,
Ed. Cérès, 1995, pp. 280-281. (40) Hubert (Annie), « Cuisine et politique, le plat national existe-t-il ? »,
Revue des Sciences Sociales, n° 27, 2000, p.8. (41) Poulain (J.P), Sociologie de l’alimentation, Toulouse, Privat, 2002, p.174. (42) Ibid., p.186.
)43( 43
022012
282
(44) Fischler (C.), L’Homnivore, le goût, la cuisine et le corps, Paris, Odile Jacob, 1990, p. 70.
(45) Hubert (Annie), Op.Cit. p.10. (46) Calvo (Manuel), « Migration et alimentation », Cahiers de Sociologie
économique et culturelle, N° 4, 1985, pp. 52-89. (47) Ibid. (48) Hassoun (Jean-Pierre) et Raulin (Anne), « Homo exoticus », in Bessis
(Sophie) (sous la direction de.), Mille et une bouches, Coll. Mutations/Mangeurs, n° 154, Paris 1995, pp. 119-129.
(49) Fishler (Claude), op.cit.
285
1618
/
جامعة خميس مليانة / 3
Résumé
Les résultats de l’étude ont bel et bien démontré le rôle des
associations sportives de proximité grâce aux moyens et aux
programmes dont elles disposent pour l’encadrement des adolescents,
en les incitant à la pratique des activités sportives de loisir q
ui jouent un rôle très important dans leur développement physique,
mental et social.
299
12
1.12
2
2
4 0.05 9.49 202.93
3 0.05 7.81 119.23
1 0.05 3.80 50
5 0.05 3.08 65.83
5 0.05 3.08 50
5 0.05 599 50
2 0.05 7.81 16.96
022012
300
3 0.05 3.80 14.34
5 0.05 3.80 410.5
1 0.05 3.80 1102.08
1 0.05 3.80 410.5
1 0.05 3.80 53.68
2.12
022012
302
3.12
2
2
1 0.05 3.80 181.75
1 0.05 3.80 203.31
3 0.05 7.81 11.31
1 0.05 3.80 11.17
1 0.05 3.80 1851.28
1 0.05 3.84 10.17
1 0.05 3.81 228.17
022012
314
(1) Dominique De Guibert, Créer, Animer, Gérer, Dissoudre Une Association,
éd Maxima, Paris2007, P:15. 2
1965444 3
20054344 4
2009
5 2010
6 1199952
7 - 7199699125
8 2 199673
9 200773
10 200653
315
Résumé :
Le but de cette étude est de connaitre et de traiter le sujet de
la stratégie sportive appliquée par les fédérations sportives algérienne
et sa réalisation sur le terrain, tout en prenant en considération la
compétence et la suffisance des ressources humaines employées par
ces fédérations, ainsi que la suffisance des ressources financières pour
la réalisation des objectifs tracés par ces fédérations sportives.
325
10
11 18 49 82 24.06
11
47 78 13 22 19.26
12
26 43 34 57 1.06
13
20 33 40 67 666
14
32 53 28 47 0.26
15
36 60 24 40 2.4
20.053.84
10 82
022012
326
8 70
2004
14 3.7
3
2
16
10 17 50 83 26.66
17
43 72 17 28 11.26
18
52 87 08 13 32.26
19
25 42 35 58 1.66
329
1 200921
2 le Petit larousse, Ed,2001.320 4
1200910 52200730 6200135 7160 8 20099
9 www. wajst 26.123/news articles/20 le structure milieu jeune. html 10
200311 11
2010153 12 11 13
2004100 (14)110
151995102
331
Résumé :
Avec des besoins specious, y compris les personnes handicapées physiques dans le besoin d'activités sportives et physiques en raison de leur rôle actif dans le développement de leurs capacités et contribuer au traitement de divers aspects, en particulier les physiques, il devrait donc être d'intérêt pour cet aspect et de renforcer toutes les possibilités disponibles
345
)1( 199029
)2( 199622
(3) www.bahrainonline.org/ showhread- vu 22/06/2012. 19:57. )4(
200581 )5(
200602 )6(
201088
)7( 200117
)8( 46 )9( 47 )10(
200840،39 )11(
20083332 )12(
349
511
511
Résumé:
Cette étude vise à mettre en évidence le motif de l'écriture historique, un sujet de la généalogie, qui a porté sur sa culture arabe et islamique depuis les premières conventions et a continué dans le reste des termes historiques de ceux-ci.
En Andalousie et de l'écriture dans les lignées trouvé un terrain fertile pour elle et cet isolement de l'île et de distinction géographique, en plus de la multiplicité des éléments sociaux a entrainé dans l'intérêt des auteurs à écrire des livres est apparu dans la généalogie dans ce domaine. Le plus important de ce qui a été écrit pendant du 5eme siècle /11m, Dans cet article, j'ai choisi Ibn Hazm que les historiens de premier plan dans ce domaine de la connaissance historique et la définition de celui-ci et d'étudier son livre "La population lignées Arabe" en termes de son contenu, et des sources invoquées, et la méthodologie utilisée dans ce livre.
022012
354
26–
27
511402101128.
4041013
4081017
4091018 414 1023 417
422102710312930 4221031
31
43346910421069
359
)1( 1967
33 )2(
198340 )3(
196314 )4(
19883173
1997298
1997 391 193616
237 2 198215472
)5( 332 130 20012133
20008131 )6(
21213 )7(
1997399400
022012
360
)8( 1838 3741
1979 40 102104138139
19952183 )9(
194042 )10(
19838 )11( 21981
75 )12( 302
181364
1960196623061972
146 )13( 12235236 )14(
195983
361
)15( 1968 3 322
10 1975 1 402
)16(
1986510301 )17(
20032333
)18( 197511142
)19( 112184 )20(
1982140 )21( 5
1978248249 )22( 2334 )23( 365
1955174213 )24( 3169 )25(
1981211 )26(
2002173
022012
362
)27( 140 )28( 251 )29( 181 )30( 262 )31( 40 )32( 2170 )33( 4
197712 )34( 6474850515259122321 )35( 5758 )36( 5560 )37( 586163 )38( 71 )39(
21988211 )40( 12
3738224
1415 )41( 36 )42( 6 )43( 49549814 )44( 487490
363
)45( 1956
1961970150 )46( 506 )47( 511 )48( 1415 )49( 212 )50( 2632336388118124398 )51(
200190 )52( 85214 )53( 85214 )54( 6690
Revue des Sciences
de l’homme et de la Société
Périodique international à comité de lecture Publié par la Faculté des Sciences Humaines et Sociales
Université -Biskra- Algérie
ISSN 2253-0347
N°2
Juin 2012
Dépôt Légal 1695-12
Revue des sciences de l’homme et de la société
3
Les « révolutions 2.0 » des facebookiens dans
l’espace arabe
Dr. Daoud Djefafla
UFR de Communication – Université Paris XIII
Laboratoire LabSiC MSH – Paris Nord (France)
Abstract:
La problématique de cette étude est d’examiner la question
selon laquelle « les révolutions arabes » de 2010 sont le produit des
réseaux sociaux (Facebook et ses compagnie). L’hypothèse qui essaye
à répondre à cette question s’articule sur l’idée selon laquelle : « les
printemps arabes » ne sont pas le résultat de seuls les médias
électroniques mais il y a aussi d’autre élément qui sont impliqués dans
les événements de protestation.
2010
Juin /2012 / n°2
4
Introduction
Dans une grande partie des pays arabes, la fin de l’année 2010
est marqué par le déclanchement des plusieurs de protestations
« populaires » contre les régimes politiques en place ce que s’est
traduit, par exemple, par la chute des présidents tunisien Benali et
l’égyptien Moubarak ou par la guerre civile au Yémen et en Syrie, etc.
Le point commun qui rassemble tout ces mouvements de
revendications est c’est qu’ils se sont produites sous le signe de
métamorphoses révolutionnaires véhiculées souvent par de multiple
dispositifs de communication. La forte présence des médias et de
nouvelles technologies de l’information et de la communication
(NTIC) a laissé de nombreux chercheurs qualifier ceci comme des
révolutions des communications (Dagnaud, 2011).
Cette attitude s’articule sur des faits techniques comme
l’usage l’Internet (réseaux sociaux, blogs, courriels, etc.) par les
protestataires et par leurs adversaires, ou comme l’utilisation des
NTIC (Smartphones, terminaux téléphoniques, caméscopes
numériques, etc.).
Le recours à ces moyens et à ces dispositifs pour la production
et la diffusion des continus sur l’actualité en cours a donné naissance à
des nouveaux énoncés à l’instar de « les révolutions numériques
arabes(1), les révolutions de Facebook, le printemps arabe des
fecebookiens, etc. ». Ce qui est frappant dans tout ces énoncés et bien
Revue des sciences de l’homme et de la société
5
d’autres c’est d’abord la mise en évidence du caractère révolutionnaire
sur les événements qui se produisent, ensuite c’est le résumé de toute
implication médiatique ou communicationnelle dans ce qui se passe
aux seuls les nouveaux médias en oubliant la contribution des grands
médias à l’instar des chaînes panarabes Al Jazeera et Al Arabiya dans
la production et la diffusion des flux informationnels, et enfin
l’articulation entre ces deux éléments ce qui résume la situation,
qualifiée en révolution, qu’elle est faite uniquement par les jeunes
(seuls maitrisent le net) dans l’espace arabe.
A partir de ce constat, une question importante se dessine
selon laquelle serait-il possible de qualifier ce qui se passe dans une
grande partie des pays arabes comme un printemps numérique ou dire
en d’autre termes qu’il s’agit d’une révolution digitale ? Cette
interrogation est la traduction d’une problématique qui consiste à
comprendre les mouvements de protestations ; sont-ils le résultat
engendré d’une articulation entre produits et diffusions médiatiques
numériques ce qui, par conséquent, donne à Internet le statut d’un
acteur singulier qui agit seul sur le terrain social et qui résulte d’un
coté la mise à l’écart de tout autre médiateur quelque soit sa nature
(télévision, presse écrite, etc.) et de l’autre coté l’élimination de toute
autre protagoniste de revendication (pouvoir et opposition politique,
syndicat, association, etc.). Pour répondre à ce questionnement, il faut
examiner une thèse selon laquelle les mouvements des protestations
dans les pays arabes ne sont pas le résultat d’une médiation faite par
Internet mais ils sont des actions autonomes relèvent d’une
Juin /2012 / n°2
6
métamorphose sociale et politique globale dont ce média, Internet,
joue un rôle parmi d’autres qui reste amplifier. A partir de cela, il
semble pertinent, afin d’examiner cette hypothèse de mettre en relief
l’approche et la méthode de recherche de cette étude.
1. Approche et méthode de recherche
Cette étude s’articule sur deux piliers ; théorique et empirique. Le
premier l’encadre sur le registre des concepts et le second la mettre
dans son contexte social.
1.1. Le fondement théorique : une approche foucaldienne
Le fondement théorique de cette étude s’articule sur les
éléments qui constituent son titre, à savoir, les facebookiens et leurs
actions, « les révolutions », et l’espace arabe. Ces sujets renvoient à
des concepts clés. Explication. Ce qui parle de la nouvelle génération
évoque nécessairement des protagonistes, les facebookiens en
l’occurrence, qui agissent dans un terrain bien défini, celui de « la
révolution », avec des moyens et pour des fins. Ceci dit, il s’agit d’une
lutte entre des acteurs dotés d’un « pouvoir » dans un « champ » de
confrontation entre différents personnages qui utilisent un « discours »
propre à eux pour gagner leur « guerre » qui engendre une violence
réelle et qui se traduit sur le web par une violence symbolique. Donc,
il s’agit d’une confrontation entre plusieurs acteurs (gouvernements,
oppositions) qui font usage à leurs pouvoirs respectifs, et chacun
d’entre eux et par son discours spécifique, dénonce la position de
Revue des sciences de l’homme et de la société
7
l’autre dans le pays ou se déroule « la révolution » qui est le champ de
la lutte. Cette explication, qui se base sur l’emprunt et l’usage des ces
concepts (le pouvoir, le discours, le champ) dans cet article pour
démontrer les enjeux des ces « révolutions » dans l’espace arabe,
nécessite la mise en relief de leurs origines, leurs significations et
enfin la manière dont ils sont empruntés et utilisés. Tout cela sera
expliqué ainsi :
Pour commencer, il faut retrouver les origines du concept du
« pouvoir » dans l’œuvre de Michel Foucault dont il a consacré une
grande partie de ses études cliniques. Selon lui, le pouvoir n’est pas
une chose acquise dans les mains de quelqu’un qu’il le manipule selon
son désir, mais c’est un sujet qui se trouve en action permanente au
sein de la société et passe entre tous, pour rassembler ou disperser les
uns et les autres. Cela dit que le pouvoir « ne s’applique pas,
purement et simplement, comme une obligation ou une interdiction, à ceux qui ‘ne l’ont pas’ ; […] il les investit, passe par eux et à travers eux ; il prend appui sur eux, tout comme eux-mêmes, dans leur lutte
contre lui, prenant appui à leur tour sur les prises qu’il exerce sur eux » (Foucault, 2003, p.31-32). Ainsi, le pouvoir ne se possède pas
mais il s’exerce puisqu’il est considéré comme un acte ou comme le
qualifie Foucault un mode d’action, (Foucault, 1984, p. 313). C’est cet
aspect-là du pouvoir qui nous intéresse c’est-à-dire en tant que mode
d’action que nous tentons d’utiliser dans un contexte médiatique pour
examiner le pouvoir des réseaux sociaux utilisés dans « les
révolutions » arabes et derrière eux les facebookiens. Pour le faire,
Juin /2012 / n°2
8
notre inspiration va au travail de J-P. Esquenazi : Le pouvoir d’un média : TF1 et son discours dans lequel il souligne qu’une théorie du
pouvoir exercé par la télévision ne peut pas être définie selon le
binôme pouvoir/domination et affirme qu’ « un média ne peut pas s’imposer à son interlocuteur (…) il ne l’enferme pas, ne l’oblige à
rien » (1996, p. 21). En revanche, il trouve que la chaîne de TF1
exerce son pouvoir par l’ensemble de ses « actions » à quoi s’obligent
ces partenaires, en l’occurrence les interlocuteurs, pour en devenir des
téléspectateurs (Esquenazi 1996, p. 25-26). A partir de là et pour notre
sujet, il nous semble que le pouvoir d’Internet du « révolutions »
s’émerge dans le fait d’établir un rapport avec ses internautes et de
« signer » avec eux un « contrat moral » qui consiste à naviguer sur
son produit numérique. Dans ce « contrat », ce nouveau média est
satisfait de simple présence des individus devant le poste informatique
connecté sur leurs sites et son pouvoir est déjà bâti. En ce qui
concerne l’autre partie du contrat, les potentiels internautes ont
effectué leur connexion, comme le dit Esquenazi, « au nom des
contenus de ses émissions » (1996, p. 27), autrement dit, au nom de ce
qui est mie en ligne. D’après cela, le pouvoir des nouveaux médias
dans l’espace arabe « révolutionnaire », conçu comme des relations
avec ses internautes et son action envers eux, est déterminé par son
produit numérique et sa pratique sur la Toile. Dès lors, nous pouvons
dire que « le pouvoir » de Facebook, des blogs et du reste des réseaux
sociaux dans la situation des « révolutions » arabes peut s’articuler sur
Revue des sciences de l’homme et de la société
9
deux axes. Primo, tenter de conquérir les usagers d’Internet dans
l’objectif d’avoir une place au coté du reste des médias dans l’espace
arabe. Secundo, exercer, par son pouvoir, la fonction d’être dans
l’espace arabe. A partir de là, nous pouvons retenir du pouvoir
foucaldien deux caractéristiques d’une grande importance qui nous
serviront pour notre travail : les relations et l’acte qui constituent le
pouvoir. Cette question permet d’évoquer les modalités d’exercice du
pouvoir. Il s’agit là des instruments qu’il se donne, du champ où il
intervient et du réseau qu’il dessine. Tous ces éléments se manifestent
dans son discours. A partir de là, il est nécessaire de mettre en
évidence le discours des réseaux sociaux dans « les révolutions »
arabes comme une action médiatique, c’est-à-dire une pratique
numérique complexe, et de déterminer, par conséquent, les
instruments qu’elle utilise, le/les champ(s) où elle intervient et le
réseau qu’elle dessine. Cette question est le sujet du point suivant.
Restons toujours sur notre approche foucaldienne. Le philosophe
ne voit pas le discours comme l’ensemble des choses dites et la
manière dont elles sont dites, ni comme des rapports de duels entre un
discours dominant et un autre dominé, avec entre eux la barrière des
classes. Foucault observe le discours comme l’ensemble d’énoncés en
tant qu’ils appartiennent à la même formation discursive (1969, p.
153). Il est le champ « stratégique, où les éléments, les tactiques, les armes ne cessent de passer d’un camp à l’autre, de s’échanger entre
les adversaires et de se retourner contre ceux-là mêmes qui les utilisent » (Foucault, 1994, p. 123). Donc, le discours est d’abord
Juin /2012 / n°2
10
« une formation » qui a ses propres « règles » qui lui donnent sa
fonction en tant que créateur des rapports, entre les parties, et sa force
comme origine du pouvoir. Cela dit, il faut observer le discours
comme « un champ » (Bourdieu, 2002, p.114) c’est-à-dire comme un
lieu d’affrontement. Il est le lieu de lutte, parce que la position
occupée, par chaque acteur (média et ses interlocuteurs), détermine la
nature de lutte et définit comment les échanges des éléments de lutte
se font. Il est aussi un instrument parce que les armes utilisées par
chaque acteur et les tactiques menées par eux définissent l’enjeu et la
contradiction de la lutte. Dans cette perspective, comment cerner ces
« règles » selon lesquelles le champ de lutte se construit et les
éléments qu’utilisent dans le discours des nouveaux médias dans
l’espace arabe ? Pour le faire, il faut observer le discours numérique
de la générations Facebook non pas comme un texte de langage, mais
comme un fait social qui a deux dimensions : une informative, celle
qui concerne ses objets (les textes qui parlent du rassemblement du
place Tahrir, la vidéo d’un accrochage armé entre rebelle libyens et
force de l’armée, etc.) et une indicative qui se porte sur le discours
même parce qu’elle détermine les relations de pouvoir produites par
ce discours, (la hiérarchisation du rassemblement du place Tahrir par
rapport aux autres informations, le choix de réaliser une vidéo, etc.).
C’est pourquoi la compréhension du discours passe nécessairement
par la saisie de la dimension indicative.
Revue des sciences de l’homme et de la société
11
En fait c’est celle-ci qui construit « le lien entre le discours et celui qui l’écoute : elle rassemble ce que le discours indique comme
ses présupposés ; et la compréhension de ceux-ci par les auditeurs leur permet d’accéder au sens de ce qui est dit concernant les objets ». (Esquenazi 1996, p. 30) C’est dans ce sens que nous
essayons de cerner la fonction « indicative » du discours de face book,
des blogs et les autres technologies dans « les révolutions » arabes,
comme des règles et des pratiques, et par conséquent saisir le rapport
du nouveau médias avec son interlocuteur pour un objectif : mettre en
évidence son pouvoir. Autrement dit, il faut déterminer « le régime de
communication » propre à ces médias électronique. Dans ce sens-là et
à partir de ces règles-là, le discours médiatique peut s’opérer sur le
monde dont lequel il « sélectionne ce dont il parle ; il choisit certains aspects, attribue des positions, et attribue des liens entre les objets »
(Esquenazi 1996, p.32). Grosso modo à partir de sa vision du monde,
le discours médiatique construit son propre monde. Voilà, nous y
sommes, le discours communicationnel des réseaux sociaux, comme
action médiatique, comme pratique numérique et comme fait social
établit des rapports par lesquels il exerce son pouvoir. Celui-ci se
manifeste par la sélection des énoncés, le choix de certains aspects,
l’attribution des positions et les liens entre les objets. Dès lors, il est
pertinent de s’interroger : comment les médias numériques des
« révolutionnaires » arabes instaurent un lieu d’affrontement et
comment récupèrent-ils les instruments de lutte ? Ou encore et
puisque le discours est l’arme du pouvoir de « qualification et
Juin /2012 / n°2
12
disqualification » (Foucault 1994, p. 124), il est important également
de poser la question : que qualifient-ils (ou disqualifient-ils) dans leurs
discours ? Comment et pourquoi elle le fait ? En un mot, il faut faire
apparaître le discours électronique des réseaux sociaux comme un mode opérateur.
1.2. Le volet empirique
Le voler empirique de cette étude, qui permet de mettre en
examen l’hypothèse de cette recherche, s’articule sur deux éléments :
une enquête réalisée spécialement à cette fin et se déroule en deux
phases et un corpus qui représente des pages de Facebook et des blogs
examinés également pour le présent article. Explication.
a) Les entretiens
Les entretiens de cet article ont été réalisés par téléphone
depuis Paris avec 20 individus facebookiens (qui font usage ou qui
navigue seulement sur Internet), qui représentent six pays arabes. La
Tunisie, la Libye, l’Egypte et la Syrie sont évoqués par quatre
participants, le Bahreïn et le Yémen sont représentés par deux
participants pour chaque pays. En outre, les interviewés âgés de 18 à
40 ans, ils ont des niveaux éducatifs disparates qui se situe entre le
primaire et l’universitaire. Selon les statistiques, 6 sont arrêtés leurs
scolarités à l’école primaire, 5 ont acquêt le diplôme du collège, 7 sont
des lycéens et 2 diplômés de l’université. Pour l’usage de
l’informatique, 4 individus déclarent posséder des ordinateurs et des
Revue des sciences de l’homme et de la société
13
terminaux mobiles pour accéder aux réseaux sociaux, 5 d’entre eux
disposent uniquement d’une machine chez-eux et 10 vont au
cybercafé. Pour la situation financière, il y a 7 participants qui ne
trouvent pas de problèmes pour se connecter à tout moment, 10 qui
utilisent internet presque régulièrement mais avec un temps limité car
les moyens financiers le permet mais sous certaines conditions et 3
participants avouent qu’ils cotisent avec d’autres amies ou voisins
pour accéder à un poste informatique en groupe. Enfin, il est
important de souligner que les entretiens ont été réalisés séparément
dans une période qui se situe entre le premier janvier et le 30
septembre 2011 et qui ont duré, en moyenne, une heure et demi pour
chacun. Il s’agit de mener des entretiens approfondis avec l’ensemble
des participants sur deux phases ; des moments semi-directfis et des
entretiens de remise en situation qui a consisté à s’appuyer sur les
pages de Facebook qui font objet d’usage des participant entant
qu’auteurs ou que lecteurs. Tunisie Libye Egypte Syrie Bahreïn Yémen
Participants 4 4 4 4 2 2
Filles 3 2 1 3 1 2
Garçons 1 2 3 1 1 0
Figure 1 : les participants à l’enquête
b) Le corpus
Juin /2012 / n°2
14
Le second élément empirique de la présente recherche se
construit par 30 unités de contenu qui se présentent sous pages
Internet de trois catégories ; les réseaux sociaux (Facebook et Twitter)
et les blogs mies en ligne pendant la période allant du 1er janvier 2011
et le 30 septembre de la même année et qui concernent les six pays
arabes déjà évoqués, à savoir, l’Egypte, la Tunisie, la Libye, la Syrie,
le Bahreïn et le Yémen. Les unités de ce corpus sont distribuées ainsi :
Tunisie Libye Egypte Syrie Bahreïn Yémen
Facebook 2 2 3 4 3 2
Twitter 1 0 2 2 0 0
Blog 2 2 3 1 1 0
Total 5 4 8 7 4 2
Figure 2 : les unités selon les pays et le genre médiatique
Dans ce corpus, nous avons choisis les unités qui sont produite
par des personnes physiques et par conséquent les blogs des
associations ou les pages Facebook institutionnels, par exemple, ne
figure pas dans l’échantillon à examiner. En outre, les unités pris en
considération sont seulement les contenus produits à l’intérieur des
pays concernés. Autrement dit, les blogs des oppositions politiques
exilées, par exemple, ne font partie de notre corpus. Ceci pour mesurer
Revue des sciences de l’homme et de la société
15
l’autonomie de l’action de « la génération Facebook » dans les pays
concernés.
A présent et après la mise en lumière des deux fondements
(théorique et empirique) de cette recherche, nous commençons, dans
le cadre de l’examen de l’hypothèse de notre étude, par la mise en
relief de la genèse des « révolutions arabes ».
2. La genèse de la « révolution 2.0 » dans l’espace arabe
L’implication d’Internet (réseaux sociaux, blogs) dans « les
révolutions arabes » ne constitue pas la première médiation des
mouvements de révoltes des populations arabes. Il existe de mise en
médias des ces protestations par des grands acteurs
communicationnels dans la région du Moyen Orient et l’Afrique du
Nord à l’instar ce qu’a fait la chaîne qatarie Al Jazeera en médiatisant
largement l’action du jeune tunisien Bouazizi et les manifestations qui
ont suivie dans son pays par plusieurs dispositifs audiovisuels ;
reportages, décryptage, débats et analyses. Du coté de la Toile, il faut
enregistrer le contenu du frère de cette télévision, le site
<www.aljazeera.net>, qui a accompagné son flux informationnel
proposé aux internautes sur ces événements par des contenus inédites
selon de multiples formats ; analyses, commentaires, tribunes libres,
etc. dont lesquels, cette plateforme a donné la parole à plusieurs
protagonistes tunisiens notamment Rached El Ghanouchi.
A partir de cela, un constat s’impose : la médiation de cette
télévision constitue la première action dans le champ médiatique à
Juin /2012 / n°2
16
proximité régional (arabe). Dans ce sens, la télévision française n’a
pas manifesté d’intérêt à ceci que tardivement. L’explication de cela
peut être trouvée dans les réactions de Paris sur le sujet. Ce que peut
être souligné de cette première médiation est que la mise en avant du
mouvement des contestations dans l’espace arabe est née au départ par
un média classique, Al Jazeera en l’occurrence, et qu’Internet a
regagné le champ de la médiation dans un deuxième temps. Dans cet
esprit, l’arrivée du Web sur le champ médiatique des événements
trouve ses origines dans quelques facteurs qui sont :
Le recours aux nouveaux médias par les internautes dans
l’espace arabe dans leurs luttes politiques contre les pouvoirs en place
trouve ses origines dans ce que peut être appelé « un dispositif près à
utiliser ». En fait, il s’agit de la disponibilité des nouveaux médias
avant le déclanchement des événements c’est-à-dire l’existence des
pages de réseaux sociaux (Facebook et Twitter) et des blogs utilisés
pour d’autre fin (culturel, social, sportif, etc.). Donc il s’agit d’une
acquisition de la plateforme c’est-à-dire le dispositif technique et puis
l’aspect humain c’est-à-dire l’expérience de la manipulation de la
technique ou comme l’appelle les sociologues des nouveaux médias
l’environnement numérique entendu ici comme l’ensemble des
technologies et des instruments numériques, les usages et les pratiques
qui le rendent possible (Doueihi, 2011, p.40).
A ce stade là, les internautes « révolutionnaires » n’ont qu’à
traçinsformer la nature de l’usage vers la politique. Pour résumer, il
Revue des sciences de l’homme et de la société
17
faut dire que la disponibilité d’un dispositif technique, l’acquisition
d’une expérience dans la manipulation et le transfère des attributions
jouent un rôle important dans la propagation des contenus numériques
contestataires dans l’espace arabe.
L’implication des masses dans la révolte constitue un élément
important dans l’amplification de l’usage des nouveaux médias. La
sortie massive des révoltés dans les places publiques et les rues
engendre un résultat important ; l’augmentation de nombres de
participants de l’alimentation des nouveaux médias au niveau
quantitatif. Il s’agit là de l’arrivée des centaines des images vidéo, des
témoignages, des nouvelles des manifestations, etc. Tout ceci amplifie
l’offre de contenu des nouveaux médias et par conséquent la
satisfaction de davantage des internautes qui veulent, dans l’absence
des informations sur ce que se passe par les médias classiques, savoir
les évolutions des événements. Il y a là une observation importante à
marquer : les nouveaux médias dans l’espace arabe se consacrent dans
la réalité communicationnelle au coté des médias classiques par leurs
productions massives de contenu. Ces acteurs numériques qui se sont
implantés dans le champ médiatique, jusqu’au là réservé aux grands
médias, sont les créateurs d’un nouvel environnement
communicationnel digital.
2.1. La parole des blogueurs
Dans les sociétés occidentales, le blog est conçu pour être une
tribune d’opinion car il est considéré comme l’incarnation du rapport
Juin /2012 / n°2
18
entre le citoyen et la chose publique parce que dans la blogosphère,
l’internaute veut s’informer par lui-même et développer de nouveaux
modes d’engagement. Si dans les démocraties occidentales, les
blogueurs ne substituent pas aux journalistes et les blogs n’ont pas
vocation à remplacer les médias, dans l’espace arabe les choses sont
moins clair. En effet, vue plusieurs facteurs qui pèsent sur les médias
arabes ; l’emprise des pouvoirs politique ou financier, l’attachement
organique des moyens de communication aux corporations
d’influences, etc., le travail journalistique ne semble pas toujours en
mesure de satisfaire les exigences professionnels du métier, le produit
médiatique vie souvent sous l’ombre de la subjectivité et la médiation
est souvent la victime de la vision personnelle du médiateur.
Dans cette situation intervient le blog et son auteur dans
l’espace comme alternative par fois mais comme source d’information
souvent. Dans ce cas le web est le moyen de communication de ceux
qui sont mal représentés dans les médias traditionnels, voir qui en sont
exclus (Flichy, 2010, p. 58). Considéré comme un point de publication
structuré selon l’ordre chronologique inversé, dont l’auteur peut être
un seul individu ou un groupe de rédacteur, le blog qui n’est pas tenu
de se concentrer sur un sujet particulier et peut couvrir un large
éventail de question, (Doueihi, 2011, p. 112) joue dans les
« révolutions » arabes un rôle majeur. Dans cet esprit, Ali, un
blogueur tunisien de 28 ans nous explique :
Revue des sciences de l’homme et de la société
19
« A travers mon blog, j’ai suivie la révolution moment par moment et j’ai transmis les nouvelles des événements a tout le
monde »L’action du blogueur dans la chose publique prend plusieurs
formes et dans le cas des « révolutions arabes » elle se varie entre la
parole du l’expert, le dit d’un témoin, etc. Explication :
La lutte des jeunes « révolutionnaires » arabes via les réseaux
sociaux tient à opposer le pouvoir des régimes en place par leur propre
pouvoir. Dans ce sens, vient la production d’un discours opposé à
celui des autorités. Pour comprendre cette idée, il faut prendre
l’exemple d’un ancien policier égyptien résidant aux Etats-Unis
d’Amérique qui explique à ses concitoyens comment résister face au
gaz lacrymogène dans la rue et faire face aux forces de l’ordre sans
craindre leurs bombes. Par cette explication appuyée par des
illustrations, le blog de ce jeune policier devient le mode d’emploi
d’un dispositif sécuritaire contre celui du gouvernement. Ce blog
montre en vérité comment les internautes ont récupéré un fragment
dans le dispositif du discours du régime égyptien et comment ils l’ont
retourné contre lui. A ce stade, Wael, un blogueur égyptien de 26 ans
nous confirme que :
« Par le biais de mon blog que j’anime j’essaye de servir la
révolution car je me Contente pas du rôle de médiateur je veux être utile davantage par des actions … »
En effet, par leurs écrits et leurs témoignages, les internautes
des « révolutions » arabes ont démontré leurs capacités de mobiliser
Juin /2012 / n°2
20
Internet pour leurs causes et ont affirmé ce que disait Patrice Flichy
que l’activisme électronique permet de surveiller l’action des pouvoirs
publics, de dénoncer leurs agissements, de donner un sens aux
phénomènes sociaux et d’exprimer une opinion (2010, p.56) Cette
dénonciation prend deux formes ; rallier l’opinion et la maintenir en
éveil et la mobilisation de l’action qui transforme la sympathie en
opérations (Flichy, 2010, p. 59). Dans ce sens, il y a l’expérience d’un
blogueur syrien de 20 ans qui souligne que :
« Le but que j’ai fixé dans mon blog est de mobiliser le maximum de gens pour notre cause et faire rassembler des énergies autour d’elle »
2.2. Les pratique des facebookiens
Les réseaux sociaux et en particulier Facebook constituent
« l’image de marques » des « révolutions arabes ». Une grande partie
du succès du dispositif communicationnel trouve sa raison dans
l’usage de cette technologie par les différents protagonistes dans le
champ de la confrontation. La présence des réseaux sociaux dans ce
combat s’articule sur trois éléments ; la mise en place des groupes
amis, l’identification et l’action. Explication :
Pour la mise en place des groupes d’amis, les facebookiens
s’appuient sur plusieurs mécanismes ; la notoriété supra-numérique
d’une personne pour fonder une groupe actif. Ceci s’articule sur des
individus qui viennent d’autres champs (politique, médiatique,
culturel, etc.) et ramène leur package avec eux pour le mobiliser dans
Revue des sciences de l’homme et de la société
21
le nouveau champ médiatique à savoir ; les réseaux sociaux. Dans ce
registre, il y a le facebookien égyptien Wael Ghonime qui est le
représentant de la firme Goolge au Moyen Orient et qui devenu
pendant la « révolution égyptienne » un symbole singulier qui a
mobilisé les foule derrière lui. Sur un autre registre, il y a également
les fecebookiens qui se fabriquent aux seins d’un réseau social par
leur position et attitude qui se radicalisent ou qui critiquent
sévèrement les pouvoir en place. De toute manière, la stratégie de la
mise en place des groupes d’amis au sein des médias sociaux
(Facebook et Twitter) a montré son succès dans la mobilisation des
internautes et leur regroupent autour d’une cause comme nous
souligne Zahi, fecebookien tunisien de 20 ans :
« Dans ma page de Facebook, il y a de tout ; vidéo, image et information … mon but est de ne pas laisser le régime nous traite
comme des délinquants et de faire montrer notre cause à tout le monde »
Pour le deuxième élément qui est l’identification, nous
pouvons dire qu’elle s’articule sur le message même du groupe.
Autrement dit, sur le contenu choisi et véhiculé par les « les amis ». Et
là il y a la fameuse phrase de McLehan « le medium c’est le message »
trouve sa pertinence. Dans un deuxième temps de l’identification,
l’internaute dépasse le stade de la reconnaissance du message au stade
de l’adhésion qui se concrétise par l’appartenance au groupe comme
membre actif ou au moins comme sympathisant passif par le suivi et
Juin /2012 / n°2
22
l’implication dans le dispositif même s’il n y a pas de rentrée concrète
dans le mouvement.
L’adhésion de l’internaute dans la ligne directrice d’un
quelconque message signifie qu’il se reconnaît dans ce que dit une
telle page de Facebook et que son identité électronique déborde son
identité réelle car il n’est plus nommé X ou Y et il n’est plus résidant
dans un tel endroit mais plutôt un internaute attaché à cette page et ce
qu’elle contient. Le fecebookien ne s’identifie pas par « je suis » mais
par « j’aime » dans une déclinaison par le goût qui efface les
références socioculturelles au profit d’une complicité au sein de sa
propre génération (Dagnaud, 2011, p. 32) et dans le cas des
« révolutions arabes », il est le manifestant contre le régime syrien ou
le protestataire contre les politiques du Caire à l’instar de ce que fait
les autres internautes de sa génération.
Enfin, il y a l’action qui consiste à mettre en œuvre des
stratégies sur le terrain et sur ce point les facebookiens (actif ou
passif) investissent le terrain de la lutte par de différents modes ; des
rassemblements, des marches, distributions des tracts, la diffusions
des images (vidéo ou photographie). Cela peut être illustré par le cas
de Djalal Brik et son succès qu’internaute de diffuser ses massages en
mode vidéo qui portent ses opinions et ses commentaires à l’encontre
des armées et son commandement et qui ont fait réagir l’opinion
publique tunisien autour cette affaire(2).
Revue des sciences de l’homme et de la société
23
Dès lors et par un petit rappel : nous avons élaboré l’hypothèse
de cette recherche sur l’idée selon laquelle les « révolutions arabes »
ne sont pas le résultat du seul le facteur communicationnel représenté
dans ce cas là par les nouveaux médias (les réseaux sociaux). Dans la
continuité de cette idée nous allons essayer dans les deux points
suivants de démontrer les éléments qui laisse penser qu’Internet est la
cause principale des « révolutions arabes » et ensuite mettre en
lumière les facteurs qui milite pour l’idée selon laquelle ces
« révolutions » sont le fruit de plusieurs éléments complexe et divers.
3. Les éléments qui font penser qu’Internet est la cause des « révolutions arabes »
Les réseaux sociaux ont joué un rôle important dans le
déroulement des « révolutions arabes » ce qu’a laissé penser que ces
dernières sont le fruit de ceux-ci. Dans ce sens, il y a deux éléments
qui font émerger cette impression. Ils sont d’ordre médiatique et
politique.
3.1. La configuration du champ de médiation
Les « révolutions arabes » ont donné naissance à une
reconfiguration du champ de la médiation des événements de
contestation dans plusieurs pays. Elle se manifeste sur plusieurs
registres dont la création des rapports de coopération indirecte entre
médias classiques et nouveaux médias, la consécration des pratiques
électroniques comme des genres journalistiques indépendants (le
blog), etc. Explications :
Juin /2012 / n°2
24
Par exemple, il y a le blog qui a remis en cause le journalisme
traditionnel dans certains pays arabes et commence dorénavant à jouer
un rôle plus important dans la vie politique. Dans ce sens, les
pratiques de la blogosphère et bien d’autres dans l’espace arabe
peuvent redéfinir les sources et les méthodes qu’utilisent les personnes
et les collectifs pour échanger et évaluer les nouvelles au-delà de
l’emprise des médias classique. Dans cet esprit, le blog « est à l’origine de nouveaux modèles et de nouvelles technologies qui sont
en train de refondre la production de l’information sur l’environnement numérique puisqu’il s’agit d’un forum interpersonnel et intellectuel d’interaction et de production de savoir » (Doueihi,
2011, p. 105). Cette nouvelle refondation du contenu informationnel
offre aux nouveaux acteurs, les blogueurs en l’occurrence, de nouveau
positionnement dans le champ médiatique. Ainsi, ils peuvent acquérir
d’autre rôle social comme expert, observateur, etc. A ce stade là, il est
important, par exemple, de signaler la présence dans les médias de
nombreux blogueurs égyptiens comme des experts des affaires
égyptiennes dans le JT de TV5 Monde le 11 février pour commenter
le discours du président Moubark à la veille de son départ du pouvoir.
D’un point de vue communicationnel, « les révolutions »
arabes ont réorganisé les rapports entre les différents producteurs du
flux informationnel car désormais ce n’est pas les grand médias qui
détiennent le monopole de la diffusions des nouvelles et n’ont plus
l’exclusivité de médiatiser seuls les événements. Comme l’explique
Revue des sciences de l’homme et de la société
25
un fecebookien, les téléspectateurs semblent abandonner leurs postes
de télévision vers une autre destination. Interrogé par un journaliste,
un individu égyptien confirme que dorénavant « ce n’est pas moi qui
regarde la télévision mais plutôt la contraire c’est elle qui me regarde(3) ».
Sur une grande partie des « révolutions » c’est les réseaux
sociaux et les terminaux mobiles qui offrent aux publics les news de
ce qui se passe. Sous l’emprise du gouvernement, la chaîne de
télévision tunisienne Tunis 7(4).n’assure pas le droit de l’information à
leurs concitoyens et ses journaux télévisés n’évoquent guère les
marches des contestataires dans les rues tunisiennes. En Egypte, la
chaîne Al Masriya suit le même modèle. Les manifestants de place
Tahrir ne cachent pas leurs mécontentement de leurs télévision
nationale et hurlent « Al kadib Al hassri Ala télévision Al massri(5) ».
Dans cette rupture flagrante entre les téléspectateurs et leurs
télévisions, le contrat qui relie les deux partie et qui concrétise le
pouvoir des corporations médiatiques sur les publics semble résilier et
par conséquent ses dernier semble se libérer de toute emprise
télévisuelle sur leur destin.
Les rapports entre les médias sont eux aussi touchés par les
répercussions des « révolutions arabes ». Dans ce registre, nous
enregistrons un nouveau phénomène médiatique qui consiste à faire
des nouveaux médias des sources premières de news. Il devenu banal
de voir et d’une manière constante sur la chaîne Al Jazeera ou autres
Juin /2012 / n°2
26
des images tournés par des amateurs et empruntés d’un blog ou d’une
page de Twitter. Cette pratique explique une tendance de coopération
entre la télévision et le réseau social dans les échanges des nouvelles
(information ou image). C’est dans ce contexte qu’interviennent les
nouveaux médias en tant qu’alternative qui offrent aux publics
assoiffés aux nouvelles une offre de news diversifiée.
3.2. La configuration du champ politique
L’implication des nouveaux médias dans la vie politique
durant les mouvements de contestation de l’espace arabe a influencé
considérablement l’action politique dans certains pays de la région.
Cette influence montre encore uns fois les échanges des rapports de
force entre les différents protagonistes et par conséquent la
manipulation du pouvoir entre les mains des uns et des autres. Dans ce
contexte, nous observons l’exercice du pouvoir par les acteurs des
nouveaux médias (blogueur et facebookien) sur la le champ de la
politique. Explication :
Dans le premier gouvernement transitoire tunisien qui a été
formé après la chute du régime du président Ben Ali, il y a un
blogueur qui est nommé au poste de secrétaire d’Etat à la jeunesse.
Cette nomination explique le rôle important qui a joué les internautes
dans « la révolution du Jasmin » et qui est reconnue par la suite par les
Revue des sciences de l’homme et de la société
27
pouvoir publique par cette intégration au cabinet ménestrel. Il s’agit
ici d’un processus de connaissance et de reconnaissance (Bourdieu,
2002) de la part de l’acteur politique de l’internaute et de lui accepter
dans le champ politique au tant qu’acteur. Un autre exemple et cette
fois-ci de l’Egypte où le conseil militaire qui a prie le pouvoir après la
chute du régime a communiqué des informations sur sa volonté
politique de partir sur sa page Facebook et non pas par la télévision.
De ce fait, il parait que les fecebookiens sont réussi à s’imposer dans
le champ politique et imposer leur nouveau média comme un nouveau
pouvoir de communication. Cette infiltration dans le monde politique
touche pratiquement toutes ses facettes.
Un célèbre blogueur libyen a été tué par les forces du régime
dessous au début de la guerre dans son pays. Cette protagoniste, fort
activiste par sa parole et son image sur le Web, est tué parce qu’il est
considéré comme un acteur a part entière dans les jeux du pouvoir et
du positionnement dans le champ politique et n’est plus vue pas les
acteurs de son champ (le gouvernement ou l’armée) comme un simple
amateur du Web qui s’amuse à boguer sur la Internet mais comme un
professionnel du média qui constitue un danger pour le régime en
place.
Il a perdu son statut d’amateur pour devenir homme de
propagande (Flichy, 2010, p.58). Là également, Les réseaux sociaux
ont montré leur percé dans le champ politique et leur lutte a finie par
mettre en conflit leur pouvoir et le pouvoir politique.
Juin /2012 / n°2
28
Dans la configuration politique, il y a l’imposition des
internautes leur mode de communication dans le déroulement des
« révolutions ». Dans ce sens, il y a un exemple très intéressant. Il
s’agit de « l’Armée numérique syrienne » qui est institution autonome,
réelle et active sur Facebook et qui a pour rôle principale combattre
les facebookiens protestataires(6).
Cet exemple illustre parfaitement l’idée de Bourdieu sur « le champ » (2002) et montre comment le régime syriens investie le
champ du nouveau média par une corporation spécialisée dans les
attaques des blogueurs. Cette stratégie évoque la lutte entre deux
protagonistes dans le champ des médias numérique pour la
domination et pour s’imposer et avoir une place et ne pas laisser le
champ au seul adversaire. Le même exemple démontre aussi le
concept de Foucault du discours lorsqu’il le signifie comme une
appropriation des outils de l’autre pour les combattre avec leurs
propres armes. En effet, l’usage de l’armée syrienne du Facebook pour
lutter contre les facebookiens est signifiant car il vise à les combattre
par leur propre arme. Mai il n’y pas que cela, il y aussi le concept du
pouvoir qui se manifeste dans cet exemple. Il s’agit du positionnement
du régime syrien dans le champ de la lutte. Et comme le pouvoir n’est
pas un objet acquis mais un positionnement qui tisse des relations et
dirige des actes parce que en agissant ainsi, les autorités syrienne
s’offre une existence sur Facebook.
4. Les « révolutions arabes » ne sont pas facebookiennes
Revue des sciences de l’homme et de la société
29
Dans le point précédent, nous avons explique comment les
« révolutions arabes » peuvent être l’œuvre de Facebook et ses
compagnies. Maintenant, nous allons essayer de mettre en lumière les
facteurs qui nous laissent dire que ces « révolutions » sont le produit
de plusieurs éléments et ne sont pas le résultat de seuls les nouveaux
médias. 4.1. Le recours aux grands médias
Le recours aux grands médias dans les grands moments
signifie que les nouveaux médias n’ont pas encore en mesure d’être le
premier acteur dans le champ communicationnel et que l’exclusivité
reste toujours entre les mains de la télévision. Dans « les révolutions
arabes », plusieurs exemple illustrent parfaitement cette constatation
et défend l’idée selon laquelle l’audiovisuel reste la maître du jeu dans
les articulations des rapports entre communication et politique. Ainsi,
la fameuse déclaration de l’ancien président égyptien Hosni Moubarak
du 12 janvier 2011 et selon laquelle il doit annoncer son départ ou son
maintient au pouvoir a été diffusée sur la chaîne égyptienne El
Masriya(7).et reliée par plusieurs stations dans le monde. Egalement,
Aicha El Kadhafi, la fille de l’ancien leader libyen a accordé en
exclusivité à la France 2(8), une chaîne publique française, sa
déclaration destinée au français et au monde après le début des frappes
de l’Otan sur son pays. Toujours dans la même logique, il y a les
messages du Kadhafi d’après la chute de Tripoli sont diffusés sur la
chaîne syrienne Ar Raye.
Juin /2012 / n°2
30
Tout ces exemple et bien d’autre témoigne du poids que
dispose le Télévision comme medium dans les moments grave dans la
vie de l’humanité et que Internet n’est pas encore arrivé à acquérir cet
agora. Dans ce recours aux grands médias, il y a deux remarques à
faire et qui concerne le choix de télévision comme outil du pouvoir et
comme un dispositif discursif. Pour la première remarque, et dans tous
les exemples cités au-dessus, les politiques ont choisis la télévision
comme outil du pouvoir qui est dans leurs mais et qui les maitrisent
parfaitement. L’importance de ce choix réside dans le fait que ce
medium est conçu dans ces cas comme leur propre champ de lutte à
l’inverse d’Internet qui est le champ des « révolutionnaires » et par
conséquent il est important dans leur stratégie de guerre de mener les
affrontements dans un terrain connu et maitrisé. Donc, il s’agit de
question de manipulation du pouvoir. Pour la deuxième remarque, il
s’agit bien d’un choix d’un discours. Ceci s’explique par le poids
important que dispose la télévision dans le système
communicationnel. Donc le discourt télévisuel reste toujours le
dominant sur les autres médias nouveaux et classiques.
4.2. La crédibilité d’Internet
Malgré tout ce qu’a été évoqué, les réseaux sociaux et les
blogues soufrent toujours et en particulier dans l’espace arabe de la
question de la crédibilité. L’un des exemples les plus frappant est le
drame anecdotique d’une blogueuse syrienne qui a été enlevé par les
autorités de son pays parce qu’elle est homosexuelle selon son blog
Revue des sciences de l’homme et de la société
31
A Gay Girl in Damascus. Cette information diffusée sur Facebook et
Twitter a prie une grande ampleur même dans les grand médias et au
niveau international(9). quand tout-à-coup le monde découvre que la
fameuse blogueuse n’existe pas et il s’agit tout simplement d’un
internaute américain étudiant en Ecosse qui s’amusait à se faire passer
par une fille(10).
Cette histoire évoque d’une manière claire le problème dont
souffre Internet globalement qui est la crédibilité où la frontière entre
la réalité et le l’imaginaire est floue. En effet, la question de la véracité
est un souci majeur pour tout les médias mai elle reste, pour le Web,
un enjeu de taille car elle constitue le sens de l’existence même du
contenu numérique dans la mesure où elle veut se différencier des
autres médias qualifiés par leur homogénéité communicationnelle. Et
dans l’espace arabe, cette problématique de véracité et notamment
dans les produits des réseaux sociaux représente un élément important
qui joue un rôle vital dans la crédibilité non seulement des contenu
diffusé mais la crédibilité même des acteurs qui sont derrière ledit
contenu. Pourquoi ? Parce que les réseaux sociaux en général et dans
l’espace arabe en particulier se présente comme alternative aux grands
médias, qui ont perdu en Occident leur aura et en Orient leur public.
Donc, pour les protagonistes, de Facebook et ses compagnie
dans l’espace arabe, la vraie question est ne pas comment dire ou quoi
dire mais surtout la question de dire la vérité et par conséquent voir
qui dit la vérité. En effet, la crédibilité des jeunes internautes et leur
action dans la chose politique en tant qu’acteur est conditionnée par la
Juin /2012 / n°2
32
crédibilité de leur parole véhiculée par le biais leur diffusion
numérique.
Conclusion:
En concluant cette recherche, nous pouvons confirmer l’idée
selon laquelle les réseaux sociaux ne sont pas la seule raison des
« révolutions arabes » et que les médias électroniques n’ont pas fait
« les printemps arabes » par la simple diffusion du flux
informationnel, par le partage des vidéos des événements sanglantes
ou par l’appel à manifester ici ou là, etc. Au-delà de cette principale
observation, il y a d’autres remarques qui méritent d’être signaler :
Les chutes des différents régimes dans quelques pays arabes ne
trouvent pas ses origines dans ce qu’ont fait les médias électronique
mais plutôt dans d’autres facteurs notamment politiques. Les
exemples qui illustrent ceci sont multiples. La chute de la Jamahiriya
a pour cause l’intervention militaire de l’Otan au pays, le départ de Ali
Revue des sciences de l’homme et de la société
33
Saleh et négocié avec les gouvernements et son régime reste en place
et pareillement en Egypte ou le Conseil militaire qui gouverne est le
produit du président déchu. A partir de cela, il nous semble que « les
révolutions arabes » sont loin d’être le fruit de Facebook et que leur
finalité n’est toujours pas la même.
La pratique des internautes dans les pays arabes qui consiste à
mettre en avant un mouvement de contestation véhiculé par les
réseaux sociaux n’est pas une pratique inédite car nous pouvons
enregistrer des mouvements similaires qui a connu l’Occident dans
plusieurs capitales du monde comme Madrid, Londres, New York et
qui est connu sous le nom des indignés. Ses mouvements ont suivi le
même cheminement de ceux des pays arabes sauf à leurs objectifs qui
n’étaient pas « la démocratisation de leurs pays » mais des
revendications sociales et économiques (Dagnaud, 2011, p.99).
Sur le registre communicationnel, « les révolutions arabes »
ont démontré deux réalités. D’abord, les médias classiques (télévision
notamment) conservent leurs poids dans le champ médiatique et dans
les jeux du pouvoir entre les acteurs politiques. Dans ce sens, nous
avons vu l’implication totale, par exemple, d’Al Jazeera et d’Al
Arabiya dans tous les conflits et comment ces deux chaînes reflètent
dans leurs programmes les attitudes politiques panarabes,
respectivement, du Qatar et de l’Arabie Saoudite. Ensuite, il y a les
nouveaux médias qui semblent avoir acquérir une nouvelle place dans
l’espace arabe et dont ils deviennent un nouveau protagoniste. En
Juin /2012 / n°2
34
effet, les réseaux sociaux et les blogs font désormais partie du système
communicationnel dans la région. Néanmoins, leur existence reste
fragile et leur action reste limitée en raison de trois facteurs qui ont
des rapports avec Internet dans les pays arabes :
- Le premier facteur est de nature technique et concerne l’introduction
de l’Internet dans l’espace arabe. Dans ce sens et à l’exception de
quelques pays comme les EAU, toute la région souffre de la qualité du
réseau Web et cela sur plusieurs stades comme les limites de la
connexion ADSL, le non distribution d’Internet sur tout le territoire
(uniquement dans les grandes villes), etc.
- Le deuxième facteur concerne le contenu numérique dans la région
et qui s’explique par la faible participation des Arabes à l’échelle
internationale dans la production de la connaissance via Internet. Dans
ce sens, il est important que les pays arabes et les organisations
concernées comme l’Alesco à mettre des stratégies d’implantation sur
le Toile.
- Le troisième facteur de réglementation qui concerne des aspects
économiques comme les droits d’auteur dans le domaine du
téléchargement ou les aspects juridiques qui concerne les rapports
d’Internet avec les autres acteurs de la société.
En trouvant des solutions pour ces difficultés, Internet dans l’espace
arabe globalement et les réseaux sociaux en particulier peuvent
Revue des sciences de l’homme et de la société
35
devenir un protagoniste incontournable et peuvent ainsi jouer un rôle
dans le développement et dans la promotion des droits et des libertés.
Les références
(1) La mise entre guillemets des énoncés révolution arabe, printemps arabe, etc. et leur usage dans cette étude indique la réserve sur la signification de cette proposition. Il s’agit d’étudier seulement les événements qui se produisent en tant qu’objet communicationnel en laissant les énoncés évoqués auparavant à des études spécialisés en sociologie ou en science politique. C’est pourquoi, dans ce texte, l’utilisation de ce vocable reste appropriée exclusivement aux événements qui ont connus la Tunisie et l’Egypte en début de 2011 et qui ont résulté le départ des deux présidents Zine El Abidine Ben Ali et Hosni Mubarak.
(2) http://www.france24.com/ar/20111114-tunisia-jalel-brik-web-videos-youtube-facebook--funs> (22 11 2011).
(3) Reportage réalisé au Caire, diffué dans l’édition du JT de 20 heures de France 2 le 11 02 2011. Voir l’intégralité du reportage sur le site <http://jt.france2.fr/20h/>.
Juin /2012 / n°2
36
(4) Tunis 7 est me nom de la chaîne gouvernementale en Tunisie. Le numéro 7 fait référence au 7 novembre 1987 la date dont laquelle Zine Ben Ali a réalisé son coup d’Etat et accédé au pouvoir. Après la chute de son régime, la chaîne est rebaptisé La télévision nationale tunisienne.
(5) Le slogan est en arabe égyptien, il signifie littéralement « les mensonges sont diffusés exclusivement sur la télévision égyptienne ».
(6) Voir les détails sur le site <www.alarabiya.net/articles/2011/10/07/170567.html > (site visité le 19 10 2011).
(7) Voir le site de la chaîne égyptienne sur <http://www.egytv.net/masr/home.aspx> site visité le 18 11 2011.
(8) L’interview est sur le site <http://info.france2.fr/revolutions-arabes/kadhafistes-rebelles-negociations-directes--69472524.html> site visité le 18 11 2011.
(9) Le célèbre quotidien newyorkais New York Times s’est intéressé à l’événement. Voir les détails sur <http://thelede.blogs.nytimes.com/2011/06/07/syrian-american-blogger-detained/> site visité le 19 10 2011.
(10) Voir l’explication du faut bloqueuse sur < http://www.france24.com/fr/20110613-blogueuse-syrienne-amina-araf-existe-pas-gay-girl-damascus-syrie-etudiant-americain> site visité le 19 10 2011.
Bibliographie
(1) Bourdieu, Pierre (2002) La distinction, Paris, Les Editions de Minuit.
(2) Bourdieu, Pierre (2002) Questions de sociologie, Paris, Les Editions de Minuit.
(3) Cardon, Dominique (2010) La démocratie Internet, Promesses et limites, Paris, La république des idées et Seuil
Revue des sciences de l’homme et de la société
37
(4) Chantepie, Philippe, Le Diberder, Alain (2010) Révolution numérique et industrie culturelles, Paris, La Découverte
(5) Dagnaud, Monique (2011) Génération Y, les jeunes et les réseaux sociaux, de la dérision à la subversion, Paris, Sciences Po. Les presses
(6) Doueihi, Milad (2011) La grande conversion numérique, Paris, Editions du Seuil
(7) Foucault, Michel (2003) Surveiller et punir, Paris, Gallimard
(8) Foucault, Michel (1994) Dits et écrits, Paris, Gallimard
(9) Foucault, Michel (1969) Archéologie du savoir, Paris Gallimard
(10) Flechy, Patrice (2010) Le sacre de l’amateur, Sociologie des passions ordinaires à l’ère numérique, Paris, La république des idées et Seuil
(11) Jauréguiberry, Francis, Proulx, Serge (2011) Usages et enjeux des technologies de communication, Toulouse, Edition Erès-
(12) Mattelart, Armand (2004) La mondialisation de la communication, Paris, PUF.
(13) Miège, Bernard (2010) L’espace public contemporain, Grenoble, PUG.