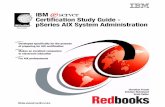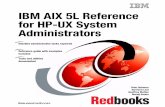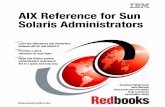Rapport de Stage Mélanie Sert - IUT Aix-Marseille Université
-
Upload
khangminh22 -
Category
Documents
-
view
3 -
download
0
Transcript of Rapport de Stage Mélanie Sert - IUT Aix-Marseille Université
1
AIX MARSEILLE UNIVERSITE
INSTITUT UNIVERSITAIRE DE TECHNOLOGIE
Département Carrières sociales option Gestion urbaine
Licence Professionnelle
Conduite de projets territoriaux durables
Rapport de stage présenté par :
Mélanie Sert
Maître de Stage : Tuteur de stage :
Monsieur Michel Bergé Lefranc Madame Hélène Garnier
Co Gérant de la SARL
Architecte DPLG. Urbaniste
Année 20162017
Elaboration d’un document de Recommandations Urbanistiques
et Architecturales
SARL BERGELEFRANC ARCHITECTURE
11, traverse des Laitiers 13015 Marseille
3
AIX MARSEILLE UNIVERSITE
INSTITUT UNIVERSITAIRE DE TECHNOLOGIE
Département Carrières sociales option Gestion urbaine
Licence Professionnelle
Conduite de projets territoriaux durables
Rapport de stage présenté par :
Mélanie Sert
Maître de Stage : Tuteur de stage :
Monsieur Michel Bergé Lefranc Madame Hélène Garnier
Co Gérant de la SARL
Architecte DPLG. Urbaniste
Année 20162017
Elaboration d’un document de Recommandations Urbanistiques
et Architecturales
SARL BERGELEFRANC ARCHITECTURE
11, traverse des Laitiers 13015 Marseille
4
Remerciements
Mon stage n’aurait pu se dérouler sans l’accueil de Monsieur et Madame Bergé Lefranc au
sein de leur cabinet et je les en remercie. Aussi, je tiens à les remercier pour la rapidité avec
laquelle ils m’ont intégré.
J’émets toute ma reconnaissance à Madame Bergé Lefranc pour sa pédagogie et le temps
qu’elle m’a accordé durant la période de mon stage. Pour l’aide qu’elle m’a apportée pour
rédiger mon rapport de stage et les réponses à mes questions.
Je remercie Monsieur Bergé Lefranc pour toutes les connaissances qu’il m’a transmises dans
le domaine de l’urbanisme avec passion et pour son aide quant à la rédaction de mon rapport
de stage. Sans la réalisation de ce stage au sein de leur SARL, je n’aurai pas pu découvrir la
réalité de l’exercice de l’urbanisme et en moindre, de celui de l’architecture.
Je tiens à remercier ma tutrice Madame Hélène Garnier pour le temps qu’elle m’a accordé,
son suivi et ses conseils afin de réaliser un rapport de stage relatant mon expérience de stage.
5
Résumé
Le Conseil départemental des Bouches du Rhône est le maitre d’ouvrage de la création des
centres de secours sur son territoire. Les coûts associés à ses projets s’élèvent à plusieurs
milliers, voire millions d’euros. C’est pourquoi, soucieux de la bonne administration de son
budget, le Conseil départemental missionne un Bureau d’Etude afin de réaliser un cahier de
Recommandations Urbanistiques et Architecturales, document préalable au projet.
L’objectif de ce RUA est de valider ou non, la faisabilité du projet de l’équipement public sur
le site au sein duquel il va s’insérer. C’est un document qui contient d’une part, des éléments
très précis et concis sur le site du futur projet et d’autre part, des éléments plus généraux sur
l’environnement proche et global du futur projet à l’échelle de la commune.
L’Elaboration de ce document préalable au projet n’est pas une tâche aisée. En effet, il
nécessite le regroupement des compétences et connaissances de nombreux acteurs. De plus,
un grand nombre de facteurs à la fois techniques mais aussi environnementaux sont à prendre
en compte lors de l’élaboration de ce document. Enfin, le futur équipement public ou
collectif jouera un rôle à part entière au sein du territoire dans lequel il est implanté.
Mots clés :
Conseil départemental / Bureau d’Etude / Centre de secours / RUA / Préalable
6
Abstract
The BouchesduRhône’s regional board is the public contracting authority for the creation of
fire stations on its territory. The costs associated to its projects are raising to thousands, even
millions of euros. That is why, solicitous about its budget’s good management, the regional
board commissions a design office in order to produce a list of Urban and Architectural
Recommendations, prior document to the project.
The purpose of this UAR is to confirm or not the feasibility of the public equipment’s project
onto the area within it will join. It is a document that not only contains very specific and
concise elements about the future project’s area, but also more global elements about its
immediate environment, at town scale.
The creation of this document prior to the project is no easy task. Actually, it requires the
gathering of the expertise and the knowledge of many actors. More, a large number of factors,
both technicals and environmentals, have to be taken into account when drafting this
document. Finally, the forthcoming public equipment will play a full part among the territory
in which it will be established.
Keywords :
Regional board / Design Office / Fire station / UAR / Prior to
8
Table des sigles et des abréviations
� CDAC : Commission Départementale d’Aménagement Commercial
� DUT : Diplôme Universitaire de Technologie
� EPAD : Etablissement Public d’Aménagement et de Développement
� ER : Emplacement Réservé
� PME : Micro, Petites et Moyennes Entreprises
� PLU : Plan Local d’Urbanisme
� RUA : Recommandations Urbanistiques et Architecturales
� SAGE : Schéma d’Aménagement et de Gestion de l’Eau
� SAN Ouest Provence : Syndicat d’Agglomération Nouvelle Ouest Provence
� SARL : Société à Responsabilités Limités
� SDIS : Service Départemental d’incendie et de Secours
� ZAC : Zone d’Aménagement Concerté
� ZICO : Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux
9
Introduction
Le Conseil départemental des Bouches du Rhône mène de nombreuses activités. Parmi elles,
une consiste à la création de centres de secours à l’échelle du département. Cette
construction « s’inscrit dans le plan pluriannuel de construction du Service Départemental
d’Incendie et de Secours des BouchesduRhône. » Ainsi, avant de mettre en œuvre un projet
dont le coût est significatif, le Conseil départemental demande la rédaction d’un cahier de
Recommandations Urbanistiques et Architecturales.
L’objectif de ce document est de vérifier la possibilité de mettre en place le projet souhaité.
C’est dans ce contexte que s’insère ma mission, qui est la rédaction de la première partie de
ce document préalable au projet et qui validera la possibilité de sa conception.
L’objectif majeur de ma mission est donc de valider la faisabilité du projet, grâce à un
diagnostic précis du terrain réservé au projet et de son environnement proche.
Quelle est la procédure d’élaboration et de mise en œuvre d’un équipement public structurant
à l’échelle d’un territoire ?
Pour commencer je présenterais l’environnement dans lequel j’ai évolué tout au long de mon
stage, le contexte et les objectifs de ma mission.
Ensuite, nous verrons comment est construit et réalisé un document de Recommandations
Urbanistiques et Architecturales.
Pour terminer, je mettrais en place une réflexion en m’appuyant sur mon expérience de stage
afin de comprendre en quoi un équipement public apporte une structure spatiale et reflète le
dynamisme de la commune dans laquelle il s’implante.
10
Dans cette première partie, nous allons aborder l’environnement de travail dans lequel j’ai
évolué tout au long de ces 3 mois de stages. Puis, nous verrons les objectifs de ma mission
principale, que j’ai réalisé en même temps que d’autres tâches qui m’étaient confiées.
1. Environnement de réalisation du stage et mission
1.1 L’organisme d’accueil
1.1.1 La structure
Environnement de travail
Mon stage s’est déroulé au sein d’une SARL située à Marseille aux Aygalades dans le 15ème
arrondissement. Au sein de ce cabinet évolue Monsieur Michel Bergé Lefranc et Madame
Anne Marie Bergé Lefranc. Ils travaillent ensemble depuis plusieurs années.
Ils exercent à leur compte et ont créé une SARL en fonctionnement depuis 8 ans. Ils accueillent
tous les ans des stagiaires afin de les aider dans leur période la plus active et qui nécessite une
grosse quantité de travail. Ils ne comptent pas leurs heures et travaillent parfois même les
weekends. Cependant le fait d’être leur propre patron leur permet une certaine flexibilité dans
leurs activités ce qu’ils considèrent comme étant de nos jours un grand avantage.
Evolution du statut de la structure
Lorsque Monsieur Bergé Lefranc décida d’exercer en profession libérale en 1988 il créa une
« Entreprise Individuelle ». Celleci se définit comme étant, « une entreprise en nom propre
ou en nom personnel. L'identité de l'entreprise correspond à celle du dirigeant, qui est
responsable sur ses biens propres ». Cependant, en 2008, Monsieur Bergé Lefranc et Madame
Bergé Lefranc décidèrent de créer une SARL. Ce changement de statut s’est décidé car le fait
que Monsieur Bergé Lefranc était un travailleur indépendant et Madame Bergé Lefranc sa
salariée posait des questions de sécurité du travail. En effet, après plusieurs « cas
dramatiques » vécus par leurs confrères, la création d’une SARL est devenue, à leurs yeux, le
meilleur moyen pour exercer leur activité de manière pérenne avec une sécurité optimale.
11
Effectivement, s’ils continuaient d’exercer sous une entreprise individuelle, plusieurs
problèmes pouvaient se poser à eux :
Lorsque Monsieur Bergé Lefranc allait prendre sa retraite, sa femme Anne Marie, allait
se retrouver sans emploi étant donné qu’elle n’avait plus de directeur et donc plus
d’employeur.
S’il arrivait quelque chose à Monsieur Bergé Lefranc (décès ou incapacité de travailler),
Madame Bergé Lefranc ne pouvait pas poursuivre les projets car les contrats et
notamment les contrats publics sont non cessibles. Tandis qu’avec une SARL, si un des
deux gérants est dans l’incapacité de travailler, l’autre peut tout de même continuer
les projets en cours.
Avec une SARL, « les marchés sont au nom de la SARL ». Ainsi, en cas de problème financier il
n’y a qu’à faire un dépôt de bilan et arrêter leurs activités, tandis que sous le statut
d’entreprise individuelle, « le patrimoine personnel de l’entrepreneur est confondu avec celui
de son entreprise ».
12
1.1.2 Les activités menées au sein de la SARL
Les activités exercées au sein de la SARL se répartissent à part égale entre l’urbanisme (études
et conseils) et l’architecture (missions de maîtrise d’œuvre).
Quelques réalisations de la SARL
Cahier de Recommandations
Urbanistiques et ArchitecturalesPlan Local d’Urbanisme
« Association Jane Pannier. Phocéenne d’Habitation. Marseille
Création d’une résidence relai pour femmes handicapés mentales
et logements sociaux (CADA). Mission complète.
Association Fraternité de la Belle de Mai. Marseille.
Aménagement d’un centre aéré. Mission complète.
Réhabilitation de l'Ecole Maternelle privée à Endoume.
Extension.
Centre commercial et cabinet médical. Les Pennes Mirabeau.
Concession automobile, ZAC de FerriéCapelette, Marseille (13). »
Quelques réalisations de la SARL
ArchitectureRavalement de façadesConception d’ouvrages
Extension de bâti
Urbanisme
Etudes d’impact
« Elaboration du PLU de Moustier Sainte Marie
Elaboration du PLU des Pennes Mirabeau
Elaboration du PLU de Gardanne
Révision simplifiée de la commune de Appietto. Corse du Sud.
Elaboration du Cahier des Recommandations Urbanistiques et
Architecturales
Gendarmerie de Trets / SDIS Istres
Etudes d’impacts dans le cadre de permis de construire de centres
commerciales de plus de 10 000 m² de surface
Hyeres, Tignieu, Cogolin, Agde etc… »
13
1.1.3 Organisation du travail
Monsieur et Madame Bergé Lefranc réalisent ensemble la majorité des missions qui leurs sont
confiées. Monsieur BergéLefranc s’occupe principalement de la rédaction des documents
nécessaires pour mener à bien les diverses activités de la SARL, qu’ils portent soit sur de
l’urbanisme ou de l’architecture. Tandis que pour sa part, Madame Bergé Lefranc s’occupe de
la partie graphique que nécessite la réalisation de leurs travaux.
Michel Bergé Lefranc Anne Marie Bergé Lefranc
1.1.4 La convivialité et la franchise
L’Ambiance de travail qui règne au sein du cabinet est très différente de celle d’une grande
entreprise. J’ai pu comparer l’atmosphère de travail d’une entreprise de 230 salariés lors de
la réalisation de mon stage de deuxième année de DUT à celle d’une entreprise familiale.
Il en est ressorti deux ambiances très différentes. Tout d’abord, au sein d’une SARL tous les
salariés se connaissent tandis que dans une plus grande entreprise, l’anonymat est plus
présent. De plus, le fait de travailler avec son patron est très différent. Lors de mon stage de
2ème année de DUT je n’ai jamais vu le directeur, je ne me référais qu’à ma chef de service.
Le fait d’être intégrée dans une petite structure rend le travail plus convivial et les échanges
directs, contrairement aux grandes entreprises ou les salariés communiquent entre eux
souvent par mails. Evoluer dans une petite structure, qui est de plus familiale, permet de donc
de travailler dans une ambiance conviviale. Cependant, celleci est parfois stressante car lors
des rendus de documents (PLU par exemple), il y a toujours des modifications de dernière
minute, qui nécessitent de travailler dans l’urgence.
Partie rédactionnelle des
Plans Locaux d’Urbanisme
Ravalement de façades :
pièces écrites
Suivis de chantiers
Relevés terrains
Partie graphiques des PLU
Réalisation de documents de
Recommandations
Urbanistique et
Architecturales
Suivi de chantiers
Entraide
Echange
Conseils
Transfert de documents
14
1.1.5 Mes activités
Activités Annexes
RUA d’Aix en Provence
Création de planche photo
Création de cartes
Réunions avec les services techniques
Relecture du document final
PLU de Gardanne
Repérage sur carte des permis de
construire, des servitudes, des lieux
dits
Saisie de données des emplacements
réservés modifiés et supprimés
Rédaction d’une partie du rapport de
présentation du PLU concernant les ER
supprimés et modifiés
Création d’une carte des permis de
construire accordés depuis 2011 sur la
commune
Présence à 2 réunions
Travail sur la révision allégée du PLU :
Dessin sous AUTOCAD : Reculements,
chemin piéton, modifications de
zonages, modifications de numéros
d’ER
Mise en forme des différentes cartes
de la commune pour la révision allégée
et la modification sous AUTOCAD
Montage de la révision allégée et de la
modification du PLU
CDAC St Maximin la Sainte Beaume
Cartographie à partir du cadastre :
carte d’occupation de l’espace,
voirie, les différentes zones et les
équipements
Rédaction du cahier de
Recommandations Urbanistiques et
Architecturales pour la création
d’un SDIS à ISTRES
PLU des Pennes Mirabeau
Réalisation de la présentation
Power Point de la révision allégée
pour une réunion publique
PLU Moustiers Sainte Marie
Prise de photo sous Google
Maps
Cartographie sous AUTOCAD :
propriété foncière
schéma viaire
consommation de l’espace
structure paysagère
Relecture de documents
Synthétisation de données sur
le SAGE pour l’intégrer dans le
rapport de présentation.
Création de carte : Unités
Paysagère à l’échelle de la
commune Coreldraw
Mission Principale
15
Tout au long de mon stage, ma mission principale était la rédaction d’une partie du cahier de
Recommandations Urbanistiques et Architecturales pour la construction d’un SDIS (Service
Départemental d’Incendie et de Secours) à Istres.
L’objectif principal de ma mission était de regrouper toutes les informations à la fois
techniques qui concernent le terrain du futur centre de secours, mais aussi les informations
concernant la commune dans laquelle le projet s’implante. Cela nécessite de mettre en place
de nombreuses recherches afin :
D’établir une liste d’éléments techniques concernant le terrain (servitudes,
emplacements réservés, réseaux…).
D’analyser l’environnement proche dans lequel s’insère le futur projet.
D’analyser l’environnement global dans lequel s’insère le futur projet.
1.2 Un RUA pour la création d’un centre de secours : pour la sécurité de
tous
Le RUA concerne un projet de construction d’un centre de secours sur la commune d’Istres.
Avant d’exposer la méthodologie que j’ai employé pour rédiger le RUA je vais vous parler des
SDIS afin de mieux comprendre le contexte de réalisation de ma mission. Les informations qui
suivent sont tirées d’un site internet (Voir Sitographie) étant donné que je n’ai pas de
connaissances en matière d’établissements de secours.
1.2.1 Présentation des SDIS
« Les SDIS sont des établissements publics administratifs, dotés de la personnalité juridique et
de l’autonomie financière. Les SDIS sont les seuls établissements publics qui possèdent les
compétences nécessaires en matière de secours et de lutte contre l’incendie.
Les SDIS permettent d’organiser une véritable mutualisation des moyens et des charges
permettant de garantir l’égalité des citoyens dans leur droit constitutionnel à être secouru.
Il existe différente catégories de SDIS définies suivant plusieurs critères qui sont ; la taille de
la population qu’ils défendent ; leur budget annuel ; le nombre de sapeurspompiers
professionnels ; le nombre de sapeurspompiers volontaires. »
16
1.2.2 Missions et organisation des SDIS
« Les SDIS mènent plusieurs missions :
o Prévention, protection et lutte contre les incendies
o Prévention et évaluation des risques de sécurité civile
o Préparation des mesures de sauvegarde et organisation des moyens de secours
o Protection des personnes, des biens et de l’environnement
o Secours d’urgence aux personnes victimes d’accidents, de sinistres ou de catastrophes
ainsi que leur évacuation »
ORGANISATION DES SDIS
� Le Président
« Il représente de l’établissement public, prend ou arrête toutes les décisions relatives au
fonctionnement du SDIS. »
� Le Conseil d’administration
« Il contient entre 22 à 30 élus possédant des voix délibératives et 6 représentants des
sapeurspompiers ayant voix des consultatives.
C’est un organe qui définit et décide les orientations générales au bon fonctionnement du
SDIS. »
� Le Bureau
« Il comprend au maximum cinq membres et est composé du président, des trois vice
présidents, et éventuellement d’un membre supplémentaire.
Le conseil d'administration peut déléguer au bureau une partie de ses attributions, à
l'exception des délibérations relatives à l'adoption du budget. »
17
� Les Personnels
Les SDIS sont composés de :
« Les sapeurspompiers professionnels du département
Les sapeurspompiers volontaires
Les sapeurspompiers auxiliaires du service de sécurité civile
Le service de santé et de secours médical est composé de médecins, pharmaciens,
infirmiers, et vétérinaires qui ont la qualité de sapeurspompiers volontaires. »
LES RESSOURCES DU SDIS
� Les SDIS possèdent plusieurs sources de financement
« Les contributions annuelles du Département, des Communes et des Etablissements
Publics de Coopération Intercommunale compétents en matière d’incendie et de secours
Les subventions, fonds de concours, dotations et participations des Communautés
européennes, de l’État, des collectivités territoriales et des établissements publics
Le produit des emprunts
Les dotations aux amortissements des biens meubles et immeubles
Les reprises sur amortissements et provisions
Les dons et legs ».
Les SDIS sont donc des établissements dont les missions visent à protéger et à secourir la
population à travers leurs activités. Au sein du département des Bouches du Rhône leur
création nécessite l’élaboration d’un RUA afin de valider la faisabilité du projet.
Nous allons dans la partie suivante, découvrir qu’estce qu’un RUA, quand il est mis en œuvre,
la manière dont il est élaboré et quel est son contenu. Mais aussi, quelles sont les contraintes
auxquelles il faut faire face lors de son élaboration et quelles sont celles qu’il faut prendre en
compte dans le document. Enfin, nous finirons par parler des acteurs qui interviennent dans
son élaboration, quels est leurs rôles, et quelles connaissances et compétences ils apportent.
18
2. L’élaboration du document de Recommandations Urbanistiques
et Architecturales
2.1. Définition d’un RUA
2.2.1 Qu’estce qu’un RUA
Un RUA « est un document d’urbanisme dont l’objectif est d'offrir aux concepteurs un aperçu
du site, de présenter les contraintes et recommandations urbanistiques et architecturales afin
de les aider à élaborer un projet d’aménagement et de construction cohérent et répondant
aux objectifs du Maître d’Ouvrage ». Le RUA permet d’avoir un aperçu du site et du territoire
au sein duquel le futur projet va s’implanter. « C’est une pièce qui est jointe au règlement du
concours de maîtrise d’œuvre ».
Les RUA sont une particularité du Département des Bouches du Rhône. D’Après Madame
Bergé Lefranc, seul le département des Bouches du Rhône demande la réalisation d’un RUA
avant de débuter tout projet.
Les futurs concepteurs doivent pouvoir prendre appui sur ce document afin de réaliser un
projet répondant aux attentes du Maître d’Ouvrage. Le RUA peut être perçu comme un
document regroupant les données nécessaires pour obtenir des informations suffisantes sur
un site, sans avoir à faire des recherches complémentaires. Il peut, de cette manière, être
perçu comme un cahier des charges dont il est impératif de prendre connaissance pour
l’élaboration du projet.
Les contraintes d’urbanisme présentes sur le site y sont toutes recensées. L’analyse du site à
travers de multiples thématiques fait émerger un diagnostic que les architectes devront
prendre en compte dans la création du projet. Dans le cadre du projet du centre de secours
d’Istres, « le RUA donne la synthèse des informations, des données et documents recueillis »,
en particulier auprès de la commune d’Istres.
Ainsi, les architectes qui répondront au concours, devront s’appuyer sur le RUA afin de
proposer un projet qui corresponde au mieux au site et à ses contraintes mais aussi mettre en
valeur ses avantages et opportunités.
19
2.2.2 Les conditions d’établissement du document
Un RUA est établit lorsqu’un projet d’importance est mis en œuvre. Un projet est jugé
« significatif » lorsque le coût dépasse plusieurs milliers d’euros.
C’est le Département qui demande la création d’un RUA. En effet, l’organisation d’un concours
est très long et cher. Le Conseil départemental préfère donc payer pour qu’un RUA soit créé
afin de valider la faisabilité du projet plutôt que d’organiser directement un concours
d’architectes qui coûte très cher, sans savoir si le projet est réalisable.
La mise en place d’un RUA présente plusieurs intérêts :
S’assurer que l’on ne va pas dépenser inutilement de l’argent en vérifiant que le
projet est faisable.
Permettre aux architectes de faire leur phase de conception à partir de bases saines.
L’intérêt d’un RUA c’est donc d’être directif et de vérifier que l’on peut établir le programme
sur le terrain mis à disposition pour le projet.
L’élaboration d’un RUA nécessite une longue phase de recherche afin d’obtenir toutes les
informations que l’on souhaite sur le site du futur projet. Dans cette partie nous allons voir la
méthodologie mise en œuvre pour mener à bien ma mission, les différentes étapes qui
mènent à la construction d’un RUA et les contraintes auxquels il faut faire face lors de la
réalisation de ce document.
2.2 L’analyse des données du site
2.2.1 Un travail de recherche et de synthèse
Cidessous le plan du RUA d’Istres et les chapitres que j’ai réalisé (en bleu). La partie du Cahier
du RUA que j’ai mis en œuvre se trouve en Annexe.
Madame Bergé Lefranc m’a confié la première partie du RUA à réaliser « Analyse des données
du site ». Cette première partie, traite de plusieurs thématiques relatives au site et à son
environnement proche.
20
1. ANALYSE DES DONNEES DU SITE
1.1 Situation
Le site
Etude de sol
1.2 Récolement des services concédés
Eau Potable
Assainissement
Telecom
GRDF
Electricité
Eau pluviale
1.3 Environnement du projet
Histoire
Sociologie
Contexte urbain
La ZAC du Tubé
Les canaux
La Caspienne
L’Etang de l’Olivier et son jet d’eau unique en France
L’aérodrome d’Istres
Les ZNIEFF et NATURA 2000
Parcs et jardins d’Istres
Trame urbaine
Forme du bâti
Relations avec le tissu urbain
1.4 Périmètres des monuments historiques
1.5 Etude des circulations et des flux
1.5 Etude des prescriptions urbanistiques
1.6 Etude relative à la qualité environnementale
Qualité de l’air
Données climatiques
21
L’acoustique
Le réseau routier
Le réseau ferré
L’Aéroport de MarseilleProvence
Les risques
2. Adaptation du programme au site
2.3 Validation de la surface du terrain
2.4 Synthèse des contraintes du site
2.5 Sujétions d’insertion sur le site du programme
3. Synthèse
3.1 Délimitation du terrain
3.2 Traitement des limites du terrain
3.3 Accès à l’équipement
3.4 Analyse des dispositions des espaces libres et des espaces construits
3.5 Prospects et masse des espaces construits
3.6 Eléments forts qui devront être retenus lors de la conception des projets
3.7 Zones à aménager à l’extérieur de l’équipement
3.8 Plans d’implantations des viabilisations
22
La méthodologie employée afin de pouvoir mener à bien ma mission est la suivante ;
Tout d’abord, la lecture d’un précédent RUA rédigé par Madame Bergé Lefranc m’a
permis de m’informer des thèmes et sujets à aborder dans la partie « Analyse des
données du site ».
Après avoir lu ce RUA je suis arrivée à l’élaboration d’une trame (un plan) que j’ai suivi
tout au long de ma mission.
Pour recueillir les données nécessaires afin de compléter la précédente trame, j’ai
procédé par plusieurs moyens :
o Dans un premier temps, avec les documents qui étaient à ma disposition et
notamment le PLU de la ville d’Istres (4 tomes), j’ai fait un long travail de lecture
et de recherche d’informations afin de les sélectionner, les synthétiser et
finalement les intégrer au document. En plus du PLU :
Je me suis basée sur le Cahier des Charges de Cession de Terrains du
site, où l’on trouve des informations plus précises que celle fournies
dans le PLU sur les parcelles et leurs utilisations.
J’ai aussi fait des recherches complémentaires sur Internet car les
documents mis à dispositions par la commune ne permettaient pas
d’avoir toutes les informations suffisante pour l’élaboration du RUA.
o Ensuite, j’ai réalisé une partie graphique que j’ai insérée dans le RUA. Ainsi, j’ai
créé des cartes abordant plusieurs thématiques :
Les servitudes (liés aux bruits ; au captage de la caspienne, qui est une
source d’eau potable ; liés à la proximité de la Base Aérienne 125…)
La localisation du terrain
Les réseaux passant sur le terrain
L’occupation de l’espace
Les ZNIEFF
Le schéma viaire
Le zonage général
J’ai aussi inséré des cartes provenant du PLU et de sources internet
J’ai créé des planches photos représentant les cônes de visions, ceuxci
permettent de se projeter sur le site.
23
C’est de cette manière que j’ai travaillé pour construire le RUA ; d’une part grâce la
recherche d’informations et leurs synthétisations et d’autre part, avec le dessin de cartes
illustrant et enrichissant les propos textuels.
Pour réaliser ce RUA, j’ai dû faire preuve d’une grande curiosité et m’intéresser en détail aux
parcelles étudiées, mais aussi à leur environnement et donc à la commune dans laquelle
s’implante le projet. Le RUA m’a permis d’aborder d’une part, l’environnement général dans
lequel s’insère le projet mais aussi d’autre part, son environnement proche et direct. C’est un
document très intéressant à réaliser car il permet de découvrir l’ensemble d’un territoire à
partir de l’étude de quelque unes de ses parcelles.
D’un point de vue méthodologique, j’ai préféré commencé par rédiger les parties qui
concernaient la commune en globalité plutôt que directement me pencher sur l’étude des
parcelles. Même si, dans le RUA, les parties concernant l’étude des parcelles du futur centre
de secours sont au début du document.
Méthodologie en Schéma :
Prise de connaissance par la
lecture de RUA déjà créés
Elaboration d’une trame ou
d’un plan regroupant les points
essentiels à aborder
Recherche et recueil des
informations textuels
Recherche et créations de
cartes
Compilation au sein du RUA des
informations textuelles et
graphiques
24
2.2.2 Les contraintes issues des documents d’urbanismes
Au cours de la réalisation du RUA j’ai dû faire face à plusieurs contraintes issues des
documents qui m’étaient fournis. En effet, il est nécessaire de s’appuyer sur un grand nombre
de documents urbanistiques de natures diverses pour réaliser une étude complète du site et
de son environnement. De ce fait, les informations recherchées étaient dispersées dans de
nombreux documents, parfois conséquents à l’image du PLU. Cette dispersion d’informations
rend donc le travail de recherche très vite fastidieux et demande ainsi beaucoup de temps et
d’organisation.
2.2.3 Transmission de documents et réunions
La mission de réalisation du RUA d’Istres a été confiée à Madame Anne Marie Bergé Lefranc
par le Département des Bouches du Rhône. C’est donc ce dernier qui la rémunère pour réaliser
cette mission. Il lui transmet le cahier des charges correspondant à l’élaboration du RUA. Le
SDIS a lui, précédemment donné son programme au département.
Les documents nécessaires à la rédaction du RUA proviennent de sources multiples :
Conseil départemental : Cahier des charges pour élaborer le RUA, informations
complémentaires sur le site…
Mairie : Plan Local d’Urbanisme
EPAD : Cahier des Charges de Cession de Terrain
Les multiples sources de provenance des documents rend le processus de création du RUA
plus long car il y a des délais d’accession parfois long, plusieurs semaines, à ces documents.
Le Conseil départemental fournit des données auxquelles Madame Lefranc n’a pas accès.
Ainsi, il cherche des informations de son côté pour enrichir le contenu du RUA. Il a notamment
découvert qu’il y avait un autre captage situé sur la base aérienne 125 alors que ce captage
n’était pas indiqué au sein du PLU car il est situé sur la base aérienne et donc censuré.
Deux réunions à la mairie d’Istres ont été nécessaires pour réaliser le RUA et obtenir toutes
les informations utiles à son élaboration. Lors de la première réunion étaient présents :
Une personne du Service Urbanisme de la Mairie d’Istres
Une personne du Service Foncier de la Mairie d’Istres
25
Le Chef de projet du Conseil départemental pour la construction du centre de secours
d’Istres
Madame Bergé Lefranc et moimême, chargées de la rédaction du RUA.
Cette première réunion permit de faire connaissance avec les différents acteurs qui
participent à la réalisation du RUA. Elle permit également d’obtenir de plus amples
informations concernant le foncier. Seules les questions relevant du domaine de l’urbanisme
ne furent pas satisfaites.
La seconde réunion eut lieu avec les mêmes membres que la précédente, hormis la personne
du service urbanisme qui fut remplacée par le directeur de l’urbanisme de la mairie d’Istres.
De plus, un nouvel acteur fit son entrée, le représentant de l’EPAD. La seconde réunion fut
plus riche en informations que la première. Elle fut mieux organisée avec un ordre du jour et
des points précis à aborder. De plus, le directeur du service de l’urbanisme de la mairie
« dirigea » la réunion et celleci permit de compléter le manque d’informations et de répondre
aux interrogations des acteurs intervenants au sein du projet. Elle fut plus efficace que la
première réunion que certains acteurs n’avaient pas préparé et n’étaient donc pas en capacité
de répondre aux interrogations.
L’Elaboration d’un RUA n’est donc pas un travail qui se réalise seul mais en collaboration avec
d’autres acteurs intervenants sur le territoire.
Lors des réunions j’ai observé que le projet du SDIS mettait en mouvance plusieurs acteurs, à
des échelles et à des implications plus ou moins importantes. Dans cette partie, nous allons
voir les différents acteurs et leurs rôles au sein de la phase préalable au projet.
2.3 Rôles et compétences des nombreux acteurs intervenant au sein du
projet
2.3.1 L’EPAD
« L’Etablissement Public d’Aménagement et de Développement Ouest Provence (EPAD) a
vendu au SAN Ouest Provence trois parcelles de terrain, situées dans la ZAC du Tubé » et a
fourni le Cahier des Charges de Cession de Terrain. Ces parcelles seront celles du futur centre
de secours.
26
2.3.2 Le SAN Ouest Provence
Afin d’implanter la nouvelle caserne de pompiers, « le SAN Ouest Provence a vendu par un
acte datant du 07 janvier 2014, à la ville d’Istres les trois parcelles que l’EPAD lui avait cédé ».
Le SAN est le Syndicat d’Agglomération Nouvelle Ouest Provence, c’est une intercommunalité.
« Le SAN est compétent en matière de programmation et d’investissement dans les domaines
de l'urbanisme, du logement, des transports, des réseaux divers, de la création des voies
nouvelles, du développement économique. »
2.3.3 La ville
La ville d’Istres doit céder l’ensemble des parcelles au Conseil départemental afin de
permettre la construction du centre de secours. De plus, pour l’élaboration du RUA elle a
transmis le PLU, organisé et accueilli les réunions. Elle prend en charge l’édification des
constructions du SDIS et met en mouvance les acteurs du projet.
2.3.4 Le Conseil départemental des Bouches du Rhône
Il missionne le Bureau d’étude pour élaborer le RUA. Il transmet des documents d’urbanisme
concernant le terrain et finance la construction du SDIS. De plus, il recherche des informations
qui pourraient contribuer à enrichir le RUA.
2.3.5 Le bureau d’étude
Son rôle principal est de réaliser le RUA. Il possède de multiples compétences en architecture
et urbanisme ce qui lui permet d’avoir un regard multi facettes sur le site.
Le bureau d’étude met en œuvre ses propres recherches afin de réaliser un RUA qui soit le
plus complet possible. C’est lui qui démarche les acteurs nécessaire à la conception du RUA
afin qu’aucune interrogation sur le projet ne persiste. Son rôle est de « débroussailler le
terrain » afin de laisser aux concepteurs un document clair et concis, qui les aidera réellement
à concevoir le futur projet. Le bureau d’étude met par exemple en œuvre une Déclaration de
Travaux sur le site internet d’Inéris afin d’obtenir les réseaux qui passent sur le terrain ou à
proximité. Il participe aussi aux réunions organisées par la Mairie afin d’obtenir des
informations complémentaires et de poser les questions qui découlent de ses recherches.
27
De nombreux acteurs interviennent ainsi dans la phase préalable au projet, chacun apporte
ses propres compétences et permet de progresser vers la concrétisation du projet.
A présent, nous allons voir les différentes contraintes issus des documents urbanistiques qui
s’appliquent au projet et que l’on doit prendre en compte dans le RUA.
2.4 Vérification et prise de conscience des multiples contraintes qui
s’appliquent au projet lors de son élaboration
2.4.1 Des contraintes juridiques
Lors de l’élaboration du RUA, il est nécessaire de prendre en compte la législation et la
réglementation qui s’appliquent sur le site du futur projet.
Par exemple, concernant le SDIS, dans le règlement du PLU une zone UEtub a été créée. Celle
ci concerne la zone du Tubé Retortier au sein duquel le site du futur centre de secours
s’implante. Il est donc nécessaire, de faire figurer dans le RUA les règles qui concerne le terrain
du futur SDIS, afin que les concepteurs puissent prendre en compte ces règles dans leur projet.
Le site est aussi concerné par le règlement de la ZAC dans laquelle il s’insère. Ce règlement est
présenté sous la forme d’un Cahier des Charges de Cession de Terrain. Le règlement le plus
contraignant est celui qui doit être pris en compte. Le règlement contient plusieurs articles
qui abordent des thématiques multiples. Par exemple ; « Occupations et utilisations du sol
interdite », Accès et voirie », « Desserte par les réseaux », « Hauteur maximum des
constructions »…
De plus, lors de la rédaction du RUA, il faut aussi prendre en compte les contraintes qui
s’appliquent au site, en plus de celles qui sont dans les règlements. En effet, il existe des
servitudes. Cellesci sont des contraintes auxquelles le site doit faire face. Il est impossible de
passer outre ces contraintes, c’est pour cette raison que les futurs concepteurs du projet ne
doivent pas négliger la prise en compte de ces servitudes. Par exemple sur le site du futur SDIS
d’Istres il y a une servitude de tréfonds et une servitude de droit de passage.
Aussi, il existe des emplacements réservés par la commune, ceuxci sont représentés par des
limites d’emprise. Par exemple, une limite d’emprise a été créée pour la future Autoroute A56
(actuellement RN 1569). Une partie du terrain est impactée par cet emplacement réservé.
Cela signifie que le projet ne peut pas s’étendre sur ces parcelles. Ces emplacements réservés
28
signifient que lors de la conception du projet il faudra prendre en compte la future A 56 et ses
externalités (notamment le bruit).
Ensuite, il faut vérifier si le terrain est concerné par le transport de matières dangereuses.
Concernant le futur SDIS, « la proximité du site avec la RN1569 et la voie ferrée peuvent le
surexposer aux conséquences des produits transportés qui peuvent être inflammables,
toxiques, explosifs ou radioactifs ». De plus, le site se trouve au sein du périmètre rapproché
du captage de la Caspienne. « Il faut donc soumettre pour avis le projet de construction de la
future caserne à un hydrogéologue agréé ». L’étude hydrogéologique devra prendre en
compte les risques et contraintes du stockage d’hydrocarbure.
Toutes ces contraintes sont donc à recenser et à intégrer dans le RUA. Les concepteurs devront
adapter leur projet à toutes ces contraintes et surtout les prendre en considération.
2.4.2 Des contraintes humaines
Pour élaborer le RUA, de nombreux acteurs sont impliqués. En effet, aux réunions, de
nombreuses personnes étaient présentes rien que pour la phase préalable au projet. Chacune
d’elles avaient un rôle, soit d’informateur ; elles étaient présentes car c’est elles qui avaient
les réponses aux questions, soit en tant que demandeur ; comme le Bureau d’Etude qui
souhaitait que l’on apporte des réponses à ses interrogations.
Ainsi, cette multiplicité d’acteurs rend le processus plus long car, plus il y a d’acteurs, plus la
transmission d’information est compliquée. Par exemple, lors de la première réunion
certaines personnes n’avaient pas reçu un document d’informations tandis que d’autres
l’avaient reçu. Il y a donc une inégalité qui se créé face à la récupération d’information et de
plus, au vu du nombre d’acteurs, le processus devient forcément plus long.
Cette multiplicité d’acteurs démarchés pour la phase préalable au projet rend compte de
l’importance de cette phase au sein du déroulement global du projet.
Enfin, dans les dernières parties du RUA, le Bureau d’Etude doit proposer un projet
d’aménagement du terrain. Cependant le terrain est grand, il existe donc plusieurs
combinaisons possibles de projet. Ainsi, le projet proposé dépend entièrement du regard du
Bureau d’Etude étant donné qu’il est seul à élaborer le RUA, il ne sera donc pas exhaustif.
29
2.4.3 Des contraintes urbanistiques
Les contraintes urbanistiques sont tous les éléments qui influencent le projet dans sa
conception et sa mise en forme (matériaux…).
La présence de la base aérienne émet des contraintes notamment concernant le bruit. Elle a
donc mis en œuvre « un Plan d’Exposition au Bruit ». D’après celuici, le futur centre de secours
ne sera pas impacté par les nuisances émises par l’aérodrome. « Cependant cette affirmation
est à nuancer en raison des incertitudes sur diverses hypothèses, des variations dans les
conditions de propagation et de réception du son etc. le zonage alors déterminé est
APPROXIMATIF ». Ainsi, lors de la conception du projet les futurs concepteurs devront veiller
à ce que le SDIS soit le plus isolé possible des différentes sources de bruits, étant donné que
le terrain est exposé au bruit émis par la RN 1569 et est probablement exposé au bruit de la
base aérienne 125.
De plus, la base aérienne militaire 125, qui se situe à proximité du terrain, à 300 mètres à
l’Ouest, a du valider la présence d’un pylône radio de 24 mètres de hauteur afin que le SDIS
puisse recevoir ses appels en toute circonstances. La présence de ce pylône sur un terrain si
proche de la base aérienne était susceptible de poser des problèmes mais il n’était pas non
plus concevable d’en supprimer sa présence.
Aussi, la station de stockage d’hydrocarbure posait problème car le site se situe dans le
périmètre rapproché de protection de la Caspienne. Il faudra donc, lors de la conception du
projet que les architectes prennent en compte cette proximité avec le captage et puisse
éloigner au maximum la station de stockage d’hydrocarbure. Ce point a été soulevé lors de la
seconde réunion à la mairie, certains acteurs de cette réunion proposaient déjà des solutions
afin de pouvoir installer au mieux ce stockage en toute sécurité pour l’environnement et pour
les hommes.
Un projet nécessite donc de s’adapter au terrain sur lequel il s’implante et ne peut pas
simplement être conçu sans avoir préalablement analysé le terrain et l’environnement proche
et global dans lequel il s’insère.
30
2.5 Le projet de création du SDIS
Le RUA n’a pas encore été livré au département car Madame Bergé Lefranc attend des
réponses à des problèmes soulevés lors de son étude, cela la retarde dans la finalisation du
document. Au sein du projet de création d’un SDIS, le RUA fait partie des documents préalable.
Les futurs concepteurs devront attentivement le consulter avant d’élaborer leur projet.
Il m’est impossible de délivrer des résultats concrets quant à la réalisation de ma mission étant
donné que celleci consiste à la rédaction d’un document. Cependant, j’ai considéré qu’il était
nécessaire de réaliser le RUA comme si nous allons nousmêmes mettre en œuvre le projet
car cela permet d’être plus impliqué et de se poser les bonnes questions. La procédure
d’élaboration et de mise en œuvre de cet équipement public est donc un travail qui nécessite
l’interaction de nombreux acteurs, chacun ayant leurs propres compétences.
Dans cette partie nous avons pu voir de quelle manière est élaboré un RUA, la méthodologie
que j’ai employé pour le construire et les acteurs qui étaient impliqués dans son montage.
Mais aussi les nombreuses contraintes qu’il faut prendre en compte lors du projet et que l’on
découvre au cours de nos recherches.
L’Elaboration de ce document n’est donc pas un simple travail rédactionnel mais nécessite de
mettre en place de multiples démarches avec de nombreux acteurs intervenant dans la phase
préalable au projet. C’est un véritable travail d’analyse du territoire et du site au sein duquel
le projet sera implanté qui mène à réaliser de nombreuses activités à la fois de rédaction mais
aussi de dessin.
31
Ce travail d’élaboration du RUA a suscité en moi de nombreuses interrogations dont je vais
vous faire part dans cette troisième partie et auxquelles je tenterai de répondre tout en
démontrant en quoi la création d’un centre de secours et donc d’un équipement public, donne
une « structure » à la commune et surtout à la zone dans laquelle il s’insère. Nous verrons que
la création d’un équipement public répond à des attentes en termes de développement de la
commune et reflète ainsi son dynamisme.
3. Analyses et réflexions
Dans cette partie, nous allons d’abord définir ce qu’est un « équipement public ou collectif »
puis ce que signifie le terme « structurant ». Ensuite, nous ferons ressortir les principales
caractéristiques de la commune d’Istres puis nous verrons en quoi l’équipement public du
SDIS apporte une structure à ce territoire. Enfin, nous apprendrons qu’un équipement public
présente certaines limites en termes de fonction structurante sur un territoire.
3.1 La façon dont un équipement public joue un rôle structurant…
3.1.1...sur l’environnement urbain dans lequel il s’implante
Un Equipement public c’est « l’ensemble des installations, réseaux et bâtiments assurant à la
population locale et aux entreprises les services collectifs dont elles ont besoin.
Il en existe 2 types :
équipements d'infrastructure (au sol ou en soussol) : voiries, réseaux de transport ou de
communications, canalisations...
équipements de superstructure (bâtiments à usage collectif) : bâtiments administratifs,
centres culturels, équipements sportifs, écoles, SDIS...
Le terme « structurant signifie qui structure, qui aide une structuration, qui dote d'une
structure, qui organise pour former un ensemble. »
Le SDIS, équipement public de type « superstructure » s’implantera au sein de la commune
d’Istres. Celleci se caractérise par sa grande superficie et sa proximité avec l’étang de Berre.
Elle se situe à l’Ouest de ce dernier et non loin des villes attractives, de Marseille et d’Aix en
Provence, elle bénéficie ainsi de leur dynamisme. Istres est aussi à proximité des sites
industrialo portuaires, et profite de leur attractivité.
32
Istres présente certaines
spécificités. En effet, l’eau est
devenue un symbole de la
commune, celleci, qui était
pratiquement inexistante du
fait qu’aucun cours d’eau
naturels ne passait sur la
commune, grâce à de
nombreux travaux
d’aménagements et plus
récemment, grâce à la création
du barrage de SerrePonçon par
EDF, l’activité agricole a pu se
développer.
De plus, la ville possède un jet
d’eau unique en France allant
jusqu’à 50 mètres de hauteur.Source : Rapport de Présentation PLU Istres, Révision N°4
« En 2007, d’après l’Insee Istres comptes 42 700 habitants soit 376 habitants par km² ». La
population d’Istres n’a cessé d’augmenter depuis 1968.
La population istréenne augmente mais est aussi touchée par le vieillissement de la
population. D’après le tableau cidessous nous remarquons que la part des 45 ans et plus est
plus élevée en 2007 qu’en 1999 et qu’à l’inverse la part des 0 – 44 ans est plus faible en 2007
qu’en 1999.
34
« La taille moyenne des foyers diminue depuis plusieurs années ». Ce n’est pas une
caractéristique propre à la commune mais le reflet d’une « tendance nationale » notamment
avec l’augmentation de l’espérance de vie. La ville d’Istres est donc une commune en plein
essor dont la situation spatiale lui permet d’être attractive. Hormis le vieillissement de sa
population et la baisse du nombre moyen de personne par ménage, phénomènes nationaux.
Istres est une ville dans laquelle le pourcentage de chômage est faible. « Istres possède un
taux de chômage de 12%, ce taux est inférieur à celui du SAN Ouest Provence (12.6 %) et du
département (14,3%) ». Cette caractéristique révèle son dynamisme.
C’est une commune qui se développe continuellement d’où la nécessité de mettre en place
un nouveau SDIS, le centre de secours existant ne permettant plus de satisfaire la demande
initial.
Le SDIS sera implanté dans la partie Nord de la ZAC du Tubé. Cette zone accueillant déjà des
grandes enseignes, l’implantation du SDIS lui donnera une autre dimension. Le SDIS dont
l’objectif principal est la protection des hommes sera ainsi un élément caractéristique du Nord
de la ZAC du Tubé Retortier. La vocation de cette partie de la ZAC ne sera donc plus totalement
commerciale et industrielle. Le SDIS apportera ainsi une structure différente à cette zone et
d’autres activités annexes seront amenées à se développer à ses côtés. Par exemple, les
salariés qui seront présents sur le site auront peutêtre le besoin de manger en dehors de la
caserne, c’est l’opportunité pour des restaurateurs de s’installer sur la zone… De plus, le SDIS
sera un pourvoyeur d’emploi potentiel pour les istréens qui seraient en capacité d’intégrer la
nouvelle caserne.
On pourrait croire que le SDIS a été implanté au Nord de la ZAC suivant un choix délibéré,
cependant ce n’est pas le cas. En effet, comme nous l’avons dit dans la partie précédente
relative à l’élaboration du RUA, « l’EPAD a vendu au SAN les parcelles les plus éloignées de
l’entrée de la ZAC car ce sont les moins coûteuses ». Ce choix peut être contestable étant
donné que les sapeurspompiers ont besoin de sortir au plus vite de la ZAC pour intervenir le
plus efficacement possible sur la commune.
Le SDIS, équipement public, aura ainsi un rôle structurant sur sa zone d’influence la plus
proche, qui est celle de la ZAC et dans une moindre mesure sur la commune d’Istres.
35
Il permettra d’attirer des entreprises de natures différentes de celles qui sont déjà présentes
sur la zone. Représentant la vitalité et l’évolution de la commune, il permettra de créer une
nouvelle dynamique au sein de la partie Nord de la ZAC du Tubé Retortier.
Un équipement public peut donc participer à structurer un territoire de par son rôle et sa
vocation et de par les opportunités qu’il apporte.
3.1.2 … mais qui ne peut ignorer les contraintes de son environnement
L’implantation d’un équipement public, dans notre cas, un SDIS nécessite de prendre en
compte l’environnement dans lequel il s’implante. Ainsi, l’environnement extérieur au SDIS
lui impose de respecter une certaine structure et des caractéristiques particulières
notamment à cause des obligations qu’il est nécessaire de respecter lors de la conception du
projet.
Le SDIS sera le premier bâtiment vu de la RN 1569 en venant de Miramas et le dernier en
venant de Fos sur Mer ou Istres. La Caserne se devra ainsi de représenter la ville aux passants,
c’est pourquoi son aspect notamment extérieur, devra être conçu comme un bâtiment
« ambassadeur » de la commune d’Istres, afin que celleci soit mise en valeur à travers ce
bâtiment qui devra représenter le dynamisme de la ville, son évolution et la volonté de se
développer.
De plus, un équipement public peut être soumis à des contraintes naturelles directement liées
à l’environnement d’insertion du projet. Par exemple, le site du futur projet de création du
centre de secours se situe au sein du périmètre rapproché du captage de la Caspienne qui est
la principale source en eau qui alimente la commune d’Istres. Le SDIS devra donc être agencé
de manière à ce que les équipements présentant un danger pour ce captage soient le moins
susceptible de représenter un danger pour ce captage d’eau naturel essentiel pour la
commune.
Lors de la création d’un équipement public il est aussi nécessaire de prendre en compte les
contraintes technologiques qui peuvent s’imposer suivant le terrain d’implantation du projet.
Par exemple, pour la création du SDIS, un pylône de 24 mètres de hauteur devra être mis sur
le terrain, cependant ce pylône a posé problème compte tenu de sa proximité avec la base
aérienne 125, lieu censuré. C’est après une prise de contact avec la base aérienne que celleci
36
a autorisé la présence du pylône. Celuici pouvait poser des problèmes de confidentialité mais
aussi d’interférence avec les transmissions de la base aérienne.
Pour terminer, l’équipement public doit s’adapter aux règles déjà présentes qui s’imposent à
lui lors de sa création. Par exemple, le projet doit être élaboré en fonction des servitudes et
des contraintes physiques du site. Les futurs concepteurs du SDIS devront ainsi prendre en
compte dans leur projet, la proximité avec la RN 1569 et future A56, les règles du à
l’implantation au sein d’une ZAC…
Il existe parfois des dérogations à ces règles imposées aux futurs concepteurs du projet. En
effet, en prenant l’exemple du SDIS le terrain du futur projet se trouve en zone ZICO. « Les
Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux sont des sites d’intérêt majeur qui
hébergent des effectifs d’oiseaux sauvages jugés d’importance communautaire ou
européenne. » Malgré cela et les règles mises en œuvre pour protéger la zone ZICO, celleci
n’est plus d’actualité. Effectivement, la création sur la partie Nord de la ZAC du Tubé Retortier
de bâtiments à vocation industriels et commerciales ont fait fuir ces oiseaux. De plus, une
trame verte et bleu passait sur le terrain du futur projet, mais le busage du canal a mis fin à
cette trame verte et bleu. Ainsi, même si le zonage ZICO est toujours existant dans les
documents d’urbanisme, il n’est pas pris en compte dans l’élaboration du projet.
Nous avons donc pu voir que l’implantation d’un équipement public hormis sa
représentativité d’évolutions du territoire, a un impact non négligeable sur le territoire dans
lequel il s’insère notamment grâce aux opportunités qu’il créé en terme d’emplois mais aussi
aux activités annexes qu’il attire. Mais aussi que la fonction structurante d’un équipement
public sur un territoire fait face à certaines limites, étant donné que cet équipement doit
s’adapter à l’environnement dans lequel il s’insère.
37
3.2 Une mission qui révèle les difficultés d’organisation des acteurs
intervenants
3.3.1 Une multitude d’acteurs
Comme évoqué précédemment, le projet de création du SDIS met en relation de nombreux
acteurs. La Ville, le Conseil départemental, le représentant de l’EPAD, le Bureau d’Etude, tous
interviennent dans la phase préalable au projet. Chacun apporte ses propres compétences et
connaissances pour faire évoluer le projet.
Cependant, le regroupement de ces acteurs pour travailler en commun sans qu’ils se
connaissent particulièrement au préalable peut créer des difficultés. Tout d’abord, certains
documents transmis par le service urbanisme de la mairie n’étaient pas envoyés à tous les
acteurs. Certains n’avaient donc pas toutes les informations alors que d’autres étaient en leurs
possessions. Cela a créé une inégalité devant l’information. De plus, lors de la première
réunion il se faisait ressentir un problème d’organisation entre les différents acteurs.
Cette multiplicité d’acteur intervenant pour la majorité ponctuellement sur le projet créé donc
des problèmes de communication et des problèmes d’organisation des réunions. Chaque
acteur n’est que partiellement impliqué au projet. Par exemple un des acteurs n’avait pas
préparé la première réunion car il était incapable de répondre aux questions du bureau
d’étude et du Conseil départemental. La réunion fut très infructueuse voir inefficace
concernant le domaine dans lequel l’acteur avait compétence.
Cette multitude d’acteurs intervenant sur le territoire avec leurs propres compétences et
connaissances rend ainsi chaque procédure très longue.
3.3.2 De nombreuses formalités
L’administration française est connue pour ses nombreuses formalités et ses délais de
traitements, d’actions plutôt longues. J’ai pu l’observer à travers ma mission. En effet, dans le
Cahier des Charges de Cession de Terrains j’ai découvert avec étonnement que le terrain mis
à disposition par la ville pour le SDIS l’était depuis 2014 et transféré entre plusieurs acteurs
territoriaux.
38
Le terrain appartenait à l’EPAD Ouest Provence qui gère la ZAC du Tubé sur lequel le terrain
est situé. « Celuici l’a vendu au SAN Ouest Provence afin d’implanter la nouvelle caserne de
pompiers, le SAN Ouest Provence a ensuite vendu par acte du 7 janvier 2014 à la ville d’Istres
les parcelles et les délaissés. La ville d’Istres doit céder l’ensemble des parcelles au conseil
départemental ». Pour que le terrain soit cédé au conseil départemental afin de construire le
SDIS il a donc fallu environ trois ans. Le terrain est cédé gratuitement au conseil départemental
des Bouches du Rhône mais celuici doit prendre en charge les constructions du SDIS.
Il n’y a pas de date dans les documents d’urbanisme qui nous informe sur la création du SDIS
hormis la date limite pour déposer le permis de construire qui a elle, été repoussée.
3.3.3 Caractère complémentaire des différents documents d’urbanisme
La multiplicité des documents nécessaire à la création du RUA peut être perçue comme un
inconvénient et d’un côté il l’est. Cependant, cette multitude de documents permet de trouver
des informations complémentaires afin d’élaborer un document complet.
De cette manière, le Cahier des Charges de Cession de Terrains est un document
complémentaire au PLU. En effet, il fournit des informations plus détaillées que le PLU sur les
parcelles et leurs utilisation, telles que les accès et les dimensions des parcelles du terrain.
Ainsi, en s’appuyant sur ces deux documents on trouve des informations similaires et
complémentaires. Les informations similaires permettent d’attester de la véracité des
informations tandis que les données complémentaires enrichissent nos recherches.
Les différents documents sur lesquels je me suis appuyée pour réaliser ma mission sont les
suivants.
Fournis par le Conseil Départemental :
le PLU
le programme fonctionnel et technique
l’arrêté préfectoral et le périmètre de protection de la caspienne
le plan de récolement du busage du canal de boisgelin
le rapport d’étude géotechnique
Fournis par l’EPAD :
le Cahier des Charges de Cession de Terrains
39
Fournis par le géomètre :
le plan topographique et de bornage des lots
Fournis par le bureau d’étude :
la déclaration de projet de travaux
Ces différents documents d’urbanisme auxquels nous avons accès pour élaborer le RUA
permettent ainsi d’obtenir des données complémentaires à propos d’une caractéristique du
terrain et donc d’enrichir notre étude.
3.3.4 Propositions et préconisations
Le regard extérieur et nouveau que j’ai pu apporter lors de mon expérience de stage me
permet d’émettre des propositions et préconisations pour une future élaboration du RUA
dans de meilleurs conditions afin d’améliorer les délais de mise en œuvre de celuici et ses
conditions d’élaboration.
Pour commencer, au cours de ma mission, j’ai constaté que certains documents étaient plutôt
vieux, notamment l’analyse hydrogéologique. De ce fait, il serait intéressant d’avoir des
documents techniques plus récents.
J’ai aussi remarqué lors des réunions quelques disfonctionnements, notamment concernant
leur organisation. Il serait donc bien à chaque réunion de donner un ordre du jour, et une
personne qui mène la réunion afin de pouvoir répondre aux interrogations de chacun et de
pouvoir être plus productifs. Il faut aussi transmettre les documents en temps et en heure
sinon le Bureau d’Etude est retardé pour réaliser le RUA et donc, tout le processus est à son
tour retardé.
J’ai aussi été très surprise par le nombre de papier que la SARL imprimait et ce, à la demande
des administrations. Celleci devrait passer au numérique et limiter ses demandes de
documents papiers, ce qui éviterait premièrement le stockage des documents, qui coûte cher
et qui n’est pas forcément nécessaire, mais aussi qui permettrait de faire un geste pour
l’environnement en limitant la consommation de papier et d’encre.
Le stockage des pièces d’urbanisme pourrait se faire sur disques durs, ce qui limiterait les
couts de stockage et la consommation de papier.
40
Conclusion de la mission et du stage
L’élaboration du RUA s’inscrit dans la phase préalable au projet. C’est un document qui
synthétise les contraintes du site, qui met en évidence ses caractéristiques et en fait ressortir
un diagnostic qui valide ou non la faisabilité du projet. Il peut être considéré comme un cahier
des charges que les concepteurs devront suivre, afin de concevoir un projet de SDIS adapté à
la situation du terrain et aux servitudes qui l’impactent.
J’étais en charge de réaliser la première partie de ce document qui s’intitule « Analyse des
données du site ». Pour élaborer cette partie du RUA j’ai mis en place une méthodologie qui
a consisté tout d’abord à m’appuyer sur les thèmes abordé dans des RUA précédemment
réalisés par Madame Bergé Lefranc. Ensuite, j’ai principalement mené un travail de recherche,
de lecture et de synthèse des informations pour les intégrer au sein du RUA. Enfin, j’ai réalisé
un travail conséquent en matière de documents graphiques à intégrer au RUA. Pour cela, j’ai
utilisé un logiciel de dessin « CorelDraw », qui était nouveau pour moi, j’ai donc appris à le
prendre en main. La création du RUA a nécessité la mise en œuvre de deux réunions au sein
des services de la Mairie d’ISTRES auxquelles j’ai assisté.
La rédaction du RUA n’est donc pas seulement un travail de rédaction mais nécessite la mise
en interaction de nombreux acteurs territoriaux représentant des échelles territoriales
différentes. Lors d’élaboration du RUA de multiples facteurs sont à prendre en considération,
notamment les contraintes environnementales et technologiques qui s’appliquent au projet.
Il faut également savoir gérer la multitude de sources, d’acteurs et d’informations. Un
équipement public tel qu’un SDIS permet de créer une structure autour de sa zone d’influence
à la fois spatiale mais aussi économique. Son insertion ne doit pas se faire sans la prise en
compte de l’environnement dans lequel il s’insère. La volonté de création d’un équipement
public ayant pour vocation la protection des habitants, montre une évolution de la commune
et ainsi son dynamisme.
A travers cette mission et la réalisation d’activités annexes à celleci, j’ai découvert
l’application de l’urbanisme au monde professionnel. J’ai ainsi pu mener à bien et de manière
autonome la rédaction d’un document d’urbanisme préalable au projet, le RUA. Ce travail a
41
permis à Madame Bergé Lefranc, chargée par le Conseil départementale des Bouches du
Rhône de l’élaboration du RUA, de pouvoir mener d’autres activités.
Lors de ces trois mois de stage, j’ai appris énormément dans le domaine de l’urbanisme car
j’ai participé au PLU de Moustier Sainte Marie, de Gardanne et des Pennes Mirabeau
principalement en apportant des compétences graphiques mais aussi dans une moindre
mesure par des documents écrits. J’ai également découvert le fonctionnement d’une SARL et
ai été intégré à une ambiance de travail familiale et conviviale.
Cependant, j’ai le sentiment que l’urbanisme conduit à produire énormément de documents
plus ou moins utiles et ce, entièrement pour la simple et bonne raison d’être en capacité de
se protéger de détracteurs potentiels.
De plus, j’ai constaté que la SARL de Monsieur et Madame Bergé Lefranc n’avait pas été
épargnée par la crise. En effet, du fait de leur petite structure, ils ne peuvent plus mener de
missions conséquentes ou ils sont obligés de s’associer avec des confrères pour mener une
mission d’importance. Ainsi, ils se cantonnent dans le domaine de l’architecture à des
ravalements de façades et à l’extension de bâtis. Ils se sont donc plus tournés vers des
missions d’urbanisme et notamment d’élaboration de PLU.
Pour les années à venir je souhaite continuer mes études dans le domaine de la prévention et
la gestion des risques. J’estime que c’est un domaine porteur, qui recoupent plusieurs de mes
centres d’intérêts ; la protection de l’environnement mais aussi la protection des hommes.
Les compétences que j’ai pu acquérir lors cette expérience professionnelle me seront très
utile, notamment la prise en main de plusieurs logiciels de dessin tels qu’Autocad ou
CorelDraw. Enfin, les connaissances acquises lors de la licence professionnelle pourront elles
aussi m’être utiles.
Ces 12 semaines de stages ont été très enrichissante. J’ai découvert la réalité de l’exercice de
l’urbanisme et de l’architecture. J’ai été surprise par l’application professionnelle de ces deux
domaines et particulièrement par celui de l’urbanisme. J’ai beaucoup appris et acquis de
nouvelles compétences.
42
Bibliographie
Rapports et textes officiels :
� Rapport de Présentation Plan Local d’Urbanisme, Révision N°4, SAN Ouest Provence,
Ville d’Istres, 638 p.
Documents internes :
� Convention de mise en œuvre ZAC du tubé Retortier, (13 octobre 2011), Ville d’ISTRES,
6 p.
� Ouest Provence Extrait du registre des arrêtés Cahier des Charges de Cession de
Terrain établit en application de l’article L 311 6 du Code de l’Urbanisme, (13 octobre
2011), 11 p.
� Programme Fonctionnel et Technique, (décembre 2016), Direction Départementale
des Services d’Incendie et de Secours des BouchesduRhône, p 3.
� Cahier des Charges Mission de réalisation du cahier de Recommandations
Urbanistiques et Architecturales Conseil départemental des Bouches du Rhône, 10 p.
� Cahier des Recommandations Urbanistiques et Architecturales RUA d’Istres, (mai
2017), SARL Bergé Lefranc Architecture, 60 p.
� Curriculum Vitae SARL Bergé Lefranc Architecture, 5 p.
� Arrêté Préfectoral Captage de la Caspienne (Juillet 2003), Préfecture des Bouches du
Rhône, 8 p.
43
[consulté le 2 juin 2017] Disponible à l’adresse : http://www.collectivites
locales.gouv.fr/files/m61tome1titre12010.pdf
46
Annexes
Les logiciels employés pour réaliser mes activités
J’ai découvert de nombreux logiciels au cours de mon stage et j’ai pu les prendre en mains
rapidement. Ils m’ont tous été très utiles pour réaliser ma mission principale et mes autres
activités.
� CorelPhotoPaint
Ce logiciel permet de retoucher les photos. Je l’ai utilisé pour faire des montages photo afin
de réaliser des planches photos principalement pour le RUA d’Istres et d’Aix en Provence.
� CorelDraw
Ce logiciel est un outil de conception graphique (dessin). Je l’ai régulièrement utilisé afin de
réaliser des cartes et des planches photos pour les RUA d’Istres et d’Aix en Provence.
� Excel
Ce logiciel est un tableur. Je l’ai utilisé pour saisir des données concernant les emplacements
réservés, supprimés ou modifiés se trouvant sur la commune de Gardanne.
� Adobe Acrobate Professional
J’ai utilisé ce logiciel afin de mettre en forme des documents PDF.
� Word
Ce logiciel de bureautique m’a permis de rédiger mon rapport de stage.
� Géo portail
Ce logiciel permet de rechercher un lieu, une photographie aérienne, une parcelle cadastrale,
une carte ancienne, des données géographiques je l’ai souvent utilisé pour m’informer à
propos d’un site, de ce qui se trouve à proximité (routes, bâtiments, équipements …).
� Cadastre
Ce site permet de consulter le cadastre des différentes communes qui se trouvent en France.
� AUTOCAD
Ce logiciel est un logiciel de dessin assisté par ordinateur. Je l’ai utilisé pour créer des cartes
concernant les PLU.
Département des Bouches du Rhône
Direction de l’Architecture et de la Construction
Service Construction Patrimoine
52, avenue de SaintJust 13256 Marseille cedex 20
RECOMMANDATIONS URBANISTIQUES ET ARCHITECTURALES
Centre de secours d’Istres
Mai 2017
BERGE-LEFRANC Architecture
11, traverse des Laitiers 13015 Marseille Téléphone : 04 96 15 78 16 Fax : 04 91 09 86 86
PREAMBULE
Le cahier des recommandations urbanistiques et architecturales
Ce document a pour objet d'offrir aux concepteurs un aperçu du site, de présenter les
contraintes et recommandations urbanistiques et architecturales afin de les aider à élaborer
un projet d’aménagement et de construction cohérent et répondant aux objectifs du Maître
d’Ouvrage.
Dans le cadre du projet de centre de secours qui nous occupe, il donne la synthèse
d’informations, de données et documents recueillis en particulier auprès, de la commune
d’Istres.
Objet de l’étude
La présente étude concerne la création du centre de secours sur un terrain actuellement
inoccupé situé dans la zone nord de la ville, en bordure de la RN 569 et à proximité de
l’Aérodrome d’IstresleTubé.
Ce document traitera dans un premier temps de la situation générale du terrain par rapport
à la commune, à partir de sa zone d’influence, dans un second temps il resserrera l'analyse
sur l’environnement proche du projet puis en final une synthèse des contraintes et objectifs
sera exposée.
ANALYSE DU SITE
1. Analyse des données du site
1.1 Situation
Le site
Le site s’inscrit au sein de la ZAC du Tubé Nord/ Retortier.
Le terrain, assiette du projet, regroupe plusieurs parcelles non construites. Le canal de
Boisgelin, qui a été busé, traverse le site. Celuici est bordé :
Au Nord par des terres agricoles ;
Au Sud par plusieurs bâtiments à visées d’activités ;
A l’Est par le canal des Martigues longe la RN 569 (future A56) et des terres agricoles ;
A l’Ouest par Gardner Cryogenics, deux restaurants et l’aérodrome d’IstresleTubé
L’emprise du projet se développe sur une surface de 21 080 m².
Etude de sol
La société ETUDES ET RECHERCHES GEOTECHNIQUES (ERG) a effectué le 18/12/2014 une
étude géotechnique de type G1 préalable, dans le cadre du projet de la construction du
centre de secours situé sur la commune d’Istres.
Il en est ressorti que le terrain est sensiblement plat au droit du projet. Il est bordé à l’Ouest
par la rue Régis Huilier et à l’Est par la RN 1569. Le terrain est divisé du NordOuest au Sud
Est par un canal d’irrigation actuellement sans eau.
D’après les informations communiquées par le BRGM, les formations du secteur sont
classées en aléa faible visàvis du retrait et/ou gonflement des argiles. Aussi, la commune
d’Istres se situe en zone de sismicité 3 (aléa modéré) selon le décret du 22/10/2010.
Au regard de la carte géologique de la France, à l’échelle 1/50 000, feuille « Istres » le site se
compose des formations alluvionnaires des Cailloutis de Crau essentiellement constituées de
galets siliceux emballés par une matrice sableuse. Parfois une croûte superficielle cimente le
sable sur une faible épaisseur pour constituer une formation rocheuse de type poudingue.
Des lentilles sableuses sont parfois rencontrées dans ces terrains globalement raides. Au sein
de ces formations des variations latérales et verticales de faciès brutales sont fréquemment
observées.
Les investigations géotechniques de GPR ont permis de préciser le contexte géotechnique au
droit du futur centre de secours en mettant en évidence des terrains compacts (graves
grossières) dès la subsurface à partir d’une profondeur comprise entre 0.4 et 0.6m/T.
Ils proposent de fonder le futur centre de secours par l’intermédiaire de semelles
superficielles à semiprofondes, filantes ou isolées. Par ailleurs, compte tenu de
l’hétérogénéité des terrains et de son mode de dépôts (alluvionnaire), des sur profondeurs
plus ou moins ponctuelles sont à prévoir afin d’atteindre des terrains compacts non
remaniés.
1.2 Récolement des services concédés
Une Déclaration de Travaux a été déposé.
Eau Potable
SUEZ EAU France indique la présence d’un réseau de distribution d’eau potable d’un
diamètre de 250mm.
On note aussi la présence d’une borne incendie (voir plan).
Assainissement
Un réseau d’évacuation des eaux usées d’un diamètre de 200mm est aussi présent.
Telecom
Orange indique un réseau de conduite enrobée et une artère en plein terre.
GRDF
GRDF indique la présence d’un réseau de gaz : MPB PE1252004, canalisation de type MPB
en polyéthylène et de diamètre 125.
Electricité
Il indique la présence de réseaux électriques BT (3x150+1x70)AL, BTA (3x95+1x50)AL+TLR) et
HTA (3x1x240) (réseau nappe niveau inférieur) souterrains.
Présence d’un poste électrique de type « Poste Client HTA/BT » sur le terrain.
Eau pluviale
En complément de ces éléments, le plan de géomètre indique un réseau d’eau pluviale de
diamètre 300, avec 2 antennes en bordure du terrain.
Le terrain bénéficie de l’ensemble des réseaux nécessaires au bon fonctionnement du centre
de secours.
1.3 Environnement du projet
Histoire
La commune d’Istres est située à l’ouest de l’étang de Berre. Son territoire, d’une superficie
de 11 373 hectares est l’un des plus étendus de France. Istres bénéficie de la proximité des
agglomérations Marseillaise et Aixoise (60 km par l’autoroute).
Le territoire d’Istres est habité depuis la préhistoire. La première implantation humaine
connue remonte au Magdalénien final. Vers 10 000 avant JC, une peuplade de quelques
centaines d’individus aurait vécu aux alentours de l’Abri Cornille situé sur une colline à
l’ouest de l’étang de l’Olivier.
A la fin du néolithique, une civilisation de pasteurs occupe la colline de Miouvin dominant
l’étang de l’Olivier. D’autres fouilles ont mis en évidence un troisième site, également situé
sur une hauteur en bordure de l’étang de l’Olivier, l’Oppidum du Castellan.
Le centre ancien d’Istres prend naissance à partir d’une fortification seigneuriale. La ville
d’Istres s’élève ensuite en anneau autour de l’église du XIIème siècle sur une colline
dominant l’étang de l’olivier.
L’éloignement de la ville des grands axes de communication ne l’épargnera pas des
nombreuses guerres et invasions qui secouèrent la Provence jusqu’au XIIIème siècle.
Les habitants d’Istres furent aussi durement touchés par la famine de l’année 1970.
Peu avant la période Révolutionnaire, la ville qui était jusqu’alors un gros bourg replié à
l’intérieur de ses remparts, s’étire audelà de son enceinte. A cette époque, elle compte un
peu plus de 2000 habitants, dont une forte proportion d’agriculteurs. Outre ces activités
agricoles orientées vers l’élevage du mouton, la culture du blé, de la vigne et du foin, Istres
connait l’élevage du ver à soie, l’exploitation du chêne Kermès et la récolte du sel. La pêche
et la chasse viennent en complément de ces différentes activités.
Cette profusion de sources de travail assure à Istres un développement important malgré
son isolement par rapport aux grands axes de circulation.
Sociologie
Développement démographique :
Au début du XIXème siècle, la commune connait un développement particulier avec
l’implantation des soudières. Le premier essor industriel d’Istres est lié à l’exploitation des
salines et à l’industrie chimique de Rassuen (engrais) à la fin du XIXème siècle. On recense
alors en 1901 près de 3 500 habitants.
Lors de la première guerre mondiale, l’école d’aviation (1917), puis la base aérienne sont
créées, contribuant à l’expansion de la ville et à sa croissance démographique. En effet, près
de 7 300 habitants sont recensés à Istres en 1936.
Un développement démographique lié à l’immigration et à l’industrie
Depuis 1968, la population d’Istres ne cesse d’augmenter. En quarante ans, la population a
plus que triplé pour atteindre 42 775 habitants en 2007. Istres compte aujourd’hui 376
habitants par km².
Il est possible de distinguer trois phases dans l’évolution de la population istréenne ;
Une première phase de 1968 à 1982. La commune enregistre des taux de croissance annuels
spectaculaires (de 4.4% par an entre 1968 et 1975, jusqu’à 6.7% entre 1975 et 1982). Cette
envolée démographique s’explique par l’industrialisation du site de FossurMer d’une part
et par l’arrivée de la population maghrébine rapatriée d’autre part.
Une deuxième phase de 1982 à 1990 ou la croissance démographique de la commune chute
remarquablement, passant de 6.7% à 2.6% par an. Cette régression démographique
s’explique par le freinage de l’immigration et par la crise économique qui touche
particulièrement le secteur secondaire, entraînant une précarité de l’emploi autour de
l’Etang de Berre.
Une troisième phase à partir de 1990 ou la croissance démographique d’Istres ralentit et se
stabilise autour de 1.2% par an.
Il est important de notifier que le site est localisé au sein d’une zone industrielle. Il se situe à
1,2 km des premières zones résidentielles très peu dense « Les Craux » et à 2km d’un
quartier résidentielle plus denses « Les Bellons ». Ainsi, la construction du centre
départementale de secours d’Istres n’a pas d’impact significatif sur la population.
La structure de la population par âge
Istres n’échappe pas à la tendance généralisée de vieillissement de la population en France.
Toutes les tranches de la population en deçà de 45 ans sont en 2007 moins représentées
qu’en 1999, tandis qu’à partir de 45 ans, toutes les tranches d’âge ont pris de l’importance.
Par exemple, en 1999 les moins de 14 ans représentaient 21.5% de la population istréenne,
en 2007 ils ne sont plus que 18.6%. Ce phénomène est également observé à l’échelle
intercommunale et départementale.
Istres demeure toutefois une commune plutôt « jeune ». En effet, comparativement aux
moyennes départementales, elle compte une part plus importante d’enfants de 0 à 19 ans et
une part nettement moindre de 65 ans et plus.
Une analyse par quartier démontre que certains quartiers concentrent une population plutôt
jeune, avec une part importante de 019 ans (plus de 30% des habitants), c’est notamment
le cas du Prépaou 1 et 2, de Bardin ou la Romaniquette tous situés à environ 5 kilomètres au
sud du site d’étude. Trigance compte également une très faible part de personnes âgées.
Au contraire, certains quartiers présentent un taux important de personnes âgées, avec près
de 25% de 65 ans et plus, comme les Baumes ou le Cros de la Carrière (quartiers situés à plus
de 5 km au sud du site du futur centre de secours). Il s’agit en effet de quartiers anciens,
dans lesquels les habitants sont installés depuis de nombreuses années.
La transformation des structures des ménages
La part des ménages d’une seule personne a fortement augmenté passant de 22.5% à 26.2%.
De plus, la part des couples sans enfants a elle aussi fortement augmenté, passant de 24.8%
à 29%.
Enfin, la part des ménages composés de couples avec enfant(s) a fortement diminué,
passant de 41% à 32.8% entre 1999 et 2007.Cela traduit clairement le phénomène de
décohabitation et de diminution de la taille des ménages.
Le niveau de vie des ménages
Istres compte 56.3% de foyers fiscaux imposables en 2008 un soit un pourcentage plus élevé
qu’à l’échelle du SAN (Syndicat d’Agglomération Nouvelle Ouest Provence) (52.7%) ou du
département (53.3%).
Les revenus sont légèrement supérieurs à Istres et les disparités y sont moins importantes
(rapport interdécile plus faibles sur Istres qu’à l’échelle du SAN et surtout du département).
Le niveau de formation
Le taux de scolarisation des enfants de 6 à 17 ans est quasiment de 100 %, seuls 36.5% des
1824 ans sont scolarisés en 2007. Cette part est beaucoup plus faible qu’à l’échelle du
département, ou 57% des 1824 ans sont encore scolarisés. Cette différence élevée peut
toutefois s’expliquer par les méthodes de recensement (un étudiant quittant sa ville
d’origine pour habiter dans une ville universitaire le temps de ses études sera comptabilisé
làbas, d’où une différence très élevée entre Istres et AixenProvence par exemple).
Contexte urbain
La zone d’activités industrielles, commerciales et tertiaires s’est développée au nordest de
l’aérodrome d’IstresleTubé.
Le site est plutôt isolé et à l’écart des premières habitations ;
Au nord, des prairies permanentes répertoriés au registre parcellaire graphique (RGP) et le
captage de la Caspienne ;
A l’Est, le canal des Martigues, une voie ferrée, la RN 1569 et des prairies permanentes ;
A l’ouest, l’aérodrome d’IstresleTubé ;
Au sud, Euro techni contrôle, Frans Bonhomme, Métifiot, SEERC, le gymnase « O. Arcelli »
et son stade, le cimetière « Notre Dame de la Crau », la Haltegarderie « le tobogan », le
groupe scolaire « la clé des champs » qui regroupe l’école maternelle Raoul Ortollan et
l’école primaire Raoul Ortollan.
La ZAC du Tubé
La zone du Tubé, quant à elle, est divisée en trois parties :
₋ Le Tubé sud qui a atteint le maximum de sa capacité. C’est une zone mixte qui accueille des
entreprises industrielles, commerciales et tertiaires avec un nombre important d’entreprises
soustraitantes des activités de transports et industrialo portuaires installées sur les
communes voisines.
Le Tubé centre accueille, sur sa partie sud, essentiellement des PME artisanales, mais
également des établissements de plus de 50 salariés, notamment dans le domaine du
bâtiment et des transports.
Sur sa partie nord, une zone commerciale est en train de se constituer, autour de grandes
enseignes de jardineries, bricolage…et le futur centre de secours.
Le dossier de réalisation de la ZAC du TubéRetortier a été approuvé par arrêté préfectoral
en date du 14 juin 1977.
Le 26 juin 2002, le SAN à confier la poursuite de la réalisation de la ZAC à l’EPAD Ouest
Provence dans me cadre d’une Convention Publique d’Aménagement.
Les canaux
Le réseau hydrographique naturel du territoire est pratiquement inexistant et seulement
représenté par quelques ruisseaux intermittents et fossés. Etant donné qu’il n’y a pas de
cours d’eau naturel en Crau et que la pluviométrie est faible, il a été nécessaire de procéder
à l’irrigation pour permettre une mise en valeur des terres.
Les premiers travaux datent de la Renaissance. Jusqu’à cette époque, la totalité de la Crau
n’était qu’une plaine de cailloux. Grâce à la construction par Adam de Craponne d’un canal
qui depuis 1554 amène les eaux de la Durance sur son ancien delta, la Crau s’est
transformée peu à peu en une vaste plaine cultivée avec l’apparition d’une Crau « verte »
irriguée, contrastant avec la steppe aride des coussouls. Ces canaux sont, depuis la
réalisation par EDF du barrage de SerrePonçon et l’aménagement de la Durance,
réalimentés à partir de cet ouvrage à hauteur de Lamanon. Cette irrigation avec des eaux
très chargées en limons appelés « nites » a permis de créer des prairies permanentes
irriguées. L’irrigation s’effectue par un ruissellement en évitant une submersion trop
prolongée. La multiplication des points d’entrée de l’eau permet une répartition homogène.
L’entretien, l’aménagement et la modernisation des canaux d’irrigation et d’assainissement
sont fondamentaux pour assurer la pérennité des activités agricoles, tout particulièrement la
culture du foin de Crau, aujourd’hui seul produit non alimentaire labellisé AOC.
Pour l’irrigation de la Crau, l’eau de la Durance est prélevée dans le canal EDF en deux
points ;
Une prise principale à Lamanon, qui alimente le canal commun de Boisgelin
Craponne
Une petite prise légèrement en aval de la précédente appelée prise de Beauplan
Les deux plus importants canaux principaux sur la Crau sont le canal de Craponne, d’une
longueur de 135 km et le canal des Alpines de 115 km.
Concernant le site de la futur caserne départementale le terrain est divisé NordOuest au
SudEst par le canal d’irrigation Boisgelin qui a été busé.
Comme nous l’avons cité précédemment la commune d’Istres possède un réseau
hydrographique pauvre, nécessitant le recours à l’irrigation pour la pratique de l’agriculture,
d’où la présence de nombreux canaux et filioles sur le territoire communal. Les principaux
canaux qui traversent le territoire communal d’Istres sont le canal d’Istres, le canal de
Boisgelin, le canal des Martigues, le canal de Craponne, les canaux jumeaux, le canal de
l’étang d’Entressen et le canal de Capeau. Ils sont gérés par plusieurs Association Syndicale
Autorisées (ASA).
La Caspienne
La Caspienne est un puit de captage qui se situe au nord de l’agglomération, en bordure de
la RN 1569 qui relie Istres à Miramas. Ce puit d’eau potable alimente la commune d’Istres.
Cette station est protégée par la mise en place de périmètres de protection immédiats,
rapprochés et éloignés.
A ces périmètres sont associés des règlements dictant les règles d’urbanisation sur les
parcelles concernées.
Un diagnostic hydrogéologique a été mis en œuvre en 1987 par le Service géologique
régional ProvenceAlpesCôte d’Azur du BRGM afin d’évaluer les risques encourus, de
déterminer les mesures minimales de protection à envisager et d’identifier les solutions de
rechange ou de secours envisageables.
Il en est ressorti que deux canaux à fort débit (200 à 600 litres par seconde) encadrent au
Nord la parcelle clôturée qui constitue le périmètre immédiat. On ignore leurs relations avec
la nappe qui gît 12 à 15 mètres plus bas, mais on peut penser qu’ils constitueraient, le cas
échéant, des barrières collectrices efficaces contre la progression superficielle de polluants
liquides ou solubles, sauf s’ils en sont euxmêmes le véhicule.
La route nationale RN 1569 en remblai de 5 à 6 mètres, domine le site à l’Ouest à 50 mètres
des forages et à 100 mètres du puits. Elle constitue une source de pollution potentielle
importante : pollution chronique par le plomb, mais surtout pollution accidentelle.
De même, les voies ferrés ParisMarseille 300 mètres à l’Est et de la base militaire 40 mètres
au Sud, sont des sources potentielles de pollution accidentelle importantes par les quantités
qui risquent d’être mises en jeu.
Enfin, il existe deux décharges dans les environs, la décharge contrôlée d’ordures ménagères
d’Istres, 400 mètres et la décharge de matériaux inertes, non contrôlée, 400 mètres au Sud
Est. Toutes deux, probablement situées hors du cône d’appel des pompages et qui
paraissent donc peu à redouter.
Concernant le site, celuici se trouve au sein du périmètre de protection rapproché du
captage de la Caspienne. De plus, l’arrêté préfectoral interdit les installations de stockage
d’hydrocarbure dans cette zone.
De ce fait, il faut soumettre pour avis le projet de construction de la future caserne à un
hydrogéologue agréé.
Il sera nécessaire de prendre en considération la nécessité d’une station de carburant et
d’une aire de lavage étant donné que le terrain du futur centre de secours se trouve au sein
du périmètre de protection rapproché du captage de la Caspienne.
L’Etang de l’Olivier et son jet d’eau unique en France
Le jet d’eau de l’étang de l’Olivier, situé à plus de 80 mètres du bord dans l’anse du
Castellan, atteint une hauteur record de 50 mètres. Immense drapeau liquide, il concrétise
l’ambition et la vitalité d’une ville respectueuse de son environnement et tournée vers
l’avenir. Il contribue également à faciliter l’oxygénation de l’étang de l’Olivier.
Ce jet d’eau est unique en France. Il est installé sur un châssis de 6 mètres de côté, immergé
à 50 cm sous le niveau de l’eau pour une meilleure intégration dans l’étang. Cette structure
métallique, en acier inoxydable, pèse 2 200 kilos. La colonne d’eau est alimentée par une
pompe d’une puissance équivalente à 125 chevauxvapeur, située à 3.5 mètres sous
l’eau.
Le jet d'eau est éclairé la nuit par un faisceau de 14 projecteurs. 8 projecteurs diffusent une
lumière blanche directement dans la colonne. 6 projecteurs installés sur le flotteur diffusent
alternativement une lumière rouge, verte ou bleue.
L’aérodrome d’Istres
Istres est le berceau historique de l’aéronautique. La ville s’est développée en parallèle de sa
base aérienne 125 Charles Monier, site hautement stratégique, prépondérant pour l’armée
de l’air française. Mondialement connue la base aérienne continue de participer activement
au prestige de la ville.
A partir de 1920, l’essor de l’aviation se traduisit à Istres par les prouesses de nombreux
pilotes, de raids et de compétitions. En 1950, parallèlement à la Base militaire stratégique,
l’implantation du Centre d’Essais en Vol (CEV) donne à Istres une vocation industrielle avec
une bonne ration de premiers vols mais aussi de records.
L’Ecole d’aviation s’implante en mai 1917. Mondialement connue, elle détient la palme du
rendement : 2 770 pilotes brevetés pour les besoins de la guerre entre 1917 et 1918.
La base aérienne 125 « Charles Monier » est souvent qualifiée de « hors norme » au regard
de ses caractéristiques physiques avec sa piste de 5 000 mètres, la plus longue d’Europe, ses
500 bâtiments, et sa superficie de 2 100 hectares et aussi par la diversité des unités
accueillies ou soutenues : 5 000 personnes, dont 4 000 du ministère de la Défense, réparties
en 70 unités ou entités civiles et militaires, industrielles et étatiques.
Aujourd’hui l’aérodrome d’Istres, dont l’Armée de l’air est affectataire principal, est un outil
essentiel de la défense de notre pays. La base aérienne d’Istres, très bien implantée dans un
environnement exceptionnel, est un site particulièrement actif qui abrite de nombreuses
missions opérationnelles, au cœur de la défense de la France.
La base aérienne et militaire et la zone du Prignan (situé au nordouest de notre site)
accueillent ainsi des entreprises liées aux activités militaires et aéronautiques (piste d’envol,
rechercher nucléaire, base de l’OTAN, base aérienne, DASSAULT, SNECMA, société
européenne de propulsion, école de l’air…). La base aérienne (militaire + entreprises)
globalise entre 5 000 et 5 500 emplois, qui sont recensés dans la catégorie « employé » selon
l’INSEE.
Le SCOT préconise le renforcement du pôle avionique autour de la Base aérienne 125.
Les ZNIEFF et NATURA 2000
Les ZNIEFF ou « Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Floristique et Faunistique » sont des
secteurs particulièrement intéressants sur le plan écologique, participant au maintien des
grands équilibres, naturels ou constituant le milieu de vie d’espèces animales et végétales
rares, caractéristiques du patrimoine naturel régional. Ces zones sont identifiées, localisées
et décrites par l’inventaire des ZNIEFF, établi pour le compte du Ministère de
l’environnement.
Natura 2000 est un réseau européen de sites naturels dont le but est de concilier
biodiversité et activités humaines, dans une logique de développement durable. L’Objectif
principal du réseau Natura 2000 est de favoriser le maintien de la biodiversité, tout en
tenant compte des exigences économiques, sociales, culturelles et régionales, dans une
logique de développement durable.
Le site de la future caserne de secours départementale d’Istres n’est pas directement
concerné par les ZNIEFF de types 1 et 2 et Natura 2000. Cependant, le site est à la frontière
des délimitations de la zone Natura 2000 concernant la directive habitats. Le site est aussi à
proximité des ZNIEFF de types 1 et 2.
Parcs et jardins d’Istres
Istres a été couronnées 4 fleurs par le Label des "Villes & villages fleuris".
La nature a toujours été au cœur des préoccupations istréenne. La commune offre ainsi à ses
habitants un cadre végétal d'excellence avec ses nombreux parcs et jardins qui embellissent
la commune et contribuent ardemment à en faire un lieu de vie et de séjour agréable. Avec
son jardin méditerranéen, ses nombreux parcs et la plaine de la Crau, la nature est au cœur
des paysages istréens.
Le jardin méditerranéen en est l’élément moteur. Situé à proximité de la chapelle Saint
Sulpice et surplombant l'étang de l'Olivier, il a été élaboré à partir de 1997 par le service des
Espaces Verts de la ville d’Istres. Le jardin présente une centaine de variétés de plantes et
d’arbustes du pourtour méditerranéen.
Le jardin méditerranéen offre un lieu de promenade inédit et idéal.
Trame urbaine
Le boulevard Frédéric Mistral, le Boulevard de la République et le Boulevard Paul Painlevé
constituent la périphérie du centre historique d’Istres. Depuis cette couronne, l’Avenue Saint
Exupéry, l’Avenue Alderic Chave, le Boulevard Jean Jacques Prat desservent le centreville
jusqu’à rejoindre les routes départementales, RD53a, RD52a, RD5 et RD16. Ces voies mènent
aussi jusqu’aux différents quartiers d’Istres.
La RD52a, l’Avenue Georges Guynemer et le Chemin des Bellons permettent de rejoindre la
route nationale RN1569 (future A56).
Le terrain de futur centre de secours est assez bien desservi étant donné qu’il se situe au
sein de la ZAC du Tubé Nord. Le site est donc accessible par la RN 1569, par le chemin des
Bellons et la rue Régis Huilier.
Forme du bâti
L’Emplacement du futur centre de secours d’Istres étant défini au sein d’une zone à vocation
industrielle, les bâtiments situés au pourtour du site sont de « type » entrepôts.
Les volumes des bâtiments avoisinants le site sont ainsi assez imposants et pour la majeur
partie, de forme rectangulaire.
Relations avec le tissu urbain
Le terrain du futur centre de secours se trouve au sein de la ZAC du Tubé Nord.
Le site est accessible par la RN 1569 (future autoroute A56) et par le chemin des Bellons. Le
site se trouve à l’Ouest de la RN 1569 et est isolé de la zone urbaine par cet axe majeur de la
commune d’Istres.
La relation du site avec le tissu urbain est donc peu développée.
1.4 Périmètres des monuments historiques
Certains monuments ou sites sont protégés au titre de la législation sur les monuments
historiques dans la commune d’Istres et génèrent un périmètre de protection de ses abords
d’un rayon de 500 mètres tel que défini par la loi de 1913 sur les Monuments historiques,
destiné à protéger les abords.
Le site de la construction du centre de secours n’est pas impacté par le périmètre de
protection des monuments historique. Les monuments classés et les sites inscrits se
trouvent pour la majorité au centre de la ville d’Istres et les autres ouvrages n’impactent pas
le site.
1.5 Etude des circulations et des flux
Istres possède un réseau routier national et départemental performant.
La RN 1569 est le principal axe traversant NordSud de la commune permettant la liaison
entre Miramas et FossurMer. Elle permet aussi l’accès aux axes autoroutiers :
A54 au Nord qui relie Aix en Provence à Nîmes
A55 au Sud qui relie Martigues à Marseille et la RN 568 (FosArles).
A terme, son élargissement à 2x2 voies et son passage en autoroute (A56), assurera une
liaison directe avec l’A54, via le contournement routier de Miramas.
La RD569n permet la liaison entre Fos, Miramas et Salon. Elle traverse la zone agglomérée et
elle a, dans cette section urbaine, un rôle de desserte interquartiers. La RD5 reliant Istres à
Martigues remplit elle aussi un rôle de liaison interquartiers dans sa traversée en zone
agglomérée. La RD52 comptabilise un trafic de 1 476 véhicules par jour, ce qui prouve qu’elle
constitue une liaison importante entre StMitrelesRemparts et Istres.
A l’Est de la voie ferrée, le réseau routier est bien adapté. Les voies structurantes constituent
un quadrillage qui assure un bon maillage entre le centreville et les quartiers. Les quartiers
Sud sont donc très bien desservis et ne présentent pas de problèmes particuliers.
Cependant, la zone agglomérée située à l’Ouest de la voie ferrée présente une insuffisance
des axes EstOuest et des barreaux NordSud. Ce secteur est stratégique pour le
fonctionnement communal puisqu’il recèle les plus importantes potentialités d’urbanisation
pour les années futures. Or, le réseau actuel connaît des insuffisances qui ne manqueront
pas de limiter l’expansion urbaine s’il n’y est pas remédié.
Les principaux problèmes rencontrés en termes de fluidité du trafic ;
L’Option retenue sur la commune est celle des « rondspoints européens » qui assurent une
bonne fluidité du trafic. Seules deux sections connaissent des ralentissements aux heures de
pointe :
le rondpoint des Cognets (vers le centre commercial)
le rondpoint de la Transhumance, en venant de Miramas : entrée base aérienne+
entrée agglomération
Le site du futur centre de secours d’Istres est desservit par la RN 1569 dont la fréquentation
est plutôt dense et ce, particulièrement aux heures de pointes. L’accès au site se fera par
l’emprunt du chemin des Bellons et par la rue Régis Huilier.
Les transports collectifs
Le réseau de transports en commun comporte des lignes urbaines et des lignes
interurbaines.
Le réseau du Conseil Général traverse la commune d’Istres et le réseau Ouest Provence le
bus comporte plusieurs lignes, un réseau propre à la ville d’Istres et un service de transport à
la demande. De plus, le réseau bus du soleil dessert le quartier du Ranquet à Istres.
Des tarifs attractifs ont été instaurés, comme par exemple la carte annuelle à 10 euros pour
les moins de 26 ans. Il est important de noter que les quartiers situés à l’Ouest de la voie
ferrée sont moins bien desservies que les quartiers Est.
La commune d’Istres est traversée par la ligne de chemin de fer MiramasMarseille. Il existe
deux haltes ferroviaires sur la commune, Istres Gare Principale et Gare de Rassuen.
Réseau de bus d’Istres
Le site du futur centre de secours est desservit par la ligne 7 (ZI Retortier/Coutarel), du
réseau Ulysse.
Cette ligne propose 18 allers/ 19 retours quotidiens du lundi au samedi, avec une amplitude
horaire de 7h03 à 20h42. Elle dessert la zone du Retortier, des centres commerciaux des
Craux et des Cognets, du quartier du Prépaou, desserte des établissements scolaires du 2e
degré.
Les déplacements à vélo
La voiture est aujourd’hui le mode de transports privilégié par les Istréens. Cependant, la
commune s’est lancée depuis quelques années dans le développement des mobilités
douces, à travers la réalisation d’études et des premiers aménagements. Ainsi, au printemps
2006 a pu être réalisée la première bande cyclable d’une longueur de 4,6 km.
Une étude approfondie des pratiques et comportements des cyclistes a été menée pour la
DGST en 2005. Celleci démontre que la gestion des intersections et la mise en place de
stationnement sécurisé pour les vélos apparaissent comme les conditions sine qua non de la
réussite du réseau cyclable istréen.
La finalité politique du vélo est celle de rendre le cœur de ville accessible aux bicyclettes afin
de favoriser le commerce de proximité et de desservir l’ensemble des Etablissements
Recevant du Public (écoles, collèges, lycées, mairies…). Le vélo est également envisagé dans
sa dimension touristique comme un moyen propice à la découverte du patrimoine istréen.
De plus, à Istres, le contexte semble favorable au développement du vélo. L’absence de
relief particulièrement élevé ainsi qu’un réseau de voiries de « ville nouvelle » favorisent ce
mode de déplacement.
1.5 Etude des prescriptions urbanistiques
Le terrain fait partie de la ZAC du Tubé Retortier. La convention commune de mise en œuvre
passée entre l’EPAD et le Cahier des Charges de Cession de Terrain pour les lots 81 et 83
s’appliquent en sus du règlement du PLU.
Le site de la ZAC du Tubé est en zone UEtub du PLU d’Istres, correspondant à la zone
commerciale, artisanale et de service du Tubé, mais dans lequel les constructions liées aux
activités agricoles sont autorisées (ZAC).
C’est le règlement le plus contraignant qui s’applique.
Dispositions générales
ARTICLE 6 – Constructions, installations et ouvrages techniques nécessaires au
fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif
Dans les secteurs où les dispositions des chapitres 2 à 5 du règlement d'urbanisme les
autorisent, compte tenu de leur utilité publique ou de leur intérêt collectif, les constructions,
installations et ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou
répondant à un intérêt collectif peuvent s'implanter nonobstant les dispositions des articles
3 à 14.
Le Centre de Secours est d’intérêt collectif, l’article s’applique, sauf contreindication de la
convention et CCCT.
Le CCCT donne des contraintes supplémentaires au PLU sur les surfaces constructibles, les
accès, l’aspect architectural, le traitement du pluvial.
Convention et CCCT sont joints en annexe.
ARTICLE 11 – Implantation des constructions par rapport aux voies et aux emprises
publiques
1.1 Retrait par rapport aux canaux et fossés d’irrigation ou d’assainissement pluvial
Afin de garantir leur bonne gestion et de permettre l’accès aux engins pour l’entretien,
aucune construction, ni clôture, ni affouillement, ni plantation, ne peut être implantée :…/….
₋ à moins de 2 mètres du franc bord d’un canal ou d’un fossé busé. Les clôtures en travers
de la canalisation devront prévoir une ouverture d’une largeur de 2 mètres au droit de la
canalisation.
11.2 Retrait par rapport aux voies départementales et nationales
Dans la zone agglomérée, un retrait de 35 mètres par rapport à l’axe de la RN1569 (future
A56), et de 5 mètres par rapport à l’emprise des bretelles de la RN1569, est imposé à toute
construction.
Le recul est porté à 50 mètres de l’axe de la RN1569 hors agglomération.
Dans tous les cas, l’article L.11114 du Code de l’Urbanisme s’applique en dehors des
espaces actuellement urbanisés, sur les espaces matérialisés au document graphique.
Les constructions et installations y sont interdites dans une bande de 100 mètres de part et
d’autre de la RN1569 et dans une bande de 75 mètres de part et d’autre des autres voies.
Cette interdiction ne s’applique pas : aux constructions ou installations liées ou nécessaires
aux infrastructures routières, aux services publics exigeant la proximité immédiate des
infrastructures routières, aux bâtiments d’exploitation agricole, aux réseaux d’intérêt public.
Elle ne s’applique pas non plus à l’adaptation, au changement de destination, à la réfection
ou à l’extension de constructions existantes.
Il ne s’applique pas dès lors que le règlement du PLU, ou les orientations d’aménagement
par secteur et par quartier, ou le règlement d’une ZAC, prévoit des dispositions spécifiques
relatives à la prise en compte par les projets de construction ou d’installation des nuisances,
de la sécurité, de la qualité architecturale ainsi que de la qualité d’urbanisme et des
paysages.
Le retrait de 35m par rapport à l’axe de la national s’applique. Le retrait de 35m correspond à
la limite de l’Emplacement Réservé n°1 pour la création de l’autoroute
ARTICLE 12 – Protection des captages d’eau destinés à la consommation humaine. A
l’intérieur des périmètres de protection des captages, tout projet d’aménagement ou toute
ouverture à l’urbanisation est conditionnée à l’avis d’un hydrogéologue agréé portant sur la
compatibilité ou non du projet avec la protection du/des captages concernés ou au respect
des prescriptions de l’avis du 09/02/2009 de l’hydrogéologie agréé pour le site d’Areva.
Il convient de se reporter à l’annexe 5.2.12 au présent Plan local d’urbanisme : servitudes
d’utilité publique de type AS1.
Le terrain du centre de secours est implanté dans le périmètre de protection du captage. Les
contraintes s’appliquent.
Le Département missionnera un hydrogéologue agrée.
ARTICLE 13 – Eclairage Afin de limiter l’impact de l’éclairage sur les oiseaux et chiroptères, il
convient de : réduire le nombre de lampadaires aux stricts besoins de l’opération,
d’orienter l’éclairage vers le sol et de positionner sur les lampadaires des « chapeaux » afin
d’orienter la lumière vers le sol, de privilégier les minuteries, les lampes bassetension et
les réflecteurs de lumière, Il est contreindiqué d’utiliser des halogènes et des néons,
d’utiliser lorsque cela est possible un éclairage de sécurité à déclencheur de mouvement,
de ne pas disperser les éclairages vers les zones naturelles ou boisées.
Règlement de la zone UEtub:
La zone EU est une zone à vocation économique, destinée à accueillir des activités
commerciales, artisanales, industrielles et de services. Elle comprend différents secteurs, se
différenciant par leurs activités dominantes.
Le terrain est impacté par le secteur du périmètre de protection du captage d’eau de la
caspienne destiné à la consommation humaine. Celuici se trouve ainsi au sein du périmètre
de protection rapproché de ce captage d’eau. Il est donc impératif de soumettre pour avis le
projet de construction de la future caserne à un hydrogéologue agréé.
Article UE1 Occupations et utilisations du sol interdites
En secteur UEtub :
les constructions et installations liées aux activités agricoles ou forestières
les constructions et installations liées à l’industrie, autres que celles visées à l’article UE2
les constructions et installations à usage artisanal, autres que celles visées à l’article UE2
les constructions et installations à usage d’habitation, autres que celles visées à l’article UE2
les dépôts de véhicules, les garages collectifs de caravanes, les parcs d’attraction et les
terrains de sports motorisés
les terrains de camping et de caravaning
les parcs résidentiels de loisir, les villages de vacances
le stationnement des caravanes isolées et les habitations légères de loisir
l’ouverture et l’exploitation de carrières et les décharges
les installations classées au titre de la protection de l’environnement soumises à
autorisation ou à déclaration, autres que celles visées à l’article UE2
les affouillements et les exhaussements du sol non liés à une opération autorisée
les ouvrages privés prévus sur ou audessus d’un canal d’irrigation
Article UE2 Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières
En secteur UEtub :
les constructions et les installations liées à l’industrie, à condition d’être compatibles avec le
caractère de la zone et de ne pas produire pour le voisinage de nuisance ;
les constructions et les installations à usage artisanal, à condition d’être compatibles avec le
caractère de la zone et de ne pas produire pour le voisinage de nuisance ;
les constructions et installations à usage d’habitation, à condition d’être nécessaires au
fonctionnement de l’activité et à condition qu’elles n’excèdent pas 50% de la surface de
plancher de l’activité liée avec un maximum de 80 m² ;
les installations classées pour la protection de l’environnement compatibles avec le
caractère de la zone, à condition qu’elles ne produisent pas de nuisance pour leur voisinage ;
A l’intérieur du périmètre de protection rapproché d’un captage d’eau destiné à la
consommation humaine, les projets de construction ou d’installation autorisés doivent être
soumis pour avis à un hydrogéologue agréé.
Article UE3Accès et voirie
3.1 Accès
Les caractéristiques des accès doivent répondre aux normes minimales en vigueur
concernant l’approche des moyens de défense contre l’incendie et de protection civile ainsi
que la circulation des véhicules des services publics.
Les accès doivent être adaptés à la nature et à l’importance des usages qu’ils supportent et
des opérations qu’ils desservent et aménagés de façon à apporter la moindre gêne et le
moindre risque pour la circulation publique automobile, cycliste, piétonnière et des
personnes à mobilité réduite.
Le Cahier des Charges de Cession de Terrain de la ZAC indique :
Un seul point de desserte et un seul accès sont prévus, toutefois, d’autres points de desserte
seront «éventuellement possibles, en accord avec l’EPAD et aux frais de l’acquéreur.
A noter que le terrain est constitué de 2 lots, donc bénéficie potentiellement de 2 accès
distincts.
3.2 Voirie
Les caractéristiques des voies publiques ou privées doivent répondre aux normes minimales
en vigueur concernant l'approche des moyens de défense contre l'incendie et de protection
civile ainsi que la circulation des véhicules des services publics.
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées
doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent
desservir.
Les voies nouvelles en impasse doivent comporter un dispositif de retournement permettant
aux véhicules lourds de sécurité, de propreté, assurant des missions de service public, de
manœuvrer et de faire demitour.
L’ouverture de voies nouvelles publiques ou privées est soumise aux conditions minimales
suivantes, et sera soumise à l’approbation des services techniques municipaux.
Largeur de chaussée :
₋ 5 mètres pour les voies en impasse ;
₋ 4 mètres pour les voies à un seul sens de circulation ;
₋ 5,50 mètres pour les voies à double sens de circulation.
Article UE4 Desserte par les réseaux
4.1 Eau potable
Toute construction ou installation qui requiert une alimentation en eau doit être raccordée
au réseau public de distribution d'eau potable.
Toute construction et installation nouvelle doit répondre aux normes définies pour la lutte
contre l’incendie.
4.2 Eau brute
Dans le périmètre d’une Association Syndicale Autorisée d’arrosant, en cas de division
foncière d’une parcelle desservie par le réseau d’irrigation, la desserte de chacune des
parcelles issue de la division devra être assurée par la personne à l’initiative de la division.
4.3 Assainissement
Eaux usées :
Toute construction doit être raccordée au réseau public d'assainissement.
L’évacuation des eaux usées autres que domestiques dans le réseau, si elle est autorisée, est
subordonnée à un prétraitement approprié.
Eaux pluviales :
Les rejets des eaux pluviales dans le réseau public d’assainissement des eaux usées et dans
le réseau d’irrigation sont interdits.
Les rejets des eaux pluviales doivent être dirigés vers un système de collecte des eaux et
évacués soit dans les collecteurs publics soit par des techniques alternatives. Les réseaux
relatifs aux nouvelles constructions seront dimensionnés pour une occurrence décennale
minimale.
Les techniques alternatives aux réseaux d’assainissement pluvial permettent de réduire les
flux d’eaux pluviales le plus en amont possible. Les techniques à mettre en œuvre sont à
choisir en fonction de l’échelle du projet :
₋ à l’échelle de la construction : cuves de récupération d’eau de pluie couvertes,
toitures terrasses ;
₋ à l’échelle de la parcelle : puits et tranchées d’infiltration ou drainantes, noues,
stockage des eaux dans des bassins ;
₋ à l’échelle d’une opération d’aménagement d’ensemble :
o au niveau de la voirie : extension latérales de la voirie (fossés, noues)
o au niveau du quartier : stockage des eaux dans des bassins, puis
évacuation vers un exutoire de surface ou infiltration dans le sol
(bassins d’infiltration).
Concernant les noues et les toitures terrasse, le temps de stagnation d’eau sera inférieur à
24h, l’écoulement sera gravitaire avec une vidange/infiltration constante.
Les ouvrages enterrés comme les chaussées à structure réservoir, chaussées poreuses ou
bassins enterrés sont déconseillés. Le volume stocké dans ces ouvrages ne sera pas
comptabilisé comme mesure compensatoire à l’imperméabilisation nouvelle à moins que ces
ouvrages ne soient visitables.
Concernant les bassins de rétention, les prescriptions et dispositions constructives suivantes
sont à privilégier :
₋ pour les programmes de construction d’ampleur importante, l’aménageur
recherchera prioritairement à regrouper les capacités de rétention plutôt qu’à multiplier les
petites entités ;
₋ afin de faciliter l’intégration paysagère des ouvrages dans le tissu urbain, les
volumes de rétention seront préférentiellement constitués par des bassins ouverts,
végétalisés et accessibles, la profondeur des bassins sera faible (2m maximum) et les talus
seront très doux. Les bassins seront de préférence compartimentés : avec au moins un
compartiment étanche, et un compartiment infiltrant ;
₋ les bassins ou noues de rétention devront être aménagés pour permettre un
traitement qualitatif des eaux pluviales (compartiment étanche avec géomembrane
ou autre). Ils seront conçus de manière à optimiser la décantation et permettre un
abattement significatif de la pollution chronique. Ils seront également munis d’un
ouvrage de sortie équipé d’une cloison siphoïde.
₋ les dispositifs de rétention seront dotés d’un déversoir dimensionné pour la crue
centennale et dirigé vers le fossé exutoire ou vers un espace naturel, dans la mesure du
possible le déversoir ne devra pas être dirigé vers des zones habitées ou vers des voies de
circulation ;
₋ lorsque les débits de fuite sont faibles (inférieurs à 10 l/s), il est préconisé de mettre
en place une grille sur l’ouvrage de sortie afin de ne pas obstruer l’orifice de sortie ;
₋ enfin, afin d’éviter la prolifération des moustiques, un temps de remplissage et de
vidage inférieur à 48h pourra être imposé. Des filtres à sables pourront également être
préconisés afin d’éviter les volumes « morts » à ciel ouvert. En cas d’augmentation de
l’imperméabilisation et si l’opération concerne une unité foncière supérieure à 0,2 ha, des
mesures de maîtrise des débits doivent être mises en œuvre pour toute pluie de période de
retour inférieure ou égale à 10 ans, à hauteur d’un débit de fuite maximum de 10 l/s par
hectare de bassin versant collecté par l’ensemble de l’opération et d’un volume de 800 m3
par hectare imperméabilisé.
Dans tous les cas, afin de garantir le bon fonctionnement hydraulique des ouvrages de
sortie, la capacité de fuite devra être au minimum de 5 l/s.
Dans tous les cas, le pétitionnaire doit se référer au « zonage pluvial » joint en annexe du
PLU.
Le Cahier des Charges de Cession de Terrain de la ZAC indique :
Les eaux pluviales de toiture devront être récoltées et rejetées dans un bassin d’infiltration
situé sur l’emprise du lot. Les eaux de pluie des voiries et d’autres surfaces devront être
rejetées dans le réseau secondaire situé en limite de propriété sans toutefois que le débit au
point de rejet n’excède la valeur de 40l/s/ha de terrain drainé. Le pétitionnaire devra stocker
les eaux de ruissellement dans un bassin de rétention imperméable, avant rejet au réseau
public. Ce bassin sera indépendant du bassin d’infiltration des eaux de toiture. Un séparateur
d’hydrocarbures devra être installé en amont du bassin de rétention.
Le séparateur d’hydrocarbure sera un élément important du dispositif au vu de la
problématique de la protection de la Caspienne.
ARTICLE UE6 Implantation des constructions par rapport aux voies et aux emprises
publiques
Les constructions et installations doivent être implantées à une distance minimale de 5
mètres par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou à créer.
Les 5m de recul s’applique à partir de l’Emplacement Réservé n°1 pour la création de
l’autoroute
6.2 Retrait par rapport aux canaux et fossés
Afin de garantir leur bonne gestion et de permettre l’accès aux engins pour l’entretien,
aucune construction, ni clôture, ni affouillement, ni plantation, ne peut être implantée :
₋ à moins de 2 mètres du franc bord d’un canal ou d’un fossé busé.
Les clôtures en travers de la canalisation devront prévoir une ouverture d’une largeur de 2
mètres au droit de la canalisation.
Le canal busé coupe donc la constructibilité du terrain en 2 secteurs distincts.
ARTICLE UE7 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
7.1 Retrait par rapport aux limites séparatives
La distance horizontale comptée de tout point de la construction au point le plus proche de
la limite séparative, doit être au moins égale à 5 mètres.
ARTICLE UE10 Hauteur maximum des constructions
La hauteur d’une construction est la différence d’altitude calculée verticalement entre le
point le plus bas de la façade de la construction mesurée à partir du terrain naturel avant
travaux et tout point de l’égout du toit ou du sommet de l’acrotère.
La hauteur des constructions mesurée dans les conditions définies cidessus ne peut excéder
12 mètres.
Toutefois, des dépassements de cette hauteur pourront être exceptionnellement autorisés
lorsqu’ils sont motivés par des impératifs techniques ou fonctionnels.
Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas aux constructions et installations
nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
Les dispositions de hauteur ne s’appliquant pas aux installations nécessaires aux services
d’intérêt collectif, la hauteur du pylône radio n’est pas un problème, si toutefois, le pylône est
accepté par les services de la base aérienne.
ARTICLE UE11 Aspect extérieur
Les constructions et installations doivent être de forme simple, et présenter un aspect
extérieur compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, en harmonie avec
leur environnement architectural et paysager.
Les permis de construire et déclaration de travaux pourront être refusés ou n’être accordés
que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur
situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou
ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt
des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation
des perspectives urbaines.
Le Cahier des Charges de Cession de Terrain de la ZAC indique :
L’ensemble des bâtiments implanté sur une même parcelle devra assurer une unité
architecturale et urbanistique au niveau de la volumétrie, du traitement des façades et des
toitures.
11.1 Matériaux et teintes
L’emploi extérieur à nu des matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un parement ou
d’un enduit sont interdits.
11.2 Toitures
Les pentes des toitures inclinées ne doivent pas excéder 35%. L’usage des tuiles y compris la
tuile plate mécanique dite marseillaise est autorisé.
Les souches de cheminées doivent être de forme géométrique simple et réalisées aussi près
que possible du faîtage.
Les conduits apparents en saillie sur la maçonnerie des murs sont prohibés.
11.3 Constructions à usage d’habitation
Les constructions à usage d’habitation doivent être intégrées ou accolées à la construction
principale pour former un ensemble cohérent, et traitées avec le même soin.
11.4 Clôtures
Les clôtures et portail doivent être de forme simple, leur hauteur visible ne doit pas dépasser
2 mètres.
Les clôtures seront de préférence grillagées transparentes ou à écran végétal. Elles ne
doivent comporter aucune partie maçonnée autre qu’un mur bahut dont la hauteur visible
ne doit pas dépasser 1 mètre.
Les prescriptions du 11.1 s’appliquent également aux parties maçonnées des clôture; les
plaques de béton moulé ajourées ou non, les parpaings non enduits, les banches métalliques
ou tous autres matériaux qui n’auraient pas vocation de clôture et qui ne présenteraient pas
un caractère architectural compatible avec l’ensemble des constructions de la zone, sont
interdits.
Localement, une implantation en retrait ou une hauteur inférieure à 2 mètres peuvent être
imposée afin de ne pas créer de danger pour la circulation générale. Les portails devront être
implantés en retrait de l’alignement des voies afin d’éviter les manœuvres dangereuses des
véhicules entrant et sortant.
Les dispositions cidessus s’appliquent, pour la zone UEtub mais la hauteur visible du mur
bahut ne doit pas dépasser 60 centimètres.
11.5 Aires de stockage
Lorsque l’établissement réalisé nécessite la création de surfaces de stockage de matériaux
ou matières premières, elles ne doivent pas être visibles depuis les voies publiques. Elles
doivent être masquées par des haies végétales persistantes ou des masques bâtis
appropriés.
Ces aires ne sont pas autorisées en façade des grands axes et doivent être reportées en
arrière des constructions.
Le Cahier des Charges de Cession de Terrain de la ZAC indique :
Les aires extérieures (de stockage et de présentation de matériel) devront respecter un recul
de 3mètre de la limite de propriété recevant un traitement paysager adapté.
L’aire de stockage d’hydrocarbure et, dans une moindre mesure, l’aire de lavage devront
respecter cet article.
11.7 Installations diverses
Les postes électriques et blocs techniques doivent être de préférence intégrés à une
construction et harmonisés dans le choix des matériaux et des revêtements de construction.
Les dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables (tels que les capteurs
solaires) doivent être intégrés à l’architecture des constructions.
ARTICLE UE12 – Stationnement
12.5 Services publics ou d’intérêts collectifs
1 place pour 4 personnes reçues (le nombre de personnes reçues étant défini de la
même façon que pour la réglementation de sécurité incendie).
₋ Stationnement vélo : à déterminer en fonction de la nature, du taux et du rythme
de fréquentation, de la situation géographique.
A ces espaces à aménager pour le stationnement des véhicules de transports des personnes,
s’ajoutent les espaces à réserver pour le stationnement des camions et véhicules utilitaires
en fonction de l’activité des établissements.
ARTICLE UE13 Espaces libres et plantations
Afin de préserver un espace suffisant entre la cité de la Bayanne et la zone d’activités, une
haie devra être implantée.
Le Cahier des Charges de Cession de Terrain de la ZAC indique :
Les plantations des arbres de haute tige répondant aux obligations du PLU doivent être
effectuées dans des conditions permettant leur bon développement. A cette fin, ils devront
être éloignés d’au moins deux mètres par rapport aux limites séparatives et aux bâtiments, et
l’espace de plantation (bande plantée ou fosse individuelle pour chaque arbre) devra offrir un
volume de terre libre d’au moins 1,5m x 1,5m x 1,5m pour favoriser le développement
racinaire.
ARTICLE UE14 Coefficient d'occupation du sol
Pour les constructions à usage autres que l’habitation :
Le COS est fixé à 0,5.
Le COS n’est plus applicable dans les PLU, néanmoins, le terrain étant en ZAC, le CCCT
s’applique.
Le COS de 0,5 s’applique, soit 8 651 m² de surface de plancher.
1.6 Etude relative à la qualité environnementale
Les caractéristiques du climat du secteur d’Istres sont celles du climat méditerranéen, chaud
et sec l’été, relativement pluvieux aux intersaisons, avec des averses brutales survenant
après des périodes de forte sécheresse.
Concernant les précipitations deux facteurs interviennent :
Il pleut peu (550 mm par an en moyenne entre 1971 et 2000) et les précipitations
sont très irrégulières dans l’année.
Il existe des irrégularités d’une année sur l’autre (de 220 mm en 1967 à 900 mm en
1972).
Les vents soufflent pratiquement en permanence sur la plaine, la fréquence des calmes
étant de 8.5%. Le mistral est le vent dominant (il peut atteindre 120 km/h) et en activant
l’évapotranspiration, il accentue le caractère aride de la Crau. Il souffle en moyenne 110
jours par an, tout particulièrement en été. Les vents du secteur Est et SudEst sont des vents
marins qui apportent la pluie, ils soufflent 50 jours par an environ, particulièrement en
automne.
Ces phénomènes (vents + précipitations faibles et irrégulières) permettent à la sécheresse
de jouer un rôle de facteur limitant.
La température moyenne annuelle est comprise entre 14° et 15°C. Elle s'abaisse rarement en
dessous de 6°C mais des températures de 17° C ont été enregistrées.
On observe en été, dans les zones caillouteuses, une température plus élevée. Les cailloux
jouent un rôle d’accumulateur et régulateur thermique, phénomène important pour la
biologie et la microfaune du sol. La moindre culture ne peut être entreprise que derrière un
abri constitué généralement par des haies de cyprès ou de peupliers.
Au niveau de l’ensoleillement, la région PACA bénéficie en moyenne de 300 jours
d’ensoleillement par an, ce qui en fait l’un des territoires les mieux pourvus d’Europe. Il est
maximal de mai à août avec un ensoleillement mensuel variant de 350 à 400 heures. Ces dix
dernières années, le cumul moyen d’ensoleillement sur Istres était de l’ordre de 2 500
heures par an.
Qualité de l’air
Les oxydes d'azote et le dioxyde d’azote
Le terme « oxydes d’azote » désigne le monoxyde d’azote (NO) et le dioxyde d’azote (NO2).
Ces composés sont formés par oxydation de l’azote atmosphérique (N2) lors des
combustions (essentiellement à haute température) de carburants et de combustibles
fossiles.
Le dioxyde d’azote (NO2) est émis lors des phénomènes de combustion, principalement par
combinaison de l’azote et de l’oxygène de l’air. Les sources principales sont les véhicules et
les installations de combustion.
Le NO2 se rencontre également à l’intérieur des locaux où fonctionnent des appareils au gaz
tels que les gazinières, chauffeeau...
Quelles sont les lignes directrices de l’Organisation Mondiale pour la Santé ?
Les valeurs recommandées par l’Organisation Mondiale pour la Santé sont fondées sur des
études épidémiologiques et toxicologiques publiées en Europe et en Amérique du Nord.
La qualité de l’air s’est améliorée au cours des vingt dernières années, seules les
concentrations d’ozone stagnent. Cependant, les niveaux de pollution relevés en 2015 sont
en légère hausse par rapport aux deux années précédentes en raison de conditions
météorologiques moins favorables à la dispersion des polluants. Ainsi, l’année 2015 marque
une « pause » dans cette lente amélioration. En ProvenceAlpesCôte d'Azur, plus de 340
000 personnes résident dans une zone dépassant la valeur limite pour la protection de la
santé. Des efforts restent à fournir pour respecter les lignes directrices de l’OMS, les
objectifs de réduction fixés dans les plans d’actions (Plan de protection de l’atmosphère
entre autres) et pour prendre en compte la qualité de l’air dans tous les schémas
d’aménagement du territoire.
Données climatiques
Les diagrammes météorologiques du site internet meteoblue sont basés sur 30 ans de
simulations de chaque heure des modèles météorologiques. Ils donnent une bonne
indication des tendances météorologiques typiques et conditions prévues (température,
précipitations, rayonnement solaire et vent). Les données météo simulées ont une
résolution spatiale d'environ 30 km.
Températures et précipitations moyennes
La "maximale moyenne quotidienne" (ligne rouge continue) montre la température
maximale moyenne d'un jour pour chaque mois pour Istres. De même, «minimale moyenne
quotidienne" (ligne bleu continue) montre la moyenne de la température minimale. Les
jours chauds et des nuits froides (lignes bleues et rouges en pointillé) montrent la moyenne
de la plus chaude journée et la plus froide nuit de chaque mois des 30 dernières années.
Ciel nuageux, soleil et jours de précipitations
Le graphique montre le nombre mensuel de jours ensoleillés, partiellement nuageux,
nuageux et des précipitations. Les jours avec moins de 20% de la couverture nuageuse sont
considérés comme des jours ensoleillés, avec 2080% de la couverture nuageuse, comme
partiellement ensoleillés et plus de 80% comme nuageux.
Températures maximales
Le diagramme de la température maximale à Istres montre le nombre de jours par mois qui
atteignent certaines températures.
Quantité de précipitations
Le diagramme de la précipitation pour Istres indique depuis combien de jours par mois, une
certaine quantité de précipitations est atteint.
Vitesse du vent
Le diagramme pour Istres montre combien de jours dans un mois peuvent être attendus
pour atteindre certaines vitesses de vent.
Rose des Vents
La Rose des Vents pour Istres montre combien d'heures par an le vent souffle dans la
direction indiquée. Exemple SO: Le vent souffle du sudouest (SO) au nordest (NE).
L’acoustique
Le réseau routier
La RN 1569 est classée en catégorie 2 sur la section passant à proximité du futur centre de
secours. Le site de la future caserne de secours est compris dans la largeur des secteurs
affectés de part et d’autre de la voie avec un niveau sonore diurne de 79dB.
De plus, il est prévu à l’horizon 2020, la transformation de la RN 1569 en une autoroute
(A56). Il est donc important d’anticiper la présence d’une autoroute à proximité du site.
Les travaux de l’autoroute devraient commencer à l’horizon 2025. Son classement dépendra
entre autre de la vitesse autorisée.
Le réseau ferré
La voie ferrée est classée en catégorie 1, c’estàdire que la largeur des secteurs affectés de
part et d’autre de la voie est de 300 mètres. Certaines parcelles du site du futur centre de
secours se trouvent à une distance inférieur au périmètre établit de 300 mètres ainsi, elles
sont impactées par le niveau sonore de la voie ferré.
Aux abords des voies bruyantes, les règles de construction définies par les arrêtés
préfectoraux doivent obligatoirement être respectées.
L’aérodrome de la base aérienne 125
Le code de l’urbanisme impose que soient établis des Plans d’Exposition au Bruit (PEB)
autour des aérodromes. Ce document d’urbanisme a pour objectif de permettre un
développement maîtrisé des communes sans exposer au bruit de nouvelles populations.
Le Plan Exposition au Bruit de la base aérienne a été approuvé le 04 juillet 1974 et mis en
révision le 31 juillet 1992. Il comprend 4 types de zones de bruit et touche l’ouest et le sud
ouest de la commune.
D’après le Plan d’Exposition au Bruit de l’Aérodrome d’Istres Le Tubé, le site du futur centre
de secours d’Istres n’est pas impacté par les nuisances émises par l’aérodrome.
Le zonage du PEB est basé sur la détermination, en chaque point du sol environnant
l’aérodrome, d’un « indice isopsophique » représentant le niveau d’exposition totale au
bruit des avions. La valeur de l’indice et par conséquent la gêne, décroissent de façon
continue lorsqu’on s’éloigne de l’aérodrome.
L’environnement est partagé en 4 zones d’exposition décroissante au bruit :
La zone A ou l’indice isopsophique est supérieur à 96
La zone B ou l’indice isopsophique est compris entre 80 et 96
La zone C ou l’indice isopsophique est compris entre 84 et 89
Extérieur de la zone C ou l’indice isopsophique est inférieur à 84 et continue à
décroitre
En raison des incertitudes sur diverses hypothèses, des variations dans les conditions de
propagation et de réception du son et des approximations inévitables dans une méthode de
calcul intégrant des sons de nature très variée, le zonage ainsi déterminé est APPROXIMATIF.
L’Aéroport de Marseille-Provence
L’Aéroport de Marseille Provence se situe sur la commune de Marignane. Conformément
aux mesures réglementaires citées précédemment, l’aéroport de MarseilleProvence est
soumis à la procédure de Plan d’Exposition au Bruit (PEB).
Le plan d’exposition au bruit de l’aérodrome de MarseilleProvence a été approuvé par
arrêté préfectoral le 4 août 2006. Il comporte 4 types de zones de bruit et ne touche Istres
qu’à sa frontière avec Miramas, au nordest de la commune. Le site n’est donc pas impacté
par les externalités liées au bruit de l’aéroport de MarseilleProvence.
Les risques
Le risque nucléaire
La présence d’engins nucléaires sur la base aérienne 125 est source d’un risque nucléaire.
Le site est soumis à un Plan Particulier d’Intervention (PPI) dont le périmètre d’alerte
concerne les abords des pistes et des hangars et englobe une partie de la zone agglomérée
(Bayanne). Il s’agit uniquement d’un dispositif d’information de la population en cas
d’accident.
Le PPI n’induit pas d’inconstructibilité.
Le risque lié au dépôt des essences des armées
Un périmètre de danger de 200m est fixé autour du dépôt des essences des armées,
installation classée située au sein de la BA125, côté Tubé.
Un avis devra être systématiquement demandé à la BA125 pour tout projet de construction
de locaux habités à proximité de cette installation classée.
Le transport des matières dangereuses
Les conséquences sont avant tout celles du produit transporté, qui peut être inflammable,
toxique, explosif ou radioactif.
La commune est concernée par le Transport de Matières Dangereuses :
par voie ferrée (voies FosMiramas),
par route : RN1569
Sources :
Tome 1, Tome 2, Tome 3 et Tome 4 du Plan Local d’Urbanisme d’Istres
Site de l’office de tourisme de la ville d’Istres
Rapport d'étude géotechnique G1 Istres ERG
Déclaration de Projet de Travaux : Eclairage Ville, EDF, GRDF, Orange, SUEZ
Convention de mise en œuvre ZAC du Tubé Retortier, commune d’Istres
Cahier des Charges de Cession de Terrain établi en application de l’article L 3116 du
Code de l’Urbanisme