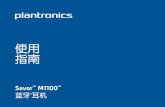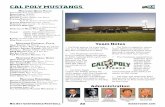Structural studies of poly(butyl acrylate) – poly(ethylene oxide) miktoarm star polymers
RAMAJAKARIMANGA Dina Tsihafoy Poly n° 1301
-
Upload
khangminh22 -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of RAMAJAKARIMANGA Dina Tsihafoy Poly n° 1301
UNIVERSITE D’ANTANANARIVO
ECOLE SUPERIEURE POLYTECHNIQUE D’ANTANANARIVO
DEPARTEMENT BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS
Mémoire de fin d’étude en vue d’obtention du diplôme d’ingénieur en
Bâtiment et Travaux Publics
ETUDE DE CORRELATION ENTRE
LE COMPTEST LNTPB ET LA
MESURE DE COMPACITE IN SITU
Présenté par : RAMANJAKARIMANGA Dina Tsihafoy
Soutenu devant la commission d’examen le 16 décembre 2008 :
Monsieur Martin RABENATOANDRO : Président
Monsieur Tiana Richard RANDRIAMALALA : rapporteur
Monsieur Pierre Donat Guy RAKOTOARISON : Directeur
Monsieur Moïse RALAIARISON : Examinateur
Monsieur Victor RAZAFINJATO : Examinateur
Monsieur Andrianirina RANDRIANTSIMBAZAFY : Examinateur
Promotion : 2007 - 2008
SOMMAIRE
REMERCIEMENTS
NOTATIONS ET SYMBOLES
LISTE DES TABLEAUX
LISTE DES FIGURES
INTRODUCTION
RECONNAISSANCE DES SOLSRECONNAISSANCE DES SOLSRECONNAISSANCE DES SOLSRECONNAISSANCE DES SOLS
Chapitre I- DEFINITIONS ET ELEMENTS CONSTITUTIFS D’UN SOL
Chapitre II- LES CARACTERISTIQUES PHYSIQUES DES SOLS
Chapitre III- LES ESSAIS DE COMPORTANCE ET PORTANCE DU SOL
Chapitre IV- DENOMINATION ET CLASSIFICATION DES SOLS
CONCLUSION [I]
METHODOLOGIEMETHODOLOGIEMETHODOLOGIEMETHODOLOGIE DEDEDEDE CONTROLE DE COMPACTAGE IN SITUCONTROLE DE COMPACTAGE IN SITUCONTROLE DE COMPACTAGE IN SITUCONTROLE DE COMPACTAGE IN SITU
Chapitre I- GENERALITES
Chapitre II- METHODE AU SABLE
Chapitre III- DENSITOMETRE A MEMBRANE
Chapitre IV- METHODE AU CAROTTIER
Chapitre V- METHODE AU GAMMADENSIMETRE
CONCLUSION [II]
ETUDE DE CORRELATION ENTRE LE «ETUDE DE CORRELATION ENTRE LE «ETUDE DE CORRELATION ENTRE LE «ETUDE DE CORRELATION ENTRE LE « COMPTEST LNTPBCOMPTEST LNTPBCOMPTEST LNTPBCOMPTEST LNTPB » ET LA MESURE DE » ET LA MESURE DE » ET LA MESURE DE » ET LA MESURE DE
COMPACITE A L’AIDE D’UN GAMMADENSIMETRECOMPACITE A L’AIDE D’UN GAMMADENSIMETRECOMPACITE A L’AIDE D’UN GAMMADENSIMETRECOMPACITE A L’AIDE D’UN GAMMADENSIMETRE
Chapitre I- COMPTEST LNTPB
Chapitre II- ETUDE DE CORRELATION
Chapitre III- PRESENTATION DES RESULTATS
CONCLUSION [III]
CONCLUSION GENERALE
BIBLIOGRAPHIE
ANNEXES
RESUME
TABLE DES MATIERES
Etude de corrélation entre le « Comptest-LNTPB » et la mesure de compacité in-situ
RAMANJAKARIMANGA Dina Tsihafoy –Département BTP - Promotion 2008 Page | 1
REMERCIEMENTS
Le travail présenté dans ce mémoire a été réalisé au sein de l’Ecole Supérieure Polytechnique
d’Antananarivo (E.S.P.A) dans le Département Bâtiment et Travaux Publics, en collaboration avec le Laboratoire
National de Travaux Publics et du Bâtiment (L.N.T.P.B) sis à Alarobia.
Je tiens à présenter mes remerciements, tout d’abord à Dieu de m’avoir donné le courage, l’esprit et toutes les
forces pour que je puisse finir mes cinq années d’étude et surtout ce mémoire pour pourvoir me qualifié en tant
qu’ingénieur en BTP.
Ensuite je remercie spécialement Monsieur RAKOTOARISON Pierre Donat, qu’il trouve ici l’expression de
toute ma gratitude pour l’encadrement et le soutien qu’il m’a apporté tout le long de ce mémoire.
Je suis reconnaissant à Monsieur RANDRIAMALALA Richard, Ingénieur de Recherche à la Direction des
Recherches et Développement au LNTPB, d’avoir bien voulu juger ce travail en tant que rapporteur.
J’exprime ma sincère reconnaissance à :
- Monsieur RABENATOANDRO Martin ;
- Monsieur RALAIARISON Moïse ;
- Monsieur RAZAFINJATO Victor ;
- Monsieur RANDRIANTSIMBAZAFY Andrianirina ;
Pour l’honneur qu’ils m’ont fait en acceptant de juger ce travail, de présider le jury, d’en être les examinateurs.
Je suis vivement reconnaissant à :
- Monsieur RAMANANTSIZEHENA Pascal : Directeur de l’Ecole Supérieure Polytechnique d’Antananarivo ;
- Tous les enseignants en BTP, qui ont témoigné leurs connaissances ;
Je souhaiterais également remercier toutes les personnes qui m’ont aidé dans mon travail, en particulier
quelques personnels de LNTPB que j’ai côtoyés pendant la réalisation de l’essai, tous les ingénieurs, professeurs,
techniciens, pour les échanges, les contacts et l’ambiance de travail que nous avons partagés.
Ma dernière pensée ira à mon mari, toute ma famille et mes proches.
« Tous les jours de ma vie, la bonté et la
générosité de Dieu me suivront pas à pas »
(Psaume 23 :6)
Etude de corrélation entre le « Comptest-LNTPB » et la mesure de compacité in-situ
RAMANJAKARIMANGA Dina Tsihafoy –Département BTP - Promotion 2008 Page | 2
NOTATIONS ET SYMBOLES
Pour les besoins du présent ouvrage, les notations suivantes s'appliquent :
GENERALITES :
Les masses, en gramme
m: masse total d’un matériau à étudier;
ms : masse des grains solides contenant dans ce matériau ;
mw : masse de l’eau.
Les poids, en KN (avec P=mg)
P: Poids total d’un matériau à étudier;
Ps : Poids des grains solides contenant dans ce matériau ;
Pw : Poids de l’eau.
Les volumes, en m 3
V: volume total d’un matériau à étudier ;
Vs : volume des grains solides contenant dans ce matériau ;
Vw : volume de l’eau ;
Va : volume de la phase gazeuse ;
Vv : Volume des vides ;
V : Volume de l’échantillon de sol ;
PARAMETRES D’IDENTIFICATION :
Poids volumiques, en KN/m 3
γs : poids volumique des particules solides;
γd : poids volumique du sol sec ;
γsat : poids volumique du sol saturé ;
γ’ : poids volumique déjaugé ;
γw : poids volumique de l’eau.
Etat de consistance
e : indice de vide, (1) ;
n : porosité, (1) ;
Sr : degré de saturation, en (%);
W : teneur en eau, en (%) ;
Etude de corrélation entre le « Comptest-LNTPB » et la mesure de compacité in-situ
RAMANJAKARIMANGA Dina Tsihafoy –Département BTP - Promotion 2008 Page | 3
WL : limite de liquidité, en (%) ;
WP : limite de plasticité, en (%) ;
WR : Limite de retrait, en (%) ;
IP : indice de plasticité, en %;
IC : indice de consistance, *(1) ;
ID : indice de densité, *(1).
Granulométrie et composition :
D ou d : diamètre des grains, en mm ;
Dn ou dn : diamètre des grains à n pourcent, en mm ;
Cu : coefficient d’uniformité, *(1) ;
Cc : coefficient de courbure, *(1) ;
CMO : teneur en matière organique, en % ;
QUELQUES ABREVIATIONS :
CBR : Californian Bearing Ratio;
ES : Equivalent de Sable ;
GTR : Guide Technique pour la Réalisation des remblais et des couches de forme
HRB : Hyhway Research Board ;
LNTPB : Laboratoire Nationale pour des Travaux Publics et du Bâtiment ;
L.P.C : Laboratoires des Ponts et Chaussées ;
OPM : Optimum Proctor modifié ;
OPN : Optimum Proctor normal ;
VBS : Valeur de Bleu de méthylène d'un Sol.
ETAT DU MATERIAU
th : très humide ;
h : humide ;
m : moyen ;
s : sec ;
ts : très sec.
MATERIAUX UTILISES
L.A.S : limon argilo-sableux ;
Etude de corrélation entre le « Comptest-LNTPB » et la mesure de compacité in-situ
RAMANJAKARIMANGA Dina Tsihafoy –Département BTP - Promotion 2008 Page | 4
S.L : sable limoneux.
*(1) : un nombre décimal
LISTE DES TABLEAUX
Tableau n° 1: Relations entre les différents paramètres (voir ouvrage [1]) .......................................................... 12
Tableau n° 2 : masse minimale de tamisât nécessaire en fonction de la dimension d’ouverture des mailles du
tamis (selon la norme NF P 18-560) ...................................................................................................................... 18
Tableau n° 3 : Dimension standard des moules Proctor et CBR (voir ouvrage [1]). .............................................. 33
Tableau n° 4 : Les dimensions standard de chaque dame (voir ouvrage [1]). ................................................ 34
Tableau n° 5 : Quantités approximatives de matériaux (voir ouvrage [1]). .......................................................... 35
Tableau n° 6 : Dénomination adoptées en fonction de la grosseur des grains ..................................................... 44
Tableau n° 7 : Caractéristiques des sols pulvérulents et des sols cohérents ......................................................... 44
Tableau n° 8 : Qualificatif selon la teneur en matières organiques ...................................................................... 45
Tableau n° 9 : description sommaire des sols ....................................................................................................... 45
Tableau n° 10 : dénomination selon l’indice de densité relative. .......................................................................... 46
Tableau n° 11 : dénomination selon la densité ..................................................................................................... 46
Tableau n° 12 : dénomination selon la plasticité .................................................................................................. 47
Tableau n° 13: dénomination en fonction de l’indice de consistance ................................................................... 48
Tableau n° 14 : classification LPC pour les sols grenus .......................................................................................... 50
Tableau n° 15: CLASSIFICATION DES SOLS FIN CLASSE A ..................................................................................... 55
Tableau n° 16: CLASSIFICATION DES SOLS SABLEUX OU GRAVELEUX, AVEC FINES CLASSE B .............................. 56
Tableau n° 17: CLASSIFICATION DES SOLS SABLEUX OU GRAVELEUX, AVEC FINES CLASSE B (suite) ................... 57
Tableau n° 18: CLASSIFICATION DES SOLS COMPORTANT DES FINES ET DES GROS ELEMENTS CLASSE C ........... 58
Tableau n° 19 : CLASSIFICATION DES SOLS INSENSIBLES A L’EAU ......................................................................... 59
Tableau n° 20: les caractéristiques du Comptest LNTPB ....................................................................................... 89
Tableau n° 21: Tableau des différents types de matériaux classés selon leurs caractéristiques. ........................ 103
Tableau n° 22: Les différentes valeurs pour le sol de type I ................................................................................ 107
Tableau n° 23: Les différentes valeurs pour le sol type II .................................................................................... 108
Tableau n° 24: valeurs des coefficients de corrélation pour chaque type de sol ................................................. 109
Tableau n° 25: les équations d’ajustements obtenus après calcul ...................................................................... 109
Tableau n° 26: Tableau récapitulatif des erreurs ainsi calculées ........................................................................ 118
Tableau n° 27 : Le domaine d’application de chaque méthode de contrôle. ...................................................... 121
Etude de corrélation entre le « Comptest-LNTPB » et la mesure de compacité in-situ
RAMANJAKARIMANGA Dina Tsihafoy –Département BTP - Promotion 2008 Page | 5
LISTE DES FIGURES
Figure 1: constituants d’un sol ________________________________________________________________ 11
Figure 2 : Schéma d’un pycnomètre ____________________________________________________________ 15
Figure 3 : série de tamis à mailles carrées _______________________________________________________ 18
Figure 4: représentation des courbes granulométriques (ouvrage [1]). ________________________________ 22
Figure 5 : Schéma d’un essai par sédimentométrie ________________________________________________ 23
Figure 6 : Coupelle métallique (calotte sphérique) qui tombe de 10 mm sur un socle en bois de dureté bien
déterminée. _______________________________________________________________________________ 26
Figure 7 : Mise en place de l'échantillon _________________________________________________________ 27
Figure 8 : détermination de la limite de plasticité _________________________________________________ 28
Figure 9 : moule PROCTOR ___________________________________________________________________ 33
Figure 10: les matériels pour la réalisation de l’essai Proctor. ________________________________________ 34
Figure 11 : exemple de courbes Proctor normal et modifié __________________________________________ 37
Figure 12 : Courbe donnant les valeurs de poinçonnement __________________________________________ 41
Figure 13 : état d’un sol en fonction de sa teneur en eau. ___________________________________________ 47
Figure 14 : Abaque de plasticité de Casagrande __________________________________________________ 51
Figure 15 : Tableau synoptique de classification des matériaux selon leur nature ________________________ 60
Figure 16: Coupe de la pointe (pointe perdue) ____________________________________________________ 92
Figure 17 : coupe de la pointe avec enclume. _____________________________________________________ 93
Figure 18 : figure del’appareil COMPTEST _______________________________________________________ 94
Figure 19: Abaque de détermination de la valeur de compacité in situ pour le sol limon argilo-sableux _____ 111
Figure 20: Abaque de détermination de la compacité in situ pour le sol sable limoneux. _________________ 112
Figure 21: Abaque vierge pour la détermination de la valeur de compacité in situ pour le sol limon argilo-sableux
________________________________________________________________________________________ 119
Figure 22: Abaque vierge pour la détermination de la compacité in situ pour le sol sable limoneux. ________ 120
Figure 23: fiche du procès verbal de l’analyse granulométrie par tamisage ______________________________ I
Figure 24: titre d'exemple d'un procès verbal d'un essai granulométrie par sédimentométrie _______________ II
Figure 25:exemple d'un procès verbal de ladétermination des limites d'Atterberg _______________________ III
Figure 26: exemple d’un procès verbal de la courbe Proctor _________________________________________ IV
Figure 27 : Schéma du cône à sable _____________________________________________________________ V
Figure 28: schéma d’un densitomètre à membrane ________________________________________________ VI
Figure 29: Représentation de la droite de régression ______________________________________________ VIII
Etude de corrélation entre le « Comptest-LNTPB » et la mesure de compacité in-situ
RAMANJAKARIMANGA Dina Tsihafoy –Département BTP - Promotion 2008 Page | 6
Figure 30: courbe pour l'ajustement en exponentiel _______________________________________________ IX
Figure 31: Courbe pour l'ajustement en puissance __________________________________________________ X
LISTE DES PHOTOS
Photo 1 : étuve pour sécher l’échantillon et balance pour peser. ........................................................................ 14
Photo 2 : Appareil de CASAGRANDE et l’outil à rainure ....................................................................................... 26
Photo 3: L’appareil pour effectuer l’essai CBR. .................................................................................................... 42
Photo 4 : Densitomètre au sable .......................................................................................................................... 66
Photo 5 : creusement de la cavité ........................................................................................................................ 68
Photo 6: densitomètre à membrane et plaque de base. ...................................................................................... 71
Photo 7: détermination du volume total. ............................................................................................................. 73
Photo 8: Gammadensimètre Troxler série 3411 B ................................................................................................ 78
Photo 9 : Tableau de l’appareil. ........................................................................................................................... 79
Photo 10 : Prise de mesure après enfoncement ................................................................................................... 83
Photo 11: photo d'une tige guide muni de son poignet ....................................................................................... 90
Photo 12: mouton d'un Comptest-LNTPB ............................................................................................................. 90
Photo 13 : Pointe, tige de fonçage avec l’enclume ............................................................................................... 91
Photo 14: exécution de l'essai par le Comptest - LNTPB ...................................................................................... 95
Photo 15: Photo du cône à sable ............................................................................................................................ V
LISTE DES ANNEXES
ANNEXE 1: Exemple d’une fiche du procès verbal pour l’analyse granulométrique par tamisage. ......................... I
ANNEXE 2: Exemple d’une fiche du procès verbal pour l’analyse granulométrique par sédimentométrie. ............ II
ANNEXE 3: Exemple d’une fiche du procès verbal pour la limite d’Atterberg. ........................................................ II
ANNEXE 4: Exemple d’une courbe Proctor. ............................................................................................................ III
ANNEXE 5: SCHEMA D’UN DENSITOMETRE A SABLE .............................................................................................. V
ANNEXE 6: SCHEMA D’UN DENSITOMETRE A MEMBRANE ................................................................................... VI
ANNEXE 7: METHODE DE CALCUL POUR LA DETERMINATION DE LA COURBE DE CORRELATION ..................... VII
ANNEXE 8: Fiche d’essai pour l’essai Proctor ....................................................................................................... XIV
ANNEXE 9:: Fiche d’essai pour la limite d’Atterberg ............................................................................................. XV
ANNEXE 10: Fiche pour la détermination de la densité in situ au grain de riz ..................................................... XVI
ANNEXE 11: photo d'un Comptest LNTPB ........................................................................................................... XVII
Etude de corrélation entre le « Comptest-LNTPB » et la mesure de compacité in-situ
RAMANJAKARIMANGA Dina Tsihafoy –Département BTP - Promotion 2008 Page | 7
INTRODUCTION
Etudier les comportements des sols sous leurs aspects résistance et déformabilité, fournir aux
constructeurs les données nécessaires pour étudier les ouvrages de génie civil et de bâtiment,
assurer leur stabilité en fonction des sols sur lesquels ils doivent être fondés ou avec lesquels
ils seront construits… telles sont les missions en géotechnique accomplies par les ingénieurs
spécialisés.
Cette grande responsabilité nous amène à faire des études particulières pour apporter une aide
précieuse aux problèmes rencontrés par les laboratoires.
Dans le domaine du génie civil, la géotechnique joue un rôle très important dans l’acte de
construire tous les travaux de la route, des bâtiments, barrages, etc.
Concernant le contexte de compactage sa vérification est très importante avant de bâtir soit un
bâtiment soit mise en œuvre de remblai.
Habituellement il existe déjà quatre méthodes de vérification de compactage comme : le
densitomètre à sable, densitomètre à membrane, méthode au carottier et le gammadensimètre.
Mais ces méthodes présentent des inconvénients par ces limites d’utilisation.
L’objectif de ce mémoire est de proposer une autre méthode de vérification de compactage
in-situ qui pourrait apprécier plus facilement et plus rapidement la compacité d’un sol à
étudier. Ce qui nous a poussé de choisir comme thème de mémoire : « Etude de corrélation
entre le "Comptest LNTPB " et la mesure de compacité in situ».
Notre travail s’inscrit clairement dans le cadre d’un environnement professionnel, par
conséquent il est nécessaire de pratiquer une étude à long terme pour les différents types de
sol.
Mais à cause de l’insuffisance de temps, l’étude dans cet ouvrage est limitée seulement pour
les deux types de sols suivants :
Etude de corrélation entre le « Comptest-LNTPB » et la mesure de compacité in-situ
RAMANJAKARIMANGA Dina Tsihafoy –Département BTP - Promotion 2008 Page | 8
• Limon argilo-sableux ;
• Sable limoneux.
Dans la première partie de l’ouvrage, nous allons parler de la reconnaissance de sol. Après
avoir se rappelé des caractéristiques physiques des sols et l’essai de portance du sol, il est
nécessaire de classifier le sol qui va plus particulièrement nous intéresser tout le long de cette
étude.
Dans la seconde partie, nous allons détailler les quatre méthodes de vérification de
compactage in-situ par le gammadensimètre. Cette partie permet de nous expliquer plus
clairement le principe et les procédures de détermination pour chaque méthode.
Nous proposons enfin en dernière partie les études de corrélation entre le « Comptest LNTPB
et la mesure de compacité in situ déjà existant. Nous examinerons successivement la
description de cet appareil, ses principes et procédures d’utilisation. Ensuite la démarche
mathématique pour l’étude de corrélation.
Nous concluons cette dernière partie par des abaques qui résument les résultats de calcul.
Etude de corrélation entre le « Comptest-LNTPB » et la mesure de compacité in-situ
RAMANJAKARIMANGA Dina Tsihafoy –Département BTP - Promotion 2008 Page | 9
RECONNAISSANCE DES SOLSRECONNAISSANCE DES SOLSRECONNAISSANCE DES SOLSRECONNAISSANCE DES SOLS
Etude de corrélation entre le « Comptest-LNTPB » et la mesure de compacité in-situ
RAMANJAKARIMANGA Dina Tsihafoy –Département BTP - Promotion 2008 Page | 10
Chapitre I- DEFINITIONDEFINITIONDEFINITIONDEFINITIONSSSS ET ELEMENTS ET ELEMENTS ET ELEMENTS ET ELEMENTS
CONSTITUTIFS D’UN SOLCONSTITUTIFS D’UN SOLCONSTITUTIFS D’UN SOLCONSTITUTIFS D’UN SOL
I- DEFINITIONS ET DESCRIPTIONS
Un sol se présente sous forme d’agrégats de particules généralement minérales, mais parfois
organiques, de taille et de forme variable. Ses particules sont faiblement liées et peuvent être
séparées par agitation ou trituration dans l’eau.
Un sol est un matériau meuble, poreux, non homogène situé à proximité de la surface de la
terre.
Les sols proviennent par deux origines principales :
• La désagrégation des roches par altération mécanique ou physicomécanique sous
l’effet des agents naturels, tels que :
-Fissuration consécutive à la décompression, aux effets des chocs thermiques ou
du gel ou aux contraintes tectoniques ;
-Attaques mécaniques (chocs ou frottements) dans un processus naturel de
transport : gravitaire, éolien, fluvial, marin, glaciaire ;
-Attaques chimiques sous l’effet de circulations d’eaux ;
• La décomposition d’organismes vivants : végétaux (tourbes), ou animaux (craies).
On l’utilise comme matériau de base en génie civil. Il sert de :
-Support pour les ouvrages : toutes les structures réalisées transmettent leurs
charges au sol de fondation par l’intermédiaire de fondations superficielles ou profondes ;
-Matériau de construction : exploité en carrières ou dragué en rivière, il entre dans
la fabrication des bétons (granulats), est utilisé pour la fondation des chaussées, la réalisation
de barrages, de digues, de remblais, etc.
Etude de corrélation entre le « Comptest-LNTPB » et la mesure de compacité in-situ
RAMANJAKARIMANGA Dina Tsihafoy –Département BTP - Promotion 2008 Page | 11
Le sol est un matériau à trois phases : agrégats des particules minérales dont les vides peuvent
être remplis de liquide et/ou de gaz. On distingue globalement :
- La phase solide constituée par les particules minérales ou organiques de
l’agrégat ;
- La phase liquide, constituée par l’eau qui occupe les vides de l’agrégat. On dit
que le sol est saturé si toutes les vides sont remplis d’eau ;
- Dans le sol non saturé, une partie de vide est remplie par du gaz,
essentiellement de l’air.
0 Va Vv
P Pw Vw V
Ps Vs
Figure 1: constituants d’un sol
P: Poids total V: volume total
Ps : Poids des grains solides Vs : volume des grains solides
Pw : Poids de l’eau Vw : volume de l’eau
Va : volume de la phase gazeuse
II- PARAMETRE DEFINISSANT L’ETAT DU SOL
Volume des vides : Vv = Vw + Va
Volume de l’échantillon de sol : V = Vs + Vw + Va = Vs + Vv
Poids volumique apparente du sol : γ = P / V
Poids volumique sec : γd = Ps / V
Poids volumique du solide : γs = Ps / Vs
Teneur en eau : W = Pw / Ps
Indice des vides : e = Vv / Vs
Porosité : n = Vv / V
Degré de saturation : Sr = Vw / Vv
GAZ
LIQUIDE
SOLIDE SOLIDE
Etude de corrélation entre le « Comptest-LNTPB » et la mesure de compacité in-situ
RAMANJAKARIMANGA Dina Tsihafoy –Département BTP - Promotion 2008 Page | 12
La phase solide du sol est caractérisée par la description de ses particules élémentaires
(dimensions, formes, état de surface, nature chimique et minéralogique) et de leur
arrangement.
Le tableau ci après nous montre la relation entre les différents paramètres du sol.
Définition n (-) e (-) γ [kN/m3] γd [kN/m3]
Teneur en eau W
[%]
w
s
WW
W
S
Wγγ
=−
n.Sr.(1 n).
W
S
Wγ
γ= e.Sr.
d
d
Wγ γ
γ−=
1 1W
d S
W γγ γ
= −
Porosité n (-) += W av V VV
V V - n
e1 e
=+
1
SW
γγ
= −+
n(1 )
γ γγ−= s d
s
n
Poids volumique
apparente γh [kN/m3]
WV
Ws+WwVs+Vw+Va
= SWγ γ= − +(1 n)(1 )
(1 )
1 S
Wγ γ+=+ e
- (1 ) dWγ γ= +
Poids volumique
sèche γd [kN/m3] + +S
s w a
WV V V
(1 )γ γ= −d sn 1
γγ =+
sd e
1 W
γγ =+d -
Poids spécifique γs
[kN/m3]
WsVs
(1 )(1 )W
γγ =− +s n
γ γ= −s d(1 e) (1 )(1 )W
γγ =− +s n
1
γγ =−
ds n
Tableau n° 1: Relations entre les différents paramètres (voir ouvrage [1])
Etude de corrélation entre le « Comptest-LNTPB » et la mesure de compacité in-situ
RAMANJAKARIMANGA Dina Tsihafoy –Département BTP - Promotion 2008 Page | 13
Chapitre II- LES CARACTERISTIQUES PHYSIQUES LES CARACTERISTIQUES PHYSIQUES LES CARACTERISTIQUES PHYSIQUES LES CARACTERISTIQUES PHYSIQUES
DES SOLSDES SOLSDES SOLSDES SOLS
I- La teneur en eau (Norme à consulter NF P 94-050)
On considère la teneur en eau comme un paramètre d’état pour la classer parmi les
caractéristiques physiques et pour évaluer la consistance d’un sol fin.
La détermination de la teneur en eau pondérale des matériaux se fait par étuvage d’un
échantillon intact, remanié ou reconstitué.
1) Définitions
- La teneur en eau pondérale d’un matériau (W) est le rapport du poids de l’eau dans
le matériau (PW) au poids des particules (Ps), exprimé en pourcentage ;
- La teneur en eau naturelle (Wnat) d’un matériau est la teneur en eau déterminée
lorsque les conditions de prélèvement sur site, de transport et de conservation de
l’échantillon n’ont entrainé aucune modification.
2) Principe
La teneur en eau est directement liée à l’indice des vides. Elle permet donc de caractériser
l’état du sol. La teneur en eau se mesure conventionnellement en portant le sol à la
température de 105°C jusqu’à ce que sa masse se stabilise. Cela correspond à l’évaporation de
l’eau libre du sol. Pour les sols contenant des matières organiques, la température d’étuvage
est limitée à 60°C pour éviter de bruler les matières organiques. C’est aussi le cas des sols
contenant du gypse (le gypse perd son eau de constitution vers 65°C).
Lors de l’étuvage, l’échantillon provoque une perte d’eau. On mesure alors par pesage les
masses de l’échantillon et de l’eau évaporée.
Etude de corrélation entre le « Comptest-LNTPB » et la mesure de compacité in-situ
RAMANJAKARIMANGA Dina Tsihafoy –Département BTP - Promotion 2008 Page | 14
Photo 1 : étuve pour sécher l’échantillon et balance pour peser.
3) Méthode
Pour la réalisation de l’essai, il y a une masse minimale de matériau nécessaire à respecter en
fonction de la dimension des éléments passants à travers le tamis à maille carrée d’ouverture
dm.
L’échantillon de matériau est pesé, puis placé dans une étuve. Une fois la dessiccation
réalisée, l’échantillon est pesé à nouveau.
Les pesés donnent par différence la masse d’eau évaporée.
W
s
mW
m=
Avec :
2 3
3 1
W
s
m m m
m m m
= −= − ; en gramme
Où :
m1 : masse du récipient, en gramme;
m2 : masse de l’échantillon avec le récipient, en gramme ;
m3 : masse de l’échantillon avec le récipient après étuvage, en gramme.
La valeur de la teneur en eau est exprimée en pourcentage et l’intervalle
d’arrondissage est de 0,1.
Etude de corrélation entre le « Comptest-LNTPB » et la mesure de compacité in-situ
RAMANJAKARIMANGA Dina Tsihafoy –Département BTP - Promotion 2008 Page | 15
II- LE POIDS SPECIFIQUE (γs) Selon la norme NF P 94-054
1) Définition
Le Poids spécifique γs d’un matériau est l’ensemble des poids volumiques de chaque
particule sans avoir compter les vides.
2) But
On détermine le poids spécifique pour pouvoir confirmer l’identification des sols (état
de saturation). Pour le sol courant, on le déterminera par méthode pycnométrique et pour les
granulats c’est par pesée hydrostatique.
3) Méthode pycnométrique
Appareillage : Des pycnomètres, ayant des références pour les identifier, muni de son
bouchon ;
Figure 2 : Schéma d’un pycnomètre
Principe :
Le problème est de mesurer le volume des grains solides constituant l'échantillon de sol.
Cette mesure est effectuée généralement au pycnomètre.
Une masse connue Ms de sol séché (par passage à l'étuve à 105'C jusqu'à masse constante) est
introduite dans un récipient contenant de l'eau distillée. Un agitateur magnétique sépare les
particules les unes des autres. Les bulles d'air libérées sont aspirées par-un vide d'air (trompe à
eau). Après s'être assuré qu'aucune bulle d'air n'est piégée entre les particules solides, on
détermine avec un très grand soin le volume d'eau déplacée par les particules solides.
Etude de corrélation entre le « Comptest-LNTPB » et la mesure de compacité in-situ
RAMANJAKARIMANGA Dina Tsihafoy –Département BTP - Promotion 2008 Page | 16
Exécution de l’essai :
− Prendre une certaine quantité de matériau pour l’essai
− Etuver cette prise à 105°C pour le sol courant pendant 24 heures ;
− Si l’échantillon est sec, broyer légèrement à l’aide du mortier et pilon de façon à
ne pas écraser les éléments grenus ;
− Bien malaxer pour avoir un échantillon homogène ;
− en effectuant l’opération de quartage, on prélève les 2 parties opposées et les 2
autres parties sont conservées pour confirmer en cas de doute sur les résultats;
− étalonner les pycnomètres avant leur usage, pour déterminer le volume en pesant
le pycnomètre vide muni de son bouchon, soit P1;
− peser le pycnomètre ayant de l’eau distillé jusqu’au repère, soit P2 ;
− Verser le matériau dans le pycnomètre, l’agiter bien puis enlever les vides en
utilisant la cloche à vide ;
− Remplir le pycnomètre avec de l’eau distillé et laisser se décanter pendant
quelques heures ;
− Repeser
− On passe au calcul
Expression des résultats :
Le volume de la phase solide Vs, égal au volume d'eau déplacée par le sol, est déterminé par
pesée.
Puis on obtient le poids d’après la relation : P= m x g avec g : accélération de la pesanteur,
en m/s-2.
Soit :
• P2 : poids du pycnomètre contenant l'eau distillée jusqu’au repère, en kN
• P3 : poids du pycnomètre contenant le sol, l'eau distillé avec pycnomètre plein, en kN.
P3= P2 + Ps –ρw .Vs
Avec
Ps : poids des particules solides,en KN ;
ρw : masse volumique de l'eau distillée,en T/m3 ;
VS : volume des particules solides, en m3 2 3S
W
P P PV s
ρ+ −=
Etude de corrélation entre le « Comptest-LNTPB » et la mesure de compacité in-situ
RAMANJAKARIMANGA Dina Tsihafoy –Département BTP - Promotion 2008 Page | 17
D’où : 2 3
S SS W
S S
P P
V P P Pγ ρ= = ×
+ − Exprimé en [kN/m3]
L'erreur relative sur le résultat est de l'ordre de quelques 10-4.
III- ANALYSE GRANULOMETRIQUE (selon NF P 18-560)
1) Description
Un sol est constitué de particule de dimension différente. L’analyse granulométrique a pour
but de déterminer la proportion pondérale des granulats.
L’essai consiste à faire la description des sols, et contribue à apprécier les qualités drainantes
et la sensibilité à l’eau des matériaux ainsi que leur aptitude au compactage.
L’analyse se fait de deux (2) façons différentes :
Par tamisage pour les particules ayant des dimensions comprises entre 0,080mm et 80mm
(appelées aussi gros éléments) ;
Par sédimentométrie pour les particules inférieures à 0,080mm (les fines).
Pour séparer les fines et les gros éléments on procède à un lavage de ce matériau.
2) Analyse granulométrique par tamisage
L’essai consiste à repartir, au moyen d’une série de tamis à mailles carrées, un matériau en
plusieurs classes granulaires de dimensions croissantes.
Les résultats obtenus sont exploités, soit sous leur forme numérique, soit sous forme
graphique (courbe granulométrique).
Etude de corrélation entre le « Comptest-LNTPB » et la mesure de compacité in-situ
RAMANJAKARIMANGA Dina Tsihafoy –Département BTP - Promotion 2008 Page | 18
Figure 3 : série de tamis à mailles carrées
a) Réalisation de l’essai
On a effectué une prise d’essai de masse M, qui dépend des dimensions des éléments
le plus gros qu’elle contient, telle que :
300D < M <500D
D : diamètre maximale des grains observées dans le sol étudié, en mm ;
M : masse de la prise, en gramme.
La prise d’essai se présente selon les tableaux ci-dessous :
Tamis d (µm) 400 500 630 800
Masse de sol
(g) 20 50 100 150
Tamis
d(mm) 1 5 6,3 8 10 12,5 16 20 25 31,5 40 50 63 80 d>80mm
Masse de
sol (kg) 0,2 0,3 0,4 0,5 8 1,2 2 3 5 8
12
20 30 50 6 3,666.10m d−=
Diamètre
des
montures
des tamis
200mm≥
250mm≥
315mm≥
Tableau n° 2 : masse minimale de tamisât nécessaire en fonction de la dimension d’ouverture des mailles
du tamis (selon la norme NF P 18-560)
Etude de corrélation entre le « Comptest-LNTPB » et la mesure de compacité in-situ
RAMANJAKARIMANGA Dina Tsihafoy –Département BTP - Promotion 2008 Page | 19
Cette prise d’essai s’effectue sur le matériau à l’état naturel pour avoir la teneur en eau
naturelle de l’échantillon.
Puis on détermine la masse sèche Ms de l’échantillon après étuvage à 105°C (60°C
pour les matériaux évolutifs) en fonction de la teneur en eau par la formule suivante :
1s
MM
W=
+
Etant donné qu’on a obtenu la masse M après avoir fait une opération de quartage, le
matériau doit être trempé dans l’eau pendant 12 heures de temps au minimum. Après
trempage, on procède au lavage du matériau à l’aide du tamis de 0,080mm, d’une cuvette,
d’un pinceau pour séparer les fines de l’échantillon à étudier. Quand le lavage est terminé, on
récupère les passants pour les essais de sédimentométrie.
Après avoir séché à l’étuve les éléments > 0,080mm, on a obtenue une nouvelle masse
Ms1 lors du pesage. On procède alors au tamisage de ces éléments en agitant manuellement la
série de tamis (colonne). Au bout de cette agitation, chaque tamis va retenir des grains de
dimension supérieure au trou, on les appelle « refus ».
Tamisage de l'échantillon :
Verser le matériau lavé et séché dans la colonne de tamis. Cette colonne est constituée par
l'emboîtement des tamis, en les classant de haut en bas dans l'ordre de mailles décroissantes,
et en ajoutant un fond plein et un couvercle.
Agiter manuellement ou mécaniquement cette colonne, puis reprendre un à un les tamis en
adaptant un fond et un couvercle. Agiter chaque tamis.
Verser le tamisât recueilli sur le fond sur le tamis immédiatement inférieur.
Pesées :
Peser le refus du tamis ayant la plus grande maille: soit R1 la masse de ce refus.
Ajouter le refus obtenu sur le tamis immédiatement inférieur. Soit R2 la masse du refus
cumulé.
Poursuivre la même opération avec tous les tamis de la colonne pour obtenir les masses des
différents refus cumulés
Peser le tamisât sur le fond. Soit Tn sa masse.
Etude de corrélation entre le « Comptest-LNTPB » et la mesure de compacité in-situ
RAMANJAKARIMANGA Dina Tsihafoy –Département BTP - Promotion 2008 Page | 20
b) Expression des résultats
Les résultats sont portés sur une feuille d'essai dont un modèle est donné en annexe 1.
Les masses des différents refus cumulés Ri sont rapportées à la masse totale de l'échantillon
pour essai sec Ms.
Les pourcentages de refus cumulés obtenus sont inscrits sur la feuille d'essai.
100i
s
R
M×
Les pourcentages de tamisât correspondants sont égaux à :
100 100i
s
R
M
− ×
Tracé de la courbe granulométrique :
Il suffit de porter les divers pourcentages des tamisât ou des différents refus cumulés sur une
feuille semi-logarithmique :
En abscisse : les dimensions des mailles, échelle logarithmique
En ordonnée : les pourcentages sur une échelle arithmétique.
La courbe doit être tracée de manière continue et peut ne pas forcement passer par tous les
points.
Interprétation des courbes
La forme de la courbe granulométrique obtenue apporte les renseignements suivants :
La dimension D du plus gros granulat,
La plus ou moins grande proportion d'éléments fins,
La continuité ou la discontinuité de la granularité.
Soit Dx le diamètre correspondant au pourcentage x %. On définit :
Etude de corrélation entre le « Comptest-LNTPB » et la mesure de compacité in-situ
RAMANJAKARIMANGA Dina Tsihafoy –Département BTP - Promotion 2008 Page | 21
� L'étalement de la granulométrie par le coefficient d'uniformité de HAZEN.
6 0
1 0u
DC
D=
Pour Cu < 2 : granulométrie uniforme
Pour Cu > 2 : granulométrie étalée
� Le coefficient de courbure
230
10 60C
DC
D D=
×
Selon la forme de la courbe, on dira que la granulométrie est :
La granulométrie est étalée
Granulométrie serrée
Etude de corrélation entre le « Comptest-LNTPB » et la mesure de compacité in-situ
RAMANJAKARIMANGA Dina Tsihafoy –Département BTP - Promotion 2008 Page | 22
Granulométrie continue
Granulométrie discontinue
Granulométrie bien graduée
Granulométrie mal graduée
Figure 4: représentation des courbes granulométriques (ouvrage [1]).
Le traçage de la courbe granulométrique se fait à partir des poids de chaque refus
cumulé. Cette courbe sert à classifier les sols meubles ou grenus.
3) Analyse granulométrique par sédimentométrie
Cet essai permet de déterminer la distribution pondérale de la taille des particules de
sols de dimension inférieure à 0,080mm (les fines). Il complète l’analyse granulométrique par
tamisage, et qui est nécessaire à la description et à la classification de ce sol.
Les particules inférieures à 0,080mm sont mises en suspension dans l’eau additionnée
d’un dé floculant après avoir se décanter puis siphonner et étuver.
Pour la prise d’essai, on associe 40g d’échantillon avec 1,5g de solution
d’hexamétaphosphate de sodium.
En laissant se reposer pendant 24 heures, les particules sédimentent à différentes
vitesses en relation avec leur taille. Ensuite, on passe à la mesure à l’aide d’un densimètre qui
sera effectué à l’évolution dans le temps et de température de suspension. La distribution
pondérale de la taille des particules sera calculée.
Etude de corrélation entre le « Comptest-LNTPB » et la mesure de compacité in-situ
RAMANJAKARIMANGA Dina Tsihafoy –Département BTP - Promotion 2008 Page | 23
Figure 5 : Schéma d’un essai par sédimentométrie
CALCUL :
Au bout d’un certain temps t, les particules de dimension D vont descendre avec la
vitesse v à la profondeur Hr.
A l’instant t, il n’y a plus des particules de diamètre >D à la profondeur H, à laquelle
est faite la mesure de densité, car leur sédimentation est plus rapide. D’autre part, la
concentration de la suspension en particules de diamètre <D à la profondeur Hr est la même
qu’à l’instant initial.
Alors : %G=10
1
1040
2000 R
s
s ×−
×γ
γ
D=Femnt
Hr
/
Un abaque donne les valeurs de Fe en fonction de la température de la suspension et
du poids volumique des grains solides de l’échantillon.
IV- EQUIVALENT DE SABLE (selon NF P 18-598)
1) Description
L’équivalent de sable a pour but de connaître la propriété du sable utilisé c'est-à-dire
de mesurer les quantités des éléments sableux qui sédimentent et les éléments fins qui se
floculent.
La valeur de l’équivalent de sable (ES) est obtenue en mesurant la partie sableuse
sédimentée et la hauteur totale du floculant et la partie, sableuse sédimentée, et en effectuant
le rapport des deux mesures.
2) Réalisation de l’essai
Pour la réalisation, on utilise une éprouvette portant deux (2) repères, on introduit
jusqu’au première repère en bas de la solution spéciale et on verse la prise M= 120(1+W), en
Etude de corrélation entre le « Comptest-LNTPB » et la mesure de compacité in-situ
RAMANJAKARIMANGA Dina Tsihafoy –Département BTP - Promotion 2008 Page | 24
gramme. En attendant 10 minutes de repos, on fixe l’éprouvette avec son contenu sur la
machine agitée, cette dernière va faire 90 cycles en 30 secondes. L’agitation terminée, on
procède au lavage en introduisant directement au fond de l’éprouvette un tube laveur pour que
la couche de sable fines ne se perde pas en faisant couler la solution. Lorsque la solution
arrive au second repère en haut, on arrête le lavage. En laissant se reposer pendant 20 minutes,
les particules vont se décanter. Alors on passe à la mesure.
Soient :
h1 : la hauteur total du flocula et du sable ;
h2 : la hauteur du sable.
2
1
1 0 0h
E Sh
= ×
En conclusion, si :
ES = 100 : sable propre ;
ES > 80 : sable mieux pour le béton ;
35 < ES < 75 : sable pour la construction routière.
V- ETUDE DE LA PLASTICITE DU SOL : LIMITE D’ATTERBERG
Les limites d’Atterberg caractérisent les différents états du sol fin suivant la teneur en
eau. C’est de définir l’état plastique d’un sol.
Le comportement d'un sol varie dans des proportions importantes en fonction de sa teneur en
eau.
Pour une valeur élevée de la teneur en eau, le sol se comporte à peu prés comme un liquide ;
c'est de la boue: les forces de cohésion ne sont pas assez importantes pour maintenir les
particules en place.
Quand la teneur en eau diminue, vient la phase plastique ; on peut encore modeler la terre
sans qu'elle s'effrite, elle conserve sa forme.
Puis on ne peut plus modeler la terre: elle se fendille au cours du travail: c'est la phase solide.
Etude de corrélation entre le « Comptest-LNTPB » et la mesure de compacité in-situ
RAMANJAKARIMANGA Dina Tsihafoy –Département BTP - Promotion 2008 Page | 25
On peut encore subdiviser cette phase solide. Lorsque la quantité d'eau demeure relativement
importante, la pellicule d'eau qui enveloppe les grains repousse ces grains et augmente le
volume apparent ; de sorte que, si l'on sèche un tel sol, il y aura retrait. Tandis que, pour une
teneur en eau encore plus faible, l'eau ne repoussera plus les particules du sol, et le volume
sec sera égal au volume humide: ce sera la phase solide sans retrait.
Les teneurs en eau qui correspondent au passage de l'un à l'autre de ces états sont
respectivement :
• la limite de liquidité WL ;
• la limite de plasticité Wp ;
• la limite de retrait WR.
On appelle indice de plasticité la différence Ip = WL - WP. C'est l'étendue de l'intervalle
pendant lequel on peut " travailler " le sol.
On appelle indice de consistance Ic le rapportL
P
W W
I
−, W étant la teneur en eau du sol à l'état
naturel.
1) Réalisation de l’essai
L’essai consiste à déterminer les coups compris entre 15 et 35 pour 4 ou 5 opérations
et de calculer la teneur en eau correspondant. Puis on va tracer la courbe de teneur en eau (en
%) en fonction du nombre de coup (N). Déterminer graphiquement la teneur en eau
correspondant à 20 coups.
a) Préparation de l'échantillon
On utilise une " pâte " de sol ne comportant que les éléments fins qui passent à travers le
tamis de 0,4 mm.
Il ne faut pas sécher le sol avant de le tamiser: on modifierait le comportement de certaines
particules.On opère par voie humide:
Placer le sol dans le tamis, sur un récipient plus grand,
Etude de corrélation entre le « Comptest-LNTPB » et la mesure de compacité in-situ
RAMANJAKARIMANGA Dina Tsihafoy –Département BTP - Promotion 2008 Page | 26
Verser doucement de l'eau, et laver au pinceau,
Laisser reposer; décanter,
Laisser sécher jusqu'au point désiré, sans chauffer
b) Limite de liquidité
Matériel utilisé :
Photo 2 : Appareil de CASAGRANDE et l’outil à rainure
Figure 6 : Coupelle métallique (calotte sphérique) qui tombe de 10 mm sur un socle en bois de dureté bien
déterminée.
Mode opératoire :
Préparation de l'échantillon :
Amener, par tâtonnement, l'échantillon à une teneur en eau légèrement supérieure à la limite
de liquidité.
Etude de corrélation entre le « Comptest-LNTPB » et la mesure de compacité in-situ
RAMANJAKARIMANGA Dina Tsihafoy –Département BTP - Promotion 2008 Page | 27
Mise en place de l'échantillon :
Répartir la pâte à la spatule, de façon homogène, dans la coupelle.
Figure 7 : Mise en place de l'échantillon
La pâte recouvre le fond de la coupelle sauf sur une partie d d'environ 3 cm.
Epaisseur f au centre: 15 à 20 mm, pourtour sensiblement horizontal.
Essai :
Faire une rainure dans l'axe de la coupelle en tenant l'outil sensiblement perpendiculaire à
cette coupelle,
Tourner la manivelle, 2 chocs par seconde. Compter le nombre de chocs N tout en observant
le fond de la rainure. Arrêter lorsque les lèvres de la rainure se rejoignent sur une longueur de
1 cm environ.
Si le nombre de chocs est inférieur à 15, on laisse se sécher l'échantillon puis on recommence
l'essai,
Si le nombre est supérieur à 35, ajouter un peu d'eau (bien mélanger), puis on recommence
l'essai,
Si 15 ≤ N ≤ 35, déterminer la teneur en eau. Pour cela:
Prélever à l'aide de la spatule un peu de pâte de chaque côté des lèvres de la rainure,
Placer ce prélèvement dans une coupelle de masse M, exprimée en gramme ;
Peser immédiatement, soit Mh, en gramme ;
Porter à l'étuve pour dessiccation complète (ou sur plaque chauffante),
Peser sec, soit Ms, en gramme.
Etude de corrélation entre le « Comptest-LNTPB » et la mesure de compacité in-situ
RAMANJAKARIMANGA Dina Tsihafoy –Département BTP - Promotion 2008 Page | 28
. . '
.h s
s
M M Masse de l eauW
M M Masse sèche
−= =−
Par définition, la limite de liquidité WL est la teneur en eau qui correspond à la fermeture de 1
cm pour un nombre de chocs N égal à 25.
Mais le nombre de chocs N aura rarement été 25. Il faut donc recommencer en faisant varier
la teneur en eau.
On tracera alors la droite moyenne ajustée sur les couples de valeurs obtenus (lg N - W) et on
déduira WL correspondant à N = 25.
Calculs et résultats :
Les quantités étant peu importantes, il est souhaitable d'obtenir le centigramme pour les
pesées de l'échantillon.
Pour le calcul des teneurs en eau: 1 chiffre décimal pour chaque prise, la limite de liquidité
obtenue pour une valeur N égale à 25 étant arrondie à l'entier le plus proche.
c) Limite de plasticité
La limite de plasticité WP est inférieure à WL; il faut donc laisser l'échantillon sécher un peu
plus.
Quand le moment est venu, faire une boulette de pâte et la transformer en un cylindre en la
roulant sur une surface plane propre, lisse, sèche et non absorbante ( à la main ou à l'aide
d'une plaque plane, un aller et retour par seconde ) .
Figure 8 : détermination de la limite de plasticité
Par définition, la limite de plasticité WP est la teneur en eau du rouleau qui se fissure au
moment où son diamètre atteint 3 mm ± 0,5 mm.
Etude de corrélation entre le « Comptest-LNTPB » et la mesure de compacité in-situ
RAMANJAKARIMANGA Dina Tsihafoy –Département BTP - Promotion 2008 Page | 29
Le rouleau terminé doit avoir 10 cm de longueur et ne doit pas être creux. La limite de
plasticité est atteinte lorsque, simultanément, le rouleau se fissure et que son diamètre atteint 3
mm ± 0,5 mm.
Si aucune fissure n'apparaît, le rouleau est réintégré à la boulette. La pâte est malaxée et
légèrement séchée.
Si la limite de plasticité est atteinte, déterminer la teneur en eau du rouleau.
Faire un minimum de 2 essais et, si les valeurs s'écartent de plus de 2% de la valeur moyenne,
refaire un essai.
Pour le calcul des teneurs en eau: 1 chiffre décimal pour chaque prise, la limite de plasticité
obtenue en faisant la moyenne arithmétique des teneurs en eau étant arrondie à l'entier le plus
proche.
VI- VALEUR DE BLEU DE METHYLENE D'UN SOL (Norme
à consulter : NF P 94-068)
1) Définition
Les argiles contenues dans un sol ont la propriété de fixer le bleu de méthylène
proportionnellement à leur surface spécifique.
L'essai consiste à mesurer par dosage la quantité de bleu de méthylène pouvant s'absorber sur
la prise d'essai. Cette valeur est rapportée proportionnellement à la fraction 0/50 mm du sol
considéré.
2) Appareillage et matériel d'essai
� Agitateur à ailettes tournant entre 400 et 700 t/mn.
� Dispositif de dosage permettant d'injecter des volumes de 2, 5 et 10 cm3
� Papier filtre blanc avec teneur en cendre < 0,01 %.
� Baguette de verre de 8 mm de diamètre
� Récipient de 3,000 dm3 et de diamètre 155 mm
� Solution de bleu de méthylène de qualité médicinale à 10 g/l
� Matériels courants : balance, tamis, chronomètre, etc
Etude de corrélation entre le « Comptest-LNTPB » et la mesure de compacité in-situ
RAMANJAKARIMANGA Dina Tsihafoy –Département BTP - Promotion 2008 Page | 30
3) Préparation de l'échantillon
- Si le Dmax du matériau est ≤ 50 mm, prélever une masse m de matériau à sa teneur en
eau naturelle telle que : m > 200 Dmax (m en grammes, Dmax en millimètres).
- Si le Dmax du matériau est > 50 mm, prélever 10 kg de sa fraction 0/50 mm.
- Si le Dmax de l'échantillon prélevé est ≥ 5 mm:
• Séparer par tamisage et si nécessaire par lavage la fraction 0/5 mm
contenue dans cet échantillon.
• Déterminer la proportion pondérale C de la fraction 0/5 mm sèche
contenue dans le matériau (ou dans sa fraction 0/50 mm lorsque Dmax > 50 mm). Cette
proportion peut-être lue sur la courbe granulométrique du matériau.
- Homogénéiser la fraction 0/5 mm ainsi séparée et préparer trois prises d'essai
sensiblement égales et de l'ordre de:
• 30 à 60 g dans le cas de sol très argileux à argileux,
• 60 à 120 g dans le cas de sol moyennement à peu argileux.
- Introduire la 1ère prise d'essai de masse m1 dans le récipient de 3,000 dm3 et ajouter
500 cm3 d'eau déminéralisée. Placer le récipient sous l'agitateur et le faire tourner pendant au
minimum 5 mn à 700 t/mn.
- La 2è prise de masse m2 sert à déterminer la teneur en eau de chacune des prises
d'essai.
- La 3è prise est conservée dans un récipient hermétique pour renouveler l'essai si
nécessaire.
4) Mode opératoire
La prise d'essai étant imbibée:
Mettre l'agitation à 400 t/mn pendant toute la durée de l'essai.
A l'aide du dispositif de dosage, introduire dans la suspension 5 à 10 cm3 de solution
de bleu.
Au bout de 1 min, prélever à l'aide de la baguette une goutte de suspension et la
déposer sur le papier filtre.
Etude de corrélation entre le « Comptest-LNTPB » et la mesure de compacité in-situ
RAMANJAKARIMANGA Dina Tsihafoy –Département BTP - Promotion 2008 Page | 31
Le test est dit positif si, dans la zone humide, apparaît autour du dépôt central une
auréole bleu claire. Il est dit négatif si l'auréole est incolore.
Injecter successivement des doses de 5 à 10 cm3 jusqu'à ce que le test devienne positif.
A partir de ce moment, effectuer des tests toutes les minutes sans ajout de solution.
Si l'auréole disparaît avant la 5è min, procéder à de nouvelles injections de 2 à 5 cm3,
chaque addition étant suivie d'essais effectués de minute en minute
L'essai est terminé lorsque le test reste positif pendant 5 min. Noter le volume total V
de solution nécessaire pour atteindre l'adsorption totale.
5) Calculs et expression des résultats
Les grandeurs mesurées au cours de l'essai sont :
m1 : Masse humide de l'échantillon constituant la première prise d'essai (en grammes)
m2 : Masse humide de l'échantillon servant au calcul de la teneur en eau (en grammes)
m3 : Masse sèche de l'échantillon m2 (en grammes)
V : Volume de la solution de bleu de méthylène utilisé (en centimètres cubes)
La valeur au bleu du matériau testé est:
0
100B
VBS Cm
= × ×
Avec VBS est la valeur de bleu de méthylène d'un sol
B = masse de bleu introduite = V * 0,01
C = Proportion de la fraction 0/5 mm
m0 = masse sèche de la prise d'essai = m1 / (1+w)
w = teneur en eau de l'échantillon = (m2 - m3) / m3
Etude de corrélation entre le « Comptest-LNTPB » et la mesure de compacité in-situ
RAMANJAKARIMANGA Dina Tsihafoy –Département BTP - Promotion 2008 Page | 32
Chapitre III- LES LES LES LES ESSAIS DE COMPORTANCE ET ESSAIS DE COMPORTANCE ET ESSAIS DE COMPORTANCE ET ESSAIS DE COMPORTANCE ET
PORTANCEPORTANCEPORTANCEPORTANCE DUDUDUDU SOLSOLSOLSOL
I- ESSAI DE COMPACTAGE : ESSAI PROCTOR (Norme à
consulter : NF P 94-093)
Quel que soit le procédé utilisé pour corroyer une terre, passage d’engins, de rouleaux,
damage manuel ou mécanique, etc., la densité finale du sol ainsi transformé dépend de la
teneur en eau.
1) Description
Le compactage permet de diminuer les vides dans le sol et d’augmenter ainsi sa
résistance à la déformation.
Les caractéristiques sont la teneur en eau qui doit être optimale et le poids volumique
sèche maximal.
On distingue deux (2) types d’essai Proctor :
� Essai Proctor normal (OPN) utilisé pour la construction des digues, de la route
à faible trafic, barrage, etc. Pour l’essai, la masse de la dame est de 2,5 kg, son
hauteur de chute est de 25 cm, le moule est de diamètre 12 cm et de hauteur 12
cm ;
� Essai Proctor modifié (OPM) pour la route à forte trafic. Pour l’essai, la masse
de la dame est de 4,5 kg, son hauteur de chute est de 35 cm, le moule est de
diamètre 15 cm et de hauteur 15 cm.
Les deux (2) essais sont identiques dans leur principe, seules diffèrent les valeurs des
paramètres qui définissent l’énergie de compactage appliquée.
On réalise 5 opérations avec une teneur en eau croissante de 2% entre chaque
opération. En observant tous les résultats, on passe au traçage de la courbe appelée « courbe
Proctor » reliant la variation du poids volumique sec en fonction de la teneur en eau.
On détermine alors, d’après cette courbe, la valeur de la teneur optimale Wopt qui
correspond au poids volumique sec maximalmaxdγ .
Etude de corrélation entre le « Comptest-LNTPB » et la mesure de compacité in-situ
RAMANJAKARIMANGA Dina Tsihafoy –Département BTP - Promotion 2008 Page | 33
2) Matériel utilisé
a) MOULE
C'est un tube métallique cylindrique, ouvrable en deux demi-coquilles que l'on peut fixer sur
une base, et muni d'une hausse.
Figure 9 : moule PROCTOR
Il existe 2 moules : le moule PROCTOR, utilisable pour les sols fins
le moule C.B.R., utilisé le plus souvent.
Moule D (mm) H (mm)
PROCTOR 101,6 116,5
C.B.R. 152 152,5 dont disque d'espacement, épaisseur 36 mm soit
hauteur utile = 116,5 mm
Tableau n° 3 : Dimension standard des moules Proctor et CBR (voir ouvrage [1]).
b) DAME
Deux (2) dames sont utilisées en fonction de l'intensité de compactage désiré :
La dame P.N. pour l'essai PROCTOR NORMAL
La dame P.M. pour l'essai PROCTOR MODIFIE
Etude de corrélation entre le « Comptest-LNTPB » et la mesure de compacité in-situ
RAMANJAKARIMANGA Dina Tsihafoy –Département BTP - Promotion 2008 Page | 34
Type φ (mm) Masse (g) Hauteur de chute (mm)
P.N. 50 2490 305
P.M. 50 4535 457
Tableau n° 4 : Les dimensions standard de chaque dame (voir ouvrage [1]).
Figure 10: les matériels pour la réalisation de l’essai Proctor.
3) Conditions de compactage
L'énergie de compactage dépend de la dame et du moule utilisés.
On fait varier le nombre de couches de remplissage, et le nombre de coups de dame par
couches:
• Essai PROCTOR NORMAL : remplissage en 3 couches.
• Essai PROCTOR MODIFIE : remplissage en 5 couches.
Pour que toute la surface soit uniformément touchée, on compactera ainsi:
• Moule PROCTOR : 3 cycles de 8 coups répartis, plus un dernier coup
au centre, soit 25 coups par couche.
• Moule C.B.R. : 8 cycles de 7 coups répartis, six approximativement
tangents à la périphérie et le 7è au centre, soit 56 coups par couche.
Etude de corrélation entre le « Comptest-LNTPB » et la mesure de compacité in-situ
RAMANJAKARIMANGA Dina Tsihafoy –Département BTP - Promotion 2008 Page | 35
Les quantités approximatives de matériaux à introduire par couche sont les suivantes:
Moule Essai P.N.
(3 couches)
Essai P.M.
(5 couches)
PROCTOR 650 g 400 g
C.B.R. 1700 g 1050 g
Tableau n° 5 : Quantités approximatives de matériaux (voir ouvrage [1]).
4) Réalisation de l’essai
L’essai Proctor est nécessaire pour identifier les matériaux et pour définir les
spécifications de compactage lors de la construction des remblais et des couches de forme.
Lorsqu’on rencontre des matériaux friables tels que : craies, marnes, schistes, grès et
calcaires tendres etc., l’essai nécessite une interprétation spécifique. Et si l’échantillon
contient beaucoup des éléments supérieurs à 20mm, on procède au calcul de correction.
Pour la prise de l’échantillon, on prend entre 15kg à 100kg suivant la granularité du
matériau, car il est n’est pas autorisé de réutiliser le même matériau pour la détermination de
plusieurs points de la courbe Proctor.
En commençant l’essai, il faut que le matériau doive avoir son état hydrique jugé
suffisamment sec, alors il est nécessaire de le sécher soit à l’air soit à l’étuve réglé à 50°C au
maximum. Puis on passe au tamisage du matériau et à l’opération de quartage.
Pour les compactages, le matériau est humidifié par addition progressive de la quantité
d’eau puis malaxée.
Compactage :
Compacter la première couche à l’aide de la dame normal ou modifiée selon le cas, en
appliquant 55 coups bien repartis sur la totalité du moule (en répétant 7 fois le cycle suivant 6
coups adjacents entre eux sur la paroi et le septième coup au centre).
Scarifier légèrement la surface compactée à l’aide de la truelle et introduire
successivement la deuxième couche puis recommencer les mêmes opérations de compactage
et ainsi de suite jusqu’à la cinquième (5ème) couche.
Etude de corrélation entre le « Comptest-LNTPB » et la mesure de compacité in-situ
RAMANJAKARIMANGA Dina Tsihafoy –Département BTP - Promotion 2008 Page | 36
Quand la compactage de la dernière couche est terminée, on enlève la hausse, on a
constaté que la hauteur du matériau a dépassé au niveau supérieur du moule à environ 1cm
qu’on arase à l’aide de la règle à araser en partant du centre vers l’extérieur, et pour nettoyer
les parois du moule utiliser le pinceau.
On va peser le moule à 5grammes près après avoir enlever l’embase et le disque. Pour
déterminer la teneur en eau, on prélève 2 échantillons de la partie supérieure de l’éprouvette
compactée, le second dans la partie inférieure.
Après étuvage à105°C, peser et faire la moyenne avant de démouler l’éprouvette à
l’aide de marteau en bois et d’un burin.
5) Expression des résultats
Pour chaque éprouvette compactée il convient de calculer :
- La teneur en eau ;
- Le poids de matériau sec contenu dans le moule ;
- Le poids volumique du matériau sec en tenant compte du volume réel du
moule utilisé, déterminé à partir de mesures géométriques réalisées à
0,1mm près.
En obtenant toutes les résultats, on passe au traçage de la courbe appelée « Courbe
Proctor » reliant la variation du poids volumique sec en fonction de la teneur en eau. La
courbe de compactage présente un maximum de densité sèche ( maxdγ ) pour une teneur en eau
optimale (Wopt). Le plan est borné à droite par l’hyperbole (dite courbe de saturation) définie
par la relation paramétrique suivant :
3............... .. 1 /r sw
sr
w
Sd avec T m
s W
γγ γγγ
×= =+
Etablies pour :
Sr = 100 et 80 %/m3
Et pour :
γs = 2,70 T/m3 (estimée ou mesurée)
Etude de corrélation entre le « Comptest-LNTPB » et la mesure de compacité in-situ
RAMANJAKARIMANGA Dina Tsihafoy –Département BTP - Promotion 2008 Page | 37
• Calcul de la teneur en eau W exprimée en [%] :
W = 100×Ps
Pe
Avec Pe : poids d’eau dans le sol, en kN ;
Ps : poids des particules, en kN.
• Poids volumique sec γd : c’est le rapport du poids de particule au volume total de
l’échantillon étudié, en kN/m3.
γd =V
Ps
L’essai est fait au laboratoire sur les matériaux inférieurs à 5 mm.
De toute façon la correspondance entre la réalisation d’une densité par un engin sur place ou
la norme Proctor au laboratoire doit être assurée par les essais in situ dont les résultats sont
utilisés ultérieurement pour le contrôle d’exécution.
ur l’identification des sols, on peut dire que :
� maxdγ < 16 kN/m3 : on a un mauvais sol ;
� 18 kN/m3 < maxdγ < 19 kN/m3 : un sol convenable ;
� maxdγ > 20 kN/m3 : un sol excellent.
Figure 11 : exemple de courbes Proctor normal et modifié
Etude de corrélation entre le « Comptest-LNTPB » et la mesure de compacité in-situ
RAMANJAKARIMANGA Dina Tsihafoy –Département BTP - Promotion 2008 Page | 38
Interprétation de la courbe
On a appliqué une énergie constante sur les différents essais qu’on a effectués à l’aide d’une
dame normalisée. Dans ce cas on observe que :
Si la teneur en eau est plus basse, le sol contient une certaine quantité des vides qu’on
pourra encore diminuer en additionnant de l’eau et en malaxant à nouveau;
Si l’on augmente progressivement la teneur en eau, la densité sèche continue à croitre.
A ce moment on atteint la valeur maximum de la densité sèche qui correspond à une teneur
en eau optimum.
Quand on augmente encore la quantité d’eau, l’eau ajouté ne peut plus trouver sa
place, alors les particules de terre ne peuvent plus se serrer autant les unes contre les autres,
et nécessairement la densité sèche diminue.
Au fur et à mesure qu’on ajoute de l’eau, cette densité sèche continue à décroitre
jusqu’à ce que la terre obtienne un caractère plastique à tel point qu’on ne puisse plus la
compacter.
Influence des cailloux sur la densité sèche et la teneur en eau optimum
Des corrections sont à apporter à la teneur en eau optimum et au poids volumique sec
maximal dans le cas où les matériaux contiennent des cailloux (éléments supérieurs à 20 mm).
Les formules de correction pour le poids volumique sec ne sont applicables que pour un
pourcentage m d’éléments supérieurs à 20 mm inférieur ou égal à 25% (m25%≤ ).
Correction de la teneur en eau
Par hypothèse, on néglige la quantité d’eau retenue par les éléments supérieurs à 20 mm.
Alors la teneur en eau corrigée W’ tenant compte des éléments supérieurs à 20 mm est la
suivante :
' (1 )100
mW W= −
Avec :
• W : teneur en eau optimale de l’essai Proctor, en % ;
• m: pourcentage pondéral du refus à 20 mm, en %.
Etude de corrélation entre le « Comptest-LNTPB » et la mesure de compacité in-situ
RAMANJAKARIMANGA Dina Tsihafoy –Département BTP - Promotion 2008 Page | 39
Correction du poids volumique sec maximal
On suppose que les éléments supérieurs à 20mm flottent dans la fraction fine (m25%≤ ).
Le poids volumique sec corrigé γd’ est donné par la formule :
max
'max
1 ( 1)100
dd
d
s
m
γγγγ
=+ −
Avec :
• maxdγ : poids volumique sec optimum Proctor ;
• m: pourcentage pondéral du refus à 20 mm, en % ;
• γs : poids volumique des grains solides des éléments supérieurs à 20 mm.
II- ESSAI CBR (Californian Bearing Ratio)
Cet essai permet d’évaluer la résistance des sols au poinçonnement en mesurant les
forces à appliquer sur un poinçon cylindrique pour le faire pénétrer à vitesse constante dans
une éprouvette de matériau.
On a comme type d’indice :
- Indice Portant immédiat (IPI) ;
- Indice CBR immédiat ;
- Indice CBR après immersion.
Pour la détermination de l’indice CBR de dimensionnement de chaussée, les
caractéristiques suivantes sont souvent retenues :
- Teneur en eau : Wopt ;
- Masse volumique sèche maxdγ ;
- Etat de saturation qui est obtenu après quatre jours d’immersion.
Avant d’effectuer l’essai CBR, il faut donc faire l’essai Proctor pour déterminer la
teneur en eau optimum qui sera la teneur en eau de moulage de l’essai CBR. Il faut déterminer
également la teneur en eau naturel avant moulage du matériau à étudier pour pouvoir
apprécier la quantité d’eau qu’il faudra ajouter au matériau pour l’amener à la teneur en eau
optimum de l’essai Proctor.
Etude de corrélation entre le « Comptest-LNTPB » et la mesure de compacité in-situ
RAMANJAKARIMANGA Dina Tsihafoy –Département BTP - Promotion 2008 Page | 40
L’eau joue un rôle important sur la capacité portante des sols, le poinçonnement est
réalisé soit à la teneur en eau naturelle, soit une teneur en eau déterminé après imbibition ou
après saturation.
Pour l’indice Portant Immédiat, on retient comme caractéristique d’état :
• La teneur en eau où on veut évaluer l’aptitude du matériau à supporter
la circulation des engins;
• La masse volumique du sol sec correspondant à la valeur obtenue lors
du compactage à la teneur en eau considérée, à l’énergie Proctor normal pour le sol, et à
l’énergie Proctor modifié dans le cas d’un matériau d’assise de chaussée.
On prépare une série d’échantillon compacté avec la teneur en eau optimale. Les
échantillons sont poinçonnés soit directement soit après 4 jours d’immersion selon l’objet de
l’essai. On trace une courbe de pression en fonction de l’enfoncement du piston.
Sur cette courbe on trouve les forces correspondantes aux enfoncements de 2,5mm et
5mm, ensuite on calcule les indices de portance ou indice CBR tel que :
Indice CBR = max (3,705,2P
; 1,105
0,5P)×100
70,3 et 105,1 en kgf/cm², pression provoquant les mêmes enfoncements dans les matériaux de
référence qui est le tout-venant de concassage.
Calculs et résultats
Reporter sur un graphe effort – déformation (force et pénétration) les valeurs de
poinçonnement mesurées pour les enfoncements prévus.
Si la courbe présente une concavité vers le haut au démarrage, il y a lieu de corriger
l'origine de l'échelle des enfoncements.
Etude de corrélation entre le « Comptest-LNTPB » et la mesure de compacité in-situ
RAMANJAKARIMANGA Dina Tsihafoy –Département BTP - Promotion 2008 Page | 41
Figure 12 : Courbe donnant les valeurs de poinçonnement
Avec P2, 5 = ²......
...'.
cmenpistonSection
kgenFtenfoncemendEffort =
3,19
.. 5,2FEffort
P5 = ²......
...'.
cmenpistonSection
kgenFtenfoncemendEffort =
3,19
.. 5FEffort
Etude de corrélation entre le « Comptest-LNTPB » et la mesure de compacité in-situ
RAMANJAKARIMANGA Dina Tsihafoy –Département BTP - Promotion 2008 Page | 42
On a alors,
Indice portant CBR à 2,5 mm =(2,5)
1001351
F ×
Indice portant CBR à 5,0 mm = (5,0)
1002026,5
F ×
Pour le plate forme de terrassement : CBR > 0 ;
Pour le remblai de fondation : CBR > 30 ;
Pour la couche de base : CBR > 80.
Photo 3: L’appareil pour effectuer l’essai CBR.
Etude de corrélation entre le « Comptest-LNTPB » et la mesure de compacité in-situ
RAMANJAKARIMANGA Dina Tsihafoy –Département BTP - Promotion 2008 Page | 43
Chapitre IV- DENOMINATION ET DENOMINATION ET DENOMINATION ET DENOMINATION ET CLASSIFICATION CLASSIFICATION CLASSIFICATION CLASSIFICATION
DES SOLSDES SOLSDES SOLSDES SOLS
I- INTRODUCTION
On appelle « sol » la partie meuble de l’écorce terrestre qui peut être séparé simplement par
agitation dans l’eau. Nous avons affecté au sol un symbole pour faciliter son identification
pendant cette étude.
Classer un sol consiste à l’identifier grâce à des mesures quantitatives et à lui donner un nom
afin de le rattacher à un groupe de sol de caractéristiques semblables.
Les critères retenus pour la dénomination du sol reposent sur une appréciation faite par le
sondeur à partir de l’aspect visuel, de la couleur, de la grosseur des grains et éventuellement
de l’odeur.
II- DENOMINATION DES SOLS DANS LE DOMAINE
GEOTECHNIQUE
1) Dénomination suivant la granularité
La répartition granulométrique des composantes d’un sol est le critère le plus utilisé pour la
dénomination d’un sol.
Les dimensions des grains sont appréciées visuellement par comparaison aux ouvertures d’un
tamis normalisé.
Etude de corrélation entre le « Comptest-LNTPB » et la mesure de compacité in-situ
RAMANJAKARIMANGA Dina Tsihafoy –Département BTP - Promotion 2008 Page | 44
Tableau n° 6 : Dénomination adoptées en fonction de la grosseur des grains
On a classifié deux grandes catégories de sol, illustrées par le tableau ci-après, les sols
pulvérulents et les sols cohérents.
Tableau n° 7 : Caractéristiques des sols pulvérulents et des sols cohérents
d < 2µm argile
2µm < d < 20µm Limon
20µ < d < 0,2 mm Sable fin
0,2 mm < d < 2 mm Sable grossier
2 mm < d < 20 mm Gravier
d > 20 mm cailloux
Sols Pulvérulents ou granulaire ou grenus Cohérents ou fins
Particules
Grains Proportion notable des particules fines à très fines
Forme régulière Forme irrégulière
Altération physico-mécanique Altération physico-chimique
Liaison particule-eau
Faible ou nulle. Eau libre Forte. Eau liée. Existence d’une couche d’eau absorbée
Pas d’influence de :
La nature minéralogique des particules ;
Des électrolytes de l’eau libre
Influence de :
La nature minéralogique des particules ;
Des électrolytes de l’eau libre
Force de liaison Force de pesanteur prépondérante
Force de pesanteur
Force d’attraction moléculaire et électrostatique
prépondérantes à courte distance.
Etude de corrélation entre le « Comptest-LNTPB » et la mesure de compacité in-situ
RAMANJAKARIMANGA Dina Tsihafoy –Département BTP - Promotion 2008 Page | 45
2) Dénomination selon la teneur en matières organiques
Le nom est donné dans le tableau suivant à l’issue d’essais selon les normes P 94-058,
NF P 94- 055, XP P 94-047.
Teneur en matières organiques CMO, (%) Qualificatif
CMO 3≤ Non organique
3< CMO ≤ 10 Faiblement organique
10< CMO ≤ 30 Moyennement organique
CMO > 30 Très organique
Tableau n° 8 : Qualificatif selon la teneur en matières organiques
3) Selon la résistance
Le tableau ci-après traduit la fermeté d’un sol par référence à sa cohésion non drainée et par
l’aperçu de la résistance apparent du sol.
Sol Cohésion non drainée Cu
[kPa] Essai simplifié
Très mou <20 S’échappe entre les doigts par une pression.
Mou 20 à 40 Peut être pétri par une légère pression des doigts.
Plastique 40 à 75 Peut être pétri par une forte pression des doigts.
Ferme 75 à 150 Ne peut être pétri par les doigts, le pouce y marque une empreinte.
Très ferme 150 à 300 Rayé par l’ongle.
Dur >300 Difficilement rayé par l’ongle.
Tableau n° 9 : description sommaire des sols
Etude de corrélation entre le « Comptest-LNTPB » et la mesure de compacité in-situ
RAMANJAKARIMANGA Dina Tsihafoy –Département BTP - Promotion 2008 Page | 46
4) Selon la compacité
L’indice de compacité ID ou indice de densité relative représente l’état dans lequel se trouve
un sol sableux par rapport à ses états le plus dense possible et le plus lâche possible en
relation avec sa résistance mécanique.
Etat du sol ID [sans unité]
Très lâche ID ≤ 0,2
Lâche 0,2 < ID ≤ 0,4
Moyennement dense 0,4 < ID ≤ 0,6
Dense 0,6 < ID ≤ 0,8
Très dense ID > 0,8
Tableau n° 10 : dénomination selon l’indice de densité relative.
5) Selon la densité
L’état du sol peut être complété en se référant à sa masse volumique sèche selon le tableau 7.
Etat Masse volumique ρd, [T/m3]
Peu dense ρd ≤ 1,6
Dense 1,6 <ρd ≤ 1,8
Très dense ρd > 1,8
Tableau n° 11 : dénomination selon la densité
Ce tableau correspond à des sols non évolutifs et dont la masse volumique des grains est de
l’ordre de 2,7 T/m3 ne comportant pas de pores fermés dans leur masse solide.
Etude de corrélation entre le « Comptest-LNTPB » et la mesure de compacité in-situ
RAMANJAKARIMANGA Dina Tsihafoy –Département BTP - Promotion 2008 Page | 47
6) La plasticité
Les éléments inférieurs à 400 µm contenus dans un sol sont caractérisés au moyen des limites
d’Atterberg et de l’indice de plasticité.
Indice de plasticité IP, (%) Qualificatif
Ip ≤ 12 Non plastique
12 < Ip ≤ 25 Peu plastique
25 < Ip ≤ 40 Plastique
Ip >40 Très plastique
Tableau n° 12 : dénomination selon la plasticité
7) La consistance
L’indice de consistance situe la teneur en eau w mesurée sur la même fraction
granulométrique que les limites d’Atterberg, par rapport aux limites d’Atterberg.
Ic = L
p
W W
I
−
Etat solide Etat plastique Etat liquide
Sans Avec
Retrait Retrait
W
0 WR WP WL (teneur en eau)
Figure 13 : état d’un sol en fonction de sa teneur en eau.
Etude de corrélation entre le « Comptest-LNTPB » et la mesure de compacité in-situ
RAMANJAKARIMANGA Dina Tsihafoy –Département BTP - Promotion 2008 Page | 48
consistance Ic [sans unité]
Liquide < 0
Très molle >0 et < 0,25
Molle >0,25 et < 0,5
Ferme >0,5 et < 0,75
Très ferme >0,75 et < 1
dure >1
Tableau n° 13: dénomination en fonction de l’indice de consistance
8) La saturation
Le matériau est considéré :
Comme saturé si Sr= 1 alors e.ρw = w.ρs
Comme non saturé si Sr<1 alors Sr = s
w
w
e
ρρ
××
Etude de corrélation entre le « Comptest-LNTPB » et la mesure de compacité in-situ
RAMANJAKARIMANGA Dina Tsihafoy –Département BTP - Promotion 2008 Page | 49
III- CLASSIFICATION SELON LES CARACTERISTIQUES
GEOTECHNIQUES DES SOLS
Il existe trois types de classification qui sont la plus utilisée:
� La classification par LPC;
� La classification HRB ;
� La classification GTR.
- La classification des laboratoires des ponts et chaussées (L.P.C.) s’appuie essentiellement
sur l’analyse granulométrique et sur les caractéristiques de plasticité de la fraction fine,
complété par des essais simples (couleur, odeur, effet de l’eau, etc.).
Cette classification est inadéquate pour les tourbes et les marnes car il n’y a aucune relation
entre leur granulométrie et leurs propriétés ;
- La classification HRB (Hyhway Research Board) est basée à la fois sur la granulométrie
simplifiée (tamis de 2 mm, 0,50mm, 0,08mm) ainsi que sur la limite de liquidité et l’indice de
plasticité ;
- La classification GTR (Guide Technique pour la Réalisation des remblais et des couches
de forme) est aussi très largement répandue. Elle est utilisée dans les travaux de terrassement.
Les sols sont désignés par le nom de la portion granulométrique prédominante qualifiée par
un adjectif relatif aux portions secondaires.
1) CLASSIFICATION LPC
a) Pour les sols grenus
La classification de LCPC (Laboratoire centrale des ponts et chaussées) est la plus utilisée
pour les sols grenus. Elle permet de donner un nom au sol en fonction de la quantité des
éléments fins et de la position des limites d’Atterberg dans la ligne A.
Les sols sont dits grenus lorsqu’ils possèdent plus de 50% des éléments >0,80mm.
Etude de corrélation entre le « Comptest-LNTPB » et la mesure de compacité in-situ
RAMANJAKARIMANGA Dina Tsihafoy –Département BTP - Promotion 2008 Page | 50
Lorsque les pourcentages des fines (éléments < 0,08mm) se trouvent entre 5% et 12%, on
utilise un double symbole.
Tableau n° 14 : classification LPC pour les sols grenus
b) Pour les sols fins
La classification des sols fins utilise les critères de plasticité liés aux limites d’Atterberg.
Elle est précisée dans le diagramme de plasticité ci-après.
Désignation géotechnique Définitions Symboles Conditions
GRAVES
Grave propre bien graduée
Plus de 50% des
éléments >80µm ont
un diamètre >2mm
Moins de 5%
d’éléments
<80µm
Gb
(GW)
Cu > 4
Et 1 < Cc < 3
Grave propre mal graduée Gm
(GP)
Une des conditions de Gb non
satisfaite
Grave limoneuse Plus de 12%
d’éléments
<80µm
GL
(GM)
Limite d’Atterberg au- dessous de la
ligne A
Grave argileuse GA
(GC)
Limite d’Atterberg au- dessus de la
ligne A
SABLES
Sable propre bien graduée
Plus de 50% des
éléments >80µm ont
un diamètre <2mm
Moins de 5%
d’éléments
<80µm
Sb
(SW)
Cu > 6
Et 1 < Cc < 3
Sable propre mal graduée Sm
(SP)
Une des conditions de Sb non
satisfaite
Sable limoneuse Plus de 12%
d’éléments
<80µm
SL
(SM)
Limite d’Atterberg au- dessous de la
ligne A
Sable argileuse SA
(SC)
Limite d’Atterberg au- dessus de la
ligne A
Etude de corrélation entre le « Comptest-LNTPB » et la mesure de compacité in-situ
RAMANJAKARIMANGA Dina Tsihafoy –Département BTP - Promotion 2008 Page | 51
Figure 14 : Abaque de plasticité de Casagrande
On a un diagramme qui a pour abscisse la limite de liquidité WL et pour ordonnée l’indice de
plasticité. On obtient la ligne A dans le repère et cette ligne a pour équation :
Ip = 0,73 (WL – 20)
La nature et la plasticité du sol sont obtenues à partir des différentes positions par rapport à la
ligne A.
On définit quatre grandes catégories principales :
o Les limons très plastiques : Lt ;
o Les limons peu plastiques : Lp ;
o Les argiles très plastiques : At ;
o Les argiles peu plastiques : Ap.
Etude de corrélation entre le « Comptest-LNTPB » et la mesure de compacité in-situ
RAMANJAKARIMANGA Dina Tsihafoy –Département BTP - Promotion 2008 Page | 52
2) CLASSIFICATION HRB (Highway Research Board)
Cette classification permet de connaître la qualité du sol, qui est qualifié d’excellent à
mauvais. Les paramètres de cette classification sont : WL et Ip en fonction de différentes
fractions de pourcentage passant à 2 mm, 0,5 mm, et 0,080 mm.
Le tableau de référence est le suivant :
Tableau n°16 : Tableau de référence pour la classification HRB
Etat %passant
à 2mm
%passant
à 0,5mm
%passant
à 0,08mm WL IP
Groupes et sous
groupes de
classification
Nature
Excellent
à bon
0 à 50 0 à 30 0 à 15 - 0 à 6 A-1 A-1-a Pierre- gravier-
sable 0 à 50 0 à 30 0 à25 - 0 à 6 A-1 A-1-b
- 50 à 100 0 à 10 - 0 A-3 Sable fin
- - 0 à 35 0 à 40 0 à 10
A-2
A-2-4
Gravier et sable
limoneux ou
sable argileux
- - 0 à 35 40 à 100 0 à 10 A-2-5
Passable à
mauvais
- - 0 à 35 0 à 40 0 à 10 A-2-6
- - 0 à 35 40 à 100 0 à 10 A-2-7
- - 35 à 100 0 à 40 0 à 10 A-4
Sol limoneux
- - 35 à 100 0 à 40 0 à 10 A-5
- - 35 à 100 0 à 40 >10 A-6
Sols argileux - - 35 à 100 40 à 100 <WL - 30
A-7
A-7-5
- - 35 à 100 40 à 100 >WL - 30 A-7-6
Etude de corrélation entre le « Comptest-LNTPB » et la mesure de compacité in-situ
RAMANJAKARIMANGA Dina Tsihafoy –Département BTP - Promotion 2008 Page | 53
3) CLASSIFICATION SELON LA NORME NF P 11 – 300 OU G.T.R.
Le GTR : Guide Technique pour la Réalisation des remblais et des couches de forme.
Les sols sont classés d’après leur nature, leur état et leur comportement.
Les paramètres de nature sont : la granularité, l’indice de plasticité et la valeur au bleu de
méthylène. Ce sont des paramètres qui ne varient pas ou peu ni dans le temps, ni pendant les
manipulations.
Comme paramètre de nature on a :
a) La granularité :
La dimension maximale des plus gros éléments contenus dans le sol a pour seuil de retenu de
50 mm. Cette valeur permet de distinguer les sols fins, sableux et graveleux ( 50mm≤ ) des
sols grossiers.
Le pourcentage des fines (% de fines) permet de distinguer les sols riches en fines des sols
sableux et graveleux. Ce paramètre a pour seuils de retenus :
• 35% : les sols ont un comportement assimilable à celui de leur fraction fine si son
pourcentage de fines est au-delà de ce seuil de 35%.
• 12% : est le seuil conventionnel pour la distinction entre les matériaux sableux et
graveleux pauvres ou riches en fines.
Le tamisât à 2 mm permet de distinguer les sols à tendance sableuse ou à tendance graveleuse.
b) L’indice de plasticité Ip
Ce parametre caractérise l’argilosité des sols.
• Ip = 12 : limite supérieure des sols faiblement argileux ;
• Ip = 25 : limite supérieure des sols moyennement argileux ;
• Ip = 40 : limite entre sols argileux et très argileux.
c) La valeur de bleu méthylène VBS
Il s’agit d’un autre paramètre permettant de caractériser l’argilosité du sol.
On détermine la VBS (valeur de bleu du sol) à partir de l’essai au bleu de méthylène à la tache
sur une fraction 0/2 mm. La valeur trouvée est rapportée à la fraction 0/50 mm par une règle
de proportionnalité.
Etude de corrélation entre le « Comptest-LNTPB » et la mesure de compacité in-situ
RAMANJAKARIMANGA Dina Tsihafoy –Département BTP - Promotion 2008 Page | 54
• 0,1 : Seuil en dessous duquel on peut considérer que le sol est insensible à l’eau. Ce
critère doit être complété par la vérification du tamisât à 0,80 mm qui doit être ≤ 12% ;
• 0,2 : seuil au-dessus duquel apparaît à coup sur la sensibilité à l’eau ;
• 1,5 : Seuil distinguant les sols sablo-limoneux des sablo-argileux ;
• 2,5 : Seuil distinguant les sols limoneux peu plastique des sols limoneux de plasticité
moyenne ;
• 6 : Seuil distinguant les sols limoneux des sols argileux ;
• 8 : Seuil distinguant les sols argileux des sols très argileux.
Concernant les paramètres d’état, il s’agit des paramètres qui ne sont pas propres au sol, mais
en fonction de l’environnement dans lequel il se trouve.
Pour les sols meubles sensibles à l’eau, on considère uniquement l’état hydrique car son
importance est capitale vis-à-vis de tous les problèmes de remblai et de couche de forme.
Les différends états hydriques considérés :
- Etat très humide (th) : l’humidité est très élevé, le sol ne peut plus être réutilisable dans
les conditions technico-économiques normales ;
- Etat humide (h) : l’état d’humidité est élevé, le sol peut être réutilisé en prenant des
dispositions particulières (aération, traitement, etc.) estimées comme normales ;
- Etat d’humidité moyenne (m) : Etat d’humidité optimale ayant un minimum de
contraint pour la mise en œuvre ;
- Etat sec (s) : faible humidité mais autorisant encore la mise en œuvre en prenant des
dispositions particulières comme arrosage, sur compactage, etc. ;
- Etat très sec (ts) : humidité très faible n’autorisant plus la réutilisation du sol.
d) Tableaux de classification des sols (GTR)
La classification des sols est repartie entre quatre (4) classes :
� Classe A : sols fins ;
� Classe B : sols sableux et graveleux avec fines ;
� Classe C : sols comportant des fines et des gros éléments ;
� Classe D : sols insensibles à l’eau.
Etude de corrélation entre le « Comptest-LNTPB » et la mesure de compacité in-situ
RAMANJAKARIMANGA Dina Tsihafoy –Département BTP - Promotion 2008 Page | 55
Tableau n° 15: CLASSIFICATION DES SOLS FINS CLASSE A
CLASSEMENT SELON LA NATURE CLASSEMENT SELON L’ETAT HYDRIQUE
Paramètres de nature
Premier niveau de classification classe
Paramètre de nature
Deuxième niveau de classification
Sous classe fonction de la
nature Paramètres d’etat
Sous classe
fonction de l’état
Dmax ≤ 50 mm et Tamisat à
80µm>35%
A
Sols
fins
VBS ≤ 2,5(*)
ou
Ip ≤ 12
A1
Limon peu plastiques, lœss,
silts, alluvionnaires, sables
fins peu pollués, arènes peu
plastique…
IPI(*) ≤ 3 ou Wn ≥ 1,25 WOPN A1th
3 < IPI(*) ≤ 8 ou 1,10 ≤ Wn < 1,25 WOPN A1h
8 < IPI ≤ 25 ou 0,9WOPM ≤ Wn < 1,1 WOPN A1m
0,7WOPM ≤ Wn < 0,9 WOPN A1s
Wn < 0,7 WOPN A1ts
12 < Ip ≤ 25(*)
ou
2,5 <VBS≤ 6
A2
Sables fins argileux, limons,
argiles et marnes peu plastique
arènes…
IPI(*) ≤ 2 ou Ic(*) ≤ 0,9 ou Wn ≥ 1,25 WOPN A2th
2 < IPI(*) ≤ 5 ou 0,9≤ Ic(*)< 1,05 ou 1,1 ≤ Wn < 1,3 WOPN A2h
5<IPI≤ 15ou 1,05≤ Ic(*)<1,2 ou 0,9WOPM ≤ Wn < 1,1 WOPN A2m
1,2<IC ≤ 1,4 ou 0,7WOPM ≤ Wn < 0,9 WOPN A2s
IC > 1,3 ou Wn < 0,7 WOPN A2ts
25 < Ip ≤ 40(*)
ou
6 <VBS≤ 8
A3
Argiles et argiles marneuses,
limons très plastiques…
IPI(*) ≤ 1 ou Ic(*) ≤ 0,8 ou Wn ≥ 1,4 WOPN A3th
1 < IPI(*) ≤ 3 ou 0,8≤ Ic(*)< 1 ou 1,2WOPN≤ Wn < 1,4 WOPN A3h
3<IPI≤ 10ou 1≤ Ic<1,15 ou 0,9WOPM ≤ Wn < 1,2 WOPN A3m
1,15<IC ≤ 1,3 ou 0,7WOPM ≤ Wn < 0,9 WOPN A3s
IC > 1,3 ou Wn < 0,7 WOPN A3ts
Ip > 40
Ou
VBS > 8
A4
Argiles et argiles marneuses,
très plastiques…
Valeur des paramètres d’état, à définir à l’appui d’une étude
spécifique
A4th
A4h
A4m
A4s
(*) Paramètres dont le choix est à privilégier
Etude de corrélation entre le « Comptest-LNTPB » et la mesure de compacité in-situ
RAMANJAKARIMANGA Dina Tsihafoy –Département BTP - Promotion 2008 Page | 56
Tableau n° 16: CLASSIFICATION DES SOLS SABLEUX OU GRAVELEUX, AVEC FINES CLASSE B
Classification à utiliser pour les remblais et les couches de forme
Classement selon la nature Classement selon l’état hydrique Classement selon le comportement
Paramètres de nature
Premier niveau de
classification
classe Paramètres de nature
Deuxième niveau de
classification
Sous classe
fonction de
nature
Paramètres d’état Sous classe
fonction de
l’état
Paramètres de
comportement
Sous classe fonction du
comportement
Dmax ≤ 50 mm et
Tamisat à 80µm≤ 35%
B
Sols
sableux et
graveleux
avec fines
Tamisat à 80 µm ≤ 12%
Tamisat à 2mm > 70%
0,1≤ VBS≤ 0,2
B1
Sables
silteux…
Matériaux généralement insensibles à
l’eau
FS ≤ 60
FS > 60
B11
B12
Tamisat à 80 µm ≤ 12%
Tamisat à 2mm > 70%
VBS > 0,2
B2
Sable
argileux
(peu
argileux)…
IPI(*) ≤ 4 ou
Wn ≥ 1,25WOPN
B2th FS ≤ 60
FS > 60
B21th
B22th
4 < IPI(*) ≤ 8 ou 1,10
WOPN≤ Wn<1,25 WOPN
B2h FS ≤ 60
FS > 60
B21h
B22h
0,9WOPN≤ Wn<1,1WOPN B2m FS ≤ 60
FS > 60
B21m
B22m
0,5WOPN≤ Wn<0,9WOPN B2s FS ≤ 60
FS > 60
B21s
B22s
Wn<0,5WOPN B2ts FS ≤ 60
FS > 60
B21ts
B22ts
Tamisat à 80 µm ≤ 12%
Tamisat à 2mm > 70%
0,1≤ VBS≤ 0,2
B3
Graves
silteuses..
Matériaux généralement insensibles à
l’eau
LA ≤ 45 et
MDE ≤ 45 B31
LA>45 et
MDE>45 B32
(*) Paramètres dont le choix est à privilégier
Etude de corrélation entre le « Comptest-LNTPB » et la mesure de compacité in-situ
RAMANJAKARIMANGA Dina Tsihafoy –Département BTP - Promotion 2008 Page | 57
Tableau n° 17: CLASSIFICATION DES SOLS SABLEUX OU GRAVELEUX, AVEC FINES CLASSE B (suite)
Classification à utiliser pour les remblais et les couches de forme
Classement selon la nature Classement selon l’état hydrique Classement selon le comportement
Paramètres de nature Premier niveau de classification
classe Paramètres de nature Deuxième niveau de
classification
Sous classe fonction de la
nature
Paramètres d’état Sous classe fonction de l’état
Paramètres de comportement Sous classe fonction du comportement
Dmax ≤ 50 mm et Tamisat à
80µm≤ 35%
B Sols
sableux et graveleux avec fines
Tamisât à 80 µm ≤ 12% Tamisât à 2mm > 70% VBS >
0,2
B4 Graves argileuses (peu argileuses)….
IPI(*) ≤ 7 ou Wn ≥ 1,25 WOPN B4th LA ≤ 45 et MDE ≤ 45 LA >45 et MDE > 45
B41th B42th
7< IPI(*) ≤ 7 ou 1,10 WOPN≤ Wn < 1,25 WOPN B4h LA ≤ 45 et MDE ≤ 45 LA >45 et MDE > 45
B41h B42h
0,9 WOPN≤ Wn < 1,10 WOPN B4m LA ≤ 45 et MDE ≤ 45 LA >45 et MDE > 45
B41m B42m
0,6 WOPN≤ Wn < 0,9 WOPN B4s LA ≤ 45 et MDE ≤ 45 LA >45 et MDE > 45
B41s B42s
Wn < 0,6 WOPN B4ts LA ≤ 45 et MDE ≤ 45 LA >45 et MDE > 45
B41ts B42ts
Tamisât à 80 µm compris entre 12 et 35%
Tamisât à 2mm≤ 70% VBS
<1,5(*) ou Ip ≤ 12
B5 Sables et graves très silteux…
IPI(*) ≤ 5 ou Wn ≥ 1,25 WOPN B5th LA ≤ 45 et MDE ≤ 45 LA >45 et MDE > 45
B51th B52th
5< IPI(*) ≤ 7 ou 1,10 WOPN≤ Wn < 1,25 WOPN B5h LA ≤ 45 et MDE ≤ 45 LA >45 et MDE > 45
B51h B52h
12 < IPI(*) < 30ou
0,9 WOPN≤ Wn < 1,10 WOPN B5m LA ≤ 45 et MDE ≤ 45
LA >45 et MDE > 45
B51m B52m
0,6 WOPN≤ Wn < 0,9 WOPN B5s LA ≤ 45 et MDE ≤ 45 LA >45 et MDE > 45
B51s B52s
Wn < 0,6 WOPN B5ts LA ≤ 45 et MDE ≤ 45 LA >45 et MDE > 45
B51ts B52ts
Tamisât à 80 µm compris entre 12 et 35%, VBS > 1,5(*)
ou Ip ≤ 12
B6 Sables et graves argileux à très
argileux
IPI(*) ≤ 4 ou Wn ≥ 1,3 WOPN ou Ic≤ 0,8 B6th
4<IPI(*) ≤ 10ou0,8<Ic<1ou1,10WOPN≤ Wn<1,3WOPN B6h
10<IPI(*)<25ou1<Ic<1,2ou0,9WOPN≤ Wn(*)<1,10WOP B6m
0,7 WOPN≤ Wn < 0,9 WOPN ou 1,2 < Ic < 1,3 B6s
Wn < 0,7 WOPN ou Ic > 1,3 B6ts (*) Paramètres dont le choix est à privilégier
Etude de corrélation entre le « Comptest-LNTPB » et la mesure de compacité in-situ
RAMANJAKARIMANGA Dina Tsihafoy –Département BTP - Promotion 2008 Page | 58
Tableau n° 18: CLASSIFICATION DES SOLS COMPORTANT DES FINES ET DES GROS ELEMENTS CLASSE C
Classement selon la nature
Classement selon l’état hydrique et le comportement Paramètres de nature
Premier niveau de
classification
classe Paramètres de nature
Deuxième niveau de classification
Sous classe fonction de la
nature
Dmax > 50 mm et Tamisât à
80µm>12% ou si le tamisât
à 80µm≤ 12%, la VBS est
> 0,1
C
Sols comportant
des fines et des
gros éléments
Matériaux anguleux comportant une fraction
0/50mm >60 à 80% et matériaux roulés. La
fraction 0/50 est un sol de classe A.
C1Ai
Argiles à silex, éboulis,
moraines, alluvion
grossières…
Le sous classement, en fonction de l’état hydrique et du comportement des sols de cette classe, s’établit
en considérant celui de leur fraction 0/50mm qui peut être un sol de la classe A ou de classe B.
• 1er exemple : un sol désigné C1A2h est un sol qui est :
- Soit entièrement roulé,
- Soit entièrement ou partiellement anguleux ; sa fraction 0/50 représente plus de 60
à 80% de la totalité du matériau.
Dans les deux cas, sa fraction 0/50mm appartient à la classe A2 avec un état hydrique h.
• 2ème exemple : Un sol désigné C1B42m est un sol qui est :
- Entièrement ou partiellement anguleux ; sa fraction 0/50mm représente moins de
60 à 80% de la totalité du matériau.
La fraction 0/50mm est un sol de la classe B42se trouvant dans un état hydrique m.
Les différentes sous-classes composant la classe C sont :
C1A1 C1A3
C1A2 C1A4
C2A1 C2A3
C2A2 C2A4 Etat th, h, m, s, ou ts
C1B11 C1B31
C1B12 C1B32
C2B11 C2B31
C2B12 C2B32 Matériaux généralement insensibles à l’état
hydrique
C1B21 C1B51
C1B22 C1B52
C1B41 C1B6
C1B42
C2B21 C2B51
C2B22 C2B52
C2B41 C2B6
C2B42
Etat th, h, m, s, ou ts
Matériaux anguleux comportant une fraction
0/50mm >60 à 80% et matériaux roulés. La
fraction 0/50 est un sol de classe B.
C1Bi
Argiles à silex, Argiles à
meulière, éboulis, moraines,
alluvion grossières…
Matériaux anguleux comportant une fraction
0/50mm ≤ 60 à 80% et matériaux roulés. La
fraction 0/50 est un sol de classe A.
C2Ai
Argiles à silex, Argiles à
meulière, éboulis, biefs à
silex…
Matériaux anguleux comportant une fraction
0/50mm ≤ 60 à 80% et matériaux roulés. La
fraction 0/50 est un sol de classe B.
C2Bi
Argiles à silex, Argiles à
meulière, éboulis, biefs à
silex…
Etude de corrélation entre le « Comptest-LNTPB » et la mesure de compacité in-situ
RAMANJAKARIMANGA Dina Tsihafoy –Département BTP - Promotion 2008 Page | 59
Tableau n° 19 : CLASSIFICATION DES SOLS INSENSIBLES A L’EAU
Classification à utiliser pour les remblais et les couches de forme CLASSE D
Classement selon la nature Classement selon l’état hydrique
Paramètres de nature
Premier niveau de
classification
classe
Paramètres de nature
Deuxième niveau de
classification
Sous classe fonction
de la nature Valeurs seuils retenues Sous classe
VBS ≤ 0,1
Et
tamisât à 80µm≤ 12%
D
Sols insensibles à
l’eau
Dmax ≤ 50 mm et
Tamisat à 2mm>70%
D1
Sables alluvionnaires
propre, sables de dune…
Matériaux
insensibles à
l’eau ; mais leur
emploi en couche
de forme nécessite
la mesure de leur
résistance
mécanique
(LOSAngelès –
LA – et/ou Micro
Deval en présence
d’eau – MDE -)
ou Friabilité des
sables (FS)
FS≤ 60 D11
FS>60 D12
Dmax ≤ 50 mm et
Tamisat à
2mm≤ 70%
D2
Graves alluvionnaires
propre, sables…
LA ≤ 45 et
MDE ≤ 45
D21
LA>45 et MDE>45 D22
Dmax > 50 mm
D3
Graves alluvionnaires
grossière propre, dépôts
glaciaires….
LA ≤ 45 et
MDE ≤ 45 D31
LA>45 et MDE>45 D32
Etude de corrélation entre le « Comptest-LNTPB » et la mesure de compacité in-situ
RAMANJAKARIMANGA Dina Tsihafoy –Département BTP - Promotion 2008 Page | 60
Figure 15 : Tableau synoptique de classification des matériaux selon leur nature
Etude de corrélation entre le « Comptest-LNTPB » et la mesure de compacité in-situ
RAMANJAKARIMANGA Dina Tsihafoy –Département BTP - Promotion 2008 Page | 61
CONCLUSION [I]
Cette partie qui fait l’objet de la reconnaissance des sols en effectuant les essais du
laboratoire. Il faut alors bien maitriser toutes les techniques de reconnaissance du sol au
laboratoire afin de classer et connaître le type et la nature de sol concerné.
Alors après avoir se rappelé des caractéristiques physiques des sols et l’essai de portance du
sol, il est nécessaire de classifier le sol qui va plus particulièrement nous intéresser tout le
long de l’ouvrage.
Etude de corrélation entre le « Comptest-LNTPB » et la mesure de compacité in-situ
RAMANJAKARIMANGA Dina Tsihafoy –Département BTP - Promotion 2008 Page | 62
METHODOLOGIEMETHODOLOGIEMETHODOLOGIEMETHODOLOGIE DEDEDEDE
CONTROLE DE CONTROLE DE CONTROLE DE CONTROLE DE CCCCOMPACTAGEOMPACTAGEOMPACTAGEOMPACTAGE
IN SITUIN SITUIN SITUIN SITU
Etude de corrélation entre le « Comptest-LNTPB » et la mesure de compacité in-situ
RAMANJAKARIMANGA Dina Tsihafoy –Département BTP - Promotion 2008 Page | 63
Chapitre I- GENERALITEGENERALITEGENERALITEGENERALITESSSS
I- INTRODUCTION
Il est évidemment souhaitable de fonder les ouvrages sur un bon sol, mais ce n’est pas
toujours possible.
Les caractéristiques des sols cohérents sont en général très bien définies par les essais
de laboratoire sur échantillons intacts.
Il n’en est pas de même pour les sols pulvérulents, sables, et graviers ou sable fin dont
un échantillon intact est sinon impossible, du moins très aléatoire.
Les méthodes in situ qui comprennent essentiellement la méthode au sable (ou au
grain de riz), la méthode au densitomètre à membrane, la méthode au carottier et la méthode
au gammadensimètre ont été utilisées selon les dispositifs et les types de sol.
Les principes de la méthode au sable, la méthode au carottier et la méthode au
densitomètre à membrane sont fondés sur la détermination du poids spécifique apparent d’un
volume de sol prélevé. Le volume est estimé immédiatement sur le terrain alors que le poids
est évalué au laboratoire après séchage et pesée. La connaissance de ces deux variables
permet de déterminer la densité apparente selon la relation :
P
Vγ =
Soit : P est le poids sec de l’échantillon, en kN;
V est le volume de l’échantillon prélevé et séché, en m3.
La compacité « Ic » est le rapport entre la densité sèche en place et celle de référence obtenu
au laboratoire par l’essai Proctor.
maxd
d
Icγ
γ= (Sans unité)
Avec :
100100
hd W
γγ = ×+
max 100100
hd
OPMW
γγ = ×+
, en kN/m3.
Etude de corrélation entre le « Comptest-LNTPB » et la mesure de compacité in-situ
RAMANJAKARIMANGA Dina Tsihafoy –Département BTP - Promotion 2008 Page | 64
Soit :
max
: . . . ;
: . . .Pr ;
d
d
densité sèche en place
densité sèche optimum octor
γγ
, en kN/m3;
γh : densité apparente in situ du matériau compacté, en kN/m3;
En ce qui concerne la méthode au gammadensimètre, le principe se fonde sur la
mesure de l’intensité atténuée N qui s’exprime selon une formule.
La valeur de la densité apparente est donc liée, non seulement au type de sol, mais aussi à la
méthode de mesure.
II- LES PARAMETRES A CONTROLER :
Lors de la réalisation de compactage sur chantier les paramètres suivants doivent être
contrôlés :
• Juste avant le compactage, on doit vérifier la teneur en eau qui doit être comparé avec
l’optimum obtenu au laboratoire, puis l’épaisseur des couches à compacter.
• Lors du compactage, on doit tenir compte du nombre de passe obtenu par la planche
d’essai.
• Après le compactage, la vérification de la compacité est obligatoire.
Il faut que la compacité du corps de remblai soit supérieure ou égal à 90% et
pour les 30 derniers centimètres il faut que la compacité soit supérieure ou égale à 95%.
Etude de corrélation entre le « Comptest-LNTPB » et la mesure de compacité in-situ
RAMANJAKARIMANGA Dina Tsihafoy –Département BTP - Promotion 2008 Page | 65
Chapitre II- METHODE AU SABLEMETHODE AU SABLEMETHODE AU SABLEMETHODE AU SABLE
I- OBJET
La méthode au sable a pour but de déterminer le poids spécifique apparent (qu’on assimilera
numériquement à la densité apparente) d’un volume de sol déterminé in situ prélevé d’une
cavité.
II- PRINCIPE DE LA METHODE
La méthode au sable ou au grain de riz consiste à déterminer le volume occupé par le sol.
Une cavité est creusée dans le sol sur une surface plane taillée horizontalement. La totalité de
la terre est recueillie pour la détermination de son poids sec P (et de son humidité). La cavité
est exactement remplie de sable dont le volume versé correspond à celui de l’échantillon
prélevé.
Le poids du sable substitué permet de calculer le volume occupé par le matériau prélevé.
On peut pratiquer cette méthode pour les sols mous ou pulvérulents et elle est recommander
aussi pour les sols contenant des éléments coupants ou pointus.
III- APPAREILLAGE
En exécutant cette méthode, elle nécessite un appareil de déversement qui comprend :
- Une trémie tronconique de volume habituel de 3 à 4 litre ;
- Entonnoir équipé d’une pige permettant d’assurer une hauteur de chute constante, cet
entonnoir est conçu pour permettre sa fixation sur une plaque de base;
- La trémie et l’entonnoir sont reliés entre eux par un robinet à boisseau dont le passage
libre est de même section que celle de bec de l’entonnoir ;
- Une plaque rigide de base carrée de dimension C x C cm² (40x40 cm²) percée d’un
orifice circulaire de diamètre B adapté à la granularité du matériau, et en respectant la
règle : 2C
B> ;
Etude de corrélation entre le « Comptest-LNTPB » et la mesure de compacité in-situ
RAMANJAKARIMANGA Dina Tsihafoy –Département BTP - Promotion 2008 Page | 66
- Quatre piquets d’ancrage ;
- Matériel de creusement (pelle, piochon, burin, couteau, marteau, etc.) ;
- Matériel de prélèvement (sac, feuille plastique, pinceau) ;
- Sacs de sable sec pré pesés ;
- Règle à araser ;
- Une balance de 10 kg sensible au gramme près.
Photo 4 : Densitomètre au sable
IV- METHODE D’ESSAI
1) Préparation du sable
CALIBRAGE DU SABLE
En suivant la norme, le sable utilisé dans nos études doit être prélevé sur une plage de mer. Il
subit le traitement suivant :
• Trempage dans l’eau pendant une heure et rinçage pour éliminer le sel ;
• Séchage à l’air jusqu’à ce qu’il devienne coulant et ne colle plus dans la main ;
• Premier tamisage dans un tamis de 2 mm de maille ;
• Second tamisage dans un tamis de 1 mm de maille afin d’obtenir du sable dont le
diamètre est compris entre 2 et 1 mm ;
• Récupérer le sable de diamètre inférieur à 1 mm ;
• Tamiser celui-ci dans un tamis de 0,80 mm afin d’obtenir une seconde catégorie de
sable dont le diamètre est compris entre 1 et 0,80 mm.
Etude de corrélation entre le « Comptest-LNTPB » et la mesure de compacité in-situ
RAMANJAKARIMANGA Dina Tsihafoy –Département BTP - Promotion 2008 Page | 67
On obtient ainsi deux (2) classes de sable à la fin des tamisages. La deuxième classe
dimensionnelle (1 – 0,80 mm) permet de tirer le maximum de l’échantillon de sable prélevé.
NB : Pour réussir un bon calibrage, il faut :
� Un tamis de 20 cm de diamètre ;
� Procéder au tamisage du sable par petite quantité ; la couche de sable dans le tamis
doit être mince et bien étalée ;
� Eviter de forcer le passage du sable au travers de la maille du tamis, c'est-à-dire, éviter
d’exercer de pression à la main, par exemple, pour accélérer le tamisage.
Cette méthode ne s’applique ni aux sols trop secs fissurés ni aux sols trop humides lorsque
l’ouverture de la cavité de mesure s’accompagne d’une déformation. On peut utiliser aussi le
sable de rivière mais on doit le calibrer. Il peut être obtenu par tamisage à l’aide des tamis
0,40 mm et 0,315 mm.
La quantité à prévoir est de 5 kg par essai.
Le sable non concassé doit avoir les caractéristiques suivantes :
• Dmax≤ 2 mm ;
• % de fines (tamisât à 80 µm) ≤ 1% ;
• W ≤ 0,5%.
DETERMINATION DU POIDS VOLUMIQUE DU SABLE
Pour déterminer le poids volumique du sable, on prend un récipient de volume connu qui est
supérieur à 2 dm3, le remplir avec le sable au moyen de l’entonnoir muni de sa pige ; après
avoir enlevé l’appareil à déverser, on arase le sable avec la plane en prenant soin de ne pas
tasser le sable. Peser le récipient plein.
La valeur de référence retenue est la moyenne arithmétique des poids volumique déterminé
après trois remplissages successifs de ce même récipient.
Le poids volumique du sable sera exprimé par la formule :
1 2sable
P P
Vγ −=
Soit :
γsable : le poids volumique du sable, en kN/m3 ;
P1 : la moyenne des pesées du récipient d’étalonnage plein, en kN ;
P2 : le poids du récipient de l’étalonnage vide, en kN ;
V : volume du récipient d’étalonnage calculé, en m3.
Etude de corrélation entre le « Comptest-LNTPB » et la mesure de compacité in-situ
RAMANJAKARIMANGA Dina Tsihafoy –Département BTP - Promotion 2008 Page | 68
2) Réalisation de l’essai
a) Mesure du volume initial ou volume mort de l’appareil de déversement
Placer la plaque de base sur une surface plane sensiblement horizontale, en fixant cette plaque
avec les piquets d’ancrage (valet). Fixer l’appareil de déversement sur la plaque de base,
robinet fermé. Verser une quantité de sable P3 choisie dans la trémie sans perdre d’élément
avec robinet ouvert jusqu’à remplissage complet du volume délimité par la plaque de base et
l’entonnoir. Fermer le robinet. Il faut prendre soin de ne pas tasser le sable par choc de
vibration au moment de l’ouverture et de la fermeture du robinet.Après avoir enlever
l’appareil de déversement, récupérer le sable restant dans la trémie et le peser.
Répéter cinq fois de suite l’opération et effectuer la moyenne de mesures des poids de sable
restant : soit P4.
Le volume mort de l’appareil est donné par :
3 4
m o r ts a b l e
P PV
γ−=
Soit :
P3 : le poids du sable, trémie remplie, en kN ;
P4 : le poids de sable restant après la fermeture du robinet, en kN ;
γsable : le poids volumique du sable, en kN/m3.
b) Creusement de la cavité
Pratiquer le creusement du sol sur une profondeur de 10 à 15 cm (environ au demi-rayon du
diamètre de l’orifice) à travers l’orifice de la plaque de base. La forme de la cavité doit être
régulière.
Tout le matériau extrait du trou sera soigneusement recueilli (sans perte, et le mettre dans un
sac hermétique). Peser le matériau humide, soit P5 et déterminer sa teneur en eau naturelle.
Photo 5 : creusement de la cavité
Etude de corrélation entre le « Comptest-LNTPB » et la mesure de compacité in-situ
RAMANJAKARIMANGA Dina Tsihafoy –Département BTP - Promotion 2008 Page | 69
c) Mesure du volume total (Vt)
L’appareil de déversement doit être placé au dessus de la cavité après avoir pesé la quantité de
sable. La trémie de l’appareil soit pratiquement pleine, soit P6 ce poids.
Ouvrir le robinet et laisser couler le sable jusqu’à remplissage du système, soit P7 le poids du
sable restant dans la trémie après coulage.
Calculer le poids du sable utilisé : Putilisé = P6 – P7 ;
Le volume total du sable dans la cavité est :
u ti l isét
sa b le
PV
γ=
d) Expression des résultats
Le poids volumique humide est donné par :
5h
t m ort
P
V Vγ =
−
Et le poids volumique sec par :
100
100h
d W
γγ =+
Où : W : la teneur en eau obtenue, en % ;
Pi : exprimé en kN ;
Vt et Vmort : en m3 ;
γh et γd : en kN/m3.
Etude de corrélation entre le « Comptest-LNTPB » et la mesure de compacité in-situ
RAMANJAKARIMANGA Dina Tsihafoy –Département BTP - Promotion 2008 Page | 70
Chapitre III- DENSITOMETRE A DENSITOMETRE A DENSITOMETRE A DENSITOMETRE A MEMBRANEMEMBRANEMEMBRANEMEMBRANE
I- PRINCIPE DE LA METHODE
Cette méthode est destinée à déterminer le poids volumique d’un matériau en place. Cet essai
ne s’applique pas lorsque le volume de la cavité de mesure peut varier durant l’essai (sable
lâche, argile très humide, etc.). De plus cet essai est destiné particulièrement aux matériaux de
dimension Dmax inférieure à 50 mm, car l’appareil n’est pas adapté aux matériaux purement
pulvérulents, présentant de gros éléments qui risquent d’endommager fréquemment la
membrane.
L’essai consiste à creuser une cavité en recueillant complètement le matériau extrait qui sera
pesé, puis à mesurer le volume de la cavité à l’aide d’un densitomètre à membrane. C’est un
appareil permettant de plaquer une membrane sur les parois du trou creusé.
II- APPAREILLAGE
On utilise un appareil appelé ∀Densitomètre à membrane ∀ dont le corps de l’appareil est
composé d’un cylindre plexiglas de volume minimal de 3000 cm3 et d’un piston coulissant
dans le cylindre et assurant l’étanchéité à l’eau entre les deux faces. Le piston muni d’une
tige graduée équipée d’un index permettant la mesure du volume au cm3 de telle façon qu’un
déplacement égal à une graduation correspondante à une variation de 10 cm3 de volume
engendré par le piston. L’extrémité extérieure de la tige est munie d’une poignée et d’un
bouchon pour le remplissage de la cavité inférieure et d’un niveau visible appelé aussi piège à
bulle pour le contrôle du remplissage. Et à la partie inférieure du cylindre est munie d’une
couronne permettant d’une part d’assurer l’étanchéité de la membrane car la membrane est
souple, étanche, amovible, en latex ou en matériau de propriété équivalente ; d’autre part de
fixer le densitomètre sur une plaque de base ayant un orifice circulaire du même diamètre que
la membrane.
Cet appareil est complété par les accessoires suivants :
Etude de corrélation entre le « Comptest-LNTPB » et la mesure de compacité in-situ
RAMANJAKARIMANGA Dina Tsihafoy –Département BTP - Promotion 2008 Page | 71
• Quatre (4) valets de fixation de la plaque de base ;
• Matériel de creusement (pelle, piochon, burin, couteau, marteau, etc.) ;
• Matériel de prélèvement (sac, feuille plastique, pinceau, etc.) ;
• Récipient étanche pouvant contenir 5 à 10 kg de matériau ;
• Balance de précision de 5 kg sensible au 0,5 g ou de 10 kg sensible au gramme.
Une graduation à vernier permet de mesurer avec précision le déplacement du piston.
Dimensions usuelles :
Surface de la section: 100 cm2,
Vernier au 1/10 de millimètre,
Précision de 1 cm3,
Si la longueur est de 30 cm, on peut donc mesurer des volumes de 3 dm3.
Photo 6: densitomètre à membrane et plaque de base.
Etude de corrélation entre le « Comptest-LNTPB » et la mesure de compacité in-situ
RAMANJAKARIMANGA Dina Tsihafoy –Département BTP - Promotion 2008 Page | 72
III- METHODE D’ESSAI
1) Opération préalable
L’endroit où sera réalisé l’essai doit être dégagé de toutes parties de sol pouvant avoir
remanié, et dressé soigneusement à l’aide de couteau et de la plane de façon à épouser
parfaitement la plaque de base.
Fixer la membrane sur l’embase du cylindre ; le densitomètre doit être rempli d’eau. Pour se
faire, enlever le bouchon de la poignée et remplir avec de l’eau, de façon qu’aucune bulle
d’air ne subsiste dans le cylindre.
Vérifier l’étanchéité du dispositif.
2) Réalisation de l’essai
a) Préparation du terrain et mise en place du densitomètre :
Il est nécessaire de dresser le sol à l'emplacement où on désire mesurer la masse volumique.
Ne pas laisser de cailloux ou autres éléments susceptibles de percer la membrane.Fixer
solidement la plaque de référence du densitomètre sur le sol à l'aide de chevillettes ou autres
accessoires. Enlever l'appareil afin d'ôter la plaque de protection de la membrane.
b) Mesure du volume initial ou le volume mort (V0)
La plaque de base étant bien fixée au sol, qui est sensiblement horizontal ou au moins égale à
celle de la plaque d’appui, à l’aide des valets de fixation. Le densitomètre sera placé au dessus
de cette plaque de base.
La membrane sera plaquée au sol en appuyant sur le piston jusqu’à l’obtention de la pression
désirée (supérieure ou égale à 5 kPa).
Cette opération sera sanctionnée par une lecture (V0) indiquée par le vernier coulissant de la
tige. Enlever le densitomètre.
Etude de corrélation entre le « Comptest-LNTPB » et la mesure de compacité in-situ
RAMANJAKARIMANGA Dina Tsihafoy –Département BTP - Promotion 2008 Page | 73
c) Creusement de la cavité
Réaliser soigneusement un trou aussi ovoïde que possible, de même diamètre que l’orifice de
la plaque de base et la profondeur doit être égale au rayon de l’orifice, à l’aide du couteau, du
burin, du marteau et à la main d’épicier. On évitera les anfractuosités et les aspérités.
La taille de l’appareil doit être adaptée à la cavité réalisée.
Le matériau extrait doit être placé dans un récipient étanche de tare T. Peser le matériau
humide, soit P1, et déterminer sa teneur en eau naturelle (Wnat).
d) Détermination du volume total (Vt)
Le densitomètre étant remis sur la plaque, la membrane sera une fois de plus plaquée aux
parois du trou en actionnant le piston jusqu’à obtention de la pression désirée (cette pression
doit être égale à celle du volume mort, mais ne doit pas déformer le matériau). La lecture sur
la tige donne la valeur V1. La valeur V1 est le volume total Vt.
Photo 7: détermination du volume total.
e) Expression des résultats
Le poids volumique apparent humide est donné par la formule :
1
1 0
( )h
P T
V Vγ −=
−
Etude de corrélation entre le « Comptest-LNTPB » et la mesure de compacité in-situ
RAMANJAKARIMANGA Dina Tsihafoy –Département BTP - Promotion 2008 Page | 74
Où : P1 : Poids du matériau extrait de la cavité, en kN ;
T : poids du récipient étanche de tare, en kN;
V0 et V1 : les volumes indiqués par le vernier du densitomètre avant et après extraction
du matériau, en m3.
Le poids volumique sec par :
100
100h
d W
γγ =+
Où : W : la teneur en eau, en %;
γh et γd sont respectivement les poids volumiques apparents humide et sec, en kN/m3.
Etude de corrélation entre le « Comptest-LNTPB » et la mesure de compacité in-situ
RAMANJAKARIMANGA Dina Tsihafoy –Département BTP - Promotion 2008 Page | 75
Chapitre IV- METHODE AU CAROTTIERMETHODE AU CAROTTIERMETHODE AU CAROTTIERMETHODE AU CAROTTIER
I- PRINCIPE
La méthode au carottier consiste à déterminer un volume de sol intact en remplissant
parfaitement par enfoncement dans la masse de sol intact un récipient de forme appropriée et
de volume connu V appelé carottier.
Le poids du sol prélevé est déterminé par pesée.
Le poids du sol sec est obtenu par pesée après séchage à l’étuve, jusqu’à avoir des poids
constants.
Cette méthode est réservée aux sols dont les plus gros grains sont au maximum de la
dimension des sables très fins et présentant une certaine cohésion (de l’ordre de 20 kN/m²).
II- APPAREILLAGE
La méthode nécessite :
• Un carottier qui est cylindrique et métallique rigide indéformable, dont l’extrémité est
taillée en biseau pour faciliter l’enfoncement dans le sol. Les dimensions usuelles sont
de 4cm de diamètre intérieur, 5 cm de génératrice pour épaisseur de métal de 2mm,
l’angle de biseau étant de 15°. La tare du carottier est T1
• Une balance de portée 500 g sensible au 0,5 g ;
• Une plane ;
• Des couteaux ;
• Une étuve de laboratoire pour les poids volumiques secs ;
• Une coupelle de tare T2.
Etude de corrélation entre le « Comptest-LNTPB » et la mesure de compacité in-situ
RAMANJAKARIMANGA Dina Tsihafoy –Département BTP - Promotion 2008 Page | 76
III- MODE OPERATOIRE
L’essai peut être réalisé soit en laboratoire sur échantillon intact, soit sur chantier sur le sol in-
situ.
Dans les deux cas, dresser une surface sensiblement plane de dimension supérieure au
diamètre du carottier.
Poser le carottier graissé intérieurement muni de son casque sur la surface préparée et
l’enfoncer par pression en évitant tout mouvement de bascule du carottier. L’enfoncement du
carottier doit être tel que le sol dépasse de quelques millimètres la surface supérieure du
carottier. Le carottier sera dégagé latéralement avant de couper le sol sous le carottier.
Araser soigneusement les deux faces du carottier à l’aide de la plane, et nettoyer
soigneusement la surface extérieure du carottier de toute parcelle de matériau pouvant y
adhérer.
Soit P1 le poids de l’ensemble carottier et sol.
Placer le carottier dans la coupelle et mettre l’ensemble à l’étuve jusqu’à dessiccation
complète.
Soit P2 le poids de l’ensemble carottier, coupelle et sol.
IV- RESULTATS
Le poids volumique du sol est donné en kN/m3 par :
1 1P T
Vγ −=
Le poids volumique sec par :
2 1 2( )d
P T T
Vγ − −=
Avec : P1 : poids de l’ensemble carottier et sol, en kN ;
P2 : poids de l’ensemble carottier, coupelle et sol sec, en kN ;
T1 : tare du carottier, en kN ;
T2 : tare de la coupelle, en kN ;
V : volume du carottier, en m3.
Etude de corrélation entre le « Comptest-LNTPB » et la mesure de compacité in-situ
RAMANJAKARIMANGA Dina Tsihafoy –Département BTP - Promotion 2008 Page | 77
Chapitre V- METHODE AU GAMMADENSIMETREMETHODE AU GAMMADENSIMETREMETHODE AU GAMMADENSIMETREMETHODE AU GAMMADENSIMETRE
Cette présente méthode consiste à déterminer la mesure ponctuelle du poids volumique d’un
matériau en place à l’aide d’un appareil d’exécution rapide appelé : gammadensimètre à
pointe.
I- PRINCIPE
La mesure du poids volumique des matériaux se fait par lecture directe sur affichage
incorporé dans l’appareil. Les matériaux se situent entre la partie supérieure libre d’une
couche et à une profondeur donné Z, et ils absorbent des photons gamma d’énergie donnée
émise par une source enfoncée à la profondeur Z dans la couche soumise à l’essai. Cette
énergie est détectée par l’appareil lui-même. Et le gammadensimètre permet d’obtenir
rapidement sur terrain, c'est-à-dire de 2 à 3 minutes, la valeur du poids spécifique de cette
couche.
C’est un appareil d’exécution rapide, par conséquent il est adapté aux grands chantiers de
terrassement. Pourtant il est un appareil très délicat.
II- APPAREILLAGE
L’appareil possède quatre parties principales qui peuvent être indépendantes ou regroupées
selon le modèle de l’appareil :
1. Un ensemble source comprenant :
• Une source radioactive qui émet les rayons gamma (le césium 137 ou le cobalt
60) portée par une tige. Cette source doit être introduite dans le matériau jusqu’à
la profondeur de l’enfoncement de la tige porteuse ;
• Un conteneur de protection qui reçoit la source en dehors des mesures.
2. Une embase qui assure la géométrie de mesure et détermine :
• Le positionnement de l’appareil sur la surface libre de la couche à ausculter ;
• L’emplacement du détecteur des rayonnements ;
Etude de corrélation entre le « Comptest-LNTPB » et la mesure de compacité in-situ
RAMANJAKARIMANGA Dina Tsihafoy –Département BTP - Promotion 2008 Page | 78
• La profondeur d’emplacement de la source ;
L’indication de la profondeur d’action pour la configuration possible de mesure doit être
obligatoirement figurée sur l’appareil ;
3. Une échelle de compactage avec ou sans micro processeur associé : cette échelle
dénombre les impulsions électriques issus des détecteurs pendant le temps nécessaire
pour obtenir le nombre de compactage prédéterminée.
4. Un bloc standard : pour les appareils à source inamovible convenant pour la méthode
avec rapport de compactage.
En résumé, l’instrument proprement dit est :
• Le bloc standard : sert en premier lieu à établir des comptages standard et
permet d’autre part de tester la stabilité à long terme de l’appareil ;
• La plaque de perçage : permet de préparer le site à tester et guide la tige de
perçage pendant son enfoncement ;
• Tige de perçage : permet d’effectuer un trou pour des mesures en transmission
directe ;
• Extracteur de tige : permet une extraction facile de la tige de perçage de divers
matériaux ;
• Chargeur et adapteur : permettent une liaison soit au réseau soit à un
connecteur de type allume cigare ;
• Marteau de 2 kg.
Photo 8: Gammadensimètre Troxler série 3411 B
Etude de corrélation entre le « Comptest-LNTPB » et la mesure de compacité in-situ
RAMANJAKARIMANGA Dina Tsihafoy –Département BTP - Promotion 2008 Page | 79
L’appareil est accompagné d’une notice technique. Elle donne :
� La nature et la fréquence des révisions périodiques ;
� Toutes les vérifications à faire avant le fonctionnement de l’appareil ;
� Toutes les opérations à effectuer pendant la réalisation de l’essai ;
� Les abaques nécessaires pour accomplir les calculs ;
� Les valeurs de correction de compactage DC en fonction du temps mort Q des
compteurs utilisés ;
� Le mode d’emploi du microprocesseur associé ;
� La méthode de détermination du bruit de fond.
III- MODE OPERATOIRE
L’essai consiste à réaliser un trou à l’aide de la tige de perçage et de la plaque de perçage, le
trou doit être perpendiculaire à la surface et ayant une profondeur Z + 6cm au moins.
Il faut bien vérifier que la totalité de la surface d’appui de l’embase soit en contact avec le
matériau.
La vérification de la batterie de l’appareil est nécessaire avant l’utilisation. Une batterie bien
en marche fait 50 heures sans arrêt si on l’a chargé pendant 14 heures. La charge peut se faire
avec un courant de 115V et 230V.
Photo 9 : Tableau de l’appareil.
Etude de corrélation entre le « Comptest-LNTPB » et la mesure de compacité in-situ
RAMANJAKARIMANGA Dina Tsihafoy –Département BTP - Promotion 2008 Page | 80
1) Fonctionnement
Bloc standard :
• Le bloc standard doit être placé sur une surface de haute densité. L’utilisateur va
s’éloigner d’au moins 1m50 de toute structure verticale et s’il y a une autre jauge
nucléaire il faut l’espacer de 10m ;
• La propreté du bloc standard est toujours exigée.
Chauffage de l’appareil :
L’appareil sera placé sur le bloc standard, et le mettre en marche en appuyant sur
l’interrupteur, laisser là pendant 10 minutes.
Si la batterie est faible, le tableau 000 avec BAT disparaît aussitôt.
Comptage standard :
Il est important de prendre un comptage standard journalier pour vérifier le fonctionnement de
l’appareil et compenser la décroissance de la source. L’appareil doit être mis sous tension ce
qui aura pour incidence d’initialiser l’autocontrôle. Lors de la prise d’un comptage standard,
l’appareil compare automatiquement le nouveau comptage avec la moyenne des quatre
comptages précédents. Le nouveau comptage sera acceptable s’il ne présente une différence
supérieure à plus ou mois de 2% pour le comptage humidité et plus ou moins 1% pour le
comptage densité.
Manipulation de l’appareil pour trouver les valeurs :
La référence de notre appareil est 3411.
• Comptage standard :
Appuyer sur ON et l’appareil se mettra en mode autocontrôle durant 5 minutes.
Appuyer pendant l’autotest sur n’importe quelle touche, la touche aura pour incidence
l’affichage du message.
Après le signal indiquant la fin de l’autocontrôle, l’afficheur inscrira le message.
Hors utilisation, l’appareil s’éteindra automatiquement après 5 heures.
Appuyer sur STANDARD, l’afficheur indiquera le message :
Si la réponse est YES, appuyer sur YES pour démarrer le comptage standard.
Etude de corrélation entre le « Comptest-LNTPB » et la mesure de compacité in-situ
RAMANJAKARIMANGA Dina Tsihafoy –Département BTP - Promotion 2008 Page | 81
• Test et mesure :
On peut utiliser cet appareil pour une vérification soit pour les sols soit pour les enrobés.
La sélection du mode de travail (sols ou enrobés) s’effectue en appuyant sur SHIFT et
MODE.
- Le mode sols (SOILS) indiquera la densité humide (WD), la densité sèche (DD), la
densité sèche optimum Proctor (%PR), le pourcentage d’eau (%M), et la teneur en eau
en Kg/m3 (M) ;
- Le mode enrobé (ASPHALT) indiquera la densité humide et le % MARSHALL
(%MA) ou la densité humide et le % de vide (% VOIDS).
Pour sélectionner le mode sols, appuyer sur SHIFT et MODE la solution qui apparaîtra après
MODE pourra être sols ou enrobés qui dépend de la sélection antérieure.
• Préparation du terrain :
L’état de surface pour la mesure influe sur la quantité des résultats. La plaque de perçage peut
être utilisée pour préparer les surfaces non lisses ; les surfaces ouvertes peuvent être comblés
par un apport de sable fin provenant de sites voisins.
Placer la plaque de perçage sur la surface à tester et la niveler par un mouvement de va et
vient. Passer la tige de perçage à travers l’extracteur de tige et l’insérer dans un des deux
guides-tiges de la plaque de perçage, marquer le contour afin de positionner plus facilement
l’appareil sur le site.
Oter la tige de perçage, enlever la plaque de perçage délicatement. Placer l’appareil au dessus
du trou. Abaisser la tige porte source à l’aide des mécanismes de la poignée et la descendre à
la profondeur désirée. Tirer doucement l’appareil pour que la tige porte source soit en contact
avec la paroi du trou.
Effectuer alors le test de mesure.
Pour déterminer la densité, soit le bouton DS équivaut à 3670 tolérance ±1% (étalonnage
compte usine).
Pour trouver DS, appuyer STANDARD - appuyer SHIFT – lâcher STANDARD – lâcher
SHIFT et on a DS.
La touche MS : vérification de compactage usine mais W% => 570 ± 2%.
Pour trouver MS, il suffit d’appuyer directement sur la touche MS et on obtient la valeur.
Etude de corrélation entre le « Comptest-LNTPB » et la mesure de compacité in-situ
RAMANJAKARIMANGA Dina Tsihafoy –Département BTP - Promotion 2008 Page | 82
• Mise en mémoire de la densité de référence.
Les chiffres obtenus sont exprimés en kg/m3.
1. Si la valeur de la densité de référence est > 2000 kg/m3, mettre le signe (+) sur la
moisture correction (mesure correction) par contre si on a une densité < 2000 kg/m3,
mettre le signe (-) ;
2. Toucher SHIFT SET pour avoir 2000 : appuyer SHIFT – appuyer SET – lâcher SET –
lâcher SHIFT.
Pour enregistrer le Proctor de référence : appuyer immédiatement SET jusqu’à l’obtention de
1870 kg/ m3.
NB : L’emploie du bloc standard est terminé jusque là.
2) Etalonnage de W%
On a deux valeurs de W%, W% obtenue par la jauge et celle de l’étuve.
NB : La valeur W% de la jauge est de type en surface.
Prise de mesure (essai en surface) :
La position à prendre est en rétrodiffusion ou BACK SCATTER ;
On utilise la jauge du bloc standard, on la retire alors du bloc et la placer sur une surface lisse
plus précisément sur le sol compacté. Abaisser la gâchette et placer la poigné sur la position
rétrodiffusion. On obtient la mesure après l’enfoncement.
Etude de corrélation entre le « Comptest-LNTPB » et la mesure de compacité in-situ
RAMANJAKARIMANGA Dina Tsihafoy –Département BTP - Promotion 2008 Page | 83
Photo 10 : Prise de mesure après enfoncement
IV- EXPRESSION DES RESULTATS
Les calculs seront effectués selon l’emplacement ou point de mesure.
Pour les appareils à bloc source amovible
On doit obtenir le taux de compactage corrigé noté : Cc
Pour la correction on va utiliser les valeurs de corrections DC qui sont en fonction du temps
mort Q.
Cc = C + DC – C’
Où : C : le taux de compactage à la profondeur Z ;
DC : valeur de correction ;
C’ : le taux de compactage du bruit de fond.
La mesure du bruit de fond est effectuée chaque jour sur chaque site d’essai, la source étant
éloignée de 10 m.
Etude de corrélation entre le « Comptest-LNTPB » et la mesure de compacité in-situ
RAMANJAKARIMANGA Dina Tsihafoy –Département BTP - Promotion 2008 Page | 84
CONCLUSION [II]
Il existe plusieurs méthodes de mesurer la densité apparente afin de déterminer la compacité
d’un sol : celle du laboratoire et celles de terrain (in situ).
Il est préférable d’obtenir sur chantier même les résultats de compactage de façon à pouvoir
envisager les solutions adéquates en vue d’un meilleur résultat ; soit une reprise de
compactage soit une scarification de la couche mise en œuvre.
On peut le faire très simplement en déterminant le volume d’une cavité avec du sable de poids
spécifique connu, ou avec de l’eau contenu par une membrane étanche et élastique. Il faut
auparavant avoir récupéré toutes les terres sortant de la cavité, éviter leur dessiccation, puis le
peser et mesurer leur teneur en eau.
Une méthode ultra moderne utilise le rayon gamma. Des appareils commercialisés permettent
d’opérer très facilement à la surface du sol.
D’après certaines études (faites par YORO en 1983 ; GODO en1989) on a constaté que pour
un même sol ou un même horizon, la densité apparente variait plus ou moins selon la méthode
utilisée.
Les différences de résultats observées entre les mesures effectuées sur un même sol peuvent
être dues à des erreurs de manipulation et les limites d’utilisations liées à chaque méthode.
1) LES AVANTAGES DE CHAQUE METHODE
Méthode au sable :
- Cette méthode est applicable aux éléments grossiers, racines, horizons trop
durs et cassants
- On peut l’opérer sur des grands volumes ;
- Elle met en jeu un matériel peu coûteux.
Méthode au densitomètre à membrane :
- Une méthode simple ;
- Relative
Etude de corrélation entre le « Comptest-LNTPB » et la mesure de compacité in-situ
RAMANJAKARIMANGA Dina Tsihafoy –Département BTP - Promotion 2008 Page | 85
Méthode au carottier :
- Dans le cas de sol gonflant, la méthode au carottier est la meilleure mais non
parfaite, l’expansion de l’échantillon restant possible sur la face du profil et
aux extrémités du cylindre.
Méthode au gammadensimètre :
- une méthode rapide, d’où la possibilité de réaliser un grand nombre de mesure ;
- Elle peut être répétée autant de fois que l’on veut en un même temps ;
- Elle est peut destructive
2) LES DIFFERENTES INCONVENIENTS DE CES QUATRE
METHODES
Pour les méthodes au sable, au carottier, et au densitomètre à membrane :
• ces méthodes demandent beaucoup de temps car il faut attendre plusieurs heures au
moins 24 heures pour avoir les résultats (en attendant le passage à l’étuve);
• parfois il existe des risques de sous-estimation ou de surestimation du volume ;
• Pour la méthode au sable et le densitomètre à membrane, la réalisation demande
assez de temps (l’extraction des matériaux à une profondeur voulue est longue et
minutieuse), et la gamme de volume est relativement étroite alors il est impossible
d’opérer sur un petit volume;
• L’utilisation du densitomètre à membrane présente des limites, ne peut pas être
conseillé dans les horizons trop meubles ou boulant qui peut se déformer sous l’effet
de la pression exercée. L’appareil n’est pas adapté aux sols de dimension supérieure
à 50 mm et purement pulvérulents qui risquent d’endommager fréquemment la
membrane.
• Pour la méthode au sable, de point de vue technique, elle est difficile à appliquer en
présence de fissure ou de cavité où le sable peut s’écouler. Pendant la réalisation elle
a besoin d’un endroit calme pour éviter le tassement du sable (exempt d’une
vibration) ;
Etude de corrélation entre le « Comptest-LNTPB » et la mesure de compacité in-situ
RAMANJAKARIMANGA Dina Tsihafoy –Département BTP - Promotion 2008 Page | 86
• La méthode au carottier n’est pas applicable sur les éléments grossiers, racine,
horizons trop durs et cassant, mais par contre il est préférable de l’utiliser dans le cas
d’un sol gonflant.
Pour la méthode au gammadensimètre, les éléments grossiers ne permettent pas une
diffusion correcte des photons gamma émis dans le sol. Lors de la réalisation de l’essai, elle
demande un endroit exempt d’acier et de fer (il ne faut pas que les engins circulent aux
alentours de l’essai). Ensuite, le contrôle est minutieux et l’appareil coûte très cher.
Etude de corrélation entre le « Comptest-LNTPB » et la mesure de compacité in-situ
RAMANJAKARIMANGA Dina Tsihafoy –Département BTP - Promotion 2008 Page | 87
ETUDE DE CORRELATION ENTRE
LE « COMPTEST LNTPB » ET LA
MESURE DE COMPACITE A L’AIDE
D’UN GAMMADENSIMETRE
Etude de corrélation entre le « Comptest-LNTPB » et la mesure de compacité in-situ
RAMANJAKARIMANGA Dina Tsihafoy –Département BTP - Promotion 2008 Page | 88
Chapitre I- COMPTESTCOMPTESTCOMPTESTCOMPTEST LNTPBLNTPBLNTPBLNTPB
I- OBJECTIFS ET SES AVANTAGES
Le COMPTEST est un appareil du laboratoire conçu au LNTPB (Laboratoire National des
Travaux Publics et du Bâtiment) qui consiste à tester le compactage comme son nom
l’indique.
Cet appareil sert à définir une nouvelle méthode de mesure ponctuelle de la compacité in-situ
d’un matériau.
Il s’applique particulièrement aux matériaux de dimension Dmax inférieur à 20 mm. Alors cette
méthode ne s’applique pas aux matériaux utilisés en couche de chaussées (couche de
fondation, couche de base, etc.). Mais on peut l’utiliser pour les remblais et les plates forme
de chaussée.
C’est une méthode très facile à manipuler. C’est un appareil d’exécution rapide, elle permet
d’obtenir rapidement sur terrain (minutieuse) la compacité d’un sol, par conséquent il est
adapté aux grands chantiers de terrassement.
En plus il est facile à fabriquer localement, il résiste beaucoup au choc, à l’usure et à la
fatigue et peut être à la portée de tout le monde grâce à son bas prix.
La méthode de détermination de compactage par le Comptest LNTPB peut nous séduire par
son aspect purement mécanique c'est-à-dire par un procédé quelconque, on descend dans le
sol une pointe jusqu’à profondeur déterminée (15 cm).
Le coût relativement faible des essais fait un excellent outil pour détecter les problèmes.
II- PRINCIPE DE L’ESSAI
L’essai consiste à enfoncer une pointe par battage à l’aide d’un mouton de masse M qui
tombe en chute libre d’une hauteur H. Ce mouton va frapper une enclume qui est solidaire à la
pointe et fixer au bout du train de tige par serrage à pas de vis.
On définit la compacité d’un matériau par le nombre de coups nécessaires à un enfoncement h
donné qui est de 15 cm.
Etude de corrélation entre le « Comptest-LNTPB » et la mesure de compacité in-situ
RAMANJAKARIMANGA Dina Tsihafoy –Département BTP - Promotion 2008 Page | 89
La mesure de compacité est effectuée directement en utilisant des abaques de corrélation de
l’indice de compacité et le nombre de coups par un enfoncement de 15 cm. Cet abaque est fait
après avoir réalisé quelques étalonnages avec les résultats obtenus par le gammadensimètre.
Les différentes caractéristiques de l’appareil sont données par le tableau suivant.
FACTEURS COMPTEST LNTPB
Mouton :
Masse du mouton (Kg)
Hauteur de chute (m)
4,527
0,50±0,02
Tige guide :
Masse de la tige guide (Kg)
Longueur de la tige guide (m)
Diamètre de la tige guide (mm)
1,324±0,5
0,86
15
Enclume+tige de fonçage+pointe
Masse enclume+tige guide+pointe (Kg)
Diamètre supérieure enclume (mm)
Diamètre de la tige de fonçage (mm)
Longueur de la tige de fonçage (m)
1,046±0,5
77,6
19,8
0,219
Pointe :
Diamètre de la partie cylindrique (mm)
Diamètre de la partie conique (mm)
Hauteur de la partie cylindrique filetée (mm)
Hauteur de la partie cylindrique non filetée mm)
Hauteur de la partie conique (mm)
Angle au sommet (°)
18,6
2,05
26
10
17
60
Tableau n° 20: les caractéristiques du Comptest LNTPB
Etude de corrélation entre le « Comptest-LNTPB » et la mesure de compacité in-situ
RAMANJAKARIMANGA Dina Tsihafoy –Département BTP - Promotion 2008 Page | 90
III- APPAREILLAGE
1) Tige guide
Une tige guide permet de guider verticalement le mouton. La masse de la tige est de 1,324kg
±0,5g, ayant un diamètre de 15 mm et 88 cm de long.
L’axe de la tige et de l’enclume doit être rectiligne, avec une déviation maximale de 5mm
c'est-à-dire il faut que l’ensemble reste toujours vertical pour que le frottement entre la tige
guide et le mouton soit négligeable.
Cette tige est une tige en acier pleine et à haute résistance au choc, à l’usure et à la fatigue.
Ses deux extrémités sont filetées, l’une en haut sert à fixer le poignet qui est destiné à
maintenir la tige verticalement, et l’autre sert à fixer la tige à l’enclume.
Photo 11: photo d'une tige guide muni de son poignet
2) Mouton
Le mouton sert à faire le battage pour enfoncer la pointe muni d’une enclume. La masse du
mouton est de 4,527 kg environ. Le rapport entre le diamètre et la longueur est compris entre
0,8 et 0,3. Le mouton doit comporter un trou axial dont le diamètre est de 3 à 4 mm plus
grand que celui de la tige guide. Ce mouton glisse librement sur la tige guide et tombe en
chute libre et sa vitesse initiale doit être nulle ou négligeable.
La hauteur de chute est de 0,50 m ±0,02 m.
Photo 12: mouton d'un Comptest-LNTPB
Etude de corrélation entre le « Comptest-LNTPB » et la mesure de compacité in-situ
RAMANJAKARIMANGA Dina Tsihafoy –Département BTP - Promotion 2008 Page | 91
3) Pointe, tige de fonçage et enclume
On appelle pointe (au sens propre) l’embout à l’extrémité du train de tige de fonçage. C’est
une pointe perdue. Elle est cylindro-conique, la partie cylindrique est filetée à 26 mm pour le
raccordement avec la tige de fonçage.
La pointe a pour diamètre :
• 1,86 cm pour la partie cylindrique;
• Et 2,05 cm pour la partie conique.
Le diamètre du cône doit être supérieur à celui de la tige de fonçage pour que le frottement
entre la tige et le sol soit plus ou moins négligeable.
La pointe doit avoir un angle au sommet de 60°.
L’extrémité de la pointe doit être tronquée de 5mm.
On considère comme faisant partie de la pointe la longueur de tige de fonçage. Cette tige a
pour diamètre 1, 98 cm et pour longueur 21,93 cm, et munie d’une graduation qui sert à
déterminer la profondeur d’enfoncement (graduation limité à 15cm).
L’ enclume est parfaitement solidaire à la tige de fonçage. Elle a de la forme conique de
diamètre supérieure de 7,76 cm.
Photo 13 : Pointe, tige de fonçage avec l’enclume
Etude de corrélation entre le « Comptest-LNTPB » et la mesure de compacité in-situ
RAMANJAKARIMANGA Dina Tsihafoy –Département BTP - Promotion 2008 Page | 92
Figure 16: Coupe de la pointe (pointe perdue)
Etude de corrélation entre le « Comptest-LNTPB » et la mesure de compacité in-situ
RAMANJAKARIMANGA Dina Tsihafoy –Département BTP - Promotion 2008 Page | 93
Figure 17 : coupe de la pointe avec enclume.
Etude de corrélation entre le « Comptest-LNTPB » et la mesure de compacité in-situ
RAMANJAKARIMANGA Dina Tsihafoy –Département BTP - Promotion 2008 Page | 94
Figure 18 : figure del’appareil COMPTEST
Etude de corrélation entre le « Comptest-LNTPB » et la mesure de compacité in-situ
RAMANJAKARIMANGA Dina Tsihafoy –Département BTP - Promotion 2008 Page | 95
IV- PROCEDURE D’ESSAI
1) Généralités
La longueur d’enfoncement doit être limitée à 15 cm. Mais on devra arrêter de l’enfoncer
quand on rencontre des cailloux ou une racine, et refaire l’essai à quelque centimètre de
l’endroit précédent.
L’essai doit être effectué verticalement. Les tiges (tige guide et tige de fonçage) et la pointe
doivent être guidées au début de l’essai pour maintenir les tiges verticales.
2) Battage
Avant de commencer à compter le nombre de coups, on recommande d’abord l’enfoncement
de la partie conique de la pointe dans le sol. Le battage doit être continu, avec une hauteur de
chute de 0,50m ±0,02m. La surface de contact de l’enclume doit être bien horizontale pour
garder la verticalité.
Le nombre de coup doit être compris entre 10 et 70 coups pour un matériau compacté suivant
sa teneur en eau et sa nature, en enfonçant jusqu’à15 cm la tige de fonçage.
L’essai terminé, on ôte l’ensemble de la pointe en le tournant au sens contraire du serrage de
la pointe pour ne pas la perdre.
Photo 14: exécution de l'essai par le Comptest - LNTPB
Etude de corrélation entre le « Comptest-LNTPB » et la mesure de compacité in-situ
RAMANJAKARIMANGA Dina Tsihafoy –Département BTP - Promotion 2008 Page | 96
V- PRESENTATION DES RESULTATS D’ESSAI
Les résultats ne sont pas pareils suivant la nature et les caractéristiques du matériau.
On a des abaques que l’utilisateur doit amener avec lui pour la lecture directe de la valeur de
compactage. Un abaque doit comporter le nombre de coups et la valeur de compacité d’un
matériau selon sa nature.
D’après cet abaque, on obtient directement la compacité du sol concerné.
Il y a des seuils à respecter que l’utilisateur doit savoir. Ces seuils ont été déterminés d’après
des essais et calcul effectués par des faisceaux des droites auprès de la courbe.
Pour un Limon argilo sableux, si le nombre de coups sera comprise entre 16 et 30 coups le
compacité du sol à étudier est plus de 90% mais n’atteint pas encore le 95%. Et s’il dépasse
le 30 coups on a une compacité de 95% et plus.
Pour un sable limoneux, si on a un nombre de coups de 20 à 40 coups la compacité du sol à
étudier est plus de 90%, et en dépassant les 40 coups elle atteint le 95%.
Si le nombre de coups est très élevé c'est-à-dire dépasse les 70 coups il est préférable de
refaire l’essai en déplaçant quelque centimètre de ce point car il y a peut être un obstacle
dedans (un caillou ou une racine). De même si le nombre de coups est trop petit, il faut refaire
aussi l’essai car cela peut être dû à l’hétérogénéité du sol (pour un sol hétérogène la teneur en
eau optimal peut être différente).
Chaque type de sol doit avoir son abaque de détermination.
Etude de corrélation entre le « Comptest-LNTPB » et la mesure de compacité in-situ
RAMANJAKARIMANGA Dina Tsihafoy –Département BTP - Promotion 2008 Page | 97
Chapitre II- ETUDE DE CORRELATIONETUDE DE CORRELATIONETUDE DE CORRELATIONETUDE DE CORRELATION
I- OBJECTIFS
En terme mathématique, la corrélation est la relation qui existe entre deux ou plusieurs
phénomènes qui varient simultanément, qui sont fonction l’un de l’autre et qui évoque un lien
de cause à effet.
L’objectif majeur de cette étude est d’obtenir la corrélation entre les nombres de coups
effectués par le Comptest LNTPB et les valeurs de compacité obtenues par le
gammadensimètre (ou les autres méthodes de détermination de compacité in situ).
En général, la corrélation se présente sous forme de fonction (droite ou courbe).
Depuis longtemps nous avions l’habitude d’utiliser les quatre méthodes, citées dans la partieII
de cet ouvrage, pour déterminer le compactage in situ .Or ces différentes méthodes ont ces
inconvénients, alors ce mémoire a pour but de résoudre une partie des problèmes qu’on pourra
régler.
D’après ces quatre méthodes de détermination du compactage, on sait que le
gammadensimètre permet de donner rapidement les valeurs voulues comme la densité sèche
in situ, la teneur en eau, et surtout la compacité. C’est pourquoi le choix du gammadensimètre
pour la réalisation de cette étude.
II- PROCEDURE D’ETUDE DE CORRELATION
S’il est difficile, voire impossible, de donner une justification théorique quantitative de
l’existence de relations entre les propriétés d’un massif de sol naturel, il est facile d’admettre
que les différents paramètres d’un sol donné doivent avoir des relations.
De plus, à l’intérieur d’une même catégorie de paramètres, par exemple les paramètres de
densité, il existe à l’évidence des relations entre les paramètres mesurés dans les différents
types d’essais en place ou en laboratoire, même si l’on ne peut pas les exprimer de façon
explicite.
Etude de corrélation entre le « Comptest-LNTPB » et la mesure de compacité in-situ
RAMANJAKARIMANGA Dina Tsihafoy –Département BTP - Promotion 2008 Page | 98
Cette réflexion purement qualitative est confirmée par l’expérience : il existe effectivement,
dans chaque dépôt de sols, des relations entre les paramètres géotechniques, ainsi que des
relations plus générales, valables pour un type de sol, ou même pour plusieurs types de sols.
La corrélation, qu’il n’est possible de caractériser que de façon statistique, s’explique par la
raison que toutes les propriétés d’un même empilement de particules évoluent de façon
coordonnée et traduisent l’existence d’une loi de comportement générale pour chaque grande
classe de sol.
La corrélation est un moyen de fabrication de valeurs complémentaires de certains paramètres
en fonction des autres.
Si on analyse simultanément des données provenant de deux sites, pour des sols de même
nature, on trouve en général que les valeurs des paramètres sont plus dispersées, et cette
dispersion augmente quand le nombre de sites s’accroît et quand on regroupe des données
relatives à différents types de sols. Les erreurs expérimentales, lors de la détermination des
paramètres qui servent à établir les corrélations, exercent également une influence défavorable
sur la qualité des corrélations obtenues.
Les méthodes classiques de l’analyse statistique ont été exposées dans de nombreux ouvrages
auxquels on pourra se reporter pour une description détaillée de ces méthodes. Dans la
présente partie, seront rappelés seulement les principes essentiels des méthodes couramment
utilisées pour les études de corrélations en mécanique des sols.
Pour l’application des techniques de l’analyse statistique, chaque paramètre doit être
considéré comme une variable aléatoire, c’est-à-dire comme une grandeur non déterminée a
priori, dont on sait qu’elle peut prendre telle ou telle valeur dans un ensemble de valeurs
possibles, avec une certaine probabilité.
La corrélation est présentée par des fonctions, soit sous forme d’une courbe tantôt en
puissance tantôt en exponentiel, soit sous forme d’une droite. Il faut d’abord s’assurer du
choix par la détermination de l’indice mesurant le degré de liaison entre deux variables
appelé « coefficient de corrélation », les relations entre les variables seront ajustées.
Etude de corrélation entre le « Comptest-LNTPB » et la mesure de compacité in-situ
RAMANJAKARIMANGA Dina Tsihafoy –Département BTP - Promotion 2008 Page | 99
1) Principe de détermination de la courbe de tendance (voir ouvrages [11]et [13])
a) Coefficient de corrélation
Dans le plan OXY, on a des nuages des points.
Le coefficient de corrélation ρ est le pourcentage linéaire de ces points.
− Si ρ=1, les nuages des points constituent relativement une ligne ;
− Pour ρ<1, cela indique que quelque pourcentage des points se situent dans la
limitrophe de la ligne.
D’une manière quantitative :
− 0,87 : les nuages de point peuvent s’ajuster à une droite appelée « Droite de
régression ». On dit que l’ajustement est linéaire ;
− 0 < ρ< 0,87 : les points s’ajustent par une courbe, soit en puissance soit en
exponentiel. Il s’agit d’un ajustement non linéaire ;
− -1 < ρ<0 : on prendra la valeur absolue du coefficient de corrélation ρ, alors
l’ajustement ne change pas.
Pour l’ajustement linéaire, Il consiste à déterminer une droite (D) qui sera aussi proche que
possible des nuages des points observés. Pour cela on utilise la méthode des moindres carrés.
b) Ajustement linéaire
On a un ajustement linéaire dans le cas où l’ajustement des nuages des points s’effectuent
linéairement, cas où ρ est compris ou égal entre à 1 et 0,87.
Il consiste à déterminer une droite (D) qui sera aussi proche que possible des nuages des
points observés. Pour cela on utilise la méthode des moindres carrés.
L’équation de la droite de régression est de la forme : Y= aX+b.
Ainsi la droite de régression a pour équation:
2 2XY XY
X X
Y X Y Xσ σσ σ
= + − (C’est la droite d’ajustement)
Etude de corrélation entre le « Comptest-LNTPB » et la mesure de compacité in-situ
RAMANJAKARIMANGA Dina Tsihafoy –Département BTP - Promotion 2008 Page | 100
c) Ajustement non linéaire
Pour analyser simultanément les valeurs de plusieurs propriétés d’un même sol, on fait en
général l’hypothèse que les relations cherchées sont linéaires. Cette hypothèse n’exclut pas
l’existence de relations de type non linéaire entre les propriétés du sol : les variables aléatoires
liées par des relations linéaires peuvent être des fonctions non linéaires des propriétés du sol
(logarithmes, fonctions puissances, exponentielles, etc.), ce qui donne une grande souplesse à
ce type d’analyse linéaire.
On dit que l’ajustement est non linéaire dans le cas où l’ajustement de nuage des points ne
s’apparente pas à une droite dont le coefficient de corrélation ρ est compris entre 0 à 0, 87.
L’ajustement sera une courbe soit en exponentiel soit en puissance, qui s’étude comme suit :
Ajustement en exponentiel
L’exponentiel est définie par l’équation : Y = KAX
De ce fait, on commence à ajuster linéairement LnYi en Xi. Et on obtient la droite de
régression Y= aX +b.
Pour se faire on remplace Y par LnY.
XY K A= × (C‘est l’équation de la courbe d’ajustement à tendance exponentiel)
Avec :2
X Y
X
Y X
K e
σσ
−
=
2X Y
XA e
σσ
=
Ajustement en puissance
La puissance est définie par l’équation Y= K XE.
Dans ce cas, il suffit d’ajuster le caractère LnYi en LnXi, après le calcul on obtient la droite
de régression.
EY K X= ×
Avec :
( )
2
Y E X
X Y
X
K e
Eσσ
−=
=
Etude de corrélation entre le « Comptest-LNTPB » et la mesure de compacité in-situ
RAMANJAKARIMANGA Dina Tsihafoy –Département BTP - Promotion 2008 Page | 101
2) Etude de corrélation entre le Comptest LNTPB et le Gammadensimètre
L’objectif de cette étude est d’obtenir la corrélation entre les résultats venant du
gammadensimètre et ceux du Comptest LNTPB.
Cette détermination présente deux variables : le nombre de coups venant du Comptest et la
valeur de la compacité du gammadensimètre.
a) Procédure de calcul :
Détermination de ρ : coefficient de corrélation
Soient :
Xi : la compacité par le gammadensimètre ;
Yi : les nombres de coups par le COMPTEST.
Considérons donc l’échantillon d’un couple de deux variables X et Y :
(x1, y1), (x2, y2), …, (xn, yn). On appelle covariance de cet échantillon la valeur :
1
1cov( , ) ( )( )
n
i ii
X Y X X Y Yn =
= − −∑
Le coefficient de corrélation est alors défini par :
cov( , )
( , ) XY
X Y X Y
X YX Y
σρσ σ σ σ
= =× ×
Où σx et σy sont les écarts-types des variables x et y.
Avec :
22
1
22
1
1
1
1
1
n
X ii
n
Y ji
n
XY i ji
X Xn
Y Yn
X Y XYn
σ
σ
σ
=
=
=
= −
= −
= −
∑
∑
∑
Et
1
1
n
ii
n
ii
XX
n
YY
n
=
=
=
=
∑
∑
Etude de corrélation entre le « Comptest-LNTPB » et la mesure de compacité in-situ
RAMANJAKARIMANGA Dina Tsihafoy –Département BTP - Promotion 2008 Page | 102
Conditions :
� Si 0,87ρ ≥ : on a un ajustement linéaire, alors les nuages des points s’ajuste en une
droite d’équation : Y = a X + b
� Si 0,87ρ < : l’ajustement sera non linéaire c'est-à-dire que les nuages des points
s’ajustent à une courbe.
� Si on a un ajustement en exponentiel :(Voir la démarche en annexe 7)
XY K A= × (C‘est l’équation de la courbe d’ajustement à tendance exponentiel)
Avec :2
X Y
X
Y X
K e
σσ
−
=
2X Y
X
X
A e
σσ
=
� Si on a un ajustement en puissance :(Voir la démarche en annexe 7)
EY K X= × (C‘est l’équation de la courbe d’ajustement à tendance exponentiel)
Avec :
( )
2
Y E X
X Y
X
K e
Eσσ
−=
=
b) Résultats
Le but de cette étude est de connaître l’allure de variation de la compacité du sol étudié en
fonction de nombre de coups effectué par le « comptest- LNTPB ».
D’après les moments qu’on a effectué des essais, on a obtenu plusieurs couples de mesures de
compacité par le gammadensimètre et le nombre de coups par le Comptest LNTPB. Pendant
la réalisation de ces essais on a utilisé des matériaux de différentes natures et caractéristiques
qui sont définis par le tableau ci après.
Etude de corrélation entre le « Comptest-LNTPB » et la mesure de compacité in-situ
RAMANJAKARIMANGA Dina Tsihafoy –Département BTP - Promotion 2008 Page | 103
Tableau n° 21: Tableau des différents types de matériaux classés selon leurs caractéristiques.
Nature et Provenance Wnat
[%]
GRANULOMETRIE Limites PROCTOR CBR Classification
Dmax
[mm]
2,0
[%]
0,5
[%]
0,2
[%]
0,08
[%]
WL
[%]
WP
[%]
IP
[%]
γOPM
[kN/m3]
WOPM
[%] 0j 4j
Gnf
[%] LPC HRB GTR
Type I : Limon argilo-sableux
rougeâtre (LAS)
Provenance : chantier Ivato
Aéroport
22,01 6,30 95,7 73,7 51,4 40,4 37,5 22,1 15 1,92 13,0 26 0,08
Sable
argileux
(SC)
Sols
argileux
(A-7-6)
Sables
fins
argileux
(A2)
14,5 2,00 98,2 82 - 54 37,3 20,1 17 1,83 14,6 18 0,09
Argile
peu
plastique
(AP)
Sols
argileux
(A-6)
Sables
fins
argileux
(A2)
Type II : Sable limoneux
jaunâtre (SL)
Provenance : chantier
d’Ambohiboahangy
Ambohimalaza PK 0+000 au
PK 2+420
13,1 2,00 100 83 58,9 52,1 32,4 15 9 1,82 15,0 19 0,07
Limon
peu
plastique
(Lp,Op)
Sable
limoneux
(A-2-4)
Limon
peu
plastique
(A1)
Etude de corrélation entre le « Comptest-LNTPB » et la mesure de compacité in-situ
RAMANJAKARIMANGA Dina Tsihafoy –Département BTP - Promotion 2008 Page | 106
Voici quelques couples de mesure obtenues pendant la réalisation d’essai:
Matériaux de type I : Limon argilo-sableux rougeâtre (L.A.S) (provenance : chantier
Ivato Aéroport)
LPC HRB GTR
Sable argileux (SC) Sols argileux (A-6) à (A-7-6) Sables fins argileux (A2)
Compacité « C » Nombre de coups « N »
Compacité « C » Nombre de coups « N »
84 11
94,9 40
84,6 10
95 24
86,4 10
95 27
86,7 13
95,1 28
88,9 18
95,2 31
89 20
95,3 27
89,2 13
95,4 30
89,6 17
95,5 40
89,7 15
95,6 30
89,9 16
96 23
90,6 20
96,1 19
91,7 26
96,3 38
92 29
96,4 20
92 27
96,5 37
92,1 18
96,6 44
92,2 41
96,8 46
92,3 21
96,9 32
92,3 36
97,1 48
Etude de corrélation entre le « Comptest-LNTPB » et la mesure de compacité in-situ
RAMANJAKARIMANGA Dina Tsihafoy –Département BTP - Promotion 2008 Page | 107
Tableau n° 22: Les différentes valeurs pour le sol de type I
Compacité « C » Nombre de coups « N »
Compacité « C » Nombre de coups « N »
92,5 30
97,2 55
92,8 29
97,8 50
92,8 30
98 27
92,8 22
98,2 34
93 24
98,3 40
93,1 25
98,4 56
93,2 26
98,6 62
93,3 30
98,7 52
93,4 22
99,2 32
93,6 30
99,3 27
93,7 26
99,6 49
94,1 28
99,7 52
94,2 27
100,8 60
94,5 30
101 62
94,6 32
101,2 66
94,7 27
104,7 76
94,8 31
105,4 75
Etude de corrélation entre le « Comptest-LNTPB » et la mesure de compacité in-situ
RAMANJAKARIMANGA Dina Tsihafoy –Département BTP - Promotion 2008 Page | 108
Type II : Sable limoneux jaunâtre (SL) (provenance : chantier d’Ambohiboahangy
Ambohimalaza – aménagement de la route du PK 0+000 à PK 2+420)
LPC HRB GTR
Limon et sol organique peu
plastique (Lp, Op)
Sable limoneux (A-2-4) Limon peu plastique (A1)
Compacité « C » Nombre de coups « N »
Compacité « C » Nombre de coups « N »
84,2 19 94,8 36
85,9 20 94,9 38
88,2 23 95 47
89,1 21 95,1 39
91,2 30 95,8 61
92,7 38 96 49
93,2 31 96,1 68
93,6 38 96,2 78
93,8 45 96,3 60
94 32 96,5 57
94,5 35 96,8 64
94,7 52
Tableau n° 23: Les différentes valeurs pour le sol type II
Etude de corrélation entre le « Comptest-LNTPB » et la mesure de compacité in-situ
RAMANJAKARIMANGA Dina Tsihafoy –Département BTP - Promotion 2008 Page | 109
Démarche à suivre :
On prend comme variable aléatoire la compacité et le nombre de coups.
Les résultats seront ajustés dans le plan OXY.
• X correspond à la compacité « C » du sol par le gammadensimètre;
• Y correspond au nombre de coups « N ».
D’où la détermination de la valeur du coefficient de corrélation ρ en appliquant les valeurs
trouvées de , , , ,X Y XYX Y σ σ σ d’après le calcul.
Les valeurs du coefficient de corrélation ρ pour chaque type de sol :
Sol X Y σX σX σXY ρ
Type I : Limon argilo-sableux (L.A.S)
Provenance : Chantier Aéroport Ivato 94,66 32,70 4,09 15,02 2,68 0,04
Type II : Sable limoneux (S.L)
Provenance : Chantier d’Ambohiboahangy
Ambohimalaza du PK 0+000 au PK 2+420
93,41 42,65 3,39 15,96 6,58 0,12
Tableau n° 24: valeurs des coefficients de corrélation pour chaque type de sol
Les valeurs de ρ pour chaque type de sol sont toutes inférieures à 0,87, alors on procède à un
ajustement non linéaire. Par application de la méthode expliquée précédemment, on obtient
les résultats consignés sur le tableau suivant :
Tableau n° 25: les équations d’ajustements obtenus après calcul
Après avoir obtenu les équations d’ajustement, on aperçoit que les courbes varient selon le
type de sol. On peut alors tracer un abaque à partir de ces équations. Les abaques qui seront
classés selon le type de sol à utiliser.
Sol ρ Equation d’ajustement
Type I : Limon argilo-sableux (L.A.S)
Provenance : Chantier Aéroport Ivato 0,04 N=4,02 10+7 e+0,16C
Type II : Sable limoneux (S.L)
Provenance : Chantier d’Ambohiboahangy
Ambohimalaza du PK 0+000 au PK 2+420
0,12 N=1,77 10-05 e+0, 57C
Etude de corrélation entre le « Comptest-LNTPB » et la mesure de compacité in-situ
RAMANJAKARIMANGA Dina Tsihafoy –Département BTP - Promotion 2008 Page | 110
Chapitre III- PRESENTATION DES RESULTATSPRESENTATION DES RESULTATSPRESENTATION DES RESULTATSPRESENTATION DES RESULTATS
Les résultats de calcul seront représentés sous forme d’un abaque. Chaque type de sol a son
abaque de résultats. Et comme les coefficients de corrélation sont tous inférieur à 0,87, on
obtient un ajustement non linéaire c'est-à-dire une courbe (ζ) qui a pour équation : N = K AC
avec "K" et "A" varient selon le type de sol.
• N au nombre de coups obtenu par le Comptest LNTPB ;
• C correspond à la compacité du sol.
Pour le matériau de type I : limon argilo sableux (L.A.S), provient des travaux
d’aménagement Tarmac et bretelle d’Ivato Aéroport. La courbe a pour équation :
N=4,02 10+7 e+0,16C on a un ajustement en exponentiel.
Pour le deuxième type de sol : on a un sable limoneux (S.L), provient des travaux de
réhabilitation de la route d’Ambohimalaza du PK 0+000 à PK 1+250. Qui a pour équation :
N=1,77 10-05 e+0, 57C on a aussi un ajustement en exponentiel.
Alors après avoir obtenu ces deux équations, on a pu tracer les abaques correspondants.
1) Abaque de détermination de la compacité « C » après étalonnage.
Voici les abaques obtenus après étalonnage avec la compacité du gammadensimètre:
Cet abaque a pour :
� Abscisse X : les valeurs de la compacité du sol « C » obtenu par le gammadensimètre
(ces valeurs sont pareils même si on utilise les trois autres méthodes de détermination
de compactage in situ comme la méthode au sable, la méthode au densitomètre à
membrane, la méthode au carottier.) ;
� Ordonnée Y : le nombre de coups « N » obtenu par le « Comptest – LNTPB ».
Pour chaque type d’abaque on a toujours précisé la nature et la provenance du matériau
suivi de leur classification.
Etude de corrélation entre le « Comptest-LNTPB » et la mesure de compacité in-situ
RAMANJAKARIMANGA Dina Tsihafoy –Département BTP - Promotion 2008 Page | 111
Matériaux de type I : Limon argilo-sableux « L.A.S » (provenance : aménagement
tarmac et bretelle Ivato Aéroport)
LPC HRB GTR
Sable argileux (SC) Sols argileux de A-6 à A-7 Sables fins argileux (A2)
La courbe a pour équation (ζ) : N=4,02 10+7 e+0,16C
Le coefficient de corrélation est égal à 0,04
Figure 19: Abaque de détermination de la valeur de compacité in situ pour le sol limon argilo-sableux
(ζ)
Etude de corrélation entre le « Comptest-LNTPB » et la mesure de compacité in-situ
RAMANJAKARIMANGA Dina Tsihafoy –Département BTP - Promotion 2008 Page | 112
Matériaux type II: sable limoneux « S.L » (provenance : chantier d’Ambohiboahangy
Ambohimalaza du PK 0+000 à PK 2+420)
LPC HRB GTR
Limon et sol organique peu
plastique (Lp, Op)
Sable limoneux (A-2-4) Limon peu plastique (A1)
La courbe a pour équation (ζ) : N=1,77 10-05 e+0, 57C
Le coefficient de corrélation est égal à 0,12
Figure 20: Abaque de détermination de la compacité in situ pour le sol sable limoneux.
Etude de corrélation entre le « Comptest-LNTPB » et la mesure de compacité in-situ
RAMANJAKARIMANGA Dina Tsihafoy –Département BTP - Promotion 2008 Page | 113
2) Interprétation des résultats
Les figures 19et 20 ce sont des abaques qui montrent les relations existant entre la compacité
« C » et ne nombre de coups « N » obtenu par le Comptest LNTPB, pour deux types de sols
différents tels que les limons argilo sableux rougeâtre et les sables limoneux jaunâtre. Pour
ces deux types de sol, nous avons remarqué que la relation entre les deux paramètres est
associée à un coefficient de corrélation faible. Quand les points sont beaucoup plus dispersés
dans le graphique la qualité de la corrélation est plus faible. Pour les limons argilo sableux, le
coefficient de corrélation est égal à 0,04 et pour les sables limoneux il est égal à 0,12. Alors
on a un ajustement non linéaire plus précisément régression en exponentielle.
a) Détermination de la compacité par l’utilisation de la corrélation entre
le nombre de coups par le Comptest LNTPB et la mesure de la compacité in situ
existante :
On a la phase d’étalonnage qui exige :
• L’établissement de la courbe de corrélation entre la mesure de compacité « C » in situ
par la méthode existante et le nombre de coups obtenu par le comptest LNTPB. D’après les
différents couples effectués lors de la pratique (des essais sur terrain) et l’étude statistique
faite, on a pu déduire cette courbe de corrélation (ζ). La validité de cette méthode est limitée
aux sols passant entièrement au tamis de 0,4 mm ou présentant à ce tamis un refus très faible,
on les appelle « sols fins ».
• L’établissement de l’abaque de corrélation entre la compacité « C » et le nombre de
coups « N » par le Comptest LNTPB.
On obtient l’abaque de corrélation recherché en traçant la courbe de corrélation, en graduant
l’axe des abscisses de valeur de compacité « C » par la méthode in situ déjà existé et l’axe des
ordonnées de nombre de coups « N » obtenu par le Comptest LNTPB.
Etude de corrélation entre le « Comptest-LNTPB » et la mesure de compacité in-situ
RAMANJAKARIMANGA Dina Tsihafoy –Département BTP - Promotion 2008 Page | 114
Pour le processus et la mise en œuvre sur chantier :
• Mesure de la compacité in situ à l’aide du gammadensimètre. Nous avons choisit de
faire l’étalonnage avec la méthode au gammadensimètre en raison de sa rapidité ;
• Détermination du nombre de coups à l’aide du Comptest LNTPB. La compacité est
déduite en faisant l’étalonnage de ce nombre de coups avec la compacité obtenue par
la méthode au gammadensimètre.
Les résultats nous ont montré que la corrélation entre la compacité in situ et le nombre de
coups effectué par le Comptest-LNTPB d’un matériau de même classe est une courbe (plus
exactement une courbe par ajustement en exponentielle) c'est-à-dire que pour trouver la
compacité on a l’équation :
N = K AC
Soit C : la compacité du sol ;
N : le nombre de coups effectué par le Comptest LNTPB.
K : coefficient qui varie selon la nature du sol concerné. Pour le sol type I (Limon
argilo sableux ou L.A.S) K est égale à 4,02 10+7 et pour le sol type II (sable Limoneux ou
S.L) K est égale à 1,77 10-05
A : valeur qui varie peu selon la nature du sol c'est-à-dire pour le sol type I (Limon
argilo sableux ou L.A.S) A est égale à e+0,16 et pour le sol type II (sable Limoneux) A est
égale à e+0, 57.
Le sol type I c’est le limon argilo-sableux (L.A.S) venant des travaux d’aménagement tarmac
et bretelle d’Ivato aéroport, sa courbe de corrélation a pour équation :
(ζ) : N=4,02 10+7 e+0,16C
Le deuxième type de sol est le sable limoneux (S.L) venant du chantier d’Ambohiboahangy
Ambohimalaza du PK 0+000 au PK 2+420, l’équation de la courbe est :
(ζ) : N=1,77 10-05 e+0, 57C
Etude de corrélation entre le « Comptest-LNTPB » et la mesure de compacité in-situ
RAMANJAKARIMANGA Dina Tsihafoy –Département BTP - Promotion 2008 Page | 115
b) Utilisation de l’abaque de corrélation :
L’abaque sert à déterminer directement la compacité d’un sol de nature donnée en utilisant le
« Comptest-LNTPB ».
Le nombre de coups ainsi effectué est introduit dans l’abaque qu’on peut lire sur l’échelle de
l’ordonnée des nombres de coups, puis on obtient la compacité correspond à l’ordonnée du
point d’intersection de ce nombre de coups avec la courbe de corrélation (ζ).
Plus clairement, l’abaque de corrélation a pour :
• Abscisse X : la compacité « C » obtenue par la méthode de détermination de
compactage in situ existante ;
• Ordonnée Y : le nombre de coups « N » obtenu par le Comptest LNTPB.
Si on a par exemple un sol de type I, on doit utiliser l’abaque qui correspond à ce type de sol.
C’est très facile de déterminer la valeur de compacité quand on utilise le Comptest LNTPB
avec son abaque.
Ou bien quand on poursuivra l’étude on verra si on peut assembler tous les abaques de chaque
type de sol ainsi déterminé dans un seul abaque, et on peut avoir un seul et unique abaque.
C’est encore pour facilité le travail.
D’après les résultats sur l’abaque, on peut tirer que :
- La compacité à 95% est atteint quand le nombre de coup sera 30 environ pour le limon
argilo sableux ;
- Et pour les sables limoneux, 95% correspond à 40 coups près.
Lors de l’exécution de l’essai si on a obtenu des résultats qui dépassent trop largement le seuil
indiqué sur l’abaque, il est certain qu’il y a eu d’obstacle (des cailloux, une racine, etc.) dans
le sol à réceptionner. Il faut répéter l’essai un peu plus loin de l’essai précédent jusqu’à
l’obtention du vrai résultat. De même si le nombre de coups est trop petit, il faut refaire aussi
l’essai car cela peut être dû à l’hétérogénéité du sol (pour un sol hétérogène la teneur en eau
optimal peut être différente).
Certaines corrélations établies sur un site et parfaites pour ce site, peuvent aussi être
totalement inadaptées sur un autre site, même constitué d’un sol de même nature. Cette
Etude de corrélation entre le « Comptest-LNTPB » et la mesure de compacité in-situ
RAMANJAKARIMANGA Dina Tsihafoy –Département BTP - Promotion 2008 Page | 116
divergence traduit habituellement l’influence d’autres paramètres que ceux qui sont analysés,
par exemple l’influence de l’état du sol, en plus de sa nature. Si la relation obtenue par
régression linéaire ou non entre deux paramètres dépend d’autres facteurs, elle peut varier non
seulement d’un site à l’autre, mais aussi à l’intérieur d’un même site. Alors il est
indispensable de poursuivre l’étude en étalonnant avec d’autre paramètre du site afin d’éviter
des erreurs d’analyse statistique des données.
c) Précision de l’appareil : fidélité et justesse
• Effet de frottement entre la tige de fonçage et le sol :
Cette appareil a même principe que le pénétromètre dynamique (Dynamic cone penetrometer
ou DCP), mais ils se diffèrent par sa taille et son poids. D’après l’ouvrage [10] il y a des
études pour évaluer l’effet de frottement sur les tiges de fonçage du DCP.
On ne note aucune différence évidente entre les profils des essais de pénétration réalisés avec
et sans avant-trou. Les valeurs en pointe sont moins élevées avec un avant-trou, contrairement
à ce que l’on aurait pu s’attendre. La différence est attribuable à l’emplacement des essais
plutôt qu’au composant frottement. Ces résultats tendent à démontrer que le frottement n’est
pas un paramètre influant lorsque les essais sont effectués à une profondeur inférieure à 4
mètres. Aucune correction n’est à appliquer lorsque l’on débute l’essai à partir de la surface
au lieu du milieu de la croûte. Alors on ne tient compte de l’effet de frottement.
• Fidélité et justesse de l’appareil
La précision définie l’écart en % que l’on peut obtenir entre la valeur réelle et la valeur
obtenue. Ainsi un appareil précis aura à la fois une bonne fidélité et une bonne justesse.
Fidélité:
Théoriquement, la fidélité c’est la corrélation entre les mesures observées et les mesures
vraies à un test.
Où ici X et Y sont des mesures déviations (écarts à la moyenne). Cependant, cela a peu
d’intérêt en pratique puisque nous ne connaissons pas la valeur des mesures vraies.
Une autre façon similaire de définir théoriquement la fidélité: c’est une proportion de
variance, soit la variance vraie sur la variance observée;
Etude de corrélation entre le « Comptest-LNTPB » et la mesure de compacité in-situ
RAMANJAKARIMANGA Dina Tsihafoy –Département BTP - Promotion 2008 Page | 117
La fidélité est en général exprimée numériquement sous forme d’écart-type, de variance ou de
coefficient de variation.
Écart type (Erreur quadratique moyenne de fidélité) : 22
1
1 n
X ii
X Xn
σ=
= −∑
Avec moyenne
Coefficient de variation : CV =
Justesse
C’est l’aptitude à délivrer une réponse proche de la valeur vraie et ceci indépendamment de la
notion de fidélité. Elle est liée à la valeur moyenne obtenue sur un grand nombre de mesures
par rapport à la valeur réelle.
Étroitesse de l’accord entre la valeur MOYENNE obtenue à partir d’une large série de
résultats d’essais et une valeur de référence acceptée. (ISO)
La valeur de référence acceptée est la valeur conventionnellement vraie.
Le défaut de justesse résulte des erreurs systématiques.
- "Erreur de justesse" relative :
- déterminer l’erreur moyenne sur l’équation obtenue, caractérisée par la
variance de la régression :
- Erreur de fidélité à 95% (ou intervalle autour de la moyenne dans lequel se trouvent le 95% des valeurs obtenues) :
Etude de corrélation entre le « Comptest-LNTPB » et la mesure de compacité in-situ
RAMANJAKARIMANGA Dina Tsihafoy –Département BTP - Promotion 2008 Page | 118
On prend par exemple le sable limoneux :
70,83% des observations se situent dans l’intervalle [ X ; ± σX] ;
95,83% des observations se situent dans l’intervalle [ X ; ± 2σX] ;
Et 100% des observations se situent dans l’intervalle [ X ; ± 3σX].
On désigne par écart probable d’une variable aléatoire, le nombre ε, tel que la probabilité que
la variable aléatoire s’écarte d’une quantité ε par rapport à son espérance mathématique est
égale à , d’où l’expression :
P(|X - E[X]| ≤ ε) =
Avec E[X] = qui est la moyenne ou espérance mathématique.
Pour la loi de Gauss, cet écart probable est égal à :
ε = σx. (2 ln 2)
L’écart probable définit ainsi l’intervalle] µ - ε, µ + ε [regroupant toutes les valeurs de la
variable aléatoire qui ont plus d’une chance sur deux de se réaliser.
Alors on a : ε = 16,920 pour le limon argilo sableux, l’intervalle est définie par] 15 ,49[ ;
ε = 16,983 pour le sable limoneux,] 27,60[
Nature de sol Erreur de justesse
[%]
incertitude (écart type) [%]
erreur moyenne
[%]
Erreur de fidélité à
95%
Intervalle où se trouve la
compacité à 95% Limon argilo
sableux ±5 4 ±10 ] 15 ; 49[ [25 ; 35]
Sable limoneux ±5 3,5 ±10 ] 27 ; 60[ [35 ; 45]
Tableau n° 26: Tableau récapitulatif des erreurs ainsi calculées
D’après ces résultats, on a vu que les erreurs sont généralement inférieures à 8%, c’est à dire
les erreurs de justesse de l’appareil par rapport au gammadensimètre est égale ±5%, donc on
peut les acceptées. Pour les erreurs moyennes on a ±10%, les erreurs sont encore assez grands
alors on peut les diminuer en modifiant l’appareil par sa taille ou son poids.
Etude de corrélation entre le « Comptest-LNTPB » et la mesure de compacité in-situ
RAMANJAKARIMANGA Dina Tsihafoy –Département BTP - Promotion 2008 Page | 119
0n va présenter dans les figures ci-après les deux abaques vierges qu’on va utiliser lors de la
détermination de la compacité à l’aide du Comptest LNTPB.
Matériaux de type I : Limon argilo-sableux « L.A.S » (provenance : aménagement
tarmac et bretelle Ivato Aéroport)
LPC HRB GTR
Sable argileux (SC) Sols argileux de A-6 à A-7 Sables fins argileux (A2)
La courbe a pour équation (ζ) : N=4,02 10+7 e+0,16C
Le coefficient de corrélation est égal à 0,04
Figure 21: Abaque vierge pour la détermination de la valeur de compacité in situ pour le sol limon argilo-
sableux
(ζ)
Etude de corrélation entre le « Comptest-LNTPB » et la mesure de compacité in-situ
RAMANJAKARIMANGA Dina Tsihafoy –Département BTP - Promotion 2008 Page | 120
Matériaux type II: sable limoneux « S.L » (provenance : chantier d’Ambohiboahangy
Ambohimalaza du PK 0+000 à PK 2+420)
LPC HRB GTR
Limon et sol organique peu
plastique (Lp, Op)
Sable limoneux (A-2-4) Limon peu plastique (A1)
La courbe a pour équation (ζ) : N=1,77 10-05 e+0, 57C
Le coefficient de corrélation est égal à 0,12
Figure 22: Abaque vierge pour la détermination de la compacité in situ pour le sol sable limoneux.
Etude de corrélation entre le « Comptest-LNTPB » et la mesure de compacité in-situ
RAMANJAKARIMANGA Dina Tsihafoy –Département BTP - Promotion 2008 Page | 121
CONCLUSION [III]
Comme nous avons dit au début de l’étude, cette méthode, basée sur la corrélation entre « N »
le nombre de coups par le Comptest LNTPB et « C » la compacité in situ par le
gammadensimètre, cherche à répondre à l’impératif de délai de réponse des contrôles. Au
cours des étalonnages portant sur des sols limon argilo-sableux rougeâtre, des sable limoneux
jaunâtre, nous avons constaté que les valeurs de K et de A de la courbe de corrélation (ζ), qui
est de la forme générale (ζ) : N = K AC, ne sont pas les mêmes.
Pour le limon argilo sableux (ζ) : N=4,02 10+7 e+0,16C
Pour le sable limoneux (ζ) : N=1,77 10-05 e+0, 57C
Pour d’autre type de sol, on doit avoir une autre équation de la courbe, mais pour pouvoir
déterminer les autres courbes correspondant à ces types il faudrait effectuer un complément
d’étude qui nécessite beaucoup de temps pour permettre de tirer des conclusions plus précises
sur la validité de cette méthode.
On a choisit de faire l’étalonnage par la méthode au gammadensimètre à raison de sa rapidité
car les autres méthodes nécessitent beaucoup de temps.
Les abaques de détermination qui sont vierges seront dans l’annexe.
Cette méthode est destinée pour les contrôles de compactage des remblais ou assises des
chaussées en sols fins.
Un tableau est donné ci-après indiquant le domaine d’application de chaque méthode.
Méthodes Eléments > 20mm
> 25%
Eléments > 20mm
<25%
Eléments > 20mm
<25%
Φmax>600mm Φmax<600mm Φmax>5mm Φmax<5mm
Au sable X X X
Au densitomètre à
membrane
X X
Au carottier X
Au gammadensimètre X X
Comptest LNTPB X X
Tableau n° 27 : Le domaine d’application de chaque méthode de contrôle.
Etude de corrélation entre le « Comptest-LNTPB » et la mesure de compacité in-situ
RAMANJAKARIMANGA Dina Tsihafoy –Département BTP - Promotion 2008 Page | 122
CONCLUSION GENERALE
Les ingénieurs ont pour tâche d’améliorer les conditions de travail et prévoir les évolutions
futures. D’une part ils recherchent tous les moyens pour faciliter la méthode utilisée pour
aider les constructeurs ou les laboratoires dans leur travail. D’autre part, ils cherchent des
méthodes le plus rapide possible et moins couteux.
Au terme de cette étude c’est très utile de savoir faire l’identification de sol afin de les
classifier. C’est une première base de connaissance en géotechnique. Ensuite, nous avons
choisi de décrire tous les méthodes de vérification de compactage in situ déjà existé. Ce qui
conduit au choix de la méthode de vérification par gammadensimètre à raison de sa rapidité.
Au final, on dispose de nouvelle méthode pour aider les laboratoires dans leur travail. Cette
méthode trouve son intérêt dans le grand chantier de terrassement et dans l’exécution du
remblai.
Alors la mesure de compacité à l’aide d’un « Comptest LNTPB », qui fait l’objet de ce
présent mémoire, est beaucoup plus rapide de son utilisation et ne nécessite pas des personnes
qualifiés. En revanche, elle n’est applicable qu’à des matériaux de dimension inférieure à 20
mm.
D’après les résultats obtenus sur chantier qu’on a effectué, nous avons une analyse statistique
qui conduit à déterminer la corrélation entre les mesures de compacité « C » et le nombre de
coups « N » par le Comptest LNTPB. Cette corrélation est présentée sous forme d’une courbe
d’équation : N= K AC avec K et A varie selon la nature du sol à étudier.
Cet ouvrage constitue une première approche de l’étude lors de la préparation de ce mémoire
de fin d’étude. Une recherche plus fondamentale et approfondie sera indispensable pour la
poursuivre qui nécessite une étude à moyen ou à long terme.
En conclusion, le présent mémoire nous permet d’acquérir de nombreuses connaissances qui
sont si nécessaires et utiles pour notre vie professionnelle.
Etude de corrélation entre le « Comptest-LNTPB » et la mesure de compacité in-situ
RAMANJAKARIMANGA Dina Tsihafoy –Département BTP - Promotion 2008 Page | 123
BIBLIOGRAPHIE
[1]. Alain BRETTE .Fascicule de cours. Lycée Pierre Caraminot 19300 EGLETONS ;
[2]. Bulletin de liaison des laboratoires des ponts et chaussées. Contrôle de compactage
des remblais et les assises de chaussées (N°17), janvier- février 1966, p. 2-1 à 2-24.
[3]. CASSAN M. (1978). Les essais in-situ en mécanique des sols. Tome 1. Réalisation
et interprétation ;
[4]. COLLAS J & HAVARD M (Eyrolles 1983). Guide de géotechnique – Lexique et
essais ;
[5]. Cours de mécanique des sols: Ecole Supérieur Polytechnique d’Antananarivo
(E.S.P.A) ;
[6]. Ch SCHÖN(1965). Classification géotechnique des sols basée sur la classification
USCS. Bulletin de liaison des Laboratoires routiers, n° 16, pp. 3-5 à 3-16 nov.-déc.
[7]. F. Schlosser (1992/97). Eléments de mécanique des sols. Editeur Presses de I'ENPC;
[8]. GÉOTECHNIQUE (1999). Recueil de normes - tome 1 : Essais en laboratoire -
tome 2 : Essais sur site - tome 3 : Justification des ouvrages. Exécution des travaux.
Editeur AFNOR;
[9]. G.OLIVAN & Guy SANGLERAT (1963). Problème pratiques des mécaniques des
sols et fondation. Tome 2. 2è édition, Dunod, Paris, 268p ;
[10]. G. OLIVAN (1984). Structure des sols, mécanique des sols. PP 14 – 33 : Cours de
l’école national des travaux publics de l’Etat (ENTPE) Lyon-France ;
[11]. HERINAUX. Cours de statistique.
[12]. H. CAMBEFORT . Géotechnique de l’ingénieur : Reconnaissance des sols ;
[13]. Jacques DUPONT (VIBREUX). Statistique
Etude de corrélation entre le « Comptest-LNTPB » et la mesure de compacité in-situ
RAMANJAKARIMANGA Dina Tsihafoy –Département BTP - Promotion 2008 Page | 124
[14]. J. COSTET & Guy SANGLERAT (1975). Cours pratique de mécanique des sols.
Tome 2. 2è édition, Dunod, Paris, 352p ;
[15]. LCPC-SETRA (1992). Réalisation des remblais et des couches de forme. Guide
technique. Fascicule 1 : Principes généraux, 98 p. Fascicule 2 : Annexes techniques,
101 p. Laboratoire central des ponts et chaussées, Paris et Service d’études
techniques des routes et autoroutes, Bagneux ;
[16]. Recommandation pour les terrassements routiers (n°1, n°2, n°3, n°4) 1976-1980 ;
[17]. R.D. Holtz, W.D. Kovacs (1991). Introduction à la géotechnique. Editeur Ecole
Polytechnique de Montréal;
[18]. YORO (G.), GODO (G.), (1990). Les méthodes de mesure de la densité apparente.
Analyse de la dispersion des résultats dans un horizon donné. Cah. Orstom, sér.
Pédol.,Vol. XXV, n° 4, 1989-1990 : 423-429. 370 Cah. Orstom, sér. Pédol, vol.
XXVII, n° 2, 1992: 365-372.
Etude de corrélation entre le « Comptest-LNTPB » et la mesure de compacité in-situ
RAMANJAKARIMANGA Dina Tsihafoy –Département BTP - Promotion 2008 Page | I
ANNEXES
Etude de corrélation entre le « Comptest-LNTPB » et la mesure de compacité in-situ
RAMANJAKARIMANGA Dina Tsihafoy –Département BTP - Promotion 2008 Page | I
ANNEXE 1: Exemple d’une fiche du procès verbal pour l’analyse granulométrique par tamisage.
Figure 23: fiche du procès verbal de l’analyse granulométrie par tamisage
Etude de corrélation entre le « Comptest-LNTPB » et la mesure de compacité in-situ
RAMANJAKARIMANGA Dina Tsihafoy –Département BTP - Promotion 2008 Page | II
ANNEXE 2: Exemple d’une fiche du procès verbal pour l’analyse granulométrique par sédimentométrie.
Figure 24: titre d'exemple d'un procès verbal d'un essai granulométrie par sédimentométrie
ANNEXE 3: Exemple d’une fiche du procès verbal pour la limite d’Atterberg.
Etude de corrélation entre le « Comptest-LNTPB » et la mesure de compacité in-situ
RAMANJAKARIMANGA Dina Tsihafoy –Département BTP - Promotion 2008 Page | III
Figure 25:exemple d'un procès verbal de ladétermination des limites d'Atterberg
ANNEXE 4: Exemple d’une courbe Proctor.
Etude de corrélation entre le « Comptest-LNTPB » et la mesure de compacité in-situ
RAMANJAKARIMANGA Dina Tsihafoy –Département BTP - Promotion 2008 Page | IV
Figure 26: exemple d’un procès verbal de la courbe Proctor
Etude de corrélation entre le « Comptest-LNTPB » et la mesure de compacité in-situ
RAMANJAKARIMANGA Dina Tsihafoy –Département BTP - Promotion 2008 Page | V
ANNEXE 5: SCHEMA D’UN DENSITOMETRE A SABLE
Figure 27 : Schéma du cône à sable
Photo 15: Photo du cône à sable
Etude de corrélation entre le « Comptest-LNTPB » et la mesure de compacité in-situ
RAMANJAKARIMANGA Dina Tsihafoy –Département BTP - Promotion 2008 Page | VI
ANNEXE 6: SCHEMA D’UN DENSITOMETRE A MEMBRANE
Figure 28: schéma d’un densitomètre à membrane
Etude de corrélation entre le « Comptest-LNTPB » et la mesure de compacité in-situ
RAMANJAKARIMANGA Dina Tsihafoy –Département BTP - Promotion 2008 Page | VII
ANNEXE 7: METHODE DE CALCUL POUR LA DETERMINATION DE LA COURBE DE
CORRELATION
3) Coefficient de corrélation
Dans le plan OXY, on a des nuages des points.
Le coefficient de corrélation ρ est le pourcentage linéaire de ces points.
− Si ρ=1, les nuages des points constituent relativement une ligne ;
− Pour ρ<1, cela indique que quelque pourcentage des points se situent dans la
limitrophe de la ligne.
D’une manière quantitative :
− 0,87 : les nuages de point peuvent s’ajuster à une droite appelée « Droite de
régression ». On dit que l’ajustement est linéaire ;
− 0 < ρ< 0,87 : les points s’ajustent par une courbe, soit en puissance soit en
exponentiel. Il s’agit d’un ajustement non linéaire ;
− -1 < ρ<0 : on prendra la valeur absolue du coefficient de corrélation ρ, alors
l’ajustement ne change pas.
Pour l’ajustement linéaire, Il consiste à déterminer une droite (D) qui sera aussi proche que
possible des nuages des points observés. Pour cela on utilise la méthode des moindres carrés.
4) Droites d’ajustement
a) Ajustement linéaire
On a un ajustement linéaire dans le cas où l’ajustement des nuages des points s’effectuent
linéairement, cas où ρ est compris ou égal entre à 1 et 0,87.
Il consiste à déterminer une droite (D) qui sera aussi proche que possible des nuages des
points observés. Pour cela on utilise la méthode des moindres carrés.
L’équation de la droite de régression est de la forme : Y= aX+b.
Ainsi la droite de régression a pour équation:
Y = 2 2
XY XY
X X
X Y Xσ σσ σ
+ −
Etude de corrélation entre le « Comptest-LNTPB » et la mesure de compacité in-situ
RAMANJAKARIMANGA Dina Tsihafoy –Département BTP - Promotion 2008 Page | VIII
Représentation de la droite de régression sur DY/X
La droite de régression se trouve sur le plan OXY qui sera représenté comme suit :
Figure 29: Représentation de la droite de régression
L’équation de la droite de régression est de la forme : Y= aX+b.
Par l’utilisation de la méthode des moindres carrés, les coefficients a et b seront :
Ainsi la droite de régression a pour équation:
Y = 2 2
XY XY
X X
X Y Xσ σσ σ
+ −
Cette droite est appelée « droite de régression de Y en X »
Avec :
X : La valeur de la moyenne des abscisses Xi ;
Y : La valeur de la moyenne des ordonnées Yi ;
σ : l’écart-type :
22
1
22
1
1
1
1
1
n
X ii
n
Y ji
n
XY i ji
X Xn
Y Yn
X Y XYn
σ
σ
σ
=
=
=
= −
= −
= −
∑
∑
∑
2 2
cov( , ) XY
X X
X Ya
b Y aX
σσ σ
= = = −
Etude de corrélation entre le « Comptest-LNTPB » et la mesure de compacité in-situ
RAMANJAKARIMANGA Dina Tsihafoy –Département BTP - Promotion 2008 Page | IX
b) Ajustement non linéaire
Pour analyser simultanément les valeurs de plusieurs propriétés d’un même sol, on fait en
général l’hypothèse que les relations cherchées sont linéaires. Cette hypothèse n’exclut pas
l’existence de relations de type non linéaire entre les propriétés du sol : les variables aléatoires
liées par des relations linéaires peuvent être des fonctions non linéaires des propriétés du sol
(logarithmes, fonctions puissances, exponentielles, etc.), ce qui donne une grande souplesse à
ce type d’analyse linéaire.
On dit que l’ajustement est non linéaire dans le cas où l’ajustement de nuage des points ne
s’apparente pas à une droite dont le coefficient de corrélation ρ est compris entre 0 à 0, 87.
L’ajustement sera une courbe soit en exponentiel soit en puissance, qui s’étude comme suit :
Ajustement en exponentiel
Pour l’ajustement en exponentiel les nuages des points se présentent comme suit :
Figure 30: courbe pour l'ajustement en exponentiel
L’exponentiel est définie par l’équation : Y = KAX
De ce fait, on commence à ajuster linéairement LnYi en Xi. Et on obtient la droite de
régression Y= aX +b.
Pour se faire on remplace Y par LnY.
Ainsi :
Y = aX be +
Donc :
Etude de corrélation entre le « Comptest-LNTPB » et la mesure de compacité in-situ
RAMANJAKARIMANGA Dina Tsihafoy –Département BTP - Promotion 2008 Page | X
Y = ( )a X be e
Y = K AX
Avec : K = eb ;
A = ea
Ajustement en puissance
C’est le cas où les nuages des points se présentent comme la figure ci-dessous :
Figure 31: Courbe pour l'ajustement en puissance
La puissance est définie par l’équation Y= C Xa.
Dans ce cas, il suffit d’ajuster le caractère LnYi en LnXi, après le calcul on obtient la droite
de régression :
LnYi = a LnXi + b
LnYi aLnXi be e +=
Yi = Xa eb
Yi = C Xia
Avec C = eb
5) Procédure de calcul :
a) Détermination de ρ : coefficient de corrélation
Soient :
Xi : les nombres de coups par le COMPTEST ;
Etude de corrélation entre le « Comptest-LNTPB » et la mesure de compacité in-situ
RAMANJAKARIMANGA Dina Tsihafoy –Département BTP - Promotion 2008 Page | XI
Yi : la compacité par le gammadensimètre.
Considérons donc l’échantillon d’un couple de deux variables X et Y :
(x1, y1), (x2, y2), …, (xn, yn). On appelle covariance de cet échantillon la valeur :
1
1cov( , ) ( )( )
n
i ii
X Y X X Y Yn =
= − −∑
Le coefficient de corrélation est alors défini par :
cov( , )
( , ) XY
X Y X Y
X YX Y
σρσ σ σ σ
= =× ×
Où σx et σy sont les écarts-types des variables x et y.
Avec :
1
1
n
ii
n
ii
XX
n
YY
n
=
=
=
=
∑
∑
22
1
22
1
1
1
1
1
n
X ii
n
Y ji
n
XY i ii
X Xn
Y Yn
X Y XYn
σ
σ
σ
=
=
=
= −
= −
= −
∑
∑
∑
Conditions :
� Si 0,87ρ ≥ : on a un ajustement linéaire, alors les nuages des points s’ajuste en une
droite d’équation : Y = a X + b
2 2XY XY
X X
Y X Y Xσ σσ σ
= + − (C’est la droite d’ajustement)
Etude de corrélation entre le « Comptest-LNTPB » et la mesure de compacité in-situ
RAMANJAKARIMANGA Dina Tsihafoy –Département BTP - Promotion 2008 Page | XII
� Si 0,87ρ < : l’ajustement sera non linéaire c'est-à-dire que les nuages des points
s’ajustent à une courbe, pour cela on ajuste linéairement les coordonnées des points
suivants :
22
1
22
1
1
1
1( )
1( )
n
X ii
n
Y ji
n
XY i ii
X Xn
LnY Yn
X LnY XYn
σ
σ
σ
=
=
=
= −
= −
= −
∑
∑
∑
et
1
1
n
ii
n
ii
XX
n
YY
n
=
=
=
=
∑
∑
D’où la droite de régression.
� Si on a un ajustement en exponentiel :
2 2X Y X Y
X X
L n Y X Y Xσ σσ σ
= + −
2 2XY XY
X X
X Y X
Y e
σ σσ σ
+ −
=
XY K A= × (C‘est l’équation de la courbe d’ajustement à tendance exponentiel)
Avec :2
X Y
X
Y X
K e
σσ
−
=
2X Y
XA e
σσ
=
Etude de corrélation entre le « Comptest-LNTPB » et la mesure de compacité in-situ
RAMANJAKARIMANGA Dina Tsihafoy –Département BTP - Promotion 2008 Page | XIII
� Si on a un ajustement en puissance :
2 2X Y X Y
X X
L n Y L n X Y Xσ σσ σ
= + −
2 2XY XY
X X
LnX Y X
Y e
σ σσ σ
+ −
=
( )ELnX Y EXY e e −= ×
D’où :
EY K X= ×
Avec :
( )
2
Y E X
X Y
X
K e
Eσσ
−=
=
Etude de corrélation entre le « Comptest-LNTPB » et la mesure de compacité in-situ
RAMANJAKARIMANGA Dina Tsihafoy –Département BTP - Promotion 2008 Page | XIV
ANNEXE 8: Fiche d’essai pour l’essai Proctor
Etude de corrélation entre le « Comptest-LNTPB » et la mesure de compacité in-situ
RAMANJAKARIMANGA Dina Tsihafoy –Département BTP - Promotion 2008 Page | XV
ANNEXE 9: : Fiche d’essai pour la limite d’Atterberg
Etude de corrélation entre le « Comptest-LNTPB » et la mesure de compacité in-situ
RAMANJAKARIMANGA Dina Tsihafoy –Département BTP - Promotion 2008 Page | XVI
ANNEXE 10: Fiche pour la détermination de la densité in situ au grain de riz
Etude de corrélation entre le « Comptest-LNTPB » et la mesure de compacité in-situ
RAMANJAKARIMANGA Dina Tsihafoy –Département BTP - Promotion 2008 Page | XVII
ANNEXE 11: photo d'un Comptest LNTPB
Etude de corrélation entre le « Comptest-LNTPB » et la mesure de compacité in-situ
RAMANJAKARIMANGA Dina Tsihafoy –Département BTP - Promotion 2008 Page | XVII
RESUME
Le Comptest LNTPB est destiné à évaluer rapidement le compactage du sol en place. Une
description des composantes de l’équipement et du déroulement des essais est présentée de
même que les domaines d’utilisation du Comptest LNTPB. La procédure d’essai sur chantier
est décrite en précisant les particularités apportées selon les conditions de terrain et les types
de sols ou de matériaux.
Cet ouvrage met l’accent sur les corrélations entre la mesure de compacité en place par le
gammadensimètre et le Comptest LNTPB. Cette étude de corrélation cherche à résoudre
quelques problèmes rencontrés lors de contrôle de compactage en place. Les résultats
provenant de deux expérimentations sont présentés. Le premier cas réfère à de essais effectués
sur des limons argilo sableux et deuxième sur des sables limoneux. On y explique comment
les résultats sont analysés et de quelle façon les utiliser dans la pratique. Enfin, les
orientations au niveau de la recherche et les limites d’utilisation de la méthode sont discutées.
Mots cléfs : Compacité, Comptest LNTPB, in-situ, nombre de coups, corrélation,
ajustement, densitomètre, gammadensimètre, carottier, sol fins.
Etude de corrélation entre le « Comptest-LNTPB » et la mesure de compacité in-situ
RAMANJAKARIMANGA Dina Tsihafoy –Département BTP - Promotion 2008 Page | i
TABLE DES MATIERES
REMERCIEMENTS
SOMMAIRE
NOTATIONS ET SYMBOLES
LISTE DES TABLEAUX
LISTE DES FIGURES
INTRODUCTION
RECONNAISSANCE DES SOLSRECONNAISSANCE DES SOLSRECONNAISSANCE DES SOLSRECONNAISSANCE DES SOLS
Chapitre I- DEFINITIONS ET ELEMENTS CONSTITUTIFS D’UN SOL .............10
I- DEFINITIONS ET DESCRIPTIONS .......................................................................................... 10
II- PARAMETRE DEFINISSANT L’ETAT DU SOL ...................................................................... 11
Chapitre II- LES CARACTERISTIQUES PHYSIQUES DES SOLS ........................13
I- La teneur en eau (Norme à consulter NF P 94-050) ..................................................... 13
II- LE POIDS SPECIFIQUE (γs) Selon la norme NF P 94-054 ........................................... 15
III- ANALYSE GRANULOMETRIQUE (selon NF P 18-560) ................................................ 17
IV- EQUIVALENT DE SABLE (selon NF P 18-598) .............................................................. 23
V- ETUDE DE LA PLASTICITE DU SOL : LIMITE D’ATTERBERG ....................................... 24
VI- VALEUR DE BLEU DE METHYLENE D'UN SOL (Norme à consulter : NF P 94-
068) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….29
Chapitre III- LES ESSAIS DE COMPORTANCE ET PORTANCE DU SOL ...........32
I- ESSAI DE COMPACTAGE : ESSAI PROCTOR (Norme à consulter : NF P 94-093) .... 32
II- ESSAI CBR (Californian Bearing Ratio) ............................................................................... 39
Chapitre IV- DENOMINATION ET CLASSIFICATION DES SOLS .........................43
I- INTRODUCTION ........................................................................................................................... 43
II- DENOMINATION DES SOLS DANS LE DOMAINE GEOTECHNIQUE ........................... 43
III- CLASSIFICATION SELON LES CARACTERISTIQUES GEOTECHNIQUES DES
SOLS ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….49
METHODOLOGIEMETHODOLOGIEMETHODOLOGIEMETHODOLOGIE DEDEDEDE CONTROLE DE COMPACTAGE IN SITUCONTROLE DE COMPACTAGE IN SITUCONTROLE DE COMPACTAGE IN SITUCONTROLE DE COMPACTAGE IN SITU
Chapitre I- GENERALITES ..........................................................................................63
Etude de corrélation entre le « Comptest-LNTPB » et la mesure de compacité in-situ
RAMANJAKARIMANGA Dina Tsihafoy –Département BTP - Promotion 2008 Page | ii
I- INTRODUCTION ........................................................................................................................... 63
II- LES PARAMETRES A CONTROLER : ...................................................................................... 64
Chapitre II- METHODE AU SABLE .............................................................................65
I- OBJET ............................................................................................................................................... 65
II- PRINCIPE DE LA METHODE...................................................................................................... 65
III- APPAREILLAGE ......................................................................................................................... 65
IV- METHODE D’ESSAI ................................................................................................................. 66
Chapitre III- DENSITOMETRE A MEMBRANE ..........................................................70
I- PRINCIPE DE LA METHODE...................................................................................................... 70
II- APPAREILLAGE ............................................................................................................................. 70
III- METHODE D’ESSAI ................................................................................................................. 72
Chapitre IV- METHODE AU CAROTTIER ...................................................................75
I- PRINCIPE ........................................................................................................................................ 75
II- APPAREILLAGE ............................................................................................................................. 75
III- MODE OPERATOIRE ............................................................................................................... 76
IV- RESULTATS ............................................................................................................................... 76
Chapitre V- METHODE AU GAMMADENSIMETRE .................................................77
I- PRINCIPE ........................................................................................................................................ 77
II- APPAREILLAGE ............................................................................................................................. 77
III- MODE OPERATOIRE ............................................................................................................... 79
IV- EXPRESSION DES RESULTATS .......................................................................................... 83
Chapitre VI- CONCLUSION ...........................................................................................84
................................................................................................................... 87
ETUDE DE CORRELATION ENTRE LE «ETUDE DE CORRELATION ENTRE LE «ETUDE DE CORRELATION ENTRE LE «ETUDE DE CORRELATION ENTRE LE « COMPTEST LNTPBCOMPTEST LNTPBCOMPTEST LNTPBCOMPTEST LNTPB » ET LA » ET LA » ET LA » ET LA
MESURE DE COMPACITE A L’AIDE D’UN GAMMADENSIMETREMESURE DE COMPACITE A L’AIDE D’UN GAMMADENSIMETREMESURE DE COMPACITE A L’AIDE D’UN GAMMADENSIMETREMESURE DE COMPACITE A L’AIDE D’UN GAMMADENSIMETRE .......... 87
Chapitre I- COMPTEST LNTPB ..................................................................................88
I- OBJECTIFS ET SES AVANTAGES ............................................................................................ 88
II- PRINCIPE DE L’ESSAI ................................................................................................................ 88
III- APPAREILLAGE ......................................................................................................................... 90
IV- PROCEDURE D’ESSAI ............................................................................................................ 95
V- PRESENTATION DES RESULTATS D’ESSAI ........................................................................ 96
Chapitre II- ETUDE DE CORRELATION ....................................................................97
I- OBJECTIFS ..................................................................................................................................... 97
Etude de corrélation entre le « Comptest-LNTPB » et la mesure de compacité in-situ
RAMANJAKARIMANGA Dina Tsihafoy –Département BTP - Promotion 2008 Page | iii
II- PROCEDURE D’ETUDE DE CORRELATION .......................................................................... 97
Chapitre III- PRESENTATION DES RESULTATS ................................................... 110
CONCLUSION ................................................................................................................. 119
CONCLUSION GENERALE ................................................................................................ 122
BIBLIOGRAPHIE
ANNEXES
RESUME
TABLE DES MATIERES
Etude de corrélation entre le « Comptest-LNTPB » et la mesure de compacité in-situ
RAMANJAKARIMANGA Dina Tsihafoy –Département BTP - Promotion 2008 Page | i
Nom et Prénoms : RAMANJAKARIMANGA Dina Tsihafoy
Téléphone : 033 14 029 48
Adresse: Lot II N 155 Analamahitsy Antananarivo 101
Titre de mémoire : « Etude de corrélation entre le Comptest LNTPB et la mesure de compacité in situ »
Nombre de page : 122
Nombre de figure : 31
Nombre de tableaux : 27
Nombre de photo : 15
Nombre d’annexe : 11
RESUME
Le Comptest LNTPB est destiné à évaluer rapidement le compactage du sol en place. Une
description des composantes de l’équipement et du déroulement des essais est présentée de
même que les domaines d’utilisation du Comptest LNTPB. La procédure d’essai sur chantier
est décrite en précisant les particularités apportées selon les conditions de terrain et les types
de sols ou de matériaux.
Cet ouvrage met l’accent sur les corrélations entre la mesure de compacité en place par le
gammadensimètre et le Comptest LNTPB. Cette étude de corrélation cherche à résoudre
quelques problèmes rencontrés lors de contrôle de compactage en place. Les résultats
provenant de deux expérimentations sont présentés. Le premier cas réfère à de essais effectués
sur des limons argilo sableux et deuxième sur des sables limoneux. On y explique comment
les résultats sont analysés et de quelle façon les utiliser dans la pratique. Enfin, les
orientations au niveau de la recherche et les limites d’utilisation de la méthode sont discutées.
Mots cléfs : Compacité, Comptest LNTPB, in-situ, nombre de coups, corrélation,
ajustement, densitomètre, gammadensimètre, carottier, sol fins.
Encadreur : Monsieur RAKOTOARISON Pierre Donat Guy





















































































































































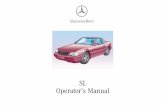

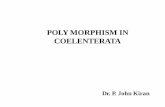
![Microcalorimetric Investigation of DNA, poly(dA)poly(dT) and poly[d(AC)]poly[d(GT)] Melting in the Presence of Water Soluble (Meso tetra (4 N oxyethylpyridyl) Porphyrin) and its Zn](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/631f222063ac2c35640aaab6/microcalorimetric-investigation-of-dna-polydapolydt-and-polydacpolydgt.jpg)