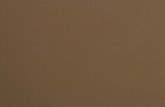Ramadhan et alimentation, le cas des femmes diabétiques d’Oran,
Transcript of Ramadhan et alimentation, le cas des femmes diabétiques d’Oran,
1
Titre : Ramadhan et alimentation : le cas des femmes diabétiques à Oran (Algérie)
Ramadhan and food: diabetic women in Oran (Algeria)
Résumé :
Cet article repose sur une étude qui a été menée à Oran (Algérie) durant le mois de Ramadhan. L‟enquête, de
type qualitatif a consisté à faire des entretiens semi-directifs, approfondis et de longue durée avec des femmes
diabétiques au sein de leurs domiciles. L‟objectif étant de tenter de comprendre les logiques socio-sanitaires qui
président à leurs comportements alimentaires durant le mois de Ramadhan.
La pratique du jeûne durant le mois de Ramadhan constitue dans la religion musulmane une obligation aussi bien
qu‟une valeur socio-culturelle très importante. Au vu des résultats de notre enquête, malgré les risques encourus
pour leur santé, les patientes diabétiques continuaient de jeûner et adoptent une attitude fluctuante vis-à-vis des
prescriptions médicales, particulièrement en ce qui concerne leur alimentation. En effet, le régime alimentaire
préconisé par les médecins fait souvent l‟objet d‟irrégularités dans sa mise en œuvre. Ces patientes vivent une
situation de désarroi, liée aux contraintes sociales auxquelles elles font face, mais aussi vis-à-vis des
prescriptions médicales et de l‟obligation religieuse de jeûner.
Mots clefs : diabète, alimentation, Ramadhan, contraintes sociales, stigmate, femmes, Oran (Algérie).
Abstract:
This article bases on a study which was led to Oran (Algeria) during the month of Ramadhan. The investigation,
of qualitative type consisted in making semi-directive, deepened and long-term conversations with women
diabetics within their places of residence. The objective is to try to understand the logics socio sanitary, which
preside over their eating habits, during the month of Ramadhan. The practice of the fast, during the month of
Ramadhan constitutes in the Moslem religion, an obligation as well as an important socio cultural value. In view
of the results of our investigation, in spite of the risks incurred for their health, the diabetics continued to fast and
adopt a fluctuating attitude towards the prescriptions, particularly as regards their food. In Indeed, the diet
recommended by the doctors is often the object of irregularities in its stake in work. They live a situation of
confusion, bound to the social constraints which they face, medical prescriptions and religious obligation to fast.
Keywords: diabetes, food, Ramadhan, social constraints, stigma, women, Oran (Algeria).
Introduction
Le diabète est une maladie caractérisée par une hyperglycémie chronique (hausse du taux de glucose dans le
sang) résultant d‟un défaut de sécrétion d‟insuline (hormone produite par le pancréas) ou de son action ou alors
de ces deux anomalies associées. Il se présente principalement sous deux formes :
Le diabète de type 1 (ou diabète juvénile) : il touche les personnes les plus jeunes et est caractérisée par une
insulinodépendance. Il provoque une fréquence plus élevée de comas ainsi qu‟une installation plus rapide des
complications. Le patient doit s‟astreindre à un régime alimentaire et à des injections pluriquotidiennes
d‟insuline.
Le diabète de type 2 (ou diabète obèse) : il affecte les personnes relativement âgées. Non insulinodépendant, il
2
est caractérisé par une évolution généralement lente des complications. Un régime pauvre en sucre et des
antidiabétiques oraux sont préconisés afin d‟équilibrer la glycémie.
Les principales complications de cette pathologie peuvent être d‟ordre ophtalmologique, cardiovasculaire et
rénal.
Le diabète est considéré comme étant l‟une des causes de décès les plus importantes dans le monde. Selon
l‟Organisation Mondiale de la Santé (O.M.S.), il y aurait, en 2009, plus de 180 millions de diabétiques dans le
monde (Boukraâ, 2009, p17). Un chiffre d‟autant plus effarant qu‟on prévoit le double à l‟horizon de 2030.
L‟O.M.S. estime que le taux de mortalité dû au diabète va augmenter de 50% durant la prochaine décade si
aucune mesure urgente n‟est prise. Véritable épidémie, il est responsable de plus de décès que le V.I.H. en tuant
une personne toutes les dix secondes.
Impulsée par le développement socio économique et les progrès de la médecine, l‟Algérie traverse depuis deux
décennies une transition sanitaire révélée par plusieurs études. En effet, un accroissement de l‟espérance de vie,
synonyme d‟un vieillissement progressif de la population, s‟est accompagné d‟un net recul des maladies
infectieuses contre une augmentation des pathologies chroniques non transmissibles (TAHINA1, 2007, p3). La
3ème
étude2 nationale des indications multiples, réalisée en 2008, a révélé qu‟au classement des maladies
chroniques, le diabète occupe la 2ème
place derrière l‟hypertension artérielle, le nombre de personnes diabétiques
est en progression, passant de 0,3% chez les sujets âgés de moins de 35 ans à 4,1% chez les 35-59ans et 12,5%.
En outre, les femmes sont les plus exposées que les hommes avec respectivement un taux de 2, 3% contre 1, 9%,
notamment après l‟âge de 35 ans. Celles âgées de 60ans ou plus représentent 14,1% contre 11% chez les
hommes pour la même catégorie d‟âge (Boukraâ, 2009, p17). Maladie insidieuse, elle ne se déclare qu‟à partir
de la cinquième ou de la septième année de dérèglement métabolique. Génétiquement transmissible, les
personnes ayant des antécédents familiaux y sont fortement exposées.
Face à l‟impossibilité de guérir la maladie, la prévention, qui inclut l‟action sur les facteurs de risque ainsi que le
dépistage représente le principal pivot d‟une politique que visent les spécialistes de la question (ministère de la
santé, médecins généralistes et spécialistes, etc.). L‟approche médicale centrée sur la réalité organique de la
pathologie du diabète, se focalise sur l‟équilibre de la glycémie et sur la prévention des complications. Elle
prend peu ou prou en considération la dynamique sociale qui imprègne profondément la maladie. De nombreux
professionnels de la santé, que nous avons rencontrés tout au long de nos investigations, incriminent de fait, la
non observance des patients, qualifiant leur comportement d‟indiscipliné et d‟irrationnel. Or L‟application de la
norme médicale ne dépend pas toujours de la seule volonté du diabétique, souvent confronté au regard des
« autres », aux contraintes imposées par la norme sociale du réseau familial, de voisinage ou professionnel, etc.
(Mebtoul, 2003, p258).
De nombreuses études en sciences sociales ont porté un regard critique sur l‟approche médico-centrée de
1 Une enquête nationale, nommée T.A.H.I.N.A. (transition and health impact in north Africa) a été menée dans le
cadre global d‟un projet de recherche sur la transition épidémiologique et son impact sur la santé en Afrique du
nord. Elle a été réalisée en 2005 par l‟I.N.S.P. (l‟institut national de santé publique d‟Alger) en collaboration
avec l‟union européenne dans 16 wilayas (départements). 2 Cette étude complémentaire à celles réalisées en 1995, 2000, 2003, et 2006, en collaboration avec le ministère
de l a santé, a concerné un échantillon de 30 000 familles de différentes régions du pays.
3
l‟observance. Trostle (1988) et Lerner(1997), suite à leurs analyses historiques sur le concept d‟observance (ou
de compliance), ont souligné que ce dernier reflétait l‟exercice du monopole professionnel d‟un pouvoir et d‟un
contrôle dans le domaine de la santé et des soins et renvoie à une idéologie de l‟autorité des médecins et des
professionnels de la santé. Ainsi la non-observance est étiquetée de déviance et est porteuse d‟un jugement
normatif de la part d‟une médecine fondée sur des données validées de la science. Mais on oublie souvent que le
bricolage, les doutes et les erreurs sont aussi l‟apanage de la pratique médicale qui se trouve confrontée en
permanence à l‟incertitude devant les limites des connaissances médicales, particulièrement pour le diabète qui
fait l‟objet de diverses controverses entre médecins (Mebtoul, 2003, p254).
Dans la perspective médicale de la prise en charge du diabète, le respect du régime alimentaire revêt une
dimension importante. En effet, l‟administration du traitement médical, qu‟il s‟agisse de l‟insuline ou
d‟antidiabétiques oraux est tributaire d‟une alimentation hypocalorique, réduite en lipides saturés et en sucres
simples. Cette approche rejoint dans son optique, l‟éducation nutritionnelle conventionnelle dont l‟objectif est la
modification des comportements liés à l‟alimentation. A ce propos, un intérêt grandissant est suscité pour l‟étude
des pratiques alimentaires. Ceci est en partie lié au risque nutritionnel et sanitaire apparu au cœur des débats sur
les questions alimentaires contemporaines, particulièrement depuis mai 2004, année de l‟approbation par l‟OMS
de sa stratégie mondiale pour l‟alimentation, l‟exercice physique et la santé (Imbert, 2008, p9).
Des études réalisées, de par le monde, ont montré que, malgré les nombreux programmes d‟éducation et de
sensibilisation à une saine alimentation, force est de constater que le bilan reste peu convaincant. Le faible
impact des compagnes de prévention et de sensibilisation montre bien qu‟au-delà de sa dimension bio-
nutritionnelle, l‟alimentation intègre d‟autres préoccupations qui sont d‟ordre socio culturel (Calandre, 2002,
p92). La limite de l‟éducation nutritionnelle est qu‟elle impute d‟emblée aux acteurs des comportements
irrationnels sans tenter de saisir leur rationalité. Elle est basée sur l‟hypothèse selon laquelle l‟ignorance et le
manque de connaissances diététiques sont à incriminer dans les mauvaises conduites alimentaires et que
l‟acquisition d‟un savoir et d‟un savoir-faire est à même d‟aboutir à une amélioration de la situation
nutritionnelle Calandre, 2002). Elle met ainsi en position dominante les critères de santé et de nutrition, tout en
éclipsant les autres fonctions de l‟alimentation, hédonique, sociale et culturelle. Ces dernières ne sont reconnues
que comme des obstacles à la satisfaction des besoins nutritionnels. Or l‟alimentation n‟est pas réductible à la
nutrition ; elle n‟est pas seulement la satisfaction d‟un besoin physiologique, elle est un acte complexe qui
renvoie à des réalités psychologiques, sociales et culturelles. (Lahlou, 1998). Le savoir scientifique légitime
diffusé par les structures hiérarchiques peut se heurter à des résistances et des contestations. Et« ce n‟est pas
parce que les gens savent, qu‟ils font nécessairement»3 (Lahlou, 1998). Perretti-Watel (2001) le montre bien,
lorsqu‟il parle de résistance et de contestation face à la diffusion du savoir scientifique. Ce cas de figure est
illustré par Calandre, (2002), lorsqu‟elle parle de paradoxe américain en évoquant les États-Unis, pays où la
culture nutritionnelle est la plus diffusée et qui enregistre le plus important taux d‟obésité.
3 Cité dans Calandre N, 2002, alimentation, nutrition et sciences sociales, concepts, méthodes pour l‟analyse des
représentations et pratiques nutritionnelles des consommateurs, mémoire (paru en ligne) de recherche pour
l‟obtention du DEA en économie du développement agricole, agroalimentaire et rural, sous la direction de Lucie
Sirieix et Nicolas Bricas.
4
L‟alimentation, à travers les pratiques et les représentations, a une dimension sociale qui ne peut se réduire à la
seule quantité de nutriments ingérés. Elle est aussi selon, Garabuau-Moussaoui,(2002), une production sociale et
un système de comportements et de représentations de la vie sociale . Le sociologue de l‟alimentation, Poulain
(2002), abondant dans le même sens, considère que :
« Les hommes ne mangent pas des nutriments mais des aliments cuisinés, combinés entre eux au sein de
préparations culinaires….selon un protocole fortement socialisé »
Le regard socio anthropologique, qui tente de comprendre la complexité de l‟objet aliment, s‟inscrit dans une
logique de refus du jugement de valeur sur les pratiques alimentaires (Mebtoul, 2007). Notre posture tente ainsi
de questionner les logiques sociales déployées par les femmes diabétiques à l‟égard de l‟alimentation, le sens
attribué au régime et les différentes contraintes auxquelles elles font face, particulièrement durant le mois de
Ramadhan. Il nous semble que la compréhension des sens donnés à l‟aliment et au régime est importante avant
de décréter la transformation autoritaire des comportements alimentaires. Car comme le proclamait déjà
Margareth Mead dés 1945 : « avant de chercher à savoir comment changer les habitudes alimentaires [il faut
tout d’abord] comprendre ce que manger veut dire ».
Le jeûne4 du mois de Ramadhan constitue l‟un des cinq
5 piliers de l‟Islam. Il est non seulement une obligation
religieuse mais aussi une valeur socio culturelle très importante. Il constitue un moment privilégié pour les
musulmans algériens, où l‟accent est mis sur le partage et la vie communautaire. Durant cette période des
changements conséquents affectent le mode de vie des familles algériennes. L‟interdiction de manger et de boire
de l‟aube jusqu‟au coucher du soleil impose une modification des horaires des prises médicamenteuses et les
repas sont répartis pendant la nuit sur une durée plus courte (Ababou et al., 2008, p93). En outre le repas servi à
la rupture du jeûne est le plus souvent collectif, copieux et comporte une grande variété de sucreries et de
pâtisseries dites orientales, à l‟exemple de la « Zalabia » et la « Chamia » élaborées à base de miel et très prisées
durant cette période. Devant cet état de fait, les diabétiques éprouvent d‟énormes difficultés à suivre leur
régime. Ainsi la gestion sociale et médicale du diabète, déjà complexe tout au long de l‟année, l‟est encore
davantage pendant le mois de Ramadhan. Les patientes diabétiques avec lesquelles nous nous sommes
entretenues dans notre enquête continuaient d‟observer tant bien que mal le jeûne. En plus de la spécificité de la
gestion du diabète durant le Ramadhan et particulièrement du régime alimentaire, du caractère collectif des repas
et des traditions culinaires s‟ajoutent d‟autres contraintes liées aux conditions économiques. En effet les
diabétiques disent se sentir obligés de jeûner de peur d‟être stigmatisés. Un sentiment de culpabilisation
religieuse semble également être éprouvé du fait de la sacralité du mois de Ramadhan. Ce présent article se
propose d‟analyser les logiques qui sous tendent les comportements alimentaires de femmes diabétiques à Oran,
durant le mois de Ramadhan.
4 Il est stipulé dans le coran comme suit « ô croyants !on vous a prescrit le jeûne (essiyam) comme nous l‟avons
prescrit à ceux d‟avant vous, ainsi atteindrez-vous la piété » (sourate 2, verset 183). 5 Le jeûne du mois de Ramadhan constitue le 4
ème des 5 piliers fondamentaux sur lesquels est bâti l‟islam,
comprenant la profession de foi (croyance en Dieu et en son prophète), la prière (5 fois par jour), l‟aumône
(ezzakat) et le pèlerinage des lieux saints (la Mecque et Médine).durant ce mois, il est strictement interdit de
manger , de boire et d‟entretenir des relations sexuelles, de l‟aube jusqu‟au crépuscule.
5
Approche théorique :
Notre cadre théorique s‟inscrit dans la dynamique de recherche qui a vu depuis l‟avènement des années 80,
l‟adoption de nouveaux paradigmes dans les recherches en sociologie de la santé. Il s‟agit de la perspective
interactionniste, en référence aux travaux d‟Anselm Strauss. Ses travaux ont eu le mérite d‟objectiver les savoirs
profanes déployés par les patients et leurs familles et de mettre en exergue la richesse des dynamiques socio
sanitaires qui sont produites au sein et à l‟extérieur de l‟espace domestique (Mebtoul, 2008,p 82). La démarche
d‟Anselm Strauss nous semble ici particulièrement pertinente dans la mesure où cet auteur appréhende la gestion
de la maladie en termes d‟action. En effet il considère que le malade, acteur incontournable du travail médical,
est un agent réflexif, créatif et actif dans sa gestion quotidienne de la maladie. Il fait face à des contraintes qui
modulent ses actions, sans pour autant être un objet passif soumis à des forces sociales (Strauss, 1992, p12).
Anselm Strauss montre bien que : « les interactionnistes ont porté un grand intérêt aux processus sociaux,
impressionnés qu‟ils avaient été tant par l‟immensité du changement social que par ses potentialités.
Simultanément, ils ont postulé que les êtres humains sont des créatures actives qui modèlent leurs
environnements et leurs futurs, et font face à des contraintes qui pèsent sur l‟action. Ils ont adopté une position
intermédiaire entre une vision du monde sans aucune sorte de contraintes- un monde qui dépendrait entièrement
de la volonté humaine -et la vision d‟un monde structurellement déterministe. » (Strauss, 1992, p 255).
Méthodologie d‟enquête :
Parce qu‟elles ne sont pas en mesure d‟appréhender le sens que les individus donnent à leurs expériences, les
enquêtes quantitatives ne permettent pas de comprendre les logiques d‟action sous-jacentes. En revanche les
recherches qualitatives constituent des outils privilégiés pour appréhender les comportements de manière plus
globale car elles s‟attachent aux dimensions subjectives des situations et des actions. (Chauvin, Parizot, 2005,
p9)
Notre objectif étant de comprendre les logiques qui président aux comportements des diabétiques, l‟approche
qualitative a donc été privilégiée. Elle est basée sur huit entretiens individuels, approfondis, répétés et de longue
durée (entre une heure et demi et deux heures environ) et sur l‟observation fine et détaillée des différents espaces
investis. Ces deux techniques jumelées nous ont en effet parues les mieux adaptées afin de « Relever les
discours et les situations permettant d’accéder aux croyances, aux représentations, aux pratiques et aux
institutions qui donnent sens à une société » (Fassin, 1990, p89).
Ainsi un guide d‟entretien a été élaboré, sous forme d‟un canevas de questions ouvertes. En plus des données
factuelles sur les enquêtées, différents thèmes ont été explorés. En premier lieu, l‟histoire de la maladie a été
abordée, incluant son ancienneté, les représentations relatives à son étiologie et les pratiques thérapeutiques
afférentes. Ensuite le rapport à l‟alimentation, avec l‟entourage familial et sociétal, ainsi qu‟aux éventuelles
complications liées au jeûne du mois de Ramadhan a constitué la trame de fond des questions.
6
Notre enquête s‟est déroulée dans le centre6 de santé de Maraval situé dans la ville d‟Oran. Le médecin
généraliste y exerçant est notre informateur privilégié. Il est chargé du suivi des malades chroniques,
principalement des diabétiques, pour certains de très longue date. Nous avons pu assister aux consultations
générales, pris contact avec les malades pour ensuite prendre rendez-vous pour des entretiens à domicile. Nous
avons interviewé 7 femmes au foyer âgées entre 39 et 65 ans, toutes atteintes du diabète de type 2(ne prenant
que des antidiabétiques oraux), mais dont les caractéristiques socioculturelles étaient très diversifiées. Les
entretiens se sont déroulés pendant le mois de Ramadhan.
Les propos des enquêtées ont été recueillis sur un enregistreur numérique. A la fin de chaque entretien, un
compte rendu général a été élaboré incluant les conditions de sa réalisation et les observations. Le matériel
sonore a ensuite été réécouté à plusieurs reprises et les discours des interviewées ont été traduits de l‟arabe
dialectal et retranscrits en français. L‟interprétation des données s‟est faite par analyse de contenu thématique
des discours.
La constitution exclusive du corpus d‟enquête par des femmes n‟a pas été un choix délibéré. En effet tout au
long de notre présence au centre de santé, elles étaient plus nombreuses à consulter. En outre, et selon une source
confirmée du service de diabétologie relevant du centre hospitalo-universitaire d‟Oran, les femmes seraient les
plus exposées au diabète. Cette caractéristique n‟est pas spécifique à l‟Algérie. En effet, dans quasiment toutes
les régions du monde, il semblerait que les femmes soient les plus touchées par la maladie7 (Henrichs, 2009,
p3).
Nous avons structuré notre article en quatre temps : nous évoquerons tout d‟abord les contraintes économiques.
En effet nos interviewées liaient les difficultés de suivre le régime préconisé à la précarité de leur situation. Dans
un deuxième temps, nous allons montrer comment certaines traditions culinaires et habitudes alimentaires ont un
impact sur les pratiques alimentaires des diabétiques. Dans le troisième point nous appréhenderons comment
l‟alimentation renvoie à des univers de sens aussi variés que le plaisir, la convivialité et la commensalité. Le
dernier point abordera quelques aspects illustrant le dilemme aussi bien médical que religieux que ces femmes
diabétiques rencontrent dans la gestion de leur maladie.
1- Les contraintes économiques :
Le diabète devient de plus en plus une maladie des pauvres. En effet, « contrairement à l‟idée fausse généralisée
selon laquelle le diabète est une condition propre aux riches, ce sont les communautés pauvres qui sont les plus
vulnérables face au diabète et les moins bien équipées pour profiter des soins et des mesures de prévention des
complications du diabète » (Williams ; Riley, 2006, p31). Les difficultés économiques suivies de la dévaluation
du dinar algérien ont provoqué une augmentation significative du prix des aliments de base, notamment des
céréales. L‟étude réalisée en 2006 par le C.E.N.E.A.P8a révélé que 11,1% des ménages algériens sont pauvres,
6 Il s‟agit d‟une polyclinique publique, situé dans un des quartiers résidentiels d‟Oran et comptant parmi les
unités sanitaires de base. 7 Cité dans diabetesvoice, revue éditée par la Fédération Internationale du Diabète, parue en mai 2009, p 3. 8Centre national d‟études et d‟analyses pour la population et le développement.
7
15,2% vivent en milieu rural et 8% dans les centres urbains (Hamadachi, 2009, p1).
Dans les entretiens réalisés, la relation entre le niveau des ressources financières et la consommation alimentaire
est apparue comme un facteur déterminant dans les conduites alimentaires des diabétiques. En effet dans un
contexte marqué par la cherté des produits alimentaires, la composition du panier de provisions reste tributaire
des fluctuations des prix du marché. Cette situation s‟accentue pendant la période de Ramadhan où l‟on assiste
régulièrement à une véritable flambée des prix. Devant cet état de fait, les femmes qui sont des actrices sociales
incontournables dans les pratiques culinaires préparées et conçues dans leur « territoire » représenté par la
cuisine (Mebtoul, 2007,p19) mettent en branle une imagination créatrice afin de concocter le fameux « ftour » du
Ramadhan. Houria a 65 ans. Elle est diabétique depuis 12 ans. Son mari est retraité. Elle a 2 filles mariées et 3
garçons. Deux sont partis en France. Son troisième fils vit avec elle, avec sa femme et son enfant :
« Quand mon fils m’a lu la feuille que lui a remise le médecin, où étaient mentionnés les aliments que je dois
prendre pour mon régime, je ne pouvais qu’en rire. N’est ce pas drôle ! Le régime demande des moyens que je
n’ai pas. Mon fils ne travaille pas et la retraite de mon mari ne peut pas subvenir à tous nos besoins. Le médecin
m’a encore dit hier de faire le régime, mais avec quoi ?avec un million de centimes comment faire…est ce
qu’avec un million on peut acheter les pommes, la viande de bœuf, le poulet, etc. Heureusement qu’on ne paye
pas de loyer, cet appartement, on l’a acheté au début des années quatre vingt à 5millions. Maintenant, on est
obligés d’acheter du riz et de la pomme de terre, que te dire sinon que nous vivons « la situation du pauvre » et
même la pomme de terre qui était le légume par excellence du pauvre, avec laquelle on arrivait à faire la cuisine
sans trop se casser la tête, eh bien ! Elle est devenue par les temps qui courent un luxe, son prix a atteint les
100DA ! Tu te rends compte elle est devenue aussi chère que les fruits sinon plus ! Nous nous ingénions, ma
belle fille et moi à préparer des plats qui soient agréables et suffisants pour tout le monde, surtout en cette
période de Ramadhan. Alors pour ce qui est du régime, c’est une autre paire de manche. Manger des fruits
comme les pommes, de la viande grillée, des légumes, c’est vraiment impossible… Impossible…on nous dit de
faire le régime mais il faut voir comment on vit !! »
Saliha a 39 ans. Elle est diabétique depuis 3 ans. Son mari est instituteur. Elle a 5 enfants. Elle avoue que la paie
de son mari est insuffisante :
« Mon mari n’achète que le strict minimum et il me dit de me débrouiller. Je suis obligée de voir à droite et à
gauche pour réaliser un « ftour » convenable. Je fais la « hrira » pour 2 jours et je ne jette pas les restes, je les
mets au frigo et je les garde pour moi et mes enfants. La Ramadhan est synonyme de dépenses. La paie de mon
mari est de 24.000DA9 en plus de cela, je dois compléter le trousseau de ma fille qui doit se marier
prochainement. J’ai même vendu mes bijoux en or et mon mari n’est pas au courant. Je n’aime pas lui demander
de m’acheter des fruits comme les pommes, j’ai trop honte. Tu sais comment je fais pour me débrouiller ? Je
mets au fur et à mesure des pièces dans la tirelire et dés que je vois qu’il y a assez d’argent, j’achète ce qui
manque pour moi et pour mes enfants et tu sais les petites choses qui manquent demandent plus de frais que les
autres. Il va de soi que je les achète en cachette, mon mari n’en sait rien. Lui, il achète le gros, il fait le marché,
9 Avoisinant les 200 euros.
8
il achète les légumes…Des fois avec 300 DA, j’achète quelques épices, du sel, du vinaigre, etc. Par exemple ce
matin en emmenant ma fille à l’école, j’ai acheté le savon à 50 DA, si je lui dis, il me répondra, qu’il n’a pas. Il
me dit toujours de me débrouiller. Il lui arrive quand même de m’acheter des pommes mais c’est très
occasionnel. Les diabétiques ont besoin de bien manger et de prendre des vitamines. Le régime demande
beaucoup de moyens. Il ne suffit pas de dire aux malades de faire le régime, ce n’est pas aussi facile! La
dernière fois j’étais malade, je ne me sentais pas bien. Quand je suis allée voir le médecin, il m’a dit que j’ai
une carence en calcium et en vitamines, il m’a dit que ce que je mange est pauvre en vitamines, mais comment
faire ? ».
Ces deux illustrations montrent la difficulté de concevoir le régime devant les contraintes liées à la cherté de la
vie. Elles révèlent aussi en filigrane un autre aspect et qui concerne cette primauté que la femme -et plus
particulièrement la mère – accorde à toute la famille : importance du repas familial, préparation du trousseau de
la mariée, et ce au dépend d‟elle-même. Ainsi les pratiques alimentaires et culinaires sont révélatrices de la
construction identitaire des acteurs sociaux comme de leurs relations. Manger, davantage qu‟une question
collective, est au centre de l‟organisation sociale. Les aliments, qui ont un ancrage socioculturel indéniable, sont
porteurs de valeurs, de symboles et du poids de l‟histoire des usages sociaux. L‟alimentation apparait ainsi
comme le socle à partir duquel se développent les identités individuelles qui s‟expriment dans l‟altérité pour
fonder les identités collectives (Hubert, 2000, p27). L‟alimentation en tant que fait social constitue un ensemble
de représentations, savoirs et pratiques qui, s‟affirment dans ses différences par rapport à d‟autres systèmes
alimentaires (Suremain et al., 2006). Nous verrons à présent comment les femmes diabétiques que nous avons
interrogées semblent construire leur rapport à l‟alimentation.
2-Le poids des habitudes alimentaires
Le discours médical préconise de consommer des aliments en se basant sur leurs qualités diététiques. Il laisse
transparaître des jugements de valeur prompts à sanctionner certains comportements comme des aberrations par
rapport à une conception scientifique et idéalisée de l‟aliment, réduit à ses caractéristiques nutritionnelles,
économiques et, à la rigueur organoleptiques (De Garine, 1971, p47). Cette approche est d‟autant plus normative
qu‟il s‟agit d‟un régime prescrit pour une maladie chronique où il est demandé aux diabétiques de se conformer à
un certain nombre d‟exigences basées sur des rations alimentaires réparties dans la journée. Ces dernières
doivent obéir à un certain nombre de règles consistant à manger moins sucré, moins salé et moins gras. Ces
recommandations largement relayées par la biomédecine à l‟échelle planétaire, n‟envisagent le corps que dans
ses dimensions biologiques et physiologiques et font abstraction du sens qui est donné à l‟aliment et aux critères
liés à la place qu‟il occupe au sein de la famille. En effet, les repas qui constituent à la fois un élément capital de
la rythmique régulière des personnes et un rituel, contribuent à forger les habitudes alimentaires (Rivière, 1994,
p8). A ce propos, Fischler (2001) estime que tout ce qui est biologiquement mangeable, ne l‟est pas
culturellement et que pour ainsi dire, chaque culture a sa propre grammaire culinaire.
L‟espace familial, producteur de relations affectives, est aussi le lieu de socialisation par excellence des pratiques
culinaires (Mebtoul, 2007, p19). L‟ancrage social des habitudes et traditions culinaires apparait ainsi comme
déterminant dans les comportements alimentaires des diabétiques. Ces derniers semblent aussi être influencés
9
par cette préférence pour un ou plusieurs aliments fortement valorisés sur le plan symbolique (Rivière, 1994,
p17) à l‟exemple du pain et du couscous. Ces derniers, présents quotidiennement ou occasionnellement sur les
tables algériennes vont à l‟encontre du régime préconisé par les médecins. Il semble difficile selon nos
interlocuteurs de diminuer leur consommation :
« Le médecin nous dit de consommer une baguette de pain en la répartissant tout au long de la journée. Or cette
quantité est insuffisante et je ne peux pas manger sans pain, c’est comme cela. » (Khadîdja, 56 ans diabétique
depuis 20 ans.).
Le pain occupe une place centrale dans notre alimentation quotidienne. En effet, les algériens sont de grands
amateurs de pain, il est présent sur toutes les tables. Sa fabrication relève du sacré car il est considéré comme une
« na‟ma » (un don de dieu). Il symbolise, comme dirait Poulain (2002), la communion des hommes avec le divin
et les hommes entre eux, Appelé communément « el khobz », il accompagne presque tous les plats et
principalement les ragoûts. Trempé délicatement dans la sauce, il absorbe le liquide et aide à saisir les morceaux
de légumes et de viande, jouant ainsi le rôle de la fourchette (Feki, 2000, p 282). Et comme l‟écrivit si bien
l‟anthropologue Claude Rivière(1994) :
« D’un goût agréable à tous, (il) constitue un trait d’union entre les divers plats et fait l’unité de ceux qui le
partagent… Il est symbole de sécurité, non seulement comme base de l’alimentation mais parce qu’il évoque le
fruit du travail, la force investie dans la culture des céréales. ».
Le couscous10
occupe une place de choix dans la gastronomie algérienne. Plat berbère, par excellence, il
symbolise l‟identité alimentaire des populations du Maghreb. Issu d‟une histoire ancestrale, d‟après Annie
Hubert (1995), de nombreux travaux de recherche historique, ont permis de conclure que les Berbères sont à
l‟origine de la création de la cuisson des céréales à la vapeur. Cette méthode novatrice utilisée depuis l‟antiquité,
permet en outre de conserver les valeurs nutritives des aliments ainsi cuits. Il se décline en une multitude de
variantes, selon les régions, les saisons ou les occasions. Couscous ordinaire ou festif, couscous des pauvres ou
des riches, avec ou sans légumes, avec ou sans viande (ou poisson), il est toujours empreint de sacralité, lié à
l‟attribut d‟abondance des céréales, dont il est le produit, mais aussi au roulage, symbole de la multiplicité
bénéfique, selon Bahloul (1983). Associé à l‟hospitalité, à l‟offrande, à la distribution aux pauvres, il est présent
dans les« waâda »11
. On y vient célébrer en communion et dans la liesse, autour d‟un grand couscous, l‟ancêtre
commun, ou rendre hommage à un saint homme vénéré auquel est dédié un mausolée. Se retrouver pour manger
ne se limite pas aux événements heureux. Partagé aussi lors des funérailles, il accompagne les gens venus
exprimer leur compassion et leur douleur, renforçant ainsi les liens familiaux et communautaires. La diversité
de ses recettes, spécifiques à chaque région (et même à chaque village) ne constitue pas moins un synonyme de
10 Selon Gobert (1940), l’étymologie du couscous viendrait du bruit (qui fait « keskes ») produit de la préparation de ses grains, lors d leur passage au tamis. 11 Les waâda ( zerda, lewziaa ou encore timechret) constituent des repas festifs occasionnels pour célébrer les saints spécifiques à chaque région ou seulement partager équitablement la viande issue de l’abattage de moutons ou de bœufs.
10
rassemblement et de partage, dans la mesure où, l‟identité alimentaire de l‟individu se construit dans son rapport
à l‟autre. Ce registre alimentaire présent dans toutes les occasions apparait ainsi comme un fait social total au
sens que lui a attribué Mauss (De Garine, 1991, p 86).
En évoquant avec nos interviewées la question du régime préconisé par le médecin traitant, elles étaient
unanimes à déplorer les 6cuillers12
de couscous, qu‟elles ne devaient pas dépasser :
« Pendant le mois de Ramadhan, j’aime prendre une bonne assiette de couscous avec du petit lait au « shour »,
il n’est pas question de me contenter de ces 6 cuillères. Pour moi c’est sacré je ne peux pas m’en passer ! je sais
que je ne dois pas en prendre, mais le problème, c’est que je n’arrive pas à prendre autre chose à la place du
shour. Pourtant Dieu merci, il y a de tout, j’essaye de réchauffer tel ou tel plat, la sauce au céleri, le tajine aux
haricots, aux raisins secs, mais je n’arrive pas à en manger, « mon cœur se ferme » et je n’ai plus d’appétit,
c’est comme si, on avait mis mon cœur dans un sachet en plastique et enfermé dedans. Je ne te le cache pas,
j’adore me servir ce bol de couscous avec du petit lait tout frais. Je veux changer, mais je n’y arrive pas. J’ai de
plus en plus mal aux jambes, je crois que c’est à cause du couscous. Si seulement je pouvais le bannir et ne plus
en manger ! Mais dés que je m’apprête à rompre le jeûne, je ne me vois pas manger autre chose au « shour »
(Halima, 65 ans diabétique depuis 18 ans.).
La datte est un fruit particulièrement apprécié durant le mois sacré de Ramadhan. Elle est consommée en entrée
avec du lait cru, dés que le muezzin annonce la rupture du jeûne, suivant la tradition du prophète Mohamed
(qlsssl). Dénoyautées et réduites en pâte, les dattes entrent aussi dans la préparation de différentes recettes
traditionnelles, à l‟exemple du « Makrout » Ce dernier compte parmi les douceurs qui agrémentent les soirées de
Ramadhan. Dans l‟entretien que Nacera nous a accordé, elle disait :
« Je n’aime pas trop les gâteaux, mais si on sert du « Makrout » j’en prends, surtout en soirée avec du thé à la
menthe, en famille ou avec les invités. Je l’apprécie beaucoup, plus que tout autre gâteau, je prends 2à 3 pièces,
c’est selon, si j’en ai envie, mais pas plus, les autres gâteaux, je n’aime pas… De toute façon, en mangeant, je
fais attention quand même. »
Ainsi, ces aliments- symboles convoquent l‟imaginaire de l‟individu et produisent un sens qui déborde largement
le cadre alimentaire. Strauss (1962) estime ainsi que les nourritures sont non seulement bonnes à manger mais
également bonnes à penser. L‟alimentation et la cuisine sont des marqueurs identitaires et constituent « un
élément tout à fait capital du sentiment collectif d‟appartenance. » (Fischler, 1990, P112)
Le régime alimentaire, produisant des modifications dans les pratiques culinaires socialisées au sein de l‟espace
familial, peut être producteur de tensions entre les membres de la famille. C‟est le cas de Kheira, 56 ans
diabétique depuis 19 ans, qui est aussi hypertendue. Elle doit donc suivre pour cela un régime sans sel. Elle
disait :
«Au moment de servir, les garçons qui mangent avec leur père ne sont pas satisfaits. Ils émettent des
commentaires, ils veulent que le repas soit impeccable, ils ne veulent pas re-saler, ils disent qu’ils ne sont pas
malades, alors je dis à ma fille de ne pas prendre en considération mon régime pour éviter les problèmes. ».
On peut donc rappeler l‟influence de l‟environnement social immédiat, représenté principalement par la famille
sur l‟alimentation des diabétiques, mais aussi celle de la dimension symbolique et imaginaire des aliments qui se
12
Les médecins avec lesquels, nous nous sommes entretenus nous l‟ont confirmé.
11
révèle comme un aspect fondamental dans la relation qui s„instaure entre le diabétique et ce qu‟il mange. Mais le
comportement alimentaire est lié aussi à d‟autres critères comme l‟appréciation du goût et le sens du partage.
C‟est à l‟analyse de ces aspects que va être consacré le paragraphe suivant.
3- Gout, plaisir et commensalité
Pour qu‟un aliment soit reconnu par le « mangeur » ou le groupe social auquel il appartient, il ne suffit pas qu‟il
possède des qualités nutritionnelles, encore faut-il qu‟il fasse plaisir. En effet « les aliments acquièrent au sein
des repas une mystérieuse valeur symbolique, évocatrice de réconfort, qui est l‟un des facteurs de leur
acceptabilité ». (Trémolières, 1978, p 316). Ainsi, les aliments procurent du plaisir. Plaisir lié à l‟appréciation
des mets mais aussi plaisir des repas pris en collectivité, dans la convivialité. En revanche les restrictions et
autres modifications préconisées dans le cadre du suivi du régime alimentaire remettent en cause les qualités
psychosensorielles des aliments. A la question des plats qui sont incontournables au mois de Ramadhan, Halima
cite le « Berkouk ». Plat sucré à base de pruneaux, elle dit le préparer à sa façon, sans rajout de sucre et estime
qu‟il est bien meilleur que ceux servis dans les fêtes et mariages. Elle avoue en prendre, mais avec modération.
D‟un autre coté, elle ne cache pas son goût effréné pour les fruits de saison, surtout en période automnale.
D‟ailleurs, pas plus tard que la veille de l‟entretien, elle nous a confiés avoir consommé sans retenue du raisin. A
ce propos elle dit s‟être régalée. Elle ajouta :
« Quand je suis en groupe avec la famille et les amis, je mange le plus normalement du monde et je me sens
vraiment bien. Avec mes amies diabétiques, on se dit, puisqu’on ne se rencontre pas souvent, alors les rares fois
qu’on a l’occasion de se voir, on met le diabète de côté. On le laisse entre les mains de Dieu. On ne fait pas du
tout attention (tout en riant). Aussi bien pour moi que pour mes voisines, on mange ce qui nous est servi et ça ne
nous fait pas de mal, je t’assure qu’on se sent vraiment bien ! Je n’ai jamais mangé sans sel, pourtant je suis
hypertendue. Je sale normalement et je mange comme tous les membres de ma famille, de toute façon, je ne
mets pas trop de sel. Manger comme dit le médecin c’est perdre ce plaisir. La nourriture n’a plus de goût. Le sel
et le sucre sont importants. Sans eux, la nourriture ne ressemble à rien… C’est comme de la terre !».
Messaouda a 51 ans, elle est célibataire et vit seule. Son diabète remonte à 30 ans. Evoquant « le régime des
médecins » comme elle le qualifie, elle disait :
« Manger uniquement « le régime », franchement ne me plaît pas. Les médecins m’ont recommandés de
diminuer la quantité de pain, de couscous, de gâteaux et autres sucreries, de fritures et tout ce qui peut
augmenter le cholestérol. D’un autre côté, il faut manger des légumes cuits à la vapeur. Je ne te mentirais pas,
j’achète l’huile, même si par exemple, je fais cuire les aubergines à la vapeur, pour le poisson, je n’aime pas le
manger grillé, je n’apprécie pas son goût cuit de la sorte. Quand j’achète les sardines, je les fais fondre dans
très peu d’huile et à feu très doux et il a vraiment meilleur goût, autrement je ne l’apprécie pas ».
Ainsi, le plaisir gustatif et la distraction obtenus dans la consommation et le partage apparaissent comme des
éléments à prendre en compte dans les prises alimentaires des diabétiques. L‟aliment doit non seulement
12
apporter des nutriments, mais il doit aussi faire plaisir et même avoir du prestige, lui donnant ainsi une valeur de
réconfort. Manger renvoie à des horizons aussi variés que la santé, la dégustation, la convivialité. A présent,
nous verrons quelques exemples qui illustrent la complexité de la gestion du diabète en ce mois sacré de
Ramadhan.
4-Désarroi et incertitude
Les patientes diabétiques qui tentent tant bien que mal de respecter le jeûne essaient d‟adapter leur traitement et
leur régime alimentaire. Elles éprouvent d‟énormes difficultés en fonction des contraintes du rite sacré du mois
de Ramadhan. Même si l‟acte de jeûner est une obligation pour tout musulman, comme stipulé dans la sourate 2,
verset 183 : « ô croyants ! Nous vous avons prescrit le jeûne (essiyam) comme nous l‟avons prescrit à ceux
d‟avant vous, ainsi atteindrez-vous la piété ». Néanmoins le coran a spécifié certaines catégories qui sont
exemptes du jeûne, comme les malades mentaux, les femmes enceintes, celles en période de menstruation et
allaitant leurs nouveaux nés, les personnes âgées et les malades chroniques. A ce propos, on peut lire dans les
versets184 et 185 de la sourate citée précédemment (sourate 2, « el baqarah », la vache) : « quiconque d‟entre
vous est malade ou en voyage, devra jeûner un nombre égal d‟autres jours. Mais pour ceux qui ne pourraient le
supporter, il y a une compensation : nourrir un pauvre. Et si quelqu‟un fait plus de son propre gré, c‟est pour lui ;
mais il est mieux pour vous de jeûner ; si vous saviez ! Le mois de Ramadhan au cours duquel le coran a été
descendu comme guide pour les gens, et preuves claires de la bonne direction et du discernement. Donc
quiconque d‟entre vous est présent en ce mois, qu‟il jeûne !et quiconque est malade ou en voyage, alors qu‟il
jeûne un nombre égal d‟autres jours.-Dieu veut pour vous la facilité, il ne veut pas la difficulté pour vous, afin
que vous en complétiez le nombre et que vous proclamiez la grandeur de Dieu pour vous avoir guidés, et afin
que vous soyez reconnaissants ! 13
».
Les femmes diabétiques rencontrées continuaient de pratiquer le jeûne, malgré leur connaissance de la dispense
clairement édictée dans le livre saint. Elles étaient tiraillées entre ce qu‟elles considèrent comme leur devoir
religieux, leurs rapports sociaux et le risque de survenue de complications lié à leur alimentation et à cette
sensation effrénée de faim. Elles se retrouvent désemparées, éprouvant un sentiment de culpabilité et vivant ainsi
un véritable dilemme. Messaouda déclarait :
« Si je suis le régime, peut-être que j’irais mieux. Mais moi, je ne suis pas le régime, il y a des choses que je ne
dois pas manger, mais que je prends par dessus tout. Quand je sens mes yeux fatigués, que ma tête tourne et que
mes jambes fourmillent et s’échauffent, je sais que ma glycémie est élevée, je prends mes médicaments, et j’évite
toutes ces choses interdites, mais dés que je sens une amélioration, je reviens à mes habitudes, je n’y peux rien,
c’est la tentation. Je sais bien que prendre les médicaments sans faire le régime, ne sert pas à grand-chose, mais
que veux-tu ? Des fois, je ne mange pas et ma glycémie monte et ma tension aussi et des fois je mange et Dieu
prend soin de nous, avec la maladie, ça monte et ça descend. Crois tu que si je ne prenais plus de sucre ou de
sel, je me porterais mieux ? »
Saliha et Nacera âgées respectivement de 39 et 43 ans, essayant de normaliser leur vie en ce mois sacré de
13 Traduction trouvée sur le site www.oumma.com et www.al-islam.com
13
Ramadhan souffrent de ne pas trouver un équilibre à la gestion compliquée de leur diabète. Leurs propos
témoignent de leur désarroi. Saliha nous confiait :
« Ce matin, j’ai lavé le linge, je suis un peu fatiguée et j’ai faim, mais pour le moment, j’arrive à tenir. Si je
sens que je ne vais pas bien, je serais obligée de rompre le jeûne. J’ai mal aux pieds, le médecin m’a dit de ne
pas faire le jeûne et que c’est cause de cela que j’ai mal, mais vois-tu, je ne sais vraiment quoi faire ! En cette
période de Ramadhan, les horaires des repas sont chamboulés et je t’avoue que je suis vraiment perdue, je ne
sais pas à quelle heure prendre mes médicaments ! Mon problème c’est surtout cette sensation de faim, dés que
je prends de l’insuline ou du glucophage, j’ai envie de manger. Tu sais quand on me parle de régime, ce n’est
pas que je ne veux pas le faire, mais je ne peux pas le faire. J’ai besoin de manger sinon je ne peux pas tenir
debout. Si je fais le régime et l’injection …je tombe. Je prends alors du pain, quand il n y a pas autre chose.
Quand je veux vraiment me rassasier, je mange de la pomme de terre cuite dans l’eau avec du sel, de la hrira ou
alors je prends de la chorba avec du pain. Quand j’ai vraiment faim, j’ai envie de manger tout ce que je vois !
Certains me disent de ne pas faire le jeûne et d’autres non. L’imam, quant à lui m’a dit de ne pas jeûner, mais
est ce que c’est vraiment permis ? ».
Abondant dans le même sens, Nacera nous disait: « ce qui est difficile pour moi, c’est de contrôler la quantité de
nourriture que je prends. Pendant ce mois de Ramadhan, on ne peut pas manger comme d’ordinaire, c’est le
mois du jeûne, nous sommes musulmans et on ne doit pas manger sauf si on est vraiment malade. Je cuisine,
j’éteins les fourneaux et je sors de la cuisine. Mais dés que le muezzin annonce la rupture du jeûne, je mange
jusqu’à m’évanouir. Je ne peux pas manger une petite quantité. Je n’arrive pas à me contrôler. Je ne me lève de
table qu’après complète satiété, je deviens si lourde que j’ai à peine la force de faire la prière du soir. Je
deviens comme de la hrira (tout en riant). Hier par exemple, j’ai difficilement terminé le jeûne, j’étais très
fatiguée, je suais énormément. J’ai toujours fait le jeûne. C’est la troisième fois que je fais le Ramadhan, après
avoir eu le diabète. Quand j’étais enceinte du petit, j’ai jeûné pendant 15 jours, alors que je prenais de
l’insuline. Le médecin me l’a reproché, mais puisque je prends des comprimés, je peux jeûner normalement, du
moins j’essaye ».
Le jeûne du mois de Ramadhan semble ainsi ajouter de la difficulté à la situation déjà complexe de la gestion au
quotidien du diabète. En plus des désagréments liés à la maladie elle-même, à l‟exemple de la sensation effrénée
de manger, jeûner ou ne pas jeûner, les femmes interviewées semblent à la recherche d‟un équilibre qu‟elles ne
trouvent pas.
14
Conclusion
Le jeûne du mois de Ramadhan apparaît comme un élément non négligeable qui vient s‟ajouter à la gestion déjà
complexe du diabète. En interrogeant la situation alimentaire de femmes diabétiques, ces dernières ont montré
des capacités assurément inégales de gestion de la maladie. Malgré le désarroi et l‟incertitude, elles se révèlent
actrices face aux situations sociales dans lesquelles elles se trouvent. Elles s‟autorisent des écarts à l‟égard de la
gestion de leur maladie, en particulier de leur régime alimentaire. Cette «non-compliance » qualifiée de
comportement « irrationnel » par le discours médical, apparaît comme une recherche d‟autonomie, préférant être
plutôt dans une logique de régulation des symptômes que dans une logique de contrôle de la maladie et vivre
normalement leur quotidien, malgré les symptômes de la maladie (Strauss et al., 1975). Soumises à des
contraintes de différents ordres, ces femmes ont cependant un espace de liberté qui leur permet d‟exercer des
logiques et des rationalités plurielles. Nous avons tenté dans cet article de proposer une approche de la question,
en nous focalisant sur l‟alimentation dans le contexte du Ramadhan. Il est clair que cette approche mérite une
analyse plus poussée qui envisagerait de restituer plus en profondeur les différents registres des représentations
que ces femmes élaborent de leur maladie et de la santé –elle-même en lien avec l‟alimentation- en fonction des
contextes et des rôles sociaux par exemple qu‟elles exercent.
Bibliographie :
ABABOU M. ABABOU R., EL MALIKI A., « Le jeûne du Ramadhan au Maroc : un dilemme pour les patients
diabétiques et les soignants, in Sciences sociales et santé, volume 26, n°2, juin 2008, p 79-103.
BAHLOUL J., « nourritures de l‟altérité : le double langage des juifs d‟Algérie », in Annales, E.S.C., March-
April 1983, 2, p325-340.
BASZANGER I., « Les maladies chroniques et leur ordre négocié ». In Revue française de sociologie, Vol.27,
N°1. 1986 p 3-27.
BOUKRAA J. « 2,1%de la population de l‟ouest atteints du diabète », in le quotidien d‟Oran, 15novembre
2009, p17.
CALANDRE N, 2002, alimentation, nutrition et sciences sociales, concepts, méthodes pour l’analyse des
représentations et pratiques nutritionnelles des consommateurs, mémoire de recherche pour l‟obtention du DEA
en économie du développement agricole, agroalimentaire et rural, sous la direction de Lucie Sirieix et Nicolas
Bricas.
CARICABURU D., MENORET D. (2004). Sociologie de la santé. Institutions, professions et maladies, Armand
Colin, 235p.
CHAUVIN P., PARIZOT I., introduction-les déterminants sociaux de la santé : une approche pluridisciplinaire,
santé et recours aux soins des populations vulnérables (avec la collaboration de Sandrine Revet), INSERM,
Paris, 2005, 325 pages
DE GARINE I., « la nourriture ne sert pas qu‟à s‟alimenter », revue Cérès, revue FAO, volume 4, N°1, janvier-
février 1971, (47-51).
15
DE GARINE I. (dir.), « Facteurs socioculturels et saisonnalité dans l‟alimentation : l‟exemple de deux
populations du Tchad et du Cameroun, in Les changements des habitudes et des politiques alimentaires en
Afrique : aspects des sciences humaines, naturelles et sociales », publisud, 1991, p.85-115.
DEMAZIERE D.., DUBAR C., Analyser les entretiens biographiques. L’exemple de récits d’insertion, Paris,
Nathan, « essais et recherches » 1997.
DONOVAN J., BLAKE D., “patient non-compliance: deviance or reasoned decision-making”, in social science
and medicine, 34, 5, 1992, 507- 513.
FASSIN D., Décrire, entretien et observation, Sociétés, développement et santé, Ellipses, 1990
FEKI A., 2000, « Cuisine tunisienne, cuisine méditerranéenne ? ». In Alimentation et pratiques de table en
méditerranée, colloque du GERIM, Sfax, 8-9 mars 1999, sous la direction de Yassine Essid, édition GERIM. p
279-285.
FISCHLER C., l’Homnivore, le goût, la cuisine et le corps, Poches Odile Jacob, Paris, 2001.
GOBERT E., usages et rites alimentaires des tunisiens, leur aspect domestique, physiologique et social, éditions
de la bibliothèque IBLA, Tunisie, 1940.
GARABUAU-MOUSSAOUI I., PALOMARES E.et DESJEUX D., coord., « Alimentations contemporaines »,
l‟Harmattan, 2002.
GOFFMAN E., Les rites d’interaction, le sens commun, Paris, Editions de Minuit, 1967.
GOFFMAN E., Stigmates. Les usages sociaux du handicap, Paris, Editions de Minuit, 1975.
HADJIAT A., « Diabète : Le jeûne, facteur aggravant », Liberté, quotidien national d‟information, 2006, p8
HAMADACHI K., 2009, « Le diabète : la maladie des pauvres ? » http://www.algerie-focus.com
HENRICHS H.R., « la surprenante diversité des aspects du diabète liés au genre » DiabetesVoice, mai 2009,
volume 54, numéro1, p3.
HUBERT A., « destins transculturels », Milles et une bouches. Cuisines et identités culturelles, in Autrement,
Paris, 1995.
HUBERT A., « cuisine et politique, le plat national existe-t-il ? », in Revue des sciences sociales, 2000, 27.
IMBERT G., 2008, « vers une étude ethno épidémiologique du diabète de type 2 et de ses complications, » in
société française de santé publique N°20, février, pages 113 à124. (www. Cairn.info)
KOURTA D., « Le diabète ausculté lors d‟un congrès maghrébin, menace sur toutes les tranches d‟âge », El
watan, quotidien national d‟information, 2006, P.7.
LAHLOU S., Penser manger, PUF, coll. Psychologie sociale, 1998, 239 pages.
LE BRETON D., Sociologie du risque, puf, 1995.
LERNER B.H., “From careless consumptives to recalcitrant patients: The historian construction of non
compliance”, in social science and medicine, 1997, 45, 9, 1423-1431.
MAUSS M., sociologie et anthropologie, paris, 1950
Mead M., Guthe C.E., “Manuel for the studies of food habits”, Bulletin of national research council, national
academy of sciences, n°111, 1945.
MEBTOUL M., « Les significations attribuées à la prise en charge de deux maladies chroniques ; diabète et
hypertension artérielle à Tlemcen (Algérie) », in coopérations, conflits et concurrences dans le système de santé,
16
Rennes, ENSP, 2003, p 251-268.
MEBTOUL M., «Logiques des acteurs sociaux et systèmes de santé en Algérie », Correspondances, n°75, 2004.
MEBTOUL M., « Quand les habitudes alimentaires mettent en défaut les normes médicales », El joumhouria,
dimanche 30 septembre, 2007 p19.
Mebtoul M., « anthropologie de la santé : familles et maladies chroniques », Journal algérien de médecine,
volume XVI, N°3, mai-juin, 2008, p 82-83.
PERRETI-WATEL P. la société du risque, Collection Repères, édition La découverte, 2001, 124 pages.
POULAIN J.P., CORBEAU J.P., Penser l’alimentation. Entre imaginaire et rationalité. Éd. privât, 2002, 206
pages,
POULAIN, J.P., sociologies de l’alimentation. Les mangeurs et l’espace social alimentaire. Ed Puf, Paris, coll.
Sciences sociales et sociétés, 2002, 286 pages
RIVIERE C., Les rituels du manger, in Revue Prévenir, numéro 26, 1994 p7-29.
RIVIERE C. Les rites profanes, puf, 1995.
SARRADON-EK A., « le sens de l‟observance. Ethnographie des pratiques médicamenteuses de personnes
hypertendues », in sciences sociales et santé, juin 2007, vol. 25, n°2.
STRAUSS C.L., Le totémisme aujourd’hui, Paris, PUF, 1962.
STRAUSS A., La trame de la négociation, sociologie qualitative et interactionnisme. (Textes réunis et présentés
par I. Baszanger), Paris, L‟Harmattan, 1992.
STRAUSS A., CORBIN J., FAGERHAUGH S., GLASER B.G., MAINES D., SUCZECK B., WIENER, C.
Chronic illness and the quality of life, saint-louis, C.V. Mosby Co, 1975.
SUREMAIN (DE) C-H, KATZ E, « introduction : modèles alimentaires et recompositions sociales en Amérique
latine », Anthropology of food, 2008, http:/aof.revues.org
TAHINA, 2007, (Transition And Health Impact in North Africa) (Contrat N°I CA3- CT-2002-10011), 305
pages, document PDF, http://www.mpl.ird.fr/tahina/index.htm
TREMOLIERES J., 1978. Partager le pain, R. Laffont.
TROSTLE J.A., 1988,” medical compliance as an ideology”, in social science and medicine, 27, 12, 1299-1308
WILLIAMS R. et RILEY P. « L‟année des personnes défavorisées et vulnérables. » In : Diabetes’voices, march
2006, vol. 51, n°1. pp. 30-33. 19e congrès mondial du diabète , Cape Town déc. 2006.