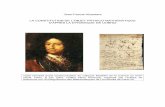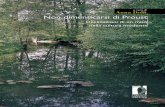La constitution de l'objet physico-mathématique dans la dynamique leibnizienne
Proust et l'objet comestible
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
3 -
download
0
Transcript of Proust et l'objet comestible
PROUST ET L'OBJET COMESTIBLE
Grace Beecher Kenny
M.A.
Birkbeck College
University of London
September 1990
Résumé
Cette étude, ancrée dans une lecture approfondie du texte de
A la recherche du temps perdu, de Marcel Proust, tente de
décrire et d'analyser l'usage qu'il y fait de l'objet
comestible. Le travail s'effectue sur deux niveaux - le
rhétorique/stylistique, et le romanesque/diégétique.
Il se divise en quatre thèmes principaux:
1o les tropes de l'association - métonymie, métaphore,
comparaison;
2o l'acte de création - ses règles, ses techniques, ses
résultats;
3o les personnages - représentants des voix multiples
proustiennes;
4o les endroits - l'espace proustien de la création et de
la consommation.
Il sera question de dégager quelques grands axes textuels
liés à l'idée du comestible, et de repérer enfin quelques
travaux qui restent à faire. Les ouvrages consultés, hors
du texte lui-même, se trouvent dans la bibliographie en fin
de mémoire.
TABLE DES MATIERES Page
1 INTRODUCTION 1
2 LA GARNITURE DU SOUVENIR ET DU REVE 5
2.1 LES BOUQUETS SENSIBLES 5
2.1.1 Métonymie et métaphore 5
2.1.2 Comparaisons 20
2.2 CONCLUSION 22
3 L'ARTISTE ET L'OEUVRE, ET LA
CRITIQUE 24
3.1 LA CREATION 24
3.2 LES METHODES 31
3.2.1 Procédés 34
3.2.2 Processus 38
3.3 LA CONSISTANCE 40
3.4 CONCLUSION 45
4 LES PERSONNAGES 48
4.1 MARCEL 48
4.2 LES NOURRICES FAMILIALES 51
4.2.1 Grand'mère/mère/tante 51
4.2.2 Françoise 54
4.3 LES NOURRICES (SUITE) 56
4.3.1 Les laitières 57
4.3.2 Les marchandes de coquillages et
autres fournisseuses 60
4.4 LES PROCHES 63
4.4.1 Swann 64
4.4.2 Odette 66
4.4.3 Gilberte 67
4.4.4 Albertine 68
4.4.5 Saint-Loup 69
4.5 LE MONDE 71
4.6 CONCLUSION 76
5 LES ENDROITS 78
5.1 LES ENDROITS OU L'ON MANGE 78
5.1.1 Intérieur 78
5.1.2 Extérieur 84
1 INTRODUCTION
Cette étude a pour but d'illustrer, de mettre en lumière, et
d'analyser les différents moyens et les différentes façons
par lesquels Marcel Proust, dans A la recherche du temps
perdu, s'est servi de l'objet comestible. Parmi les
innombrables ouvrages consacrés à l'examen de l'oeuvre
proustienne plusieurs d'entre eux traitent de la nourriture,
et plusieurs traitent du monde sensible en général.
1 Or, les premiers se dessinent sur un plan assez
restreint (voir par exemple Matoré2) et les seconds (surtout
Richard) ne font de la sensibilité gustative qu'un genre
parmi d'autres. Il a semblé alors utile, et peut-être
intéressant, de tenter un amalgame des approches pratiques
d'un Matoré, des aperçus généreux de J.-P. Richard et des
théories esthétiques littéraires d'écrivains critiques aussi
différents que Barthes, Beckett et Leo Bersani.
Le véritable amalgame ne fait pas valoir ses ingrédients
individuels; une étude écrite n'a pas cependant,
1 Voir bibliographie et surtout J.-P. Richard, Proust et lemonde sensible, Seuil, 1974.
2 G. Matoré, 'Les images gustatives dans Du côté de chezSwann', Annales Universitaires Saraviensis, Philosophie,Lettres, 6 (1957), pp.685-692.
1
malheureusement, cette possibilité et les éléments doivent
se poursuivre selon les catégories spatio-temporelles qui
nous définissent. Cela pour dire que même si les chapitres
qui suivent ont des titres et des sous-titres, il ne faut
pas croire par là que les idées qui y sont exprimées ne
s'appliquent pas à l'ensemble de l'oeuvre, et qu'elles n'ont
pas des attaches trés étroites entre elles.
Il ne sera donc pas question d'analyser l'objet comestible
et ses appas - l'alimentation, la nourriture, la cuisine -
en tant que tel; l'intention est de faire ressortir
quelques éléments rhétoriques (stylistiques) et narratifs
(les plus communs) du texte où l'idée du comestible se voit
mise en oeuvre de façon unique à Proust.
Ainsi il ne sera pas question des associations saisonnières
par exemple des aliments (fruits, légumes, etc), mais des
associations tropiques des aliments, selon les tropes les
plus fondamentaux, c'est-à-dire la métonymie et la
métaphore. Nous essayerons de voir comment ces techniques
rhétoriques de rassemblement et de ressemblance se
construisent et s'utilisent dans ce monde proustien qui est
si saturé de sensibilités et de sensations, parmi lesquelles
celles du goût et de l'odorat occupent une place
privilégiée. Les associations qui combinent objet
comestible et sensation sont nombreuses, généralement
2
amorcées par la mémoire involontaire.1
Il ne sera pas question non plus de voir en quoi consiste,
pratiquement, la cuisine; la cuisine se trouvera
transformée en image convaincante de l'acte créateur
universel, avec ses règles, ses méthodes, ses jouissances et
ses déceptions. Le cuisinier et le créateur se voient
obligés de jouer un même rôle de maître d'oeuvre, en
transformant la matière première - données affectives,
épisodes vécus, et autres ingrédients - en oeuvre (de cru
en cuit serait trop simple), de lutter contre
l'incompréhension et les jalousies et de subir la critique,
informée ou pas.
Dans chaque récit, de nature aussi peu narrative soit-il,
les transformations s'effectuent grâce aux personnages et
aux figurants. Or, dans l'oeuvre proustienne, il est
souvent difficile de distinguer la voix narrative à
proprement parler, c'est-à-dire la voix du narrateur qui se
décrit sentir et vivre au cours de son "histoire", in
propria persona, comme dit Bowie2, de la voix de l'écrivain,
1 "Memory - a clinical laboratory stocked with poison andremedy, stimulant and sedative." Samuel Beckett, Proust,Calder and Boyars, 1970, p.35.
2 M. Bowie, 'Proust's Narrative Selves' Moy qui me voy, 1989,
(continued...)
3
qui analyse et critique son propre texte au cours de son
"écriture." Nous essayerons donc de prendre les traits
saillants des personnages les plus importants du récit, et
de les analyser, toujours dans le cadre du comestible,
aussi bien sous le regard critique (dans les domaines
esthétique, social, ontologique etc.) de l'écrivain, que
dans leur cadre de personnages romanesques agissants,
sentants, et plus ou moins sympathiques.
Enfin nous parlerons de ces petits mondes fantaisistes,
abymes du grand et du réel, où les transactions liées à tout
ce qui concerne la nourriture s'effectuent. L'espace
proustien, qui se voit défini plus par les états d'âme du
narrateur que par les lois naturelles de la superficie et de
la distance, se rétrécit miraculeusement parfois pour
devenir, sous les charmes de la consommation, un abri aux
dimensions abordables.
2(...continued)pp.131-146.
4
2 LA GARNITURE DU SOUVENIR ET DU REVE
2.1 LES BOUQUETS SENSIBLES
2.1.1 Métonymie et métaphore
Le filigrane du texte romanesque proustien est le glissement
perpetuel entre les différentes causes (objets, événements,
sentiments), les sens que celles-ci frappent et les
sensations par là éveillées. Le schéma serait une boucle
tri-polaire (données affectives/sens/sensations) où non
seulement les voies directes d'un point à l'autre risquent
une déviation inattendue, mais où chaque étape du trajet
risque de comporter non pas un seul élément, mais plusieurs.
L'expérience de tous les jours se voit bouleversée, quand,
par exemple, la donnée auditive qu'est le son d'un
calorifère à eau que quelqu'un allume n'éveille pas
seulement une sensation de l'ouïe mais trois autres en plus,
qui seraient normalement d'un tout autre ordre: dans le cas
présent celles-ci se rapportent à la vue (paysage à colline
dans le brouillard), à la température (la chaleur d'une
tasse remplie) et au goût (le chocolat). (III, 494)1
1 Toutes les références à A la recherche du temps perdu sont
(continued...)
5
Ce passage a été anticipé dans ses associations, par la
description d'une matinée à Doncières, imbue encore
d'imagerie centrée sur la bouche: "Imbibant la forme de la
colline, associé au goût du chocolat et à toute la trame de
mes pensées d'alors, ce brouillard... vint mouiller toutes
mes pensées de ce temps-là" (II, 81), et par un souvenir de
cette même matinée
Entre la couleur grise et douce d'une campagnematinale et le goût d'une tasse de chocolat, jefaisais tenir toute l'originalité de la viephysique, intellectuelle et morale que j'avaisapportée... à Doncières,
et voilà que l'écrivain/narrateur propose une analyse de son propre art,
et qui, blasonée de la forme oblongue d'unecolline pelée - toujours présente même quand elleétait invisible - formait en moi une série deplaisirs entièrement distincte de tous autres,indicibles à des amis [à en douter] en ce sens queles impressions richement tissées les unes dansles autres qui les orchestraient, lescaractérisaient bien plus pour moi et à mon insuque les faits que j'avais pu raconter. (II, 346)
Cet éveillement (ou émerveillement) multiple s'effectue sur
le plan rhétorique par une technique de métonymie qui veut
qu'une part peut représenter le tout et que leur contiguité
accidentelle peut accorder à plusieurs éléments une même
force affective.
1(...continued)à l'édition établie et annotée par Pierre Clarac et AndréFerré, 3 vol., Bibliothèque de la Pléïade, Paris, Gallimard,1954.
6
Dans le schéma proustien évoqué plus haut, la métonymie peut
s'opérer non seulement au niveau des données affectives,
mais aussi dans le domaine des sens et des sensations.
Comme dit Stephen Ullmann,
l'intérêt de Proust pour les impressionssensorielles ne se bornait pas à leur qualitéintrinsèque et aux analogies qu'elles suggéraient: il était également fasciné par leur capacité àévoquer d'autres sensations et l'ensemble ducontexte d'expérience auquel elles étaientassociées. D'où l'importance des sensations dansle processus de la mémoire involontaire1.
Cependant, il y a au moins deux commentaires à proposer là-
dessus.
Premièrement, cette notion métonymique qui se veut un effet
de style n'est que le reflet écrit d'une vérité vécue. Si
nous acceptons que chez Proust la métonymie et la métaphore
ne peuvent qu'avec difficulté se distinguer, nous pouvons
croire avec Beckett que "the rhetorical equivalent of the
Proustian real is the chain-figure of the metaphor".2
Genette3 parle du "déplacement métonymique... bien connu de
1 Stephen Ullmann, Style in the French Novel, CambridgeUniversity Press, 1957, p.197. Voir aussi Jonathan Culler,The Pursuit of Signs - semiotics, literature, deconstruction,Londres, Routledge and Kegan Paul, 1981.
2 S. Beckett, Proust, p.88.
3 Gérard Genette, Figures III, Collection poétique, Paris,Editions du Seuil, 1980, p.58.
7
la psychanalyse". Mais sur un plan tout autre, celui de la
sociologie (et qui fut à l'origine de l'intérêt du présent
auteur), il est permis d'envisager les expériences
sensorielles de tous les jours sous la forme d'un ensemble,
plus ou moins limité, d'activités et de sensations
différentes. Dans un ouvrage de Goffmann1, par exemple, il
utilise le terme de "bundle" (la meilleure traduction serait
peut-être bouquet, ou paquet, même "faisceau"2) pour
désigner cet ensemble de données affectives par lesquelles
l'être humain éprouve le monde.3 De la même façon Nabokov
emploie un terme même plus concrétisé pour décrire cette
collection hétéroclite, unifiée par le fait de l'individu
ressentant:
1 Erving Goffmann, The Presentation of Self in Everyday Life,London, Allen Lane, 1969.
2 En suivant Alain Robbe-Grillet dans Le Miroir qui revient,"un faisceau de circonstances fortuites", p.221.
3 Il a semblé intéressant de présenter ici un passage repéréultérieurement à la première rédaction de ce chapitre. C'estun extrait du livre de Georges Cattaui (Marcel Proust, London,the Merlin Press, 1967, p.70), traduit du français en anglaispar Ruth Hall:
Perhaps Proust is one of those who consciously ornot, attained the Philosopher's Stone, unattainableby definition, of which Mallarmé had dreamed. Hashe not, better than any other, united, sheathed andtied in bundles like a single stem (the peduncle onwhich the "immense edifice of memory" rests) thosemultiple lilies, those Nympheas which "grew toomuch for our reasons"?
8
In other words, a nosegay of the senses in thepresent and the vision of an event or sensation inthe past, this is when sense and memory cometogether and lost time is found again1.
Il y a au moins un endroit dans le roman où le narrateur
dresse, comme aurait fait un homme moyen, d'une façon
explicite, une liste des ingrédients d'une soirée dont il se
souviendra; les fleurs bien sûr y entrent.
Rachel m'offrit du champagne, me tendit une de sescigarettes d'Orient et détacha pour moi une rosede son corsage. Je me dis alors: "Je n'ai pastrop à regretter ma journée; ces heures passéesauprès de cette jeune femme ne sont pas perduespuisque par elle j'ai, chose gracieuse et qu'on nepeut assez payer, une rose, une cigaretteparfumée, une coupe de champagne". (II, 171)
Beckett, aussi, voit l'homme proustien non pas comme un
point fixe, mais comme un vaisseau par lequel circule le
temps, et il emploie pour désigner cette idée de flux, une
métaphore qu'on croirait empruntée à Proust lui-même.
The individual is the seat of a constant processof decantation, decantation from the vesselcontaining the fluid of future time, sluggish,pale and monochrome, to the vessel containing thefluid of past time, agitated and multi-coloured bythe phenomena of its hours.2
1 Vladimir Nabokov, 'Marcel Proust. The Walk by Swann'sWay', in Lectures on Literature, (Ed. Fredson Bowers), London,Weidenfeld and Nicholson, 1980.
2 Samuel Beckett, Proust, p.15.
9
Une seconde remarque s'impose. Les critiques ont beaucoup
parlé du caractère involontaire de la mémoire proustienne.
Cependant les bouquets, les paquets et même les tout petits
bouquets ne se font pas d'eux-mêmes. Les éléments, soient-
ils fleurs ou autres choses, sont plus ou moins
minutieusement selectionnés par le cueillant ou le
fleuriste.
On pourrait à juste titre protester que le paquet sans cesse
changeant qu'est l'homme moyen se compose d'éléments qu'il
est dans l'impossibilité de choisir ou de maîtriser1.
Certes, mais les oppositions volontaire/involontaire,
conscient/inconscient, nécessaire/accidentel ne constituent
pas des binaires radicalement tranchés. Il suffit de
constater que deux êtres humains dont les circonstances et
l'environnement pourraient sembler identiques,
construiraient, de par leur individualité même, des univers
différents; a fortiori, leurs méthodes d'expliciter chacun
son univers, différeraient encore plus. Autrement, tout
homme moyen, tout écrivain, serait à même de décrire
l'univers où habite Proust. Or, la génie de Proust consiste
à bâtir tout un monde particulier mais universel. Tout
ceci pour dire que "l'involontaire" n'a de force ni
1 Voir Malcolm Bowie, 'Proust, Jealousy, Knowledge' in Freud,Proust and Lacan: theory as fiction, Cambridge UniversityPress, 1987.
10
d'intérêt que sous l'imprimatur d'un esprit unificateur
remarquable.
Pour souligner l'importance de cet acte de rédaction il
suffit de citer un auteur dont l'approche à la création
littéraire semble être très loin de celle de l'oeuvre
proustienne. Et pourtant:
Une fois venu le moment de la rédaction, c'est entoute conscience que je déclenche le mécanisme, ousi l'on veut, que j'ouvre le robinet dusubconscient, disons de la sensation. Ce travailest on ne peut plus volontaire.1
Toutefois ces procédés métonymiques sont soutenus et
renforcés par des techniques métaphoriques. Dans l'univers
du romanesque, le narrateur propose au lecteur, en mise en
abyme de ses propres effets de style métaphorique, un
compte-rendu élaboré de ce qu'il appelle en toutes lettres
les "arts de transposition".
Les réunions mondaines... si elles avaient pris laplace de mes sorties avec ces jeunes filles,m'eussent fait le même effet que si à l'heure dudéjeuner on nous emmenait non pas manger, maisregarder un album... mais c'est comme déléguée desautres sens qu'elle [la perception visuelle] sedirige vers les jeunes filles; ils vont chercherl'une derrière l'autre les diverses qualitésodorantes, tactiles, savoureuses, qu'ils goûtentainsi même sans le secours des mains et deslèvres; et, capables, grâce aux arts detransposition, au génie de synthèse où excelle le
1 Robert Pinget, Le libéra, Paris, Editions de Minuit, 1984,postface.
11
désir, de restituer sous la couleur des joues oude la poitrine, l'attouchement, la dégustation,les contacts interdits, ils donnent à ces fillesla même consistance mielleuse qu'ils font (sic)quand ils butinent dans une roseraie, ou dans unevigne dont ils mangent des yeux les grappes. (I,893)
A côté de la saturation de ce texte d'images du comestible,
on voit toute une série de mots clés tels que "désir",
"interdits", "consistance", "mielleuse"; en fin de compte
on voit apparaître l'idée surprenante de sens qui se
détachent entièrement de leur support corporel pour
s'aventurer dans un royaume autonome. C'est la mise en
application d'un processus décrit par Ricoeur1:
le pouvoir de la métaphore serait de briser unecatégorisation antérieure, afin d'établir denouvelles frontières logiques sur les ruines desprécédentes.
Mais il est souvent difficile de distinguer là où la
métonymie glisse dans la métaphore et vice versa (autant
dire que les "chiens de faïence" de Genette2 font étalage
d'une surdité et d'un mutisme peu étonnants devant les
richesses stylistiques proustiennes); cependant il nous
incombe de proposer quelques distinctions aussi arbitraires
soient-elles pour pouvoir accéder à un examen critique
gustatif du texte. Pour reprendre une autre idée de
1 Paul Ricoeur, La métaphore vive, Paris, Seuil, 1975, p.251.
2 Genette, Figures III, p.25.
12
Genette, il faut distinguer la macro-structure narrative du
roman de ses micro-structures stylistiques. D'un côté sont
les procédés rhétoriques de base par lesquels le roman se
construit sous la plume créatrice; de l'autre sont les
tropes diégétiques, voire ceux "dont le véhicule est
emprunté à la diégèse, c'est-à-dire l'univers spatio-
temporel du récit". D'un côté la conscience (ou
inconscience) unificatrice est celle de l'écrivain (qu'on
distingue mal du narrateur, surtout dans les dernières
pages, alors que le narrateur de l'enfance et de la jeunesse
a certaines qualités du personnage romanesque classique);
de l'autre l'esprit rassembleur reste celui des personnages
dans leurs caractères particuliers.
Une seconde opposition s'esquisse dans le corps du récit,
celle qui distingue la distance spatiale de la distance
temporelle, toutes deux franchies et sur le plan macro-
structural et sur le plan micro-structural à l'aide de
transports tropiques métonymiques et métaphoriques.
Or, "vis-à-vis du terme charnel", et de bien d'autres, "le
terme comestible tient donc lieu tout à la fois de métaphore
et de métonymie: il est tantôt voisin et tantôt substitut,
souvent les deux en même temps."1
1 J.-P. Richard, Proust et le monde sensible, p.16.
13
Les lignes de base du roman sont tracées le long
d'associations d'idées et de sensations très souvent ancrées
dans le goût et l'odorat, qualités primaires (pace V. E.
Graham1) de l'objet comestible; la plus célèbre de ces
associations, et qui met en marche le vaste souvenir qu'est
le texte lui-même est sans doute celle qui s'amorce par le
goût de la madeleine trempée dans le thé familial. (I, 44,
45)
Le fait que ce lien avec le passé souvent s'effectue à
l'aide de l'odorat ou du goût n'a pas échappé aux écrivains
travaillant un certain temps après Proust, mais suivant sans
doute en partie la même voie esthétique qui veut que ce soit
la conscience qui crée l'art et non les objets en eux-mêmes.
L'importance des choses - grêles saucisses auxaromates ou lampes électriques dissimulées aumilieu des feuillages - ne réside évidemment pasdans leur signification intrinsèque, mais dans lafaçon dont elles ont marqué notre mémoire.2
Il s'agit donc de repérer quelques instances encore de la
force associative de l'objet comestible. Le souvenir du
narrateur dans le souvenir de l'écrivain se dresse par
exemple dans un passage riche en imagerie gustative où le
1 V. E. Graham, 'The Imagery of Proust', Language and Style,general editor Stephen Ullmann, Oxford, Basil Blackwell, 1966.
2 A. Robbe-Grillet, Le miroir qui revient, Paris, Minuit,1984, p. 177.
14
jeune homme pique-nique avec ses amies, les jeunes filles en
fleurs. Il préfère les sucreries aux sandwiches et aux
fromages des temps modernes (voir plus loin sur le caractère
ignoble de la nourriture nouvelle).
Mais les gâteaux étaient instruits, les tartesétaient bavardes. Il y avait dans les premiersdes fadeurs de crème et dans les secondes desfraîcheurs de fruits qui en savaient long surCombray, sur Gilberte, non seulement la Gilbertede Combray, mais celle de Paris aux goûters de quije les avais retrouvés. Ils me rappelaient cesassiettes à petits fours, des Mille et une Nuits,qui distrayaient tant de leurs "sujets" ma tanteLéonie quand Françoise lui apportait, un jour,Aladin ou la Lampe Merveilleuse, un autre, AliBaba, le Dormeur Eveillé, ou Simbad le Marinembarquant à Bassora avec toutes ses richesses. (I, 904)
Il ne faut pas s'étonner de cet anthropomorphisme qui veut
que les friandises nous parlent; le chapitre suivant
découvre l'analogie profonde qui existe entre
cuisiner/parler/écrire et consommer/écouter/lire.
Le narrateur est si frappé par la force qu'ont les
sensations de rappeler non seulement d'autres sensations
mais des sentiments plus abstraits pourrait-on dire, qu'il
va chercher des preuves de ce mouvement dans des oeuvres
littéraires antérieures; il se rend compte que ce qu'il
fait n'est pas original, mais il se vante, à juste titre,
d'avoir fait évoluer la technique à ses limites. Ainsi
repère-t-il dans Les Mémoires d'outre-tombe de
Chateaubriand,
Une odeur fine et suave d'héliotrope s'exhalaitd'un petit carré de fèves en fleurs; elle ne nous
15
était point apportée par une brise de la patrie,mais par un vent sauvage de Terre-Neuve, sansrelation avec la plante exilée, sans sympathie deréminiscence et de volupté. Dans ce parfum nonrespiré de la beauté, non épuré dans son sein, nonrépandu sur ses traces, dans ce parfum chargéd'aurore, de culture et de monde, il y avaittoutes les mélancolies des regrets, de l'absenceet de la jeunesse. (III, 919)
Non seulement l'objet comestible rappelle-t-il en soi
d'autres objets comestibles ressentis (goûtés, sentis) dans
le passé, mais il rappelle les sensations qui les
entouraient. La gamme de ces sensations passe du plus
concret - odeur/odeur ou goût/goût - par des associations
plus enchevêtrées telles odeur/plaisir, aux mélanges de
sensations, sens et sentiments, disons essentiels, c'est-à-
dire réduits à leur essence dans un ou plusieurs de leurs
éléments. Dans le dernier cas on a à faire à l'évocation
d'états d'âme semblables les uns aux autres:
si les phrases de Vinteuil semblaient l'expressionde certains états de l'âme analogues à celui quej'avais éprouvé en goûtant la madeleine trempéedans la tasse de thé, rien ne m'assurait que levague de tels états fût une marque de leurprofondeur. (III, 381)
Pour ce qu'il en est des rapports simples de sensation
gustative présente à une sensation gustative antérieure, les
exemples ne sont pas nombreux étant donné l'importance dans
l'oeuvre de bâtir toujours des associations et d'effectuer
des transpositions. Avant de passer aux éléments annexes,
qu'ils entraînent avec eux, il est possible de signaler les
16
rapports des goûts identiques (du chocolat à Doncières (II,
81), et plusieurs fois à Paris (II, 346), (III, 494)).
Le plaisir, évoqué dans sa manifestation charnelle, sensible
ou intellectuelle, est bien sûr un des grands thèmes de
l'oeuvre. Il nous incombe de citer quelques exemples où le
plaisir dans le passé se renouvelle grâce à une sensation
d'un objet comestible dans le passé plus proche, rappelé
dans le présent:
je venais de voir qu'elle avait apporté du cidreet des cerises, ce cidre et ces cerises qu'ungarçon de ferme nous avait apportés dans lavoiture, à Balbec, espèces sous lesquels j'auraiscommunié le plus parfaitement, jadis, avec l'arc-en-ciel des salles à manger obscures par les joursbrulants (III, 479).
Le schéma se présente:
vue de cerises 6 (souvenir de cerises + Balbec) 6(Balbec + salles à manger + chaleur) = plaisir.
Un schéma dans le sens inverse se présente dans la
Prisonnière, volume précédant la Fugitive:
Ainsi rien ne ressemblait plus qu'une belle phrasede Vinteuil à ce plaisir particulier que j'avaisquelquefois éprouvé dans ma vie par exemple devantles clochers de Martinville, certains arbres deBalbec ou, plus simplement, au début de cetouvrage, en buvant une certaine tasse de thé. (III, 374)
Plaisir = (phrase de Vinteuil + plaisir) 7 (clochers deMartinville + plaisir) ou (arbres de Balbec + plaisir)ou (goût du thé + plaisir).
Un élément très important que renferme cette idée du plaisir
est que celui-ci n'est jamais simple, ni entier; il est on
17
ne peut plus fugace et n'arrive que rarement à assouvir le
désir ou la faim; le plaisir le plus intense consiste donc
en ce qu'on pourrait appeler ses appâs temporels - son
attente, son espérance et bien sûr, son souvenir. Le
souvenir, par une inversion qui n'en est pas une, peut très
bien être celui d'une attente et dans l'oeuvre en question,
l'attente est souvent celle d'un plaisir à manger, où,
comble des combles, l'attente du plaisir à venir peut être
prolongée par un plaisir entièrement de circonstance:
Au moment où Elstir me demanda de venir pour qu'ilme présentât à Albertine, assise un peu plus loin,je finis d'abord de manger un éclair au café. (I, 871,2)
ou bien,
quelle joie, pensant déjà au plaisir du déjeuneret de la promenade, (I, 672)
et encore,
Je reconnaissais cette heure inutile, vestibuleprofond du plaisir, et dont j'avais appris àBalbec à connaître le vide sombre et délicieux,quand seul dans ma chambre comme maintenant,pendant que tous les autres étaient à dîner, jevoyais sans tristesse le jour mourir au-dessus desrideaux, sachant que, bientôt, après une nuitaussi courte que les nuits du pôle, il allaitressusciter plus éclatant dans le flamboiement deRivebelle... (II, 390)
Roland Barthes a également repéré cette joie en sursis de
l'attente gastronomique. Parlant du rapport entre sexe et
goût, il dit:
... entre les deux plaisirs, une différencecapitale: l'orgasme, c'est-à-dire le rythme mêmede l'excitation et de sa détente... On dirait quele seul élément critique de la joie gastronomique,
18
c'est son attente.1
L'espérance et l'espoir relèvent encore le plaisir de cette
attente appétissante:
Il arrive souvent que le plaisir qu'ont tous leshommes à revoir les souvenirs... est plus vif chezceux que la tyrannie du mal physique etl'espoir... laissent assez confiants qu'ils lepourront bientôt faire, pour rester vis-à-visd'eux en état de désir, d'appétit... (III, 26)
Le goût du café au lait matinal nous apporte cettevague espérance d'un beau temps qui jadis sisouvent, pendant que nous le buvions dans un bolde porcelaine blanche, crémeuse et plissée quisemblait du lait durci quand la journée étaitencore intacte et pleine, se mit à nous souriredans la claire incertitude du petit jour. (III,889)2
Si l'opposition métonymie/métaphore ne s'opère pas d'une
façon simple dans le texte proustien, la distinction
métaphore/comparaison n'est pas non plus toujours claire.
La métaphore n'est qu'une comparaison où le terme comparant
est implicite. L'écrivain le fait [sous] entendre. Il
dépend de l'art de l'auteur et de l'astuce du lecteur pour
que l'effet se fasse sentir: il est des métaphores
fatiguées où le "comme" ne se fait même plus sous-entendre;
il est des comparaisons où le "comme" est superflu tant
1 R. Barthes, 'Lecture, avant-propos', La physiologie du goût,Brillat-Savarin, p.29.
2 Voir 3.2.2 sur la consistance contradictoire et étonnante dulait, p.35.
19
elles sont banales. Il est permis de mettre dans cette
dernière catégorie toutes les fois où les jeunes filles
adorées apparaissent en objets comestibles, pour la plupart
des fruits juteux:
... cet arôme que mes regards allaient cherchersur ces jeunes filles et dont la douceur finissaitpar s'incorporer à moi. Ainsi les raisins sesucrent-ils au soleil. (I, 910, 911)
Certes, mes désirs de Balbec avaient si bien mûrile corps d'Albertine, y avait accumulé des saveurssi fraîches et si douces... (que je lui eussedonné rendez-vous)... (II, 387)
Ses deux petits seins haut remontés étaient sironds qu'ils avaient moins l'air de faire partieintégrante de son corps que d'y avoir mûri commedeux fruits. (III, 79)
Et en l'éveillant j'avais seulement, comme quandon ouvre un fruit, fait fuser le jus jaillissantqui désaltère. (III, 387)
2.1.2 Comparaisons
Une véritable comparaison métaphorique suivie, liée à l'idée
que l'attente et le comble sont supérieurs au fait du
plaisir lui-même, est offerte dans les pages centrées autour
de la rencontre anticipée avec Albertine:
Et cet atelier paisible avec son horizon rurals'était rempli d'un surcroît délicieux, comme ilarrive d'une maison où un enfant se plaisait déjàet où il apprend que, en plus, de par lagénérosité qu'ont les belles choses et les noblesgens à accroître indéfiniment leurs dons, seprépare pour lui un magnifique goûter. (I, 844)
20
Une comparaison qui réunit en elle un très grand nombre
d'idées clées que l'on traitera ultérieurement - la
transposition métaphorique des actes de lire, de manger et
de connaître, l'importance métonymique des
nourrices/marchandes, le rôle libérateur des voyages et des
vacances et cet obstacle nécessaire au voyeur qu'est la
vitre - vient accompagner une promenade en auto dont, comme
toujours, le héros se rappelle et les faits et les
sensations.
J'avais à peine le temps d'apercevoir, aussiséparé d'elles derrière la vitre de l'auto que jel'aurais été derrière la fenêtre de ma chambre,une jeune fruitière, une crémière, debout devantsa porte, illuminée par le beau temps, comme unehéroïne que mon désir suffisait à engager dans despéripéties délicieuses, au seuil d'un roman que jene connaîtrais pas. (III, 166)
Ces jeunes filles resteront ce que les anglais appellent "a
closed book".
Il y a quand même un livre véritable qui apparaît de temps
en temps le long de cet autre roman qui est en train de
s'écrire et de se lire sous nos yeux. Il s'agit du livre
de recettes de Mme Léon Daudet, autrement connue sous le nom
de Pampille. Et ce livre est en toutes lettres comparé à
de la poésie, avec un extrait pour le prouver, tandis que
son contenu ne peut être comparé qu'à un plat.
... sa conversation s'imprégnait un peu du charmemélancolique des pardons et, comme dirait ce vraipoète qu'est Pampille, "de l'âpre saveur descrêpes de blé noir cuites sur un feu d'ajoncs". (III, 36)
21
... dont le vocabulaire, habituellement limité àtoutes ces vieilles expressions, était savoureuxcomme ces plats possibles à découvrir dans leslivres délicieux de Pampille, mais dans la réalitédevenus si rares, où les gelées, le beurre, lejus, les quenelles sont authentiques, necomportent aucun alliage, et même où on fait venirle sel des marais salants de Bretagne. (II, 502)
Il s'agit, dans les deux cas, du langage appétissant de Mme
de Guermantes.
2.2 CONCLUSION
Nous avons vu qu'il est impossible de démêler les tropes de
rapprochement et de comparaison dans A la recherche du temps
perdu, et que les critiques qui ont voulu le faire se voient
obligés d'utiliser eux-mêmes un langage pour le moins imagé
pour essayer d'y faire un peu d'ordre. En fait, c'est en
cela que résident la force et la richesse des images
proustiennes; le lecteur se voit embarqué dans un
tourbillon d'associations affectives qui se servent
d'éléments pris dans tous les domaines de la sensibilité et
dans tous les moments d'une vie sans cesse se rebouclant sur
elle-même. Les ensembles physiques se transforment en
ensembles métaphysiques, dont un ingrédient peut faire
remonter à la surface consciente tous les autres. Et les
ingrédients, choisis avec soin, relèvent, dans un nombre
surprenant de cas, de ces zones primitives, primordiales et
raffinées de la sensibilité, l'odorat et le goût.
22
La résurrection du passé de Marcel dans laRecherche du temps perdu est, pour l'essentiel,une résurrection de désirs perdus. En un sens,Marcel n'est rien d'autre qu'une succession dedésirs - c'est-à-dire qu'il revit constamment lesentiment d'un manque. Mais, en art, le manqueexistentiel du désir est ressenti comme uneplénitude d'images; dans le monde de mots qu'estla littérature, la réalité manquante est présentedans le langage qui affirme son absence.1
1 Leo Bersani, 'Le réalisme et la peur du désir', Littératureet réalité, Paris, Seuil, 1982, p.76. Voir aussi M. Bowie,'Proust's Narrative Selves' in Moy qui me voy, The Writer andthe Self from Montaigne to Leiris, Oxford, 1989, pp.131-146.
23
3 L'ARTISTE ET L'OEUVRE, ET LA CRITIQUE
3.1 LA CREATION
Il y a un sens très profond par lequel la cuisine de
Françoise, surtout quand il s'agit de son boeuf mode, est
une mise en abyme de l'oeuvre entière. L'analogie n'est pas
bien fraîche, mais on a explicitement à faire dans l'oeuvre
de La recherche à une transformation de matières premières
(événements, pensées, sentiments) hétéroclites, passagères,
en un plat homogène, offert par l'auteur au lecteur. Il
s'agit avant tout de transformer ce qui est divisé, séparé
et doté d'angles aigus en une matière lisse et convenable à
l'occasion - celle-ci étant la production d'une oeuvre en
soi. L'écrivain cherche
the absence of interruptions, the lack of jaggededges which allows for the characterisation of thenovel's narrative texture as a play offragmentation and reunification that can be called"fondu", (ie smooth (Gérard Genette)) or "soudé"(ie welded (Proust))1
Proust n'aime évidemment pas les matièresdéchirées, ni déchirantes; il refuse de la mêmefaçon l'aigre, le rugueux, ou le craquant.2
1 P. De Man, Allegories of Reading. Figural Language inRousseau, Nietzsche, Rilke and Proust, 1979, p.68.
2 J.-P. Richard, Proust et le monde sensible, p.31.
24
Comme dit Mouton1, parlant de ces petits pois comme des
billes vertes dans un jeu (I, 121), c'est une
analogie qui fait de ces légumes une étonnantenature morte, rendant parfaitement le poli froidde ces petites boules vertes, qui semblent placéessous une cloche pneumatique; c'est comme il n'yavait plus d'air pour adoucir leurs rontours quis'inscrivent dans l'espace avec une rigueurgéométrique.
Sur la beauté du lisse et de l'homogène par rapport au
texte, deux remarques de Proust sont citées dans Figures III
de Gérard Genette (1972):
La "beauté absolue" de certaines pages c'est,rappelons-le, une espèce de fondu, d'unité transparente où toutes les choses sont venues seranger les unes à côté des autres dans une espèced'ordre.2
Dans le style de Flaubert, par exemple, toutes lesparties de la réalité sont converties en une mêmesubstance, aux vastes surfaces, d'un miroitementmonotone. Aucune impureté est restée... Tout cequi a été différent a éte converti et absorbé.3
Dans le dernier volume du texte se poursuivent d'étonnants
passages où l'acte d'écrire se présente comme une suite
d'activités pénibles et fatigantes, où on discerne, dans le
chaos ordonné de la création, des poursuites à première vue
incompatibles; l'écrivain
1 Jean Mouton, Le style de Marcel Proust, chapitre III.
2 Proust, Correspondance, Plon, 1930-36, p.86.
3 Proust, Contre Sainte Beuve, Pléïade, 1971, p.269.
25
devrait préparer son livre minutieusement, avec deperpétuels regroupements de forces, comme uneoffensive, le supporter comme une fatigue,l'accepter comme une règle, le construire commeune église, le suivre comme un régime, le vaincrecomme un obstacle, le conquérir comme une amitié,le suralimenter comme un enfant... (III, 1032)
Ecrire est aussi coudre:
Quand je n'aurais pas auprès de moi toutes mespaperoles, comme disait Françoise, et que memanquerait juste celle dont j'aurais besoin,Françoise comprendrait bien mon énervement, ellequi disait toujours qu'elle ne pouvait pas coudresi elle n'avait pas le numéro de fil et lesboutons qu'il fallait. (III, 1033))
Mais surtout,
D'ailleurs, comme les individualités (humaines ounon) sont dans un livre faites d'impressionsnombreuses qui, prises de bien des jeunes filles,de bien des églises, de bien de sonates, servent àfaire une seule sonate, une seule église, uneseule jeune fille, ne ferais-je pas mon livre dela même façon que Françoise faisait ce boeuf mode,apprécié par Monsieur de Norpois, et dont tant demorceaux de viande ajoutés et choisisenrichissaient la gelée. (III, 1034-35)
Ici, se montre très nettement la supériorité de la cuisine
par rapport aux autres arts créateurs; le résultat est
utile, à l'encontre de la beauté "inutile" de ces boutons
d'or des bords de la Vivonne (I, 168).
1
Il nourrit et il est apprécié des gens moyens.
1 Au sujet de ces mêmes boutons d'or, Pommier dit, dans LaMystique de Marcel Proust, Paris, Droz, 1939, p.47
Phrase bien remarquable! Le sentiment esthétiqueresulterait de la récurrence qui se produit vers lasurface des choses incomestibles, dont la matièrene se prête pas à une assimilation plus profonde.
26
Beckett est d'accord pour trouver, dans la recherche de
l'essence de nombreux événements, en distillant l'universel
artistique des données quotidiennes, le propre du travail
littéraire.
... because - if I may add this nux vomica to anapéritif of metaphors - the heart of thecauliflower or the ideal core of the onion wouldrepresent a more appropriate tribute to thelabours of poetical excavation than the crown ofbay.1
Pourtant, si parler/écrire est nourrir, le silence a aussi
ses attraits: l'imagerie gustative est si répandue qu'elle
se trouve appropriée et au parler et au silence.
L'air y était saturé de la fine fleur d'un silencesi nourricier, si succulent, que je ne m'yavançais qu'avec une sorte de gourmandise, surtoutpar ces premiers matins... où je le goûtais mieux. (I, 49)
De la même façon qu'on envisage la cuisine comme une
activité très proche de celle de l'écriture littéraire, de
même Proust compare-t-il la cuisine en tant que telle à
d'autres arts créateurs. La comparaison s'effectue ou bien
par analogies explicites ou bien par métaphores suivies.
Pour parler de la musique, on voit que la cuisinière
Françoise par exemple "sachant qu'elle allait composer...
vivait dans l'effervescence de la création" (I, 445), ou
encore, "en laisser une seule goutte dans le plat eût
1 Samuel Beckett, Proust, p.29
27
témoigné de la même impolitesse que se lever avant la fin du
morceau au nez du compositeur" (I, 71). Plus loin,
admettant qu'interpréter est en partie créer, on voit Odette
qui joue la sonate de Vinteuil pour Swann et celle-ci par
métonymie claire, lui rappelle tout un printemps "dont il
n'avait pu jouir autrefois". C'était comme "on fait, pour
un malade, de bonnes choses qu'il n'a pu manger" (I, 533).
Même dans le cadre des personnages plus secondaires, le
rapport musique/cuisine se fait aussi:
Elle [Madame de Gallardon] semblait non pasadresser une invitation, mais demander un service,et avoir besoin de l'avis de la princesse sur laquintette de Mozart, comme si ç'avait été précieuxde recueillir l'opinion d'un gourmet. (I, 333)
Les musiciens même peuvent succomber à l'ennui des tâches
culinairement anodines: "il se penchait sur sa contrebasse,
la palpait avec la même patience domestique que s'il eût
épluché un chou". (III, 251) Mises à part les grandes
soirées où les personnages se comportent en comédiens et
comédiennes (II, 434), le discours critique du spectacle
s'applique aussi bien à la cuisine:
J'eus ce soir-là, à l'entendre traiter les pluscélèbres de gargotes, le même plaisir qu'autrefoisà apprendre, pour les artistes dramatiques, que lahiérarchie de leurs mérites n'était pas la mêmeque celle de leurs réputations. (I, 484)
Avec son air de simplicité Françoise était pourles cuisiniers célèbres une plus terrible"camarade" que ne peut l'être l'actrice la plusenvieuse et infatuée. (I, 485)
28
Même les céramistes y passent: "il [poisson cuit au court
bouillon] avait l'air d'apparaître dans une céramique de
Bernard Palissy". (II, 118)
Mais la comparaison la plus évoluée entre cuisine et beaux
arts se manifeste dans les passages voués à Françoise en
tant qu'artiste doué, vraisemblablement sculpteur:
Comme elle attachait une importance extrême à laqualité intrinsèque des matériaux qui devaiententrer dans la fabrication de son oeuvre, elleallait elle-même aux Halles se faire donner lesplus beaux carrés de romsteck, de jarret de boeuf,de pied de veau, comme Michel-Ange passant huitmois dans les montagnes de Carrare à choisir lesblocs de marbre les plus parfaits pour le monumentde Jules II... Maman... craignait que notrevieille servante ne tombât malade de surmenagecomme l'auteur du Tombeau des Médicis dans lescarrières de Pietrasanta... Françoise avait envoyécuire... comme du marbre rose, ce qu'elle appelaitdu jambon de Nev' York. (I, 445)
Cette image de Françoise sculpteuse par qui "notre menu,
comme ces quatre-feuilles qu'on sculptait au XIIIe siècle
aux portails des cathédrales, reflétait un peu le rythme des
saisons et des épisodes de la vie" (I, 71) renvoie à l'image
déjà citée du créateur/cuisinier, de la
créatrice/cuisinière. C'est la créativité en soi, la
créativité réalisée en création, qui est l'essentiel de
l'art et qui marque les grands esprits: la notion est
proposée (idée équivoque, mais séduisante pour notre époque)
que l'intention de l'artiste compte autant ou plus que le
résultat. Ceux qui ne reconnaissent pas ce fait sont des
"goujats qui, même dans le présent qu'un artiste leur fait
29
d'une de ses oeuvres, regardent au poids et à la matière
alors que n'y valent que l'intention et la signature"
(I,71). Ce leitmotiv de Françoise acharnée mais créatrice,
qui double en quelque sorte le narrateur lui-même le long de
sa création à lui (pour aboutir comme nous l'avons vu plus
haut) se poursuit dans ce même passage par un très joli jeu
de mots:
Ce jour-là, si Françoise avait la brûlantecertitude des grands créateurs, mon lot était lacruelle inquiétude du chercheur. (I, 446)
Il est sans doute erroné de penser, comme Hughes, que le ton
de ces passages est ironique; le ton de Hughes lui-même
semble vouloir écarter toute possibilité de sérieux chez
l'écrivain:
In this way, these humble images taken from theservant's domestic pursuits [sewing, cooking] gaina new importance and value when used in thecontext of the Narrator's own artistic creation.
What is more, he occasionally allows himself tospeak of Françoise's culinary achievements inquasi-artistic terms.1
Nous avons la même surprise chez Mouton2, qui s'étonne que
"Tantôt la comparaison élève la cuisine à la dignité de
l'oeuvre d'art... tantôt c'est le domaine de l'art qui
1 E. Hughes, Marcel Proust, A Study in the Quality ofAwareness, Cambridge, Cambridge University Press, 1983, p. 73.
2 Jean Mouton, Le style de Marcel Proust, p.86.
30
réjoint sans penser déchoir [sic], celui de la cuisine."
Il est frappant de noter qu'il existe à côté de cette mise
en abyme qu'est la cuisine (ou "dramatization" pour employer
le terme de De Man), une autre qui consiste en la
transformation lente de l'habillement d'Odette. Au début
de sa carrière romanesque, celle-ci s'habille un peu
n'importe comment; les différents éléments de ses vêtements
ne vont pas ensemble. Ce n'est que sous l'influence de
Swann, manipulateur créateur, que son apparence devient un
véritable ensemble, uni par ses formes, ses couleurs et son
style.
3.2 LES METHODES
Ayant accepté que le roman entier, à son aboutissement, est
la réalisation d'une transformation de matières premières en
produit fini, et qu'au cours de cette transformation celle-
ci se décrit elle-même, en grande partie à l'aide de mises
en abyme comme celles qui viennent d'être citées, il reste
encore un troisième niveau où cette isotopie de
transformation se manifeste. Il s'agit de toute une série
de tropes basés sur les transformations culinaires et qui ne
font que souligner, sur un plan immédiat et particulier,
cette notion universelle de transformation.
31
Dans ce contexte il faut distinguer deux sortes de
transformation, celles qui se produisent par procédé, et
celles qui se produisent par processus. Par procédé, il
faut entendre un ensemble de règles, plus ou moins rigides,
par lequel un état de choses en devient un autre; ces
règles ne sont pas celles de la nature (bien qu'en fin de
compte elles doivent se baser sur des lois naturelles), mais
ont été inscrites par quelque maître en l'art pour apprendre
aux autres comment il faut faire; le modèle dans le domaine
qui nous intéresse ici est bien sûr la recette.
Par processus, il faut entendre une suite d'événements qui
se produisent, hors de toute volonté humaine, et par
laquelle, là encore, un état de choses, ou plus précisément
un état de la matière première, se trouve transformé: dans
cette catégorie d'événements il faut compter dans le domaine
culinaire les fondements, les ébullitions, les congélations,
les gellifications et les coagulations.
Il est tentant de vouloir rapprocher cette distinction entre
procédé - changement contingent, choisi et imposé par la
volonté artistique - et processus - changement inexorable
imposé par les lois de la nature - à la distinction entre
métaphore et métonymie. Selon De Man, Proust explicite,
dans un passage appelé "métafigural" sa préférence pour la
méthode métaphorique.
32
The necessary link that unites the buzzing of theflies to the summer makes it a much more effectivesymbol than the tune heard perchance during thesummer. The preference is expressed by means ofa distinction that corresponds to the differencebetween metaphor and metonymy, necessity andchance being a legitimate way to distinguishbetween analogy and contiguity.1
Cependant ce rapprochement ne peut s'opérer qu'à un niveau
assez superficiel, car en fait le texte de Proust "ne
pratique pas ce qu'il prèche"; "les chiens de faïence"2 que
sont la métaphore et la métonymie risquent de figer et
d'appauvrir les subtilités proustiennes. Pour une
discussion plus soutenue du rôle multiple de ces chiens de
faïence, voir le chapitre 2.
Quoi qu'il en soit, les tropes de la transformation de la
matière sont nombreuses dans l'oeuvre. Il s'agit le plus
souvent de changer ce que le narrateur appelle la
consistance, de dur en mou, de liquide en vapeur, de liquide
en solide et ainsi de suite. Jean-Pierre Richard y voit
deux tendances opposées, aussi bien la consistance qui
devient inconsistance (par le jaillissement et la
vaporisation) que l'inconsistance qui devient consistance
(par la coagulation, les épaississements et les
1 P. De Man, Allegories of Reading, p.14.
2 G. Genette, Figures III, p.25.
33
cristallisations).1 La distinction faite plus haut, entre
procédé métaphorique et processus métonymique tranche donc
dans ces mouvements opposés de transformations matérielles,
où règne la motion perpetuelle.
3.2.1 Procédés
Dans Du côté de chez Swann, (I,50) on voit toute une chambre
construite avec les soins d'un bon cuisinier, avec des fonds
de grandes lignes métaphoriques ("devants de four",
"cheminée", "chausson", chaud, creux), relevées d'images
inattendues mais véridiques ("air grumeleux", "arômes
croustillants"); c'est nous qui soulignons:
le soleil... badigeonnait toute la chambre... etle feu cuisant comme une pâte les appétissantesodeurs dont l'air de la chambre était toutgrumeleux et qu'avait déjà fait travailler et"lever" la fraîcheur humide et ensoleillée dumatin, il les feuilletait, les dorait, les godait,les boursouflait, en faisant un invisible etpalpable gâteau provincial, un immense "chausson",où à peine goûtés les arômes plus croustillants,plus fins, plus réputés, mais plus secs aussi duplacard, de la commode, du papier à ramages, jerevenais toujours avec une convoitise inavouéem'engluer dans l'odeur médiane, poisseuse, fade,indigeste et fruitée du couvre-lit à fleurs.
Déjà, est à remarquer l'association de convoitise et de
honte; les appétits charnels ne peuvent s'avouer, qu'il
s'agisse de fruits, de jeunes filles ou, a fortiori, de
1 J. P. Richard, Proust et le monde sensible, p.115.
34
jeunes hommes.1
Françoise, dans la même suite d'idées, et par sa profession
même, attire les comparaisons de cuisine raffinée: son
sourire se place "sous les tuyaux d'un bonnet éblouissant,
raide et fragile comme s'il avait été de sucre filé"; ce
bonnet miraculeux se dote à la page suivante d'un tuyautage
"éclatant et fixe [qui] avait l'air d'
être en biscuit." (I,53,54). Le sucre filé colle très
étroitement au chez soi dédoublé des endroits de délices
inavoués:
En m'éveillant je vis, comme de la fenêtre de lacaserne de Doncières, la brume mate, unie etblanche qui pendait gaîment au soleil consistanteet douce comme du sucre filé. (II,390)
Il convient de noter encore ici la douceur qu'incarne la
consistance homogène.
Le paysage, évidemment, et le temps, se prêtent aisément aux
comparaisons suivies et le narrateur, qui attend son dîner,
ne peut se priver de l'anticiper en s'apprêtant:
une bande de ciel rouge au-dessus de la mer,compacte et coupante comme de la gelée de viande,puis bientôt, sur la mer déjà froide et bleuecomme le poisson appelé mulet, le ciel du mêmerose qu'un de ces saumons que nous nous serionsservis tout à l'heure à Rivebelle, ravivaient leplaisir que j'allais avoir à me mettre en habitpour partir dîner (I,803)
1 "This connection between metaphor and guilt is one of therecurrent themes of autobiographical fiction" dit Paul de Man,dans Allegories of Reading, p.64
35
Un autre thème, étroitement lié à celui de la nourriture, se
manifeste à la fin de ce passage: le plaisir ne consiste
pas à manger, mais à attendre. Le dîner se place à la fin
d'une suite d'autres activités dont le plaisir consiste à le
remettre à plus tard - "remontais", "me mettre en habit",
"partir". (A l'encontre du proverbe suspect, l'appétit ne
vient pas en mangeant, mais en attendant). Après la gelée
véritable du boeuf de Françoise et la gelée anticipée dans
le ciel du dîner à venir, il est assez étonnant de voir que
non seulement les viandes se conservent en gelée, mais les
sentiments aussi, les sentiments aigre-doux de l'amour,
de sorte que ces soirs de janvier où elle venait,et qui par là m'avaient été si doux, mesouffleraient dans leur bise aigre une inquiétudeque je ne connaissais pas encore, et merapporteraient, mais devenu pernicieux, le premiergerme de mon amour, conservé dans leur gelée (III, 484)
S'il est clair que dans un sens le fruit défendu s'incarne
en la chair de filles et de garçons et qu'à la limite cette
chair est immangeable (voir 3.3), il reste à noter que le
narrateur se plaît à comparer les changements qui
s'effectuent brusquement ou lentement dans les visages des
gens à des procédés culinaires; il parle, sans penser à son
caractère, à la désagréable Andrée: "Aussitôt je voyais son
visage se gâter comme un sirop qui tourne; il semblait à
jamais brouillé. Sa bouche devenait amère." (III, 62).
Certains procédés ne marchent donc pas toujours. Chez la
36
duchesse de Guermantes, la transformation s'effectue par le
temps et non la jalousie; c'est la décomposition de l'âge:
Dans les joues restées si semblables pourtant dela duchesse de Guermantes et pourtant compositesmaintenant comme un nougat, je distinguai unetrace de vert-de-gris. (III, 937)
Il faut croire avec Paul de Man, que les niveaux tropiques
sont si enchevêtrés dans A la recherche du temps perdu que
tout signifie toujours quelque chose d'autre.1 Cependant
il y a des endroits où l'on ne peut être mené qu'à croire,
presque, l'évidence de ses yeux, encore qu'on est dans un
état de surdité profonde. Le détour (déviation)
extraordinaire que fait le narrateur dans l'attente de Saint
Loup dans sa chambre d'appartement de Doncières (chambre
préservée de l'odeur de pain bis exhalé par le reste du
bâtiment), raconte richement l'acte sexuel, sans doute
solitaire, sous la forme de l'acte banal de faire bouillir
du lait; la "tempête de neige" ("signe prémonitoire"), "les
flots", "l'oeuf ascendant et spasmodique"... finissent par
tout noyer dans "une mer blanche après ce mascaret lacté."
(II, 77)
1 "Everything in this novel signifies something other thanwhat it represents, be it love, consciousness, politics, art,sodomy or gastronomy: it is always something else that isintended." Allegories of Reading, p.77.
37
3.2.2 Processus
La mer et le lait font échange de leurs qualités non pas
seulement sous l'action des prises électriques, mais aussi
par les lois de la nature. S'interrogeant sur ses
affinités avec Baudelaire, le narrateur, attablé dans la
salle à manger de Balbec, compare le soleil du poète à celui
qui en ce moment brûlait la mer comme une topaze,la faisait fermenter, devenir blonde et laiteusecomme de la bière, écumante comme du lait (I,674).
Nous voilà devant des qualités et une image
interchangeables: la mer est laiteuse comme de la bière;
en même temps elle est écumante (qualité primaire de la
bière) comme du lait. De même quand, par un tour de main
inexplicable, le lecteur a l'occasion de lire par-dessus
l'épaule du narrateur quelques pages du journal inédit des
Goncourt, tour de force en lui-même; la mer (est-ce une
bavure?) se trouve de nouveau assimilée à cette liquide
nourricière (voir 4.2 et 4.3 sur le rôle des nourrices et
autres fournisseuses):
la lumière ne serait plus donnée que par une merpresque caillée ayant le bleuâtre du petit lait (III, 713).
(Si le premier rapprochement lumière/mer/lait, cité plus
haut, évoque le souvenir de Baudelaire, le second fait
parler de Flaubert).
38
Vers la fin du livre, quand les différents fils du récit
sont venus tisser une étoffe très dense, il faut une
comparaison bien plus éclectique pour caractériser une eau
qui représente et rappelle dans un mouvement rayonnant de
cercles concentriques tels ceux mis en marche par un caillou
qui tombe, les multiples éléments d'une métonymie complexe
amorcée dans le courant de l'histoire par l'odeur du pétrole
- le désir, la robe bleu (sic) et or de Fortuny, un
printemps, Venise, cette dernière étant un endroit terraqué,
réduit à son essence, en printemps décanté, par "la
fermentation progressive... d'une eau vierge et bleue."
(jeune fille habillée de Fortuny?) (III, 412).
Par le passage du temps s'effectuent des changements de
consistance moins excitants:- le fondement, le mûrissement.
Dans l'église de Combray, les pierres tombales se sont
mises, sous l'oeil tendre du narrateur, à fondre et à
couler. Leur couleur, leur manque de rugueux, viennent
achever ce que la douceur locale ressentie a suggéré:
Ses pierres tombales... n'étaient plus elles-mêmesde la matière inerte et dure, car le temps lesavait rendues douces et fait couler comme du mielhors des limites de leur propre équérissure qu'icielles avaient dépassées d'un flot blond entraînantà la dérive une majuscule gothique en fleurs,noyant les violettes blanches du marbre. (I, 59)
La transformation qu'est le mûrissement, mais naturel, est à
la base du plaisir qu'éprouve le narrateur en la compagnie
d'Albertine et de ses amies. Par sous entendus, tous les
39
plaisirs ont leurs attraits, ici transformés en parfums,
mais, par une inversion du comparant et du comparé, ce ne
sont que les parfums vrais, résultat de mûrissement non
forcé, qui émanent des plaisirs véritables.
Le plaisir vrai qui est à leur origine [celle dedes relations] laisse ce parfum qu'aucun artificene parvient à donner aux fruits forcés, auxraisins qui n'ont pas mûri au soleil. (I, 950)
On se rappellera une des belles phrases rarissimes de Zola:
"les grosses fraises de jardin, qui sentent la fadeur des
arrosoirs".1
3.3 LA CONSISTANCE
Ayant parlé brièvement de la création et des méthodes par
lesquelles elle peut se réaliser à travers la transformation
de la consistance de la matière, examinons un petit passage
dont la position sur le plan de l'imagerie gustative est
extrêmement difficile à préciser. Cependant il réunit en
quelques lignes un si grand nombre des thèmes de A la
recherche qu'il serait inadmissible de ne pas en prendre
note. Il s'agit d'une soirée "entre camarades" chez les
Verdurin, où madame Verdurin est en train de parler tout
banalement de son nouveau canapé, mais où, sous ses propos
anodins, il est permis d'apercevoir des références à toutes
1 E. Zola, Le Ventre de Paris, Bibliothèque de la Pléiade,1960, p.823.
40
sortes d'obsessions thématiques. Même dans la voix
authentique Verdurin résonnent les voix multiples du
narrateur et de l'écrivain.
- Rien que les petites frises des bordures, tenezlà, la petite vigne sur fond rouge de l'Ours etles Raisins. Est-ce dessiné? Qu'est-ce que vousen dites, je crois qu'ils le savaient plutôt,dessiner. Est-elle assez appétissante, cettevigne? Mon mari prétend que je n'aime pas lesfruits parce que j'en mange moins que lui. Maisnon, je suis plus gourmande que vous tous, mais jen'ai pas besoin de me les mettre dans la bouchepuisque je jouis par les yeux. Qu'est-ce quevous avez tous à rire? Demandez au docteur, ilvous dira que ces raisins-là me purgent. D'autres font des cures de Fontainebleau, moi jefais ma petite cure de Beauvais. Mais, MonsieurSwann, vous ne partirez pas sans avoir touché lespetits bronzes des dossiers. Est-ce assez douxcomme patine? Mais non, à pleines mains,touchez-les bien.
- Ah! si madame Verdurin commence à peloter lesbronzes, nous n'entendrons pas de musique ce soir, ditle peintre.
- Taisez-vous, vous êtes un vilain. Au fond, dit-elleen se tournant vers Swann, on nous défend à nous autresfemmes des choses moins voluptueuses que cela. Maisil n'y a pas une chair comparable à cela! (I, 207,8)
Laissant de côté le jeu de mots involontaire sans doute de
chair et chaire, il est possible de distinguer dans ce court
échange plusieurs niveaux thématiques du roman. Sur le plan
mondain se manifeste la niaiserie bon enfant de madame
Verdurin qui s'entoure de tout ce qui est à la mode, et qui
demande qu'on l'apprécie. La voilà encadrée non seulement
d'un mobilier artistique, mais aussi d'artistes (peintre,
musicien) et de scientifiques (docteur, peut-être Swann lui-
même). En plus, elle réussit à faire une simple référence
41
littéraire, pas trop recherchée.
Ces petits raisins en bronze représentent sans doute un art
mauvais et un goût regrettable. On voit donc que cet art,
en sa création, ne fournit qu'objets factices, qui ne
correspondent pas au véritable, qui ne servent à rien, qui
ne nourrissent point. Un art bon, nourricier, serait celui
d'un jardinier doué.
Cependant, même le ton facétieux de madame Verdurin laisse
apparaître la notion que même l'art mauvais peut mener à la
jouissance, sinon par un sens, au moins par un autre. Les
transpositions des objets entre eux et des sens, qu'en
principe ils éveillent en nous, sont innombrables dans
l'oeuvre de Proust; elles en sont l'image de marque. Même
un objet fait pour être goûté peut être transformé par l'art
en un objet propre à la vue et au toucher.1
Mais ni la vue, ni le toucher, ni même l'acte de manger ne
mène à la connaissance et à la possession entière.
("Whatever the object, our thirst for possession is, by
definition, insatiable"2.) Ces petits raisins montrent par
1 V. E. Graham prétend que les images de nourriture sontpresque toujours visuelles. Cela n'est pas évident. VoirGraham, The Imagery of Proust, chapitre 1.
2 Beckett, Proust, p.17
42
leur consistance on ne peut plus dure en fait,
l'impossibilité d'accéder à la personne intérieure qu'est
âme de l'être aimé, être aimé représenté sans cesse en
fruits à surface lisse et impénétrable. Ces fruits (image
au plus haut degré du doux et du succulent) dessinés en
bronze (matière resistante et froide) renferment en mise en
abyme coquette cette contradiction immense de l'amour
charnel, le fait qu'à la limite il est défendu aux amants de
s'entredévorer - la défense elle-même étant l'imperméabilité
résistante de la surface corporelle.
Beckett a bien décrit cette imperméabilité:
The impenetrability of the most vulgar andinsignificant human creature is not merely anillusion of the subject's jealousy (although thisjealousy stands out more clearly under the Röntgenrays of a jealousy so fiercely hypertrophied aswas that of the narrator... ). All that isactive, all that is enveloped in time and space,is endowed with what might be described as anabstract, ideal and absolute impermeability.1
Ces leçons sur la qualité des faux raisins sont reprises
explicitement lors de la connaissance croissante qu'a le
narrateur d'Albertine:
J'appris qu'il n'était pas possible de la toucher,de l'embrasser, qu'on pouvait seulement causeravec elle, que pour moi elle n'était pas une femmeplus que des raisins de jade, décorationincomestible des tables d'autrefois, ne sont desraisins. (II, 361)
1 Beckett, Proust, pp.57-58.
43
Tous les traits ambigus de cette amante, et de tous les
amants (voir aussi 4.4.4), s'étalent en leur manque et leur
suffisance; voir aussi "les mères profanées" de Compagnon1:
Je sentais sur mes lèvres qu'elle essayaitd'écarter, sa langue, sa langue maternelle,incomestible, nourricière et sainte. (III, 497)
Un tout dernier mot sur la consistance et sur les charmes
ambiguës d'Albertine qui se défend dans son imperméable en
caoutchouc.2
Valéry hésitait à employer le mot "caoutchouc"dans un poème. Ici, il désigne pourtant l'objetpoétique par excellence. D'une matièreintermédiaire entre la chair et le fer, empruntantà l'une et à l'autre, ni dur ni mou, à la foissouple et rigide, froid et chaud, défensif etattrayant, le caoutchouc, qui transporte lesqualités, est la matière même de la métaphore, entout cas de la métaphore proustienne, dont GérardGenette a montré l'attache métonymique dans uneliaison de contenu à contenant.3
1 Antoine Compagnon, Proust entre deux siècles, Paris, Seuil,1989, p.160.
2 Ce caoutchouc n'apparaît que dans un cahier de brouillonpour Sodome et Gomorrhe datant du début de la guerre de 1914,le Cahier 46.
3 Antoine Compagnon, Proust entre deux siècles, Paris, Seuil,1989, p.118.
44
3.4 CONCLUSION
Nous avons vu qu'en un sens très profond l'acte véritable de
créer, quoi que ce soit, consiste à transformer des matières
premières, hétéroclites, passagères (des impressions, des
événements, des ingrédients), en une substance assimilable
et "essentielle". Ce travail de création, puisqu'aucune
création ne peut partir du néant, consiste à transformer des
éléments en ensemble. Par une analogie un peu poussée,
nous avons voulu montrer que les techniques littéraires qui
utilisent la ressemblance et le rassemblement, c'est-à-dire
les tropes de métaphore et de métonymie, ont des équivalents
en techniques culinaires qui utilisent les procédés et les
processus. Les deux sortes de techniques dépendent de
qualités ou bien imposées par le créateur (en petit) aux
éléments à traiter - c'est-à-dire choisies et voulues,
engendrées par l'artifice et les recettes - ou bien
intrinsèques aux éléments (imposées par le Créateur en grand
si on veut) - donc nécessaires et naturels. Nous soutenons
donc que la distinction faite par De Man1 entre "necessary"
et "perchance" qu'il prétend faire correspondre à "metaphor"
et "metonymy", en fait opère dans le sens inverse, et que,
même si la méthode métaphorique est celle préférée par
Proust, c'est parce que le choix de l'auteur (à l'encontre
de la nécessité imposée par la nature) est le moyen par
1 P. De Man, Allegories of Reading, p.14.
45
lequel elle s'effectue. Cela ne veut pas dire qu'un
élément de choix n'entre pas dans les ingrédients
métonymiques d'un trope, aussi bien que dans la gamme de
processus naturels auxquels un bon chef peut faire appel, ni
que les deux sortes de techniques, dans les deux cas, ne
viennent se soutenir et se compléter.
Si les techniques de la création se ressemblent, il est
clair que les actes de création dans différents domaines se
ressemblent de la même manière. Cuisiner et nourrir sont
des actes de la même nature qu'écrire et parler. Lire,
donc, relève du même type d'activité que manger (et, à la
limite, consommer pour connaître). Pour un
écrivain/critique comme le narrateur/Proust qui raffole des
deux, les jeunes filles délicieuses sont des livres, les
mots sont des mets, les oeuvres annoncées ("images
inséparables des mots qui en composaient le titre" (I,73))
sont des plats - "du riz à l'Impératrice et de la crème au
chocolat" (I, 74), et par une de ces transpositions
rebouclées à gogo, les tartes deviennent "bavardes" (I,
904).
L'importance de ces rapprochements, entre tous les actes
créateurs véritables, entre toutes les réactions critiques
véridiques, est à prendre au sérieux. Le ton proustien
vacille souvent; l'ironie va et vient selon les lectures,
mais dans l'ensemble il ne faut pas se moquer des tâches
46
quotidiennes qui ont leur place dans le monde littéraire
aussi bien que dans les mondes plus "simples". Nous savons
que Proust aime la simplicité, mais en fait ce qu'il aime le
plus, ce sont ces preuves concrètes de la simplicité que
sont les attitudes sans manières et les besognes banales
mais nécessaires qui la sous-tendent. Ce qu'il admire dans
Adam Bede par George Eliot1, c'est la
peinture attentive, minutieuse, respectueuse,poétique et sympathique de la vie la pluslaborieuse et la plus humble. Tenir sa cuisinebien propre est un devoir essentiel, presqu'undevoir religieux et un devoir plein de charme.2
Enfin nous avons voulu mettre en évidence l'importance de la
consistance proustienne, non pas de cette consistance
moelleuse des crèmes et des glaces qui attire le narrateur
jeune et moins jeune, et dont J.-P. Richard a si bien
parlé3, mais de cette consistance traîtresse qu'est la chair
des jeunes filles et la pulpe des fruits sculptés en bronze.
Nous entrons dans une partie du domaine de l'entre-deux, où
les choses ne sont pas ce qu'elles semblent être et où les
surfaces attrayantes se révèlent des défences absolues.
1 Hughes, Marcel Proust, p.2.
2 Proust, Contre Sainte Beuve, p.656.
3 Proust et le monde sensible.
47
4 LES PERSONNAGES
La vie des personnages proustiens, surtout de ceux qui ne
sont pas de la famille proche du narrateur, se joue dans un
monde où les apparences sont, pour tous, importantes et pour
quelques-uns tout. Quoi de plus voyant donc, et
indicateur, après les goûts en habillement, en décor
intérieur (laissant de côté les "beaux" arts), que les goûts
en goût? Il s'agit donc de voir comment les relations
qu'ont les personnages avec l'objet comestible, ou sur le
plan symbolique, ou sur le plan diégétique, viennent
soutenir leur rôle dans l'esthétique et le narratif de
Proust.
4.1 MARCEL
On a vu que l'ouvrage entier de A la recherche du temps
perdu est en quelque sorte un parallèle du boeuf mode de
Françoise. Or, il y a un sens aussi par lequel le
narrateur, par ses faims enfantines, fait surgir toute
l'oeuvre de sa mémoire. Il s'agit bien sûr de la fameuse
madeleine qui, offerte par sa mère, et accompagnée d'une
tasse de thé, éveille le souvenir de la vie de Combray, avec
sa maison d'enfance, ses habitants et ses habitudes. Et par
là se déclenche tout le cours du livre. Il n'est pas
48
nécessaire de partager toutes les théories de Doubrovsky1
sur le manque, sur le meurtre de la mère et sur la
défécation pour accepter que le rapport qu'a le narrateur
avec celle qui nourrit est capital, ("La mère fait au fils
le coup de la nourriture ontologique."2) et que l'ouvrage
consiste largement à chercher ce, celui ou celle qui
pourrait nourrir à satiété. Evidemment cette quête ne peut
être que vaine (voir chapitre trois où il est question de la
qualité immangeable d'Albertine), et toutes les
réincarnations de la mère (grand'mère, tante Léonie,
amantes, autres nourrices) le laissent sur sa faim et sur sa
soif.
Nutrition insatiable. La conclusion, c'est cequ'on trouve au début. Matrice du livre, ce quifait d'abord, d'emblée, surgir la MADELEINE, c'estle mot FAIM.3
Cependant cet infantilisme générateur qui en quelque sorte
sous-tend l'oeuvre en entier, se traduit de même par des
goûts à jamais enfantins, surtout pour les aliments roses et
pour le lait. Compagnon a, parmi bien d'autres, récupéré
ce premier penchant, en comparant deux passions, le livre et
1 Serge Doubrovsky, La place de la madeleine, Paris, Mercurede France, 1974.
2 Doubrovsky, p.39.
3 Doubrovsky, p.183.
49
le rose.
Trois fois dans la page revient le terme d'odeur àpropos des feuillets du livre, une "fine odeur"qui n'est plus la poussière de la bibliothèquemais "aussi douce que l'odeur de l'armoire où l'onserrait les biscuits roses et le linge." Uneodeur qui est à manger, comme "le fromage à lacrème rose, celui où l'on m'avait permis d'écraserdes fraises", les "biscuits roses" achetés pluschers chez Camus, l'aubépine rose, toutes chosesdont le rose fait le prix et excite le désir.1
Le lait est, bien entendu, la nourriture par excellence et
l'on voit son importance explicitée pour la première fois
lors de la première visite à Balbec quand tous les
réconforts sont nécessaires contre l'angoisse du
dépaysement.
Et, en effet, ce soir-là, je frappai trois coups -que, une semaine plus tard, quand je fussouffrant, je renouvelai pendant quelques jourstous les matins parce que ma grand'mère voulait medonner du lait de bonne heure. (I, 668-9)
Il y a pourtant un trait bien enfantin dont Marcel essaiera
de se débarrasser plus tard - le dégoût pour les coquillages
et semblables.
De l'autre côté de mon assiette il y en avait uneplus petite remplie d'une matière noirâtre que jene savais pas être du caviar. J'étais ignorantde ce qu'il fallait en faire, mais résolu à n'enpas manger. (I, 549)
...(augmentait l'impression de dégoût que j'avaisà cette heure-là, car la chair vivante des huitresme répugnait encore plus que la viscosité desméduses ne me ternissait la plage de Balbec) (I,696)
1 Antoine Compagnon, La Troisième République des lettres,Paris, Seuil, 1983, p.226.
50
... ces affreux petits coquillages, qui, s'il n'yavait pas eu Albertine, m'eussent répugné, nonmoin d'ailleurs que les escargots. (III, 117)
Mais voir la section 4.3.2 qui suit, sur les marchandes de
ces petites bêtes.
4.2 LES NOURRICES FAMILIALES
4.2.1 Grand'mère/mère/tante
Même si l'on ne veut pas suivre jusqu'au bout Doubrovsky
quand il prétend que la mère, la grand'mère et la tante
Léonie sont interchangeables, elles ont certainement des
traits en commun. Elles nourrissent par intermittence, la
mère quand elle n'est pas en train de recevoir Swann à dîner
(au lieu de monter embrasser son fils) et la tante Léonie
quand elle ne pense pas aux autres ("ils doivent avoir une
faim" (I, 134), "il faut leur faire du veau"). Cette
dernière, par surcroît, ne mange pas elle-même mais subsiste
d'eau de Vichy; en fait c'est une malade imaginaire: elle a
écarté les médecins qui auraient prêché
la doctrine subversive qu'une petite promenade ausoleil et un bon biftek saignant (quand ellegardait quatorze heures sur l'estomac deuxméchantes gorgées d'eau de Vichy!) lui feraientplus de bien que son lit et ses médecines. (I, 69)
51
Les rapports qu'a la grand'mère à elle seule avec l'objet
comestible viennent renforcer son caractère de bonté et de
bon sens. Si on peut être d'accord avec Compagnon1 pour
croire que les questions morales n'entrent pas dans le jeu
proustien, (et que cette absence se traduit même par des
tropes plutôt liés à la flore qu'à la faune: "It is
significant that the majority of his images are botanical.
He assimilates the human to the vegetal. He is conscious
of humanity as flora, never fauna... This preoccupation
accompanies very naturally his complete indifference to
moral values and human justices. Flower and plant have no
conscious will... There is no question of right or
wrong."2), on ne peut nier que la grand'mère incarne toutes
les bonnes qualités, qui la distinguent des gens du monde,
préoccupés qu'ils sont par la mode et les apparences et ne
songeant qu'à eux-mêmes. Quoiqu'ennemie farouche de
l'alcool, elle en cherche deux fois, pour la santé de son
cher petit-fils.
Depuis longtemps déjà j'étais sujet à desétouffements et notre médecin, malgré ladésapprobation de ma grand'mère, qui me voyaitdéjà mourant alcoolique, ma'avait conseillé... deprendre... du cognac... Elle me quitta aussitôt,j'entendis la porte-cochère et elle rentra avec ducognac qu'elle était allée acheter parce qu'il n'yen avait pas à la maison. (I, 496-7)
1 A. Compagnon, Proust entre deux siècles, chapitre 6.
2 Beckett, Proust, p.89.
52
Quand j'eus expliqué mon malaise à ma grand'mèreelle eut un air si désolé, si bon, en répondant"Mais alors, va vite chercher de la bière ou uneliqueur, si cela doit te faire du bien" que je mejetai sur elle et la couvris de baisers. (I, 651)
Peut-il y avoir un plus grand sacrifice de la part de la
nourrice que de nourrir avec ce qu'elle considère être un
poison?
Elle n'aime pas les frivolités, ni les mondanités. Elle
tient à ses manières simples, naturelles et nobles.
... nous mangions des oeufs durs dans la salade,ce que était réputé commun et ne se faisait pasdans la bonne société d'Alençon. (I, 676)
... en cuisine où elle détestait ces "piècesmontées" dans lesquelles on reconnaît a peine lesaliments qui ont servi à les faire. (I, 734)
Elle fait appel à sa chère Mme de Sévigné pour exprimer ce
qu'elle ressent, même a l'égard de la restauration à Balbec,
avec ses repas, "repas que ma grand'mère, citant toujours
Mme de Sévigné, prétendait être "d'une magnificence à mourir
de faim"" (I, 694) et ses fruits médiocres: "Je ne peux
pas, ajouta-t-elle, dire comme Mme de Sévigné que si nous
voulions par fantaisie trouver un mauvais fruit, nous
serions obligés de le faire venir de Paris." (I,697).
Surtout, dans une image qui reflète jolîment le parallèle
déjà cité entre lire et manger, elle "jugeait les lectures
futiles aussi malsaines que les bonbons et les pâtisseries."
(I, 39)
53
4.2.2 Françoise
Si les parents - mère, grand'mère, tante - sont en quelque
sorte les nourrices ontologiques (pour reprendre le terme de
Doubrovsky), en fait celle qui prépare la nourriture
véritable est Françoise. Mis à part son rôle de créateur,
analysé dans le chapitre trois, elle a un statut très
ambigu, bonne et cruelle, s'emparant et se parant d'imagerie
à la fois réaliste et rocambolesque, mais à la fin
acceptable parce que traduisant par son étrangeté la grande
importance de Françoise en tant que personnage et symbole.
Elle est surtout un être explicitement (et non pas
implicitement comme les précédents) céleste. C'est un
mélange, comme sans doute tous les êtres mythiques, de
bontés et de caprices cruels.
[L'arrière-cuisine] avait moins l'air de l'antrede Françoise qu'un petit temple de Vénus. Elleregorgeait des offrandes du crémier, du fruitier,de la marchande de légumes, venus parfois deshameaux assez lointains pour lui dédier lesprémices de leurs champs. Et son faîte étaitcouronné d'une roucoulement de colombe. (I, 72)
Les derniers rites achevés, Françoise, qui était àla fois, comme dans l'église primitive, lecélébrant et l'un des fidèles, se servait undernier verre de vin. (II, 17)
Mais elle n'est pas qu'une déesse bienfaisante: elle
commande avec cruauté à ses esclaves et à la nature même.
54
on s'étonnait même que Françoise lui [à la fillede cuisine] laissât faire tant de courses et debesogne (I, 80)
Françoise, commandant aux forces de la naturedevenues ses aides, comme dans les féeries où lesgéants se font engager comme cuisiniers, frappaitla houille... (I, 120)
Elle était en train de tuer un poulet qui par sarésistance désespérée et bien naturelle, maisaccompagnée par Françoise hors d'elle, tandisqu'elle cherchait à lui fendre le cou sousl'oreille, des cris de "sale bête! sale bête!",mettait la sainte douceur et l'onction de notreservante un peu moins en lumière qu'il n'eût fait,au dîner du lendemain, par sa peau brodée d'orcomme une chasuble et son jus précieux égouttéd'un ciboire. (I, 122)
Elle est "pacifiste mais cruelle" (I, 484). Elle a "la
rudesse insensible de la paysanne qui arrache les ailes des
libellules avant qu'elle ait l'occasion de tordre le cou aux
poulets." (II, 320)
Cette créature divine est cependant si liée à sa profession
qu'elle regarde passer le monde et ses affaires en les
jugeant avec des termes culinaires, et ce sont les
faiblesses gastronomiques qui la dégoûtent. Quand il est
question, lors de la jalousie maniaque du narrateur,
d'identifier deux bagues, Françoise de promulguer "Rien qu'à
les apercevoir j'aurais juré qu'elles venaient du même
endroit. Ca se reconnaît comme la cuisine d'une bonne
cuisinière." (III, 463)
Sous son regard, les gens se caractérisent par leur égard ou
leur manque d'égard envers la nourriture. Elle s'acharne,
55
par sympathie avec Marcel, contre la petite bande:
Il en était de même quand je faisais préparer dessandwiches au chester [trad. ang.: cheddar] et àla salade et acheter des tartes que je mangeais àl'heure du goûter, sur la falaise, avec ces jeunesfilles et qu'elles auraient bien pu payer à tourde rôle si elles n'avaient pas été aussiintéressées, déclarait Françoise. (I, 897)
C'était Mme de Guermantes, et grâce à Françoise,je possédais assez vite des renseignements surl'hotel... "Oh! les beaux faisans à la fenêtre dela cuisine, il n'y a pas besoin de demander d'oùils deviennent, le duc aura-t-été à la chasse". (II, 16)
- Oui, chez Mme Octave, ah! une bien saintefemme... où il y avait toujours de quoi, et dubeau et du bon, une bonne femme, vous pouvez dire,qui ne plaignait pas les perdreaux, ni lesfaisans... (II, 26)
Elle était surtout exaspéréé par les biscottes depain grillé que mangeait mon père. Elle étaitpersuadée qu'il en usait pour faire des manièreset la faire "valser". (II, 27)
4.3 LES NOURRICES (SUITE)
Si la mère est évidemment la nourrice par excellence, et le
lait la nourriture essentielle, il ne faut pas s'étonner si
des fournisseuses moins célestes jalonnent le récit
proustien. Il s'agit en effet d'un nombre surprenant de
marchandes de toutes sortes, mais surtout de marchandes de
produits laitiers. Proust met son imprimatur propre sur ces
héroïnes du temps des seigneurs, jeunes filles mythiques,
douces, belles et surtout, puisque assujetties, disponsibles
56
- sans doute l'image fondamentale de l'objet sexuel pour
certains.
4.3.1. Les laitières
On trouve, signale Doubrovsky, "une série impressionnante de
"laitières" qui traversent la Recherche d'un bout à l'autre
et que désire le narrateur, mais qui sont des "fillettes",
donc interdites à la possession génitale."1 Il est permis
de trouver cette interprétation un peu poussée; on sent
qu'elle est là pour renforcer la thèse générale (comme
dirait le duc de Guermantes) qui veut que Marcel ne soit pas
à la hauteur d'une possession adulte. Or, il serait plus
facile, et donc moins intéressant de croire que ces jeunes
femmes représentent au contraire la disponibilité, en
principe, de celle qui fournit toutes les bonnes choses, le
lait avant tout. Il faut souligner en principe, car des
obstacles s'élèvent sans cesse entre le narrateur et ces
objets désirés, mais ces obstacles sont dans la nature des
choses, et sans doute dans l'imagination de Marcel; le
statut de fillette n'y entre pas.
Dans la description du célèbre voyage en train, où tout est
nouveau, donc hyper-présent à la sensibilité de Marcel, tous
les ingrédients du bonheur sont là, même si la distance et
1 Doubrovsky, p. 42.
57
la vie réelle viennent barrer la route à la joie rêvée.
Cependant le narrateur est très clair en insistant que "la
belle fille" n'est pas en elle-même l'objet désiré mais
qu'elle partage l'occasion du voyage pour combler et ajouter
au réveil des facultés endormies.
Je faisais bénéficier la marchande de lait de ceque c'était mon être au complet, apte à goûter devives jouissances, qui était en face d'elle. (I, 656)
La laitière qui apparaît à la petite gare est sans doute en
quelque sorte l'incarnation de la mère dont, nous l'avons
vu, Marcel cherche l'amour sans intermittences ("J'avais
besoin d'être remarqué d'elle... Il eût suffi que
j'habitasse assez près de la petite station pour pouvoir
venir tous les matins [voir la section 4.2.1] demander du
café au lait à cette paysanne." I, 657), mais aussi elle est
l'icône d'un bonheur à jamais introuvable, et dont les
autres éléments sont à définir.
Que mon exaltation eût été produite par cettefille, ou au contraire eût causé la plus grandepartie du plaisir que j'avais eu à me trouver prèsd'elle, en tous cas elle était si mêlée à lui quemon désir de la revoir était avant tout le désirmoral de ne pas laisser cet état d'excitationpérir entièrement, de ne pas être séparé à jamaisde l'être qui y avait, même à son insu, participé. (I, 657)
Une deuxième laitière traverse le chemin de Marcel lors de
son premier séjour à Balbec où l'on sent qu'il est prêt à
toutes les aventures. Sa grand'mère et Mme de Villeparisis
refusent de le laisser descendre, même si elles ne savent
pas qu'il est à la recherche d'une "belle fille", vue mais
58
anonyme (fruit donc explicitement défendu par les aïeules).
Cependant une laitière semble promettre plus: "je crus que
je pourrais la connaître [au sens biblique?] comme je
voudrais." (I, 714). Or, la lettre qui arrive à l'hôtel le
lendemain n'est pas d'elle mais de Bergotte, et ce n'est pas
la seule fois que la déception/délivrance s'effectue par la
lecture.
Les laitières sont toujours là, en leit-motiv des moments
difficiles du coeur:
tout heureux aussi flânant dans la rue que déjà demon lit j'entendais crier lumineusement comme uneplage [voir plus loin les marchandes decoquillages] de voir, sous le rideau de fer levédes crémeries [voir chapitre cinq], les petiteslaitières à manches blanches. (II, 371)
Elles sont libres, et fugaces.
les laitières attachaient vivement les bouteillesde lait. La vue nostalgique que j'avais de cespetites filles, pouvais-je la croire bien exacte? N'eût-elle pas été autre si j'avais pu garderimmobile quelques instants auprès de moi une decelles que, de la hauteur de ma fenêtre, je nevoyais que dans la boutique ou en fuite? (III,138)
La fonction ultime de ces jeunes personnes devient claire
quand Françoise amène une crémière. "Françoise... s'était
drapée de cette majesté qui ennoblit les entremetteuses..."
(III, 141). Mais en fait l'approche d'une vraie laitière
est plus troublante qu'agréable. "L'entrée de la petite
laitière m'ôta aussitôt mon calme de contemplateur". On se
59
trouve devant ce rêve, ce paradoxe, bien connu des
homosexuels, de pouvoir trouver un homme véritable qui soit
prêt à accepter la présence d'un autre homme en tant
qu'amant, ou de pouvoir trouver, pour aucun mâle "normal",
une vraie écolière, une vraie religieuse.
Elle était parée pour moi de ce charme del'inconnu qui ne se serait pas ajouté pour moi àune jolie fille trouvée dans ces maisons où ellesvous attendent. Elle n'était ni nue, nidéguisée, mais une vraie crémière... (III, 141)
Se poursuit alors une scène étonnante par sa richesse
d'imagination concernant les possibilités érotiques des
marchandes et des laitières, mais sans étonner le lecteur
qui s'attend à ce qu'il ne se passe rien. Cette confusion
et ce manque se traduisent, évidemment, par des analogies
bien littéraires.
La curiosité amoureuse est comme celle qu'excitenten nous les noms de pays: toujours déçue, ellerenaît et reste toujours insatiable. (III, 143)
En plus, le pauvre héros, pour se "donner une contenance",
demande à la laitière: "Seriez-vous assez bonne pour me
passer le Figaro qui est là...?", et voilà que le spectre
d'Albertine revient.
4.3.2 Les marchandes de coquillages et autres
fournisseuses
Ce que toutes les marchandes ont en commun avec les
60
laitières c'est qu'elles représentent la liberté. Pour
quelqu'un qui est emprisonné dans les bonnes manières d'une
haute société dont les règles marquent surtout les femmes,
ces jeunes personnes présentent une double face:
disponibilité envers le narrateur, et liberté pour elles,
et, par métonymie rêvée, pour lui. Cela devient clair
quand le narrateur cherche à se décider s'il va épouser
Albertine ou non. Pendant qu'il réfléchit, il songe aux
nouveautés insoupçonnées dont il se priverait.
si... j'allais écarter un instant le rideau de mafenêtre... c'était aussi pour apercevoir quelqueblanchisseuse portant son panier à linge, uneboulangère à tablier bleu, une laitière en bavetteet manches à toile blanche [que de couleurspropres à une mariée!], tenant le crochet où sontsuspendues les carafes de lait... Mais si lesurcroît de joie apporté par la vue des femmesimpossibles à imaginer a priori, me rendait plusdésirables... la rue, la ville... il me donnaitpar là même la soif [évidemment] de guérir, desortir et, sans Albertine, d'être libre. (III, 27-28)
Cette liberté se voit incarnée surtout par une marchande
très spécialisée, qui s'entoure de symboles "transparents".
C'est la marchande de coquillages; d'abord elle hante les
plages et les lieux de séjour, là où l'habitude et les lois
de la vie quotidienne n'ont plus d'emprise: c'est les
vacances; tout est permis. De plus, et faisant appel à un
symbolisme plus évident encore, elle vend des coquillages.
Le symbolisme des petites coquilles bi-valves n'est pas à
souligner. Il suffit de se rappeler par surcroît "la valve
rainurée d'une coquille", le fons et origo de ce flux
61
mémorial. Il n'y a pas que les fruits (défendus) qui se
croquent.
Cette présence désirée terre/mère/amante apparaît pour la
première fois lors d'une considération suivie sur la
nécessité de l'emboîtement des éléments du bonheur. Le
bonheur ne peut s'atteindre que sous forme d'ensemble (ou,
comme nous l'avons vu, sous forme de bouquet, de faisceau).
Pour Marcel adolescent tout ce qui est hors de lui est
précieux, mais hors de lui tout fond et se confond.
Et la terre et les êtres, je ne les séparais pas. J'avais le désir d'une paysanne de Méséglise ou de Roussainville, d'une pêcheuse de Balbec, commej'avais le désir de Méséglise et de Balbec...Connaître à Paris une pêcheuse de Balbec..., c'eûtété recevoir des coquillages que je n'aurais pasvus sur la plage. (I, 157)
Des jeux de mots, sur pêchés et même pêches, viennent
enrichir encore ces rêves.
Plus loin cette présence devient réelle; les coquillages
deviennent poissons, mais il est permis de croire qu'en fait
il s'agit encore de coquillages, étant donnée toute
l'imagerie sur "ouvrir" et "pénétrer" qui les pare. "Il y
en avait une grande qui, assise à demi sur le rebord du
pont, laissant pendre ses jambes, avait devant elle un petit
pot plein de poissons qu'elle venait probablement de
pêcher". (Huit plosives de suite). Elle présente la même
double face que toutes ces jeunes personnes, avec "des yeux
doux, mais un regard dédaigneux". Et le narrateur
62
d'essayer de pénétrer dans cette fille/coquille, d'atteindre
la personne "qui vivait en lui", mais "cet être intérieur...
semblait m'être clos encore, je doutais si j'y étais entré."
(I, 716), Enfin il réussit une "possession immatérielle"
en lui confiant un message pour Mme de Villeparisis. C'est
par la parole, la langue à distance, que le lien se fait.
Ce n'est pas avec les jeunes filles de bonne famille, du
même niveau social que le narrateur, que de tels liens
immédiats peuvent se forger.
C'est un grand charme ajouté à la vie dans unestation balnéaire comme était Balbec, si le visaged'une jolie fille, une marchande de coquillages,de gâteaux ou de fleurs... est quotidiennementpour nous... le but de chacune de ces journées...Mais au moins, ces petites marchandes, on peutleur parler... Or, il n'en était nullement ainsipour moi en ce qui concernait les jeunes filles dela petite bande. (I, 830-1)
La marchande qui court les plages n'a rien perdu de sa
magie: cette femme à la fois disponible mais autonome et
libre réapparaît dans deux films assez récents, Pauline à la
plage, d'Eric Rohmer, (1982), et Ball-trap on the Côte
Sauvage, de Jack Rosenthal (1989).
4.4 LES PROCHES
Entourant la famille et la maison du narrateur, se trouve un
petit groupe de personnages dont la présence et l'influence
se font sentir le long du récit. Il y a comme un système de
63
cercles concentriques avec au centre le narrateur lui-même,
entouré successivement de sa famille (et des gens de la
maison), de ses proches (amis, connaissances, parents) et
enfin du monde (haute société, artistes etc). Cela ne veut
pas dire que les personnages restent à jamais condamnés à un
cercle ou un autre mais pour la plupart la traversée de l'un
à l'autre est explicitée, peut-être par des rites des plus
conventionnels - mariage, présentation, séduction et ainsi
de suite.
4.4.1. Swann
Le premier étranger dont le narrateur ressent la proximité,
une proximité menaçante car le privant de sa mère, est
évidemment Swann. Or, Swann est un personnage très ambigu;
il est à admirer pour ces goûts, ses manières d'homme du
monde, mais ceux-ci tournent au fétichisme. Il est tentant
de croire que le narrateur et l'écrivain voient en lui un
reflet d'eux-mêmes: un dilettante doué, tracassé par une
obsession de possession amoureuse/érotique. Cela dit, les
deux faces ne manquent pas de se compléter en matière de
cuisine. En tant qu'homme cultivé il trouve la cuisine
aussi importante que tous les autres arts (et là, il est
possible de penser, même si Hughes n'en parle pas
explicitement, qu'une pointe d'ironie entre dans l'affaire;
son fétichisme ne le trahit-il pas?). On préférerait sans
64
doute le voir renforcer cette notion proustienne que la
bonne foi compte plus que les apparences.
elle [grand'tante]... n'avait pas haute idée d'unhomme qui dans la conversation, évitait les sujetssérieux et montrait une précision fort prosaïque, non seulement quand il nous donnait, en entrantdans les moindres détails, des recettes decuisine, mais même quand les soeurs de magrand'mère parlaient de sujets artistiques. (I,16-17)
Pour ceux qui préfèrent la prose à la poésie, et la
précision avant tout, la sympathie pourrait se diriger très
facilement vers Swann.
Il est vraiment un familier de la maison, mais, cependant,
d'un niveau social inférieur à la famille du jeune narrateur
et cette menue différence se révèle très clairement.
Comme elle [grand'mère] croyait qu'il devait êtreflatté par nos invitations, elle trouvait toutnaturel qu'il ne vînt pas nous voir l'été sansavoir à la main un panier de pêches ou deframboises de son jardin, et que de chacun de sesvoyages en Italie il m'eût rapporté desphotographies de chefs-d'oeuvre. [Voir l'albumdes photos de la grand'mère].
On ne se gênait guère pour l'envoyer quérir dèsqu'on avait besoin d'une recette de sauce gribicheou de salade à l'ananas pour des grands dîners oùon ne l'invitait pas. (I, 18)
Les exemples de son attitude et son savoir-faire ne manquent
pas; quant à son budget, "il en réservait pour d'autres
goûts dont il savait qu'il pouvait attendre du plaisir, au
moins avant qu'il fût amoureux, comme celui des collections
et de la bonne cuisine." (I, 280) Il s'agit de savoir si
65
le fétichisme conscient est un si grand crime.
Lui aussi est amateur des "ensembles", des "faisceaux", qui
exigent presque de l'écrivain une analogie culinaire:
il goûtait un divertissement assez vulgaire àfaire comme des bouquets sociaux en groupant deséléments hétérogènes... "J'ai l'intentiond'inviter ensemble les Cottard et la duchesse deVendôme" disait-il en riant à Mme Bontemps, del'air friand d'un gourmet qui a l'intention etveut faire l'essai de remplacer dans une sauce lesclous de girofle par du poivre de Cayenne. (I, 521)
Mais, après qu'il soit tombé amoureux, voilà que le bonheur
fourni par les collections et la bonne cuisine perd sa
saveur. L'obsession avec Odette se traduit par des
fantaisies, de véritables, où il se voit jouer à papa/maman,
à partager le vrai bonheur avec Odette, un rêve qui est
déclenché par les rites domestiques de l'orangeade et du
thé. L'orangeade et "le menu d'Odette", avec tous les
autres petits détails d'une vie rêvée, partagée, auraient
pris "une sorte de douceur surabondante et de densité
mystérieuse!" (I, 298-9)
4.4.2 Odette
Or, il suffit d'examiner les attitudes d'Odette envers la
nourriture pour voir le genre de femme dont Swann s'est
épris. Mis à part les petits jeux domestiques où elle
66
prépare l'orangeade pour Swann et qui font partie, sans
doute, de ses arts professionnels, elle recherche le dernier
cri, l'exotique toujours. C'est chez elle que le narrateur
goûte, ou ne goûte pas, le caviar (I, 549); il trouve
"l'atmosphère du salon ambrée par le samovar - importation
récente alors" (I, 593); "elle croyait montrer de
l'originalité et dégager du charme en disant à un homme:
"Vous me trouverez tous les jours un peu tard, venez prendre
le thé"" avec en plus l'accent anglais. Cet accent
anglais - "un rien d'accent anglais" - elle ne l'a pas perdu
même après cette transformation par laquelle "elle eût été,
dans une exposition végétale d'aujourd'hui, la curiosité et
la clou." (III, 950)
4.4.3 Gilberte
La jeune fille Gilberte non seulement partage les goûts et
les manières de sa mère Odette, avec ses gâteaux au chocolat
exotiques, ses "cakes", et ses "toasts", mais encore elle
répète les mêmes petits jeux de bonheur domestique, qui se
jouent, ainsi qu'entre Odette et Swann, entre Gilberte et
Marcel. Seulement ces tête-à-tête sont imbus d'une
résonance si intense que l'hypersensibilité gastronomique du
jeune narrateur se voit attaquée de tous les côtés, le
laissant dans un état de paralysie, "déjà dépouillé de ma
pensée et de ma mémoire, n'étant plus que le jouet des plus
vils reflexes", "la mémoire vide et l'estomac paralysé",
67
"dans un état d'ivresse où une décision est impossible".
Le danger et le charme (la drogue même) sont partout, dans
ce "Temple asiatique", où le narrateur assiste à une
terrible destruction (de lui-même?) d'où sortent des "fruits
écarlates" et un "goût oriental". (I, 506-7) Doubrovsky
a aussi repéré le danger que représente cette Gilberte
"nourrice". "... ce ne sont pas seulement les mères qui en
veulent à votre sommeil."1
4.4.4 Albertine
Albertine en fait, et maintes critiques l'ont souligné, a
très peu de vie autonome: elle est l'objet par excellence,
et par-là même l'objet passif. Pour ce qui concerne ce
travail, son statut est évident; elle incarne en elle-même
la possibilité, à jamais irréalisable, d'assouvir la faim et
la soif ontologiques du narrateur. Elle est donc nourrice
et boisson, mais comme nous l'avons vu, les surfaces en
chair vivante sont résistantes (si ce n'est celle des
petites coquilles).
Enfin... je vais savoir le goût de la roseinconnue que sont les joues d'Albertine... Je medisais que j'allais connaître le goût de cetterose charnelle, parce que je n'avais pas songé quel'homme, créature évidemment moins rudimentaireque l'oursin ou même la baleine manquent cependantencore d'un certain nombre d'organes essentiels,et notamment n'en possède aucun qui serve aubaiser... les lèvres... doivent se contenter... de
1 Doubrovsky, p.38.
68
vaguer à la surface et de se heurter à la clôturede la joue impénétrable et désirée. (II,364)
Cependant, hormis ce symbolisme transparent, qui réapparaît
le long de la vie partagée, anticipée, vécue, et regrettée,
avec Albertine, on trouve, dans cette vie, les mêmes petits
jeux de ménage qui caractérisent la vie du couple, de
Swann/Odette et de Marcel/Gilberte enfants.
j'attachais beaucoup d'importance à avoir avec moiune jeune ménagère qui saurait bien mieuxcommander le dîner que moi. (II, 386)
4.4.5. Saint-Loup
Le cas de Saint-Loup est bien plus riche en ce qui concerne
ses rapports rhétoriques, et narratifs, avec le comestible.
On est en droit de voir dans la personne de Saint-Loup celui
qui incarne, bien sûr, l'autre, mais aussi, soi-même. Il
est l'homme que Marcel aurait voulu être (sans réserve à
l'encontre du cas de Swann), mais en même temps il est (voir
plus haut) fournisseur de bonnes choses et maître des
problèmes de la vie mondaine. Les plaisirs partagés par
Saint-Loup et le narrateur sont des plus intimes (comme
Doubrovsky l'a remarqué dans le cas de la tante Léonie1) -
le sommeil et la nourriture; mais ce qui vient mettre en
relief les prises qu'a Saint-Loup sur le narrateur, c'est
cet enchevêtrement de tropes qu'on a décrit au chapitre
1 Doubrovsky, p.78.
69
deux, cette richesse linguistique qui étoffe les
descriptions des heures passées avec Saint-Loup, militaire,
surtout dans sa chambre, à Doncières. Par une très jolie
inversion (voir aussi Barthes sur l'idée que "l'inversion -
comme forme - envahit toute la structure de la Recherche"1)
de manque souhaitable,
Des tentures de liberty et de vieilles étoffesallemandes du XVIIIe siècle la préservaient del'odeur qu'exhalait le reste du bâtiment,grossière, fade et corruptible comme celle du painbis. (II, 74)
On sent que les plaisirs des dîners partagés, au foyer, dans
de "petites salles à manger oubliées" (II, 396), ou dans de
grands restaurants, ont apporté plus de bonheur véritable au
narrateur que toutes les soirées mondaines. Même dans les
cafés bruyants, Saint-Loup a ce pouvoir magique qu'ont
certaines gens (la mère et la grand'mère surtout) d'apaiser
ses terreurs.
Le malheur pour moi voulut que, Saint-Loup étantresté quelques minutes à s'adresser au cocher afinqu'il revînt nous prendre aprés avoir dîné, il mefallut entrer seul.
Il [le patron] me donnait des marques de respectexcessives pour que j'oubliasse qu'elles n'avaientpas commencé dès mon arrivée, mais seulement cellede Saint-Loup. (II, 401 et 407)
1 Roland Barthes, 'Une idée de recherche', Recherche deProust, 1980, p.36.
70
4.5 LE MONDE
Ayant signalé que le statut social et amical de maints
personnages change sans cesse et parfois brusquement1 le
long du récit, on parlera brièvement de quelques autres
personnages dans leurs rapports dans l'esprit du narrateur
et dans leur propre vie, avec l'objet comestible. Il y a
un sens (voir chapitre trois sur la création) où tous les
personnages sont les ingrédients de la pièce montée qu'est A
la recherche du temps perdu2, mais de temps en temps la
comparaison se particularise: parmi les habitués du
restaurant pourrait se trouver "une vieille dame serbe dont
l'appendice buccal est d'un grand poisson de mer, parce que
depuis son enfance elle vit dans les eaux douces du faubourg
Saint-Germain" (I, 681). La duchesse de Guermantes, aussi,
vers la fin de sa vie, lors de la matinée révélatrice, se
voit transformée en "poisson sacré", à "corps saumoné" (III,
927) mais ses joues, quoique restées semblables, sont
pourtant "devenues comme un nougat" (III, 937). Par la même
occasion, les jeunes semblent maintenant pouvoir classer les
différents membres de la famille Guermantes, croyant "que
c'était une Guermantes d'une moins bonne cuvée, d'une moins
bonne année, une Guermantes déclassée". (III, 1104)
1 R. Barthes, p.34.
2 V. E. Graham, The Imagery of Proust, p.214.
71
La marquise de Gallardon, pensant justement à ses relations,
ou leur manque, avec les Guermantes, "rejetait fièrement en
arrière ses épaules détachées de son buste et sur lesquelles
sa tête faisait penser à la tête "rapportée" d'un
orgueilleux faisan qu'on sert sur une table avec toutes ses
plumes". (I, 329). Ski, par contre, n'était "pas plus
modifié qu'une fleur ou un fruit qui a séché". (III, 936)
Ces épithètes, comme il est coutume chez Proust, se mêlent à
la vie véritable de ces gens, pour leur fournir encore un
élément essentiel à cette existence qui se veut ancrée dans
les choses et les actes quotidiens, et le quotidien doit se
nourrir, d'aliments bien sûr, mais aussi de bonnes manières,
de concurrences, d'amitiés et d'échanges. Les Cottard, par
exemple, comparses quand même sympathiques, ont leurs
petites manies, lui de vouloir toujours mettre ses malades
au régime lacté (I, 498) et elle de connaître toutes les
bonnes adresses, ou d'en faire semblant:
Je n'ai pas besoin de vous demander la marque defabrique, je sais que vous faites tout venir dechez Rebattet. Je dois dire que je suis pluséclectique. Pour les petits fours, pour toutesles friandises, je m'adresse souvent àBourbonneux. (I, 604)
Monsieur de Norpois, visiteur fréquent chez la famille du
narrateur, se lie d'une charmante amitié avec l'amie de la
grand'mère, Mme de Villeparisis. Le premier est un vrai
critique, mais diplomatique:
72
Vous avez un chef de tout premier ordre, Madame,dit Monsieur de Norpois... Ma mère comptaitbeaucoup sur la salade d'ananas et de truffes. Mais l'ambassadeur, après avoir exercé un instantsur le mets la pénétration de son regardd'observateur, la mangea en restant entouré dediscrétion diplomatique et ne nous livra pas sapensée. (I, 458-9).
La seconde est très gourmande: la grand'mère voudrait
savoir, à Balbec, "comment elle faisait pour avoir son
courrier plus tôt que nous et de bonnes grillades" (I, 694);
elle sait que "C'est toujours plus prudent d'avoir du fruit
quand on est au bord de la mer." (I, 696); par trop de
gentillesse, "elle avait commandé pour nous à l'hôtel des
"croque-monsieur" et des oeufs à la crème." (I, 699);
elle reste "si longtemps pour moi la dame qui m'avait donné
une boîte de chocolat tenu par un canard." (I, 754)
Or, dans la dernière partie du récit, les voilà réunis par
une vraie amitié qui dépend de plaisirs partagés dépassant
de loin celui de l'amour - la table et le voyage - traduite
par ces questions pratiques "où s'empreint le prolongement
d'un mutuel amour." Encore une fois, c'est à Venise que
les yeux du narrateur voient clair.
Depuis un mois qu'ils sont ici, ils n'ont pasmangé qu'une fois l'un sans l'autre, dit legarçon... "Voilà le menu. Il y a comme entréedes rougets. Voulez-vous que nous en prenions? - Moi, oui, mais vous, cela vous est défendu. Demandez à la place du risotto. Mais ils nesavent pas le faire.
73
- Cela ne fait rien. Garçon, apportez-nous d'aborddes rougets pour Madame et un risotto pour moi. (III, 631-2)1
Pour les Verdurin, et les Guermantes, la gastronomie fait
partie d'un spectacle sans cesse renouvelé, marqué par les
goûts changeants, la mobilité montante sociale, la cruauté
et l'insouciance.
La force de Mme Verdurin, c'était l'amour sincèrequ'elle avait de l'art, la peine qu'elle sedonnait pour les fidèles, les merveilleux dînersqu'elle donnait pour eux seuls... Sa présence[celle d'un artiste célèbre] chez une Mme Verdurinn'a rien de côté factice, frelaté, cuisine debanquet officiel ou de Saint-Charlemagne faite parPotel et Chabot, mais d'un délicieux ordinaire...il ne manquait que le public (III, 236).
L'arrivée de la guerre n'ébranle pas ses priorités.
Elle reprit son premier croissant le matin où lesjournaux narraient le naufrage du Lusitanie.
1 Voir aussi l'appendice au troisième volume de l'EditionPléïade pour un enrichissement de cette rencontre:
Je voyais qu'il aimait toujours autant la cuisinequ'au temps où il dînait à la maison, et Mme deVilleparisis se montrait aussi difficile qu'àBalbec. "Mais non, ne leur demandez pas uneomelette soufflée, dit M. de Norpois, ils n'ontaucune idée de ce que c'est. Ils vous apporterontquelque chose qui n'a aucun rapport avec uneomelette soufflée. Aussi, que voulez-vous, c'estvotre faute, vous ne voulez pas entendre parler decuisine italienne." Mme de Villeparisis nerépondit pas, puis an bout d'un moment, en uneplainte aussi faible et aussi triste que celle duvent, elle gémit dans un murmure: "On ne sait plusrien faire; je ne sais pas si vous vous rappelez,autrefois, chez ma mère, on réussissait si bien cequ'on appelait une crème renversée. On pourraitpeut-être leur en demander une. - Cela nes'appelait même pas encore une crème renversée,cela s'appelait, dit M. de Norpois en mettant lemot comme entre guillemets, des oeufs au lait. Ce qu'ils vont vous donner ne sera pas fameux. Les oeufs au lait, c'était onctueux, cela avait uneatine, vous vous rappelez?"
74
(III, 772).
Chez les proches des Guermantes,
Aussitôt l'ordre de service donné, dans un vastedéclic giratoire, multiple et simultané, lesportes de la salle à manger s'ouvrirent à deuxbattants; un maître d'hôtel qui avait l'air d'unmaître de cérémonies s'inclina devant la princessede Parme et annonça la nouvelle: "Madame estservie", d'un ton pareil à celui dont il auraitdit: "Madame se meurt", mais qui ne jeta aucunetristesse dans l'assembléé, car ce fut d'un airfolâtre, et comme l'été à Robinson... (II, 434)
Une petite histoire d'envoi de faisans montre de façon
horriblement claire le côté méchant des Guermantes; la
duchesse insiste pour que son valet manque sa seule
possibilité de rendez-vous avec sa fiancée pour une
fantaisie de "gentillesse" gastronomique. (II, 484)
Le baron Charlus, en être ambigu, a une attitude ambiguë
devant la gastronomie, mais en homme de monde, il s'y
connaît.
Il reconnaissait immédiatement ce à quoi personnen'eût jamais fait attention, et cela aussi biendans les oeuvres d'art que dans les mets d'undîner (et de la peinture à la cuisine toutl'entre-deux était compris). (III, 208)
(Est-ce un souvenir antérieur de l'ouvrage de Compagnon?1)
Il ne choisit que ces aspects de la vie moderne qui lui
plaisent. On dirait à un moment qu'il partage l'horreur de
la grand'mère pour le nouveau:
ils m'ont convié comme vous, je le vois, à lachose la plus impossible à concevoir et à réaliseret qui s'appelle, si j'en crois la carte
1 A. Compagnon, Proust entre deux siècles.
75
d'invitation: "Thé dansant". Je passais pourfort adroit quand j'étais jeune, mais je doute que j'eusse pu sans manquer à la décence prendremon thé en dansant. (III, 268)
Cependant il est des passions nouvelles dont il ne faut pas
se priver, parmi lesquels ces "excellents cocktails".
(III, 781)
4.6 CONCLUSION
Toujours donc cette recherche et ce renforcement de la
simplicité, le propre de la noblesse véritable, qui se
traduit par exemple par
le petit tablier [de Mme de Villeparisis] quiapparut alors à sa taille... [et qui] ajoutaitencore à l'impression presque d'une campagnardeque donnaient son bonnet et ses grosses lunetteset contrastait avec le luxe de sa domesticité, dumaître d'hôtel qui avait apporté le thé et lesgâteaux...(II, 198-9)
Elle a sa façon de parler à la duchesse de Guermantes,
- Pense à dire à Gisèle et à Berthe (les duchessesd'Auberjon et de Portefin) d'être là un peu avantdeux heures pour m'aider, comme elle aurait dit àdes maîtres d'hôtel extra d'arriver d'avance pourfaire les compotiers. (II, 216)
La banalité et la noblesse authentique, et la créativité
véritable ne peuvent se dénouer. La mort d'un des seuls
artistes conscients véritables du récit le prouve...
Bergotte mangea quelques pommes de terre, sortitet entra à l'exposition... Il se répétait: "Petitpan de mur jaune avec un auvent, petit pan de murjaune." Cependant il s'abattit sur un canapécirculaire; aussi brusquement il cessa de penserque sa vie était en jeu et, revenant à
76
l'optimisme, il dit: "C'est une simpleindigestion que m'ont donnée ces pommes de terrepas assez cuites, ce n'est rien." Un nouveaucoup l'abattit, il roula du canapé par terre, oùaccoururent tous les visiteurs et gardiens. Ilétait mort. (III, 187).
Il y a donc trois aspects saillants qui se dégagent à
première vue de cette considération du rapport
nourriture/personnage, et nous y découvrons sûrement des
idées clés de Proust. Il faut reconnaître d'abord
l'importance capitale de la nourrice, dont le rôle
primordial se transforme en un nombre impressionnant de
personnifications, depuis la mère/grand'mère/tante jusqu'aux
marchandes de toutes sortes. Ensuite, les connaisseurs,
les vrais, le sont par égard pour tous les arts, "de la
peinture à la cuisine"; l'objet de la critique compte moins
que la bonne foi qui soutient une attention formée et
sérieuse. Enfin, les âmes nobles, par une inversion
barthésienne, doivent leur noblesse à un manque de
raffinement, et à un surplus de simplicité.
77
5 LES ENDROITS
Nous avons vu que les personnages ont des rapports parfois
surprenants avec l'objet comestible; souvent ces rapports
ne dépendent pas seulement du statut instrinsèque du
personnage en question mais détiennent leur force narrative
d'un certain manque de prise avec le monde stable et
sérieux: il s'agit de ces figurantes ambulantes que sont
les marchandes des quatre-saisons. Or l'intérêt que nous
pouvons porter à ces jeunes personnes se base sur leur lieu
de travail, et non pas sur leur travail lui-même. Il
s'agit donc d'examiner de plus près certains de ces lieux
privilégiés où des transactions concernant l'objet
comestible s'effectuent le long de A la recherche du temps
perdu. Par transactions il faut entendre aussi bien que la
consommation, l'échange et la vente.
5.1 LES ENDROITS OU L'ON MANGE
5.1.1 Intérieur
Pour commencer par ce qui se passe ordinairement, dans la
vie, il faut reconnaître que normalement on mange à
l'intérieur, on bien chez soi, ou bien chez autrui, en privé
ou en public. Or, comme chez Proust il est clair que
78
l'acte de consommer passe souvent pour l'équivalent d'un
acte de connaissance ou d'un essai d'assouvir un désir plus
ou moins conscient, il n'est pas étonnant si le cadre de ces
épisodes s'enrichit de cette patine rhétorique proustienne
connue.
Repérons d'abord quelques-unes de ces salles à manger que le
narrateur voit comme le foyer de ses préoccupations
courantes. Abandonné dans sa chambre, il envoie un mot
dans le camp de l'ennemi (la compagnie que reçoit la maison)
pour essayer d'en faire sortir sa mère - une salle à manger
"interdite, hostile, où, il y avait un instant encore, la
glace elle-même - le "granité" - et les rince-bouches me
semblaient recéler des plaisirs malfaisants et mortellement
tristes" (I, 30). Dans un tel endroit, évidemment, des
mets chauds passeraient mal.
Gilberte et une servante anonyme (voir chapitre quatre) ont
déjà habité deux des autres salles à manger marquantes: la
première est, pour un jeune homme impressionné jusqu'au
névrose, "un Temple asiatique peint par Rembrandt" (I,
506), tandis que la seconde est une de ces "petites salles à
manger oubliées" faisant partie de cette vie facticement
naturelle menée loin du grand monde. Elle est "en haut,
dans une petite pièce toute en bois,", où la servante doit
allumer "deux bougies". (II, 396). Comme de coûtume, le
souvenir et le désir demandent tous les éléments de la
scène: "le plaisir physique me parut exiger, pour être
79
goûté, non seulement cette servante mais la salle à manger
de bois si isolée." (II, 396)
Puisque la vie en société se passe en grande partie dans des
lieux publics, au théâtre, aux expositions, aux courses, et
bien sûr au restaurant, le lecteur fait la connaissance d'un
grand nombre d'entre eux, depuis l'enfance et la première
visite à Balbec, jusqu'aux voyages à Venise. Or, le
bonheur qui devrait s'y trouver, comme toujours, n'est pas
sans problèmes. Nous avons déjà vu (voir 4.4.6) qu'il faut
la présence apaisante de Saint-Loup pour rendre vivable le
café à Doncières. Le restaurant du Grand-Hotel renferme
les mêmes terreurs - personnel dédaigneux, ajouté à un
manque de savoir de la part du narrateur.
... comme en rentrant devant lui [le directeur],il me salua, sans doute pour montrer que j'étaischez lui, mais avec une froideur dont je ne pusdémêler si la cause était la réserve de quelqu'unqui n'oublie pas ce qu'il est, ou le dédain pourun client sans importance. (I, 691)
Cependant, une fois apaisées les horreurs du dépaysement et
de la solitude, ces restaurants deviennent des microcosmes
meublés, où le bonheur et l'observation du narrateur se
traduisent en longues analogies appropriées. A Rivebelle,
l'espoir de guérir et de pouvoir travailler sérieusement
vient s'ajouter au bonheur d'être à côté de Saint-Loup.
"J'étais un homme nouveau", et le restaurant/zoo, peuplé de
"certaines espèces d'oiseaux rares", se transforme en
système planétaire, où tout est "calme harmonie" sous "une
80
voûte céleste" (II, 810-1) et où, il faut l'espérer, tout se
passera comme prévu.
Grâce encore à l'amitié de Saint-Loup, quoiqu'épistolaire,
et la connaissance des aquarelles d'Elstir, le narrateur
enfin trouve dans le restaurant du Grand-Hôtel une beauté
jusqu'alors insoupçonnée.
Je restais maintenant volontiers à table...J'essayais de trouver la beauté là où je nem'étais jamais figuré qu'elle fût, dans les chosesles plus usuelles, dans la vie profonde des"natures mortes" (I, 869)
En contemplant cette scène "banale", il pense à l'oeuvre
qu'il va faire lui-même.
The book he must write will not express 'loftysubjects' because these are of no real importance. But it will also not be about spoons and napkins. Marcel does not for a moment imply that thesethings have value in themselves. They arevaluable because they point to something they arenot... Only a banal object can provide thatspecial joy.1
Le paradis terrestre que sont les séjours à Doncières avec,
évidemment, Saint-Loup, se reflète dans ce restaurant au
"feu éternel" où l'on prend un "repas d'Evangile" mais qui,
avant tout, se peuple de ces êtres ambivalents que sont les
anges. Si les serviteurs ne sont ni mortels ni divins, ils
est permis de se demander également s'ils sont mâles ou
femelles.
... je crus reconnaître un personnage qui est detradition dans ces sujets sacrés et dont ilreproduisait scrupuleusement la figure camuse,
1 Naomi Segal, The Banal Object: Theme and Thematics inProust, Rilke, Hofmansthal, and Sartre, p. 21.
81
naïve et mal dessinée, l'expression rêveuse, déjàà demie presciente du miracle d'une présencedivine que les autres n'ont pas encoresoupçonnée... à cette figuration fut ajouté unsupplément céleste recruté tout entier dans unpersonnel de chérubins et de séraphins. (II, 99)
Ce sont sans doute des habitants dignes d'un monde
mythique/chrétien de l'entre-deux.
Si le plaisir d'aller dans les restaurants avec Saint-Loup
est des plus évidents, le plaisir qu'il y a à rester chez
lui, et à y manger ne l'est pas moins. Si la possession
charnelle est à la limite impossible, au moins une autre
possession, nourrissante, peut s'accomplir dans une chambre.
- Ah! Robert, qu'on est bien chez vous, lui dis-je; comme il serait bon qu'il fût permis d'ydîner et d'y coucher! (II, 78)
et voilà que c'est fait:
Robert, sans en connaître les causes, était touchéde mon attendrissement. Celui-ci d'ailleurss'augmentait du bien-être causé par la chaleur dufeu et par le vin de Champagne qui faisait perleren même temps des gouttes de sueur à mon front etdes larmes à mes yeux; il arrosait des perdreaux; je les mangeais avec l'émerveillement d'unprofane, de quelque sorte qu'il soit, quand iltrouve dans une certaine vie qu'il ne connaissaitpas ce qu'il avait cru qu'elle excluait (parexemple d'un libre penseur faisant un dîner exquisdans un presbytêre). (II, 80)
Il ne faut pas passer sous silence la longue scène de
chambre jouée par Marcel et Albertine lors de
"l'emprisonnement" de cette dernière. On a beaucoup écrit
sur les cris de la rue (II, 126-31), mais il est permis d'y
voir, dans le cadre du présent travail, une épisode de non-
consommation. Nous voyons deux jeunes gens dans une
82
chambre, à cette heure matinale où les lève-tard sont encore
entre sommeil et réveil, mais où les gens de la rue sont
déjà au travail. Les descriptions des fruits, des légumes,
des glaces et des poissons (voir 4.3.2) sont d'un érotisme
déroutant, mais la charge érotique réside dans le langage
employé et non dans les objets décrits, dans le fait que la
charge passe dans une chambre à coucher, et dans le fait que
nous assistons à une sorte de voyeurisme par l'ouïe. On
entend, sans les voir ni les toucher, ces aliments
délectables. Cette transposition des sens et des
sensations, si fréquente chez Proust, se voit éclairée le
plus fondamentalement possible, par une division spatiale
véritable qui défend le passage de la maison à la rue, et
par cet usage répété de l'outil qui est la langue à distance
- le langage (les cris) et son entendement (l'ouïe).
A l'époque où vit le narrateur il est en train aussi de
vivre la première expérience de cette véritable langue à
distance, cette voie (voix) de communication privilégiée de
l'entre-deux, qu'est le téléphone, animé par des êtres sans
corps, donc encore des anges; c'est un "instrument
surnaturel... dont on se sert maintenant sans même y penser,
pour faire venir son tailleur ou commander une glace."
(III, 32)
83
5.1.2 Extérieur
Si les produits alimentaires peuvent passer de la rue dans
la chambre par le son, il y en a qui se consomment en fait à
l'extérieur, activité hors du commun pour des gens du beau
monde. Il s'agit dans A la recherche du temps perdu, d'une
suite de goûters et de repas pris en plein air, le plus
souvent pendant ces périodes d'hyper-sensibilité que sont
les vacances et les voyages.
Quel est donc le délire du jeune narrateur quand, entouré de
la petite bande, il boude les fermes-restaurants (idée déjà
assez osée) pour aller s'asseoir sur le haut de la falaise
pour pique-niquer? Il ne peut se séparer de ses "gâteaux
instruits", ni de ses "tartes bavardes" qui, en lui
rappelant sa vie de citadin, viennent épicer encore le
contraste entre sa névrosité morbide et la santé
surabondante de ses amies, se gavant de "nourriture
ignorante et nouvelle". (I, 904) Le voilà entouré donc
d'amies métonymiquement devenues visages translucides et
rouges, bouches riantes et bosquet de roses.
Un second contraste, encore plus surprenant, et qui prend
son temps pour révéler sa richesse, est celui qui montre un
princesse du sang en train de se comporter en visiteur au
jardin zoologique. Même les membres de la plus haute
société, quand ils sont privés de leur habitat naturel,
retrouvent une certaine grossièreté mi-touchante, mi-
84
déplaisante. Il s'agit de la princesse de Luxembourg,
rencontrée sur la digue de Balbec.
Ne sachant que faire pour nous témoigner sabienveillance, la princesse arrêta le premier quipassa; il n'avait plus qu'un pain de seigle, dugenre de ceux qu'on jette aux canards. Laprincesse le prit et me dit: "C'est pour votregrand'mère." Pourtant, ce fut à moi qu'elle letendit, en me disant avec un fin sourire, "Vous lelui donnerez vous-même", pensant qu'aussi monplaisir serait plus complet s'il n'y avait pasd'intermédiaires entre moi et les animaux... Parun merveilleux progrès de l'évolution, magrand'mère n'était plus un canard ou une antilope,mais déjà ce que Mme Swann aurait appelé un"baby". (I, 700)
Or, quand le narrateur rencontre cette dame de nouveau, dans
des locaux plus appropriés, il ne peut oublier ce dessous
sans manières révélé si longtemps auparavant. Il fait
preuve d'une fausse naïveté en ne voulant juger les gens que
par leurs gestes et non par leur famille.
... j'avais vu la princesse de Luxembourg acheterdes petits pains de seigle sur la plage pour endonner à ma grand'mère, comme à une biche duJardin d'Acclimatation. Mais ce n'était encoreque le seconde princesse du sang à qui j'étaisprésenté, et j'étais excusable de ne pas avoirdégagé les traits généraux [ou généreux?] del'amabilité des grands. (II, 425-6)
Puisqu'il est question d'actes commis pour une fois à
l'extérieur, cette comparaison rare concernant des animaux
tombe assez bien, mais il est à noter que même ici les
animaux sont en passe d'être flore plutôt que faune - des
objets bien apprivoisés, aptes à la contemplation des
blasés.
Un joli bouquet (voir les nosegays de Nabokov, 2.1.1) est
composé pour les voyages en train - "les levers du soleil",
85
bien sûr, mais aussi "les oeufs durs, les journaux
illustrés, les jeux de cartes, les rivières où les barques
s'évertuent sans avancer." (I, 654-5) Nous savons par là
que c'est avec sa grand'mère qu'il voyage ou qu'il s'en
souvient, puisque les oeufs durs sont une marque de la
simplicité de celle-ci.
5.2 LES MAGASINS D'ALIMENTATION
Les magasins d'alimentation sont comme des maisons de passe,
des endroits qui ne sont ni tout à fait privés, ni tout à
fait publics, et où des transactions un peu louches
s'effectuent, où l'on peut acheter ou goûter, et où quelques
obsessions du narrateur prennent substance. Cette idée
fondamentale de transition, entre par exemple l'état endormi
et l'état éveillé, là où les songes et la réalité
s'entremêlent, se voit reflétéé dans ces endroits où les
individus communiquent par oeillades, à la dérobée.
Quand la jalousie obsessionnelle du narrateur envers
Albertine le possède tout entier, le lecteur assiste à une
petite scène qui montre tout un ensemble d'obsessions
parallèles. Elle se joue dans une pâtisserie qui jouit "à
ce moment-là d'une certaine vogue". Même accablé de sa
passion jalouse, le narrateur veut offrir tout ce qu'il y a
de chic sur le plan mondain à l'être aimé. Non seulement
le magasin est un de ces endroits de transition où l'on ne
passe qu'un quart d'heure pour s'acheter un plaisir, mais il
86
est situé "presque en dehors de la ville." (III, 408-9).
Albertine, que le narrateur soupçonne d'être attirée par les
femmes, cherche, semble-t-il, à attirer justement
l'attention de la pâtissière; celle-ci, bien sûr, incarne
cette autre idée fixe, que nous avons développée plus haut
(voir 4.3), de la femme nourricière, ou par son lait à elle
(la mère) ou par le lait qu'elle vend (la laitière) ou par
les mets qu'elle prépare ou vend (comme la cuisinière
Françoise, ou comme ces dames du comptoir, trônant entre des
vases de verre (III, 826)). Cette incarnation de la
donatrice de subsistance, donc de la vie même, a un côté
divin, souvent chrétien. La pâtissière qui est
indifférente aux regards implorants d'Albertine -
indifférente par une sottise que pour une fois le narrateur
peut bien reconnaître - est d'une "inaccessible divinité".
La divinité des habitants des magasins ne se borne pas aux
seules femmes. Même un ange, sinon une déesse, a le
pouvoir de décider de la vie éternelle ou de la mort. Le
garçon boucher (III, 138), à rapprocher peut-être de ces
autres anges qui habitent le paradis du restaurant de
Doncières (II, 98-100), s'entoure d'icônes chrétiennes.
Dans sa boucherie on trouve une "auréole de soleil", de même
qu'un "boeuf entier pendu", faisant allusion au corps du
Christ; ses balances sont "surmontées d'une croix" et il
accomplit sa tâche de séparer les différents morceaux de
viande, avec une "religieuse conscience" - preuve visible de
87
la toute-puissance de ceux qui dispensent vie ou mort,
nourriture ou diète.
Dans certaines existences, un plaisir que s'achète est de
pouvoir regarder quelqu'un sans qu'il vous voie. Le
véritable voyeurisme se voit explicitement traité, par
exemple, lors d'un séjour à Balbec, dans la maison à
Maineville (II, 1078). Pourtant les visites à certains
magasins d'alimentation offrent une même joie discrète, là
où les vitres et les salles obscures d'intérieur permettent
une surveillance inaperçue. Epris de Mme de Guermantes, le
jeune narrateur la guette partout mais finalement la
surprend dans des circonstance rendues suspectes aussi bien
par l'attitude même de l'observateur que par le vocabulaire
employé. C'est nous qui soulignons.
... quand tout d'un coup, au fond d'une boutiquede crémier cachée entre deux hôtels dans cequartier aristocratique et populaire, se détachaitle visage confus et nouveau d'une femme élégantequi était en train de se faire montrer "des petitssuisses"... (II, 62)
Il est clair qu'un simple camembert n'engenderait pas une
telle confusion, et n'exigerait pas de guillemets.
En promenade avec Mme de Villeparisis et sa grand'mère à
Carqueville (I, 715), le narrateur se voit laissé seul par
cette dernière qui sent qu'il en serait plus heureux, et qui
prend pour prétexte d'aller dans un pâtisserie avec son
amie. Encore une fois il se voit délaissé par celles qui
s'occupent de la nourriture d'autrui.
88
Devenu vieux, son innocence sur la nature véritable de
Charlus depuis longtemps dissipée, le narrateur rapproche
quand même, par une de ces analogies de sensation en
sensation, reveillée par la mémoire d'ensembles marquants,
le plaisir qu'a le baron de rencontrer un bel inconnu, à un
souvenir d'enfance imbu du plaisir qu'ont fait naître les
dames de chez Boissier ou de chez Gouache en lui offrant des
bonbons. (III, 826)
Ce que les marchandes sont pour Marcel, les marchands le
sont pour Charlus.
"Vous ne savez rien sur le marchand de marrons ducoin, pas à gauche, c'est une horreur, mais ducôté pair, un grand gaillard tout noir? Et lepharmacien d'en face, il a un cycliste très gentilqui porte ses médicaments." Ces questionsfroissèrent sans doute Jupien car, se redressantavec le dépit d'une grande coquette trahie, ilrépondit: "Je vois que vous avez un coeurd'artichaut." (II, 609)
Seuls ces magasins où il se passe quelque chose d'agréable -
commande de biscuits, offre de bonbons, surprise de
connaissances à la dérobée - offrent des attraits au
narrateur. Le mouvement, la transition en sourdine,
l'entre-deux, sont leur raison d'être. Les rues et les
boulevards où la fruiterie, la poissonnerie et d'autres
seraient figés dans de grands magasins d'alimentation,
"sembleraient bien mornes, bien inhabitables, dépouillés,
décantés de toutes ces litanies des petits métiers et des
ambulantes mangeailles..." (III, 137)
89
Il faut quand même admettre que les magasins peuvent, même
dans l'oeuvre de Proust, jouer un rôle, si l'on peut dire,
normal. Ils font partie souvent des promenades et des
voyages et sont l'occasion de se procurer un plaisir
supplémentaire, qui, pour le narrateur, surtout jeune, est
souvent sucrerie ou pâtisserie. A Combray (I, 139), nous
voyons que les magasins savent la valeur, et donc le prix,
du bonheur. Dans le "magasin" de la Place ou chez Camus,
les biscuits les plus chers sont les roses. Les aubépines,
leur couleur et celle des biscuits ou du fromage à la crème
se confondent, mais se font payer à leur juste prix dans le
commerce.
Sur un plan plus distancié, les magasins peuvent être la
source de marques recherchées, un accompagnement nécessaire
à la vie mondaine. On a vu comment la naïve Mme Cottard,
qui essaie de faire face au beau monde du salon de Mme
Swann, émet des balbutiements à propos des mérites relatifs
des glaces Rabattet et des petits fours Bourbonneux (I,
604). L'intelligence de cette conversation est reconnue
par Mme Bontemps. Une intelligence d'un autre ordre est
celle que fournit une cousine de Swann à celui-ci quand il
veut procurer des places de gala à Odette et quand il veut
offrir à l'intermédiaire, la princesse de Parme, des fruits
de choix. (I, 309) La cousine, faisant partie d'une
famille de la riche et bonne bourgeoisie, a "la connaissance
des "bonnes adresses" et l'art de savoir faire une bonne
commande."
90
5.3 CONCLUSION
Nous avons vu que les actes de préparer, d'offrir et de
consommer la nourriture sont des actes d'une importance
fondamentale dans cette oeuvre, où viennent jouer toutes les
questions primordiales de création, de subsistance physique
et métaphysique, et de connaissance. Or il est donc
naturel d'imputer aux endroits où se passent ces actes une
importance equivalente et appropriée.
L'espace proustien n'est pas un espace bien défini et
contraint, à frontières reconnaissables (à l'encontre des
îles de Robbe-Grillet ou des villages et des villes de
Zola); comme dans le cas des personnages, l'espace ne se
présente pas comme une unité immuable, avec ses dimensions,
ses dispositions et ses topologies, à travers laquelle le
narrateur et ses amis se promènent, en regardant passer le
paysage. Au contraire, l'espace n'a d'existence qu'en
fonction de ces promenades et de ces regards. Les
environnements proustiens ne sont qu'états d'âme reflétés,
donc s'étendent ou se rétrécissent selon la capacité du
narrateur à "sortir de lui-même". Cela dit, il est des
périodes, le plus souvent quand il est sur le point, pense-
t-il, d'atteindre ce bonheur à vrai dire introuvable, où de
petits mondes se construisent autour de lui, pour répondre
au grand monde insaisissable et ennemi. Ces petits mondes,
avec leurs habitants, leurs habitudes et surtout leurs
règles de vie sont, à l'encontre du monde réel, abordables
91
et amis; ils sont, par une métonymie évidente, très souvent
des restaurants, des cafés ou même des chambres. Si, de
temps en temps, ces petits mondes font preuve de la même
hostilité que le grand, il suffit d'une présence amie (la
grand'mère ou, fréquemment, Saint-Loup) pour les
apprivoiser.
Nous avons vu aussi, élément souvent remarqué chez Proust,
que l'habitude est l'ennemi de la véritable connaissance;
ce sont les événements hors du commun qui éveillent les
facultés sensibles et spirituelles normalement endormies.
Quoi de plus déroutant, alors, que d'accomplir un acte banal
dans des circonstances extraordinaires? C'est pourquoi
nous assistons à un si grand nombre de repas et de goûters
qui s'accomplissent, non pas dans les salles à manger du
faubourg Saint-Honoré ou dans les restaurants de la côte
normande, mais sur l'herbe, dans le train, sur la plage ou
même dans la rue ("mangeailles ambulantes").
Un troisième aspect relatif aux endroits concernant la
nourriture relève aussi en partie de cette caractéristique
de l'hors du commun. Ces endroits, surtout les petits
magasins du quartier, ne sont pas, justement, des lieux
communs. Ce sont les lieux privilégiés des transactions
douteuses, là où la chair se vend et se goûte, là où l'on
est entre deux mondes, le public et le privé, et là où,
grâce aux vitres et aux intérieurs clair-obscurs, l'on peut
voir sans être vu.
92
6 CONCLUSION
Toute division en thèmes risque de paraître artificielle;
cependant, nous avons tenté, en isolant quatre grands thèmes
étroitement liés entr'eux et concernant tous les quatre
l'isotopie de l'objet comestible, l'éclairage d'un aspect
fondamental de A la recherche du temps perdu. Nous avons
essayé d'effectuer cet éclaircissement aussi bien par une
étude stylistique que par quelques commentaires diégétiques.
Dans un travail aussi limité que celui-ci il n'a pas été
possible de développer à fond tous les thèmes abordés; il
n'a pas été possible non plus d'entreprendre l'analyse d'un
certain nombre de thèmes secondaires, sujets jusqu'ici à des
traitements partiels de la part d'autres critiques.
Sous la première rubrique - en ce qui concerne les chapitres
précédents - on aurait pu élargir l'analyse des bouquets
sensibles pour particulariser encore quelques traits de ces
fameuses transpositions d'imagerie, de ces transpositions
d'épithètes qui rendent aux objets les plus passifs des
qualités bien actives ("tartes bavardes"). A la même
analyse pourraient venir s'ajouter toutes ces transpositions
qui décrivent une nourriture bâtie (les gâteaux au chocolat,
les glaces) et une architecture comestible (en passant par
les pierres tombales, au clocher, à la ville en brioche, aux
tours du Trocadéro "enduites de gelée de groseille des
anciens pâtissiers" (III, 709)). De la même manière, il y
93
a tout un travail à faire sur les rapports "réels" entre
écrire, créer et lire, manger, c'est-à-dire les menus qui,
par leur composition, composent le dîner (II, 386) ou dont
la lecture est d'une étonnante stimulation:
le menu du dîner qui tous les jours me distrayaitcomme les nouvelles qu'on lit dans un journal etm'excitait à la façon d'un programme de fête. (I, 119)
Cette suite d'idées pourrait mener à une discussion du
rapport entre la nourriture véridique et la nourriture
spirituelle, avec tout son entourage d'imagerie religieuse
(voir Bucknall1).
En ce qui concerne les personnages et les endroits, deux
thèmes supplémentaires exigeraient une étude plus
approfondie, surtout sur le plan mondain qui est si
important dans le récit proustien: il y a d'abord toute une
suite de cadeaux comestibles qui s'offrent le long de
l'ouvrage et par lesquels les donateurs cherchent la
bienveillance, voire l'amour, de ceux qui les recoivent.
Laissant de côté le lait maternel, nous avons une sélection
exquise de fruits (le plus souvent exotiques) et de bonbons
(le plus souvent des chocolats, ou, rarement, des marrons
glacés/étrennes). Les seules exceptions à la règle du
raffinement sont, comme nous l'avons vu, Mme de Villeparisis
et le princesse de Luxembourg. Les conversations à table
fourniraient une deuxième source par laquelle apprécier les
1 B. Bucknall, 'From material to spiritual food in ALRTP', inl'Esprit créateur, 11, 1971, pp.52-60
94
relations de pouvoir entre adultes et jeunes et entre,
surtout, les Guermantes et les autres.
Deux grand thèmes relatifs à la nourriture n'ont ici reçu
aucune analyse suivie: il s'agit d'abord de la maladie et
ensuite de la boisson. Le texte renferme un grand nombre
d'épisodes dans la vie romanesque de narrateur et de sa
famille aussi bien que des images fréquentes et multiples se
rapportant à la maladie et son traitement: les régimes et
les diètes aussi bien réels que symboliques jalonnent le
récit. Les amoureux ne risquent pas seulement la faim et
la soif, mais la famine (III, 464). Les grandes âmes
meurent, par contre, en mangeant ce qui leur est défendu par
la médecine (III, 998).
Les effets des différentes boissons mériteraient une étude à
eux seuls: les pouvoirs magiques de l'alcool (néfastes pour
la grand'mère, ambigus pour Marcel, conciliateurs pour
Saint-Loup et Rachèle) s'opposent aux qualités inertes et
innocentes des jus de fruit d'Odette et des Guermantes.
Nous avons traité, sous des angles différents, la question
de la nature au fond incomestible des êtres aimés. Or, un
travail est à faire sur ce qui est vraiment incomestible -
les écorces, les arêtes des soles, la coquille vide de
l'huitre, le sarment noueux d'une grappe de raisin (II, 118)
- tout ce que reste quand le repas est terminé et quand la
table est desservie. Nous voilà enfin devant de vrais
95
souvenirs qui, par leur présence matérielle, deviennent
reliques. Mais, dans un même mouvement d'évocation, ces
objets banals nous rappellent que la beauté nous entoure;
il suffit de regarder. On avait demandé à l'écrivain Shena
McKay, au cours d'une entrevue radiophonique,
"How do you make the ordinary seem wonderful?" Elle
répondit: "The ordinary is wonderful."
FAIM
96
BIBLIOGRAPHIE
I. OEUVRES DE PROUST
PROUST, Marcel, Correspondance générale de Marcel Proust,publiée par Robert Proust, Paul Brach et Suzy Mante-Proust,6 vol., Paris, Plon, 1930-1936 PROUST, Marcel, A la recherche du temps perdu, éditionétablie et annotée par Pierre Clarac et André Ferré, 3 vol.,Bibliothèque de la Pléïade, Paris, Gallimard, 1954
PROUST, Marcel, Contre Sainte Beuve, Ed. Pierre Clarc etYves Sandre, Bibliothèque de la Pléïade, Paris, Gallimard,1971
II. ETUDES CRITIQUES
BECKETT, Samuel, Proust, Calder and Boyars Ltd, London,1970. (First edition 1931)
BERSANI, Jacques, (Ed.), Les critiques de notre temps etProust, Paris, Garnier, 1971
BERSANI, Leo, Marcel Proust: the fictions of life and art,Oxford University Press, 1965
BONNET, Henri, Marcel Proust de 1907 à 1914 (essai debiographie critique) avec un supplément bibliographique,Paris, Nizet, 1959
BONNET, Henri, Marcel Proust de 1907 à 1914, (avec unebibliographie générale) 2ème édition, Paris, Nizet, 1971
BONNET, Henri, Marcel Proust de 1907 à 1914, Bibliographiecomplémentaire (II), Index général des bibliographies (I etII) et une étude: 'Du côté de chez Swann' dans A larecherche du temps perdu, Paris, Nizet, 1976
BOWIE, Malcolm, 'Proust, Jealousy, Knowledge' in Freud,Proust and Lacan: theory as fiction, Cambridge UniversityPress, 1987
BOWIE, Malcolm, 'Proust's Narrative Selves' in Moy qui mevoy, The Writer and the Self from Montaigne to Leiris,(editors George Craig and Margaret McGowan), Oxford,Clarendon Press, 1989, pp.131-146
BRIAND, Charles, Le secret de Marcel Proust, Paris, EditionsHenri Lefebvre, 1950
97
BUCKNALL, Barbara, 'From material to spiritual food inALRTP', in l'Esprit Createur, 11 (1971), pp.52-60
CASA-FUERTE, Marquis Illan de, 'Marcel Proust et lesparfums' in Revue Hebdomadaire, août 1935, pp.355-362
CATTAUI, Georges, Marcel Proust, Londres, the Merlin Press,1967
COLLIN, P. H., 'Food and drink in A la recherche', inNeophilologus, 54 (1970), pp.244-257
COMPAGNON, Antoine, Proust entre deux siècles, Paris,Editions du Seuil, 1989
COSNIER, Colette, 'Gastronomie de Proust', in Europe, août-septembre 1970, Vol. 48.3, pp.152-60
DA COSTA, F., 'La cuisine et la table dans l'oeuvre deProust' in Bulletin de la société des amis de Marcel Proustet les amis de Combray, No. 26, 1976
DELEUZE, Gilles, Marcel Proust et les signes, Paris, Pressesuniversitaires de France, 1964
DOUBROVSKY, Serge, 'Faire catléya', in Poétique, 37, 1979,p.116
DOUBROVSKY, Serge, La place de la madeleine, Paris, Mercurede France, 1974
ELLISON, Richard, The Reading of Proust, Oxford, BasilBlackwell, 1984, copyright Johns Hopkins University Press
FISER, Emeric, L'esthétique de Marcel Proust, Paris,Librairie de la revue française, 1933
FISER, Emeric, La théorie du symbole littéraire et MarcelProust, Paris, Librairie José Corti, 1941
GATES, Warren F., 'The doctrine of alimentation in Proustand Tolstoy' in South Atlantic Bulletin, January 1966, p.7
GENETTE, Gérard et TODOROV, Tzvetan (éds), Recherche deProust, Paris, Editions du Seuil, 1980
GRAHAM, V. E., The Imagery of Proust, in Series Language andStyle, General editor Stephen Ullmann, Oxford, BasilBlackwell, 1966
GRAHAM, Victor E., Bibliographie des études sur MarcelProust et son oeuvre, Genève, Librairie Droz, 1976
HUGHES, Edward, Marcel Proust: a study in the quality ofawareness, Cambridge University Press, 1983
98
LEJEUNE, Philippe, 'Ecriture et sexualité', in Europe,février 1971, pp.113-143
MATORE, Georges, 'Les images gustatives dans Du côté de chezSwann', in Annales Universitaires Saraviensis, Philosophie,Lettres, 6 (1957), pp.685-692
MAUROIS, André, A la recherche de Marcel Proust, Paris,Hachette, 1949
MOUTON, Jean, Le style de Marcel Proust, Paris, EditionsCorréa, 1948
PAINTER, George Duncan, Marcel Proust. A biography, London,Chatto and Windus, 1965
POMMIER, Jean, La mystique de Marcel Proust, Paris, Droz,1939
RICHARD, Jean-Pierre, 'Proust et l'objet alimentaire' inLittérature, 6 (mai 1972), pp.3-19
RICHARD, Jean-Pierre, Proust et le monde sensible, Paris,Editions du Seuil, 1974
SEGAL, Naomi, The Banal Object: Theme and Thematics inProust, Rilke, Hofmannsthal, and Sartre, Bithell Series ofDissertations, Volume Six, Institute of Germanic Studies,University of London, 1981 ULLMANN, Stephen, 'Transposition of sensations in Proust'simagery', in French Studies, janvier, 1954
WINTER, Alison, Proust's Additions, Cambridge UniversityPress, 1977
III. OUVRAGES CRITIQUES
BERSANI, Leo, 'Le réalisme et la peur du désir', inLittérature et réalité, (Editeurs, G. Genette et T.Todorov), Points, Paris, Editions du Seuil, 1982
COMPAGNON, Antoine, La Troisième République des lettres,Paris, Editions du Seuil, 1983
CULLER, Jonathan, The pursuit of signs - semiotics,literature, deconstruction, Londres, Routledge and KeganPaul, 1981
DE MAN, Allegories of reading. Figural language inRousseau, Nietzsche, Rilke and Proust, New Haven and London,Yale University Press, 1979
99
GENETTE, Gérard, Figures III, Collection poétique, Paris,Editions du Seuil, 1972
LODGE, David, Working with structuralism. Essays andreviews on nineteenth- and twentieth-century literature. Routledge and Kegan Paul, 1981
NABOKOV, Vladimir, Lectures on literature, édité par FredsonBowers, avec une introduction de John Updike, Londres,Weidenfeld and Nicolson, 1980
RICARDOU, Jean, 'La métaphore d'un bout à l'autre', inNouveaux problèmes du roman, Paris, Seuil, 1978
RICOEUR, Paul, La métaphore vive, Paris, Seuil, 1975
ULLMANN, Stephen, Style in the French novel, CambridgeUniversity Press, 1957
ULLMANN, Stephen, The image in the modern French novel,Cambridge University Press, 1960
IV. AUTRES OUVRAGES
ARON, Jean-Paul, Le mangeur du XIX siècle, Paris,Denoël/Gonthier, 1973
BARTHES, Roland, 'Lecture', in Brillat-Savarin, Physiologiedu goût, Paris, Hermann, 1975
BRILLAT-SAVARIN, Anthelme, Physiologie du goùt, Paris,Hermann, 1975
CENTRE DE RECHERCHE SUR L'IMAGE ET LE SYMBOLE, L'imaginairedu vin, colloque pluridisciplinaire, octobre 1981
GOFFMANN, Erving, The Presentation of Self in Everyday Life,London, Allen Lane, 1969
PINGET, Robert, Le libéra, Paris, Editions de Minuit, 1984
ROBBE-GRILLET, Alain, Le miroir qui revient, Paris, LesEditions de Minuit, 1984
ZOLA, Emile, Le ventre de Paris, in Les Rougon-Marcquart, I,Bibliothèque de la Pléiade, Paris, 1960
100