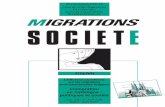Première carrière de sel gemme européenne : le Vall Salina à Cardona (Catalogne, Espagne) au...
Transcript of Première carrière de sel gemme européenne : le Vall Salina à Cardona (Catalogne, Espagne) au...
L’exploitation du sel à travers le temps D. Monah, Gh. Dumitroaia, O. Weller et J. Chapman (Eds.)
BMA, XVIII, Piatra-NeamŃ, 2007
PREMIÈRE CARRIÈRE DE SEL GEMME EUROPÉENNE: LE VALL SALINA À CARDONA (CATALOGNE, ESPAGNE)
AU NÉOLITHIQUE MOYEN (4500-3500 BC). TECHNOLOGIE, MINÉRALOGIE ET PÉTROGRAPHIE
DE L’OUTILLAGE LITHIQUE
Olivier Weller, Alfons Fíguls et Fidel Grandia
Résumé Au pied des affleurements de sel gemme de Cardona, nous avons documenté un nombre
important d’outils en pierre, la majorité était destinée à l’extraction du sel. L’étude morphologique des pièces combinée à celle des traces d’utilisation et des modes de fracturation nous a permis de caractériser les premières techniques européennes d’exploitation du sel gemme durant le Néolithique moyen. L’outillage d’extraction n’était pas spécialisé, mais la provenance relativement lointaine de sa matière première montre qu’il intègre des circulations d’objets et de ressources naturelles complémentaires d’autre exploitation minière contemporaine.
Abstract At the foot of the outcrops of rock salt in Cardona, we have traced a large number of
stone tools, the majority of which aimed at salt extraction. The morphological study of these artefacts combined with the wear and fracture studies enabled us to characterize the first European techniques of rock salt’s exploitation during the Middle Neolithic. The extraction tools were not specialized, however they were made with exogenous raw materials. The salt mining activity must be integrated both into traded raw materials and exchanged objects coming from other contemporary mining site.
Introduction Quelles fonctions ont eu les nombreux outils lithiques ramassés dans le Vall
Salina de Cardona (Catalogne)? Comment ont-ils été utilisés? Sur quelle matière première ont-ils été confectionnés? D’où provient-elle? Ces questions, parmi d’autres, ont été formulées depuis plusieurs années à partir de la grande quantité d’outils en pierre apparus dans le Salí de Cardona, au pied des affleurements naturels de sel gemme. La majorité de ces outils appartiennent à des collections particulières de mineurs, agriculteurs, curieux ou érudits d’archéologie. Seules deux collections appartiennent à des fonds muséographiques: celle du Museu de Sal Josep Arnau et celle du Patronat Municipal de Museus de Cardona.
Ce fut l’ingénieur Agustín Marín qui, pour la première fois en 1914, présenta ces outils et proposa quelques réponses à ces questions (Marín, 1933). A sa suite, un autre
O. Weller, A. Fíguls et F. Grandia 116
ingénieur publia un article plus ample sur ce thème (López de Azorin, 1933) en insistant tout particulièrement sur la matière première et sa provenance: ces outils „hechos de una roca de color verde negruzco, presentándose algo mate, comprobado por su estudio micrográfico [...] era ofita de los Pirineos bastante descompuesta” (López de Azorin, 1933: 64). Pour ces deux ingénieurs des mines, il ne faisait aucun doute que ces outils étaient néolithiques et utilisés pour l’exploitation du sel de Cardona. Marín alla jusqu’à affirmer que l’exploitation datait autour de 5000 avant J.-C. (Marín, 1933: 11).
Entre les années 30 et jusqu’aux années 80, ce thème de recherche fut totalement abandonné, et il faut attendre la fin des années 80 pour voir le thème timidement réapparaître (Fíguls, 1989; 1990). Mais c’est véritablement à la fin des années 90 que ce thème est à nouveau développé avec des travaux de recherche centrés sur l’étude scientifique d’une possible exploitation du sel de Cardona à la fois d’un point de vue local (Fíguls, Bonache, 1997) et plus régional (Weller, 2002).
Depuis le Meeting sur l’exploitation du sel qui s’est tenu à Cardona en décembre
2003 (Fíguls, Weller (eds.), 2006), nous profitons de ce colloque de Piatra-NeamŃ pour présenter de nouveaux aspects sur l’exploitation du sel gemme du Vall Salina durant le Néolithique moyen catalan, son outillage et son organisation socio-économique aussi bien dans l’environnement proche (groupe régional du Solsonià) que plus éloigné (provenance des matières premières de la Sierra de Collserola, Barcelone-Gavà). Ainsi, nous souhaitons insister sur les résultats apportés par les études technologiques et pétrographiques réalisés sur ces outils néolithiques, mais aussi sur leurs apports dans la reconstitution des fonctionnements socio-économiques de cette époque.
Le Vall Salina et la Muntanya de Sal de Cardona La commune de Cardona se situe au nord-est de l’Espagne, dans le centre de la
Catalogne à la limite de la Dépression centrale catalane. Elle occupe 66 km2 et comprend une partie de la vallée du Cardener et de ses affluents (Aigua d’Ora et Navel) qui ont creusé dans les marnes et les grès oligocènes une large vallée favorable au développement agricole.
Une grande partie du territoire est escarpé et uniquement couvert de bois ou de vignes. Les terres cultivées occupent 33% de la commune alors que 61% sont occupés par des bois, des pins et de la chênaie, et 6% par des terres improductives.
Le Vall Salina d’une superficie de 130 ha se situe entre la ville de Cardona au nord et la Serra de la Sal qui s’étend de l’est au sud. A son extrémité sud-ouest s’élève la Muntanya de Sal à plus de 120 m de haut (fig. 1), et la vallée s’ouvre vers l’est en direction du Cardener. Son altitude oscille entre 392 et 533 m. Cette vallée présente plusieurs particularités qui font que cette zone a été et est encore en constante transformation tant par l’action naturelle (infiltration, érosion, diapirisme) que l’activité anthropique (carrière, mine souterraine, déblais), si bien que son aspect actuel (fig. 2) est extrêmement différent de celui passé comme on peut le voir avec cette gravure de 1808 (fig. 3).
Première carrière de sel gemme européenne 117
Fig. 1. La Muntanya de Sal de Cardona (photo de F. Grandia).
Fig. 2. Le Vall Salina de Cardona (photo de F. Grandia).
O. Weller, A. Fíguls et F. Grandia 118
Fig. 3. Le Vall Salina d’après une gravure d’Alexandre de Laborde réalisée en 1808 (Voyage pittoresque et historique, AHC).
La partie centrale de la vallée est relativement plane, bien que les versants latéraux soient très abrupts, mais le phénomène des dolines ou bofias présente un paysage toujours en mouvement.
D’un point de vue géologique (Grandia, 2006), la Muntanya de Sal de Cardona (comme le Vall Salada) appartient aux affleurements salifères de la Formación Cardona. Ces matériaux d’origine évaporitique sont constitués par des niveaux de halitite NaCl (avec la halite et l’illite comme minéraux majoritaires), de sylvinite KCl (avec la sylvite comme minéral majoritaire) et de carnallitite KMgCl2 (avec la carnallite comme minéral majoritaire). Ponctuellement, les processus halocinétiques ont pris un caractère diapirique, c’est à dire que les sels ont perforé les roches sus-jacentes. La Vall Salina est une expression superficielle de ce diapirisme évoluant dans
l’Anticlinal de Cardona. Du fait de la solubilité élevée des chlorures, la formation salifère de Cardona, tout en s’élevant, a été rapidement dissoute par les eaux superficielles. Malgré cela, il reste toujours plusieurs affleurements dont la fameuse Muntanya de Sal. Cette dernière est formée principalement par les couches supérieures de la séquence évaporitique, c’est à dire l’unité potassique (sylvite et carnallite prédominent) et l’unité halitique supérieure (halite prédomine).
Le groupe „Solsonià” et le Néolithique de Cardona Les communautés néolithiques installées dans la zone pré-pyrénéenne catalane
autour de 4000 BC ont été définies socialement et économiquement à partir de plus de 100 sépultures en ciste (fig. 4). Depuis les recherches de Serra Vilaró (1927) qui a défini ce groupe au début du XXe siècle à partir d’un intense travail de terrain et jusqu’à aujourd’hui, on a toujours qualifié ce groupe Solsonià comme un groupe de pasteurs fondant son économie sur l’élevage complétée par une agriculture peu développée mais une chasse relativement importante, comme le suggère les nombreuses canines de sangliers dans les dépôts funéraires (Cura Morera, 1976: 51). Remarquons néanmoins que ces canines peuvent aussi provenir de porcs domestiques et pas uniquement de sangliers chassés.
Première carrière de sel gemme européenne 119
Fig. 4. La distribution des sites du Néolithique moyen et le groupe du Solsonià.
Nous pensons qu’il faut aujourd’hui relativiser cette vision puisque ces interprétations
ne sont fondées que sur le seul mobilier funéraire. En effet, nous ne pensons pas que l’agriculture a joué un rôle mineur dans l’économie de subsistance comme nous le verrons avec les 29 meules de la Roqueta (Cardona), ni d’ailleurs que la seule présence de poinçons et d’aiguilles en os d’ovi-capridés dans les sépultures suffisent à affirmer qu’il s’agisse de pasteurs. La méthodologie de terrain utilisée par Serra Vilaró répondait à une recherche de données très déterminée et, probablement, très sélective et discriminée. En vidant rapidement les sépultures, l’information a du être biaisée et générée des erreurs qu’il convient aujourd’hui de corriger. Aussi, nous soutenons que le Solsonià présente des aspects socio-économiques beaucoup plus complexes que ceux pour lesquels on lui a donné de l’importance. Par exemple, il reste encore sous-entendu que les sépultures en ciste sont très simples tant au niveau architectural que conceptuel ce que dément les recherches récentes (Castany, 1991; 1992; Fíguls, 2003a; 2003b; 2004; 2006). Citons aussi l’exploitation du sel gemme de Cardona qui conduit aussi à une toute autre idée des activités de ce groupe (Weller, Fíguls, 2006).
A Cardona, 7 sépultures du Néolithique moyen ont été documentées (fig. 5) dont 3 sont aujourd’hui détruites (Pla de Bergús, Vinya del Giralt, Cap del Pont), 2 ont été fouillées de nouveau (Palà de Coma 1 et 2) et 2 restent à localiser et à refouiller (Roqueta 1 et 2).
O. Weller, A. Fíguls et F. Grandia 120
Fig. 5. Distribution des sites néolithiques et mégalithiques de Cardona.
La sépulture de Cap del Pont est la plus proche du Vall Salina, elle se situe
juste à l’entrée de la vallée. En 1960, à l’occasion de travaux de canalisations, est apparue une ciste ou coffre en pierre contenant un individu accompagné de son mobilier funéraire (une hache en pierre polie, un couteau en silex et un récipient céramique) (Barberà et al., 1986).
C’est aussi à Cardona que, depuis le début du XXe siècle, des centaines de pièces lithiques ont été ramassées dans le Vall Salina et, en moindre nombre, à la Roqueta, un site d’habitat situé à 5 km des affleurements de sel, sans que ces outils fassent l’objet d’une étude globale.
L’industrie lithique de Cardona: usages et fonctions L’étude technologique réalisée sur environ 300 pièces de l’aire du Solsonià dont
une majorité provenant de Cardona a été centrée sur: • l’étude morphologique des pièces et leur comparaison avec les outils contemporains des
mines néolithiques de variscite de Can Tintorer à Gavà (Barcelone); • l’étude des surfaces actives, des traces d’utilisation et des modes de fracturation; • l’étude de la matière première et de sa provenance à partir d’analyses pétrographiques.
Première carrière de sel gemme européenne 121
La Vall Salina de Cardona Sept collections d’outils lithiques ont été étudiées provenant majoritairement du
Salí à l’intérieur du Vall Salina, c’est à dire juste au pied des affleurements de sel gemme. Cinq de ces collections sont privées et les deux autres correspondent, pour l’une, à une partie des pièces anciennement documentées par López de Azcona (actuellement propriété de la mairie) et, pour l’autre, à la collection du Musée du sel Josep Arnau.
Bien que l’on puisse envisager qu’il existe une relation étroite entre la forme et la
fonction d’un outil, nous ne pensons pas qu’il existe une relation de causalité directe, c’est à dire qu’une forme déterminée n’implique pas une fonction concrète. Aussi, nous avons supposé que n’importe quel outil pouvait être utilisé efficacement pour extraire le sel. A partir des observations et des analyses réalisées sur ces outils, nous pouvons en effet affirmer que n’importe quel outil tranchant ou pénétrant (hache, herminette, ciseau…) a pu être utilisé pour extraire le sel, preuve en est le très fort taux d’outils réutilisés pour l’extraction. En travaillant sur le cycle de vie des outils lithiques, nous avons pu montrer que leurs fonctions a pu varier au cours du temps soit en détournant la fonction première des outils, soit en réutilisant l’outil usé, voir une partie seulement d’un outil fracturé. Par exemple, un fragment proximal de hache a pu être transformé en pilon pour écraser le sel. Il n’existe donc pas à Cardona d’outils spécialisés pour l’extraction du sel.
Nous avons donc préféré établir notre typologie des outils en fonction des traces d’utilisation et de l’étude descriptive des surfaces actives plutôt qu’en fonction de la seule morphologie des pièces. La classification a aussi pris en compte les modes de fracturation montrant qu’il s’agit d’outils utilisés majoritairement en percussion lancée (Fíguls, Bonache, 1997).
VALL SALINA
Echantillon Utilisation première Réutilisation % Total
Outils d’extraction 51 70,83% 70,83%
Pilons 6 1 8,33% 1,39% 9,72%
Percuteurs / pilons 3 4,17% 4,17%
Haches 6 8,33% 8,33%
Petites haches (< 8 cm) 5 6,94% 6,94%
TOTAL 72
Outils d’extraction La grande majorité des outils qui composent l’échantillon provenant du Vall
Salina sont typologiquement d’anciennes haches, des herminettes et des ciseaux présentant des traces inhabituelles de compression et d’écrasement ainsi que de nombreuses fractures. Tout d’abord, on observe que le tranchant est totalement émoussé et écrasé de façon homogène jusqu’à suggéré un front épais et arrondi (masses). Quant aux macrotraces, trois types ont été mis en évidence, tous en relation avec un travail en percussion lancée (fig. 6):
O. Weller, A. Fíguls et F. Grandia 122
• Type A Un grand éclat longitudinal en négatif qui signe une fracture en charnière de l’outil. • Type B Enchaînement de plusieurs éclats longitudinaux partant du front de la pièce se
sont détachés pour n’en former qu’un (fracture en escalier). • Type C Plusieurs négatifs d’enlèvements de formes diverses et de moins de 2 cm partant
du front de l’outil se superposent (éclats et esquillement autour de la surface active distale ou / et proximale).
Fig. 6. Classification des macrotraces.
Première carrière de sel gemme européenne 123
Jorge Bonache a analysé la collection la plus complète, celle du Sr. Jaume Barberà, en appliquant un système de classification par clusters pour vérifier l’existence ou non de groupes significatifs (Fíguls et al., 2006; Bonache, 2006). Aucune relation n’a pu être mise en évidence entre les variables utilisées (mesures, formes et poids), et tout se passe comme si n’importe quel outil pouvait être utilisé pour extraire le sel.
Nous ne pensons pas qu’il s’agit d’outils polyfonctionnels, mais plutôt d’une utilisation opportuniste et d’une réutilisation de l’outillage en pierre classique dévolu, lors de son élaboration, à d’autres tâches. L’utilisation d’anciens outils d’abattage ou de travail de la terre, complets ou même fragmentés, n’en demeurait pas moins efficace pour l’extraction directe du sel gemme.
Fig. 7. Distribution des vestiges du Néolithique moyen sur un plan de la fin du XIXe siècle du Vall Salina.
O. Weller, A. Fíguls et F. Grandia 124
Percuteurs et pilons Ils représentent presque 14% de l’échantillon avec une majorité de pilons destinés,
non pas à l’extraction directe du sel, mais à réduire, piller et mettre en forme les blocs bruts de sel. Un de ces pilons correspond à une partie distale de hache et trois pièces plus polyvalentes (percuteurs-pilons) ont aussi été utilisé comme percuteur.
Haches Le faible nombre de haches en pierre, 8,33% de l’échantillon, est significatif du
peu d’intérêt sur ce site d’extraction pour le travail du bois (abattage, architecture…), sans que cela n’interdise l’établissement d’une communauté ou d’un groupe néolithique à l’intérieur du Vall Salina.
Petites haches A peine 7% de l’outillage correspond à des petites haches qui ne dépassent pas 8
cm de longueur. Quant à la répartition spatiale de cet échantillon, nous constatons que la grande
majorité des outils se situe dans le Salí (fig. 7), proche des anciennes carrières de sel du XIX e siècle. On notera aussi la présence de mobilier domestique (outils en silex et tessons céramique) mais toujours à l’extérieur des zones d’extraction proprement dites.
Fig. 8. Cristal de halite situé dans la partie active d’un outil d’extraction à x40 et x100 (photo des cristaux de J. Sanz).
Première carrière de sel gemme européenne 125
Cette approche fonctionnelle de l’outillage, en particulier celui d’extraction du Salí, a été poursuivie par l’observation des surfaces actives sous loupe binoculaire puis par une série d’analyses par diffraction X, fluorescence et phosphorescence (Fíguls et al., 2006). Ces analyses ont révélé la présence de cristaux de sel gemme, de nitre et de saponite (une argile typique du Vall Salina) situés uniquement sur les fronts de percussion des outils, le reste des surfaces des pièces n’en renfermant pas (fig. 8). Il ne s’agit donc vraisemblablement pas de pollution post-dépositionnelle mais probablement bien de résidus de l’extraction de ces minéraux plastiques ayant pénétrés les micro-infractuosités de la roche sous l’effet des percussions lancées répétées. Toutefois, durant l’enfouissement, les résidus observés ont pu être modifiés par différents processus de (re)minéralisation sous l’effet des eaux d’infiltration et de l’humidité.
La Roqueta Le domaine de la Roqueta se situe dans la vallée de la Coma, à 5 km du Vall
Salina, au coeur d’une zone ouverte favorable aux activités agricoles (fig. 9). Bien que peu renseigné, ce secteur se révèle très riche en vestiges archéologiques depuis le Néolithique. Autour de l’actuelle ferme, on dénombre deux sépultures du Néolithique moyen fouillées par María Petrus dans les années 50 (Petrus, 1958), un menhir (Serra Vilaró, 1927: 341) mais aussi du matériel du Bronze final et un four romain (Petrus, 1958).
Fig. 9. Situation du site de la Roqueta à Cardona.
O. Weller, A. Fíguls et F. Grandia 126
Parallèlement, les ramassages attentifs du propriétaire, le Sr. Ramon Roca, ont permis de documenter 98 pièces lithiques concentrées sur un secteur pour lesquelles 8 types peuvent être identifiés: houes / herminettes, haches et petites haches de moins de 8 cm de longueur, boules, ciseaux, percuteurs, pilons et meules naviformes. Parmi cette collection, 20 pièces appartiennent à des talons ou des pièces trop détériorées pour être classifier. Ces outils sont associés en surface à des tessons céramique typique du Néolithique moyen ainsi qu’à une perle en coquillage.
LA ROQUETA
% % Echantillon Utilisation première Réutilisation
(avec les meules) Total
(sans les meules) Total
Houes 14 18,18% 18,18% 29,17% 29,17%
Haches 7 9,09% 9,09% 14,58% 14,58%
Petites haches (< 8 cm) 3 3,90% 3,90% 6,25% 6,25%
Boules 2 2,60% 2,60% 4,17% 4,17%
Percuteur 1 1,30% 1,30% 2,08% 2,08%
Ciseau 1 1,30% 1,30% 2,08% 2,08%
Percuteurs / pilons 1 1,30% 1,30% 2,08% 2,08%
Pilons 10 9 12,99% 11,69% 24,68% 20,83% 18,75% 39,58%
Meules 29 37,66% 37,66% TOTAL
(avec meules) 77
TOTAL (sans meules)
48
Fig. 10. Distribution typologique des outils lithiques du Vall Salina (site d’extraction) et de la Roqueta (habitat).
Première carrière de sel gemme européenne 127
La distribution des outils de la Roqueta (fig. 10) montre l’importance des meules avec 37% de l’échantillon, vient ensuite les pilons avec 24% dont la moitié au moins sont d’anciens outils réutilisés, puis les outils classiques attendus sur un habitat néolithique. Afin de comparer ces effectifs avec ceux obtenus au Vall Salina, c’est à dire sur le site d’extraction du sel, nous avons recalculé les effectifs de la Roqueta en écartant les meules. Les pilons, outils de mise en forme des blocs de sel brut, représentent alors 39% de l’échantillon de l’habitat alors qu’aucun outil d’extraction du sel n’est présent sur le site (fig. 11). En effet, les fractures et les traces d’utilisation sur les outils de travail du bois et de la terre sont tout à fait classiques avec un poli de tranchant encore bien présent sur les deux faces des haches et un micro-esquillement continu et parallèle au fil du tranchant ne dépassant pas 2 mm de largeur.
Fig. 11. La collection de Ramon Roca de la Roqueta. De nombreux pilons pour la mise en forme des blocs bruts de sel (photo O. Weller).
Bien que non fouillé, l’habitat du Néolithique moyen de la Roqueta semble bien
représenter un lieu privilégié pour la mise en forme du sel extrait à 5 km de là. Or, lorsque l’on sait que de tels outils, les pilons et les percuteurs-pilons, ont aussi été retrouvés jusqu’à 30 km de Cardona, même en moindre nombre, dans les collections publiques ou privées de la région du Solsonès (Museu Diocesà i Comarcal de Solsona, Mas Caballol à Pinell, Ogern…), il est vraisemblable d’envisager une circulation du sel brut extrait du Vall Salina dans un rayon d’un jour de marche autour du gîte.
La chaîne opératoire de fabrication du sel est alors, à l’image des exploitations minières de silex de la même époque en Europe, fragmentée dans l’espace avec un transport des blocs (ou des plaques) bruts plus ou moins ébauchés sur le gîte d’extraction vers l’habitat où ils seront réduits et mis en forme vraisemblablement selon des poids et des volumes plus ou moins équivalents. A titre d’hypothèse, on peut envisager le
O. Weller, A. Fíguls et F. Grandia 128
débitage non pas de blocs irréguliers mais de plaques qui se délitent parfois naturellement sur les affleurements de sel de Cardona qu’il suffit ensuite de tailler et de régulariser au pilon pour obtenir un produit facilement transportable et normalisé à l’image des plaques de sel sub-sahariennes de Taoudeni (fig. 12). Les prochaines expérimentations réalisées grandeur nature à Cardona permettront probablement de mieux appréhender les différentes techniques d’extraction et de mise en forme à l’aide des outils documentés, des outils non spécialisés, peu investis techniquement et issus en grande partie de réutilisations qui semblent avoir été sélectionnés plutôt pour leur résistance, leur forte densité et la ténacité de la roche.
Fig. 12. Plaques de sel gemme naturelles de la Bofía Grande du Vall Salina à Cardona et plaques de sel taillées de la carrière à ciel ouvert de Taoudeni au Mali (photos O. Weller).
Etude pétrographique Puisque la matière première de ces outils semblait jouer un rôle central dans les
choix techniques opérés, nous nous sommes penchés sur la détermination et la provenance des roches utilisées, 70 ans après l’étude de López de Azcona (1933) qui les attribuait alors à des ophites pyrénéennes. L’observation de l’ensemble des collections conduit à déterminer une même famille de roche issue d’un métamorphisme de contact.
Sept lames minces ont été réalisées: une provenant d’un pilon des réserves du Musée de Solsona (J.R. Bardoux, Université de Brest) et 6 de Cardona (fig. 13) (Aranda et Suñé, 2006) dont 4 de la Roqueta avec un fragment d’herminette, un de talon et deux pilons (collection Ramon Roca) et 2 du Vall Salina avec un fragment de pilon et un de talon (collection de López de Azcona). Ces 6 lames minces ont été réexaminées par F. Grandia (Université Autonome de Barcelone).
Tous ces outils sont élaborés dans une roche appartenant à la famille des métapélites (roche d’origine sédimentaire à grain très fin métamorphisé) proches des cornéennes:
Le premier pilon analysé à l’Université de Brest est une cornéenne alumineuse présentant une trame minérale non orientée comportant d’abondants petits micas, biotite et muscovite, un peu de quartz et de larges sections quadrangulaires, peu biréfringentes, rapportées à de l’andalousite (atypique cependant, car de faible relief). Elles sont envahies de paillettes micacées (damouritisation) et présentent souvent une partie centrale obscurcie par d’abondantes inclusions, ce dernier caractère pouvant indiquer qu’il s’agit de la variété Chiastolite.
Première carrière de sel gemme européenne 129
Fig. 13. Lames minces réalisées sur 6 outils de Cardona (photo des lames J. Sanz et photos de l’industrie lithique A. Fíguls). Sur la lame LR3, on distingue de l’andalousite typique de Collserola.
Les 6 autres lames minces (Aranda, Suñé, 2006) ont aussi reconnu le même type de
trame minérale avec de la cordiérite, de l’andalousite (présent sur LR3), de la biotite ou de la clorite. Les auteurs attribuent ces outils à des cornéennes ou des cornubianites (pigallades).
Ce type de roche est totalement absent du secteur de Cardona où prédomine les roches sédimentaires du Tertiaire. Si l’hypothèse d’un transport fluvial dans les sédiments alluviaux récents de la rivière Cardener depuis la chaîne pyrénéenne, au nord, a été évoqué (Aranda et Suñé, 2006), les affleurements de ces roches ne se rencontrent en réalité que ponctuellement dans les massifs paléozoïques situés dans les marges nord (zone axial des Pyrénées), au-delà du Cardener, et sud (secteur central des chaînes côtières catalanes). Cette hypothèse est, semble t’il, à écarter d’autant plus que la présence d’andalousite dans deux des échantillons est typique des affleurements d’une des chaînes côtières, la Serra de
O. Weller, A. Fíguls et F. Grandia 130
Collserola. Les prospections géologiques menées sur ces affleurements de roches métamorphiques ont d’ailleurs permis d’identifier des faciès lithologiques parfaitement comparables à ceux analysés en lame mince (tout particulièrement pour l’outil réutilisé en pilon LR3). Géologiquement, la Serra de Collserola est constituée de roches métasédimentaires de faible degré (faciès des schistes verts) d’âge paléozoïque affectées par des roches ignées tardihercyniennes (Carbonifère tardif) qui ont générées localement une auréole de métamorphisme de contact.
Nous pensons donc aujourd’hui que c’est le secteur de Collserola, au nord-ouest de Barcelone, qui a alimenté la zone de Cardona à 70 km à travers l’axe des vallées Llobregat-Cardener, soit sous la forme d’ébauches, soit de produits finis comme des haches ou des herminettes, qui pouvaient alors être réutilisés sur place pour l’extraction et la mise en forme du sel.
Conclusions et perspectives Cette étude de l’outillage lithique de Cardona a permis de mieux caractériser
cette première extraction de sel gemme européenne tant du point de vue des techniques que de son organisation socio-économique, mais aussi de la replacer dans le contexte plus large du Néolithique moyen catalan. Pour résumer, deux points principaux peuvent être mis en avant:
L’outillage lithique utilisé est composé, d’une part, d’outils d’extraction peu investis, réutilisant des outils d’abattage classiques emmanchés et, d’autre part, d’outils de mise en forme plus spécifiques mais procédant aussi souvent d’un recyclage. Les premiers ont été retrouvés en grande majorité aux pieds des affleurements de sel gemme, alors que les seconds sont bien plus fréquents à l’extérieur de la zone d’extraction dans un rayon d’une journée de marche, comme sur le site d’habitat de la Roqueta où ils sont associés à un matériel domestique classique. Si l’outillage n’est pas spécialisé et semble plutôt opportuniste, sa répartition spatiale suggère une chaîne opératoire divisée dans l’espace (et peut-être aussi dans la durée) où les blocs bruts extraits de la carrière à ciel ouvert du Salí étaient transportés jusqu’à l’habitat pour y être dégrossis et mis en forme.
L’étonnante provenance relativement lointaine de la matière première des outils miniers (vraisemblablement la Serra de Collserola à environ 70 km) mérite d’être relativisée. Tout d’abord, parce qu’il s’agit en fait d’une matière première utilisée avant tout pour la fabrication d’outils d’abattage qui seront recyclés sur leurs lieux d’utilisation, et ensuite parce que ce gîte semble s’intégrer dans un réseau d’approvisionnement plus ample. En effet, ce sont ces mêmes affleurements de cornéennes qui ont été évoqués pour l’alimentation en outils miniers de la mine contemporaine de variscite de Can Tintorer à Gavà (Alvarez, Clop, 1998). D’ailleurs la distribution quantitative des perles de variscite issue de cette mine à l’échelle de la Catalogne (fig. 14) suggère encore la complémentarité socio-économique de ces deux exploitations minérales avec ce groupe du Solsonià, producteur de sel, capable d’attirer en masse ces objets d’apparat (Weller, Fíguls, 2006).
Première carrière de sel gemme européenne 131
Fig. 14. Deux exploitations minières complémentaires du Néolithique moyen catalan. Gîte probable de matière première des outils miniers de Gavà et Cardona (Serra de Collserola)
et distribution quantitative des perles en variscite de Gavà dans les sites Sepulcres de Fosa (distribution des perles en variscite d’après Edo et al., 1992; Cardona et al., 1996 complétée).
En réalité, c’est tout un réseau de circulation d’objets d’apparat comme les
bracelets en coquillages marins ou les perles en variscite, mais aussi de matières premières exogènes comme le silex blond de Haute-Provence qu’il faut intégrer à la circulation vraisemblable du sel à l’échelle régionale (Weller, Fíguls, à paraître). Ne faut-il pas alors envisager ce groupe du Solsonià, non plus uniquement comme un groupe de pasteurs fondant son économie sur le bétail et la chasse, mais bien comme un groupe d’agriculteur-éleveur, producteur de sel, qui aurait alimenté les communautés littorales? A l’image de situations ethnographiques où les circulations de coquillages, de parure, de porcs et de pains de sel sont intenses pour réguler les tensions sociales au moyen de dots et de paiements incessants (Weller et al., 1996), tensions issues de l’expansion territoriale de ces groupes, l’expansion de la culture des Sepulcres de Fosa vers l’intérieur de la Catalogne à partir de 4000 avant J.-C., justement dirigée autour du bassin du Cardener et à partir du gisement de Cardona, pourrait bien s’expliquer par une importante poussée démographique générant des tensions et une compétition sociale accrue, conduisant les communautés péri-littorales du Néolithique moyen à se déplacer et à se spécialiser dans l’exploitation et la diffusion d’une ressource rare comme le sel, un sel probablement utilisé pour la conservation alimentaire et l’alimentation du bétail, mais qui, mis en forme, devient aussi un objet identifiable, stockable et divisible et s’inscrit vraisemblablement à côté des biens à forte valeur d’échange susceptibles de circuler et d’intégrer les réseaux d’échanges à moyenne et longues distances.
O. Weller, A. Fíguls et F. Grandia 132
Remerciements Nous tenons à remercier les personnes et les institutions qui ont rendu possible cette
étude. Olivier Weller remercie la fondation Fyssen (Paris) qui a financé cette recherche post-doctorale ainsi que, pour leur accueil, le laboratoire du SERP de l’Université de Barcelone, le Musée de Solsona (Jaume Bernades) et celui de Gavà (Josep Bosch). Alfons Fíguls remercie pour leur collaboration Jorge Bonache, Gregorio Cazorla, Joan González et Loreto Serena, tous chercheurs à l’IREC, ainsi que Joan Medina et Jesús Casas de Cardona, pour l’étude de leur collection. Enfin, nous voudrions remercier ensemble Jaume Barberà et Ramon Roca de Cardona pour leur collaboration, leur aide et l’étude de leur collection ainsi que le Musée du sel Josep Arnau et les Archives municipales de Cardona.
Bibliographie:
ALVAREZ, A., CLOP, X., 1998. – Determinación de la materia prima del utillaje minero de las
minas neolíticas de Gavà (Barcelona). Rubricatum, 2, p. 145-151. ARANDA, J., SUÑE, J., 2006. – Estudi petrogràfic de les eines polides del terme municipal de
Cardona (Bages, Barcelona). In: A. FÍGULS, O. WELLER (eds.), Acts of Prehistoric and Protohistoric Workshop, Cardona, 2003, IREC, Barcelona.
BARBERÀ, J., DAURA, A., PARDO, D., 1986. – Nous indicis arqueològics al Terme de Cardona.
Butlletí del Patronat Municipal de Museus Cardona, 4, p. 78-80. BONACHE, J., 2006. – Aplicación de algoritmos de Clustering a la clasificación del utillaje de
piedra pulimentada lítica de Cardona. In: A. FÍGULS, O. WELLER (eds.), L’explotació de la sal. Acts of the 1st International Archaeology meeting about Prehistoric and Protohistoric salt exploitation, Cardona, 2003, IREC, Barcelona.
CARDONA, R., CASTANY, J., GUARDA, J., GUERRERO, L., RAMON, M., SOLÉ, J.,
1996. – Estrategies d’intercanvi i societat a la Catalunya interior durant el Neolític Mig: el Solsonià. In: Ier Congrés del Neolític a la Peninsula ibèrica. Gavà, 1995. Rubricatum, 1 (2), p. 537-548.
CASTANY, J., 1991. – Estructures funaràries dels megàlits neolítics del Solsonès. In: 9è Colloqui
internacional d’arqueologia de Puigcerdà, Puigcerdà-Andorra, p. 249-254. CASTANY, J., 1992. – Arquitectura i rituals als sepulcres neolítics del Solsonès, Gala, núm. 1,
Sant Feliu de Codines, p. 71-77. CURA MORERA, M., 1976. – El grup cultural de les cistes neolítiques del Pre-pirineu català.
Cypsela, 1, Girona, p. 49-52. DONOSO i ZAPATA, G., 1998. – El estudio tipológico del utillaje fabricado sobre corneana en
el yacimiento neolítico de las Mines prehistòriques de Gavà – Can Tintorer. Rubricatum, 2, p. 137-144.
EDO, M., VILLALBA, M.J., BLASCO, A., 1992. – Can Tintorer. Origen y distribución de minerales
verdes en el noreste peninsular durante el Neolítico. In: P. UTRILLA (coord.), Coloquio Aragón / Litoral mediterráneo. Intercambios culturales en la Prehistoria. Homenaje al Profesor J. Maluquer de Motes. Zaragoza: Universidad de Zaragoza, p. 361-373.
Première carrière de sel gemme européenne 133
FÍGULS, A., 1989. – Aproximació a l’entorn arqueològic de la Vall Salina: la interacció amb el medi. Butlletí Patronat Municipal de Museus. Cardona, 6, p. 15-23.
FÍGULS, A., 1990. – Introducció a l’estudi espacial de les cistes neolítiques de la Comarca natural
del Cardener. Butlletí Patronat Municipal de Museus. Cardona, 7, p. 21-36. FÍGULS, A., BONACHE, J., 1997. – Estudi del material lític del Museu de Sal Josep Arnau
(Cardona, Bages). XXXIX Assemblea intercomarcal d’estudiosos. Cardona 22 i 23 d’octubre de 1994, Foment Cardoní-Patronat Municipal de Museus de Cardona, p. 143-162.
FÍGULS i ALONSO, A., 2003a. – El sepulcre neolític de Cal Rajolí (Olius, Solsonès). Actes de les
Jornades d’arqueologia i paleontologia (2000). Comarques de Lleida, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Barcelona, p. 147-155.
FÍGULS i ALONSO, A., 2003b. – La necròpolis neolítica de Santa Constança (Clariana de Cardener,
Solsonès). Actes de les Jornades d’arqueologia i paleontologia (2000). Comarques de Lleida, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Barcelona, p. 157-164.
FÍGULS i ALONSO, A., 2004. – La necròpolis neolítica de Palà de Coma (Cardona, Bages). Actes
de les Jornades d’arqueologia i paleontologia (2001). Comarques de Barcelona, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Barcelona, p. 144-154.
FÍGULS, A., 2006. – El neolític mig a l’Altiplà I Prepirineu central. Revisió de l’obra de Joan
Serra I Vilaró. Tres exemple: La necròpolis de Santa Constança (Clariana de Cardener), la necròpolis de Palà de Coma (Cardona) I el sepulcre de Cal Rajolí (Olius). In: A. FÍGULS, O. WELLER (eds.), L’explotació de la sal. Acts of the 1st International Archaeology meeting about Prehistoric and Protohistoric salt exploitation, Cardona, 2003, IREC, Barcelona.
FÍGULS, A., BONACHE, J., ARANDA, J., SUÑÉ, J., VENDRELL, M., GONZÁLEZ, J., MATA-
PERELLÓ, J.M., SANZ, J., FUENTES, A., 2006. – L’explotació neolítica d’halita a la Vall Salina de Cardona. In: A. FÍGULS, O. WELLER (eds.), L’explotació de la sal. Acts of the 1st International Archaeology meeting about Prehistoric and Protohistoric salt exploitation, Cardona, 2003, IREC, Barcelona.
FÍGULS, A., WELLER, O. (eds.), 2006 – L’explotació de la sal. Acts of the 1st International
Archaeology meeting about Prehistoric and Protohistoric salt exploitation, Cardona, 2003, IREC, Barcelona.
GRANDIA, F., 2006. – Introducció a la geologia de la formació salina de Cardona. In: A.
FÍGULS, O. WELLER (eds.), L’explotació de la sal. Acts of the 1st International Archaeology meeting about Prehistoric and Protohistoric salt exploitation, Cardona, 2003, IREC, Barcelona.
LÓPEZ DE AZONA, J.M., 1933. – Industria minera neolítica en Cardona. Notas y comunicaciones
del Instituto geológico minero de España, V (5), Madrid. MARÍN, A., 1933. – El estado actual de la minería de sales potásicas. Madrid. PETRUS, M., 1958. – Prospecciones arqueológicas en la comarca de Cardona. Empúries, XIX-XX,
1957-58, Barcelona, p. 208-216.
O. Weller, A. Fíguls et F. Grandia 134
SERRA VILARÓ, J., 1927. – Civilització megalítica a Catalunya. Contribució al seu estudi. Musaeum Archaeologicum Dioecesanum, Solsona.
WELLER, O., PÉTREQUIN, P., PÉTREQUIN, A.-M., COUTURAUD, A., 1996. – Du sel pour les
échanges sociaux. L’exploitation des sources salées en Irian Jaya (Indonésie, Nouvelle-Guinée). Journal de la Société des Océanistes, 102, Paris, p. 3-30.
WELLER, O., 2002. – The earliest rock salt exploitation in Europe. A salt mountain in Spanish
Neolithic. Antiquity, 76, p. 317-318. http://www.antiquity.ac.uk/ProjGall/Pre2003/Weller/weller.html
WELLER, O., FÍGULS, A., 2006. – Première exploitation de sel gemme en Europe: organisation
et enjeux socio-économiques au Néolithique moyen autour de La Muntanya de Sal de Cardona (Catalogne). In: A. FÍGULS, O. WELLER (eds.), L’explotació de la sal. Acts of the 1st International Archaeology meeting about Prehistoric and Protohistoric Salt exploitation, Cardona, 2003, IREC, Barcelona.
WELLER, O., FÍGULS, A., à paraître. – Place et rôle du sel minier de Cardona dans les échanges
communautaires du Néolithique moyen catalan. In: N. MORERE (ed.), Las salinas y la sal de interior en la historía. Actes du Congrès international de Sigüenza, septembre 2006, Universidad Rey Juan Carlos, Madrid.