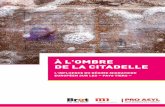Emigrer pour étudier : Le début de carrière migratoire des étudiants kabyles
Transcript of Emigrer pour étudier : Le début de carrière migratoire des étudiants kabyles
1
RICHARD COUËDEL SOUS LA CODIRECTION DE : CONSTANCE DE GOURCY et KAMEL CHACHOUA
UNIVERSITE DE PROVENCE
CENTRE DE LETTRES ET SCIENCES HUMAINES
Septembre 2006
Mémoire de Master 1 de Sociologie
Emigrer pour étudier : La dynamique familiale dans
l’élaboration du projet migratoire
Autour de projets migratoires d’étudiants kabyles
2
INTRODUCTION A l’heure de la rédaction finale de ce mémoire, l’actualité portait sur l’expulsion des familles d’immigrés « sans-papiers » et de leurs enfants pour lesquels les autorités avaient attendu la fin de l’année scolaire. Toujours sujet d’actualité, l’immigration est essentiellement envisagée comme problème auquel a d’ailleurs longtemps fait écho la sociologie en étudiant d’abord l’intégration, l’acculturation des immigrés, l’acquisition par ces derniers d’une position sociale dans la société d’arrivée. Il s’agissait alors d’une approche de la société dominante. Il a fallu attendre les travaux de A. SAYAD pour sortir de l’ethnocentrisme, pour considérer le phénomène migratoire comme mouvement entre une société de départ et une société d’arrivée et enfin étudier l’univers de l’émigré afin de comprendre celui de l’immigré. Nous ne parlons plus quant à nous d’immigration mais d’émigration-immigration. D’autre part l’émigration n’est pas uniforme dans l’espace et dans le temps. Il est nécessaire de poser un regard socio-historique sur le phénomène concerné. Nous avons choisi, pour ce premier mémoire, d’étudier l’émigration estudiantine algérienne kabyle vers la France. A cela plusieurs raisons :
- L’émigration algérienne a plus d’un siècle d’histoire. Elle est le résultat d’un lien particulier entre l’Algérie et la France, initié par une longue période de colonisation, transformé par un dur conflit qui a aboutit aujourd’hui à une relation des plus ambiguës.
- La Kabylie fut et est encore la région la plus touchée par l’émigration-immigration érigée aujourd’hui en tradition.
- Jusqu’à une période récente, 95% de l’émigration algérienne était à destination de la France.
- Depuis la fin de l’immigration de travail, la poursuite des études supérieures en France est un des modes légaux de l’immigration actuelle. Elle fut initiée par les étudiants boursiers du gouvernement algérien après la guerre d’indépendance.
Nous proposons ici de nous inscrire dans la filiation des travaux de A. SAYAD, ce qui est une des originalités de ce mémoire puisque aucun travaux portant sur l’émigration, et a fortiori à partir du pays de départ, n’ont été menés depuis la fin des années 1980. L’émigration algérienne a connu différentes formes. A. SAYAD avait défini trois âges à propos de l’émigration algérienne. Le premier âge était celui de l’émigration sur ordre, il correspondait à l’ère des « norias. » Le second voyait la perte de contrôle du groupe sur l’individu et l’individualisation de l’émigration toujours masculine. Le troisième âge était celui du regroupement familial. Force est de constater que l’émigré étudiant actuel ne correspond plus à cette typologie. C’est une émigration de non-travail avec une forte proportion féminine. Comment se fait-il que des étudiantes puissent maintenant partir seules alors que l’émigration a toujours été essentiellement masculine ? De plus, à l’heure ou les études à l’étranger ne font plus l’objet d’une politique de financement par des bourses et que les obstacles à l’immigration se multiplient, comment se fait-il que l’on parte encore étudier à l’étranger et notamment en France ? Ces considérations nous ont amenés à nous intéresser au processus aboutissant au départ des étudiants. Se poser cette question c’était aussi s’enquérir des raisons qui les poussent à partir. Des raisons économiques ? Ils n’en ont pas vraiment parlé. Notre enquête s’est déroulé du 29 janvier au 12 février 2006 à l’Université MOULOUD MAMMERI à Tizi-Ouzou. Une première enquête exploratoire nous avait permis de consolider notre problématique. Il était incontestable que les familles jouaient un rôle important dans le phénomène étudié. Nous avons choisi d’interroger la dynamique familiale à
3
l’œuvre dans l’élaboration du projet migratoire de l’étudiant, les relations entre l’individu et son groupe, en émettant l’hypothèse centrale que ce dernier avait une attitude « pro-individualiste. » Ce faisant, sont apparues plusieurs dimensions importantes :
- L’importance des prédécesseurs, de ceux qui sont partis mais qui sont revenus, et de ceux qui se sont installés définitivement dans le pays d’arrivée, en France.
- La tradition migratoire s’accompagne d’une dimension cognitive qui, à propos de l’Algérie et de la France, se traduit par une bipolarité, déqualifiant voire disqualifiant l’une et valorisant l’autre.
- Le rôle actif des parents dans l’orientation scolaire de leurs enfants, dans une complicité et une aide à l’élaboration du projet, avec une prévalence du père, surtout pour les filles.
- Et la dimension matrimoniale qui fut un peu la surprise de cette enquête tant elle est prégnante.
Mais il ne s’agit pas simplement d’une question de mariage. Cette dimension traduit la conception d’une émigration comme projet de vie total : Emigrer, partir pour étudier, s’installer, se marier, avoir des enfants,… dans le pays d’immigration. La vie future est conçue d’emblée « là-bas », en France. Les étudiants en décalage avec leur environnement, n’envisagent pas de faire leur vie « ici », en Algérie. Nous avons constaté par ailleurs, derrière ces histoires de mariage, une différence de conception de la relation amoureuse selon le sexe de l’individu. La dimension sexuée de l’émigration déjà évoquée par de précédentes études nous apparaît ici fondamentale. Les étudiants aspirent à une individuation. L’individu devenant sujet tend, dans la mesure du possible, vers une rationalité en « finalités » au pluriel. Cette rationalité ne concerne pas seulement l’étudiant, mais aussi ses parents. C’est sans doute la meilleure traduction d’une société en pleine mutation.
4
I - L’EMIGRATION ALGERIENNE
1 - Introduction La sociologie des migrations envisage sommairement deux problématiques1 : d’une part l’immigration, se concentrant sur ce que l’on nomme tantôt l’intégration, l’acculturation des immigrés et l’acquisition d’une position sociale dans le pays d’arrivée, tantôt l’assimilation ; d’autre part, les migrations traitant des causes et des modalités de la migration, l’action des pays de départ et d’arrivée.
1.1 Sortir de l’ethnocentrisme et de la mémoire sélective
L’étude des migrations fut pendant longtemps une approche de la société dominante, en l’occurrence celle du pays d’arrivée. En France, A. SAYAD est le premier à proposer un regard vraiment novateur en la matière en étudiant le phénomène des migrations en tant que mouvement et lien entre société de départ et société d’arrivée. Jusqu’au milieu des années 70, on n’abordait guère le sujet qu’en terme d’immigration. Beaucoup de travaux semblent ne commencer leur étude sur l’immigré qu’à partir de son apparition sur le sol du « pays d’arrivée2 ». A. SAYAD nous met en garde contre l’ethnocentrisme en sciences sociales qui considère l’immigré en ignorant l’émigré :
« Toute étude de l’émigration qui négligerait les conditions d’origine des émigrés, se condamnerait à ne donner du phénomène migratoire qu’une vue, à la fois partielle et ethnocentrique : d’une part, comme si son existence commençait au moment où il arrive en France, c’est l’immigrant - et lui seul- et non l’émigré qui est pris en considération ; d’autre part, la problématique, explicite et implicite, est toujours celle de l’adaptation à la société d’« accueil » 3 ».
Nous devons donc faire attention à notre approche et à la position que nous prenons pour l’observation de l’objet mais nous devons aussi regarder quelque peu en arrière. La France fait figure d’exception parmi les autres pays de l’Europe qui longtemps se perçurent et étaient vécus comme terres d’émigration. Nous pensons bien sûr aux départs de migrants vers les deux Amériques mais nous pensons rarement l’épopée coloniale en terme de migration. De plus, la France, ayant avant les autres accomplie sa transition démographique, devint à son tour, pour les besoins de son industrialisation et de son urbanisation, terre d’immigration. Après la seconde Guerre Mondiale, lorsque l’immigration redémarre de façon massive, notamment en provenance des pays du Sud, excepté chez les démographes le phénomène apparaît comme inédit.« La France est un pays d’immigration qui s’ignore » nous dit D. SCHNAPPER. Le champ d’étude des migrations internationales a souffert d’un « retard » marquant. L’immigration étant réduite à sa fonction productive, les premières études sont menées par des économistes et des géographes. Bien que quelques ouvrages sociologiques furent écrits dans les années 1930 et 1950, il faut attendre les années 1970 pour voir se développer une sociologie de l’immigration ; discipline qui restera longtemps dévalorisée car s’occupant d’un objet « indigne ». Depuis les années 1980, avec l’importance grandissante de l’Europe, l’immigration occupe une place de plus en plus grande dans le débat politique.
1 REA A., TRIPIER M. (2003), Sociologie de l’immigration, La découverte. 2 Nous nous abstiendrons d’utiliser le terme de « pays d’accueil » étant donné l’accueil parfois réservé à l’immigré. 3 SAYAD A. (1977), « Les trois âges de l’émigration algérienne en France », Actes de la recherche en sciences sociales, n°15 p. 59-89. Article repris dans : La double absence, Paris, Seuil, 1999.
5
Devant le phénomène de mondialisation des courants migratoires où la frontière entre l’immigré et le sédentaire est devenue beaucoup plus floue, certains chercheurs telle C. WITHOL DE MENDEN4 préfèrent parler de « mobilités ». La notion de mobilité5 renvoie ici tout d’abord à une capacité de déplacement et surtout à la possibilité de changement rapide de lieu, maintenant possible par des transports moins longs et moins coûteux. Un élément comme la généralisation de la détention des passeports a facilité cette envie d’ailleurs dont la proximité apparaît aujourd’hui plus grande grâce aux réceptions médiatiques tels l’antenne parabolique et Internet. C. WITHOL DE MENDEN relève une contradiction entre le fait qu’il soit maintenant possible de partir de chez soi et la limitation voire l’impossibilité d’entrer ailleurs, notamment en raison de la mise en place des visas et plus significativement de filtres aux frontières sous la forme de quotas plus ou moins arbitraires. En dépit de la fermeture des frontières, la pression migratoire s’est maintenue, empruntant les voies tantôt du regroupement familial, tantôt de l’asile mais aussi celles tant médiatisées de la clandestinité. Pour C. WITHOL DE MENDEN, la mobilité, quand elle est possible, se traduit parfois par des allers-retours permanents et s’installe en mode de vie. Nous n’utiliserons pas ce terme de mobilité puisque la fermeture des frontières, si elle vise à limiter le flux migratoire des entrées, limite aussi celui des sorties : pourquoi risquer de sortir d’un pays où l’on a réussi à s’installer s’il s’avère ensuite difficile voire impossible d’y entrer à nouveau ? Le mouvement des allers-retours se trouvant ainsi bloqué, le solde positif ne peut que se renforcer du côté des entrées. Une frontière n’est jamais étanche.
1.2 L’émigration : un fait social total
Pour A. SAYAD, la migration est ce que Marcel MAUSS appelle un « fait social total », c’est-à-dire un processus qu’il propose d’étudier dans sa globalité.
« Parler de l’immigration, c’est parler de la société en son entier, en parler dans sa dimension diachronique, c’est-à-dire dans une perspective historique, et aussi dans son extension synchronique, c’est-à-dire du point de vue des structures présentes de la société et de leur fonctionnement ; mais à condition de ne pas mutiler cet objet d’une partie de lui-même, la partie relative à l’émigration6 ».
Un immigré, avant de le devenir est avant tout un émigré. « Seules des trajectoires d’émigrés intégralement reconstituées peuvent livrer le système complet des déterminations qui, ayant agi avant l’émigration et continué d’agir, sous une forme modifiée, durant l’immigration, ont conduit l’immigré au point d’aboutissement actuel 7».
A. SAYAD cherche dans un premier temps, comme l’a fait avant lui T. ZNANIECKI, à comprendre les conditions qui , dans la société de départ, ont conduit les sujets à s’en remettre à l’émigration. A.SAYAD construit deux systèmes solidaires, d’un côté les variables d’origine, caractéristiques sociales, dispositions, aptitudes socialement déterminées avant l’entrée en France, de l’autre côté, les variables d’aboutissement, les différences qui séparent les immigrés en France même.
4 WHITOL DE MENDEN C., “Un essai de typologie des nouvelles mobilités”, Hommes et Migrations, N° 1233, septembre - octobre 2001. 5 Le petit Robert, 2001. Mobilité : Caractère de ce qui peut se mouvoir ou être mû, changer de place, de position. Caractère de ce qui change rapidement d’aspect ou d’expression. Lat. mobilitas 6 SAYAD A. (1991), L’immigration ou les paradoxes de l’altérité, Bruxelles, éd. De Boeck Université, p.15. 7 SAYAD A. (1977), Op. Cit.
6
« La confrontation de ces deux séries de variables, […] a conduit à rompre avec la représentation trop facilement admise d’une immigration homogène, indifférenciée, soumises pareillement aux mêmes actions et aux mêmes mécanismes8 ».
Ce qui revient à rompre donc avec l’image stéréotypée de la « noria », ce perpétuel renouvellement des hommes toujours nouveaux, toujours identiques, image du rural émigrant seul pour une durée nécessairement limitée. A la suite de A.SAYAD, nous envisageons notre étude au sein de cette problématique en nous préoccupant de la phase préliminaire de la migration, l’émigration. La définition du dictionnaire9 nous dit : « Emigration » : action d’émigrer, c’est-à-dire de quitter son pays pour aller s’installer dans un autre, temporairement ou définitivement. Cette définition s’arrête à l’aspect factuel et permet une large acception du terme. Elle inclut tout d’abord la question du découpage administratif. Les frontières, telles que nous les connaissons actuellement, ont été instaurées progressivement avec l’apparition des états-nations et sont, somme toute, de constitution récente. Or la migration est un droit qui préexiste à ces découpages. M. PERALDI avance, à ce propos, à la suite de Kant dans son « traité pour la paix perpétuelle », que l’Europe, en fermant ses frontières, « oublie » le droit de visite au profit de la sécurité intérieure.
« En Europe aujourd’hui, on traite les étrangers à la philanthropie plutôt qu’en leur reconnaissant des droits10 »
On leur attribue bien un « droit de résidence » mais il est accordé de manière sélective et suppose un régime d’étrangeté d’une infériorité radicale, celle de l’esclave ou du barbare, paradoxalement intégré à la cité mais dépourvu de droit, à côté duquel le citoyen est libéré de toute dette et de tout contrat. En préférant le « droit de visite », M. PERALDI se réfère à un autre régime, celui qui permet d’établir les règles d’un «échange au monde », à l’image du commerçant établi sur la place portuaire, de l’« étranger » appartenant au social, aux « luttes des places » et du classement :
« Ce droit de visite est un droit réciproque qui présuppose la mobilité croisée et l’intensité des échanges11 ».
C. WHITOL DE MENDEN12, quant à elle, insiste sur les effets de la mondialisation qui contribue à installer dans la mobilité des populations variées. Ceux qui partent ne sont pas les plus pauvres contrairement à l’idée généralement répandue. Ce sont plutôt les classes moyennes, des diplômés et parmi eux ceux qu’on appelle les « cerveaux » ou qui le deviendront, des femmes isolées, des mineurs. Ils sont attirés par un mieux-être, pas seulement économique, mais bien plutôt social, culturel, politique, religieux, sexuel ; pas tellement par un pays précisément que par des métropoles économiques et culturelles du « système monde ». C.WITHOL DE MENDEN cite la typologie des migrations de Gérard-François DUMONT13 qui propose plusieurs classements selon la nature, l’intensité et les types de flux, en cinq champs : spatial, social et culturel, temporel, juridique, et théorique. Pour elle , la distinction fondamentale est celle qui différencie les « stocks » et les flux migratoires, les installés et les 8 SAYAD A. (1977), Op. Cit. 9 Le Petit Robert, 2001. 10 PERALDI M. (2003), « Droit de visite et principe d’humanité », La pensée de midi, n°10, Eclats de Frontières, été 2003. 11 Les Algériens pouvaient migrer sans visa jusqu’en 1985. 12 WHITOL DE MENDEN C. (2001), Op. Cit. 13 DUMONT Gérard-François (1995), Les migrations internationales. Les nouvelles logiques migratoires, SEDES, Paris, 223p.
7
entrants ainsi que la typologie juridique qui, à l’instar de l’organisation des populations de la Rome antique, s’organise en cercles concentriques hiérarchisés en fonction du statut (nationaux, ressortissants européens, résidents non-communautaires, non-communautaires non résidents, réfugiés, demandeurs d’asiles, sans-papiers) ; Ce qui a des conséquences immédiates sur la vie quotidiennes des individus. Elle nous conseille en définitive une typologie plus pertinente distinguant les formes, les facteurs et les objectifs de la mobilité. Cependant nous ne la suivrons pas quant elle dit : « il y a, in fine, autant de types de migrations que de migrants eux-même …». Nous aurons cependant besoin pour notre étude de précision. Quel rapport y-a-t-il en effet entre l’exode d’un peuple qui fuit la guerre civile ou la famine (ceux que l’on nomme couramment les réfugiés), des travailleurs à la recherche d’un emploi, des cadres suivant une trajectoire sociale et mobile dans une logique carriériste, des étudiants allant poursuivre leurs études à l’étranger, des chercheurs prétendant à une meilleure valorisation de leur savoir, etc. Nous pourrions citer bien d’autres cas entrant dans la définition de l’émigration citée précédemment. Nous exclurons de notre étude l’émigration ayant un caractère forcé plus ou moins violent, c’est-à-dire provoquée sous la menace ou la contrainte. Nous exclurons également les migrations d’activités saisonnières souvent rurales, n’entrant pas véritablement dans notre définition. Peut-on dire effectivement dans ce cas que l’on quitte son pays ? Il en va de même des migrations pendulaires (Cf. les travaux de Péraldi et Tarrius) dans lesquelles les individus ont un pied dans chaque territoire. De plus, les « nouvelles » formes de migration telles celles des clandestins traversant la Méditerranée, des sans papiers mais aussi celles de la fuite des « cerveaux » des pays du Sud au bénéfice des pays du Nord, représentent deux cas de figures extrêmes. Les premiers opérant de manière illégale et les seconds étant accueillis à bras ouverts voire invités nous apprennent peu sur la réalité des logiques sociales à l’œuvre dans l’acte d’émigrer. Par contre, lorsque nous parlons de la population installée dans le pays d’arrivée, nous distinguons, comme le fait l’INSEE, deux termes : La population étrangère qui est composée d’individus ayant déclaré une nationalité autre que française et la population immigrée qui est composée de personnes nées étrangères dans un pays étranger14. Nous verrons les difficultés qu’engendre la non distinction entre ces deux catégories. Une autre difficulté réside dans le fait qu’en France, et ce depuis le régime de Vichy, nous ne disposions pas de statistiques ethniques (ni religieuses) officielles comme aux Etats-Unis par exemple. Si nous disposons d’information via les services consulaires pour le pays de départ, peu d’éléments sont à notre disposition pour étudier la population émigrée une fois arrivée en France. Les catégories euphémisées sont floues, porteuses de préjugés et souvent trop chargées médiatiquement pour être utilisables.
1.3 L’exemplarité de l’émigration algérienne
Nous avons choisi de restreindre géographiquement notre étude à l’émigration algérienne et plus précisément à l’émigration kabyle. Nous disposons d’une importante tradition sociologique sur le sujet. P. BOURDIEU grâce à et en collaboration avec A. SAYAD, a produit une véritable sociologie de l’Algérie, et cela malgré les dangers, dans un pays en pleine guerre d’indépendance. Plus tard, A. SAYAD, en renouvelant l’approche des migrations, fit des travaux sur la genèse, l’histoire, les mutations et les ressorts de l’émigration algérienne qu’il qualifia d’« exemplaire ». C’est l’exemple type
14 INSEE (1999), Recensement de la population, mars.
8
de l’émigration post-coloniale. Il existe en France une forte communauté algérienne dont la constitution est consécutive des dérèglements dû à la colonisation. C’est bien un des paradoxes de la colonisation que d’avoir vu se constituer après l’indépendance de l’Algérie une population émigrée chez l’ancien colonisateur. La politique coloniale particulière à l’égard de la Kabylie prédisposait en tous points cette région à être pionnière en matière d’émigration.
1.4 L’émigration post-migratoire : une émigration mixte de non-travail
A. SAYAD a distingué trois âges dans l’émigration algérienne vers la France15. Ces âges se déroulent certes de façon chronologique mais ils sont avant tout des formes prises par l’émigration, qui s’installant à un moment donné, perdurent jusqu’à se chevaucher. Le dernier de ces âges s’accompagne du regroupement familial dont on peut considérer qu’il eut principalement cours jusqu’à la fin des années 80. Dans son approche, il privilégie le point de vue du sujet qui impose une démarche qualitative mettant au centre de l’étude la parole des acteurs. Il s’est ainsi fait porte-parole, comme dit P. BOURDIEU, de l’émigration/immigration et a redonné la parole à des acteurs, qui absents d’un côté et totalement dominés de l’autre, en sont le plus démunis. Le contexte des années 90, ce que les Algériens appellent tantôt la « décennie noire » tantôt la « guerre civile » ou encore officiellement la « tragédie nationale », a probablement constitué une rupture importante dans l’histoire de ce pays. Nous ne traiterons pas de la question de l’émigration durant cette période étant donné que partir, quitter le pays tenait pour beaucoup de la survie, ce qui revient en quelque sorte à une émigration forcée qui, de mon point de vue, n’entre pas dans l’analyse centrée sur le sujet que je compte proposée. Mais qu’en est-il de l’émigration actuelle, c’est-à-dire depuis l’an 2000 ? La volonté d’émigration existe bel et bien de façon massive malgré les difficultés et les obstacles rencontrés. L’obtention du visa représente à bien des égards une véritable « loterie16 », dont l’attente du résultat est visible tous les jours tôt dès le matin devant le consulat de France à Alger. D’autre part, les modes que prend actuellement l’émigration ne correspondent plus à ceux définis par A. SAYAD. Peut-on parler d’un « quatrième âge » de l’émigration algérienne ? La volonté d’émigration touchant toutes les catégories sociales17, nous nous concentrerons sur une des populations actuellement représentatives des départs : les étudiants qui désirent poursuivre leurs études à l’étranger. C’est actuellement un des moyens privilégiés et légaux pour venir en France. Nous privilégierons la Kabylie, en enquêtant auprès de candidats au départ, des étudiants de l’université provinciale de Tizi-Ouzou. Nous constituerons un échantillon diversifié en interviewant des garçons et des filles issues d’origines (rurales et urbaines) et de cursus différents. Nous serons vigilants quant à la constitution et à l’histoire familiale. Nous pensons que la diversité et la singularité des cas sont un apport supplémentaire dans notre enquête. Peu d’ouvrages traitent des raisons et des causes du départ, comme si l’on partait encore du postulat implicitement reconnu que les gens partent de chez eux pour des raisons économiques. Méfions-nous de l’unanimité et osons encore poser cette question qui peut
15 Je détaille en quoi consistent ces trois âges dans la deuxième partie. 16 MASCHINO M.T. (2003), « La loterie des visas », in Le monde diplomatique, mars, pp. 4 et 5. 17 J’utilise ce terme de catégorie sociale avec beaucoup de circonspection dans le cadre de l’Algérie et surtout dans cette étude en Kabylie. C’est une société encore majoritairement rurale en pleine mutation où l’on ne peut raisonner comme on le fait au sujet des sociétés modernes en terme de classes sociales.
9
paraître naïve18 : Pourquoi les gens partent de chez eux ? Mais poser cette question de but en blanc aux intéressés risque, comme le dit H.S. BECKER19, d’engendrer une réaction de défense comme s’il s’agissait pour eux de se justifier. Pour des raisons d’ordre pratique, nous aborderons donc la question plutôt en terme de processus afin de mettre en avant les facteurs et les déterminants qui participent au projet migratoire et, chez l’individu, ses pratiques et ses actions. Nous savons peu de choses sur la genèse du départ : Comment naît chez l’individu l’idée du départ ? Quels sont les éléments qui participent à la décision de partir et à la genèse du projet ? Comment se construit le projet de départ chez l’individu ? Quels sont les moyens que l’individu met en œuvre pour réaliser son projet ? Ce qui revient en définitive à poser la question centrale : Quelle est la genèse du projet d’émigration ?
18 Mais les questions naïves, au même titre que celles que posent les enfants, sont souvent pertinentes et parfois dérangent. 19 BECKER H.S. ( 2002), Les ficelles du métier, Paris, La Découverte & Syros, Coll. Guides Repères.
10
2 - Eléments socio-historiques Nous proposons de poursuivre le raisonnement de A. SAYAD et de son approche temporelle du phénomène migratoire. Dans une lecture des changements opérés de l’émigration – immigration algérienne, il nous montre que le mouvement migratoire, pour une même population, peut être différent, en terme d’objectifs et de significations pour les individus en fonction du contexte et des transformations de la société de départ. Il définit ainsi trois phases, trois « âges » de l’émigration algérienne. Nous devons tenir compte de la démographie20 du pays et des principaux évènements ayant fait naître, croître ou décroître, en bref influencé les mouvements migratoires algériens. La lecture des différents ouvrages de Benjamin STORA21 est une bonne entrée en matière. Il distingue d’emblée la population française de la population musulmane22. Cette approche historique est complétée par l’ouvrage de A. GILLETTE et A. SAYAD23.
2.1 La colonisation française en Algérie
Entre 1830, année habituellement retenue comme marquant le début de la colonisation française en Algérie, et 1860, la population musulmane est estimée à 3 millions d’habitants.
Tableau 1 : évolution démographique de l’Algérie Année Nombre d’habitants (en millions) 1860 3 1872 2,1 1891 3,5 1911 4,7 1921 5 1936 6,3 1954 8,8 1970 13,7 1988 18,7 1993 26,6 2005 32,6
20 On ne peut raisonnablement passer sous silence le fait que la population algérienne ait doublé du début du siècle à 1954 et presque quadruplé depuis cette date. Cela ne peut pas être sans conséquences a priori sur la pression migratoire. 21 STORA B. (2004), Histoire de l’Algérie coloniale (1830-1954), Paris, La découverte, coll. « Repères », (1ère édition 1991). STORA B., (2004), Histoire de l’Algérie depuis l’indépendance, t1. 1962-1988, Paris, La découverte, coll. « Repères », (1ère édition 2001) 22 Jusqu’à l’indépendance en 1962, l’Etat français distinguait les Français de plein droit (les Français et Européens d’origine, les Juifs d’Algérie depuis les décrets Crémieux du 24 octobre 1870 et quelques Algériens occupants des postes dans l’administration) et les Français musulmans, i.e. les Algériens relevant du code de l’indigénat. 23 GILLETTE A. et SAYAD A. (1984), L’immigration algérienne en France, Paris, Entente, coll. « Minorités » (1ère édition 1976).
11
On enregistre une chute de la population entre 1861 et 1872 où l’on on dénombre alors 2 125 000 Algériens. La reprise de la croissance enregistrée en 1891 ne fléchira plus jusqu’à nos jours. La population double entre le début du siècle et 1954, année du début de la guerre d’Algérie. La population algérienne et l’activité du pays étant essentiellement rurale, il apparaît un « trop-plein » qui n’a pu être absorbé par les centres industriels encore peu importants. Trois options se présentaient alors : rester sur place, aller grossir la périphérie des villes ou bien émigrer. Elles nous rappellent que l’émigration d’Algérie n’a jamais été l’aboutissement normal d’une évolution par laquelle la société algérienne se serait d’elle-même transformée. L’irruption des colonisateurs en Algérie et d’une économie capitaliste, dont la logique et l’esprit étaient fondamentalement opposés à l’économie essentiellement rurale et pré-capitaliste, ont engendré des perturbations profondes ; l’émigration algérienne vers la France en est une des conséquences. Une série de lois foncières se succédant de 1840 à 1930 vont, afin d’établir de façon « légitime » les conditions favorables au développement d’une économie moderne fondée sur l’entreprise privée et la propriété individuelle, engendrer la dépossession des Algériens de leur terre. S’ajoute à cela des mesures d’expropriation pour cause « d’incultures ». La paupérisation de la population rurale s’aggrava encore par plusieurs calamités agricoles. Ce qui entraîna des famines et des épidémies meurtrières, l’exode de tribus entières vers le Maroc, la Tunisie et même la Syrie. C’est ainsi que l’on explique la stagnation tout d’abord puis la régression de la population entre 1861 et 1872. En 1871, suite à la dernière grande insurrection rurale, la répression se traduisit par des séquestres fonciers privant de leurs terres les plus riches les populations montagnardes. Ces dernières allaient ainsi fournir les premiers contingents d’émigrés. L’agriculture algérienne subit alors une régression de sa production d’autant plus dramatique qu’elle était destinée essentiellement à l’autoconsommation. L’Algérie connût ensuite une reprise démographique intense suivi d’un processus d’urbanisation à partir du début du 20e S. Processus qui s’accompagna d’une prolétarisation de la main d’œuvre disponible.
« Colonisation, dépossession, prolétarisation : ainsi la France avait-elle tracé, non sans violence, le chemin de l’émigration24 ».
2.2 Les premiers émigrés
De 1871 à 1913, les premiers émigrés algériens furent des convoyeurs qui accompagnèrent à Marseille les troupeaux exportés. Bien que les Algériens furent soumis dans leurs déplacements au code de l’indigénat25, ils furent suivis par des colporteurs, des marchands forains et des ouvriers attachés à des Français rentrant en Métropole. Ces derniers qui allaient servir d’intermédiaire entre employeurs français et main d’œuvre algérienne, furent les premiers agents recruteurs en France. Notons qu’à la même époque existait aussi une émigration vers les deux protectorats voisins, le Maroc et la Tunisie.
24 GILLETTE A. et SAYAD A. (1984). 25 La loi de 1881 officialisa un « code de police indigène » qui ne cessa qu’en 1944.
12
2.2.1 La Kabylie surtout Les tout premiers immigrés venaient surtout de Kabylie, des communes de Aïn-el-Hammam (Michelet), Larbaa Aït-Irathen (Fort National), Draa-el-Mizan et Guergour (La Fayette). Les raisons habituellement retenues sont les conditions géographiques, démographiques et économiques : pays de moyennes montagnes densément peuplées, très petites propriétés foncières, arboriculture, élevage. Il existait aussi une très vielle tradition migratrice ; journaliers dans les terres de la Mitidja, colporteurs à travers toute l’Algérie. Mais, ajoutent A. SAYAD et A. GILETTE, la Kabylie a fait l’objet de la part de l’administration coloniale d’une politique spéciale, à tel point que l’émigration kabyle devint une des pièces de la « politique berbère ». L’indigénophilie coloniale avait cru trouver en pays kabyle le « bon sauvage » digne de l’assimilation française. A ce titre le directeur de l’école des Lettres d’Alger, Masqueray, déclara en 1884 : « s’il y a vingt ans, un ministre avait fondé en pays indigène, 700 écoles professionnelles, nous aurions maintenant 3 000 000 d’associés parlant notre langue , connaissant nos lois, rompus à nos métiers…. En cas d’excès des forces vives, des milliers d’ouvriers kabyles et chaouïas iraient offrir leurs bras en France, à la place des italiens et des Espagnols ». De fait, les tous débuts de l’émigration coïncidèrent avec l’ouverture des premières écoles, celles des jésuites et des pères blancs, en Kabylie dès 1873. L’école devint obligatoire dans cette région en 1885. Ces mesures ne furent pas sans controverses des deux côtés de la Méditerranée de la part des colons et de leurs partisans. Ils y voyaient la fuite de leur main d’œuvre, un moindre contrôle sur elle mais surtout, avec une certaine clairvoyance les conditions de son émancipation future. Ces conditions historiques qui font de la Kabylie la première région d’émigration de l’Algérie, son rapport particulier à l’administration coloniale et, à travers elle, à la France jusqu’à nos jours, ont grandement contribués au choix de cette région pour le cadre de mon étude.
2.2.2 Contribution à l’effort de Guerre (1914-18) Le phénomène migratoire algérien est resté marginal jusqu’à la veille de la Première Guerre Mondiale. En 1906-1907, les raffineries et huileries de Marseille, pour briser les grèves, firent appel à plusieurs centaines d’ouvriers algériens, kabyles pour la plupart. Il furent ensuite transférés dans les usines parisiennes. A la même époque, les mines de la région de Lens importèrent de la main d’œuvre algérienne. On compte en 1914, 7 444 départs d’Algérie pour 6 000 retours. On ne parle pas encore d’Algériens en France. On peut par contre affirmer que l’émigration algérienne s’est instituée de façon durable dès 1915 par la participation de contingents algériens à la Première Guerre Mondiale. Une ligne verticale se dessine du port d’arrivée jusqu’au front : Marseille, Paris, Nord. Mais la guerre s’installe pour durer. Le 14 septembre 1916, un décret du ministère de la Guerre crée un « service des travailleurs coloniaux chargé d’organiser le recrutement de la main d’œuvre indigène en Indochine, Chine et Afrique du Nord ». Cette réquisition, mesure extrême, faisant qu’un Algérien fut passible du conseil de guerre en cas de refus, ne fut pas tant prise à l’encontre des Algériens que pour vaincre les résistances des Français d’Algérie. L’Etat français devint ainsi recruteur et contrôleur de la main d’œuvre coloniale. C’est ainsi que 78 566 algériens entrent en France entre 1915 et 1918. Ils sont embauchés essentiellement pour l’intendance, la fabrication de l’armement, mais aussi pour le creusement des tranchées sur le front.
13
Cette première introduction d’Algériens en France s’est faite par des déplacements, des prélèvements de populations colonisées, le plus souvent au sein de collectivités tribales démantelées. Le processus migratoire est directement lié aux différentes vagues de dépossessions foncières en Algérie : L’histoire de l’émigration se confond avec l’histoire de la société rurale, de sa déstructuration. En 1919, ils n’étaient plus que quelques milliers en métropole. Mais le processus migratoire était enclenché. La preuve était faite tant pour les employeurs français que pour les Algériens que l’émigration était profitable.
2.3 La reconstruction
De 1920 à 1924, on enregistre le premier grand flux : la reconstruction des régions dévastées et l’évolution démographique de la France due aux pertes humaines durant La Grande Guerre nécessite un apport important de main d’œuvre immigrée. Alors qu’en 1919 le nombre de départs et de retours d’Algériens étaient à peu près équivalent (environ 17 400), en 1924 on comptait 71 028 départs pour 57 467 retours. Un volant d’une centaine de milliers de travailleurs algériens allait être maintenu en France dans les années 1920, principalement dans la région parisienne. Il s’agit bien d’une immigration « provoquée » par la France pour ses besoins de guerre premièrement, économiques et démographiques pour sa reconstruction ensuite, et non simplement une émigration suscitée par la pression démographique de l’Afrique du Nord, thèse qui a longtemps servi d’explication. L’émigration commence alors à gagner d’autres régions d’Algérie. C’est ainsi qu’un flot d’argent jusqu’alors inconnu se déversa de façon généralisée sur l’Algérie (salaires mais aussi primes versées aux militaires, allocations,…). Il contribua pour beaucoup à la naissance et à la propagation de la monnaie. S’en suivra un afflux croissant vers la France qui va jusqu’à inquiéter les entrepreneurs et les colons d’Algérie. Ceux-ci tenteront via le ministère du Travail de limiter les départs mais le conseil d’Etat rappela à l’ordre le gouvernement général d’Algérie. La crise de 1929 cependant toucha durement le mouvement migratoire qui diminua jusqu’en 1935. Cela traduit la vulnérabilité des immigrés, les premiers touchés par le chômage en cas de difficultés économiques. En 1936, c’est la reprise. Aux départs individuels s’ajoutent les recrutements collectifs dans les douars, par des officiers indigènes francisés, d’Algériens qui étaient encadrés jusqu’au camp d’hébergement de l’entreprise.
Le premier âge de l’émigration algérienne Ce premier grand flux qui va continuer dans sa forme jusqu’à la Seconde Guerre Mondiale correspond à ce que SAYAD appelle le premier « âge » de l’émigration algérienne. Du point de vue de la société de départ, il s’agissait d’une « émigration sur ordre ». Dans une société paysanne qui luttait pour sa survie, le paysan était désigné par son groupe, mandaté par sa famille, son village pour une mission : ramener l’argent, les moyens nécessaires à sa perpétuation. Il était sélectionné selon des critères d’excellence paysanne :
« bon travailleur de la terre et de la maison (paysan accompli) », il était aussi « bon travailleur pour la terre et pour la maison (le bon émigré) 26».
Il se devait de rester fidèle au groupe et fidèle à ses qualités et son honneur de paysan. Les départs étaient rythmés par le calendrier agricole. Il partait pour une durée courte et chaque départ était un acte unique sans rapport avec le précédent. Il s’agit plutôt d’un perpétuel recommencement. Nous insisterons ici sur l’importance du groupe que ce soit la famille, le
26 SAYAD A. (1977), Op. Cit.
14
groupe agnatique ou le village, ce qui en Kabylie revêt souvent un caractère synonymique. L’émigré devait rester fidèle à ses origines, aux valeurs paysannes. Afin de mieux résister « aux tentations et aux effets dissolvants de la vie urbaine », il reconstituait en France, avec ses compagnons, le « petit pays » selon le schéma des structures sociales et du réseau de relations familières. C’est l’image de la « noria », rotation perpétuelle de paysans algériens qui va passer dans le sens commun et qui va être maintenue pendant longtemps va être maintenue dans les esprits. Dans un autre article, A. SAYAD analyse le mécanisme « Elghorba 27» par lequel le phénomène migratoire se reproduit. Il est illustré par le discours de Mohand A., jeune émigré en France. Il est issu d’un village kabyle où dit-il « il y a plus de gens en France qu’au village », où les jeunes n’ont pas d’autres perspectives d’avenir, pas d’autres ambitions que partir. Une longue tradition d’émigration a contribué à la désagrégation de cette communauté rurale à tel point que l’émigration est devenue l’acte d’« émancipation » par excellence.
« Aussi intimement pénétrée par l’émigration, il n’est pas étonnant que toute la vie du village soit, en définitive étroitement dépendante de la vie des émigrés ; c’est toute la communauté locale qui vit comme « suspendue » à son émigration qu’elle appelle « la France » ».
Dans le village, la position de chaque famille est étroitement liée à l’ancienneté et à la densité de son émigration. A la condition d’être suffisamment riche en hommes pour être présente à la fois dans le village et dans l’émigration, la famille est assurée d’être détentrice du capital économique fourni par l’émigration et du capital symbolique selon le « bon usage » qui en est fait ; deux capitaux au principe même de la hiérarchie sociale. Toutes les conditions sont réunies pour que la France soit perçue comme un « enchantement ». Mais Mohand A. découvre une contradiction entre la réalité de sa condition d’émigré et l’image enchantée qu’il se faisait auparavant de la France :
« …dans notre France à nous, il n’y a que des ténèbres. J’ai découvert ce qu’est l’exil (elghorba) ». « Quand nous retournons de France, tout ce que nous faisons, tout ce que nous disons, c’est du mensonge ».
Mais ce mensonge, ne pouvant qu’être indicible, contribue à perpétuer l’illusion. Ainsi le discours de l’émigré tourne autour de la « triple vérité » de elghorba : une logique traditionnelle qui l’associe au couchant, à l’obscurité, à l’éloignement, à l’isolement, à l’exil, à la frayeur, etc.… ; une vision idéalisée de l’émigration, source de richesse et acte d’émancipation, identification au bonheur, à la lumière, l’assurance,… ; « l’expérience de la réalité de l’émigration vient démentir l’illusion et rétablir elghorba dans sa vérité originelle ». Notons que ce mécanisme de reproduction par l’illusion entretenue de l’émigré initié lors du premier « âge » de l’émigration algérienne est tout aussi réel durant l’âge suivant.
2.4 La Seconde Guerre Mondiale
Les prémisses de la guerre déclenchèrent le retour de nombreux émigrés. En février 1940, le gouvernement général supprima la relative liberté de circulation trans-méditerranéenne devenant ainsi le canal obligé de tout mouvement notamment des recrutements du service de la main d’œuvre indigène du ministère du Travail de plusieurs milliers d’Algériens sous encadrement militaire pour les chemins de fer et les industries. Ils furent rapatriés à
27 SAYAD A. (1975), « ELGHORBA : Les mécanismes de reproduction de l’émigration », Actes de la recherches en sciences sociales, n° 2, pp. 50-66.
15
l’armistice. Le débarquement anglo-saxon en Afrique du Nord en novembre 1942 mis fin à l’émigration jusqu’en 1945. On ne dénombrait en 1946 que 22 114 Algériens. Mais à partir de cette date, devant le besoin de main d’œuvre pressant et à la faveur d’une forte croissance économique, la liberté de circulation devint totale. La régulation des mouvements migratoires sera jusqu’à l’indépendance spontanée et fonction de la situation économique en France. Toute tentative de contrôle échoua. On compta 66 000 départs en 1947 et 194 000 en 1955.
Le deuxième âge de l’émigration algérienne Le deuxième « âge » que définit SAYAD correspond à la perte du contrôle qui était exercé précédemment sur l’individu. La communauté paysanne n’a pu maîtriser les conséquences, les effets désintégrateurs de l’émigration en tant que déracinement. S’ajoute à cela, les « agressions » résultant du contact avec la société coloniale et surtout de la généralisation des échanges monétaires dans une économie auparavant de subsistance qui était basée essentiellement sur le troc. L’émigration, en devenant la principale source des revenus monétaires qui circulaient dans cette société paysanne, a contribué à la diffusion de l’esprit de calcul et à la modification des dispositions de l’individu à l’égard de l’économie, contribuant ainsi a renforcé le processus de « dépaysannisation », phénomène décrit dans un ouvrage28 co-écrit par P. BOURDIEU et A. SAYAD lui-même. Ce processus de dépaysannisation a eu pour effet de modifier les conditions initiales de l’émigration. Le paysan « dépaysannisé », en portant en lui tout ce qui est la négation du paysan traditionnel, a engendré une nouvelle forme d’émigration et un nouveau type d’émigré avec des aspirations nouvelles. L’émigration devient une « aventure » fondamentalement individualiste. L’émigré cesse alors d’être un paysan en esprit, il rompt avec le groupe en renonçant non seulement à entretenir des relations privilégiées avec celui-ci mais plus encore à s’en émanciper. L’émigration devient une entreprise individuelle. L’émigré est généralement plus jeune que celui de la phase précédente. L’individu envisage sa condition d’émigré comme porteuse de sens et tend à faire de son émigration sa propre fin. Une autre caractéristique de cette phase est qu’elle est devenue la condition commune d’une majorité de la population masculine. Nous pouvons noter une contradiction importante relevée par A. SAYAD. Alors que cette nouvelle forme d’émigration, par la satisfaction qu’elle apporte aux exigences économiques et sociales nouvelles imposées à la société paysanne, « porte en elle-même les mécanismes de sa perpétuation », l’individu émigré de cette seconde phase, soucieux de pourvoir à ses propres dépenses en France, n’envoie plus au groupe resté sur place qu’une assistance alimentaire, contrairement à celui de la première phase pour qui conserver une partie de ses revenus paraissait scandaleux. Une tension apparaît à ce stade entre l’individu et son groupe. Cette seconde phase voit aussi changer la durée des séjours. Ils deviennent de plus en plus longs. Le retour au pays ne se fait plus guère que pour les congés. Nous sommes passés d’un calendrier migratoire selon l’activité agricole de la société de départ à celui selon l’activité industrielle du pays d’arrivée. L’individu a un rapport plus étroit à l’emploi se traduisant par une plus grande stabilité et plus intéressé par son attention portée à la « carrière », renversant ainsi sa relation à l’égard de la société d’arrivée. L’autre versant étant que, retournant dans son village l’été comme « vacancier », parfois même « étranger », il devient « invité » dans sa propre maison. Il s’agit d’un premier renversement de perspectives. Il confirme bien toute la distance que l’individu a pu prendre avec son groupe d’origine.
28 BOURDIEU P. et SAYAD A. (1964), Le déracinement, la crise de l’agriculture traditionnelle en Algérie, Paris, Minuit (rééd. 1996).
16
Ces transformations ont eu des conséquences sur la société paysanne de départ que celle-ci n’est plus capable de maîtriser. A. SAYAD ajoute que, si dans la première phase, un rapport unissait l’émigration à l’indivision familiale – en quelque sorte le prolongement de l’organisation domestique – alors dans la seconde phase une inversion s’est effectuée : l’indivision qui préexistait au départ n’est maintenant reconstituée temporairement que pour cette circonstance, comme un prétexte. L’individu émigré ressent de plus en plus ce lien au groupe comme une charge. « Le calcul et l’esprit de calcul introduit par l’émigration tendent à se généraliser, même entre proches (…), sapent les fondements de l’ancienne solidarité et ruinent le sentiment de fraternité qui soudait l’unité familiale ». A. SAYAD perçoit également des changements, au sein la famille elle-même, des rapports entre les générations. L’émigration de la seconde phase, composée d’individus généralement plus jeunes, même s’ils sont absents, a permis à ceux-ci de s’émanciper de la tutelle familiale, d’être promu socialement et ainsi de renverser la hiérarchie qui préexistait. « En même temps que se transforment les rapports internes à la famille, c’est tout le système des échanges économiques (et symboliques) entre les générations qui se modifie ». A. SAYAD conclue ainsi l’analyse de ce second « âge » de l’émigration algérienne : « En bref, c’est la dialectique entre les structures familiales et les structures de l’émigration, en Algérie d’abord, en France ensuite, qui est au cœur du processus de transformation des conditions et des positions des émigrés ».
2.5 La Guerre d’Algérie
La Guerre va engendrer un des plus grands bouleversements qu’ait connu la société rurale algérienne : la moitié de sa population, 2 200 000 personnes, soit le quart de la population totale du pays est « déplacée » et regroupée. A cela s’ajoute l’exode vers les villes. C’est « un des déplacements de population des plus brutaux qu’ait connu l’histoire29 ». B. STORA compte à cette époque près d’un million d’hommes d’âge actif sans emploi. On dénombrait au recensement de 1954 environ 212 000 Algériens en Métropole, soit un-vingtième de la population algérienne, un homme sur sept. On en dénombrera 350 000 en 1962. Le ministère de l’intérieur, quant à lui, donne le chiffre de 456 000. L’immigration algérienne a environ doublé durant la Guerre. B. STORA propose deux éléments pour comprendre le paradoxe dans le fait que les Algériens émigrent vers le pays qui leur fait la guerre. Il faut remplacer les hommes du contingent français envoyés en Algérie et il faut accompagner le renouvellement de la structure sociale interne française (période de forte croissance et de développement économique). Mais c’est aussi le début des premiers regroupements familiaux, pour les kabyles notamment. A. SAYAD nous éclaire à ce propos :
« Alors que les conditions souterraines de cette immigration étaient largement réunies, il fallait le prétexte de la guerre (la Guerre d’Algérie) pour venir à bout des dernières réticences morales, d’ordre culturel, dirait-on, qui s’opposaient encore à l’immigration des femmes et des familles. L’émigration des hommes, qui est incontestablement une épreuve, est vécue, depuis le temps qu’elle s’accumule, comme une nécessité, et acceptée voire recherchée à la manière d’une « douce violence ». Mais comment est justifiée l’émigration des femmes ? La guerre va lui fournir la justification ultime : elle servira d’argument pour absoudre les « fautes » dont on a conscience de se rendre coupable à l’égard du groupe, de la morale traditionnelle. De manière plus accélérée et
29 GILLETTE A. et SAYAD A. (1984).
17
plus brutale, la guerre d’Algérie aura, toutes proportions gardées, le même effet sur l’émigration des familles que la première Guerre Mondiale sur l’émigration des travailleurs30.»
D’autre part l’émigration joua un rôle important dans la prise de conscience et la diffusion des idées nationalistes algériennes. Le 18 mars 1962, La signature des accords d’Evian entérine l’indépendance de l’Algérie. Ils définissent, entre autres, les droits et devoirs des ressortissants des deux pays. Quatorze articles sont consacrés aux droits des Français en Algérie, deux seulement aux Algériens en France. D’après ces articles, les algériens détiennent les mêmes droits que les Français, à l’exception des droits politiques et de certains droits syndicaux et associatifs. Point important, ils ont la liberté de circulation entre les deux pays. L’O.N.A.M.O. (Office National de la Main-d’œuvre) est créé pour veiller aux intérêts des émigrés, et rappeler les cadres nécessaires au pays. Mais les choses ne se passent pas comme prévues puisque les pieds-noirs quitteront massivement le pays. Et chose moins prévue encore, de nombreux algériens quitteront de façon concomitante le pays. C’est ainsi que nous assistons à une reprise de l’émigration en 1962. On enregistre entre le 1er septembre et le 11 novembre 91 744 entrées d’Algériens dans l’Hexagone. Ce phénomène remet en cause le « mythe du retour » cher aux nationalistes algériens pour qui l’accession à l’indépendance allait faire cesser les départs et entraîner le retour d’Algériens pour construire le pays.
2.6 Depuis l’indépendance
L’émigration, non seulement poursuit son cours, mais de 1962 à 1973, la population algérienne en France est multipliée par deux et demi.
Tableau 2 : Evolution de la population immigrée d’origine algérienne en France
1946 22 114 1954 212 000 1962 350 000
456 000 (Ministère de l’intérieur) 1965 450 000 1968 471 000 1975 710 690 1980 780 000 1990 1999 594 208
Le 9 janvier 1964, devant les nouvelles vagues migratoires, les gouvernements algérien et français prennent des mesures pour contrôler les « flux » et mettent en place un contingentement. Le volume des départs est déterminé unilatéralement par la France. La
30 SAYAD. A. (1995), avec la collaboration de Eliane DUPUIS, Un Nanterre algérien, terre de bidonvilles, Paris, Autrement, coll. « Français d’ailleurs, peuple d’ici », HS N°85, avril 1995, p. 109.
18
moyenne prévisionnelle établie à 12 000 par an sera en fait de 20 000 jusqu’en 1968. Au printemps 1965, il y a plus de 450 000 algériens en France. L’état algérien reconnaît qu’il existe un lien entre l’émigration et le niveau de développement économique du pays. Il n’est pas question d’arrêter l’émigration. Il considère le marché du travail en France comme une soupape de sécurité. L’annexe de la charte d’Alger du FLN adoptée en 1964 spécifie que « le marché du travail français fournira un débouché traditionnel pour la main d’œuvre non employée en Algérie31 ». Le 27 décembre 1968, les gouvernements français et algériens signent un accord portant le contingent annuel des travailleurs algériens, candidats à un emploi en France, à 35 000 pour une période de trois ans. Il limite en principe la liberté de circulation en instaurant un contrôle aux frontières plus sélectif et plus strict prévue par les accords d’Evian. L’Algérie a le choix des candidats à l’émigration. L’O.N.A.M.O délivre une carte de travailleur émigré, validée par une mission médicale française en Algérie. La France leur délivre un « certificat de résidence », notion et titre spécifique à la communauté algérienne. Il en existe quatre types :
- Certificat de 10 ans pour les Algériens présents en France avant le 1er janvier 1964 ; - Certificat de 5 ans pour une entrée après cette date ; - Certificat d’un an pour étudiant et stagiaire ; - Certificat de deux ans pour fonctionnaires et agents d’organismes algériens.
En résumé, les Algériens bénéficient, grâce à cette convention, d’une législation en matière d’entrée et de séjour en France plus favorable que celle définie par l’ordonnance du 2 novembre 1945 qui est le texte de référence en matière de police des étrangers La population algérienne en France compte, en 1968, 471 020 personnes. En 1971, le gouvernement Chaban-Delmas réduit le contingent annuel à 25 000. Cette mesure marque certes une préoccupation nouvelle par rapport à la croissance des communautés immigrées en France mais surtout traduit l’utilisation comme moyen de pression dans le dialogue franco-algérien depuis qu’Alger procède à des nationalisations afin de contrôler ses activités pétrolières notamment.
2.7 Premier arrêt officiel des migrations algériennes
Le 19 septembre 1973, le gouvernement algérien décide de la suspension unilatérale de l’émigration en France après qu’une série d’incidents et de meurtres viennent pointer la montée du racisme en France. C’est la fin « officielle » de l’émigration de travail. Cette mesure traduit aussi une analyse économique et politique de la situation interne des effets à long terme de l’émigration : baisse de la rentabilité financière des transferts monétaires des émigrés, coût social et culturel croissant – les transferts matériels ou symboliques risquent de perturber l’homogénéité culturelle et sociale de la société (prônée par les dirigeants algériens). L’Etat algérien comptait également par ce moyen palier au manque de main d’œuvre dans la campagne algérienne en mettant fin à la relation entre paysannerie prolétarisée et émigration. Le transfert ne se fera pas et l’Algérie verra son agriculture et le niveau de son autosuffisance chuter inexorablement. Sous le Septennat de Valéry Giscard D’Estaing, le 5 juillet 1974, c’est au tour de la France de mettre un terme à l’immigration devant la crise consécutive au premier choc pétrolier de 1973 et à la montée du chômage.
31 Citée dans : STORA B., (2004), Histoire de l’Algérie depuis l’indépendance, t1. 1962-1988, Paris, La découverte, coll. « Repères », (1ère édition 2001).
19
2.7.1 Le regroupement familial Les premiers signes de ce qu’on appelle le regroupement familial étaient apparus en 1938, mais ne repris qu’à partir de 1949. En 1954, on comptait quelques 6000 familles dont environ 15 000 enfants. Ces regroupements étaient issus de populations de régions où les structures familiales étaient le plus déstructurées et non pas des régions pionnières en matière de migration comme la Kabylie. Comme nous l’avons précédemment remarqué, la Guerre d’Algérie fut un véritable déclic pour l’émigration familiale. En huit années de guerre, la population algérienne en France a doublé. Le regroupement familial fait également suite à l’allongement de la durée des séjours. En 1968, 30% des émigrés Algériens comptaient entre 8 et 17 ans de présence sur le territoire français. Les séjours s’allongeant, les retours ne se faisant de plus en plus que pour les congés, c’est le début de la fin des « norias ». La population algérienne s’enracine en France de façon durable tout en conservant des liens avec sa société d’origine. On compte 710 690 algériens en France en 1975. Le volume atteint suffit à constituer la population algérienne en France en une microsociété autonome. Sa natalité dépasse les 25 000 naissances par an. En 1976, l’immigration familiale est rétablie au titre du regroupement familial. C’est l’arrivée des femmes et des enfants de ceux qui avaient jusque là pour beaucoup résisté et évité de s’inscrire de façon totale dans l’émigration. En 1976, 5 832 personnes entrent en France au titre du regroupement familial. Elles sont 6 365 en 1977, 7 902 en 1982, 9 094 en 1982.
2.7.2 Le troisième âge de l’émigration algérienne C’est sans doute avec un brin de provocation qu’A. SAYAD qualifie le troisième « âge » d’émigration de « colonie » algérienne en France. Durant cette phase, il note une « quasi-professionnalisation » de l’état d’émigré, une généralisation du phénomène à toute l’Algérie, à toute la population, paysans et non paysans, jeunes et moins jeunes, aux familles et aux enfants grâce au regroupement familial, une tendance de l’émigration à se constituer en une structure permanente. A. SAYAD parle d’une tradition d’émigration qui, par un réseau de liens de solidarité établi par les anciens émigrés permet l’installation des nouveaux. C’est en quelque sorte, un nouveau groupe, une nouvelle société, un « petit pays » qui s’est constitué en France avec ses structures et ses contrôles mais aussi en apportant aide et assistance. Il conditionne le rapport de l’émigré avec le pays d’ « accueil » mais aussi il vient lui rappeler les liens qui le rattachent au « grand pays ». « S’il assure la permanence de l’émigré, il entretient le sentiment du provisoire ». Il s’agit pour A.SAYAD d’une contradiction temporelle. La perpétuation des liens de l’émigré avec son groupe l’amène à se comporter comme si l’émigration était provisoire alors qu’il se sent objectivement engagé dans une entreprise durable. Ce « provisoire durable », ballottement entre deux temps et deux pays, ambiguïté des relations entre les deux pays, engendre l’« illusion collective » d’une émigration provisoire et contribue à la formation par l’ensemble de cette population émigrée d’une « petite société » plus ou moins autonome. D’une émigration de travail essentiellement masculine durant la première phase, nous sommes passer à une émigration de peuplement. Il ne faut pas considérer les trois âges définis par A. SAYAD comme étant de strictes périodes datées mais, plutôt comme on pourrait le faire pour les générations, bien comme des âges pouvant se chevaucher. Le troisième âge que l’on peut faire commencer avec la guerre d’indépendance en Algérie, période d’accélération des changements de la société algérienne, a connu aussi le départ d’émigré de la première phase. De même ce troisième âge ne s’est pas arrêté avec la rédaction de cet article en 1977.
20
D’autres éléments sont intervenus depuis. L’Algérie a décidé l’arrêt de l’émigration en septembre 1973 et la France l’arrêt de l’immigration en juillet 1974. « Les transformations morphologiques que connaît la communauté témoignent de sa tendance à compenser les déséquilibres structurels (…) qui résultaient des conditions initiales de sa formation… ». Conséquences de ces transformations morphologiques, la communauté des émigrés s’est dotée d’un véritable marché matrimonial qui atteste bien la relative autonomie qu’elle acquiert par rapport à la société française. Rappelons encore que cet article a été rédigé en 1977.
2.7.3 Au cœur des contradictions La constitution d’une communauté algérienne est consécutive du regroupement familial mais maintenant les liens de solidarité ne se constituent plus comme en Algérie ou en Kabylie sur le mode ancien de la proximité géographique et familiale mais en fonction d’une communauté de conditions d’existence. La rupture de l’émigré et de sa famille réunie avec la communauté d’origine se double d’une rupture avec le mode de société qu’il a porté avec lui. L’émigré se retrouve au cœur de contradictions. Dans l’article « Les enfants illégitimes32 » écrit en 1979, A. SAYAD explique comment les enfants nés en France ou arrivés en très bas âge telle Zahoua ne se reconnaissent pas dans le pays d’émigration de ses parents. Quand Zahoua « retourne » au pays, il y a méprise sur sa personne (elle est perçue au bled comme une fille facile) et elle est méprisée. La nouvelle génération consomme la part de l’impossible réconciliation avec la terre d’émigration. En France, elle n’est pas mieux perçue par la communauté des immigrés car ses dispositions acquises au quotidien, tant par la fréquentation de l’école et plus tard de l’université, la rendent distante en tout point de ses proches.
« Les conflits qui sont saisis, d’abord au sein de la famille, se retrouvent en réalité partout et à tous les niveaux, depuis l’aire familiale, unité la plus petite, jusqu’à l’ensemble plus vaste, l’espace politique : ils sont, en effet, ceux-là mêmes qui divisent aussi, l’une contre l’autre, et chacune contre elle-même, la communauté des émigrés algériens en France et la société algérienne ».
L’émigration contraint à une sorte de dédoublement sociologique. A la manière des colonisés, les émigrés portent en eux le produit de leur histoire, un système double et contradictoire.
« A travers l’émigration qui la prolonge, c’est d’une certaine manière la colonisation qui survit ».
Pour A. SAYAD, le thème du « retournement », que l’on pouvait croire caduc avec la fin de la colonisation, est au contraire présent partout. Il tend aujourd’hui à diviser les Algériens en émigrés algériens et Algériens non-émigrés renvoyant à l’autre son « retournement ». L’émigration, comme la colonisation, est le lieu et l’occasion les plus favorables au rapport de force, la relation inégale entre d’une part, une société, une économie, une culture dominante, et d’autre part, une société, une économie, une culture dominée.
2.7.4 Apparition de l’immigration clandestine En 1979, viennent à échéance 400 000 certificats de résidence délivrés pour 10 ans en 1969 ainsi que 130 000 pour une durée de cinq ans. Paris diffère l’échéance dans la perspective d’une négociation globale en vue de réduire le nombre d’étrangers en France. En septembre 1980, M. Stoleru signe à Alger un échange de lettres :
32 SAYAD A. (1979), « Les enfants illégitimes », Actes de la recherche en sciences sociales, 1ère partie, n°25, pp. 61-81 ; 2ème partie, n°26-27, pp. 117-134. Cet article a également paru in SAYAD A. (1991), L’immigration ou les paradoxes de l’altérité, Bruxelles, éd. De Boeck Université, 331p.
21
- Les ressortissants algériens établis en France avant le 1er juillet 1962 reçoivent un certificat de résidence d’une durée valable de 10 ans ;
- Les autres, des titres valables pour une durée de trois ans et trois mois ; - Tous pourront bénéficier d’une aide au retour ;
On compte alors 780 000 Algériens en France dont 520 000 titulaires d’un certificat de résidence, 240 000 enfants et 20 000 étudiants en séjour temporaire. Il était prévu d’examiner avant le 31 décembre 1983 les résultats constatés par un comité mixte. En 1981, c’est l’arrivée de François Mitterrand au pouvoir. Le Gouvernement Mauroy régularise 14 600 travailleurs algériens en situation irrégulière (sur 110 000 au profit d’autres nationalités) ; réformes législatives, fin des expulsions, changement de cap dans les relations franco-algériennes. En 1982, face à l’afflux de clandestins de divers pays, les contrôles sont renforcés aux frontières : 17 000 sont refoulés en quelques mois. En décembre, suite à visite de A. Benjedid, un nouveau dispositif est négocié. Tout en allégeant le contrôle, il permet de dissuader les voyageurs susceptibles de prolonger leur séjour en France au-delà de trois mois. On dénombre cette année-là 795 920 algériens en France. Le 31 août 1983 : Echanges de lettres avec les trois pays du Maghreb afin d’améliorer le contrôle de la circulation des personnes. Les ressortissants de ces trois pays, venant en France pour moins de trois mois, doivent se munir désormais d’un passeport, d’une attestation d’accueil par leur hôte en France authentifiée et d’un « diptyque » : une carte de débarquement à deux volets, dûment rempli avant leur départ, permettant aux autorités françaises de contrôler la régularité du séjour. L’échange de lettres de 1980 expirait au 31 décembre 1983. En l’absence de renégociations de la part de l’Algérie, le statut des Algériens en France est redevenu celui des accords de 1968 bien que certaines clauses soient périmées. En 1985, le visa est imposé en Algérie mais son obtention n’est pas trop difficile. Simple visa dirons-nous. On compte 820 900 algériens en France en 1988. L’arrivée de l’islamisme en 1991-92 engendre une peur. On amalgame vite « risque terroriste » et « risque migratoire ». La question implicite de l’époque est : Comment arrêter l’immigration ? En 1993, les Lois Pasqua I et II ont pour conséquences un contrôle renforcé de l’attribution des visas et de faire baisser le nombre d’entrées au titre du regroupement familial à moins de 3 000 par an. Les mesures d’assouplissement de la « loi Chevènement » entraînent une remontée du nombre d’entrées au titre du regroupement familial. En 1998, on comptait 4 962 entrées de ce type. Ce nombre était de 5 674 en 200433. Enfin notons l’importance de l’âge des enfants dans le processus du regroupement familial. Seuls les enfants de moins de 18 ans peuvent prétendre à l’entrée au titre du regroupement familial. Mais émigrer en bas âge où émigrer juste avant d’atteindre l’âge de la majorité n’a pas les même conséquences. Ceux qui arrivent à l’adolescence, ayant connu bien souvent
33 Tous ces chiffres sont disponibles dans le rapport annuel OMISTATS de l’A.N.A.E.M. (Agence Nationale de l’Accueil des Etrangers et des Migrations), organisme public né de la fusion de l’OMI (Office des migrations internationales) et du SSAE (Service social d’aide aux émigrants).
22
qu’une scolarité en arabe, ont beaucoup de difficulté pour poursuivre leur cursus et connaissent généralement l’échec scolaire. Pour ceux qui ont plus de 18 ans et qui ne peuvent prétendre à l’entrée sur le territoire français à ce titre doivent s’adapter. Nous constatons maintenant tout l’intérêt d’avoir suivi une scolarité en Français jusqu’au bac, français de plus. Il s’agit là d’une adaptation, de la mise en conformité en quelque sorte, afin de pouvoir prétendre au départ. La poursuite des études supérieures rentre également dans cette stratégie d’adaptation du « vaut mieux tard que jamais ».
2.8 L’invention de l’émigré étudiant
L’émigration ne s’arrête pas pour autant. L’émigration de travail continue certes en faible nombre et très souvent de façon clandestine. L’immigration au titre du regroupement familial connaît un flux somme toute régulier. Apparaît dans les années 1980 des émigrés d’un nouveau type : c’est l’invention de l’émigré étudiant. Rappelons que sous la domination coloniale l’enseignement supérieur était très discriminatoire. On comptait, en 1910, 1 290 inscrits européens contre 10 inscrits musulmans34 et en 1938, 2 250 inscrits européens contre 94 inscrits musulmans dont 6 filles35. La situation évolua pendant la guerre d’Algérie. En 1954-55, le nombre d’inscrits musulmans à l’Université d’Alger était de 589. Ils étaient de 1 317 en 1960-61. Ce n’est qu’après l’indépendance que le nombre d’étudiants algériens va sensiblement augmenter. Il passa de 2 725 en 1962-63 à 5 636 en 1964-65. Le tableau suivant, constitué à partir des données de l’article de A. LABDELAOUI36, nous montre la constante progression du nombre d’étudiants en Algérie. Tableau 3 : Evolution des effectifs de l’université algérienne 1970 – 1980 : Année Nombre d’étudiants en Algérie Nombre de Boursiers à l’étranger 1964-65 5 636 1 101 1970-71 19 734 N.C. 1974-75 39 139 1 768 1980-81 71 293 2 225 1984-85 111 920 5 392 1990-91 212 413 2 399 1994-95 248 092 1 983 2002-2003 589 993 37
La venue d’étudiants algériens en France n’est pas tant, dans un premier temps, le fait de démarches individuelles que le résultat des liens entretenus entre l’ancienne puissance coloniale et le nouvel Etat algérien. L’envoi d’étudiants à l’étranger renvoie au discours de la volonté de modernisation de l’Algérie indépendante et au développement de sa politique 34 Rappelons la distinction qui était faite entre Français et Musulmans. Voir précédemment note 3. 35 KADRI A. (2000), « La construction historique de système d’enseignement supérieur en Algérie (1850-1995) » in GEISSER V. (dir.), Diplômés maghrébins d’ici et d’ailleurs, trajectoires sociales et itinéraires migratoires, CNRS éditions, Paris, pp. 35-55. 36 LABDELAOUI H., « La migration des étudiants algériens vers l’étranger : les effets pervers d’une gestion étatique », in Les Cahiers du SOLIIS : Notes et Travaux Sociologiques, n°2-3, 1996-97, pp. 107-124. 37 Ce dernier chiffre vient du site web du Ministère de l’Enseignement Supérieur du Gouvernement algérien : www.mers.dz
23
nationaliste : industries industrialisantes, formation des cadres et des professeurs d’universités alors majoritairement étrangers de façon à garantir son autonomie, … De nombreux facteurs influencent la migration estudiantine et sont variables selon les époques : politiques nationales en matière d’enseignement et d’attribution de bourses, la politique étrangère de la France, politique de coopération, évolution des conditions juridiques, etc.
2.8.1 L’étudiant émigré boursier : la politique algérienne Au lendemain de l’indépendance, la formation des étudiants algériens est largement définie par les accords de coopération culturelle et technique. L’envoi d’étudiant en France vise à former au plus vite des cadres nationaux capables de prendre en main les différents secteurs administratifs et économiques du pays. L’enseignement supérieur en Algérie reste très proche de l’organisation française et, élément important, le français38 est, dans un premier temps, utilisé majoritairement. L’offre de formation n’est toutefois pas d’une grande diversité. Le nombre de bourses accordées par la France passe de 590 en 1963 à 1 200 en 1967, mais il est difficile de définir avec précision la politique ayant présidée à l’attribution de ces bourses39. Du côté algérien, la politique de formation ne s’est institutionnalisée véritablement qu’à partir du début des années 198040. L’octroi des bourses s’est fait dans un premier temps de manière anarchique et clientéliste. La bourse n’est pas tant attribuée au mérite qu’en priorité à certains, aux fils de chahid41 par exemple. L’orientation de l’offre de formation est menée, jusqu’au début des années 1970, par le Ministère de l’Industrie et les grandes entreprises d’Etats et contribue à l’auto-reproduction des cadres. Cette prééminence sera remise en cause en 1981 par l’unification de la formation à l’étranger par la Commission Nationale de la Formation à l’Etranger (CNFE). Le nombre d’étudiants boursiers des 1er et 2ème cycles va diminuer progressivement au profit de celui des 3ème cycles et des étudiants en « sciences molles ». Alors qu’en 1982, ce sont les pays « socialistes » qui prennent en charge le plus d’étudiants algériens, à partir de 1987-88, c’est la France qui en accueille le plus. Cette redéfinition du niveau et de l’orientation des étudiants boursiers traduit le passage d’une stratégie de l’entreprise (d’Etat) à une stratégie unifiée, centralisée et ambitieuse fondée sur l’université42. A partir de septembre 1983-84, tous les moyens financiers vont être généreusement accordés à cette nouvelle élite ; en plus d’une bourse conséquente, les étudiants bénéficiaient de :
- Un voyage annuel (aller-retour) ; - Des indemnités d’installation ; - Des avantages liés à la situation familiale ;
38 La politique d’arabisation de l’enseignement ne fut pas appliquée de suite après l’indépendance. Elle s’est faite par vagues successives. Ce qui ne sera pas sans poser de problème. Des personnes, par exemple, qui ont fait toute leur scolarité en Français se sont retrouvées à l’université, selon la filière, devant des enseignants arabophones. Plus tard, d’autres personnes ayant suivi une scolarité essentiellement en Arabe se retrouvèrent devant un enseignement en Français, langue conservée dans certaines filières. Aujourd’hui, une dichotomie linguistique existe aux plus hauts niveaux de l’Etat : certains ministères utilisent la langue arabe, d’autres la langue française. Il existe en outre une tension entre une élite francophone et une élite arabophone. 39 SIMON V. (2000), « La migration des étudiants maghrébins en France, une approche historique (1962-1994) », in GEISSER V. (dir.), Diplômés maghrébins d’ici et d’ailleurs, trajectoires sociales et itinéraires migratoires, CNRS éditions, Paris, pp. 245-259. 40 KADRI A. (2000), « La formation à l’étranger des étudiants algériens : les limites d’une politique rentière (1962) » in GEISSER V. (dir.), Diplômés maghrébins d’ici et d’ailleurs, trajectoires sociales et itinéraires migratoires, CNRS éditions, Paris, pp. 209-219 41 Chahid, au pluriel chouhada : martyr, sous-entendu de la révolution. Celui qui est mort en combattant lors de la guerre de libération. 42 KADRI A. (2000), Op.Cit.
24
- Etc.… Mais c’est aussi le modèle de retour des boursiers qui est ici intéressant. L’étudiant boursier de l’Etat algérien a généralement fait ses études en France. Il rentrait avec un diplôme. On lui trouvait un poste. Bien souvent cet étudiant travaillait, grâce à une loi de 1968 qui donne droit aux étudiants étrangers de travailler jusqu’à 60 heures par mois. Le boursier revenait avec des économies et il avait en plus un droit (exemption de taxe douanière jusqu’à 200 000 F) au déménagement ; ce qui lui permettait de revenir avec un capital conséquent et ainsi de prétendre au mariage. Une fois l’opération réalisée, il disparaissait de la circulation. L’opération est d’autant plus intéressante qu’il revenait bien souvent mieux doté que ceux qui ont passé leur vie à travailler en France. A une époque où l’Algérie connaissait la pénurie, ces retours d’étudiants, bien que, et peut-être parce que faibles en nombre – le faible nombre étant lié à l’idée de rareté - ont produit une image forte qui a certainement contribué à la perpétuation de l’idée et de l’envie de réussite par l’émigration. Les chiffres d’inscrits sont en hausse à partir de cette période. C’est en 1985-86 que culmine les boursiers algériens à l’étranger au nombre de 5 990.
2.8.2 Le non-retour des boursiers et réaction algérienne Mais une réorientation de la politique de formation en 1987-88 va faire chuter brutalement le nombre de boursiers. Elle vient à la suite d’un constat : les retours d’étudiants sont très peu nombreux. La formation à l’étranger participe ainsi à l’exode des cerveaux. On n’avait constaté en 1985-86 que 160 retours. A. KADRI fait remarquer de plus que la rentrée au pays est souvent un échec pour beaucoup d’étudiants ; sous-employés, mal-utilisés, mal rémunérés, non-logés, ils font alors souvent le chemin inverse. Tableau 4 : Le retour des étudiants boursiers dans le pays d’origine43 Année universitaire Nombre de boursiers à l’étranger Retours effectifs 1974-75 1778 200 1980-81 2406 61 1984-85 5392 200 On note cependant une reprise des effectifs d’étudiants boursiers à partir de 1990 due essentiellement au retour des bourses de coopération, de la part de la France particulièrement. Elles concerneront des formations soit de courte durée, soit « à distance » essentiellement destinées aux enseignants. A. KADRI considère que cela ne faisait que déplacer le problème : « la formation à l’étranger devient de plus en plus une gestion de la pénurie des devises. » Elle ne concerne ainsi que ceux qui sont dans le cercle restreint de l’administration. Les jeunes diplômés sont de plus en plus exclus de ce type de formation. A. KADRI conclue en constatant que la formation à l’étranger ne fait que redoubler les hiérarchisations en place entre ceux qui ont été formés à l’étranger et ceux formés localement. On s’aperçoit que, dans une perspective pensée ou non avant le départ, le profit de la réussite scolaire n’est pas tant le diplôme mais plutôt de décrocher une bourse pour l’étranger. En résumé, les études deviennent un mode d’entrée en France et les retours même faibles en nombre contribuent au renouvellement de ce mode migratoire. En 1985, l’accord franco-algérien de 1968 a fait l’objet d’un important avenant réduisant à un an la durée des certificats de résidence délivrés aux nouveaux entrants.
43 Il faut lire ce tableau de façon transversale. Les sorties et les entrées sont décalées de plusieurs années. Il faut, à mon avis, surtout retenir ici que les retours étaient faibles tout comptes faits des départs.
25
2.8.3 Massification de la population estudiantine et réaction française Mais les étudiants boursiers ne sont pas les seuls. En Algérie comme dans les autres pays du Maghreb, la forte croissance démographique conjuguée aux efforts fournis par l’Etat en matière de scolarisation et la forte demande sociale d’enseignement ont entraîné un accroissement des effectifs à tous les niveaux. Dans les années 1970, l’émigration étudiante déborde déjà largement le cadre de la coopération. Le régime du séjour des étudiants étrangers en France obéit à un mécanisme simple : une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » peut-être délivrée à l’étranger qui établit qu’il suit en France un enseignement ou qu’il suit des études et qui justifie qu’il dispose de moyens d’existence suffisants. L’augmentation des étudiants étrangers en France et notamment ceux en provenance des anciennes colonies coïncide avec la massification des étudiants français. Ces étudiants du « tiers-monde » sont jugés de plus en plus suspects aux yeux des autorités françaises. Ils mettraient même en péril non seulement la qualité de l’enseignement à cause de leur niveau insuffisant mais aussi la renommée de l’Université française44. Autant l’étudiant étranger bénéficiait d’une image positive dans les années 1970 dans la mesure où il représentait la future élite dirigeante, autant il devient suspect dans les années 1980 quand on s’interroge sur ses réelles motivations. C’est l’apparition progressive de l’image du « faux étudiant ». C’est la mise en place progressive de cadres juridiques afin de contrôler l’accueil et le séjour des étudiants étrangers en les soumettant à des procédures d’inscriptions particulières. Ainsi, la circulaire Bonnet du 12 décembre 1977 et le décret Imbert du 31 décembre 1979 soumettent les étudiant étrangers à la pré-inscription universitaires et instaurent un test linguistique afin de vérifier la connaissance de la langue française. L’arrivée des socialistes au pouvoir va rétablir une présentation officielle positive de l’étudiant étranger mais des mesures restrictives demeurent afin de veiller à ce que cette immigration ne devienne pas un moyen de contourner l’interdiction visant l’immigration de travail. La circulaire de Pierre Joxe du 17 novembre 1984 rétablit ainsi la nécessité de justifier de la réalité des études et en confie le rôle à la préfecture de police. En 1991, la circulaire Marchand recommande aux préfets de subordonner le renouvellement de la carte de séjour étudiant à la présentation de documents attestant l’inscription aux examens et mentionnant les résultats obtenus45. De 1985 à 1991, c’est une véritable « culture préfectorale » implicite qui s’instaure. Le séjour estudiantin a fait son expérience. Les non-boursiers, parce qu’ils travaillent à côté pour financer leur études46 et à causes de leurs résultats universitaires, donnent une représentation d’étudiants qui ne « travaillent » pas et sont par conséquent inscrits moins facilement. De 1985 à 1997, on enregistre une tendance générale à la limitation de l’accueil des étudiants maghrébins en France. Les étudiants maghrébins font l’objet d’une sélection de plus en plus importante en premier cycle. Les conditions d’admission sont aussi plus restrictives : modalités de retrait des dossiers d’admission, critères administratifs et pédagogiques de recevabilité ; le test linguistique de français devient obligatoire pour tous les candidats sauf pour les détenteurs du Diplôme d’Aptitude à la Langue Française. C’est une sélection de plus pour les pays comme l’Algérie où l’enseignement a été arabisé. C’est ainsi, comme le dit V.
44 SIMON V. (2000), 45 BORGOGNO V., SIMON V., STREIFF-FENART J. et VOLLENWEIDER-ANDRESSEN L. (1995), « Les étudiants étrangers en France: Trajectoires et devenir », Rapport de recherche pour la DP, Convention d’étude du 30 juin 1995, SOLIIS-Université de Nice. Premier volet de ce travail in Migrations études, Revue de Synthèse de travaux sur l’immigration et la présence étrangère en France, DPM/ADRI, n° 67, juillet-août 1996. 46 L’effort financier auquel peut contribuer la famille en Algérie est sans commune mesure avec le coût des études.
26
SIMON, que la nationalité du diplôme prime sur la nationalité du candidat47, les consulats donnant le plus souvent priorité aux candidats titulaires d’un bac français. Malgré ces limitations, la demande de candidats sollicitant une inscription en France demeure importante. La demande de scolarisation dans les établissements français demeure forte en Algérie jusqu’en 1988, date à laquelle les autorités algériennes interdisent aux Algériens et aux bi-nationaux l’accès aux établissements français. S’en suivra un développement d’établissements scolaires privés dont des lycées délivrant le baccalauréat français.
2.9 La décennie noire : 1992-2002
Une étude48 sur les étudiants étrangers en France a été menée en 1996-97 par V. BORGOGNO et L. VOLLENWEIDER-ANDRESSEN pour la Direction de la Population et des Migrations (DPM). La première partie nous montre qu’elle consista tout d’abord à réexaminer les statistiques officielles qui ne distinguaient pas les étudiants étrangers venus en France pour études de ceux issus de la population immigrée en France. Notons ainsi que les « véritables » étudiants étrangers représentent en 1993-94 69% des étudiants officiellement répertoriés comme étrangers alors qu’ils étaient de 82% en 1984-85, année universitaire où la proportion des étudiants étrangers dans l’ensemble de la population estudiantine culminait à 14,1%. Nous constatons donc une progression des étudiants étrangers dont les parents résident en France et un déclin du nombre d’étudiants étrangers réellement expatriés. C’est toute l’importance des termes que l’on utilise. Un étudiant peut très bien avoir une nationalité étrangère mais être résident non-permanent du pays d’accueil, ou issu d’une famille étrangère qui réside dans le pays d’accueil. Nous privilégierons, dans la mesure du possible, la notion d’étudiant étranger de « nationalité étrangère », de parents de nationalité étrangère et résidant à l’étranger, nés et ayant effectué leur scolarité à l’étranger49. On note également une forte variation de ces chiffres en fonction de l’origine géographique. On enregistre une forte croissance de la migration estudiantine européenne (+56%) et une baisse importante des étudiants originaire d’autres continents (Asie – 43%, Afrique – 37% dont Maghreb – 41%). Si nous détaillons ce dernier élément, nous notons une régression importante du nombre des étudiants expatriés marocains (-42%) et tunisiens (-40%) mais une forte progression des étudiants algériens (+70%). Mais nous verrons plus loin que ce chiffre est trompeur. Les auteurs de cet article nous disent que les changements dans les origines des étudiants étrangers expatriés sont essentiellement imputables au recul des flux d’étudiants titulaires d’un Baccalauréat français, ce qui se traduit par une désaffection des universités de l’hexagone. Ils semblent avoir oublié de mettre en parallèle toutes les mesures législatives dissuasives prises depuis 1985 en matière d’admission d’étudiants étrangers mais aussi les mesures plus informelles qui sont souvent « cachées ».
47 SIMON V. (2000), Op. Cit. 48 BORGOGNO V., SIMON V., STREIFF-FENART J. et VOLLENWEIDER-ANDRESSEN L. (1995), « Les étudiants étrangers en France: Trajectoires et devenir », Rapport de recherche pour la DPM, Convention d’étude du 30 juin 1995, SOLIIS-Université de Nice. Second volet de ce travail in Migrations études, Synthèse des travaux sur l’immigration et la présence étrangère en France, DPM/ADRI, n°79, janvier-février-mars 1998. Extraits in Les Cahiers du SOLIIS : « Les étudiants », Notes et Travaux Sociologiques, n°2-3, 1996/1997. 49 L’UNESCO adopte la même position en mettant l’accent sur la mobilité géographique transnationale de l’individu : « un étudiant étranger est une personne inscrite dans un établissement supérieur d’un pays ou d’un territoire où elle n’a pas sa résidence permanente ». COULON A., PAIVANDI S. (2003), « Les étudiants en France : l’état des savoirs », Rapport pour l’Observatoire de la vie étudiante, Université Paris 8, Centre de Recherche sur l’Enseignement Supérieur, mars.
27
Du côté de la France, l’objectif zéro de l’immigration algérienne A. REA attire notre attention sur les discours sécuritaires des politiques migratoires qui mettent en œuvre dans un même temps des dispositifs de surveillance renforcés et d’expulsion et des pratiques de tolérance arbitraires et des campagnes de régularisation. Arbitraire qui répond aux exigences économiques de certains secteurs d’activité. « L’immigration zéro n’est pas une réalité, juste un discours politique visant à légitimer la présence de nouveaux étrangers en Europe50». En 1998, un article de S. SLAMA51 dénonce la chute vertigineuse du nombre d’étudiants algériens en France à l’heure où l’on pourrait s’attendre à ce que la France assume son devoir de pays d’accueil. En 1995-96, 19 178 étudiants algériens sont inscrits dans les universités françaises, chiffre en baisse par rapport à l’année précédente. Or, cet effectif représente presque un doublement en dix ans. Il n’était que de 10 961 en 1984-85. Mais pour S. SLAMA, qui reprend la critique émise dans l’étude précédemment citée, ce chiffre est trompeur car il comptabilise également les très nombreux algériens issus de l’immigration et ceux qui séjournent sous un autre statut que celui d’étudiant. Ces chiffres ne tiennent pas compte en effet de la croissance de la population des jeunes52 issus de l’immigration au sein des universités qui a permis de « compenser » la baisse des étudiants étrangers venus en France spécifiquement pour faire des études La source la plus intéressante est sans doute le nombre de visas délivrés à des étudiants, puisqu’elle nous informe sur le flux réel d’Algériens autorisés par les autorités françaises à venir faire des études. S. SLAMA estime que 2 231 visas étudiants auraient été délivrés en 1991-92 à des Algériens, 269 en 1992-93, 175 en 1993-94 et 22 en 1994-95, soit une chute de 99% en 4 ans. Si la politique du gouvernement algérien n’est pas négligeable (limitation des bourses aux étudiants de 3ème cycle), le facteur principal est pour lui la volonté politique des autorités françaises d’interrompre le flux d’étudiants algériens pour « risque migratoire ». Elle suit corrélativement en outre la diminution du nombre de visas attribués aux Algériens depuis le début des années 1990 : alors qu’en 1989 environ 800 000 visas étaient attribués à des Algériens, ce chiffre est de 500 000 en 1990, 290 000 en 1993, 102 000 en 1994. Suite à un attentat en 1994, tous les postes consulaires français en Algérie sont fermés. Pour palier à ces fermetures, un Bureau des Visas Algériens (BVA) est ouvert à Nantes le 6 octobre 1994. En 1996 le nombre de visas pour des Algériens aurait été de 40 000. A partir de 1994-95, il a été demandé aux universités françaises de gérer directement les demandes d’inscriptions mais les visas sont délivrés en fonction de critères fixés par le service des étrangers en France du Ministère des Affaires Etrangères et du Ministère de l’Intérieur, en sachant qu’il n’est pratiquement plus accepté de visas pour des demandes de 1er et 2ème cycles. Les universités se trouvent submergées d’appels d’Algériens acceptés dans une université mais qui ne peuvent venir en France faute de visa. Devant ce problème une « procédure dérogatoire » est mise en place pour la rentrée 1996-97, mais les critères d’admission sont tels qu’ils ne concernent que peu d’étudiants. Bien que les étudiants de 3ème cycle soient relativement épargnés puisque leurs demandes sont entièrement gérées par les universités, les responsables de formation sont de plus en plus réticents à les accueillir étant
50 REA A. (2003), « Politiques d’immigration : criminalisation ou tolérance ? », La pensée de midi, n°10, Eclats de Frontières, été 2003. 51 SLAMA S.(1998), « Les étudiants algériens en France, Objectif zéro », in Plein Droit, n° 38, avril 1998. 52 Des enfants d’Algériens immigrés entrés en France au titre du regroupement familial depuis le milieu des années 1970 et qui à cette période entrent dans l’enseignement supérieur.
28
donné l’arabisation croissante de l’enseignement universitaire algérien. Ces mesures tendent finalement à ne laisser entrer que des élites53.
2.10 Partir étudier à l’étranger : Un projet et une double raison de partir
La seconde partie54 de l’étude menée en 1996-97 par V. BORGOGNO et L. VOLLENWEIDER-ANDRESSEN est centrée sur les étudiants d’origine maghrébines. Bien que ce concept de Maghreb ne soit pas pertinent, car il risque toujours d’être trop flou ou bien connoté quant à l’origine de sa perception, nous en retiendrons quelques éléments. Cette monographie se base sur une enquête par questionnaire et des entretiens semi-directifs. Les auteurs empruntent à D. SCHNAPPER le terme de « projet » pour qualifier la migration des étudiants maghrébins. Ils font le constat que ce projet ne se réduit pas à sa seule finalité universitaire. La raison du départ est toujours double : la raison universitaire se trouve toujours associée à une raison qu’ils qualifient de « sociétale ». A travers l’aspiration qu’exprime le choix d’une université du Nord se dessine la mise à distance, voire le refus, d’un système universitaire déficient et de la société qui le produit. Les auteurs distinguent une typologie en trois type de migration exprimant chacune un manque sociétal :
- une migration estudiantine dont la dimension sociétale est à dominante économique ou professionnelle par rapport à un manque de perspectives renvoyant à l’espoir d’obtenir un capital scolaire de valeur supérieure. Ce type de migration, dans le cas de non-retour, s’apparente à ce que les anglo-saxons appellent « skilled migration », la migration de compétence, mais du point de vue du pays de départ, elle est comme nous l’avons vu plutôt qualifiée de « fuite de cerveaux » ;
- une seconde dont la dominante est culturelle. La raison culturelle est ici une expression de la « supériorité » de la société d’immigration par rapport à l’identité culturelle propre. Ce type de migration inclus « la découverte » ou « l’aventure ». Elle oppose l’ouverture à la pluralité culturelle aux limites et aux contraintes, du cadre culturel de la quotidienneté dans les sociétés d’origine. Ces étudiants rejettent néanmoins une assignation culturelle et territoriale trop stricte et aspirent à plus de mobilité spatiale, culturelle, sociétale ;
- une troisième à dominante politique ou idéologique. A partir des années 1970, le milieu étudiant est partie prenante des conflits qui ont souvent pour cadre les universités. Au moment de l’enquête, ce mouvement correspond quasi exclusivement à des étudiants en provenance d’Algérie, eu égard aux évènements qui s’y déroulent depuis 1988. Cette migration n’est pas tout à fait sans lien avec le type précédent.
Enfin, les auteurs, se référant aux travaux de D. SCHNAPPER, remarquent que cette migration étudiante n’est pas sans trait à rapprocher des migrations de travail ; le principal étant celui de projet unissant une visée spécifique et une aspiration sociétale. Les étudiants européens, quant à eux, s’inscrivent plus dans une logique de coopération universitaire. L’enquête donne quelques informations quant aux liens entre ces étudiants et les membres de la communauté préalablement établie en France. 74% des étudiants maghrébins déclarent
53 Les personnes dotées d’un capital scolaire et culturelle important, notamment de la maîtrise de la langue française. 54 BORGOGNO V., SIMON V., STREIFF-FENART J. et VOLLENWEIDER-ANDRESSEN L. (1995), « Les étudiants étrangers en France: Trajectoires et devenir », Rapport de recherche pour la DP, Convention d’étude du 30 juin 1995, SOLIIS-Université de Nice. Second volet de ce travail in Migrations études, Synthèse des travaux sur l’immigration et la présence étrangère en France, DPM/ADRI, n°79, janvier-février-mars 1998. Extraits in Les Cahiers du SOLIIS : « Les étudiants », Notes et Travaux Sociologiques, n°2-3, 1996/1997.
29
avoir de la famille en France avant leur arrivée. Et parmi ces derniers, les ¾ résident dans la même région qu’elle. A LATRECHE a montré, à propos des étudiants maghrébins, que « les populations résidentes en France sont considérées comme « socles des migrations étudiantes55 ». Elle ajoute que c’est la demande sociale de formation, ainsi que les aspirations personnelles et familiales, qui poussent des jeunes vers l’étranger même s’ils ne bénéficient pas de bourses ou d’un soutien financier institutionnel.
2.11 Le retour de l’étudiant algérien
L’Observatoire Statistique de l’Immigration et de l’Intégration (OSII) a pour mission, sous l’égide du Haut Conseil à l’Intégration (HCI), de publier un rapport annuel. L’observatoire a pour vocation de s’intéresser aux flux migratoires et d’appréhender le nombre d’étrangers sur le territoire en vue d’instruire la politique d’intégration du gouvernement. Le rapport de 2002-200356, le plus récent, nous communique les chiffres en matière de visas d’entrée des étrangers en France. Rappelons qu’il existe principalement deux types de visas :
- Les visas court séjour « visas Schengen », pour des séjours n’excédant pas 90 jours sur six mois.
- Les visas de long séjour de plus de trois mois qui permettent de solliciter un titre de séjour auprès d’une préfecture. Ils ne sont pas réglés par la convention de Schengen.
Les personnes qui veulent séjourner en France doivent en principe, recevoir un visa long séjour mais, dans la pratique, le visa uniforme Schengen peut être utilisé pour permettre à certaines catégories de ressortissants étrangers de solliciter un titre de séjour auprès d’une préfecture. C’est le cas entre autres des étudiants devant subir des épreuves d’admission avant de se voir reconnaître la qualité d’étudiant et les étrangers venant en France en vue de se marier avec un Français. Ces personnes n’apparaissent donc pas dans les statistiques des visas de long séjour mais dans celles des préfectures lors de la délivrance de leur titre de séjour. Les visas ainsi délivrés en France en 2003 se distribuait ainsi :
- Visas Schengen de transit ou de court séjour : 91%. - Visas Nationaux de long séjour : 6,6%. dont 3,43% pour étudiants. - Le reste étant composé des visas Dom-Tom et des visas Pays Tiers.
Notons également que depuis le 1er janvier 2001, la France applique le paiement des frais de dossier en début de procédure ; mesure qui selon le rapport a contribué à une diminution de la demande de près de 14% entre 2001 et 2003. Sur cette même période, la délivrance de visas Schengen a diminué de près de 5% alors que la délivrance de visas long séjour a augmenté légèrement de 2%. Parmi ces derniers le nombre de visas délivré pour études a progressé de 20% entre 2001 et 2003. Il confirme la hausse enregistrée précédemment. En 1998, on enregistrait 28 951 visas Etudes pour atteindre le nombre de 69 568 en 2003, soit une progression de 140%. Elle traduit, selon ce rapport, l’attention accordée aux étudiants depuis 1998 : obligation de motiver le refus de délivrance de visa doublée d’une offre de formation en direction des étudiants étrangers. Mais de quels étudiants parle-t-on ? Le rapport ajoute : « Elle s’accompagne d’« une sélection rationnelle » opérée par les Consulats en liaison avec les Services de coopération ». 55 Cité dans COULON A., PAIVANDI S. (2003), op. cit. 56 COSTA-LASCOUX C., LEBON A., BRAY C, Rapport 2002-2003 du Haut Conseil à L’Intégration, Observatoire des statistiques de l’immigration et de l’intégration, Groupe permanent chargé des statistiques. Il a été mis en ligne sur le site de la Documentation Française en septembre 2005.
30
Alors qu’au milieu des années 1990, les délivrances de visas pour études délivrés aux étudiants algériens ont vu leur nombre chuter jusqu’à pratiquement disparaître, elles ont connu, à partir de 1998, un rétablissement et un très forte croissance. Elles sont passées de 715 à 7 265 en 2003, soit une progression de 916% alors que le total tous postes diplomatiques confondus enregistrait sur cette même période 140% de croissance. Mais gardons bien à l’esprit la distinction entre une croissance régulière et une progression après une remise à zéro. Si nous regardons du côté du nombre de titre de séjour délivré par les préfectures, on constate une augmentation constante entre 1998 et 2002, l’année 2003 ayant connu un infléchissement. Il faut cependant distinguer les étudiants des pays tiers de ceux de l’Espace Economique Européen. Ces derniers diminuent depuis 2001 car ils ne sont plus tenus de demander un titre de séjour. Les étudiants africains restent les premiers en nombre. Plus de 60% d’entre eux sont originaires du Maghreb. Les étudiants algériens confirment leur progression en passant de 2 865 en 1998 à 5 077 en 2003, soit une évolution de 77%, et deviennent ainsi le premier flux en provenance d’Afrique.
2.12 Spécificité de l’émigration féminine
Dans un article plus récent57, V. BORGOGNO et L. VOLLENWEIDER-ANDRESSEN reviennent sur les résultats de leur précédente étude afin de dégager les spécificités de l’émigration féminine. Il apparaît que des différences assez sensibles, à la fois objectives et subjectives, séparent la composante féminine de la composante masculine au sein de la migration étudiante. En nombre tout d’abord : sans remettre en cause la prédominance de la population masculine, on note la féminisation croissante de la population étudiante issue du Maghreb aussi bien au sein de la seconde génération que ceux qui viennent de l’extérieur. D’autre part, les étudiantes maghrébines appartiennent bien plus souvent aux « classes privilégiées » que leurs homologues masculins, c’est-à-dire d’après les auteurs à des milieux sociaux plus disposés à s’affranchir de la réprobation collective à l’égard de l’émigration féminine58. L’expatriation des étudiantes, notamment lorsqu’il s’agit de « jeunes filles », même si elle est jugée souhaitable, ne va certainement pas de soi pour les familles. A l’éloignement géographique se trouve associé le risque majeur d’une perte de contrôle sur les comportements sociaux des filles, et celui d’être dans l’impossibilité de leur assurer les protections particulières dont elles sont traditionnellement l’objet dans leur milieu d’origine. Ces problèmes spécifiques posées par le départ des jeunes filles sont susceptibles de trouver une partie de leur solution dans l’intervention de membre de la famille installés en France. Les auteurs rappellent que les migrations estudiantines sont indissociablement universitaires et sociétales. Mais parmi les raisons sociétales du départ, raison économique, politique ou culturelle, invoquées par les étudiants, c’est la raison sociétale culturelle qui concerne massivement et spécifiquement les filles relevant ainsi l’attraction sociétale des sociétés du Nord et la dimension émancipatrice de leur projet de migration étudiante. Il apparaît que l’expérience qu’elle font de la société d’immigration est plus nettement affirmée que chez les garçons et qu’elle est sous-tendue par une logique de décentration communautaire et une visée d’apprentissage ; ce que les auteurs nomment « une entreprise d’appropriation de l’altérité ».
57 BORGOGNO V., VOLLENWEIDER-ANDRESSEN L. (2000), « Etudiants du Maghreb en France : Spécificités du « rameau féminin » de la migration ? », in GEISSER V. (dir.), Diplômés maghrébins d’ici et d’ailleurs, trajectoires sociales et itinéraires migratoires, CNRS éditions, Paris, pp. 285-306. 58 Les auteurs me semblent insister beaucoup sur les « particularités des sociétés d’origine quant à la place faite aux femmes ».
31
Mais cette démarcation plus nette entre étudiantes et étudiants se lit dans les conséquences quant au regard porté sur la culture de la société de départ pouvant mener à une remise en cause conflictuelle de la culture d’origine.
32
3 – Actualité du projet d’émigrer L’émigration - immigration algérienne et particulièrement kabyle dure de façon quasi-ininterrompue depuis plus d’un siècle. Au fil du temps, une population s’est progressivement constituée en France qui entretient des liens durables avec sa communauté d’origine. C’est comme s’il s’agissait d’une seule et même population mais séparée en deux parties fonctionnant en vases communicants dont un côté subirait une pression supérieure à l’autre qui ainsi entretiendraient un sens migratoire permanent. En suivant un raisonnement par étapes selon la trame des âges de la vie d’A. SAYAD, nous notons qu’à chaque « âge » de l’émigration correspond un type ou des types prépondérants d’émigrés. Nous proposons une lecture de ces types d’émigrés du point de vue des rapports de l’individu avec son groupe en relation avec leur environnement social, économique, historique et juridique. Nous avons évoqué précédemment les bouleversements socio-économiques et les mutations de la société algérienne, l’influence de la démographique (croissance démographique, croissance des flux d’émigrés,…), l’impact des politiques de l’Etat, la France d’abord, puis des deux Etats en matière d’émigration - immigration, notamment à travers leur législation. Nous constatons alors que nous sommes passés d’une émigration totalement subie, telle la ponction de population, à des formes plus « libres » de mouvements, mais toujours indexés, notamment aux mesures législatives des deux pays concernés en matière de migration. Il est indispensable d’interroger le rapport à l’Etat et aux Etats quand les deux conjuguent leurs actions en matière de migration ou quand ils sont en désaccord. L’effet se fait sentir de toute façon, de manière plus ou moins sensible engendrant, pour l’individu comme pour le groupe, le développement de stratégie d’adaptation, l’un ou l’autre Etat participant quelques fois à cette stratégie. Au fur et à mesure que les mesures se font plus restrictives, nous constatons une stratégie d’adaptation59 de l’individu et de son groupe. L’émigration devient alors projet. Toute la question est de savoir quels sont les moyens à mettre en œuvre pour pouvoir émigrer. Au commencement de l’émigration algérienne, dans sa phase initiale et initiatrice, deux éléments essentiels sont à retenir, d’une part la toute puissance coloniale de la France sur l’Algérie, d’autre part, le déclenchement de la première Guerre Mondiale, événement extérieur au cadre algérien. Dans l’Algérie, alors constituée de départements français, se côtoyaient deux sociétés, une société coloniale, française de plein droit et une société colonisée, algérienne dont les droits, des individus comme de son groupe, étaient limités. Le départ d’émigrés algériens vers la France correspond à une ponction de population à des fins strictement utilitaires par l’Etat français omnipotent, dans la droite ligne de la conception humaine de « chair à canon ». Ils étaient issus d’une population totalement dominée, des zones les plus déstructurées de la société. Il s’agissait alors d’une population exclusivement masculine. On ne parle pas encore de communauté algérienne ni d’étudiants algériens en France. La première phase qu’A. SAYAD a appelé le premier âge de l’émigration algérienne intervient au moment où la France métropolitaine doit faire face à un vaste chantier de reconstruction suite aux destructions de la première Guerre Mondiale. Les départs d’émigrés sont tantôt individuels, tantôt issus de recrutements collectifs. Ils se font à l’insu des colons plutôt réticents au départ de main d’œuvre d’Algérie.
59 Je parle ici de stratégie d’adaptation et non pas simplement d’adaptation parce qu’elle est toujours une tentative qui n’aboutit pas toujours à coup sûr, loin s’en faut.
33
Il s’agit d’une émigration sur ordre, ordre du groupe à l’individu. L’individu, un homme, est sélectionné en fonction de ses valeurs paysannes par la famille, le clan familial afin de, par une émigration de travail, faire face aux transformations de l’économie, à la monétarisation croissante et ainsi d’assurer la perpétuation d’une société d’économie de subsistance. Les départs sont rythmés par le calendrier agricole. Chaque émigration est un acte unique. Ce sont ces allers – retours qui donneront l’image pérenne de la « Noria ». L’émigré, bien qu’à l’étranger, est sous l’influence de son groupe. Il constitue avec ses pairs une petite communauté isolée du reste de la société, un « petit pays » qui lui rappelle le « grand pays », celui de la famille restée sur place pour laquelle il travaille. S’initie alors un mécanisme de reproduction à partir d’une vision idéalisée de l’émigration. L’émigration étudiante est alors quasi-insignifiante. A l’instar de cette première phase, le deuxième âge fait suite à une guerre. C’est en effet pour faire face à la forte demande en main d’œuvre nécessaire à la reconstruction du pays d’abord et pour permettre un développement économique soutenu par une très forte croissance ensuite que la France, toujours coloniale, encourage la demande de main d’œuvre immigrée. La liberté de circulation est devenue totale et la démographie algérienne permet ce transfert. Dans la société algérienne, l’argent issu de l’émigration est la principale source de revenus. Le groupe familial ne maîtrise pas les conséquences de l’émigration. Il perd progressivement de son pouvoir sur l’individu. Celui-ci s’émancipe et s’individualise. Il adhère à certaines valeurs de la société d’arrivée. Il a de nouvelles aspirations. Les allers-retours entre la société de départ et la société d’arrivée sont maintenant rythmés par le calendrier industriel, annuel. Il s’agit essentiellement d’une immigration de travail où l’émigré fait « carrière ». En Métropole, la population immigrée croît régulièrement. Elle constitue une importante communauté où l’on enregistre de plus en plus de regroupements familiaux. Une tension naît entre l’individu et son groupe initial. Un renversement hiérarchique s’est effectué au profit de l’individu mais aussi du groupe nouvellement constitué en France. La Guerre d’Algérie n’arrêta pas le mouvement migratoire vers la France et il continua sa progression après les accords d’Evian. Nous avons affaire alors à deux Etats, la France, ancienne puissance, et l’Algérie indépendante. Le premier a depuis, toujours eu l’ascendant sur le second, et mène le jeu dirons-nous, en matière de politique migratoire. L’émigration étudiante, quant à elle, va se développer à partir de l’indépendance, d’abord sous les traits de l’étudiant boursier, et progressivement de plus en plus sous une forme individualisée. Le troisième âge de l’émigration algérienne se distingue par la mise en place et l’institutionnalisation du regroupement familial. L’émigration algérienne en France est alors soumise aux conventions signées entre les deux Etats. Le regroupement familial existait bien dès le début de l’émigration, de façon mineure tout d’abord. Il s’affirme progressivement et est pleinement à l’œuvre à partir des décisions prises par les deux Etats d’arrêter l’émigration en 1973-74. Avec le regroupement familial, on assiste alors à une immigration de peuplement, s’installant de façon durable malgré l’illusion du provisoire, qui grâce à son développement contribue à la création d’un marché matrimonial. Il n’y a plus à proprement parler d’immigration de travail, sauf sous la forme clandestine que la première régularisation a mise en évidence. Nous assistons en fin de compte à une immigration de femmes et d’enfants. Les femmes rejoignent leur mari, accompagnées des enfants ; les hommes, célibataires en nombre, prennent femme au pays. Ce troisième âge est bien une histoire de famille. La migration étudiante, promue dès l’indépendance, va se consolider progressivement.
34
Les « âges », i.e. les formes que prennent l’émigration selon A. SAYAD, sont placés sur une échelle de temps T, ils s’installent de manière plus ou moins progressive à partir d’un temps t1, t2, t3,…, s’étalent sur une période P significative pour chacune des formes. Mais les âges peuvent perdurer bien au-delà de leur période caractéristique et ainsi se chevaucher. Le premier âge, celui de l’émigration sur ordre, a continué pendant que se développait le deuxième âge mais s’est arrêté en 73-74. L’âge du regroupement familial a commencé de façon anecdotique bien avant sa période caractéristique pendant laquelle l’individu, généralement l’homme, faisait venir un groupe, sa femme et ses enfants. Cet âge perdure jusqu’à aujourd’hui sous une forme renouvelée.
3.1 L’émigration post-migratoire
Au premier ou au deuxième âge, la France, en tant qu’Etat colonial, dominait l’espace français et algérien. « L’Algérie, c’est la France » disait-on à une époque. Des trois pays du Maghreb, ex-colonies françaises, l’Algérie est sans aucun doute le plus acculturé. Le Maroc et la Tunisie étaient des protectorats, l’Algérie une colonie à part entière, une présence française de cent trente ans. Le développement progressif d’une forte communauté en France et l’entretien des illusions de l’émigré (mensonge sur les réalités de leur vie en France, illusion du retour,…) ont eu une conséquence importante : c’est d’avoir créé chez l’individu algérien un espace mental60 dans lequel la France est totalement intégrée au même titre que l’Algérie au point où émigrer en France n’est plus, en quelque sorte, une véritable émigration. La France, ce n’est pas tout à fait l’étranger. D’autre part, le rapport hiérarchique du groupe sur l’individu s’est inversé entre le premier et le deuxième âge. Cette inversion s’est confirmée dans le troisième âge avec le regroupement familial en France. Mais les liens subsistent entre ceux qui sont restés en Algérie et le groupe établi en France. L’émigration algérienne actuelle, bien qu’elle conserve quelques formes connues par le passé tel le regroupement familial, ne correspond plus à ce que l’on a connu. Peut-être pouvons-nous à ce titre parler d’un « quatrième âge de l’émigration algérienne ». Plus évolutif dans le temps et plus polymorphe, il serait ainsi plus difficile à saisir. On peut remarquer trois « nouvelles » formes d’émigrations légales : la naturalisation, le mariage et la poursuite d’études61. La naturalisation consiste à rechercher dans sa généalogie un parent de nationalité française et ainsi faire valoir, par le droit du sang, la nationalité française à sa descendance. Le mariage62 d’un jeune, fille ou garçon, français issu de l’immigration, allant chercher son conjoint en Algérie, procède en quelque sorte à un regroupement familial d’un nouveau genre, avec une seule personne ; notons qu’à l’étranger, c’est en France que le marché matrimonial est le plus important. Les études supérieures enfin permettent un départ légal. Nous pouvons aussi supposer qu’études et mariage peuvent faire bon ménage. C’est dans les années 1980 que va se développer une « nouvelle » figure de l’émigré algérien à travers l’étudiant à l’étranger. Or ce mode de migration qu’est l’étudiant à l’étranger est étroitement lié aux mesures prises par les deux Etats, celui du pays de départ et celui du pays d’arrivée.
60 J’utilise ici le terme d’ « espace mental » dans le sens de « volume mental » qu’utilisait M. MAUSS in MAUSS M. (1999), Sociologie et anthropologie, 8ème édition., Paris, PUF/Quadrige, pp. 437. 61 Je n’explorerai pas le récent mouvement migratoire vers le Canada et plus précisément le Québec qui constitue une alternative au refus rencontré par la France ou les autres pays européens de l’espace SCHENGEN. 62 La formation de l’espace SHENGEN a probablement contribué à recentrer la demande de visas sur la France car la présence d’une forte communauté offre une marge de manœuvre supérieure aux autres pays. Elle dispose en effet de famille sur place et par conséquent d’un marché matrimonial attractif.
35
Du côté algérien, nous avons retenu une politique volontariste de l’enseignement devant l’impératif de la formation des cadres d’abord puis pour contrecarrer la montée de l’islamisme plus tard. Elle s’est traduite par les mesures suivantes :
- L’attribution de bourses à l’étranger ; - Le développement des écoles privées françaises ; - La massification des étudiants et la multiplication des universités. - Equivalence du système universitaire algérien avec l’université française et maintenant
européenne avec le LMD. Elles signifient une véritable « promotion » de l’étudiant dans la société malgré une succession de conjonctures difficiles : économie de pénurie, crise politique, montée de l’islamisme, « guerre civile ». Du côté français, des mesures actives ont oscillé de l’ouverture contrôlée à la quasi-fermeture :
- Développement d’une politique de coopération d’abord et l’attribution de bourses. - Lois restrictives sur l’émigration, notamment à travers les lois Pasqua II et III. - Et mesures d’assouplissement de ces lois (Fluctuations en fonction des
gouvernements). - Mise en place de l’espace Schengen.
Tout est fait, de façon récurrente, pour que l’émigration vers la France s’arrête. Cela ne concerne pas que l’émigration algérienne mais toutes les migrations en provenance des pays au Sud de l’Europe, celles en provenance des « pays à risques » : risques migratoires, risques terroristes,… Malgré toutes ces mesures, comment arrive-t-on à partir ? Comment arrive-t-on quand même à perpétuer et renouveler les formes de l’émigration ? Les lois d’aujourd’hui répondent souvent à une situation passée. Les mesures législatives prises à l’égard d’un avenir hypothétique sont elles-mêmes hypothétiques. Les pores du filtre des possibilités migratoires légales se resserrent mais ne sont jamais totalement fermés. Actuellement, un des moyens de rentrer légalement en France consiste à venir y faire ses études. L’obtention du baccalauréat français63 en est le plus sûr moyen. On enregistre bien une chute du nombre d’étudiants émigrés dans le milieu des années 1990, mais le phénomène a repris et s’est affirmé depuis. Il est non seulement incontournable mais il est l’objet de forts enjeux autant de la part des individus et du groupe que des Etats respectifs. L’émigration étudiante a vu, au même titre que le regroupement familial, la promotion migratoire des femmes. Le marché matrimonial constitué de part et d’autre de la méditerranée, engendre maintenant des tractations des deux sexes. A la demande de femmes du pays par les nombreux célibataires émigrés d’abord ont succédé des appels d’offres de jeunes femmes venues étudier seules en France. L’émigration d’étudiantes est un phénomène récent et, contrairement à l’émigration masculine, elle ne peut se faire sans l’aval ou la connivence de la famille ou d’une partie tout au moins64. Cette émigration étudiante est d’abord une émigration de non-travail et ensuite une émigration de femmes. Or ces deux migrations ont la particularité d’être moins visibles que les formes connues précédemment.
63 Le baccalauréat français est le premier diplôme universitaire en France et donne droit de fait à l’inscription dans une université française. 64 BORGOGNO V., VOLLENWEIDER-ANDRESSEN L. (2000), « Etudiants du Maghreb en France : Spécificités du « rameau féminin » de la migration ? », in GEISSER V.(dir.), Diplômés maghrébins d’ici et d’ailleurs, trajectoires sociales et itinéraires migratoires, CNRS éditions, Paris, pp. 285-306.
36
L’émigration étudiante est un moyen certes légal et sûr, encore faut-il réunir toutes les conditions pour la réaliser. Elle n’est pas à la portée de tous. Contrairement à d’autres formes d’émigration, elles nécessitent des préparatifs longs. L’émigration de travail, quand elle était légale, ne demandait guère que la connaissance d’un bon réseau. Le regroupement familial, quant à lui, fonctionne de manière mécanique et binaire ; un premier membre de la famille, généralement le père, a émigré et les autres peuvent le suivre dans les limites de la législation ; l’émigration est possible ou non. Pour venir suivre les études en France, il faut déjà pouvoir y prétendre. Cela veut dire soit être titulaire du baccalauréat français qui a lui seul permet l’inscription en premier cycle à l’université en France, soit être suffisamment engagé dans le cursus universitaire pour prétendre à la poursuite d’études à l’étranger, sachant que la priorité est donnée au 3ème cycle. Dans le second cas, la réussite au test d’évaluation du français est obligatoire. Obtenir le Bac français, l’aptitude au test de Français ou le diplôme universitaire suffisamment élevé est considéré comme le sésame pour la France. Le visa est le diplôme ultime, aboutissement d’un espoir vers une vie autre. Pour mener à bien ce projet, il faut des moyens. L’individu seul ne peut y faire face d’autant plus qu’il s’agit d’un jeune encore étroitement dépendant de ses parents. Le groupe l’accompagne dans son projet65. Etudier à l’université ou, a fortiori dans un lycée privé66, et à l’université représente un investissement financier lourd pour les familles. Coûteux en Algérie, le projet l’est encore plus en France. Un tel acharnement ne justifie certainement pas la poursuite seule des études. D’autre part, émigrer suppose une connaissance fine des procédures à mettre en œuvre, des connaissances que l’individu, là non plus, n’acquiert pas seul. Le membres de la famille présents en France entrent également dans ce jeu. Les liens avec le groupe d’origine sont maintenant plus symboliques qu’économiques. Ce sont certes des liens de parenté mais aussi des liens plus larges (amis, collègues,…) qui sont mis à profit par l’entraide aussi bien matérielle (aide financière, hébergement,…) que non matérielle (certificat d’hébergement). Emigrer, c’est bien sûr le projet d’un individu mais aussi le projet de son groupe, et par sommation, d’une partie ou de toute leur société.
3.2 Le groupe67 et l’individu autour du projet d’émigration : duo ou duel ?
Mais tous les projets n’aboutissent pas. Un projet dépend de conditions objectives certes, mais comme nous le fait sentir Ahmed68 dans son entretien, ces conditions ne sont pas à elles seules suffisantes pour réussir à émigrer. Son père travaille depuis plus de 30 ans en France. Il aurait pu depuis longtemps le faire venir, tant qu’il n’avait pas dépassé l’âge de 18 ans, ainsi que le reste de la famille, mais il ne l’a pas fait. L’individu jeune qui ne connaît pas encore toutes les conditions nécessaires au départ ne sait pas toujours saisir les chances qui sont à sa portée. Sa seule volonté ne suffit pas toujours. Sa décision de partir s’est affirmée, et les membres de sa
65 La lecture des quelques entretiens exploratoires l’atteste bien. 66 Rappelons qu’actuellement en Algérie seuls des établissements privés délivrent le baccalauréat français et que parmi les lycéens qui les fréquentent, un fort taux a la nationalité française. 67 Nous entendons par groupe, la famille constituée non seulement de la cellule familiale mais aussi des membres de la famille plus élargie avec lequel l’individu a des liens. Nous incluons dans cette dynamique, les membres du groupe qui ont émigrés en France où qui en sont issus. 68 Voir l’entretien exploratoire d’Ahmed.
37
famille (sa mère, ses frères et sœurs) qui sont restés au pays le soutiennent dans son projet ou ne s’y opposent pas. C’est bien de la volonté du groupe dont il s’agit ici. A l’inverse, Nawal dans son entretien nous montre comment certains membres de sa famille et de son entourage la soutiennent dans son projet, bien que d’autres y soient hostiles. Nous lisons dans ces deux entretiens que le projet de l’individu est un double projet : partir et étudier. Or si le premier peut réussir dans la perspective du second, le second peut ne pas réussir . Au final, si le projet d’étudier n’aboutit pas, le projet d’émigrer est quant à lui bel et bien réussi. L’université est un sas migratoire parfois très provisoire. Mais bien qu’à l’illusion de l’émigré succède souvent la désillusion de l’immigré, le double projet n’a pas tout à fait échoué pour l’individu, ni pour son groupe qui l’a épaulé toute la durée de son enfance et de sa jeunesse. Nous pressentons ici, de la part du groupe, toute l’importance et les enjeux que représente la présence dans la famille algérienne d’un émigré en France. Bien que ce soit l’individu qui parte et non le groupe, les deux projets, celui de l’individu et celui du groupe, sont intimement mêlés en un. Il existe comme une dynamique relationnelle entre l’individu et son groupe. Ce projet de migration pour études est à la fois un alibi de l’individu et de son groupe pour émigrer ainsi qu’un véritable projet de vie pour l’individu. On peut envisager cette dynamique relationnelle à l’aune du triangle de la différence de M. WIEVIORKA. La dynamique relationnelle s’organise autour de trois pôles : Le groupe, l’individu et le sujet. Le groupe est basé sur des références culturelles sur lesquelles se fonde le sentiment d’appartenance des individus et sur un système de valeurs. Le groupe tend toujours à sa cohésion interne. L’individu est celui de l’individualisme moderne, qui fait de chaque personne l’atome élémentaire d’une société où les hommes, (théoriquement libres et égaux en droit) participent comme autant d’êtres singuliers à la vie moderne. L’individu défini en fonction de sa participation à la vie sociale et politique ne se solde pas d’une dissociation du groupe. Le sujet, quant à lui, a une capacité de se penser avec une certaine réflexivité et à faire des choix. La subjectivité est une composante essentielle de la différence.
« Il existe une tension structurelle forte entre la logique de l’identité (du groupe), qui pousse à la stabilité, et la logique du sujet, qui exige la virtualité permanente du dégagement69 ».
L’espace dans lequel groupe et le sujet nouent des relations harmonieuses se trouvent balisé par deux limites : d’un côté la relation peut disparaître du fait de l’absorption du sujet, d’un autre côté, elle peut se défaire du fait d’une dissociation sur un mode éventuellement conflictuel. Le sujet rappelle au groupe l’existence d’un « agir créatif personnel », l’existence d’une capacité individuelle, à définir sa propre existence, à maîtriser ses convictions, ses valeurs de références ; mais il risque aussi en permanence, d’être appeler à se soumettre, puis à se démettre, ou d’être pousser à se dégager.
« Mieux vaut cependant penser en termes de circulation, de capacité, pour ces individus, à articuler les exigences propres à chaque sommet (du triangle), à passer de l’un à l’autre, à se mouvoir. Le triangle de la différence dessine à l’évidence un espace fragile, toujours menacé de désarticulation, voire de désintégration70 ».
Une lecture holiste, quant elle, nous dirait grosso modo que, d’un côté, il n’y a pas d’individu sujet dans ce type de société71, et d’un autre côté, qu’il n’y a d’individu que marginal. Or,
69 WIEVIORKA M. (2001), La différence, Paris, Balland, Voix et Regard, pp. 137-161. 70 WIEVIORKA M. (2001), idem. 71 J’entends ici par « ce type de société », la société kabyle qui, certes du fait de la mondialisation, est plongée dans la modernité mais qui à bien des égards n’en a pas toute la complexité.
38
nous comptons infirmer ces assertions en prouvant que nous seulement l’individu existe mais qu’il y a également comme un esprit pro-individuel au sein du groupe. Tantôt l’individu affirme une volonté de départ orchestrée avec son groupe qui le prépare et s’y prépare à tel point que nous ne savons plus de qui émane cette volonté mais aussi dans quelle mesure le projet de départ n’est-il pas activé principalement par le groupe. Tantôt l’individu s’affirme en tant que sujet et proclame une volonté de départ mais n’est pas soutenu par tous bien qu’il y soit préparé depuis longtemps. L’individu développe une stratégie d’adaptation dans l’espace, la marge de manœuvre qui lui reste. En considérant l’importance de la notion de projet72, nous plaçons la parenté au cœur de l’enquête sur les migrations. Nous proposons de traiter la famille comme un groupe social à l’intérieur duquel opèrent des mécanismes produisant de la migration et d’examiner en quoi la dynamique familiale contribue au processus qui conduit à l’émigration. En faisant circuler non sans conflits les ressources entre ses membres, le groupe familial favorise la sédentarité ou engendre la mobilité. Le départ ne se réduit plus à la réaction mécanique à un « stimulus » (économique, politique,…) extérieur mais conclut l’élaboration d’un véritable projet migratoire. Il s’agit bien pour nous ici d’explorer la dynamique familiale à l’œuvre entre le groupe et l’individu dans l’élaboration et la maturation du projet migratoire.
72 Bien que l’idée de « projet migratoire » recèle une ambiguïté tenant du psychologisme ou de l’idiosyncrasie familiale, nous pensons qu’elle est intéressante pour l’analyse de l’émigration aussi bien pour des cas singuliers que pour une population plus élargie.
39
II – NOTE METHODOLOGIE
1 - Présentation de l’enquête C’est après avoir beaucoup voyagé et travaillé dans les pays « arabes73 » et musulmans, vécu deux ans à Djibouti et deux en Egypte, que je suis venu à la Sociologie. Je parle arabe, surtout le dialecte égyptien presque couramment. J’ai pu me familiariser avec le berbère, particulièrement le kabyle, à l’Université de Provence. Bien que ma curiosité et mes lectures sur l’Algérie m’aient offert une certaine connaissance, je découvrais un pays qui ne ressemble en rien à ce que j’avais vu jusque là. Je fus marqué par ma première appréhension. J’arrivais dans un pays, que l’on qualifie généralement d’« arabe » alors que nombreuses et parfois surprenantes étaient les références à la France. C’est tout d’abord la francophonie mais aussi la présence de nombreux mots et expressions inclus que ce soit dans l’arabe ou le kabyle. C’est une présence de la France à chaque détour de rue, une architecture historiquement marquée, des enseignes publicitaires aux slogans connus mais parfois surannés, des devantures de magasins rappelant tel quartier de Paris ou telle ville de province française, un jeu radiophonique en français entendu dans un taxi en quittant l’aéroport, etc. J’y trouvais une familiarité réelle de la langue française, une Algérie française à plus d’un titre. Cette impression déjà forte à Alger s’est affirmée en Kabylie, région historiquement la plus marquée par la colonisation française - pas tant physique que culturelle - et par l’émigration-immigration. La réalité aurait-elle dépassé le mythe ? Et je venais faire une enquête dans ce pays où peu d’enquêtes sociologiques ont été faites par mes compatriotes depuis la fin des années 1980. Il s’agissait pour moi, dans le cadre d’une étude sur l’émigration algérienne récente, d’interviewer des étudiants de l’université Mouloud Mammeri à Tizi-ouzou au centre de la Grande Kabylie. J’ai choisi la Kabylie parce que cette région a connu une longue histoire d’émigration vers la France. Elle a aussi été l’objet de nombreuses études qui nous ont permis de cerner, dans une perspective diachronique, les changements socio-historiques qu’a pu prendre l’émigration. Je me suis fortement inspiré des travaux d’A. SAYAD. Je propose de poursuivre son questionnement sur l’une des formes prises par l’émigration récente. Il s’agit d’une enquête centrée sur le projet de départ des étudiants désirant poursuivre leurs études à l’étranger, en l’occurrence en France. A travers la genèse du départ, je m’intéresse à la dynamique des relations entre l’individu (l’étudiant) et son groupe (ses parents proches) autour du projet de départ partant de l’hypothèse que le groupe, contrairement à ce qui avait pu être observé par le passé, développait une attitude que j’appelle pour l’instant « pro-individualiste » vis-à-vis de l’individu. C’est une façon aussi d’interroger les raisons qui poussent les individus à partir en refusant le postulat, généralement admis dans de nombreux discours, que l’émigration procède de raisons principalement économiques. Cette étude prend également en compte le développement récent de l’émigration féminine. D’autres part, il est ressorti très clairement au cours de l’enquête des thèmes que j’avais peu explorés lors de l’élaboration de ma problématique même s’ils sont apparus en filigrane dans mes quatre entretiens exploratoires de septembre 2005. Un premier thème est une dimension cognitive de l’émigration à travers notamment un registre lexical comparatif prégnant dans le discours des interviewés. Le second est la dimension matrimoniale de l’émigration–immigration. Nous connaissions le mariage comme mode migratoire contemporain mais nous fûmes surpris que cette dimension apparaisse de façon si prégnante dans le discours des interviewés. Cette dimension tient des rapports sociaux de sexe, de la recherche amoureuse et de la sexualité.
73 C’est un qualificatif très réducteur et très connoté qu’il me semble bon de mettre entre guillemets.
40
2 - Le choix de la technique d’enquête : l’entretie n L’émigration est un phénomène qui peut-être perçu selon un point de vue macro-social, en termes démographiques de flux et de stocks ou économiques par exemple, mais aussi micro-social si on l’envisage, comme je le fais au terme de ma problématique, au niveau de l’individu et de son groupe, c'est-à-dire de l’institution familiale, en proposant d’y étudier dans ses espaces la dynamique à l’œuvre, ses proximités et ses éloignements, dans le cadre de l’élaboration du projet de départ de l’étudiant à l’étranger. Il s’agit aussi d’élaborer une typologie de l’étudiant candidat au départ grâce à une analyse fine qui puisse nous permettre de saisir les changements intervenus dans le phénomène migratoire algérien au regard des figures que l’émigré a pu avoir par le passé. Il s’agit en fait de savoir si l’étudiant algérien à l’étranger correspond, d’après la terminologie de A.SAYAD, à un quatrième âge de l’émigration algérienne, c'est-à-dire à une figure nouvelle, sinon en quoi elle ressemble aux précédentes et en quoi elle diffère. Dans cette perspective, le choix de la technique d’enquête par entretien s’est imposé « naturellement », eu égard au temps imparti à l’enquête, comme moyen d’accès à la vie d’un groupe, aux communications et actions entre ses membres et dans la mesure du possible à la vie intime de l’individu. Cette technique comporte l’avantage de pouvoir étudier aussi bien les représentations, le mode de pensée de l’individu et le sens qu’il donne à ses actions que ses pratiques, son mode de vie et ses aspects matériels, que ce soit sur un plan synchronique à un moment donné ou sur un plan diachronique en suivant sa trajectoire biographique par exemple, le tout créant un système pratique74, c'est-à-dire les pratiques elles-mêmes et ce qui les relie. Un point important a été le caractère exploratoire que notre enquête a conservé jusqu’à la fin. En effet, il ne s’agissait pas pour nous de nous tenir à la validation ou l’invalidation d’une hypothèse mais bien d’explorer les multiples facettes d’un phénomène qui nous est apparu comporter, dès le début (phase exploratoire du mois de septembre 2005), des dimensions très différentes.
3 - Réflexions méthodologiques L’enquête par entretien a mis longtemps à être reconnue comme technique d’enquête à part entière. On lui reprochait l’insuffisance de ses fondements théoriques. Ces propos sont maintenant dépassés comme nous le rappelle P. BOURDIEU :
« L’opposition traditionnelle entre les méthodes dites quantitatives, comme l’enquête par questionnaire, et les méthodes dites qualitatives comme l’entretien, masque qu’elles ont en commun de reposer sur des interactions sociales qui s’accomplissent sous la contrainte de structures sociales75. »
Il demeure cependant toujours une suspicion quant à la fiabilité des données tant il est vrai que les biais apparaissent toujours nombreux, certains facilement identifiables et donc d’une certaines façon exploitables, d’autres plus insidieux – et c’est de ceux-là dont nous devons le plus nous méfier. Reprenons les propos de A. BLANCHET et A. GOTMAN dans la conclusion de leur ouvrage :
« La reconnaissance d’un biais fondamental n’est pas la marque de l’invalidité d’une méthode mais, au contraire, la condition nécessaire pour que cette méthode atteigne un
74 Je fais ici référence à la définition qu’en donnent Alain Blanchet et Anne Gotman in BLANCHET A. et GOTMAN A. (1992), L’enquête et ses méthodes : l’entretien, éd. Nathan, coll. 128, Paris. 75 BOURDIEU P. (1993), « Comprendre », in BOURDIEU P. (dir.), La misère du monde, éd. du Seuil, Paris, note 2, p. 904.
41
statut scientifique. Une méthode étant précisément caractérisée par la maîtrise des distorsions auxquelles elle soumet les faits76. »
A défaut de pouvoir contrôler et maîtriser entièrement les biais, nous pouvons les utiliser. Ils peuvent constituer une ressource exploitable dans la recherche de notre objectif principal, c'est-à-dire la quête de la réalité77. Ainsi ne faut-il pas confondre méthode et méthodologisme. Le chercheur doit être respectueux du sujet qu’il interroge mais il doit en même temps être attentif aux stratégies des acteurs sociaux.
« Le rêve positiviste d’une parfaite innocence épistémologique masque en effet que la différence n’est pas entre la science qui opère une construction et celle qui ne le fait pas, mais entre celle qui le fait sans le savoir et celle qui, le sachant, s’efforce de connaître et de maîtriser aussi complètement que possible ses actes, inévitables, de construction et les effets qu’ils produisent tout aussi inévitablement78. »
Dans notre enquête, l’entretien est déclenché à l’initiative du chercheur (apprenti sociologue) qui demande des informations à un étudiant kabyle projetant de partir étudier à l’étranger, en France en l’occurrence. L’entretien produit une réponse-discours. C’est une réponse au questionnement du scientifique, mais c’est aussi une réponse aux questions que se pose l’acteur lui-même. Nous devons donc faire attention aux contextes discursifs différents d’où ce discours est issu. La relation d’enquête est à la fois une relation sociale, une interaction et une situation de communication entre deux personnes. Par conséquent, le chercheur doit créer les conditions afin que l’étudiant développe son discours. Il doit adopter une posture suffisamment non-directive et instaurer un rapport interpersonnel de confiance avec lui. Et je dirais, toujours à la suite de P. BOURDIEU, qu’ :
« On a donc essayé d’instaurer une relation d’écoute active et méthodique, aussi éloignée du pur laisser-faire de l’entretien non directif que du dirigisme du questionnaire. Posture d’apparence contradictoire à laquelle il n’est pas facile de se tenir en pratique. En effet, elle associe la disponibilité totale à l’égard de la personne interrogée, la soumission à la singularité de son histoire particulière, qui peut conduire, par une sorte de mimétisme plus ou moins maîtrisé, à adopter son langage et à entrer dans ses vues, dans ses sentiments, dans ses pensées, avec la construction méthodique, forte de la connaissance de conditions objectives, communes à toute une catégorie79. »
Nous avons donc tenté d’instaurer une « communication non-violente » sachant que la relation d’enquête constitue forcément une intrusion dans l’intimité de l’autre. Rappelons ainsi ce que dit P. Bourdieu dans La leçon sur la leçon, à savoir que cette intrusion dans l’histoire faite corps et le principe du respect du sujet nous contraignent à accepter l’idée que des choses peuvent être dites et d’autres non, car à ce moment-là, les choses sont inséparablement psychiques et sociales. Nous devons alors accepter que des frontières soient infranchissables. C’est après coup, en retranscrivant les entretiens réalisés et non pas dans le feu de l’action, que je fus surpris par les propos des personnes interviewées, surpris par ce qu’ils m’avaient dit notamment par le caractère très intime de certaines dimensions mais aussi par la « facilité » avec laquelle ils me les avaient dites. C’est rétrospectivement que j’ai essayé de
76 BLANCHET A. et GOTMAN A. (1992), L’enquête et ses méthodes : l’entretien, éd. Nathan, coll. 128, Paris, p. 117. 77 La réalité étant ici une mise en intelligibilité du monde social, d’un travail de compréhension. 78 BOURDIEU P. (1993), Op. Cit., p. 905. 79 BOURDIEU P. (1993), Op. Cit., p. 906.
42
comprendre ce qui s’était passé. En dehors du point commun que nous partagions, c'est-à-dire notre statut d’étudiant, nous étions différents par notre nationalité, notre culture, l’âge, etc. Je pense a posteriori que la relation d’enquête entre ces étudiants et moi-même fut une rencontre. J’allais dans un pays presque inconnu, en tout cas « exotique80 ». Eux étaient unanimement animés par ce que je traduirais grosso modo par un « désir de France ». Nous pourrions parler d’une « orientation » de par la langue, leur référentiel cognitif sur la France, leur histoire le plus souvent à distance avec ce pays que ce soit leurs relations avec la partie de la famille qui y est présente ou bien à travers des relations inter-étatiques, etc. Je venais pour réaliser une enquête sur leur projet de départ, je représentais en quelque sorte ce « désir » fait corps. Me rencontrer c’était un peu donner un début de consistance à leur projet. J’étais une fenêtre sur l’horizon tant espéré. A défaut de pouvoir y mettre les pieds, ils se permettaient à leur tour une expérience « exotique ». Je pense que cela a beaucoup contribué à libérer la parole des enquêtés. Ils n’auraient probablement pas dit tout ce qu’ils m’ont dit si je n’avais pas été étranger, et plus encore si j’avais été un de leurs compatriotes ou un de leurs proches. C’est une des surprises de cette enquête. Tout le monde (ou presque) a fait l’expérience d’une conversation avec un(e) inconnu(e) dans un compartiment de wagon lors d’un voyage en train. C’est un moment en suspens. On confie sa parole à une personne que l’on ne reverra sans doute jamais et par conséquent, dégagé de toute contrainte, on peut oser s’exprimer en toute liberté. Et nous pouvons citer ici P. BOURDIEU :
« En lui offrant une situation de communication tout à fait exceptionnelle, affranchie des contraintes, notamment temporelles, qui pèsent sur la plupart des échanges quotidiens, et en lui ouvrant des alternatives qui l’incitent ou l’autorisent à exprimer des malaises, des manques ou des demandes qu’il découvre en les exprimant, l’enquêteur contribue à créer les conditions de l’apparition d’un discours extra-ordinaire, qui aurait pu ne jamais être tenu, et qui pourtant, était déjà là, attendant ses conditions d’actualisation81. »
Mais paradoxalement P. BOURDIEU avait énoncé ces propos pour des conditions en tout point opposées, pour une situation d’homologie de positions c'est-à-dire où la distance entre l’enquêteur et l’enquêté était minimum, partant du parti pris que « la proximité sociale et la familiarité assurent en effet deux conditions principales d’une « communication non violente »82. » Il concède plus loin dans le même article que cette proximité pouvait être source de malaise quand l’interrogation tendait naturellement à devenir une socio-analyse à deux ; le résultat devenant alors difficilement exploitable. Nous étions, quant à nous, à l’opposé, plutôt dans une situation d’« hétérologie83 », où l’interviewé et moi-même étions séparés par une distance84 culturelle et sociale caractérisée non pas tant par son étendue que par le fait qu’elle fut inversée. Mieux que le miroir, c’est à la chambre noire que je pense, où l’image extérieure et sa projection intérieure se rejoignent au niveau de la focale. Cette focale est le point de rencontre où se réalise l’échange. C’est ainsi que ma condition nationale a participé en quelque sorte à ma condition méthodologique. Ce qui a pu apparaître comme un biais s’est en fait avéré être une ressource.
80 Du Lat. exoticus, du gr. exôtikos, « étranger ». 81 BOURDIEU P. (1993), Op. Cit., p. 914. 82 BOURDIEU P. (1993), Op. Cit., p. 907. 83 Nous sommes condamnés au néologisme. Le dictionnaire nous donne hétérologue comme antonyme d’homologue mais rien en face d’homologie. 84 La distance aurait pu être encore plus grande si j’avais été originaire d’un pays extérieur à l’histoire commune de nos deux pays respectifs.
43
4 - Enquête exploratoire et premiers constats J’avais pu faire l’été dernier, au début du mois de septembre, lors d’un premier séjour de reconnaissance, quelques entretiens exploratoires. J’avais interviewé deux garçons et deux filles issus du même département, celui d’Amazigh (Langue et Civilisation Berbère). Les entretiens se sont déroulés à l’université où on m’avait prêté tantôt une salle, tantôt un bureau. J’avais déjà repéré les biais potentiels de ces premières conditions :
- Issus du même département, les étudiants risquaient de me délivrer des discours similaires à propos de certains items (un consensus idéologique sur la berbérité par exemple). Je ne connaissais pas le degré de cohésion de ce groupe mais savais que ce département représentait peu d’effectifs.
- Le lieu même de l’université a pu influencer l’entretien par l’ambiance scolaire qu’il suggère. C’est par exemple le caractère à la limite du récitatif d’un des entretiens qui a fini tout de même par devenir intéressant au fur et à mesure que l’interviewé se décontractait.
A ces premiers constats, j’ai pu lors de mon dernier séjour, en ajouter d’autres au fur et à mesure que mon enquête avançait dans le temps. J’ai tout de même effectué les entretiens au sein du campus, dans un bureau au calme (et parfois chauffé) pour les raisons techniques suivantes :
- Il était nécessaire d’avoir de bonnes conditions d’enregistrement et seul le campus me le permettait. Les lieux publics, cafés et restaurants sont bruyants. A l’extérieur, le climat et la ville de Tizi-ouzou en perpétuelle construction ne le permettaient pas.
- Le petit bureau que l’on m’avait attribué permettait une discrétion nécessaire à la délivrance d’une parole intime. Ce que l’on n’aurait pas eu au domicile des étudiants que ce soit au village (donc en famille) pour la plupart trop éloignée ou à la cité universitaire dont l’état se passe de tout commentaire.
- Le lieu était connu de tous, facilement repérable même pour quelqu’un extérieur à l’université et pratique pour fixer des rendez-vous.
- Après coup, je me suis aperçu que le campus représentaient pour les étudiants un véritable espace de liberté.
Analyse de la situation d’interaction : un « entretien participatif »
Lors d’un des premiers entretiens de l’enquête, j’ai eu carrément la mauvaise impression que l’étudiant (cas de Larbi par exemple) me prenait pour un recruteur venu auditionner des candidats au départ. Je me suis aperçu qu’il avait des difficultés à « rentrer dans la parole » et paradoxalement plus que lors de mes entretiens exploratoires. La modification de l’approche, une simple discussion, et de la consigne de départ, une question entrant trop directement dans le vif du sujet, avait transformée l’entretien en une série de questions-réponses. J’ai alors repris l’approche précédemment utilisé, c'est-à-dire de demander aux personnes de me raconter tout d’abord leur vie. Cette consigne vague leur a permis de tranquillement se mettre à l’aise. J’ai encore amélioré ma relation avec l’interviewé en passant plus de temps à lui expliquer le fonctionnement de l’entretien et ce qui m’intéressait en balayant avec lui, et à l’avance, le guide d’entretien de façon qu’il sache de quoi il en retourne. L’objectif était d’instaurer un climat de confiance. J’offrais ainsi à l’interviewé l’occasion et la possibilité de s’approprier en partie l’enquête, de construire et donc mieux maîtriser son discours. L’objectif était qu’il me fasse confiance et par-là même qu’il prenne confiance en lui. Il peut apparaître comme un inconvénient que l’interview
44
tourne parfois au dialogue voire à la conversation avec de nombreuses digressions par rapport aux thématiques abordées mais c’est à ce prix que j’ai pu voir surgir des thématiques peu exploitées dans l’élaboration de ma problématique. J’ai pratiqué ce que je nommerais de ce point de vue un « entretien participatif ». Un autre point important me semble-t-il est la question du choix entre le vouvoiement et le tutoiement. J’avoue ne pas l’avoir résolu et de ne pas être satisfait. Vaut-il mieux tutoyer l’interviewé afin de jouer un effet de proximité car, après tout ne suis-je pas moi-même étudiant comme eux ? Ou plutôt le vouvoyer parce qu’ayant passé la quarantaine et n’étant pas par conséquent de la même génération, eux, de toute façon, auraient tendance à me vouvoyer ? Comment « mieux passer » auprès de l’autre ? Le temps de l’enquête est court. On a toujours l’impression de ne pas avoir assez de temps. J’ai tout de même le plus souvent opté pour le tutoiement pour deux raisons importantes. C’est d’une part la façon dont je m’exprime le plus souvent avec des personnes plus jeunes que moi. Il ne m’aurait pas paru « naturel » de m’exprimer autrement. Quand on souhaite mettre à l’aise l’interviewé, il faut déjà que l’enquêteur le soit. Comment faire autrement pour que l’autre nous délivre sa parole si l’on ne se livre pas un peu soi-même ?85 J’avais aussi pour objectif d’interviewer des parents d’étudiants candidats au départ. Je n’ai pu en interviewer que deux. Les étudiants interviewés provenaient très souvent de villages éloignés de Tizi-Ouzou. Il aurait fallu un séjour plus long. Ajoutons que la temporalité en Algérie est différente de celle de la France. J’ai eu aussi quelques refus certes argumentés - un décès récent dans la famille rendant inconvenant l’entretien, un problème de calendrier, un week-end, un jour férié et la fête de Achoura. Mais peut-être s’agit-il de véritables refus de la part de l’étudiant ? Les deux parents rencontrés (le père dans les deux cas) étaient issus de milieux sociaux très différents. Le premier, directeur d’un centre de formation et maîtrisant parfaitement le français, a essayé de dominer l’entretien. Cela se passait dans son bureau, sans la présence de sa fille alors en train de passer un examen à l’université. Nous avons discuté environ ¾ d’heures avant d’arriver à ce qui m’intéressait ; la partie enregistrée a continué sous la même forme, c’est-à-dire une conversation, sur laquelle s’est greffée une tierce personne. Il n’en demeure pas moins que le contenu de cet entretien me semble assez riche bien que dépassant largement le cadre de mes hypothèses. Comme je pense que tout (ou presque) est lié dans le social, l’exploitation de cet entretien peut me donner des perspectives ou des prolongements intéressants. Le second, plus âgé, a lui-même émigré plusieurs années en France comme manœuvre. Il maîtrise moins bien le français. Alors que son fils (que j’avais interviewé seul le matin) était présent, il n’a pas senti la nécessité de me proposer une traduction comme s’il avait de toute façon peu de chose à me dire. Parlant de la France il me disait : « C’est bon pour lui » ; « Il doit tenter sa chance ». La pauvreté de cet entretien est peut-être significative en soi.
5 - Echantillon et présentation du corpus de l’enqu ête Les étudiants qui ont participé à la phase exploratoire de l’enquête sont tous issus du département de Langue et Civilisation Amazigh de l’Université Mouloud Mammeri à Tizi-ouzou. Je les ai connus grâce à l’intermédiaire de Azzedine Kinzi, enseignant de socio-anthropologie dans ce même département. Les entretiens se sont déroulés sur deux jours à la fin de mon séjour à la mi-septembre 2005.
85 J’ai adopté l’attitude que j’utilise habituellement pour entrer en communication avec l’« autre », attitude que j’ai acquise par de continuels ajustements lors de mes expériences diverses et multiples. Cette attitude prise et apprise continuellement procède d’un habitus qui me fait agir de cette manière, le plus souvent de façon inconsciente. Trouver le juste ton avec autrui nécessite plus d’expérience que de réflexion.
45
Pour l’enquête à proprement parler, j’ai obtenu mon échantillon en diversifiant mes informateurs, qui par un effet « de bouche à oreille » plutôt que « boule de neige », m’ont permis d’avoir des étudiants de quatre filières différentes. Notons que parmi les étudiants qui me furent présentés, les filles étaient plus nombreuses. Elles étaient d’ailleurs plus « volontaires » que les garçons et avaient généralement la parole plus facile. J’ai dû limiter leur nombre afin de conserver à peu près la parité homme – femme. Pourquoi les femmes seraient-elles plus à l’aise avec moi ? Ma position d’interviewer « étranger » n’est peut-être pas étrangère à cette question. Ma position « hors-champ » ouvrait un espace neutre, une sorte de « no man’s land social ». Je suis hors du champ sexuel et matrimonial, donc « hors-champ » des enjeux d’honneur et peut-être du coup suis-je considéré comme un être asexué. Je suis non seulement sans danger mais je représente une sécurité morale. Ma condition nationale me donne alors en quelque sorte une condition méthodologique. Ce statut de « hors-champ » a certainement aussi compté dans ma relation avec les hommes. Je dois préciser que tous les entretiens se sont déroulés en Français. Tous les étudiants maîtrisant suffisamment bien cette langue, certains m’ont même dit que c’était la langue86 avec laquelle ils pensaient.
Principales caractéristiques des étudiants interviewés Nom Âge Bac Filières
universitaires Recrutement d’enquête
Parents Famille en France
Ahmed G87 (exploratoire)
25 ans Lettres Amazigh Par mon hôte, professeur au département d’Amazigh
Son père est en France, remarié.
Des oncles et des cousins.
Nawal F (exploratoire)
25 ans Lettres Amazigh Idem Son père a vécu 25 ans en France.
Deux oncles. Des cousins.
Koseila G (exploratoire)
26 ans Lettres Amazigh Idem Son grand-père.
Kamelia (exploratoire) F
24 ans Sciences Amazigh idem Une de ses sœurs mariée à un immigré.
Layla F
21 ans Sciences Amazigh Rencontre informelle
Son père a vécu jeune en France
Deux oncles
Sou‘ad F
23 ans Lettres Amazigh Par Layla Un oncle
Kaci G
25 ans Amazigh Rencontre informelle
Son père a vécu 3 ans en France
86 Mais cette histoire de langues est assez délicate en Algérie. 87 G = garçon, F = fille
46
Akel F
26 ans Sciences Biologie puis Economie
Par Ouzna, rencontrée de façon informelle
Sa mère a vécu en France
Son fiancée
Tazrut F
26 ans Economie Par Akel Deux frères et un oncle
Salim G
25 ans Economie Par son frère, via mon hôte
Un oncle
Nordine G
24 ans Lettres Droit Par Ahmed Son père a vécu en France
Son frère
Arezki G
24 ans Lettres Droit idem Une tante et un cousin
Larbi G
26 ans Lettres Français Rencontre informelle
Son père. Son grand-père.
Hakima F
Sciences Français Par le Directeur du département de Français
Un oncle Son copain
Ferhat G
25 ans Lettres Français idem Son père a vécu 40 ans en France
Razika F
23 ans Lettres Français idem Son père a connu la France
Un frère
Hakim G
28 ans Sciences Informatique Colocataire de mon hôte
Saïda F
27 ans Lettres Anglais et Tourisme
Par Hakim Son grand-père Deux frères
J’ai interviewé une quinzaine de personnes lors du dernier séjour. J’en ai enregistré quatorze pour une dizaine d’heures d’enregistrement, qui vont de 20 minutes à une heure selon l’entretien. J’ai retranscrit intégralement les entretiens les plus longs qui me semblaient aussi les plus riches. Pour les autres, j’ai retranscrit les passages les plus intéressants du point de vue thématique.
6 - Exploitation des entretiens Comme nous l’avons vu précédemment, l’entretien est une réponse-discours, produit d’une interaction entre le chercheur A et un interviewé B. Le discours de B vient en réponse au questionnement de A. Outre les effets produits par le contexte de l’entretien dont nous devons appréhender les biais à défaut de pouvoir les contrôler, l’entretien nous procure un discours. La somme des entretiens réalisés nous procure un corpus que nous devons analyser. L’analyse consiste à sélectionner les données susceptibles de permettre la confrontation de ou des hypothèses aux faits. A. Blanchet et A. Gotman distingue l’analyse du discours qui concerne l’analyse de tous les composants langagiers et l’analyse du contenu qui « étudient et comparent les sens des discours pour mettre au jour les systèmes de représentations véhiculés
47
par ces discours88. » Le sens est une production, une lecture orientée et non une donnée. Il implique des hypothèses. Nous avons travaillé essentiellement à partir des textes écrits. Sur les quatorze entretiens de l’enquête, nous en avons retranscrit huit intégralement et de manière littérale, ceux que nous estimions les mieux réussis du point de vue de la quantité d’informations collectées et de la qualité de déroulement de l’entretien. Il n’en demeure pas moins que certains entretiens que j’avais jugés médiocres à tout point de vue s’avèrent tout de même riches de signification, ne serait-ce par leurs longs silences89. Le reste du corpus vient confirmer l’effet de saturation des thèmes abordés. Nous avons procédé à une analyse transversale des entretiens, appelée encore analyse thématique. Elle consiste en un découpage de chaque entretien par thèmes identifiés à partir de nos hypothèses et en la constitution d’une « grille » au fur et à mesure de l’analyse90. Les hypothèses ont été elles-même reformulées et complétées à la lecture de nos entretiens. L’analyse thématique met en évidence la récurrence et la cohérence thématique entre les entretiens. La récurrence permet ainsi de sortir de la singularité, celle de l’individu, afin d’appréhender la généralité, celle du groupe et de ses propriétés sociales. Elle permet la recherche des modèles descriptifs des représentions sociales au travers de la stabilité ou de la variabilité des thèmes et au final l’élaboration d’une nouvelle typologie. Nous avons également, de façon sous-jacente, porté une lecture longitudinale autrement dit « entretien par entretien » du corpus afin de mieux cerner, à travers la biographie de l’individu, ses pratiques. C’est toute l’importance de l’histoire de l’individu dans son discours. Cela a permis de mettre en évidence les processus internes de formation des trajectoires, d’identifier des moments-clés, des facteurs de décisions au moment des choix. Cette deuxième lecture permet de restituer la cohérence singulière du discours et l’architecture cognitive et affective des individus. Jean-Claude KAUFMAN nous met en garde en nous rappelant que « le traitement des données quel qu’il soit est toujours un travail de réduction de la complexité du réel…91 ». Pour lui, l’écrit permet efficacement d’exposer à plat les données, de les trier, ranger, de constituer des catégories et des typologies, mais il préfère l’oral pour « donner du volume à l’objet sociologique, en problématisant au plus près des faits. » Nous avons donc suivi son conseil en revenant à l’enregistrement aussi souvent que nécessaire, en adoptant une « attention flottante », s’imprégnant de l’histoire de l’interviewé tout en ayant en tête nos hypothèses de travail. Mais pour lire ces entretiens et en quelque sorte les faire parler, nous devons disposer de quelques outils.
6.1 Les outils d’analyse
Dans « l’entretien compréhensif », J.- Cl. KAUFMANN cite Wright MILLS à propos de la façon dont naissent les hypothèses et la théorie, d’un mélange paradoxal de deux facteurs : « d’une part la volonté activiste du chercheur, son « agilité intellectuelle » et son désir
88 BLANCHET A. et GOTMAN A. (1992), Op. Cit, p. 91. 89 Les silences peuvent traduire tantôt l’implicite, tantôt des paroles censurées quand l’interviewé s’interdit de dire. Cf. FOUCAULT M. (1971), L’ordre du discours, NRF, Gallimard, Paris. 90 Un inconvénient majeur de cette méthode tient au fait que l’analyste peut projeter à son insu le sens et la construction qui lui permettent de confirmer ses hypothèses « à tout prix. » 91 KAUFMANN J.- Cl. (2003), L’entretien compréhensif, Nathan, Coll. 128, Paris, p. 81.
48
farouche de comprendre ; d’autre part au contraire sa passivité, son ouverture tolérante, qui lui permettent d’accueillir des « soudures imprévues ». » Selon J.- Cl. KAUFMANN, « l’objet sociologique se construit en utilisant les catégories indigènes92 pour élaborer ses modèles, tout en prenant de la distance avec elles à mesure que les modèles se précisent. » Il n’en demeure pas moins que le chercheur se doit de rester modeste face à ces catégories indigènes, à ce savoir local93 même s’il peut paraître partiel, tronqué, illusoire. Il reste la source de l’élaboration théorique et ce n’est pas le moindre des paradoxes de la recherche en sociologie. L’hypothèse nouvelle est alors le fruit d’une concentration sur un petit nombre d’idées à la fois et d’une « soudure imprévue » bien que celle-ci repose sur l’intuition du chercheur. L’intuition est le résultat d’un travail invisible du chercheur. C’est un canal heuristique d’où peut émerger une ou des hypothèses qu’il convient de mettre immédiatement à l’épreuve des faits. La soudure idéale provient d’un fait observé lié à une hypothèse centrale tout en transformant cette dernière. J.- Cl. KAUFMANN nous invite à privilégier le scénario de la découverte, en observant avec attention les « cas négatifs » car « le risque est grand, nous dit-il, de s’enfermer dans son modèle et de refuser de voir ce qui ne correspond pas ou ce qui le contredit fortement. » Il nous invite également à prendre les risques de l’interprétation. Bien qu’elle soit paradoxalement fondée sur la subjectivité du chercheur, c’est d’elle que dépend la construction de l’objet sociologique qui va repousser les limites de la connaissance spontanée. Mais attention ! Autant une interprétation exagérée mènerait à un subjectivisme, autant une prudence exagérée nous priverait de dimension proprement sociologique. L’interprétation, comme l’hypothèse, ne repose pas sur une quelconque intime conviction ; elle doit être argumentée, vérifiée à l’aune de l’ensemble du modèle. Elle est donc contrôlée. La signification de données langagières n’est pas donnée comme telle, elle est le résultat d’une production. Nous nous aiderons pour cela de l’apport d’auteurs tels que C. KERBRAT-ORECCHIONI94 et L. COURDESSES95 qui, grâce à leurs travaux de linguistique sur la matérialité du langage, permettent des techniques de rupture et ainsi de mieux contrôler l’analyse.
6.1.1 Les outils de J.- Cl. KAUFMANN J.- Cl. KAUFMANN nous propose quelques outils opératoires afin de mieux discerner les « catégories indigènes » réellement utilisables : les phrases récurrentes et les contradictions. Les phrases récurrentes sont, au même titre que les idées et les images, des « fragments » du social que les individus incorporent sans les digérer et qu’ils restituent à l’état brut. Ces fragments même partiellement personnalisés ne circulent pas au hasard. J.- Cl. KAUFMANN nous dit que « ceux qui circulent ainsi, et qui restent inchangés d’un individu à l’autre, correspondent à des processus sous-jacents essentiels. […] ils sont reçus et transmis comme un donné d’évidence. » Il ajoute que ces fragments occupent une place cruciale dans le processus de construction de la réalité car « plus une idée est banalisée, incorporée profondément dans l’implicite (et parallèlement largement socialisée) plus est grand son pouvoir de structuration sociale. » Pour notre part nous nous sommes concentrés sur la 92 Indigène s’oppose ici à scientifique. J.- Cl. KAUFMANN justifie l’emploi de ce terme par son caractère un peu décalé qui a l’intérêt de souligner le fait que l’homme ordinaire soit porteur d’une culture inconnue. 93 J.- Cl. KAUFMANN reprend ici la dénomination de C. GEERTZ qui a tant insisté sur la nécessité de la compréhension des catégories indigènes. Lire GEERTZ C. (1986), « Du point de vue de l’indigène : sur la nature de la compréhension anthropologique » in Savoir local, savoir global, PUF, Paris, pp. 71-90. 94 KERBRAT-ORECCHIONI C. (2002), L’énonciation. De la subjectivité dans le langage, Coll. U, Armand Colin, Paris, pp. 267. 95 COURDESSES L. (1971), « Blum et Thorez en mai 1936. Analyse d’énoncés », in Langue française, n° 9, février, pp. 22-33.
49
répétition, la récurrence de phrases – c’est le cas notamment de l’expression « manque de moyen » qui revient dans tous les entretiens bien qu’elle paraisse anodine - mais plus largement de thématiques qui apparaissent effectivement sous la forme d’expressions pas toujours identiques dans la formulation mais dont le sens nous a paru semblable. Toujours à propos de ces expressions récurrents, J.- Cl. KAUFMANN dit :
« Certaines toutefois sont beaucoup plus significatives pour qui veut non seulement décrire mais comprendre en profondeur les processus à l’œuvre. Je n’ai pas de recette pour les repérer : elles sont particulièrement banales dans leur forme. Le seul outil est leur frottement avec le modèle théorique : il faut, avec des hypothèses plein la tête, trouver ce qu’elles pourraient avoir à dire.96 »
Ces expressions ne recouvrent pas la complexité du modèle théorique, loin de là, mais elles en constituent en quelque sorte des indices et souvent apportent des précisions. Le deuxième outil proposé par J.- Cl. KAUFMANN est le repérage des contradictions :
« Pour le chercheur, l’instrument privilégié pour ne pas se laisser prendre à la trop belle histoire qu’il entend, est le repérage des contradictions dans le discours. »
La biographie d’un individu, son existence comporte un aspect composite, porte des dynamiques de personnalités différentes qui impliquent des logiques différentes. Leur repérage, lorsqu’il met en valeur des contradictions, fournit des clés d’interprétation. Selon J.- Cl. KAUFMANN, ces contradictions sont de deux ordres :
- Les contradictions qui se rapportent au modèle théorique peuvent signaler l’existence d’un mécanisme social structurellement contradictoire et/ou la mise en évidence de « grappes de rôles » associant des cadres de socialisation à la fois proches et très différents.
- Les contradictions qui sont plus particulières à l’histoire de vie de l’individu. De plus, les contradictions peuvent aussi être récurrentes d’un discours à l’autre. Elles représentent alors, selon J.- Cl. KAUFMANN, « un instrument d’analyse d’une puissance considérable, car elles signalent très souvent un processus central. » j’y intègrerais pour ma part les « contradictions argumentatives ». Citons l’exemple de Hakima déclarant qu’elle pourra être hébergée chez son oncle en France sans être capable de citer et de situer la ville qu’il habite. Nous nous apercevons que lorsque les conditions objectives du départ ne sont pas réunies, l’individu déclame son projet en rêve.
6.1.2 Le triangle de la différence de Michel WIEVIORKA Nous avions émis comme hypothèse centrale l’existence d’une dynamique relationnelle entre l’individu et son groupe. Nous pressentions que les deux projets, celui de l’individu et celui du groupe, étaient intimement mêlés en un. Sans toutefois prédire toute la nature des relations entre l’individu et son groupe, nous pensions que le projet de migration pour études était à la fois un alibi de l’individu et de son groupe pour émigrer ainsi qu’un véritable projet de vie pour l’individu. Le « triangle de la différence » de M. WIEVIORKA peut constituer un outil opératoire pour appréhender cette dynamique relationnelle. La dynamique relationnelle s’organise comme à l’image d’un triangle autour de trois pôles : Le groupe, l’individu et le sujet.
96 KAUFMANN J.- CL. (2003), Op. Cit., p. 97.
50
Le groupe, c'est-à-dire l’identité collective comme le nomme M. WIEVIORKA, est basé sur des références culturelles sur lesquelles se fonde le sentiment d’appartenance des individus et sur un système de valeurs qui définit son unité. Le groupe tend toujours à sa cohésion interne, en principe97. En effet, devant la désagrégation de la société algérienne et la multiplication des références culturelles, la dimension du groupe, pour rester viable, tend à diminuer. C’est pour cela qu’en guise de groupe nous parlerons surtout de la famille étroite constituée surtout des parents et de leurs enfants même si d’autres membres de la famille, de parenté ou d’alliance, apparaissent dans le discours de l’individu. L’identité collective s’organise pour l’action qu’à partir du moment où elle se trouve confrontée à des défis, internes ou externes. Elle peut être mise en cause et mobiliser les acteurs de plusieurs façons :
- Sur le mode de la résistance, d’une conduite défensive, face à une menace externe ou à une crise intérieure au groupe.
- Sur le mode de la conquête et visant à assurer un processus d’expansion. - En combinant les deux attitudes précédentes. - En tendant à la rupture.
L’identité collective tend toujours un tant soit peu à la centration du groupe sur lui-même, centration à laquelle participent une partie de ses membres. Cette même identité collective peut revêtir des formes diverses mais son évolution dépend pour beaucoup des deux autres composantes du triangle : l’individu et le sujet. L’individu est celui de l’individualisme moderne, qui fait de chaque personne l’atome élémentaire d’une société, défini en fonction de sa participation à la vie sociale et politique mais qui ne se solde pas d’une dissociation du groupe. C’est l’individu à la fois dans le groupe et dans la société qui l’environne - et nous verrons que sa position n’est pas confortable, eu égard aux transformations rapides (et parfois violentes) que subit la société algérienne. Il peut paraître paradoxal de mettre en relation la différence collective en y incluant l’individualisme moderne. Cette mise en relation s’avère cependant indispensable selon M. WIEVIORKA car il est courant de constater un lien entre affirmation d’une identité collective et participation individuelle à la modernité.
« La logique de l’identité collective n’exclut nullement pas celle de la participation à l’individualisme moderne. Ainsi la première apparaît-elle, dans bien des cas, comme une invention des individus afin d’accéder à une modernité dont ils se verraient sinon frustrés.98 »
Et j’ajouterais ce qu’Eric HOBSBAWM nous dit dans son article « Inventing tradition » : « Une tradition communautaire que l’on pensait immémoriale n’est en fait qu’une création récente liées aux enjeux d’un passé proche et aux stratégies de tel ou tel groupe social.99 »
Le sujet, quant à lui, a une capacité de se penser avec une certaine réflexivité et à faire des choix. Cela implique également la reconnaissance, de la part du sujet, de cette même capacité chez autrui. Pour M. WIEVIORKA, la subjectivité est une composante essentielle de la différence100. Le sujet implique une capacité de dégagement des normes, y compris de celles qu’il avait auparavant choisies lui-même en toute liberté. Le paradoxe est constant : le sujet n’existe que comme distanciation, réflexivité voire retrait – tout le contraire de ce qu’offre
97 C’est moi qui souligne. 98 WIEVIORKA M. (2001), La différence, Paris, Balland, Voix et Regard, p. 140. 99 HOBSBAWM E. (1995), « Inventing tradition », in Enquête, n° 2, pp. 171-189. 100 WIEVIORKA M. ajoute aussi qu’il n’y a aucune raison de limiter cette remarque aux seules démocraties post-industrielles.
51
l’identité mais, pour exister, il a besoin de conditions favorables que l’identité seule peut lui fournir.
« Il existe une tension structurelle forte entre la logique de l’identité (du groupe), qui pousse à la stabilité, et la logique du sujet, qui exige la virtualité permanente du dégagement101 ».
L’espace dans lequel le groupe et le sujet nouent des relations harmonieuses se trouvent balisé par deux limites : d’un côté la relation peut disparaître du fait de l’absorption du sujet, d’un autre côté, elle peut se défaire du fait d’une dissociation sur un mode éventuellement conflictuel. Le sujet rappelle au groupe l’existence d’un « agir créatif personnel », l’existence d’une capacité individuelle, à définir sa propre existence, à maîtriser ses convictions, ses valeurs de références ; mais il risque aussi en permanence, d’être appeler à se soumettre, puis à se démettre, ou d’être poussé à se dégager.
« De façon plus générale, participer aujourd’hui en tant qu’individu à la vie sociale, c’est être de moins en moins appelés à se conformer à des normes et à des rôles prédéterminés. Les valeurs dominantes sont davantage celles de la flexibilité, de l’acceptation du risque et de la complexité, de l’incertitude, de la disponibilité pour la communication permanente, de la capacité à se déplacer, à changer de métier, de lieu de travail, d’entreprise. Dès lors, ce n’est pas seulement le sujet, dans sa soif d’autonomie, de liberté, et de responsabilité personnelle, c’est aussi l’individu, dans ses attentes de participation à la modernité, qui entrent en conflit avec tout principe d’identité. Et cela, pour des raisons qu’il faut rappeler : l’identité, contrairement aux valeurs dominantes d’aujourd’hui, implique une certaine stabilité, voire une rigidité, une fidélité qui fixe un univers où ce qui advient est relativement prévisible, du moins trouve un sens, et où les conduites peuvent par conséquent être orientées par des valeurs qui ne bougent pas en permanence.102 »
M. WIEVIORKA nous recommande de penser la dynamique inter-relationnelle plutôt en terme de circulation, de mouvance entre les différents sommets du triangle. Notre étude, en faisant intervenir les trois composantes du triangle en relation, nous permet de percevoir les tensions à l’œuvre dans le projet de départ des étudiants, en sachant qu’il ne s’actualise pas seulement de l’Algérie en direction de l’Algérie – pays à propos duquel nous avons perçu dans notre problématique des contradictions ne serait-ce que d’ordre historique – mais de l’Algérie vers la France, rendant la configuration du phénomène plus complexe encore. Afin de mieux différencier les trois termes du triangle, nous pouvons faire intervenir les outils de la linguistique.
6.1.3 Une question d’énonciation Catherine KERBRAT-ORECCHIONI103 à la suite de BENVENISTE nous propose de distinguer l’énoncé de l’énonciation et d’étudier au travers de cette dernière la subjectivité dans le langage. L’énonciation permet de repérer comment le sujet se manifeste dans son énoncé. JACOBSON déjà avait souligné l’importance de certains éléments que l’on retrouve dans pratiquement tous les systèmes linguistiques et que l’on peut donc considérer comme des « universaux » du langage et dont le fonctionnement sémantique est inséparable de la situation d’énonciation. Nous appelons aujourd’hui ces éléments « déictiques. » Ce terme
101 WIEVIORKA M. (2001), Op. Cit., p. 144. 102 WIEVIORKA M. (2001), Op. Cit., p. 153. 103 KERBRAT-ORECCHIONI C. (2002), L’énonciation. De la subjectivité dans le langage, Coll. U, Armand Colin, Paris, pp. 267.
52
vient du grec déixis et signifie « action de montrer. » C. KERBRAT-ORECCHIONI nous en propose la définition suivante:
« Ce sont les unités linguistiques dont le fonctionnement sémantico-référentiel (sélection à l’encodage, interprétation au décodage) implique une prise en considération de certains des éléments constitutifs de la situation de communication, à savoir : - le rôle que tiennent dans le procès d’énonciation les actants de l’énoncé, - la situation spatio-temporelle du locuteur et éventuellement de l’allocutaire. »
Elle ajoute pour être plus claire : « Ce qui « varie avec la situation », c’est le référent d’une unité déictique, et non pas son sens. » Pour savoir, par exemple, qui est désigné par le je, nous devons connaître la situation d’énonciation. Pour comprendre, nous avons besoin d’une indication que les mots de l’énoncé ne donnent pas. En résumé, tout locuteur établit un ensemble de trois coordonnées liées à la situation d’énonciation. Il fixe ainsi : un repère subjectif (la première personne, ego), un repère temporel (le maintenant, nunc) et un repère spatial (ici, hic). Ce faisant, il établit en quelque sorte une hiérarchie fonctionnelle de l’énonciateur sur le destinataire. Le locuteur a l’initiative sur l’allocutaire qui ne peut qu’essayer de le suivre. C’est là qu’apparaît toute l’importance de la subjectivité104 dans le langage, c'est-à-dire le rôle qui revient au sujet parlant. Occupant un rôle central, c’est lui qui infléchit son discours, choisit ce qui est dit et la façon de le dire. Il peut ainsi donner des jugements même personnels comme des évidences. On s’aperçoit à ce propos toute l’importance d’un entretien bien mené, des relances, des remarques, voire des provocations lancées sur le mode de l’humour. Nous avons, pour notre analyse, utilisé quelques outils de la pragmatique, tels que nous les présente C. KERBRAT-ORECCHIONI dans son ouvrage. Nous avons concentré essentiellement notre attention sur l’usage des pronoms et des temps de conjugaison des verbes. Nous pouvons mieux distinguer la nature du je, s’il n’est qu’un porte-parole ou s’il se qualifie aux yeux d’autrui et marque ainsi subjectivement son énoncé. Il en va de même pour le nous afin de savoir à quel groupe se réfère l’énonciateur. Le on est plus riche encore. Il est tantôt inclusif et ressemble alors au nous. Il renvoie à l’identité collective (la famille, le groupe élargi, la communauté nationale). Il est tantôt exclusif et il devient intéressant de savoir à quels autres fait ainsi référence le locuteur. L’utilisation du temps de conjugaison est aussi intéressant à étudier. Il permet de situer temporellement mais aussi dans l’espace le locuteur par rapport au moment d’énonciation. Nous distinguons le présent, moment de l’énonciation, mais aussi le temps de la description, souvent subjective, le passé, et le futur, temps dans lequel le sujet projette son avenir, dans notre cas l’acte migratoire. Nous avons également été attentifs aux catégories de verbes utilisés en fonction des temps de conjugaison. Savoir s’il s’agit de verbes d’état (identité), de verbes d’action, simple, factitif et de mouvement et ceci quels que soient les actants concernés. Nous avons aussi repéré de la même manière les énoncés perlocutoires et illocutoires. Tout cela nous a permis de prendre du recul par rapport au discours, d’effectuer une rupture nécessaire à l’analyse de nos entretiens et de mieux appréhender la dynamique inter-relationnelle entre l’individu et son groupe tel que nous prévoyons de le faire dans notre analyse.
104 Attention à ne pas confondre cette notion linguistique de subjectivité, ou de sujet parlant, et les notions philosophiques ou psychologiques de sujet.
53
6.2 La phase de saturation
L’exploitation de toutes nos données qualitatives extraites de notre corpus d’entretien se poursuit jusqu’à ce qu’on appelle la « phase de saturation. » Le principe en lui-même n’est pas objectif. Il doit être argumenté. C’est encore à J.- Cl. KAUFMANN que je laisse la parole pour nous expliquer le processus de saturation :
« Parmi, les hypothèses qui au début émergent en tout sens, se forme assez rapidement un groupe plus stable ( généralement lié à la question de départ). A partir de ce noyau, la saturation évolue ensuite par des cercles concentriques : autour du centre de plus en plus dur, de nouvelles hypothèses sont agrégées et progressivement stabilisées : la clarification du modèle gagne en étendue. Elle permet d’affiner et de fixer la grille de lecture.105 »
105 KAUFMANN J.- CL. (2003), Op. Cit., p. 103.
54
III – ANALYSE DES ENTRETIENS
1 - L’émigration estudiantine : Une complicité fami liale Revenons tout d’abord à notre questionnement initial. Comment se forme le projet migratoire ? Et plus exactement dans notre étude : Quelle est, chez l’étudiant kabyle, la genèse du projet de départ ? Cette question sous-entend un processus. Le projet d’émigration ne naît pas spontanément d’un néant mais dans un cadre social. Dans ce cadre naît tout d’abord une idée, l’idée de départ. On peut alors se poser la question de sa naissance106. Cette idée, une fois en germination, a besoin pour vivre qu’on s’en occupe et de façon continue. Comme elle ne naît pas par hasard, elle ne peut pas non plus aboutir « naturellement » à la réalisation du projet auquel elle a donné la vie. Pour se réaliser, le projet nécessite des investissements et des opérations comme toute production. Encore doit-elle trouver un débouché. Mettons de côté pour l’instant la part arbitraire de sa réussite. Un projet comprend toujours une part conditionnelle incontrôlable.
1.1 L’émigration érigée en tradition
Quand on étudie l’émigration algérienne – et ce doit être valable pour d’autres mouvements migratoires - il faut sans cesse se rappeler qu’elle a une histoire. Sans revenir sur le développement de notre exposé au début de ce mémoire, rappelons la position particulière de la Kabylie dans l’émigration algérienne. La Kabylie fut l’objet d’une politique spéciale, d’un investissement particulier de l’administration coloniale107. Elle a connu « l’œuvre missionnaire de la France », une francisation forcée par l’établissement des premières écoles à destinations des « indigènes » et la formation des premiers instituteurs algériens. Alors qu’elle était la région la moins colonisée « physiquement 108», elle a subit, du fait des investissements symboliques dont elle a fait l’objet, la plus grande influence culturelle de la France. C’est tout « naturellement » de Kabylie que partirent les premiers émigrés vers la métropole. L’émigration participe aujourd’hui encore à la pérennisation du « mythe kabyle. » Le départ des « pionniers » date du début du vingtième siècle et le phénomène s’est accru de façon régulière sans quasiment aucune interruption, prenant des formes différentes au gré des péripéties de l’histoire, des relations entre la France et l’Algérie. Depuis un siècle, chaque année, des algériens de Kabylie partent pour la France. Il est couramment admis, que ce soit du côté des scientifiques ou par les habitants de cette région, que pas un village, pas une famille (ou presque) n’a eu par le passé ou n’a actuellement un émigré en France. Depuis un siècle, l’émigration s’est érigée en tradition109. Dans chaque famille, on compte et on conte un grand-père, un père, un frère, un oncle ou un cousin qui a connu ou connaît l’émigration. Le poids de l’histoire varie et dépend, selon les familles, de la « densité » de ses membres dans l’immigration. La narration du départ pour la quête d’un travail s’accordait d’abord au masculin mais elle connaît depuis quelques années, notamment avec l’émigration étudiante, une féminisation plus importante. La tradition évolue, suivant les formes de l’émigration. A
106 « Le départ vers la France n’est pas le début du processus migratoire, l’idée d’émigrer est souvent bien antérieur au projet de départ lui-même. » Cf. MALIKA C., SPINOUSA N. (1997), « Parcours d’adaptation des Algériens : Des dispositions aux acquisitions », in Migrations Etudes, n° 75, septembre. 107 Notons au passage toute la contradiction de la colonisation qui d’un côté prônait les « valeurs universelles » de la France mais pour qui ses valeurs s’appliquaient selon deux poids deux mesures. 108 La colonisation foncière concernait essentiellement les plaines, minoritaires dans ce paysage de montagne. 109 J’entends ici par tradition le terme venant du latin traditio, de tradere, c'est-à-dire « remettre, transmettre » : Information, plus ou moins légendaire, relative au passé, transmise d'abord oralement de génération en génération, mais aussi : Manière de penser, de faire ou d'agir, qui est un héritage du passé (Le Petit Robert 2001).
55
l’émigration de travail a succédé l’émigration pour études. Ce dernier modèle initié par l’Etat algérien, à travers les étudiants boursiers, s’est lui aussi érigé en une déjà longue tradition. Mais aujourd’hui l’Etat algérien n’est plus celui qui envoyait en formation les cadres dont il avait besoin. L’arabisation notamment est passée par-là. De son côté l’Europe dont fait partie la France ferme ses portes110. Les conditions de départ n’existent plus comme avant mais pourtant le projet reste. L’émigration – immigration nous pose la notion d’héritage tacite111, d’un substrat qui travaille la société sans même s’en rendre compte. Cet héritage s’est fait à deux niveaux : à un niveau macro-sociologique de par l’histoire des relations entre la France et l’Algérie, et à un niveau microsociologique de par les histoires familiales. Le substrat dont nous parlons s’est aussi constitué transversalement et possède un double aspect, matériel et mémoriel. Il est matériel par ses traces objectives. C’est par exemple la grande maison moderne construite avec l’argent gagné en France ou bien l’aisance de l’émigré à la retraite qui est rentré au pays. Il est aussi mémoriel par les expériences réalisées, le rôle des modèles et l’exemple des réussites possibles. Ce double aspect, matériel et mémoriel, engendre toute une dimension cognitive de l’émigration (informations pratiques, connaissance des réseaux, …) qui contribue (avec d’autres éléments de la société algérienne) à l’élaboration d’un volume mental112 où la France est totalement intégrée. Cet univers mental et du coup social engendre en quelque sorte chez l’Algérien comme un « droit » ou un « passe-droit légal » vis-à-vis de la France. Ce substrat engendre encore la conservation de l’espoir, la croyance en la possibilité de l’élection telle que l’a expliquée M. WEBER113 : Comment peut-on produire à soi-même les signes d’une probable élection ? On comprend toute l’importance des prédécesseurs. Tous les étudiants interviewés ont ou ont eu avec la France une relation via les membres de leur famille plus ou moins proches sinon des amis. Nous pouvons décliner cette relation selon le degré de proximité personnelle qu’ils ont avec ces personnes, selon l’éloignement temporelle et la durée, mais également si la relation est active ou passive (des retours plus ou moins fréquents, des communications téléphoniques, etc.). Nous pouvons ainsi distinguer une double catégorisation indigène du rapport à l’émigration préexistant et conditionnant le projet migratoire. La première catégorisation tient compte de la présence effective ou non dans l’immigration des membres de la famille au sens large. Nous distinguons :
- Les personnes n’ayant jamais émigré, - Celles ayant émigré mais qui sont revenues au pays, pour y passer leur retraite par
exemple, - Les personnes résidant actuellement en France, dans laquelle on peut encore distinguer
ceux ayant acquis la nationalité française de ceux qui ne l’ont pas – mais cette dernière distinction n’est que rarement évoquée par les interviewés.
La deuxième catégorisation fait appel aux structures de la parenté traditionnelle. Dans un premier niveau, il existe une primauté du rameau familial installé en France par rapport à celui qui est resté au pays. Un deuxième niveau distingue les étudiants dont les parents, père ou mère, mais aussi les membres de la fratrie ont vécu un temps (ou vivent encore) en France. Le troisième niveau est atteint quand l’étudiant a lui-même vécu en France, dans son enfance ou pour un séjour (vacances, stage, visite).
110 La décision de fermeture, qu’elle soit européenne ou étatique, n’est pas suivie à la lettre par toutes les institutions qui en dépendent. L’autonomie des universités correspond à une autonomie des recrutements. C’est parfois pour elle le seul moyen de remplir certaines filières… 111 Tacite : du latin tacitus, de tacere « se taire », non exprimé, sous-entendu entre plusieurs personnes (Le Petit Robert 2001). 112 MAUSS M. (1999), Sociologie et anthropologie, 8ème édition., Paris, PUF/Quadrige, 482 p. 113 WEBER M. (1964), L’éthique protestante et l’esprit du capitalisme, Plon, Coll. Pocket, Paris.
56
Nous pouvons tenter d’esquisser selon le degré de légitimité l’ordre dans lequel sont cités ces membres. Dans un ordre croissant, viennent tout d’abord les membres féminins telles que les cousines et les tantes, ensuite apparaissent les cousins et les oncles114, puis le grand-père (cité parfois pour l’histoire car il n’est souvent plus là-bas, c'est-à-dire de retour au pays ou bien décédé), le père, la fratrie et enfin de compte soi-même. Nous verrons plus loin que, lorsqu’il s’agit notamment d’étudier l’économie de la migration, cette classification n’a plus guère d’importance, puisque c’est d’utilité et d’efficacité dont il s’agira alors. Nous avions pu déjà remarquer les déstructurations opérées par la colonisation, les déplacements de population durant la guerre d’indépendance, les premiers âges de l’émigration et l’urbanisation croissante. Avec l’immigration, les règles de la parenté qui régissaient les relations familiales par le passé volent en éclats. Elle redéfinit les liens et la hiérarchie de la parenté. On voit par exemple que l’oncle maternel devient plus proche que l’oncle paternel. Nous observons ainsi la primauté de la famille installée en France. Nous pouvons d’autre part, dans le cas où l’étudiant est déjà allé en France et a donc été son propre prédécesseur, percevoir une détermination accrue qui tient de la revendication, n’évoquant pas seulement un héritage, mais invoquant une connaissance pratique et directe du pays et par-là une légitimité accrue, un peu comme si, y étant déjà allé, il était déjà émigré – se déclarant parfois même plus proche de la France que de l’Algérie. Il a tellement investi dans les relations, les réseaux, la culture, la langue, la politique, tellement épousé son projet qu’il ne lui manque plus que l’émigration pour être en France, pour devenir Français.
1.2 Les prédécesseurs : « Y’a pas une famille qui n’a pas un membre en France. Généralement c’est l’aîné ou un père ou, je sais pas, y’a toujours quelqu’un en France. »
L’étudiant a toujours des proches, de la famille sinon des amis actuellement en France. C’est un constat qui concerne l’ensemble des interviewés. La présence de membres de la famille en France se concrétise par des liens avec ceux qui sont restés en Algérie – rappelons que les réflexions qui vont suivre restent grosso modo valables pour tous les pays d’immigration, donc dans le cas de notre étude, le Canada, la dimension coloniale en moins. Nous observons effectivement la pérennité d’un inconscient colonial lorsque les étudiants se pensent du point de vue de l’extérieur, du point de vue colonial, plus exactement celui du colonisé chez le colonisateur. Akel nous annonce dès le début de son entretien que « toute » sa famille est en France. Elle définit ces prédécesseurs nombreux et proches d’elle. Elle relate aussi le fait qu’elle ait été élevée en France et les nombreux contacts qu’elle y a pendant longtemps entretenus. Elle se situe historiquement, géographiquement et culturellement d’emblée par rapport à la France. Elle fait référence notamment aux « vacances de Noël » – appellation française incontrôlée - qu’elle allait passer en France.
« Toute ma famille est en France, mes grands-parents, mes tantes, donc euh, moi-même j’ai été élevée en France, quand j’ai été bébé. Je suis partie à 6 mois et je suis revenue à 5 ans et demi. Donc euh, quand c’était facile de partir en France, chaque année on allait en vacances, presque chaque année, avant le visa, quand c’était le passeport. »
114 L’émigration est avant tout masculine.
57
1.2.1 La primauté de la famille installée en France Le degré de parenté importe peu ; il peut s’agir du côté maternel comme paternel selon les alliances contractées. La branche familiale établie en France prime dans le discours de l’individu par rapport à celle restée en Algérie. Quand Akel parle de « toute » la famille, il s’agit en fait de la branche de la grand-mère maternelle, celle dont elle se sent plus proche alors qu’elle est en France. Elle ne fait pas référence à la famille maternelle particulièrement mais à la partie de sa famille qui réside en France. La branche familiale établie en France prime dans le discours de l’individu par rapport à celle restée en Algérie. Akel explique aussi cette proximité du fait qu’elle a été élevée par sa grand-mère maternelle en France.
« Tu dis « Toute la famille », c’est-à-dire du côté de la mère… ? Maternelle. Maternelle. Parce qu’on est plus proche de notre famille maternelle. » « Donc, moi, c’est plutôt ma grand-mère maternelle qui m’a élevée. Donc c’est ça, on est très proche de notre famille maternelle. »
A cette branche maternelle, elle oppose la branche paternelle qui est en Algérie. Elle opère ainsi une distinction entre la famille française et la famille algérienne, et ce faisant elle effectue une distanciation en se plaçant implicitement dans le groupe résidant déjà en France
« Parce qu’on est plus proche de notre famille maternelle. Notre famille paternelle, on n’est pas vraiment très très proche. » « Et pourtant mon père, c’est le cousin à ma mère. Ma grand-mère paternelle, ma grand-mère maternelle, c’est des sœurs. »
Nous aboutissons à la même constatation avec Ferhat : la primauté de ceux qui sont en France. Il distingue ceux qui sont en France (l’oncle et le frère) et celui (le père) qui est revenu au pays. Ceux qui sont actuellement présent en France représentent pour Ferhat une invitation. Ce n’est pas sans nous rappeler la vision idéalisée de l’émigration auquel faisait allusion Mohand dans l’article de A. SAYAD « El Ghorba115 ». Ferhat cite en premier son oncle qui est en France et qui semble avoir compter dans la détermination de son projet.
« Cette idée, en fait, c’est un oncle qui a déjà été en France qui m’a vraiment orienté vers ça. Il m’a conseillé aussi de faire Licence de Français pour justement, pouvoir arriver, continuer les études en France. »
En résumé, avec la primauté de la famille installée en France, c’est toutes les règles traditionnelles de la parenté qui sont remises en cause. L’émigration-immigration bouleverse les structures établies sans en donner de nouvelles.
1.2.2 L’immigration comme appel
« En fait, tout le temps, il me parlait de son aventure » Ceux qui n’ont pas eu l’occasion d’« expérimenter » personnellement la France, se réfèrent à l’expérience des autres qu’ils érigent en modèle. L’intérêt et le désir de réussir leur projet les amènent à ce que nous pourrions appeler une imitation116. Pour Ferhat par exemple,
115 SAYAD A. (1975), « ELGHORBA : Les mécanismes de reproduction de l’émigration », Actes de la recherches en sciences sociales, n° 2, pp. 50-66. 116 Terme initié en sociologie par Gabriel TARDE, dont nous conserverons l’utilisation commune. Cf. DURKHEIM E. (1997), Le suicide, P.U.F., Coll. Quadrige, Paris.
58
l’expérience de son oncle apparaît sous le jour de l’aventure et de la découverte. Elle rend à certains égards possible et plausible le départ. Celui-ci l’invite en quelque sorte à le suivre comme on le faisait dans les deux premiers âges de l’émigration algérienne117.
« En fait, il a été en France en 1991. Il a eu son Bac en 1989. Il a fait les démarches, visa d’études. Il a été là-bas. Et puis, il a passé une année. Pour des raisons financières et tout ça, il est revenu. Puis il a fait Licence de Droit. Ici ? Oui. Il a terminé puis il est reparti en France en 2001. En fait, tout le temps, il me parlait de son aventure. »
« Tu n’as rien à faire en Algérie ! » C’est encore sur le mode de l’incitation que les frères de Tazrut vivant à Paris interpellent leur sœur.
« Bien sûr Paris, parce que les universités qui m’intéressent le plus c’est Paris. Parce qu’il y a mes frères qui sont à Paris. Et c’est eux d’ailleurs, ils m’envoient, ils m’ont encouragée vraiment à venir. Et c’est eux qui m’ont dit : « viens, tu viens. Qu’est-ce que tu fais, qu’est-ce que tu fais en Algérie ? Tu n’as rien à faire et puis »… Ils me disent : « Tu n’as rien à faire en Algérie ! ». Je suis bien ici en Algérie. J’ai tout ce qui faut. Je suis bien. Rien ne me manque et… »
« Et tous mes frères sont à l’étranger, sauf deux. Mes six frères sont à l’étranger. » Avec Saïda, c’est toute l’importance de la fratrie qui nous est contée. Son grand-père paternel a émigré et est revenu au pays. Son père n’a pas émigré mais c’est la majorité des ses enfants qui sont partis, ses fils plus exactement.
« Donc, il faut savoir aussi que j’ai une famille nombreuse. J’ai huit frères et trois sœurs. Et tous mes frères sont à l’étranger, sauf deux. Mes six frères (rire) sont à l’étranger. Donc euh, j’ai trois frères au Canada, deux frères en France, et un en Allemagne. Et prochainement peut-être un autre Canada. (Rires) »
Trois d’entre eux ne comptent probablement ne pas rentrer au pays. Ils se sont mariés avec des femmes d’une autre nationalité. Il faut replacer ce modèle de mariage en rapport avec les autres modèles présents dans l’émigration algérienne. Les kabyles, principaux représentants de l’émigration en France, se marient d’abord avec une Kabyle, quelqu’un de semblable, ou bien tout à l’opposé avec une française « de souche », car le lointain les rapprochent de leur projet d’installation. Ce n’est qu’en dernière instance qu’il épouseront une Algérienne sinon une musulmane. Nous avons à faire ici à un écart radical vis-à-vis du pays d’origine et cette radicalisation fait référence, sert de modèle. De plus, la multiplicité des exemples de « réussite » existants et proches augmente la probabilité qu’elle a de partir à son tour.
« Mes frères, ils ont tous, non pas tous, bon, attendez parce que, faudrait me rappeler, Bon celui qui est en Allemagne a épousé une Allemande. » « Donc le deuxième, après l’aîné, euh, donc lui aussi, il est en France, il a épousé une française, d’origine libanaise, chrétienne. » « L’autre, il est en France. Il a épousé une finlandaise. »
Le projet migratoire unit la famille dans sa dispersion à travers l’étranger, entre ceux qui sont partis et ceux qui sont restés ou plutôt qui ne sont pas encore partis. Même la façon qu’ont Saïda et Tazrut de parler de leurs frères et sœurs est traversée par l’impact des départs.
117 SAYAD A. (1975), Op. Cit.
59
Mais c’est peut-être l’expérience d’une de ses sœurs qui est la plus significative puisqu’elle est allée en France et ne souhaite plus qu’y retourner. Elle y a séjourné deux ans et y est retournée sans pouvoir se décider à s’installer semble-t-il. Elle est maintenant rentrée au pays et vit très mal son retour. On devine l’implicite dans le discours de Saïda. L’histoire de sa sœur vient argumenter concrètement ses « bonnes » raisons de partir. Nous le verrons plus loin, en tentant de nous persuader, elle se persuade118 aussi de la seule voie possible pour son avenir.
« Euh, mes sœurs sont ici. Donc, j’ai les deux aînées enseignantes et une autre qui a fait du secrétariat. Elle a travaillé dans, dans le domaine de la justice, au tribunal. Donc, elle aussi elle a eu cette puce-là vers l’étranger, donc elle a pu avoir un visa touristique, donc euh, vers la France. Elle était partie, elle est restée deux ans. Donc, elle est soi-disant dans une situation irrégulière, entre guillemets, bon. Elle avait grillé son visa mais elle avait postulé pour, elle avait formulé un dossier d’asile euh et tout, donc qu’on lui a refusé. Le problème c’est que avant qu’elle ne parte, elle avait demandé une mise en disponibilité du travail. On lui a refusé. Ce qui fait qu’elle avait perdu son emploi. En Algérie ? En Algérie, oui. Donc elle est partie en France, elle est restée deux ans. Après deux ans, elle est rentrée. Et voilà, je peux dire qu’elle est devenue folle. Ah ouais. Elle ne supporte plus. Elle ne supporte plus. Elle a essayé de, de repartir. On lui a refusé. Donc, elle est partie vers l’Allemagne. Elle est encore rentrée. Elle est revenue en Algérie. Elle est encore ressortie vers la France. Et encore rentrée. »
Le grand-père paternel de Layla a fait venir son fils en France alors qu’il avait dix ans. Ce dernier y est resté jusqu’à terminale. C’est de toute « l’éducation française » que le père de Layla dispense aujourd’hui à sa fille que vient sa légitimité à partir. Ce n’est plus seulement ici la présence de membres de la famille en France qui importe, c’est la présence de la France en Algérie à travers ses parents proches.
« J’ai appris le français plus que le kabyle durant les premières années où je commençais à parler » La dimension cognitive la plus clairement perceptible de l’émigration commence sans doute par le fait linguistique. La prééminence de la langue française, se retrouve dans de nombreux entretiens. Elle fait aussi bien la conséquence d’un long séjour que d’un choix affirmé de la part de ses parents. Citons Layla :
« En fait mes parents et spécialement mon père revenait juste de France lorsqu’il s’est marié avec ma mère. Donc j’étais très influencée par mon père, il parlait souvent français. J’ai appris le français plus que le kabyle durant les premières années où je commençais à parler. »
Akel insiste bien sur le fait que sa mère est de « culture » française et que c’est cette culture qu’elle lui a transmise. Elle s’exprime ici en terme de culture, de mentalité, et de langue
« Parce que, de toute manière, parce que chez nous, on a été élevé d’une manière, à la maison par exemple, on n’a pas la, on n’a pas été élevé dans une culture, je veux dire
118 On repère ici la dimension perlocutoire de son discours. Cf. AUSTIN J. L. (1970), Quand dire, c’est faire, Ed. du Seuil, Paris.
60
strictement algérienne, on n’a pas, on n’a pas cette mentalité, d’ailleurs chez nous, ma mère ne parle pas le kabyle, ne parle pas l’arabe… » « Elle parle que le français. D’ailleurs on croit que c’est une française. Avant c’était tout le monde qui pensait que ma mère était française. »
Ce que nous avions constaté à propos de la primauté du rameau familial présent dans l’immigration est valable jusqu’au sein de la cellule familiale. Akel se place d’emblée du côté de sa mère, c'est-à-dire du côté de la France par rapport à son père qu’elle place du côté de l’Algérie. Elle parle de la France en terme de proximité et de l’Algérie en termes de distance.
« Elle parle que le français donc. Elle parle ni Kabyle ni l’arabe. Bon, mon père bien sûr parle kabyle, parle arabe. Donc on a été élevé à peu près, on a une éducation, moi en France je me sens bien, j’ai l’impression que c’est mon pays ; par rapport en Algérie. Ici, je suis un peu, j’ai l’impression que, je suis pas dans mon élément vraiment, les traditions tout ça, chez nous on n’a pas tout ça. » « Non parce que des fois mon père a tendance à me dire, nous rappeler qu’on est toujours en Algérie, qu’on n’est pas en France. D’ailleurs c’est ça le conflit à la maison avec ma mère. On n’est pas en France, on est en Algérie. »
Le lien avec la France est entretenu par les visites de la famille dans les deux sens, de part et d’autre de la Méditerranée, c'est-à-dire de ceux qui résident en France vers le village d’origine en Algérie et de ceux qui sont restés au pays vers les membres de la famille installés en France. Les parents de Saïda, bien qu’ils n’aient jamais émigré, ont ainsi une idée plus précise, une connaissance par l’expérience, de ce qu’est la France.
« Qu’est-ce qu’en pensent tes parents (de son projet), enfin qu’est-ce qu’ils disent ? Mes parents ? C’est-à-dire que j’ai des parents qui ne sont pas instruits mais assez tolérants quand même et compréhensifs. Et puis, les histoires de départs, ils se sont habitués avec mes frères. D’accord. Ils se disent : « une de plus qui part, c’est, c’est… » Mais ils les voient souvent leurs enfants ? Ils, ils partent les voir. Ah, ils vont les voir. Ah d’accord. Ils sont partis en France, au Canada pas encore. Il fait quoi ton père ? Il est retraité. Il a 87 ans. »
« Moi-même j’ai été élevé en France, quand j’ai été bébé » C’est la déclaration qu’Akel fait au tout début de son entretien. Elle révèle de ce fait qu’elle a déjà connu l’émigration, qu’il y a eu un antécédent. Que trouver comme meilleur argument ? Akel se distingue par sa légitimité au départ puisque c’est une expérience qu’elle a déjà vécue.
« Toute ma famille est en France, mes grands-parents, mes tantes, donc euh, moi-même j’ai été élevé en France, quand j’ai été bébé. Je suis parti à 6 mois et je suis revenue à 5 ans et demi. »
A l’instar d’Akel, Tazrut est déjà allée en France et a une connaissance pratique du pays. C’est le cas aussi d’une partie des membres de sa famille.
« Bon on est presque allé tous en France. J’ai déjà été en Allemagne, France, Allemagne. Y’a mes parents qui sont, bon presque, toute ma famille elle est partie en
61
Allemagne, en France. Euh, ma mère, elle y va souvent. Mes frères, ils sont en France. Ils viennent mes frères, c’est deux trois fois par an. Et puis mes oncles. Il y a pas de problème. Mon père, il est retraité. Ma mère, elle ne travaille pas. Quoi encore ? Ton père, il a travaillé en France ? Oui, il a déjà travaillé en France, mais pour quelques deux ans je crois. Pas trop. Non, non. Ensuite, il est revenu ici. »
C’est aussi le cas de Saïda. Elle a pu à deux reprises faire connaissance avec l’étranger, avec la France. Elle a fait un premier voyage dans son enfance et un deuxième qu’elle relate avec beaucoup de précision. C’est ainsi qu’elle a pu faire de premiers pas sur le chemin de l’émigration. Elle relate son expérience de la France et de l’Allemagne, la connaissance pratique qu’elle y a acquise.
« Donc j’étais partie en Allemagne, voilà. C’était un visa touristique. Euh plutôt un voyage assez touristique. C’était pour du tourisme. Je me suis déplacée en France, pour une dizaine de jours aussi. J’ai eu l’occasion de voir mes amis qui sont en partie d’ici d’ailleurs. Et voilà. A un moment donné, l’idée de griller, de rester m’avait traversée. Griller ? De griller, on dit griller oui. […] L’idée de griller mon visa m’était passer dans la tête et, mais… j’ai vu que c’était difficile aussi. J’ai vu de mes propres yeux que c’était difficile. Le temps passe vite et il fallait. J’avais vu, j’avais goûté au rythme de vie quand même. Je vis le rythme quotidien de mes frères aussi, donc j’ai pu m’imprégner un petit peu de… C’était pas en vacances. Eux, ils travaillaient. Exactement. Exactement, d’ailleurs je n’avais pas le temps de les voir, ou de sortir avec eux, par exemple. Donc à la dernière minute, je me suis ressaisis, je me suis dit, c’est pas, y’a pas le feu donc, je suis encore jeune donc je devrais repartir et essayer de postuler pour un visa d’études. Donc je suis rentrée et, il m’a été un petit peu, bon, je suis restée un peu plus d’un mois, donc c’était un petit peu difficile de reprendre mes petites habitudes par ici. Et j’avais tendance à comparer les choses et c’est quelques choses d’un petit peu… C’était un petit peu délicat. Voilà. »
1.2.3 Un silence sociologique En parlant des prédécesseurs, nous utilisons les termes d’héritage, de modèle, d’exemple, d’imitation, d’appel, d’incitation, de connaissance – autant de passerelles entre les anciens et les futurs émigrés. Les prédécesseurs sont rendus présent ici dans le discours et là-bas en France. L’expérience retenue est globalement positive même s’il ressort quelques nuances. L’individu se rapproche d’eux et les rend proches, comme si leur proximité entretenant l’espoir, augmentait la possibilité de réaliser le projet migratoire. En s’identifiant à leurs prédécesseurs, ils produisent à eux-même les signes d’une probable élection. Mais tout n’est pas transmis car tout n’est donc pas rose dans l’immigration. Ses aspects négatifs sont tus. C’est le cas d’anciens immigrés, souvent retraités, de ceux qui ont expérimenté et qui, ayant terminé leur émigration, sont revenus. Ils n’encouragent pas au départ, ils se taisent. C’est le cas du père de Ferhat qui, à l’inverse de son oncle, en est revenu, au propre comme au figuré119. Il a vécu 40 ans en France. C’est une période dont il ne parle pas ; 40 ans
119 « Un homme qui se souvient seul de ce dont les autres ne se souviennent pas ressemble à quelqu’un qui voit ce que les autres ne voient pas. C’est à certains égards, un halluciné, qui impressionne désagréablement ceux qui l’entourent. » Cf. HALBWACHS M. (1994), Les cadres sociaux de la mémoire, éd. Albin Michel, Paris.
62
d’existence sur lesquelles il n’a rien à dire. Nous voulons bien croire qu’il appartienne à une génération peu loquace mais si son expérience avait eu quelque aspect dont il eut pu être fier, il en aurait au moins dévoilé des bribes. Son silence peut-il être interprété comme une désapprobation ? Toute la société pousse à l’émigration. De sa mauvaise expérience, tout le monde dit que c’est une bonne expérience. Qui l’écouterait ? C’est un homme en rupture. Il ne peut plus rien dire et son silence n’est pas lui non plus sans participer à la reproduction de l’émigration.. En tout cas, son témoignage silencieux diffère de ce que l’on pouvait entendre dans « El ghorba » : « Les gens n’ont que la France à la bouche.120 ».
« Ah ! Ton père, il est parti en France. Tu peux me parler de, il parle un petit peu de son expérience ? Pas, tu sais, mon père est pas vraiment, parce que, vraiment on se connaît pas trop. Donc, il est parti là-bas. Au bout d’une année, il vient pendant les vacances et tout ça, mais y’a pas eu de complicité donc euh… Tu parles pas beaucoup avec ton père. Pas vraiment, parce que surtout son expérience en France, donc euh, je sais pas, même lui, il refuse de parler. […] Il est resté combien de temps là-bas ? Au moins 40 ans. »
Nous notons ainsi une contradiction entre le projet migratoire annoncé par les étudiants et les exemples de prédécesseurs qu’ils citent : Ils ne sont pas universitaires en France, et quand ils l’ont été, ils n’ont pas continué l’investissement de leurs diplômes algériens. Ils sont partis diplômés d’Algérie et font maintenant tout autre chose en France. Le niveau scolaire est globalement faible que ce soit au niveau de la langue, du savoir, de la formation. La valeur du diplôme est nulle même sur le marché algérien et ils le savent. Ils ont une connaissance suffisamment objective de la France pour savoir que le niveau y ai plus fort. Ils savent aussi que les conditions de vie pour un étudiant sont difficiles et que peu y arrivent. Ils citent eux même des exemples qui jouent pourtant le rôle de modèles de réussites possibles. Malgré cette contradiction, le projet persiste. Comment peuvent-ils y croire ? Comment peuvent-ils penser ce qu’ils disent ? Disent-ils vraiment ce qu’ils pensent ? Cette situation nous rappelle étrangement ce que disait A. SAYAD dans « El Ghorba121 ».Ce qui fait cette idée de départ, c’est une illusion, l’illusion de l’émigré et du mensonge à soi-même, comme s’il s’agissait de vendre à soi-même ce projet-là. Mais l’illusion n’est pas le seul fait du candidat au départ. Elle est collectivement produite et collectivement entretenue. Il faut plusieurs complicités, plusieurs illusions, plusieurs mensonges pour que se produise le projet puis l’acte véritable d’émigration. Il y a tout d’abord une tradition d’émigration. Dès le Bac, l’étudiant fait le choix initial de la filière122 qui n’est en fait qu’une filière d’émigration,. Il accumule ensuite, dans tous les sens économiques du terme, les relations, les réseaux. Sa scolarité universitaire est investit inconsciemment, quotidiennement par le futur projet d’émigrer (investir la langue française, la culture, la politique, se franciser en fait). Les parents sont également complices, comme nous le verrons plus loin, quand ils entreprennent de soutenir le projet d’études alors qu’ils soutiennent avant tout le projet migratoire et ce faisant rentrent dans l’illusion de l’étudiant. Il faut aussi compter avec la complicité du pays d’accueil : la délivrance arbitraire des visas au Consulat de France, l’inscription dans les universités, etc., contribuant à l’incertitude du projet migratoire et entretenant donc l’espoir d’un ailleurs.
120 SAYAD A. (1975), Op. Cit. 121 SAYAD A. (1975), Op. Cit. 122 Le français en est l’exemple patent.
63
Devant la variété des situations, nous sommes en droit de nous poser la question de ceux qui ne souhaitent pas partir123 et qui pourtant disposent de conditions objectives pour le faire. Cette question nous aiderait à comprendre quels sont, à partir d’un même cadre social a priori, les éléments déclencheurs aboutissant à la formulation du projet migratoire. Ce pourrait être l’objet d’une autre enquête.
1.3 Par-delà le bien et le mal : L’Algérie versus la France
Comment se forme le projet migratoire chez l’étudiant ? Nous venons d’appréhender le substrat riche et fertile sur lequel pouvait germer l’idée du projet migratoire ? Le processus n’apparaît pas pour l’instant de façon clair mais nous pouvons en distinguer aisément des signes. Ces signes se manifestent notamment124 dans le discours des interviewés à travers un lexique aussi bien substantif, qualificatif que verbal. Vus sous cet angle, tous les entretiens se déroulent selon un registre comparatif, une comparaison souvent implicite entre la France et l’Algérie. Il s’agit d’une catégorisation indigène qui opère une qualification-déqualification : Ce qui est positif d’un côté, de l’ordre du mélioratif, tout au moins de l’ordre de ce qui devrait se faire, d’une idée de la normalité : c’est la référence faite à la France ; Ce qui est négatif de l’autre côté, de l’ordre du péjoratif, de ce qui est intenable, insupportable, intolérable : c’est la référence faite à l’Algérie. C’est aussi une division de l’espace, une comparaison entre ici en Algérie et là-bas en France, et du temps entre maintenant avant l’émigration et l’avenir, au mieux bientôt dans l’immigration. Il s’agit d’un véritable clivage spatial et temporel. L’émigration est un jeu de langage à double face. Elle se conjugue entre le présent de l’élaboration du projet et le futur de sa réalisation. Cette conjugaison de l’émigré nécessite une double référence. Elle préfigure aussi la double contrainte de l’immigré, sa double absence qui est dans le même temps une double présence. Nous avons en quelque sorte affaire, avec l’émigration, à une structure cognitive comportant une valence différentielle de l’espace et du temps alimentée par des référentiels très précis sur ce qui se rapporte tantôt à la France et tantôt à l’Algérie. Tous ces signes, ces manifestations lisibles dans le lexique des discours ne surgissent pas spontanément. Issus du substrat, ils retournent l’alimenter par les personnes-mêmes qui s’en sont saisis. Réinjectés en permanence dans le langage, ils contribuent à la formation de la structure mentale et cognitive des Algériens. Mais à notre avis, il ne s’agit plus d’un lexique traduisant une relation d’opposition, lecture structuraliste de la société traditionnelle comme nous pouvions le lire chez A. SAYAD125, mais bien plutôt d’une dimension cognitive plus rationnelle parce qu’issue de connaissances globalement plus objectives permettant ce registre comparatif, ces opérations de qualification–déqualification.
1.3.1 L’Algérie : une limitation espace-temps L’Algérie est globalement considérée par les étudiants comme un espace de limitation en opposition à la France comme espace d’ouverture mais aussi dans une moindre mesure en opposition au reste du monde. Cette ouverture n’est semble-t-il pas envisageable en Algérie sauf à travers cette fenêtre sur l’extérieur que sont les d’études. Leur poursuite à l’étranger n’est essentiellement envisagée que vers la France et par la France. Cela commence par le
123 Il y en a certainement et reconnaissons que c’est une dimension qui manque à notre étude. 124 Une observation ethnographique approfondie, que ce soit dans la vie quotidienne ou dans ses institutions, nous montrerait combien à quel point l’Algérie, même si elle n’y est plus tenue, est encore attachée à la France. 125 SAYAD A. (1975), Op. Cit.
64
choix de la filière, la Licence de Français par exemple, qui donne accès à la littérature, mais pas n’importe laquelle, pas l’arabe, pas la kabyle, mais la française. Ecoutons Ferhat :
« La licence de Français, c’est effectivement, en étudiant la littérature, ça permet d’ouvrir l’esprit des gens et tout ça donc pouvoir, justement pouvoir s’intégrer facilement en France. D’accord, une ouverture vers la France. Effectivement, même un espace d’ouverture ici même en Algérie. »
L’espace de limitation s’exprime par le manque, l’étroitesse de l’horizon, l’étouffement voire la misère. Cette limitation est tantôt matérielle tantôt le fait de la société. Ecoutons ici Ferhat et Saïda :
« Vous avez parlé en fait de loisirs, donc euh. Qu’est-ce qu’on fait en dehors de l’université ? Pratiquement, y’a rien du tout. Y’a, y’a l’Internet. Pratiquement y’a ça. Y’a pas, y’a manque d’associations, y’a même pas de salle de cinéma, y’a même pas de, donc euh. Ici, on a l’impression, on est étouffé donc,… »
« Des fois on a beau être bien avec la personne, avec notre partenaire mais y’a toujours des tierces personnes…, bon je sais que c’est humain des fois la jalousie mais là c’est un peu plus spécial. C’est toute une société qui est dernière nous, c’est la conscience, c’est la famille, c’est le bon Dieu, c’est la religion, et ainsi de suite. »
Cet horizon du possible est clairement orienté vers la France, horizon au-delà duquel il n’y aura pour eux plus aucune limitation. C’est l’espace qu’il se donne pour pouvoir réaliser tous leurs projets. Ecoutons Akel :
« Ah oui. Moi, dès que j’arrive en France, je, je vais pas dormir je pense. (Rires) En France, je vais gratter tout, je voudrais faire quelque, vraiment je voudrais, je voudrais réussir franchement. Voilà. Parce que je sais j’ai des capacités, je peux faire des choses. »
Ce n’est pas en Algérie non plus que Tazrut compte créer son entreprise car cette idée lui paraît incongrue, mais en France, l’espace du possible.
« Même si on a envie de faire quelque chose, mais on peut pas. Ah bon, ici en Algérie, tu vas entendre une fille, elle va monter son propre entreprise. Qu’est-ce qu’ils vont penser d’elle ? Elle est pas (inaudible) ici. Alors qu’en France, non. Et pourtant je suis capable. »
Akel et Tazrut rejoignent ici le discours de Layla qui fait écho à celui de sa mère qu’elle rapporte. Layla exprime le besoin de liberté qu’elle n’estime pas pouvoir trouver dans la société algérienne. La limitation s’adresse ici aux femmes, et de façon spécifique à la place de la femme dans la société algérienne.
« Parce que je, pour moi, le but vraiment pour que je parte, en France, c’était, c’est pour moi, la soif de liberté. C’est-à-dire malgré que mon père ne, c’est-à-dire il est ouvert, mais quand même il se limite à la société. Il ne peut pas enfreindre certaines lois de la société. Donc pour moi, c’est plus la liberté, de trouver ma liberté de… Ah quand tu dis : « enfreindre les lois de la société », qu’est-ce que… Y’a des choses que tu ne pas faire ici ? Oui. Et que tu aimerais pouvoir faire. Quoi par exemple ?
65
En fait, par exemple pour faire un doctorat, on a besoin, surtout pour les recherches, on a besoin de marcher, de trouver des personnes à, à interviewer, etc. Mais c’est difficile pour une fille de faire ce travail là. La recherche, ici, c’est uniquement réservé aux garçons. Ah, d’accord. En fait, c’est difficile de trouver une fille qui se balade ici et là, c’est réservé aux garçons. »
Il apparaît dans le discours des interviewés une dimension temporelle importante. A l’Algérie comme espace de limitation fait écho une limitation du temps algérien. C’est l’immobilisme, l’attente, le temps perdu en Algérie qui est un temps présent à mettre en relation avec le temps du futur du possible, c'est-à-dire en France dans l’immigration. Ecoutons Tazrut :
« Je vais leur montrer de quoi je suis capable. Parce qu’ici en Algérie, je n’ai rien fait. Moi, je dors, je me lève, je pars à l’école, je reviens, je dors, je me lève,… »
Elle en veut rétrospectivement à son ex-petit ami qu’elle accuse de lui avoir fait perdre du temps dans une aventure trop longue qui s’est avérée sans lendemain. Tout le monde en prend pour son grade.
« Bon j’ai sacrifié plusieurs choses à cause de lui. Si ce n’était pas lui, peut-être, peut-être euh je suis déjà parti en France ça fait bien long temps. Si c’était pas lui. Si je suis restée ici jusqu’à aujourd’hui, c’est à cause de lui. A cause ? Ah oui. C’est à cause de lui que je suis restée ici jusqu’à aujourd’hui. »
L’espace clivée et le temps conjugué sont manifestes dans le discours de Hakim qui oppose un horizon de découverte (spatial) et de perspectives (temporel) à l’horizon étroit et sans évolution possible de carrière de l’Algérie :
« Bon avec un Magistère je peux travailler ici, je peux rester ici. Mais j’ai l’impression que je pourrai pas évoluer, je peux pas…D’après ce que je vois par exemple, mes enseignants, mes collègues, ainsi de suite… Ils ont un petit salaire, ils n’évoluent pas, ils … J’aime pas ça. En tout cas, je peux toujours revenir et travailler, donc pourquoi pas avoir, parce que si je travaille, si je commence à fonder quelque chose maintenant, je ne pourrais pas par la suite partir ou si j’entame mon projet sérieux ici, je ne pourrais pas m’offrir cette occasion. Donc je préfère me l’offrir maintenant, partir connaître des gens, je sais pas. »
La fin de l’émigration de travail a donné naissance à une émigration politique. L’utilisation du registre comparatif est aussi une façon et un besoin personnel de se convaincre soi-même qu’on part pour des raisons politiques et publiques. Ne sert-il pas de prétexte pour « dissimuler » en partie les raisons personnelles, sociales, « subalternes » et aussi indignes qui ont de tout temps constitué l’émigration en honte, en silence ?
66
Différences entre l’Algérie et la France dans le champ lexical. ALGERIE FRANCE Présent Futur Etouffement Découragement Dégoût Vie réduite Survivre Subir Misère Insécurité Arbitraire Répression Médiocrité Manques de moyens Désavantages Dévalorisation des diplômes Chômage Célibat Frustration
Epanouissement Réussite Goût Vie plus large Vivre pleinement Choisir Richesse Sécurité Droit Liberté d’expression Qualité Capacité Avantages Valorisation des diplômes Travail Mariage Amour
1.3.2 La ville versus le village Mais la différence faite entre la France et l’Algérie préfigure dans la distinction qu’ils font entre le village, ce qui est villageois et la ville, ce qui est citadin, mais pas n’importe quelle ville, la grande comme Alger et non pas la « petite » comme Tizi-Ouzou qu’ils assimilent au village. Pour Akel, par exemple, Alger la capitale a quelque chose qui tend vers la France :
« Moi, dès que je vais à Alger par exemple, le week-end, c’est pas le même chose. Je me sens bien tout ça parce que ça change. Mais Alger, c’est une grande ville, les gens c’est des citadins. C’est une autre mentalité je veux dire par rapport à Tizi. Donc y’a ça aussi qui fait que … » « Bougie, c’est bien, c’est vrai que c’est des citadins, ils savent bien vivre euh, tout ça euh… Mais la mentalité euh c’est la même chose hein. »
« Et puis, excusez-moi du terme, mais Tizi-Ouzou, c’est devenu une ville de voyous, hein. Moi, mon père quand il me ramène ici, il me dit : « Ma fille, tu fais attention. C’est une ville de voyous. On n’est jamais en sécurité ». C’est vraiment, d’ailleurs même les ruelles, c’est sale. Je sais pas, c’est une ville, moi… Elle est en pleine construction…. Elle me stresse cette ville. »
A l’opposé, le village, c’est le bled comme l’appelle péjorativement les immigrés. Il y a une graduation des espaces de limitation dont nous faisions référence précédemment. Le village montagnard représente un espace beaucoup plus restreint que la ville qui peut être perçue comme une première ouverture. Les étudiants associent le village à la vie villageoise et aux traditions. Ils s’en démarquent à l’exemple d’Akel qui se place déjà dans l’émigration et qui
67
insiste sur le fait qu’elle vive en ville126. C’est une autre façon de se dire émigrer. D’ailleurs, le village, c’est pour les vacances.
« Je suis pas à l’aise, ces traditions tout ça, les trucs agi127. C’est pas nos, notre, je suis pas trop, je suis pas trop dedans. Faut dire qu’on n’a pas été élevé. Déjà, moi j’ai pas été élevé dans un village kabyle déjà. On habite dans une ville déjà, premièrement. Oui, toi t’es citadine. Voilà. Et on allait en Kabylie, dans le village que pendant les vacances d’été. Donc euh, on n’a pas vraiment cette culture euh…. C’est ça aussi. »
Saïda le dit d’une autre manière :
« … Y’a un détail aussi. Mon petit ami, c’est pas quelqu’un qui a fait des études supérieures donc euh, bon, mais c’est assez, des fois les études n’ont rien à voir, il a une mentalité assez compatible à la mienne. On pense la même chose, on a les mêmes projets, et lui c’est quelqu’un de la montagne, il vit à la montagne. D’accord. Moi, je suis de la ville donc euh, des fois on pense, je disais qu’on pensait à l’éventualité de ne pas pouvoir partir. J’imagine un petit peu, au sein d’un village, moi qui…qui rêve de vivre en ville. Est-ce que je pourrais satisfaire la belle-famille ? J’ai toutes ces appréhensions avant. »
Différences entre le village et la ville dans le champ lexical. LE VILLAGE LA VILLE La montagne Tizi-Ouzou Alger, Bougie Sale Malaise Traditions Famille
Propre Jouissance Modernité Amis
Ce constat fait écho à ce que nous disait G. SIMMEL à propos des formations sociales restreintes telles que le village, qui en Kabylie peut être assimiler au groupe familial puisqu’il en est la traduction spatiale :
« Le stade le plus précoce des formations sociales, qu’on trouve aussi bien dans l’histoire que dans le présent, est celui-ci : un groupe relativement petit avec une solide clôture contre les voisins et les étrangers - ou contre les petits groupes, de quelques manières, antagonistes -, mais en revanche, avec une cohésion d’autant plus forte ; Un cercle qui n’accorde aux individus qu’une faible marge pour l’éclosion de qualités particulières, la liberté et l’autonomie de leurs mouvements. Ainsi naissent les groupes politiques et familiaux, les partis, les communautés religieuses ; la conservation de soi de très jeunes associations exige que les frontières soient fixées rigoureusement, elle exige aussi une unité centripète et, par conséquent elle ne peut concéder à l’individu ni liberté ni particularité à l’intérieur, ni développement à l’extérieur128. »
126 Mais peut-on parler de ville à propos de Draa El Mizan ? 127 Prononcez « agui ». C’est un adjectif démonstratif en berbère kabyle. 128 SIMMEL G. (1903), « Métropoles et mentalité », in GRAFMEYER Y. et JOSEPH I. (1990), L’école de Chicago : Naissance de l’écologie urbaine, éd. Aubier, Paris, pp. 61-77.
68
Le village est le lieu d’une forte cohésion. Il se traduit pour l’individu par une faible marge de liberté et d’autonomie, l’imposition d’une forte clôture, l’opposé exacte de la ville :
« Si l’on s’interroge sur la position historique de ces deux formes de l’individualisme qui se nourrissent des rapports quantitatifs de la grande ville : l’indépendance individuelle et la formation de l’originalité personnelle, alors la grande ville gagne une valeur tout à fait nouvelle dans l’histoire mondiale des mentalités. Le 18ème siècle trouvait l’individu retenu par des liens d’ordre politique et agraire, corporatif est religieux, qui lui faisait violence et qui avait perdu tout son sens. Ces oppressions imposaient à l’homme, pour ainsi dire, une forme « non naturelle » et des inégalités depuis longtemps injustifiées129. »
L’étudiant, qui souhaite quitter son village, son « bled », sa région qui toute entière fonctionne comme un grand village, pour la ville, ou mieux encore, pour la France, le fait dans une même optique : la quête de liberté. C’est la quête d’un espace d’affranchissement où la sociabilité négative spécifique à la ville, c'est-à-dire une sociabilité absente lui permettra, il l’espère, d’être libre. Mais seulement aller en ville n’est pas suffisant, c’est un désir de France dont il s’agit. Nous parlons à plusieurs reprises d’espace de limitation, limitation de l’espace et du temps, qui vient en écho au terme de clôture qu’utilise G. SIMMEL. Nous pourrions développer ce concept de clôture de façon intéressante. Le candidat à l’émigration est en quelque sorte confronté à une triple clôture :
- La clôture familiale et villageoise ; elle symbolise toutes les contraintes sociales imposées par le groupe, la famille élargie, dans mais aussi à l’extérieur de son champ spatial.
- Une deuxième clôture représentée par la société algérienne tout entière. Elle comprend l’Etat algérien et toutes ses institutions à travers son autorité, en tant qu’elle apparaît arbitraire et subjective.
- Enfin une troisième clôture nous semble représentée par le dernier obstacle à l’émigration : le visa symbolisant la frontière, française tout d’abord, mais aussi européenne depuis les accords de Shengen.
Ces trois clôtures forment aussi paradoxalement trois possibilités d’ouverture. « Le structurel n’est pas que contrainte, il est à la fois contraignant et habilitant130. » La famille, plus restreinte cette fois-ci, est le lieu où s’élabore le processus d’émigration. L’Etat algérien met à la disposition de ses habitants les moyens (économiques, culturels et symboliques131) nécessaires à l’élaboration du départ. L’obtention du visa enfin, quand elle est arbitraire, entretient l’espoir et participe au jeu à l’œuvre dans le projet de départ.
1.3.3 L’université de tous les savoirs C’est ainsi que nous devons faire un avenant particulier à propos de l’université algérienne très dénigrée dans le discours des interviewés. Elle fait l’objet, au même titre que la comparaison entre l’Algérie au profit de la France, d’une déqualification. Le registre comparatif est ici aussi souvent implicite. Les étudiants, en dénigrant l’université algérienne, disent sur le ton du reproche ce qu’elle devrait être, comment elle devrait fonctionner, sous-entendu comme en France. Mais l’observation quotidienne des étudiants nous dit tout autre
129 SIMMEL G. (1903), idem. 130 GIDDENS A.(1984), La constitution de la société, P.U.F/Quadrige, Paris, 474 p., 1987 pour la traduction française. 131 Quand l’élite vient se faire soigner en France et que leurs enfants y viennent pour étudier.
69
chose. Pourquoi sont-ils déjà sur le campus deux semaines avant la rentrée comme j’ai pu l’observer lors de mon premier séjour en septembre 2005 ? Pourquoi le campus est-il le seul lieu public où l’on peut trouver des couples mixtes en train de discuter ? L’ombre offerte par la végétation ne me semble pas être une explication suffisante. Dès que nous sortons du campus pour rejoindre le « centre ville » de Tizi-Ouzou, nous quittons une ambiance décontractée pour un espace doté d’une nette séparation des deux sexes. Les cafés sont exclusivement masculins, les seules filles que l’on peut y rencontrer ne sont jamais seules mais toujours accompagnées d’amies. On ne flâne pas à Tizi-Ouzou, on marche. Dans un autre registre, pourquoi l’université offre-t-elle le seul lieu de contestation politique de la ville ? Pourquoi y sent-on comme un vent de liberté ? L’université de Tizi-ouzou est réputée pour ses grèves, ses manifestations à répétitions. Ne doit-on pas voir un paradoxe entre la pratique et le discours ?
L’université en Algérie versus en France La qualité de l’enseignement universitaire algérien et ses conséquences sur la valeur des diplômes viennent alimentent les raisons du projet migratoire. Le diplôme français est convoité, il porte une valeur symbolique plus forte que le diplôme algérien. Et ceci est valable que ce soit dans la perspective d’un retour ou a fortiori pour travailler à l’étranger. Ecoutons Saïda.
« …Mais ce qui m’a stimulée le plus, c’est vouloir avoir un diplôme de qualité. Parce que je sais pas si tu es au courant. Mais l’université de Tizi-Ouzou, mais, c’est, c’est elle est renommée pour ses grèves. Je vous assure que c’est la vérité. Bejaia, c’est pas mal non plus. Oui, la Kabylie, mais Tizi-Ouzou encore, c’est un cas spectaculaire. D’accord. Donc à un moment donné, j’en avais vraiment ras le bol et, et en voyant, je citerais par exemple mes études d’Anglais. C’est vrai que la qualité des études était vraiment médiocre. Je ne sais pas comment décrire tout cela, mais j’étais pas satisfaite. Je n’étais pas satisfaite. Donc c’était la première chose qui m’a motivée à vouloir partir. »
C’est encore dans une perspective de limitation que les étudiants s’expriment à propos de l’université. Cela se traduit par l’expression récurrente de « manque de moyens ». Il s’agit d’une part d’une dimension quantitative plus particulièrement attribuée au côté matériel de l’université (Internet, photocopies,…). Akel l’exprime par un jugement sévère :
« C’est quoi, donc euh, et puis on n’a pas de, de moyens. L’Internet, on n’a pas d’Internet par exemple. C’est important. On doit sortir, on doit payer. Les photocopies, on n’en a pas. Ça n’existe pas au sein de l’université déjà. Je trouve ça assez grave, parce qu’on est obligé de sortir de l’université et tout ce qui s’en suit. »
Ferhat quant à lui parle de misère :
« Tu rentres au village tous les soirs ou t’es en cité ici ? Ouais, je, cette année je rentre, toujours au village. J’ai une chambre universitaire, je l’ai abandonnée. Voilà, une chambre à 5, 6 étudiants dans une même chambre. [….] Pour étudier c’est pas évident. C’est pas du tout évident, même pour d’autres. On ne dort pas bien, on ne mange pas bien. Faire la queue deux heures pour avoir un plat. C’est pas digne, correct, c’est pas consistant, c’est pas équilibré, C’est une hygiène, y’a pas d’hygiène, y’a rien du tout donc euh. Donc c’est ça que j’ai choisi de revenir chez moi, chez moi tous les soirs. Même je dépense un petit peu d’argent donc dans les transports tout ça, bon, c’est mieux que rester ici dans la misère. »
70
L’appréciation est d’autre part qualitative. Elle s’exprime à propos de l’encadrement, notamment des enseignants avec une idée assez précise de ce qu’ils devraient être. Akel, en utilisant le « on », se fait ici porte-parole des étudiants, groupe auquel elle s’inclut ici. Elle donne ainsi à son propos le caractère de l’évidence.
« Puis les enseignants aussi sont pas très, ils ne nous aident pas vraiment. Quand on demande de la documentation, c’est vraiment euh, « allez à la bibliothèque, y’a tout à la bibliothèque ». Je sais pas, ils fournissent pas d’efforts. On voit que c’est pas par amour, ou par, normalement un enseignant il doit aimer son métier. Il doit aider les ét… surtout en 4ème année132. On prépare un mémoire, normalement on doit avoir des, de la documentation, c’est pas ça. On a l’impression qu’ils nous, « débrouillez-vous ! ». Le stage pratique, vous le faites seul. Vous cherchez une entreprise seul, c’est pas normal. On n’est même pas soutenu par l’université donc euh. Tout ça, ça m’a, voilà. C’est pas la joie, c’est ça. »
A cette « disqualification » de l’université algérienne, de l’ici, correspond une qualification de l’université française, du là-bas, c'est-à-dire ce qui va se passer pour elle en France après son départ. C’est tout de suite l’idée d’abondance qui survient :
« Moi je me dis que si j’arrive, si vraiment mon inscription en France réussit, si j’arrive à avoir mon visa d’études, rien va m’empêcher à travailler, j’aurai tout là-bas. Tous les moyens sont disponibles. Les bibliothèques, Internet, c’est pas possible. Mais obligé, je vais travailler. »
Akel étend la critique à son environnement immédiat, aux autres étudiants desquels elle se distingue, filles comme garçons. Tout le monde en prend pour son grade. Elle se distingue d’eux par son intérêt aux études. Elle fait partie de ceux qui ont le projet de partir telle l’amie avec qui elle a fait cet entretien. Il semble que « projeter de partir » c’est déjà en quelque sorte « être en France » virtuellement. Et la France, Akel y est déjà allée. C’est peut-être en cela qu’elle se distingue des autres comme si elle était dorénavant sélectionnée comme élue.
« Et puis aussi les étudiants, le problème, l’environnement. Les étudiants, je sais pas, la mentalité. Tu discutes avec un étudiant, il est out. Il ne sait même pas ce qui se passe. Un étudiant en économie, il ne sait même pas ce qui se passe en économie. Il est là, il fait ses cours… » « Tu es étudiant en économie, tu dois savoir ce que c’est la mondialisation, ce qui se passe dans le monde, les informations. Tu as vu ce qui se passe en Russie. Rien, rien de rien. On parle que de fringues, de la mode, des trucs inutiles, je vois pas à quoi ça sert. » « Ça parle que de, que de portables, que d’argent, que de business, que de voiture,… C’est vraiment, c’est pas. Et les filles, ça ne parle que de mariage, que de trousseau133… »
L’université algérienne est décriée d’une façon générale mais n’en constitue pas moins un lieu d’investissement important, donnant accès à des ressources nécessaires au projet migratoire. Afin de poursuivre les études en France, un des moyens de quitter le pays rappelons-le, il faut bien les commencer en Algérie. Il faut en passer par-là. N’y voyons pas ici un paradoxe mais plutôt la confirmation de tout l’intérêt que les étudiants portent à l’université. Le reproche
132 En Algérie, la licence se prépare en 4 ans. La 4ème année étant essentiellement consacrée à la rédaction d’un mémoire. 133 Notons que cet entretien se termina par le récit de la rencontre amoureuse du garçon avec qui elle s’est fiancée récemment et de son projet de mariage.
71
qu’ils lui font est certainement de ne pas être assez efficace dans sa fonction, c'est-à-dire la dotation des ressources nécessaires, culturelles et symboliques, à la réalisation au départ. L’université, par l’avenir possible qu’elle promet mais aussi par le quotidien qu’elle propose, est un espace d’ouverture, une fenêtre ouverte sur la France. Etre à l’université, c’est un peu être déjà en France.
1.3.4 Une dimension proprement politique Le discours des étudiants comporte également une dimension politique importante. A travers le manque de liberté, c’est tout un système politique qui est remis en cause, qui est qualifié dans les termes de répression, corruption, piston, etc., autant d’éléments qui participe à la limitation de l’espace, à la limitation de l’existence à une survie. Ecoutons Ferhat :
« Puis y’a tout un état de choses, de choses quand même, y’a le système politique, y’a de la répression, y’a de, y’a pas de liberté, y’a de liberté individuelle, y’a, y’a rien du tout, donc à partir de là on est soumis à, de la répression quotidienne. Des pressions ? Vous avez un papier à faire dans l’administration, vous êtes pistonné, y’a pas de problème, on peut le faire sur place ; Vous connaissez personne là-bas, vous pouvez attendre une journée complète pour le faire puis en arrivant au guichet, ah ils vous disent : « revenez demain, après demain », voilà donc. Effectivement, on subit. C’est par rapport à ça aussi, pouvoir vivre quand même, s’ouvrir sur le monde. Ah oui, par exemple, pour prendre un cas, ici on a l’impression de survivre, c’est pas de vivre. L’impression de survivre. Effectivement, donc, on est, la vie des gens ici, elle est réduite, voilà, à respirer, à manger, à dormir, c’est tout (sourire). C’est tout donc effectivement, c’est par rapport à ça aussi. C’est très important. »
En dénonçant la corruption et les passes-droit qu’elle a pu observer à l’école d’hôtellerie, Saïda reproche de façon implicite aux institutions de ne pas fonctionner selon un mode moderne. Nous faisons allusion à M. WEBER qui a analysé les caractéristiques de la bureaucratie moderne.
« Je vous assure que, parce que au sein de l’institut lui-même, des fois on est affronté à des scènes incroyables. La plupart des stagiaires étaient issus d’une petite bourgeoisie si vous voulez. … Donc il y avait les gens de régions arabophones, enfants de militaires, de cadres vraiment, et y’avait la petite classe, de mon genre, du genre de personnes qui postulaient pour une formation dans le but d’avoir un emploi, d’une rémunération meilleure et faire des projets. Par contre, les autres stagiaires qui étaient issus d’une petite bourgeoisie, donc c’était les fils à maman et les filles à papa. Et voilà. Les tchichis134. Voilà, tchitchi, exactement. Et croyez-moi que c’est un petit peu délicat parce qu’on voit que les enseignants étaient là pour redresser un petit peu la situation mais en fait non. Mais ces jeunes, enfin ces fils de … Ils étaient là juste pour avoir ce diplôme-là. Mais en fait c’est pas vraiment pour aller travailler… ? Déjà que l’emploi lui-même leur est déjà réservé. D’ailleurs, à présent, ils ont des postes de travail au sein des grands établissements à Alger.
134 La tchitchi : la jeunesse dorée algérienne
72
Quels types d’établissements ? Les grandes chaînes hôtelières : Shératon, Sofitel et autres… Ah, d’accord. Donc il, or que c’est des personnes qui ne savent même pas placer des phrases ou… Et je trouve ça dommage. C’est ce qui m’a vraiment déçue. D’ailleurs ce qui m’avait étonnée le plus, parce que la filière cuisine était la plus demandée, et même pour la filière là, il fallait avoir des coups de pouce. Donc, tout est histoire de, comme on dit là, de larges épaules. Parce qu’on emploie cette formule là. Il faut avoir de larges épaules pour pouvoir accéder…et voilà. »
A la dénonciation d’un système politique, vient s’ajouter un élément important. C’est ce que nous appellerons le registre de l’assurance135, aussi bien professionnelle que personnelle. L’Algérie subit une modernisation, mais la société « traditionnelle », c'est-à-dire le village à travers la famille, ne perd pas tout contrôle sur l’individu. Si l’individu quitte le cercle de la famille, lieu de socialisation primaire mais aussi espace premier des liens de solidarité, il n’est pas assuré, n’est protégé par aucune autre instance. Ce manque d’assurance contribue également à la limitation de l’espace évoquée plus haut et donc à une incertitude sur l’avenir. La rationalité de Hakim s’accorde mal avec cet état des lieux :
« …Mais le problème ici c’est que, je sais pas si tu as remarqué, on ne respecte pas les droits d’auteurs, tout est piraté, tout est donc euh, tu peux rien faire pratiquement. Même si par exemple tu développes comme ça des systèmes informatiques, du jour au lendemain y’a des gens qui vont les pirater, personne ne peut te protéger. L’Etat algérien ne peut pas réagir par rapport à ça, je sais pas pour quelle raison. Donc c’est toute la branche qui est…, qui est handicapée parce que des gens ou une entreprise ne peut pas investir dans un domaine où elle va produire des choses et, qui lui appartiendront pas par la suite. […] Tu peux pas te lancer, y’a rien qui te protège. Le problème du livre136 par exemple, tu sors un livre, on te le pirate et personne ne peut te, ne peut te protéger donc euh… Et puis je sais pas, y’a le contexte du pays, ça ça me plaît pas du tout parce que y’a pas mal de questions qu’on veut pas régler et ça peut miner le pays dans l’avenir. C’est un pays qui peut basculer du jour au lendemain dans l’islamisme, dans je ne sais pas, dans autre chose… Et ça, ça me donne pas en tout cas envie de rester ou bien d’investir, de lancer des choses ici. Parce que c’est des choses, la question de la langue, on l’a pas encore tranchée. L’orientation du pays, est-ce qu’on veut un pays moderniste, un pays je sais pas, pro je ne sais quoi. On veut pas trancher ça. Les jeunes, on veut pas leur donner la parole. Y’a une sorte de marasme, et ça, ça peut nous réserver plein de surprises et c’est pas quelque chose qui rassure et qui donne envie de rester et de lancer des choses. Même pas une famille par exemple, tu as envie d’avoir une famille, des enfants et puis le contexte actuel, l’école publique, la santé tout ça, tout ça est décourageant. »
Saïda remet en cause la sécurité que représente la famille, ce dont elle désire s’affranchir, mais les conditions en Algérie ne le permettent pas.
135 L’Assurance est ici à mettre en opposition à l’assistance tel que le définit R. CASTEL. Cf. CASTEL R. (1995), Les métamorphoses de la question sociale. Une chronique du salariat, Paris, Fayard. 136 Hakim a commencé la rédaction d’un ouvrage de vulgarisation en informatique à partir des cours qu’il dispense dans un centre de formation.
73
« Mais avec tes diplômes, tu auras toujours la possibilité de trouver un emploi, t’as une garanti de l’emploi quand même globalement. Et toi, et puis ton ami a son magasin, je veux dire, une relative sécurité. Peut-être une sécurité matérielle, mais sur les autres plans ? C’est, y’a pas de sécurité. Rien n’est garanti. Rien n’est garanti. Quand tu dis sur les autres plans, tu penses à quoi ? Au relationnel, dans le cadre de la société, familiale surtout, parce que c’est quand même une famille assez importante. Tout commence à partir de la famille. »
74
2 - Le projet migratoire chez les uns, les unes et les autres Le projet d’émigration naît, comme nous venons de le voir, à partir d’un substrat, d’une histoire, d’un héritage des prédécesseurs entretenu de générations en générations. A l’émigration de travail a succédé l’émigration pour études déjà établie en tradition. Le substrat sur lequel elle se forme possède un aspect matériel mais aussi mémoriel traduisant un volume mental et une structure cognitive générée par l’émigration elle-même et s’adaptant au fil des âges. En se posant la question de la genèse de l’émigration estudiantine, nous avons premièrement tenté de cerner à partir de quel héritage germe l’idée de départ. Nous devons maintenant tenter de répondre à la question : Comment se construit le projet migratoire ? Cette question, pour mieux y répondre, doit être décomposée. Elle sous–entend plusieurs questions : Quels est le processus à l’œuvre dans le projet de départ de l’étudiant ? Nous envisageons ce processus non pas comme la réaction à un « stimulus » extérieur (économique, politique, etc.) mais comme la conclusion d’un véritable projet migratoire. Comme nous le pressentions dans la première partie de ce mémoire, le projet de départ, par l’importance et les enjeux qu’il représente, n’est pas le fait d’un individu seul. Sa famille est un groupe social à l’intérieur duquel opèrent des mécanismes, toute une dynamique familiale produisant de la migration. Mais dans quelle mesure ? Et l’individu, quant à lui, quels sont les moyens qu’il mobilise pour réaliser son projet ? Nous émettions également l’hypothèse de l’individualisation de l’émigration avec l’émergence du sujet mais aussi l’existence d’un comportement « pro-individuel » au sein du groupe familial. Notre étude contenant une dimension évidemment exploratoire, il s’agit pour nous de nuancer ces propos. Le projet migratoire est l’œuvre d’une commune stratégie, dans le sens d’une stratégie commune à tous, où chacun œuvre à sa façon au projet migratoire, faisant de ce projet individuel un projet commun. Nous pourrions ainsi parler d’une complicité tacite. Mais comme le suggère M. DE CERTEAU, le terme de stratégie est-il peut-être trop fort. Mieux vaudrait alors parler de tactique137. Il s’agit d’un déplacement du terrain des opérations ; alors que l’acteur opère stratégiquement sur son propre terrain, il opère tactiquement sur le terrain de l’autre.
2.1 Le choix de la filière
C’est toute la société qui encourage ses enfants au départ. A commencer par le système éducatif qui a contribué à la massification du nombre de diplômés. Deux conséquences à ce phénomène : la première est l’augmentation du nombre de prétendants à la poursuite d’études à l’étranger puisque c’est un des moyens légaux de partir, la seconde est de pas avoir pu offrir à tous une formation de qualité jusqu’à un niveau suffisant et, ce faisant, d’obliger de nombreux étudiants à poursuivre leurs études à l’extérieur du pays138. En guise d’histoire de vie, tous relatent avec précisions leur parcours scolaire, l’obtention des diplômes successifs. Le passage au lycée, l’arrivée en terminale scande la vie de toute la famille139.
137 « … j’appelle tactique l’action calculée que détermine l’absence d’un propre. Alors aucune délimitation de l’extériorité ne lui fournit la condition d’une autonomie. La tactique n’a pour lieu que celui de l’autre. Ainsi doit-elle jouer avec le terrain qui lui est imposé tel que l’organise la loi d’une force étrangère. » Cf. DE CERTEAU M. (1990), L’invention du quotidien : 1. Un art de faire, Gallimard, coll. Folio essais, Paris, 350p. J’utiliserai le plus souvent le terme de stratégie, et ce, dans son acception courante. 138 C’est à ce niveau que la raison, dans le discours des étudiants, se fait prétexte. 139 Comme très souvent en France.
75
« Enfin, l’idée je l’ai eue, l’idée de partir, quand j’avais passé mon Bac. » L’obtention du Bac constitue un instant radical. C’est la condition d’une possibilité, d’une idée. Y croire devient possible. C’est à partir de cet instant que le projet se construit. C’est peut-être l’élément déclencheur, l’activateur du projet migratoire le plus patent. Il « cristallise » en quelque sorte l’idée d’émigrer. Même dans le cas où le projet de départ n’était pas envisagé dès l’enfance, le Baccalauréat représente le premier visa. C’est la première étape à partir de laquelle le projet peut réellement commencer sa construction. C’est à la fois un rite de passage, une initiation de l’étudiant qui au même moment initie le projet de départ. Bien qu’elle comporte une part d’incertitude, l’obtention du Bac, dans tout ce qu’elle a de concret, procède bien d’une rationalité en finalité. Ecoutons la déclaration de Ferhat :
« Enfin, l’idée je l’ai eue, l’idée de partir, quand j’avais passé mon Bac. C’était en 2000. Quand j’ai eu mon Bac, je l’ai passé en 1999, je l’ai raté. J’ai refait mon Bac, je l’ai eu en 2000. »
Après l’obtention du Bac intervient le choix de la filière. La filière n’est pas toujours choisie d’emblée. L’orientation scolaire en Algérie est principalement imposée, selon des critères de notes et de quotas prévus dans les différentes filières. Elle commence dès le collège à la fin duquel se dessine trois parcours principaux de Lycée : Sciences, Lettres et Mathématiques. Le choix de la filière universitaire se fait suivant des critères semblables mais avec un plus large choix. Elle est donc bien souvent imposée négativement par les circonstances : une trop faible moyenne ou une trop mauvaise note dans telle matière au Bac pour prétendre à telle ou telle filière, mais aussi l’inverse, une trop bonne moyenne générale interdisant telle filière jugée moins élitiste par le système éducatif parfois plus porteuse du point de vue de la migration. Les recours sont cependant possibles et nous en avons souvent entendu parler dans cette enquête. Ils ont pu être le fait des étudiants comme de leurs parents. La filière d’étude envisagée à l’étranger est pour sa part choisie en connaissance de cause. C’est une ouverture vers l’extérieur, et en Algérie même. Mais elle doit d’abord garantir l’ouverture des portes de l’émigration.
« Moi, je voudrais inscrire en Marketing international. Ça m’intéresse beaucoup. » Il existe des frontières entre les disciplines. Elles sont du dehors ou du dedans. A chacune ses destinations : locales, nationales, internationales. C’est par exemple le double investissement dans la langue française et la filière du français à l’université. Pour Ferhat, le choix de la Licence de français est l’étape supplémentaire d’un processus se déroulant dans un continuum jusqu’à l’aboutissement final qu’est la France, l’espace d’ouverture convoité. La Licence de français, même en restant en Algérie, permet un début d’ouverture dans ce milieu qu’il définit plus loin comme étouffant.
« La licence de Français, c’est effectivement, en étudiant la littérature, ça permet d’ouvrir l’esprit des gens et tout ça donc pouvoir, justement pouvoir s’intégrer facilement en France. D’accord, une ouverture vers la France. Effectivement, même un espace d’ouverture ici même en Algérie. »
La filière Economie est également porteuse, mais à une condition. Ce doit être une formation à l’internationale proposant une ouverture quant aux différents possibles dans l’avenir. Tazrut fait coïncider l’idée du départ avec le choix de la filière qui lui semble promettre la réalisation du projet migratoire. Elle fait également un choix d’ouverture. Choisir l’international, c’est viser plus large que la France, c’est aussi la perspective du Canada où réside une de ses tantes. L’un ne se fait pas sans l’autre et réciproquement dans le sens où le
76
choix de la filière pertinente, même s’il tient du pari, cristallise le projet de départ. Ils sont intimement liés.
« Voilà, j’ai eu mon bac l’an 2000. Pour ce qui est de la France, c’est en fait une idée, cette idée m’est venue y’a deux ans, presque deux ans. Deux ans, j’ai choisi cette filière, quand même, je l’ai choisi c’est parce que, économie internationale, euh, je me suis dit peut-être j’aurais plus de chance d’avoir, d’avoir une inscription en France. C’est parce que c’est une, c’est une filière internationale que de choisir une autre filière. Je l’ai choisie cette filière. Moi j’ai vu qu’elle était nouvelle. Ils nous ont dit qu’on aurait beaucoup de difficultés, c’est parce que c’est une nouvelle filière et… »
Avec Hakim et Saïda nous atteignons semble-t-il une meilleure maîtrise du parcours140. L’appropriation du projet est plus grande chez eux que chez les autres étudiants. Hakim, qui fut le plus a même de faire entièrement ses choix, présente la filière informatique comme assurant plus de débouchés sur le marché de l’emploi. Sa position actuelle, c'est-à-dire a posteriori, lui permet de tenir le discours d’une rationalité en finalité.
« …c’était plus pour avoir un emploi, c’est pour des débouchés, de meilleurs débouchés. Parce que l’informatique, on sent qu’il y a plus d’opportunités de travail, que, d’embauches que les autres études. »
Saïda également se présente comme ayant maîtrisé son parcours. Elle se met en valeur et affiche une certaine réussite en sachant qu’elle a su bénéficier du système d’orientation scolaire algérien.
« Donc j’ai eu mon Bac en 1998. J’ai accédé à l’université et j’ai fait, j’ai opté pour une licence en Lettres anglaises qui a duré quatre ans. Donc j’ai achevé mes études en 2002. » « Maintenant je voudrais revenir au choix des filières que tu as fait, que ce soit le type de Bac, le type de licence, et après de continuer. Comment ça s’est fait ces choix ? C’était par rapport aux résultats du Baccalauréat aussi. Parce que j’avais eu une bonne note en langue anglaise donc je pouvais accéder à cette filière là, en premier lieu. On pouvait m’attribuer, m’accorder mon premier choix de langue anglaise. »
Saïda tient un discours rationnel. C’est tout d’abord le choix de la langue étrangère, ici l’anglais, comme ouverture des possibles, qu’elle renforce plus tard avec une formation au tourisme. Le secteur de l’hôtellerie et du tourisme en Algérie est encore peu développé. Nous pouvons comprendre le choix de Saïda comme un investissement vers une filière prometteuse avec le pari que les choses vont s’améliorer, or on s’aperçoit plus loin dans l’entretien que Saïda est très pessimiste pour l’avenir de son pays et par conséquent pour y concevoir son avenir. Il est plus sûr que son choix corresponde à une ouverture à l’international.
« J’ai opté pour une autre formation de, d’hôtellerie, et de tourisme. Donc c’est un créneau assez important donc euh, vu les perspectives, enfin, de ce domaine là, dans le pays, donc j’ai préféré opter pour cette formation là. Donc, ça a duré deux ans. »
« Je veux pas faire des études en Arabe, des études supérieures en Arabe. » Avec Saïda et Hakim se pose la question linguistique en Algérie. S’ouvrir sur l’extérieur, c’est aussi choisir sa langue. La langue française intervient dans cette perspective. Pourquoi ne pas avoir choisi l’arabe qui est une langue parlée dans une vingtaine de pays ? Pourquoi le français ? Pour l’ensemble des interviewés, l’arabe n’a jamais été envisagé comme porteur de
140 Maîtrise du parcours qui est à mettre en corrélation avec un certain degré d’affranchissement comme nous le verrons plus loin.
77
leur projet. C’est le choix de la destination qui importe. Il est hors de question d’aller dans un autre pays du tiers-monde. Les étudiants choisissent la destination des pays du Nord, et pas simplement des pays riches dans lesquels nous pourrions inclure des pays de la péninsule arabique. La langue véhicule une culture et un mode de vie, tout du moins l’image qu’on s’en donne. Hakim se déclare franchement contre la langue arabe et contre la politique d’arabisation. C’est ainsi que bien qu’il ait les moyens de poursuivre ses études à l’ENA et ainsi d’être garanti d’obtenir un poste prestigieux à l’issue de ses études, il refuse de suivre cette filière. Il renonce à la filière d’excellence car elle n’est pas en adéquation avec ses projets. Nous accordons ici projets au pluriel car il ne s’agit pas en fait d’émigrer uniquement pour étudier mais bien d’un projet de vie.
« Et en même temps, après juste le Bac, j’ai fait un concours à l’Ecole Nationale d’Administration. C’est l’école la plus réputée, la plus renommée en Algérie. J’ai fait le concours, j’étais admis mais sur place j’ai su que les études se faisaient en arabe, j’ai arrêté. Je voulais pas faire, en arabe, je je… C’est pas possible ou tu veux pas ? Je veux pas. D’accord. Je veux pas faire des études en Arabe, des études supérieures en Arabe. Ils avaient trois spécifications, direction des hôpitaux, direction des douanes ou quelques choses comme ça, je me rappelle pas du…. Y’a un truc que je ne comprends pas. Mais le concours, tu l’as passé dans quelle langue ? Y’avait trois épreuves : épreuve de culture générale en arabe, épreuve de français, épreuve d’Anglais. Mais par contre tout l’enseignement se fera en Arabe ? Oui, bon, bien sûr ils ont des modules de Français, des modules de Français pour apprendre euh…mais la majorité des…Ils ont des modules d’Histoire, des modules de langue arabe, et je ne sais pas quoi et essentiellement les études, la langue d’étude se faisait en, c’est l’arabe et ça je le voulais pas. C’est pour ça que je, pourtant là, le boulot il est assuré. C’est une école qui forme des cadres qui sont toujours casés après leur formation. »
On retrouve l’idée de la dévalorisation du diplôme national algérien. Un diplôme étranger est bénéfique dans tous les cas de situation que ce soit à l’international mais aussi au plan national s’il lui venait à rentrer au pays.
« Sinon déjà j’aurai un titre, un titre international, un titre étranger, donc ça pourrait être très avantageux pour moi pour par…, pour rester en France, ou bien pour partir ailleurs. Ou bien pour revenir. »
Comme nous venons de le voir, le choix tactique de la filière est une étape importante dans la préparation au départ. C’est à ce niveau que l’on peut le mieux observer le processus à l’œuvre dans la formation du projet migratoire des étudiants et plus exactement comment fonctionne la dynamique familiale.
2.1.1 Le projet migratoire de l’étudiant : le « je » de l’acteur ? C’est en se penchant sur l’énonciation dans le discours des interviewés que l’on peut le mieux rendre compte du processus à l’œuvre dans l’élaboration du projet migratoire même si nous devrons relativiser plus tard certains de ses aspects. Le premier élément de cette analyse du discours nous montre de différences importantes selon le sexe de l’interviewé. La dimension
78
sexuée de l’émigration dont nous avons plusieurs fois parlé dans la première partie de ce mémoire apparaît dans le langage même de l’individu. Afin de clarifier notre propos, nous commencerons par les éléments communs aux deux sexes. Nous observons donc tout d’abord, quel que soit le sexe de l’interviewé, une nette affirmation du sujet par une importante et récurrente utilisation du « je » associé à une définition de l’identité de l’étudiant et à l’affirmation de sa volonté de réussir son projet. Le sujet se démarque également par une distanciation mais aussi par une réflexivité sur sa propre situation. Nous remarquons aussi une importante utilisation du « on ». Il s’agit, quand il est inclusif, d’un « je » impersonnel, implicite. Le « on » traduit tantôt le groupe étudiant dans lequel l’interviewé s’inclut et auquel il s’identifie, se démarquant en cela des autres. Mais il s’agit bien plus souvent du groupe familial, la cellule familiale plus exactement, son lieu de socialisation primaire. Le « on » peut-être aussi exclusif. Il est intéressant de noter à son propos qu’il est généralement porteur d’un pourvoir de coercition. C’est l’Etat par exemple. Nous avons constaté, dans la première partie de l’analyse, la présence d’une dimension cognitive spatio-temporelle repérable dans le registre comparatif qui est fait entre la France et de l’Algérie, d’une différence entre le présent en Algérie et l’avenir en France, dans l’immigration. Nous constatons, à l’examen des verbes et de leur conjugaison, que tout ce qui tient de l’action, pour les candidats au départ, est au futur. Et encore constatons-nous l’utilisation de deux importantes modalités, celle de la nécessité « il faut que », et celle du conditionnel (très présent bien que diffus dans le discours de Salim par exemple). Comme quoi le projet migratoire comprend une zone certaine d’incertitude. C’est probablement parce que le projet migratoire conserve cette dimension d’incertitude qu’il fait penser à un jeu car fondé sur l’aléa. A l’inverse, ces même candidats, lorsqu’ils parlent de ceux qui ont émigré, de ceux qui ont donc réussi, « il » ou « ils » portent la marque de l’action et du mouvement. Pour les étudiants les plus âgés de notre échantillon, les parents semblent absents de leur projet, enfin c’est ainsi qu’ils en parlent. Plus l’étudiant dispose d’un capital141 scolaire important, plus il est en position de force pour imposer son projet. On retrouve à plusieurs reprises dans le discours que tient Hakim le fait qu’il se distingue des autres étudiants. Il affiche à plusieurs reprise sa réussite, que ce soit au Lycée où il a obtenu la mention Bien au Bac, ou à l’université où il a été sélectionné pour continuer en Magistère. Il a pu choisir son parcours contrairement à bien des étudiants qui subissent l’orientation scolaire et universitaire de façon plus arbitraire. Hakim se présente de plus comme complètement autonome, tout au moins par rapport à sa famille. Lorsqu’il cite ses parents, il ne nous rapporte pas tellement leurs dires mais il leur attribue l’avis général d’un sens commun. Il s’en fait plutôt alors le porte-parole.
« Et quel discours tient ton père par rapport à ton projet ? Il est tout à fait d’accord parce qu’ici c’est tout le monde qui a l’impression que ça ne marche pas. Ça pourrait pas être très bénéfique pour les enfants. […] Et ta mère ? Ma mère (en souriant) elle ne peut pas, je sais pas, elle n’a pas une idée très claire de la France et tout. Peut-être ce qui va la déranger, c’est un peu l’éloignement parce que
141 Souvent en corrélation avec l’âge.
79
je serai éloigné. Peut-être des dangers, des risques comme ça. Mais sinon, elle a pas de… »
Saïda est proche du cas de Hakim comme nous le voyons également dans d’autres thèmes.
« Qu’est-ce qu’en pensent tes parents, enfin qu’est-ce qu’ils disent ? Mes parents ? C’est-à-dire que j’ai des parents qui ne sont pas instruits mais assez tolérants, quand même et compréhensifs. Et puis, les histoires de départ, ils se sont habitués avec mes frères. D’accord. Ils se disent : « une de plus qui part, c’est, c’est… » »
Nous ne pensons pas qu’il faille voir dans les cas relativement autonomes de Saïda et Hakim seulement un effet de génération mais plutôt le fait qu’ils soient tous les deux autonomes financièrement parce qu’ils travaillent.
2.1.2 Le jeu de l’acteur La stratégie de l’acteur tient du jeu qui a ses règles et des opérations de différentes valeurs. Il s’agit de multiplier les atouts. Le choix de la filière d’études universitaires comprend une part de risque mais ce n’est en rien une loterie, c’est plutôt un pari sur l’avenir. La filière choisie en Algérie coïncide avec son prolongement prévu en France. C’est la situation que nous propose Akel :
« Comme notre filière, c’est une nouvelle filière, nouvelle spécialité qui a été ouverte l’année dernière. » « Et on sait, voilà, et on sait que, apparemment notre filière, l’économie, ils les acceptent en Master. On n’a pas à refaire une année en Licence ou dans ces, puisque nos études déjà c’est en Français. »
Bien que Ferhat ait opté depuis le collège pour une filière scientifique, il se retrouve, par le jeu de l’orientation scolaire imposée en Algérie, au Lycée dans la filière Lettres. Mais grâce à cette filière, c’est pour le français qu’il opte. Même restreint dans sa marge de manœuvre, il opte pour la filière potentiellement la plus prometteuse d’une poursuite d’études en France.
« D’accord. Mais tu as passé quel type de Bac ? Lettres Lettres. Ouais, un Bac Lettres. Mais en fait, tu avais un petit peu penser à ça en choisissant le Bac Lettres ou ? Non, non, non. Le Bac Lettres, ça a été vraiment dans l’orientation du collège au Lycée. Pour l’orientation, je sais pas, ça se fait par rapport aux objectifs pédagogiques de, du système éducatif réellement, donc on choisit des gens, quand ils veulent des personnes, ils les mettent en classe Lettres. D’autres, d’autres, on les met en classe Sciences. Donc par rapport aux objectifs pédagogiques, ils sont placés par l’éducation nationale. […] Tu voulais aller en Sciences. Ouais. J’ai fait des recours et tout ça donc, ça n’a pas pu marcher puis je me suis lancer quand même. Voilà, je continue, je n’ai pas le choix. »
Akel met toutes les chances de son côté en multipliant les candidatures. Il s’agit dans ce jeu de multiplier ses atouts.
« Dans quelle université ?
80
Ah moi j’ai (sourire), moi j’ai visé 20 universités, 20. (Rires) » Tazrut, qui a fait le même choix de filière qu’Akel, ouverte à l’internationale, reste elle-même ouverte aux différents possibles. Elle n’est pas déterminée sur un lieu précis. Il s’agit de saisir l’opportunité qui se présentera.
« Donc tu veux, t’as une idée de travail ensuite ? Après oui, oui. Comme elle, je veux travailler dans une société, dans une firme multinationale euh, dans un endroit qui me convient, dans un endroit où je vais me (rires)…. Alors, tu as déjà un endroit en tête ? En France ? Ah, je sais pas. Dans une firme…Je sais pas, j’ai pas d’endroit. Je n’ai pas vu d’abord les endroits, là où je peux travailler. Justement, je voulais partir les 15 jours là, c’était pour voir. C’est pour un peu visiter, voir un peu ce que je vais demander, voir les universités, voir euh. »
Layla multiplie aussi ses possibilités en faisant plusieurs tentatives étalées dans le temps. Elle va faire une demande de visa l’année prochaine, à l’issue de sa 4ème année de Licence. Si elle est refusée, elle réessaiera après l’obtention du Magistère. Elle porte une assurance certaine dans ses capacités. Elle est majeure de sa promotion. D’autre part, son double cursus - car elle prépare conjointement une Licence de Droit - lui permettra comme cela de doubler ses chances de départ.
« Après j’ai décidé de, d’attendre la quatrième année, de soutenir mon mémoire, puis, après quand j’ai eu mon Bac, mon deuxième Bac, j’ai fait la filière du Droit, donc aujourd’hui, je songe quand même à avoir mon Magistère au département pour euh… […] Et il y a une sélection pour le Magistère ? Non, parce que pour l’instant je suis la majeure de promo, donc… Ah d’accord, ok, enchanté (rires). Ah, ça va, c’est bien. Donc euh, normalement, j’aurais pas à passer ce, l’examen du Magistère. […] (sourire) En fait, par rapport, j’ai calculé cela, en obtenant mon Magistère, j’obtiendrai parallèlement ma Licence de Droit. Donc j’aurai deux… Double cursus en fait. Oui. Donc c’est pour ça que j’ai opté beaucoup plus pour le Magistère, mais enfin, j’ai quand même décidé de refaire la tentative de partir à l’étranger l’année prochaine. En 2006 ? C’est-à-dire après la Licence ? Après la Licence142. »
Parlant de son projet, Akel affiche une volonté n’hésitant à utiliser à deux reprises le terme de « sacrifice » parce que le jeu en vaut la chandelle. Elle confirme également une vision du projet à long terme.
« Donc je préfère être près de, des Mureaux, donc Paris, la région parisienne, bon. Sinon, au cas où j’ai un avis favorable, du Nord où, c’est pas grave. Je peux me sacrifier un an puis je ferai un transfert plus tard. Ce n’est pas un problème. Mais moi j’ai visé 20 universités, toutes les universités qui ont un rapport avec l’économie. […]
142 Layla raisonne ici en année universitaire.
81
Au cas où, bien sûr au cas où j’ai pas d’avis favorable et je n’ai pas mon visa, on fera bien sûr l’acte de mariage ici, j’attendrai mes papiers euh, mais je tiens à faire mes études quoi. Je sais que c’est plus facile bon, si je sacrifie une année c’est rien. Qu’est-ce que c’est qu’une année, ça se rattrape. Voilà donc euh. »
2.1.3 Entre prévisions et imprévues : Prévoir une issue de secours Nous avons repéré dans ce corpus, dans l’esprit du jeu précédemment cité, l’existence d’un joker. L’étudiant prévoit, dans le cas où son projet n’aboutirait pas, ce que nous appellerons une issue de secours. Elle se présente sous la forme de deux actes bien distincts : Le mariage avec un immigré, pourvu qu’il ait la nationalité française, et l’émigration vers le Canada. Ces deux actes permettent de parer aux incidents de parcours migratoire, et ceci à deux moments possibles :
- dans le cas où le projet initial ne peut aboutir à l’émigration effective, par le refus de visa par exemple,
- quand l’émigration a réussi mais ne peut pas perdurer. Il reste la possibilité alors, à partir de la France, d’entamer une demande d’émigration au Canada, plus exactement au Québec.
Cependant ils n’ont pas la même valeur. L’émigration au Canada nécessite tout d’abord une formation correspondant aux besoins du pays selon des quotas préétablis, et ensuite une expérience professionnelle minimum dans la branche correspondante. C’est une formule plus exigeante sur le plan scolaire et pénalisante dans un pays à fort taux de chômage comme l’Algérie. Le mariage a peu d’exigence. Il est, de ce fait, une parade plus sûre à l’impasse scolaire. Au cas où la demande de visa pour études est rejetée, Akel a prévu une issue de secours. Elle est fiancée à un Kabyle ayant acquis la nationalité française et résidant en France. Elle pourra, si cela s’avère nécessaire avancer l’acte de mariage pour le rejoindre. Ecoutons-la :
« Mais, mais, d’après ma vie personnelle, je pense que je vais vivre en France. Ah ! Donc euh. Pour rejoindre la famille en fait, ou ce serait par rapport à quoi ? Par rapport, bon, par rapport à quelqu’un. Déjà, je suis fiancée avec quelqu’un qui habite en France, un Kabyle, donc. … Qui a la nationalité française, il habite en France donc euh, donc normalement on doit se marier, donc je pense que, je pense pas qu’il va me laisser ici quand même. (Rires) Y’a un doute… (Rires) Mais en fait, lui il pourrait te faire venir en France sans que t’aies besoin de monter ton dossier. Mais moi ça me tient à cœur. Bon lui il me dit que la meilleure solution, c’est clair, c’est t’as ton visa d’études. T’as un statut d’étudiant. C’est clair que la mention qu’est l’acte de mariage c’est déjà bien, donc c’est plus facile. Et une fois que t’es mariée… C’est bon. Tu vas plus facilement en France. Au cas où, bien sûr au cas où j’ai pas d’avis favorable et je n’ai pas mon visa, on fera bien sûr l’acte de mariage ici, j’attendrai mes papiers euh, mais je tiens à faire mes
82
études quoi. Je sais que c’est plus facile bon, si je sacrifie une année c’est rien. Qu’est-ce que c’est qu’une année, ça se rattrape. Voilà donc euh. »
Tazrut également a prévu une issue de secours à son projet. Il ne s’agit pas du mariage mais de la possibilité de poursuivre son projet au Canada où réside une de ses tantes.
« Ils me soutiennent. Y’a ma mère qui me dit : « Alors quand tu vas passer en France, quand tu vas rester en France, dans le cas où tu, bon soi-disant tu vas terminer tes études, tu es obliger de revenir ». Ensuite, je lui ai dit comme quoi je vais partir au Canada. Elle m’a dit : « Le Canada, c’est loin ». Elle me dit : « le Canada, c’est vraiment loin. Pas comme la France ». Alors, je lui ai dit : « Tu sais maman, quand je vais prendre l’avion. Je vais prendre l’avion, je vais prendre l’avion, je vais prendre l’avion. Alors la France, le Canada, c’est… Je vois pas… Et puis y’a ma tante qui… D’accord. Mais revenir en Algérie, jamais ! »
Hakim, quant à lui, a anticipé l’hypothèse que son projet n’aboutirait pas sur une installation en France. Il a en effet entamé une procédure d’émigration au Canada depuis la Tunisie.
« Et le Canada alors, c’est venu comment cette histoire ? Bon le Canada, je sais pas, j’ai fait ça, d’abord parce que c’est facile, ils sont pas très, c’est pas pour étudier ou, c’est…aller vivre au Canada, donc c’est pour travailler, c’est donc euh. Et je l’ai fait, je sais pas, pour avoir au moins une issue. Comme ça, même si toutes les portes sont bloquées, j’ai quand même dans trois ans quatre ans, j’ai quand même une issue. Je peux toujours partir. Mais sinon, j’ai pas vraiment, le Canada, je connais pas trop, leur système et tout. Et ce qui me plaît au Canada, c’est que, ils sont très clairs dans cette question d’immigration. »
Nous avons parlé d’affirmation de l’individu en tant que sujet, repérable par l’importance de l’utilisation du « je » dans le discours des interviewés mais il s’agit maintenant pour nous de nuancer notre propos. L’émigration est en fait une conjugaison à plusieurs, le phénomène étant lui-même insérer dans les contradictions inhérentes à l’émigration.
2.2 L’investissement des parents dans l’émigration des enfants : une complicité entre ascendants et descendants
S’il apparaît que le choix de la filière corresponde à une stratégie assez précise de l’étudiant en tant qu’acteur, nous allons voir que cette stratégie ne se fait pas sans la participation active des parents, sinon d’une tierce personne le plus souvent masculine. Il existe dans tout les cas d’une complicité des parents143 à l’encontre du projet migratoire de leur enfant même si elle n’est pas formulée explicitement. La stratégie tourne autour de la scolarité. Cela va des parents initiateurs du projet à ceux affichant des réticences alimentées de prétextes dont ils ne semblent pas convaincus eux-même. La filière doit être porteuse. Bien que l’on perçoive parfois des réticences, elles ne constituent pas franchement une opposition au projet et elles sont alors suivies d’une aide active des parents. Les étudiants les plus autonomes, tenant beaucoup à cette autonomie, font abstraction dans leur discours de l’avis de leurs parents. Ils les placent implicitement de leur côté. Nous assistons en quelque sorte à une modernisation des relations entre les parents et les enfants. Ils partagent un intérêt commun et agissent
143 Il serait intéressant de mener une enquête sur les réelles motivations de l’investissements des parents dans l’émigration des enfants. Nous pouvons déjà émettre l’hypothèse de l’ « assurance » que représente la présence d’un immigré dans la famille. L’émigration serait alors économique mais pour ceux qui restent.
83
rationnellement, certes à des degrés divers. L’émigration d’un enfant est un investissement des parents à son égard mais aussi pour eux-même. C’est une sécurité, un capital. L’aide des parents est de plusieurs ordres. Elle se fait en fonction des différents capitaux, économique, social et culturel en possession. L’aide la plus facilement repérable est d’ordre financier. Les parents tissent également un lien important avec le réseau familial installé en France. Le choix de l’université en France se fait en fonction des capacités d’accueil sur place, de la situation géographique de la famille en France. La présence de membres de la famille permet d’avoir une connaissance plus objective des difficultés que l’étudiant risque de rencontrer à son arrivée et lui fait prendre conscience de toute la valeur de l’aide dont il peut bénéficier sur place. Ajoutons aussi la dimension cognitive et informationnelle transmise par la famille et nécessaire à la construction du projet. Nous pouvons observer tout d’abord un comportement nettement différencié des parents à l’égard de leurs enfants candidats au départ en fonction du sexe, mais aussi inversement, des intéressé(e)s vis-à-vis de leurs parents, ce qui recoupe la dimension sexuée déjà observée de l’émigration. Observons maintenant, comment s’articule, entre l’individu et son groupe, l’élaboration du projet migratoire, selon le sexe de l’étudiant :
2.2.1 Pour les garçons Ferhat présente tout d’abord ses parents comme relativement réticents. Sa mère tout d’abord qui a déjà vu un de ses fils partir en France et qui pressent que ce n’est qu’un début. Elle assiste au départ de ses enfants de façon passive.
« Un petit peu ma mère qui est contre. Ah, ta mère. Ouais. Ma mère qui est contre parce que la structure familiale en fait surtout des Kabyles, y’a l’attachement tout ça, la structure familiale, et puis au bout de 25 ans, en vivant dans la même famille ensemble et tout ça, et puis du jour au lendemain, elle se rend compte que son fils va quitter et tout ça parce qu’il y a… Elle a déjà un fils qui est parti… Donc un autre »
Ferhat présente également son père comme réticent - il n’a visiblement pas encouragé son premier fils à émigrer. A cela deux raisons : premièrement, son père ne l’invite pas à vivre ce que lui-même a vécu dans cette expérience, deuxièmement, l’émigration pour études a un coût, qui peut fort bien avoir raison de ses mensualités de retraite gagnée en France. Tout cela, Ferhat le sait, il l’a intériorisé. On peut très bien avoir les conditions objectives pour émigrer mais à cause de ces mêmes conditions avoir des difficultés pour le faire. Néanmoins, au final, son père ne s’y oppose pas. Devant la détermination de son fils qui réussit à obtenir un visa, il finit par l’aider en mettant à sa disposition le logement qu’il possède toujours en France.
« Mon père, au début, surtout quand il est parti le frère, il était contre l’idée de, parce qu’il était un ancien immigré. Ah ! Ton père, il est parti en France. Tu me parler de, il parle un petit peu de son expérience ? Pas, tu sais, mon père est pas vraiment, parce que, vraiment on se connaît pas trop. Donc, il est parti là-bas. Au bout d’une année, il vient pendant les vacances et tout ça, mais y’a pas eu de complicité donc euh… […] Mais il est pas contre ton projet ?
84
Non, non parce que, je sais pas, parce que réellement on n’a pas eu de discussion réellement sérieuse. Effectivement, quand je vous ai parlé de mon père avant, enfin de mon frère qui était là-bas, au début il était contre. Quand il a eu son visa, puis toutes les démarches, tous les frais, c’était lui qui les a gagnés parce qu’il travaillait. Donc, il a toujours eu l’idée. Donc il n’avait pas le choix réellement. Donc il a décidé de partir, donc il part. Oui, ton père a été mis devant le fait accompli en fait. Voilà. Mais il ne l’a pas encouragé financièrement, c’est pour ça que… Non, il l’a aidé là-bas. Il lui a laissé son studio là. »
La relation de Ferhat avec sa famille est relativement distante. Il n’utilise qu’une fois le « on » en se référant au groupe familial et il n’est pas clairement inclusif ou exclusif. Il utilise le « on » (je + son père) mais pour enchaîner sur une négation. Dans son discours, le « on » inclusif, familial ou général, est marqué par la passivité. Il faut le mettre en relation avec le pouvoir individuel du « je » en tant qu’individu, c'est-à-dire Ferhat. Mais c’est surtout le pouvoir de son oncle, premier personnage de son récit bien qu’il ait à peu près le même âge que lui, qui l’invite à venir en France. On repère à son propos une forte présence des verbes d’action, notamment de mouvement, mais aussi des verbes factitifs et performatifs. Le deuxième personnage est son frère dont il parle à un moindre degré de la même manière. C’est aussi le pouvoir individuel de son père qui l’aide finalement, à qui il reconnaît une capacité d’action sur autrui (son frère et lui-même). Ce sont, soit dit en passant, tous des figures masculines. Le pouvoir d’action dans le discours de Ferhat est individuel et masculin. Il correspond, même s’il est tacite, à une valorisation de l’individuation du sujet au sein du groupe familial. Les parents au final sont complices de la décision que prennent leurs enfants. D’ailleurs Ferhat ne leur parle même pas de son projet. Il va les mettre en quelque sorte devant quelque chose qui tient de l’évidence144.
« Il (son père) va t’accompagner en fait ?Mais là en ce moment, est-ce qu’il t’aide pour les démarches, pour le… ? Financement, non. Je n’en parle même pas, même pas à ma mère, donc euh…Effectivement donc c’est mon argent, de poche, que je dépense dans les démarches. »
Une autre évidence tient dans le soutien que l’étudiant peut recevoir de la famille présente en France. Bien que les structures « traditionnelles » de la parenté, comme nous l’avons vu, aient perdu de leur poids avec la migration, c’est encore essentiellement par elle que se tisse le réseau migratoire mais dans un rapport inversé en quelque sorte. Peu importe la proximité dans la parenté, l’essentiel est de partir. Les familles qui n’ont pas ou peu d’émigrés dans l’immigration vont chercher à tout prix des alliances migratoires. Le projet d’immigration rapproche. On va rechercher de la parenté là où il n’en existe pas. Un membre de la branche familiale issu du côté maternel n’a en temps ordinaire aucune valeur. C’est un simple allié, ce n’est pas un parent145. Il est plus facile de lui demander de l’aide. C’est donc pour cela que l’on va tenter sa chance auprès de lui. Ferhat a un oncle en France qui est légèrement plus âgé que lui et avec qui il a partagé des moments de son enfance. Il le présente comme un soutien à son projet.
144 C’est l’évidence de la tradition. 145 La parenté du côté du père est habituellement régie par une obligation de solidarité beaucoup plus forte et par là-même beaucoup plus conflictuelle. Plus le lien est fort, plus important sont les comptes à rendre.
85
« Qui d’autre peut t’aider là-bas ? Mon oncle peut-être. Ton oncle, il est sur Paris aussi ? Ouais. Il va m’aider peut-être, voilà. Je sais pas parce que, la situation actuelle est un peu différente par rapport notre situation ici euh, le vécu aussi en Algérie, c’est par rapport à ça. Je sais pas dans quelles conditions réellement je vais le trouver. Effectivement donc, s’il s’en sort, je sais bien qu’il va m’aider mais, financièrement, mais au moins, au moins psychologiquement il va m’aider. »
Nous avions parlé de l’importance de la fratrie à propos des prédécesseurs. Elle intervient aussi de façon importante dans l’économie146 de la migration. Ferhat a également un frère en France. Celui-ci lui a promis de l’aider. A l’entendre, nous avons l’idée du sacrifice du frère aîné pour le cadet.
« J’ai un frère actuellement là-bas. Donc, lui, au contraire, il m’a dit que quand on arrive ici, je ferais tout pour que vous suiviez les études le plus normalement du monde et tout ça. »
Faisons une petite parenthèse au passage à propos de Salim. Quand nous lui demandons ce qu’en pensent ses parents du projet de partir, il fait un lapsus en faisant parler sa mère. Bien qu’elle soit tout à fait passive dans son projet, car sous le contrôle de la domination masculine147, elle possède un bagage scolaire supérieur à son père mais elle représente surtout le rameau familial immigré en France. Nous avons précédemment présenté Hakim comme complètement autonome vis-à-vis de ses parents, entre autre du fait qu’il travaille. Mais il n’est pas indépendant d’une tierce personne, en l’occurrence, d’un de ses directeurs de thèse, pas l’Algérien mais le Français. C’est le seul personnage de son discours qui ait une emprise sur lui et dont dépend toute la procédure de départ et tout son projet. Si Hakim s’est fortement individualisé, c’est au prix d’une fragilité accrue qu’il conjure en affichant une certaine certitude, une volonté tenace et en faisant une présentation souvent avantageuse de lui-même. A l’heure de l’entretien, son contrat de recherche était signé. Il était donc déjà parti dans sa tête et même dans les faits.
« C’est pas un problème pour moi parce que, donc déjà le directeur de thèse je l’ai connu ici, on a travaillé ensemble, j’ai pas eu de problème pour les démarches parce que il s’est chargé lui-même de toutes les procédures administratives, m’équivalence ainsi de suite, c’est lui qui m’a fait l’inscription, je n’ai rien fait ici. Et voilà, je sais ce que je vais faire réellement, donc la problématique (de la thèse) c’est la même. »
2.2.2 Pour les filles A la différence des garçons, c’est uniquement à partir du groupe que les filles peuvent agir. On repère ce phénomène dans leur discours à partir du « on » inclusif (je + le groupe familial). Alors que l’action du « je » chez les filles s’accorde surtout au conditionnel, c’est avec le « on » inclusif que s’accorde au présent les verbes d’action. De plus, comme nous allons le voir, pour elles le rôle du père est central. C’est le cas d’Akel qui délimite la cellule familiale autour de laquelle se dessine une frontière vis-à-vis des « autres », du « on » exclusif. Bien qu’elle établisse également une distance entre elle et ses parents, son père plus que sa mère, c’est son père qui tient le rôle principal de
146 Le terme « économie » est pris dans son acception étymologique, à savoir qu’il vient de oïkos : maison et de nomos, nemein : administrer. Il est utilisé ici du fait que la migration se situe essentiellement dans la parenté. 147 Nous avons demandé s’il était possible d’avoir un entretien avec sa mère. Cela ne fut pas possible. C’est avec son père que nous avons eu une conversation alors que celui-ci maîtrise peu le français.
86
l’action. Akel s’affirme bien en tant que sujet comme les autres étudiants, quel que soit leur sexe, dans la définition de son identité, sa volonté et l’affirmation de ses aspirations, mais son « je » porte difficilement la marque de l’agir. C’est par le « on » inclusif qu’elle passe plutôt à l’action. On s’aperçoit vers la fin de son entretien que son père est intervenu de façon active dans son orientation.
« Mon père me dit : « T’as pas le choix ! ». » Le choix de la filière que suit actuellement Akel s’est fait à l’instigation de son père. Il a fait un choix qui semble plus rationnel en finalité, que ce soit en terme de formation ou dans une perspective migratoire, le but poursuivi ici étant de concilier formation et émigration. En effet, devant la déconvenue amoureuse de sa première rencontre et l’état dans lequel elle se retrouve, son père la pousse à changer de filière afin de la remettre en quelque sorte sur les rails. Elle accepte cette nouvelle orientation vers la filière économique et se l’approprie si l’on en juge par les termes qu’elle a utilisés précédemment.
« Mon père, il vient et puis voilà : « j’ai discuté avec quelqu’un, c’est un ami à moi. Il peut te faire un transfert à… ». Moi je voulais plus faire Biologie. Je voulais plus entendre parler (sa première rencontre amoureuse)… Lui (son ex-petit ami), il était dans le même institut. Il était en Médecine. Je pouvais pas le voir tous les jours. C’est au-dessus de mes forces. Je peux pas. Impossible. Donc il (son père) a vu quelqu’un, un ami à lui. « Voilà, je pourrais faire un transfert en sciences économiques ». Et moi, j’avais fait Sciences au lycée. J’ai fait filière Sciences. Moi, je connais pas l’économie. Je savais même pas de quoi ça parlait. L’économie ? Qu’est-ce que je vais faire en économie ? Donc il me fait mon père : « T’as pas le choix ! ». Finalement, je me suis inscrite en économie. »
« Mes parents, mes frères n’ont pas d’influence sur moi. Je prends mes décisions comme je le veux. Y’a seulement mon père et ma mère qui interviennent. » Layla, quant à elle, a suivi une filière scientifique au Lycée bien qu’elle envisage déjà des études littéraires. Après l’obtention de son bac, elle choisit d’entrer, contre l’avis de ses parents au département de berbère. L’université représente probablement pour Layla une émancipation. C’est un lieu qui, au regard de l’ambiance environnante, permet de « vivre » tout autant qu’étudier. Ses parents sont clairement opposés à ce projet et lui préfèrent une filière scientifique comme le lui permet son Bac. S’en suit des négociations entre elle et ses parents. Layla s’affirme. Ils finissent par accepter à la condition qu’elle passe à nouveau le bac pour suivre un deuxième cursus en parallèle. Elle a déjà été orientée de plusieurs manières par ses parents, par la langue, le français, par le choix de la filière même si elle semble avoir eu le dernier mot, et par la perspective de poursuivre ses études en France. Nous voyons qu’ici, le projet de départ est encouragé et à bien des égards initié par ses parents qui entendent choisir les filières porteuses dans ce sens. Nous pouvons ici nuancer le niveau des stratégies développées par les parents et l’étudiant. Layla vise un niveau stratégique plus individuel que ses parents. Elle veut réussir son émigration mais aussi sa vie. Ils essaient quand à eux d’agir selon une rationalité en finalité en vue du départ et en recherchant l’efficacité maximum. C’est ainsi qu'ils agissent stratégiquement même avec leur fille. D’autre part, les parents et les enfants, dont les âges diffèrent d’une génération, n’ont sans doute pas la même appréhension du temps.
« Arrivée en terminale, je devais passer mon Bac, donc je l’ai eu à la première fois. Mes parents n’avaient pas voulu que je fasse Tamazight. J’étais une scientifique, donc il vouait quelque chose de scientifique, Biologie ou Médecine, quelque chose comme ça. En fait, je me suis battue. La première fois, ils m’ont envoyée, donc j’ai pas inscrit
87
Tamazight dans mes dix choix qui m’ont été proposés. J’ai été envoyée vers le tronc commun S.I.T.I., informatique quelque chose comme ça, technique et informatique. En fait après, j’ai essayé de convaincre mes parents que j’ai été attirée pas cette langue, par le Tamazight, je voulais aller loin. Ils ont accepté de faire le transfert vers Tamazight à condition que je refasse mon Bac et que je l’obtienne pour faire une autre filière, en parallèle. »
« Pour eux Tamazight ça ne suffira pas. C’est pas ouvert à l’étranger. » La détermination des parents de Layla ne s’arrête pas là. Ils entendent, grâce à l’obtention de ce deuxième bac, l’orienter vers la filière Français avec une raison clairement énoncée : Le berbère ne permet pas l’ouverture. Elle rate de peu le nombre de point nécessaire à l’entrée dans cette filière Français - ce que nous considérerions peut-être en psychologie comme un acte manqué ; elle est alors orientée vers le Droit.
« Tu as fait un Bac scientifique. Mais il fallait que tu refasses un Bac ? Oui, scientifique. Pourquoi ? Donc, c’était une obligation de mes parents. Ils n’avaient pas voulu que, avec mon premier Bac de faire Tamazight malgré qu’ils savent bien que je n’aurais jamais fait autre chose que Tamazight, donc ils veulent que je refasse le bac avec une promesse de l’obtenir quand même. Si j’ai bien compris, parce que c’est pas évident, il faut refaire le Bac pour pouvoir refaire le choix d’une université ? Pour eux Tamazight ça ne suffira pas. C’est pas ouvert à l’étranger. [….] En parallèle, j’étudie le berbère, pour qu’ensuite, après l’obtention de mon deuxième Bac, ils puissent choisir eux-même ce que je dois faire en parallèle avec Tamazight. Pour eux c’était le français. Ils voulaient vraiment que j’étudie, que je fasse des études de français pour que ça m’ouvre des portes vers la France. En fait, après j’ai pas eu la moyenne qu’il fallait pour entrer … Au département de Français. Oui. En fait, il me manquait 0,04. Voilà (en souriant). J’ai été orientée vers le Droit malgré que j’étais une scientifique. »
Le discours de Layla s’articule autour de la relation entre elle et son père. Quand elle parle de ses parents, c’est en fait de son père dont il s’agit. Le père a une position centrale dans le groupe familial. De sa mère Layla dit : « Elle n’a pas beaucoup d’influence » Mais il n’en demeure pas moins qu’elle l’encourage dans son projet. Elle intervient pour avaliser les décisions et les actions de son mari. Chez Layla, l’action se situe principalement au futur, quand elle aura émigré. Elle est en quelque sorte sujet en pensée, pas encore en action.
« Il m’a laissé le choix. C'est-à-dire, c’est à moi de décider.» Ce lapsus est apparu dans le discours de Hakima. Il intervient après qu’elle ait à plusieurs reprises dit avoir accepté une situation qui lui était imposée. Elle affirme par exemple préférer l’anglais, mais au Bac elle obtient une meilleure note en français, filière vers laquelle elle sera orientée. Elle éprouve dans son discours comme la nécessité de se justifier en déclarant que tout compte fait, c’est le français qu’elle voulait étudier. Il s’agit d’une hétéronomie148 qui se
148 Hétéronomie : État de la volonté qui puise hors d'elle-même, dans les impulsions ou dans les règles sociales, le principe de son action. Absence d'autonomie. Cf. Le Petit Robert (2001).
88
traduit ici par sa dépendance aux événements. Mais cette hétéronomie est niée au point de revendiquer une autonomie. C’est ce qu’elle tente encore de faire lorsqu’elle déclare être indépendante de son père. Elle a ressentie le besoin de réitérer, qui plus est dans un mode indirect, son affirmation d’indépendance, comme quoi sa situation ne paraît pas si évidente. Elle ne décide en fait que selon le bon vouloir de son père. Bien que par ailleurs elle s’exprime selon le mode de la volonté, celui-ci est lié à un constat d’incapacité, d’une volonté au passé qui ne s’est pas traduit par une réalisation des souhaits. Comme pour les exemples féminins précédents, quand elle parle de ses parents, c’est surtout du père dont il s’agit. Sa mère est peu évoquée. Elle fait d’ailleurs un autre lapsus quand, en parlant de ses parents, elle utilise le « il », 3ème personne du singulier, au lieu du « ils » pluriel des parents.
« C’est ça. J’ai eu un Bac scientifique. Euh, voilà. J’ai voulu faire d’autres filières mais ma moyenne ne le permettait pas. Je voulais faire peut-être Pharmacie ou quoi autre chose. Ah ! Une filière scientifique. Mais puisqu’on m’a orientée vers les Lettres, j’ai accepté. Dans les Lettres, tu avais le choix entre plusieurs langues peut-être ? Oui, je préférais anglais. Mais comme par hasard, en passant le Bac, j’ai pas eu une bonne note (sourire). D’accord. Donc tu as pris français alors. Oui. C'est-à-dire la note de français, c’est plus élevé que la note d’anglais. Mais j’ai voulu faire français en réalité, c’est pour cela que je l’ai accepté. D’accord. Et tes parents, tu peux me parler un peu d’eux ? Est-ce que ton père est… ? Qu’est-ce qu’il fait ? Et par rapport à ton orientation, qu’est-ce qu’ils en pensent, enfin qu’est-ce qu’ils en disent ? (Sourire) Il m’a laissé le choix. C'est-à-dire, c’est à moi de décider. Ils sont inquiets bien sûr, mais… »
Même si la place du père est centrale, les filles n’en reçoivent pas moins le soutien de leur mère même de manière tacite. Nous observons, chez Akel, une différence entre le soutien matériel et financier de son père et le soutien « cognitif » de sa mère, d’un côté le rôle « visible » du père, de l’autre le rôle « invisible » de la mère. Les parents au final aident plus activement leurs filles que leurs fils.
« Ben oui, financièrement ils m’aident, euh, y’a pas de problème euh. Ma mère, elle est toujours sur Internet. Quand il y a une nouvelle information, elle vient m’informer : « voilà, viens voir le site, tel site y’a un truc ». Mon père aussi quand il discute comme çà, il dit : « voilà, j’ai discuté avec un étudiant, apparemment cette université accepte beaucoup les Kabyles, tatati »…donc c’est çà. »
Le soutien prend chez la mère de Layla, la forme d’encouragement. Elle fait aussi une projection sur sa fille de ce qu’elle aurait aimé faire plus jeune, « être libre » et partir en France via le mariage avec un émigré.
« Pour ma mère, c’est plus pour moi qu’elle opte, elle veut que je parte moi, parce que c’était son rêve de jeune fille, de se marier en France, en fait avec un émigré, partir en France. Elle veut que je fasse, que je réalise son rêve. C’est plus pour avoir, avoir ma liberté, parce que dans cette société kabyle et surtout dans les autres, c’est difficile pour une fille de travailler comme elle le veut, de sortir comme elle le désire. Voilà. […..] Parce que je, pour moi, le but vraiment pour que je parte, en France, c’était, c’est pour moi, la soif de liberté. C’est-à-dire malgré que mon père ne, c’est-à-dire il est ouvert,
89
mais quand même il se limite à la société. Il ne peut pas enfreindre certaines lois de la société. Donc pour moi, c’est plus la liberté, de trouver ma liberté de… Ah quand tu dis : « enfreindre les lois de la société », qu’est-ce que… Y’a des choses que tu ne pas faire ici ? Oui. Et que tu aimerais pouvoir faire. Quoi par exemple ? En fait, par exemple pour faire un doctorat, on a besoin, surtout pour les recherches, on a besoin de marcher, de trouver des personnes à, à interviewer, etc. Mais c’est difficile pour une fille de faire ce travail là. La recherche, ici, c’est uniquement réservé aux garçons. Ah, d’accord. En fait, c’est difficile de trouver une fille qui se balade ici et là, c’est réservé aux garçons. »
Nous constatons ici que le discours de Layla fait écho à celui de sa mère. Elle exprime le besoin de liberté qu’elle n’estime pas pouvoir trouver dans la société algérienne. C’est une remise en cause par les femmes à des degrés différents de la domination masculine149, de la prédominance de l’homme sur la femme, ressentie aussi bien dans la société algérienne que dans la société kabyle, si tenté que l’on puisse en faire une distinction. C’est de la place des femmes dans la société dont il est question, mais aussi la présence d’une solidarité féminine dans la migration, repérable par les soutiens tacites des filles par leurs mères.
2.2.3 Le contrôle des filles selon leur degré d’affranchissement Nous notons donc une attitude nuancée des parents selon que l’on ait affaire au père ou à la mère, et ceci en fonction du sexe de l’étudiant. L’émigration possède une double dimension sexuée. Les parents encouragent leurs enfants de façon active ou passive, voire même initient leur projet migratoire par l’orientation scolaire. Mais nous observons une différence majeure de comportement des parents et de la famille selon le sexe de l’étudiant. Et cette dimension sexuée comporte une dimension éminemment morale. Il apparaît clairement une volonté de contrôle des filles, surtout de la part du père qui s’érige en garant de l’honneur de la famille. Mais ce contrôle n’est pas le fait du père seulement. C’est un contrôle de toute la famille. C’est en se penchant sur l’économie de l’émigration que nous constatons le mieux ce phénomène de contrôle. Il s’agit tout d’abord de la réticence plusieurs fois constatée des pères vis-à-vis du départ de leur fille. Ecoutons Hakima :
« Et ta mère, elle en pense quoi ? Ma mère veut bien que je parte. Ta mère veut bien que tu partes. Oui. Qu’est-ce qu’elle dit pour ça ? Elle est d’accord. Oui, mais bon, en même temps, sa fille elle va s’éloigner alors, bon, y’a du pour y’a du contre. Pourquoi ce serait bien pour toi ? Elle sait bien que j’aime les voyages et que j’aime, je suis très curieuse. C’est suffisant. Et ton père ? Il est vraiment inquiet.
149 BOURDIEU P. (2002), La domination masculine, éd. Du Seuil, Coll. Points Essais, Paris.
90
D’accord. Il est inquiet par rapport à quoi ? Par rapport à tout. Je suis une jeune fille. »
La condition du départ dépend des conditions dans le pays d’arrivée. Ces conditions sont traduites dans le discours en terme matériel, notamment de logement. Mais il ne s’agit pas d’un simple logement, une chambre universitaire pourrait suffire, mais d’un logement chez quelqu’un.
« Quels obstacles tu rencontres dans ton projet ? De départ ? Oui C’est côté matériel. Matériel ? C'est-à-dire ? C'est-à-dire, il faut avoir un compte euh, il faut avoir de l’argent vraiment. C’est trop. Et euh, tes parents, ils t’aident pour ça ? Bien sûr, mais ils sont pas tout à fait d’accord, à moins de trouver quelqu’un chez qui je serais. Chez qui tu peux loger ? Oui. »
Il semble inconcevable que les filles puissent émigrer, partir à l’aventure, sans protection. A priori, l’intention est généreuse mais la nature de cette protection est définie de manière très précise. Elle doit être l’œuvre d’autres membres de la famille résidant en France, sinon de personnes sûres. L’important est d’avoir un garant de la famille sur place. Les parents d’Akel, son père et sa mère sont d’accord avec son projet de partir étudier en France. Elle cite « toute ma famille » en faisant référence à la branche familiale présente en France qui pourra l’héberger à son arrivée.
« Et tes parents, ils en pensent quoi ? Ah mes parents y’a pas de problème. Moi mes parents, ils sont d’accord. Hmmm Moi mon père y’a pas de problème, ma mère aussi donc euh, surtout le fait qu’il y a toute ma famille là-bas. Bon, peut-être si j’avais aucune famille… Hmmm Peut-être si je m’aventurais seule, là il y aurait un petit souci. Peut-être euh, mais comme ils me font confiance, donc ils savent bien que je suis bien déterminée, je pense que même là dans ce cas là, il y aurait pas eu de problème. Mais là y’a pas de problème du tout. »
Le père de Layla est quant à lui réservé et préfèrerait qu’un des fils ouvre le voie de son départ. Il jouerait alors le rôle de garant vis-à-vis du reste de la famille.
« En fait, pour mon père, il pousse plus mes frères que moi. Puisque pour lui, il doit d’abord avoir quelqu’un sur lequel on doit se baser là-bas en France, puis je dois partir en second. Mais mon père, il veut que mes deux frères partent parce que, pour lui, c’est pas une société enfin, je parle selon lui, il n’aime pas cette société, puisqu’il a vécu en France et il a vu l’écart qu’il y a entre les deux sociétés et … »
Nous apprenons plus loin, lorsqu’elle parle du choix de son université à Paris, qu’elle a déjà deux oncles qui sont en France et qui pourrait l’accueillir, jouer ce rôle de garant, mais il semble bien que l’un soit, aux yeux du père, plus sûr que l’autre.
« Tu as choisi quelles universités ?
91
Donc pour Paris, et la deuxième je me souviens pas, puisque à Paris j’ai de la famille là-bas. Ah ! Qui ? J’ai mon oncle, mon oncle, enfin paternel et maternel, le frère de mon père et le frère de ma mère. T’as deux oncles alors ? Oui. Ils sont sur Paris ? Oui. »
[…] « Et arrivée sur place, tu vas chez qui, chez ton oncle paternel ou maternel ? En fait, j’irai d’abord chez mon oncle paternel. Par la suite j’irai un peu chez mon oncle maternel. Donc c’est équilibré. C’est pas prévu que tu prennes une chambre universitaire ou quelque chose comme ça ? Ça aurait été mieux, pour moi c’est (sourire), je voulais, vraiment je voudrais avoir une chambre à l’université, à la résidence. Je ne gênerai personne, je me prendrai en charge mais… Tu seras plus libre. Oui. Aussi. Oui. Bien sûr. Peut-être ton oncle, il va te surveiller un peu, non ? Oui (sourire). Enfin, c’est pas mon oncle paternel, mais mon oncle maternel, si. Ah d’accord. Y’en a un qui te surveillera mais pas l’autre. Mon oncle paternel puisque… Pourquoi, ça vient de quoi ça ? Enfin mon oncle paternel, il est ouvert, depuis, ça fait longtemps qu’il est parti là-bas, il est très ouvert par rapport à, déjà par rapport à mon père et à mon autre oncle. Voilà. Il me tolèrerait. Beaucoup de choses, à part si je dépasse les limites bien sûr. Là, il interviendrait. »
L’âge de l’étudiant, et plus encore pour les étudiantes, compte pour beaucoup. On reconnaît ici encore une valence différentielle des sexes. Passée un certain âge, une femme à la maison est une charge, car dans bien des cas elle ne travaille pas ou n’est pas sensée travailler contrairement aux garçons. Nous retrouvons ici la place de la femme dans la société kabyle où il est encore difficile pour elle de développer une activité économique en dehors du foyer familial et de devenir ainsi financièrement autonome. Tazrut, à défaut d’être totalement autonome, est relativement affranchie (elle possède une voiture) et semble avoir exploité la marge de manœuvre qui était à sa disposition. Comme Akel, elle a 26 ans, un âge où les filles étaient autrefois mariées et avaient quitté la maison des parents (souvent pour intégrer celle des beaux-parents). Il est significatif que Tazrut n’ait pas parlé spontanément de ses parents. Elle présente comme une évidence le fait qu’elle quitte la maison parentale de son propre chef. C’est sa décision nous dit-elle.
« Et tes parents, tu leur as dit ? Oui. Ils le savent. Tu leur as dit Oui, oui, ils le savent. Y’a… Et alors ?
92
[…] La décision, c’est moi. Bon la décision, c’est qui qui va la prendre, c’est moi qui va la prendre alors euh…. Mais tes parents, ils en pensent quoi ? Non, non, mes parents me disent : « Tu fais ce que tu veux ». Quand même, j’ai 26 ans, bientôt 26 ans. Qui va me dire euh ? Mes parents, ils me soutiennent. »
Tazrut nous déclare recevoir l’aide de ses parents, non pas sans un certain signe de résignation de leur part marqué ici par le « puisque tu veux partir ». Il leur semblait tout lui avoir donné : « tu vis comme une reine », mais, peut-être cela fait-il suite à une incompréhension, ils consentent finalement à l’aider dans son projet de départ.
« Toujours par rapport à tes parents. Tu dis qu’ils t’aident etc., bon je suis un peu surpris, t’es leur fille qui va partir. Quels moyens ils mettent en œuvre pour ça ? Ah pour moi, tous les moyens. Financièrement tout. Tout, tout, tout. Ils me disent : « puisque tu vas partir alors euh… ». Quand même, ils vont pas m’empêcher à partir. C’est moi qui le veux. Personne ne m’a obligé. Ils me disent : « Bon t’as tout ici, tu vis comme une reine. Tu as tout les … ». Oui. »
Saïda est plus âgée encore et, comme nous l’avons vu plus haut, travaille. Elle détient une autonomie supérieure aux autres filles. Il n’en demeure pas moins qu’elle vive encore chez ses parents car c’est impossible pour elle de faire autrement. Il n’y a pas de femmes célibataires vivant seules, sauf à vivre de façon marginale ou dans la clandestinité. On peut en quelque sorte rapprocher le cas de Saïda des deux précédents qui ont passé l’âge à partir duquel une jeune fille n’est plus sensée être chez ses parents mais mariée. Elle n’a aucune peine alors de les mettre devant elle aussi le fait accompli.
« Qu’est-ce qu’en pensent tes parents, enfin qu’est-ce qu’ils disent ? Mes parents ? C’est-à-dire que j’ai des parents qui ne sont pas instruits mais assez tolérants quand même et compréhensifs. Et puis, les histoires de départs, ils se sont habitués avec mes frères. D’accord Ils se disent : « une de plus qui part, c’est, c’est… »
Au-delà de cette résignation des parents, nous sentons poindre ici la question fondamentale du mariage. Nous avons abordé l’émigration au début de ce chapitre en terme de conjugaison, conjugaison de personnes à commencer par l’individu, l’étudiant candidat au départ, mais aussi conjugaison dans des temps différents. Cette conjugaison de l’individu n’est pas qu’une question d’individu ou du groupe ; c’est la nature même de l’émigration algérienne, individuelle et masculine, qui provoque cette conjugaison de soi avec les autres. Cette conjugaison est aussi spatio-temporelle, spatiale entre ici et là-bas, temporelle dans le futur. C’est un projet éternel, nécessairement dans le futur. Ce projet lie les uns aux autres, car ils se décident par les autres. L’individu « je » n’est ni vrai ni faux, il se trouve en porte-à-faux, en décalage, car il n’en a pas toute la maîtrise. Ce « je » n’est-il pas plutôt grammatical que véritablement sociologique ? N’est-ce pas un « je » artificiel, un « je » en rêve ? Ce n’est peut-être qu’un mot, un « je » de langage.
93
3 - La question essentielle du mariage Nous avons perçu à plusieurs reprises la dimension sexuée de l’émigration. Elle apparaît dans le comportement aussi bien des étudiants que de leurs parents dans le processus d’élaboration du projet de départ. Elle se traduit par une prévalence du masculin sur le féminin. Nous la retrouvons également dans l’économie de la migration. Mais la surprise de cette enquête réside dans l’importance de la question du mariage dans le discours des interviewés. Nous l’avions pressentie lors des entretiens exploratoires et elle s’est confirmée lors de notre enquête. C’est une dimension que nous avions peu explorée lors de l’élaboration de notre problématique. Elle est parfois apparue alors que l’on ne s’y attendait pas. La question du mariage est une dimension cruciale et incontournable de cette enquête. Bien que cela ne soit pas toujours clairement formulé, le mariage pose problème aux étudiants des deux sexes candidats au départ. Le mariage au pays est perçu comme obstacle au départ et inversement le départ est un obstacle au mariage. Le mariage avant le départ, ce qui veut dire le mariage au pays, est perçu négativement par les filles comme par les garçons. Le mariage au pays rend le projet migratoire plus difficile – il présuppose un projet migratoire à deux, or l’émigration est d’abord et avant tout individuelle, ensuite masculine. A l’inverse la perspective du départ rend le mariage peu souhaitable, voire négatif. En effet, pour le candidat au départ, pour les filles comme pour les garçons, le projet de vie est conçu dans l’immigration. C’est aussi toute une conception du mariage et de la rencontre qui le précède qui est à revoir. Nous savons, que ce soit par observation sur le campus de l’université de Tizi-Ouzou ou à travers nos entretiens que nombreux sont les étudiant(e)s à avoir un(e) petit(e) ami(e). Ils se fréquentent à l’université et ont donc par conséquent à peu près le même âge. Or nous enregistrons habituellement un fort écart d’âge entre les deux personnes qui se marient. La perspective de se marier avec une personne du même âge n’est pas envisagée. Il incombe en effet à l’homme d’obtenir une situation économique suffisamment viable et stable, ce qui prend un certain temps. Il est donc fort probable qu’ils ne se marient pas avec la personne qu’ils fréquentent à l’université. Les étudiants entretiennent une illusion ou peut-être un silence sur une situation qu’ils ne savent pas viable à terme. Comment effectivement construire une relation ici quand on est déjà en esprit là-bas ? Peut-être avons-nous ici une première explication du fort de taux de célibat que connaît actuellement l’Algérie ? De plus, quand nous interviewons les étudiants, nous percevons un antagonisme de discours entre les deux sexes. Tous deux aspirent à autre chose que ce que leur propose jusqu’alors la société et au demeurant ils ne sont pas sur la même longueur d’onde. Les garçons revendiquent la possibilité d’une rencontre, c'est-à-dire la possibilité d’une sexualité, avant le mariage. Ils souhaitent en quelque sorte être « moderne » avant le mariage. Ils invoquent le fait que la décision du mariage ne puisse être prise à la légère et demande en quelque sorte une période d’essai. Mais nous repérons une contradiction lorsque nous les entendons dire qu’ils n’envisagent pas de se marier avec une personne avec laquelle ils auraient eu une expérience sexuelle. Dans le même temps, pour eux, la relation amoureuse n’implique pas le mariage. Il en ressort au final l’importante question de la virginité des filles, question encore taboue dans la société kabyle et algérienne. Les filles, qui ont beaucoup plus intériorisé leur position de soumission150, désirent se marier dans l’immigration, en France, même si c’est avec la personne qu’elle connaissait avant le départ. Elles veulent un mariage « moderne » après le départ. Les filles en refusant le mariage au pays aspirent à repousser les limites de leur espace, l’espace privé qui est aussi l’espace féminin. Il n’en demeure pas moins une contradiction notamment quand certaines d’entre-
150 Si elles ne sont pas allées jusqu’à me parler de sexualité c’est sans doute aussi du fait que je sois un homme. Mais peut-être me suis-je autocensuré sur ce sujet avec elles.
94
elles envisagent de se marier certes à l’étranger mais avec un Kabyle ou un Algérien. S’il arrive qu’elles conçoivent également le mariage avant le départ sur un mode plus « traditionnel » mais avec un émigré, c’est plus pour une question de sécurité, le mariage devenant dans ce cas un mode migratoire. Au final, les garçons se focalisent sur l’expérience avec une personne à l’instant présent en s’interdisant d’une certaine manière l’avenir avec celle-ci alors que les filles s’interdisent le présent, en se focalisant sur un avenir incertain.
3.1 Le mariage comme obstacle au départ, le départ comme obstacle au départ Le mariage au pays symbolise la non-réalisation du projet de départ. Tazrut a eu un petit ami pendant 7 ans. Elle l’a quitté parce qu’elle le trouvait trop sévère dit-elle, mais surtout parce qu’elle l’a trouvé avec une autre fille. Passons. En quelque sorte libérée d’une contrainte, elle exclut maintenant toute relation qui pourrait nuire à son projet. Elle cite à ce propos l’exemple d’une de ses sœurs qui est mariée et qui se retrouve donc « bloquée. »
« Et tu m’as dit que tu avais d’autres sœurs qui sont ici… Oui, j’ai une sœur mariée avec bon, deux enfants. Le deuxième, il est…en route (rires). Et puis j’ai une petite sœur, elle va passer son Bac cette année. Et une plus grande, elle a, bon elle est diplômée… Et qu’est-ce qu’elle compte faire elle ? Elle, aussi, elle veut partir. (rire) Toutes les trois ? Toutes les trois ? Toutes les deux. Non, pas celle qui est mariée. Non, non, celle qui est mariée. Elle est bloquée (rires). »
Pour Ferhat également le mariage est pour l’instant conçu comme un obstacle au départ. Il s’agit d’un calcul stratégique puisque, pour lui, la migration paraît plus difficile à réaliser à deux que seul et c’est effectivement le cas pour une migration dans le cadre d’une poursuite d’études.
« Ça veut dire, si tu te marries maintenant… Ah! (Claquement de mains) c’est fini donc. Si tu te maries maintenant, c’est fini ? Ah oui ! Tous les projets donc euh, effectivement c’est une responsabilité, dans mon projet d’aller en France. Est-ce qu’on va y aller ensemble ? Mais ce sera plus difficile alors effectivement. »
3.2 Le mariage comme stratégie d’émigration A la fin de l’entretien, Akel nous raconte sa vie amoureuse. Elle avait un petit ami, dans le même département que le sien - il s’agissait alors de sa première orientation en Biologie. Cette histoire a duré plus de deux ans. Il était persuadé qu’Akel avait la double nationalité, algérienne et française. Or, il apprend qu’elle n’a pas la nationalité française et s’écarte d’elle immédiatement sans donner de nouvelles. Cette première rencontre amoureuse est un échec. Son prétendant fréquentait en grande partie Akel parce qu’il croyait qu’elle avait la nationalité française. L’épouser, c’était obtenir le visa pour la France à coup sûr151. Il s’agit d’un acte manqué, pour lui comme pour elle. Il a raté son visa. Elle a raté sa rencontre.
151 Dans quelle mesure ne peut-on pas dire qu’épouser Akel c’était épouser la France ?
95
« Oui, c’est ma première année à l’université, il faisait Médecine lui. Bon […], soit disant, d’après ce qu’il me disait, apparemment il tenait à moi donc. Ça a duré trois ans. Trois ans, donc moi, je me suis vraiment attachée à lui et finalement, il a décidé de faire sa demande à la maison. Et lui, il croyait que j’avais la double nationalité. Mais je lui jamais dit que j’avais la double nationalité. Il savait que j’avais l’intention de partir en France, il savait bien que j’avais ma famille en France. Mais lui, il pensait que ma mère était française, que moi j’avais la double et que. Je voulais pas lui dire que je l’étais pas, et lui il était sûr que j’avais la double nationalité. Finalement, je devais partir en … en 2002, je devais partir en France. J’ai commencé à faire les démarches, pour un visa touristique, finalement j’ai pas pu partir. On a eu un petit problème familial, donc mon grand-père est tombé malade tout ça, le papa à mon père, donc on n’a pas pu partir. Donc quand je lui ai dit, c’est bon, je pars pas en France. Il est jamais venu à la maison, faire sa demande. Du jour au lendemain, plus de nouvelles, rien. Et moi, j’en avais parlé déjà à mes parents. Je leur ai dit voilà, y’a un jeune homme, il voudrait faire sa demande, tatati et puis voilà. Et, plus de nouvelles, rien. Le néant. Donc moi, j’ai failli faire une bêtise. Et j’étais dépressive, donc euh… J’ai pris des médicaments, j’ai failli euh… mettre fin à ma vie, voilà. J’étais vraiment, parce que… pour moi c’était bon. Trois ans, je le connaissais depuis trois ans euh, donc pendant un an j’ai raté mes études complètement. […] Quand je l’ai revu. Je l’ai revu. Je lui ai mis les points sur les i, on a discuté, voilà, voilà. Il fait : « mais moi, je croyais qu’on allait vivre en France ». Un truc, il m’a sorti un truc euh, bizarre donc je lui dis : « J’ai plus envie d’entendre parler de toi, tout ça. Maintenant, je suis plus étudiante. J’ai foiré mes années. C’est fini pour moi maintenant les études. » Il me fait : « de toute manière, même si c’était pas la France, moi je ne veux pas épouser une femme qui n’a pas de diplôme. »
Mais posons-nous un instant la question de ce que signifie une relation supposée amoureuse de plus de deux ans entre deux personnes sans qu’elles se soient dit l’essentiel durant tout ce temps. Il s’agit peut-être moins d’une illusion que d’un mensonge où l’on se ment plus à soi-même qu’à l’autre. Mais nous n’entrerons pas ici dans des considérations psychologiques et nous contenterons des faits. Akel nous conte ensuite sa deuxième rencontre. Il s’agit d’un cousin éloigné. Celui-ci l’avait repérée depuis qu’elle avait eu ses dix-huit ans. Il lui faisait des propositions de mariage depuis plusieurs années. Akel ne s’en préoccupait pas. Toute cette période fut accompagnée d’incitation de la famille. Ce n’est que cette année que s’est enfin faite la rencontre. Ils se sont vus quatre jours de suite et le vendredi de la même semaine, il est venu faire sa demande de mariage à ses parents. Alors que pour Akel la référence au monde qui l’entoure lui est pénible – elle parle de « leurs traditions », de « leur mentalité », « leur comportement » - elle engage en définitive une relation sur le mode « traditionnel » avec un membre de la famille, un cousin éloignée de la lignée de la grand-mère maternelle152. Elle narre sa rencontre en lui donnant une allure moderne, lui donnant les attributs de la rencontre hasardeuse, du romantique, du destin en évitant, en minimisant les attributs de la rencontre endogamique.
« Et ton petit fiancé qui est en France, tu l’as connu comment ?
152 Nous avons ici une excellente illustration de la déstructuration des règles de la parenté. Traditionnellement, le fils se mariait avec sa cousine parallèle, c'est-à-dire avec la fille de son oncle paternel. Nous sommes dans une région à dominante patriarcale. Or ici, peu importe de quel rameau de la famille il s’agit. L’essentiel étant que ce membre de la famille soit en France. Il a de plus acquis la nationalité française. L’émigration prime sur la parenté.
96
Ah ! Ça c’est une histoire… Elle est très comique. C’est quelqu’un de mon village. On a un lien de famille. Donc lui, sa grand mère-maternelle et ma grand-mère maternelle, c’est des cousines. D’ailleurs, il a le même nom de famille que ma grand-mère maternelle. C’est quelqu’un, bon qui était d’abord en Algérie. Il a fait lui des études de, à l’université, il a fait sport. Il a demandé un visa touristique. Il est parti en France. Bien sûr il a eu ses papiers, il a fait un mariage blanc euh, comme tous les Algériens, donc il a pu avoir ses papiers. Il a fait société des transports, des livraisons, sa propre société avec son frère. Donc, il a bien réussi et tout ça. Quand j’avais 18 ans, il s’intéressait à moi déjà. Moi, je savais même pas si c’est qui. On m’a toujours envoyé : « voilà Akel, Azzedine - il s’appelle Azzedine - il voudrait bien…. » C’est qui ? Moi, j’étais pas du tout intéressée. C’est qui Azzedine ? Ah non ! Ça m’intéresse pas. Je l’ai toujours … Snobé, ignoré… Ignoré. Je savais même pas comment il était fait. Donc, il a insisté insisté, puis après quand il est parti en France. On s’est perdu de vue. Moi, je l’ai vu une fois au mariage de mon cousin. On m’a dit que c’était lui. Je l’ai vu. Ça m’a… Ah bon, bon, c’est bon. Donc il est parti en France. Chaque année, il revenait l’été. Il me voyait toujours. Il me fait, moi, je dis toujours à mes amis : « Est-ce qu’elle est fiancée ? Est-ce qu’elle est mariée ? Et on me disait non ! Mais c’est pas possible, ni fiancée, ni mariée. Je me suis dit, faut que je tente ma chance encore. Il faut que je la tente. » Donc il est revenu, alors ça c’est l’année dernière. Moi, l’année dernière, kif kif153. Ah non, non je suis pas intéressée, tatati. Mais il me disait : « est-ce que, essaie, on ne sait jamais. » Non, non, c’est pas la peine de te casser la tête. Si ça se trouve la femme, la femme de ta vie t’attend en France. Oublie-moi. Fais ta vie. Bon moi, d’un seul coup, je sais pas euh, c’était comme ça, il me plaisait pas. Cette année, il est revenu. Je savais pas qu’il était en Algérie. Je ne savais pas. Et comme c’est quelqu’un de la famille, il a des contacts avec ma tante qui est en France et ma grand-mère. Et c’est quelqu’un qui est très apprécié par rapport à ma famille. Et c’est tout le monde qui me dit : « Pourquoi ? Mais essaye…» Tout le monde m’encourageait. Moi je leur disais : « Non, hors de question. » Ma grand-mère bien sûr : « C’est quelqu’un de ton village. C’est quelqu’un de notre famille. Qu’est-ce que tu veux de plus ? Il a bien réussi, il a les papiers. Qu’est-ce que tu veux ? Il a tout ce qu’il faut. » Non, non, non. Comme par hasard, j’ai écrit un texto à ma tante : « Voilà, si tu veux me donner le numéro de Azzedine. Je voudrais lui écrire un texto. » Elle m’appelle tout de suite : « Pourquoi tu cherches son numéro ? Tu l’as envoyé balader. Laisse–le tranquille. Tu vas encore le… ». Non, c’est seulement pour avoir des, il était tellement gentil. Pour avoir de ses nouvelles, si ça va. Mais franchement, il avait pas vraim… Il y avait rien hein. Elle dit : « je l’ai appelé, il est en Algérie, il vient juste d’arriver.» « Ah bon ! » Il y a 15 jours de cela. Je fais : « Ah bon ! » Elle me fait : « Oui. D’ailleurs il va te rappeler. » Il me rappelle : « Salut Akel, comment ça va, tatati. » « Ça va et toi ?. C’est juste pour avoir de tes nouvelles ». « C’est comme tu m’as dit. C’est juste pour avoir de tes nouvelles. » J’ai eu une chute de tension. Donc, c’est rien quoi. Ça veut dire que pour avoir de mes nouvelles. Y’a rien de… Il fait : « Je te vois demain. » Je fais : « Y’a pas de problème. » Donc on se voit, tout ça. Puis il me dit rien puisqu’il ne me plaisait pas. Alors on s’est vu le lundi. Le mardi, le mercredi, le jeudi, je suis rentrée chez moi. On n’a pas cours le mardi, mercredi, jeudi. Le samedi, je reviens. On s’est vu le samedi, le dimanche, le lundi…, le mardi, le mercredi, jeudi, le vendredi il est venu
153 C’est pareil.
97
faire sa demande à la maison. En quatre jours, en quatre jours, je sais pas, je sais pas comment. Maintenant… Bon, on dit des fois le destin, je sais pas si ça existe vraiment. On dit, on est fait pour quelqu’un. Je ne sais pas. »
3.3 Les genres contre les sexes : « Ah les autres ! Les garçons ! Alors les garçons c’est affreux ! Tu parles avec eux… Ils comprennent à travers. » Nous avons vu qu’Akel marquait sa distance avec les autres étudiants. C’est encore plus flagrant lorsqu’elle parle de l’autre sexe. Elle oppose sa perception à celle des « autres », « eux ». Ce qui lui semble « naturel » paraît « malsain » pour les autres et inversement. C’est aussi à travers l’idée implicite de la normalité, un jugement de la société algérienne qu’elle engage.
« Ah les autres ! Les garçons ! Alors les garçons c’est affreux. Tu parles avec eux… Ils comprennent à travers. Pour eux, si elle s’intéresse à eux c’est autre chose. Ils comprennent pas, ils… C’est malsain. Moi je le sens, je sens qu’on est dans une société malsaine. C’est ça. Je vois, tout est malsain. Rien n’est naturel. Moi, ce que je vois naturel, eux ils le voient malsain. C’est ça. Moi, si je suis avec un garçon, il m’accompagne à la cité, on discute, tout ça, les gens dans la rue vont dire : « c’est pas normal, il l’a accompagnée. » Tout est malsain chez eux. Tout de suite, ils voient le mal. Je sais pas. C’est pas normal. »
Hakim développe également une conception moderne de la rencontre mais il y a un décalage entre ce à quoi il aspire et ce qu’il vit au quotidien. Il tient un discours de généralisation dans laquelle il s’inclut en se faisant le porte-parole, le narrateur de la situation vécue en Algérie par les jeunes de sa génération et l’analyste d’une situation dont il cherche à se démarquer.
« Et puis je sais pas, tu voulais parler de ma vie en dehors des études aussi. Peut-être ma vie intime, ça je suis pas de, je suis quelqu’un qui s’avance pas, qui s’investit pas trop dans ces choses parce que y’a pas un contexte qui les favorise. Tu peux pas connaître une fille, tu peux pas…, je me dis à quoi ça sert, ça ne peut pas être une relation aboutie, ça peut pas être un investissement… Oui, on en avait parlé. Une fille ici, tu la connais que si tu te marries ? Voilà, tu peux pas par exemple la connaître, vivre avec elle, partager des moments, voyager si tu te marries pas avec elle, si tu t’engages pas. Et ça, c’est… Je sais pas comment on peut se contenter, on peut dire qu’on a, qu’on vit une relation, qu’on fonde un truc si… Si on peut pas se voir, si on peut pas vivre ensemble, parce que l’épreuve du temps qui peut vraiment vous faire connaître l’un avec l’autre. Mais ça c’est l’idée de l’amour, c’est l’idée de l’amour déjà. Oui. C’est l’idée d’une relation amoureuse. Parce que avant la question ne se posait pas en fait. Peut-être y’avait quand même une avancée, parce que ça permet de connaître déjà les gens. Un garçon maintenant peut connaître une fille pour se marier. Auparavant, on se mariait sans connaître la fille. C’est déjà une avancée. Parce qu’il y avait maintenant vingt ans ou dix ans, on se mariait sans choisir son partenaire, sans le voir, sans… Sans l’avoir vu. Ça c’est terrible. C’est la surprise. (Rire)
98
Ouais, peut-être c’est la bonne, peut-être c’est… La mauvaise. En tout cas nous sommes le fruit de ça. D’accord. Parce que nos parents ne se sont jamais connus. Et tes parents, ils s’aiment. Euh, c’est quelque chose, tu sais, quelque chose qui va te paraître un peut surprenant. Les parents ne s’appellent pas par leurs prénoms. Mon père, quand il veut mettre l’accent sur ma mère, il me dit : « ta mère », il me dit, je sais pas : « elle » mais il ne la désigne pas par son prénom. « Elle », c’est la même chose. C’est le cas de toutes les familles ou ? C’est le cas de toutes les familles. […] La sexualité…, en tout cas des parents ainsi de suite, c’est vraiment le, la très grande interrogation. S’ils n’ont pas de gros problèmes, c’est déjà ça. On peut pas, je peux pas parler d’harmonie, de vie sexuelle harmonieuse. C’est beaucoup plus l’habitude et puis la femme elle subit la sexualité. Ça c’est un objet, voilà. Elle obéit et c’est tout. J’ai l’impression que les jeunes, enfin moi, j’ai l’impression que les jeunes ne veulent plus du tout de ça, ils veulent, ils suivent un autre modèle j’ai l’impression. Tout à fait. Ils ont maintenant une autre image d’après la télé, d’après… ça commence quand même à changer. Bien sûr, c’est trop risqué. Comment tu vas partager ta vie avec quelqu’un que tu n’as jamais connu. C’est, c’est, c’est inconcevable. »
Saïda non plus ne conçoit pas de vivre son union en Algérie. Elle pense le mariage au pays comme un espace de limitation. Elle veut bien se marier mais à la condition certaine que cela soit suivi du départ. Elle considère que la personne avec qui elle a une relation en ce moment est la seule envisageable. Ils partagent les mêmes aspirations. A l’instar de Hakim, elle affiche une démarcation d’avec ses compatriotes, elle se singularise en incluant avec elle l’ami avec qui elle désire partager sa vie. Ils se sont accordés sur le mode de vie pour l’avenir. Si cette relation échoue, elle se refuse à rechercher quelqu’un d’autre dans le paysage masculin actuel en Algérie qu’elle trouve étouffant.
« Et je me dis des fois que, parlant de ma relation avec mon petit ami, je disais qu’on avait une mentalité assez compatible l’un avec l’autre et des fois, en y pensant comme ça, je me dis que si ça marche pas, je ne serai plus en relation avec euh quelqu’un du bled. Oui, tiens j’ai pas posé… Parce que vous savez, parce que il faut vraiment suer pour trouver une personne assez tolérante. Mon petit ami, contrairement à 99% des hommes par ici, me, c’est-à-dire m’imposeraient une façon de m’habiller, une façon de me comporter, le fait que je parte voir des amis garçons, que je sorte prendre une pizza ou que je ne sais quoi avec un garçon, or c’est pas le cas. C’est une personne qui m’étouffe pas, qui n’impose rien. Oui, et justement c’est la chose qui me pousse à m’accrocher. Mais si un jour c’est terminé, euh en tous les cas je suis déterminée, je veux plus de relation avec un Kabyle. Ah ! Ce serait… Ce serait trop dur à trouver. Je crois que je partagerais ma vie avec un bouddhiste, avec un juif, avec je ne sais quoi mais pas un Kabyle. D’accord. Alors si le projet, mais admettons que tu restes avec ton ami, mais si le projet de départ se fait pas ? Si ça marche pas pour le Canada, ni pour la France… ?
99
Justement c’est la chose sur laquelle je suis en train de méditer ces jours-ci. »
3.3.1 Un projet amoureux contradictoire chez les filles Nous avons observé plus haut une première contradiction dans le discours d’Akel, le fait qu’elle ait donné à sa rencontre sur le mode traditionnel les apparences d’une rencontre sur le mode moderne. Nous relevons également dans le discours de Tazrut une contradiction. Bien qu’elle n’envisage pas de se marier en Algérie il n’en demeure pas moins que l’union se fera de manière préférentielle avec un Kabyle, en France ou ailleurs. C’est comme si elle opérait tout bonnement par la migration étudiante un déplacement d’une partie des projets qu’elle ne peut réaliser au pays.
« Mais en France, une fois que tu seras établie là-bas ? Oui, oui. Si je vais rencontrer quand même quelqu’un, pourquoi ? Bien sûr je vais me marier. Je vais pas rester comme ça. Avec… un Français, un Algérien, un Kabyle ? Un Français, je sais pas, mais Arabe, Arabe, non. Arabe, déjà non. Arabe ou arabophone ? Non, non, pas un arabophone, un arabe. Il peut être arabophone et être Kabyle d’origine. Ah ! Oui d’accord, qu’est-ce que tu appelles Arabe alors ? Les gens origine arabe. […] Un Français peut-être, je sais pas mais Kabyle. (Rires) »
Nous atteignons dans le cas de Layla un engagement radical dans le projet de départ. Elle envisage un peu sa migration comme une totalité. Et c’est avec sa mère qu’elle a le plus de connivence à ce propos quand elle déclare vouloir se marier avec un français. Le départ est envisagé comme une rupture, Layla déclare vouloir faire sa vie en France.
« D’accord. Et euh, donc éventuellement tu rencontrerais quelqu’un en France alors ? Oui. Un Français ou un Algérien ? Un Français (en souriant), d’origine. Un Français d’origine ? Oui. Ah bon, d’accord. Alors dans ce cas là, tu resterais en France ? Oui. Je resterais en France. Mais je reviendrai quand même. Et tes parents, tu leur a dit ça ? Euh, ma mère… Vous en avez parlé un petit peu ? Oui, avec ma mère puisque y’a quand même des tabous avec mon père. Avec ma mère, elle est très à cran, elle me pousse à faire cela. »
3.3.2 Un projet sexuel contradictoire chez les garçons Les garçons ne conçoivent pas le mariage en Algérie, en donnant pour explication qu’ils jugent nécessaire de bien connaître la personne avec qui l’on envisage de faire sa vie. Ils explicitent d’ailleurs clairement leur propos. Cette connaissance passe par l’expérience sexuelle, expérience que la société exclue moralement avant le mariage. Ferhat refuse pour l’instant le mariage. Il ne veut pas s’engager à la légère. C’est une responsabilité qui mérite réflexion. Il ne dit pas tout de suite qu’il ne conçoit en définitive le
100
mariage qu’après une période que nous pouvons qualifier d’essai. Mais cette possibilité d’avoir une relation complète avant le mariage est exclue en Algérie.
« Et sur le plan plus personnel ? Personnel ? T’as quelque chose en vue ou euh ? Non (sourires). Quelqu’un je dirais plutôt. Non, je n’ai pas l’intention de me marier et tout ça, non. Cette idée ne m’est jamais venue à la tête. Trop jeune ? Trop jeune, non. Non, parce que le mariage avec moi, c’est un conditionnement aussi et c’est une responsabilité qu’il faut assumer. Et puis, on connaît ici des amourettes, un petit peu comme ça, passagères mais bon, pas vraiment du sérieux mais peut-être si on trouve réellement l’amour avec qui que se soit, son origine, effectivement donc je crois qu’on va construire une relation durable et stable. Et effectivement ici c’est, ici c’est, pour vivre avec quelqu’un, y’a que le mariage. … Et bon, en France, l’essentiel si tu veux vivre ensemble et tout ça, la formalité administrative, le mariage, c’est pas vraiment important. Je vois les choses ici, effectivement. Mais ici, j’ai pas l’intention donc euh, de me marier pour l’instant, effectivement donc. Ça dépend, tout dépend. »
Ferhat distingue relations sexuelles et sentiment d’amour. Il place ici le sentiment d’amour nécessaire au mariage parlant du même coup du mariage moderne. Mais le mariage que lui propose la société, c’est le mariage sur un mode plus traditionnel, c'est-à-dire sans relation avant le mariage. Or pour Ferhat, il en est hors de question. Il n’envisage pas de vivre avec une personne sans avoir eu au préalable une expérience avec elle.
« Si réellement y’a certaines frustrations et tout ça, donc des relations sexuelles, en fait, on peut pas les avoir, bon et tout ça, donc réellement y’a certaines gens qui confondent les frustrations avec le sentiment d’amour, et finalement c’est comme ça que les mariages, 80 % des mariages, ça finissent mal, ça finissent par un échec. Tu dis, parce qu’ils font la confusion entre frustrations sexuelles et frustrations affectives en fait peut-être non ? Effectivement. Donc à partir de là, quand tu n’arrives pas à avoir la relation, tu constates que ce n’est qu’une, ce n’est qu’une envie sexuelle qui le lie avec cette fille, voilà. »
Il y a ici un paradoxe. Il n’envisage pas de vivre avec une personne sans l’avoir connue intimement avant, alors qu’il ne pourra pas faire plus tard avec cette même personne, à moins d’aller en France avec elle, et encore… Pour l’instant ce n’est pas de mariage dont il est question mais bien plutôt de sexe. Et la situation en Algérie n’est pas satisfaisante. Une relation sexuelle hors mariage sous-entend généralement la prostitution, ce qui n’est pas traduit en terme valorisant.
« Ici, on trouve des gens, 30 ans, 35 ans encore vierges. Ils n’ont pas eu de relations sexuelles donc à partir de là… C’est pas possible ou euh… ? C’est pas vraiment possible mais … Comment, honnêtement ici, comment on se débrouille pour avoir des relations alors ? Des relations, généralement…on paye, voilà…des, des salopes effectivement. Il faut aller voir des prostitués.
101
Des prostituées, voilà. C’est le seul moyen ? Ouais. »
3.4 L’importante question de la virginité Ce sont les garçons qui nous ont surtout parlé de sexualité154. Ferhat nous a parlé de prostitution. Il nous parle maintenant d’une pratique assez courante : la sodomie, seul moyen nous dit-on pour une fille de conserver sa virginité155.
« Mais y’a aussi, y’a aussi une autre forme de, je sais pas, de contre-aventure peu-être, la sodomie156, effectivement donc c’est ça… Mais avec qui ? Tu m’as dit tu pratiques la sodomie et tout ça mais avec des filles ou euh… ? Ouais, c’est ça donc euh, la virginité c’est sacré aussi donc euh, on a sacralisé la virginité, c’est par rapport à ça. Surtout pour la fille, hein, la fille donc… »
C’est tout le poids de la société qui, pesant sur les filles, les rendant en quelque sorte captives, rend également captifs les garçons. Nous sommes encore ici dans un espace de limitation, sexuel celui-là.
« Oui, et il y a peut-être une question de lieu de rencontre aussi ? Bon, si tu es au village, t’es au sein de la famille. Ici, la chambre universitaire, c’est pas évident bon,…Y’a peut-être ça aussi ? Effectivement, y’a aussi le côté, l’attachement et tout ça, la dépendance de la famille et tout ça, surtout le problème généralement des filles, des filles donc qui ont toujours peur des représailles de leur famille et tout ça, donc de peur d’être chassée de la maison et tout ça, donc de se retrouver du jour au lendemain dans la rue puis elles essayent de ne pas franchir le pas et tout ça donc euh, réellement… Tu penses que c’est les filles qui ont peur ? Beaucoup plus. »
3.5 Une auto-interdiction Cet interdit sexuel que subissent garçons et filles est lui-même reproduit par les personnes qui en souffrent. C’est ainsi que l’on peut expliquer la contradiction dans laquelle Hakim se trouve, entre ce que lui-même aspire et ce qu’il est prêt à vivre. Il ne peut concevoir de sexualité en Algérie. Non seulement il s’interdit à vivre sa sexualité mais il participe lui-même à cet interdit.
« Même moi-même par exemple, peut-être ailleurs, si je suis par exemple en France, je peux par exemple accepter une fille qui n’est pas vierge. Mais ici, je ne l’accepterai pas, je ne sais pas peut-être pour quelle raison mais… C’est surprenant. Oui, c’est assez surprenant. Tu te surprends toi-même.
154 Il n’y a pas que les garçons à m’avoir parlé de la virginité de façon explicite. A l’instar de Hakim, Saïda nous fait part de toute l’importance de la virginité des jeunes femmes dans sa société à travers l’histoire d’une de ses connaissances qui ne peut envisager rentrer au pays parce qu’elle a eu un enfant hors mariage en France et qu’elle l’élève maintenant seule. 155 Mais comment attribue-t-on moralement la virginité à une personne pratiquant la sodomie ? 156 Après l’entretien, nous avons poursuivi la discussion, notamment sur les relations sexuelles. A propos de la sodomie, je lui ai demandé si elle se pratiquait avec des garçons. Il m’a répondu : « oui, y’en a qui s’assument !».
102
Ça me surprend moi-même. Je n’arrive pas à me l’expliquer. C’est tout le monde qui pense ainsi. En tout cas y’a une idée, c’est que, peut-être, ici y’a qu’une fille désaxée, qu’une fille vraiment qui n’a que, peut-être pas de bonne famille, qui est une prostituée, qui perde sa virginité avant le mariage. Voilà, c’est peut-être cette réputation là. »
[…] « Et moi, par exemple, si ma sœur, emprunte ce chemin, peut-être je risque un jour de la tuer. A défaut par exemple de la … »
Comme nous le constatons, filles et garçons sont chacun à leur manière victimes mais aussi passeurs d’un despotisme moral et d’une répression sexuelle. Nonobstant les frustrations qui découlent de ce phénomène, il serait intéressant d’émettre l’hypothèse qu’il soit également une des sources de la production du célibat en Algérie. Notre problématique proposait d’explorer la dynamique familiale à l’œuvre entre l’individu et son groupe dans l’élaboration et la maturation du projet de départ. S’intéresser au processus nous a permis de comprendre également les raisons qui poussent les individus à partir : la poursuite d’études à l’étranger, la recherche de moyens pour construire un projet professionnel viable, la soif de liberté individuelle, un désir d’individuation,…. Que ce soit au niveau du processus ou au niveau des raisons avancées, la dimension sexuée de l’émigration apparaît de façon pertinente mais le fait que la dimension matrimoniale transparaisse à ce point a créé un peu la surprise. La question matrimoniale est en effet cruciale. Elle apparaît pour l’individu porteuse du projet. Les filles comme les garçons, même si leurs raisons sont quelque peu différentes, conçoivent leur émigration comme un projet de vie total : partir pour étudier certes, mais aussi pour s’installer dans le pays d’immigration et y faire sa vie. Cela veut dire d’abord et surtout se marier au point que projet migratoire et projet de mariage soit devenu exclusif l’un de l’autre. Le lien entre les deux projets change la nature de la migration, il participe aussi d’un nouveau mode de perpétuation de l’émigration. De plus, il s’agit pour eux de réaliser à l’étranger, en France, ce qu’ils ne peuvent vivre en Algérie. C’est l’affirmation d’une individuation, l’importance d’une vie amoureuse, d’une sexualité, d’un partenaire dans le mariage. S’ils sont rationnels, c’est pour plusieurs finalités. Il convient de parler de projet migratoire pluriel. Une question surgit cependant. Les parents participent activement au projet de leur enfant en tant que processus, mais partagent-ils, avec la même intensité, les mêmes raisons qu’eux ? Les aident-ils à réaliser en France ce qu’ils ne peuvent faire en Algérie ? Les aident-ils à vivre ce qu’eux n’ont pas pu vivre ?
103
CONCLUSION Il convient, au terme de notre enquête, de mettre en évidence les similitudes et les différences que revêt l’émigration estudiantine kabyle actuelle au regard des résultats de travaux antérieurs sur l’émigration. Pour cela, nous avons choisi deux des textes fondamentaux de A. SAYAD, « Elghorba157 » et « Les trois « âges » de l’émigration algérienne en France158. » « Elghorba » est l’analyse du discours d’un émigré kabyle, saisi à deux moments, avant et après un congé en Kabylie. A. SAYAD nous conte l’histoire de Mohand, un jeune émigré issu d’un village dont il dit qu’il compte « beaucoup plus de monde en France que sur place », un village où s’est établit une ancienne et très forte tradition d’émigration, où les jeunes n’ont d’autre perspective et, initialement, d’autre ambition que de partir. Ce premier constat vient en écho au discours de nos interviewés. L’émigration est un phénomène qui concerne les jeunes. Tous ont dans leur famille un immigré et la tradition, déjà établie il y a trente ans, s’est perpétuée de génération en génération par leurs prédécesseurs. Cette prégnance du phénomène a une traduction sur le plan cognitif. L’émigration a intimement pénétré la vie du village. Il ne s’agit pas seulement d’une dépendance économique, c’est toute la vie du village qui est scandée par l’émigration. « C’est toute la communauté locale qui vit comme « suspendue » à son émigration qu’elle appelle la France. » Ecoutons Mohand :
« Les gens n’ont que la France à la bouche. »
« Même dans les conversations, de quoi parlent tous les hommes du village ? De la France ! Les anciens de France répètent leurs souvenirs… Les « permissionnaires » parlent de la France, au milieu de leur village, ils se croient encore en France ; les jeunes qui sont dans l’attente de partir rêvent de la France. On n’entend que parler de la France : la France est comme ci, la France est comme ça. »
A ces considérations colportées sur la France fait écho dans le même texte un discours en tout point opposé à propos du pays de départ :
« Que Dieu me fasse disparaître de ce pays ! » Le pays de l’étroitesse, le pays de la pauvreté, le pays de la misère, le pays « tordu », « inversé », le pays du « contraire », le pays du déclin, le pays qui suscite du mérite pour les siens, le pays incapable de retenir les siens, le pays délaissé par Dieu… »
Mohand relate son expérience dans un vocabulaire empruntant aux grandes oppositions d’ordre structural de la tradition mythico-rituelle : intérieur-extérieur, clair-obscur, … où la France est à chaque fois caractérisée par une série d’attributs qui trouvent leur antithétique dans le pays d’origine. Nous avons pour notre part constaté l’utilisation d’un registre comparatif de qualification à propos de la France et de déqualification pour l’Algérie. Il traduit la présence dans la structure cognitive d’un double référentiel. Il serait intéressant de savoir ce qui advient après l’acte migratoire. Qu’engendre-t-il ? Quelles sont les transformations qui vont s’opérer ? Survit-il à la première génération d’immigrés ? Que se passe-t-il sur le plan cognitif ? Est-il le propre de l’émigration ou se retrouve-t-il dans l’immigration ?
157 SAYAD A. (1975), « ELGHORBA : Les mécanismes de reproduction de l’émigration », Actes de la recherches en sciences sociales, n° 2, pp. 50-66. 158 SAYAD A. (1977), « Les trois âges de l’émigration algérienne en France », Actes de la recherche en sciences sociales, n°15 pp. 59-89.
104
Nous avons aussi mis en évidence les caractéristiques propres au jeu que comportait le projet migratoire, ses paris, ses enjeux, l’aléa, … C’était déjà le cas pour Mohand :
« C’est un pari à prendre ; j’ai joué. En moi-même les choses étaient réglées : ou bien je franchis la mer, ne serait-ce que pour quelques jours, j’ai alors vu mon frère, mes neveux, je me tiendrais pour satisfait comme si je n’étais venu que pour cela ; ou bien je suis renvoyé d’Alger ou de France et là je ne remettrais plus les pieds au village, advienne que pourra ! »
L’émigration comprend toujours sa part de mensonge. Il est toujours nécessaire à l’illusion. Il permet d’affronter la part arbitraire et aléatoire du projet migratoire. Il faut y croire. Pourtant Mohand prévenait déjà :
« Nous, on nous a jamais expliqué la France comme elle est avant qu’on la connaisse. On les voit revenir, ils sont bien habillés, ils ramènent des valises pleines, de l’argent dans les poches, on les voit dépenser cet argent sans regarder ; ils sont beaux, ils sont gras. » « Quand ils reviennent en vacances, c’est l’été, c’est la grande foule dans le village, c’est la joie partout, ce sont les noces. Avant de savoir, je pensais qu’en France aussi c’était tout le temps comme cela, que ce sont eux qui amenaient avec eux toute cette joie. » « C’est de notre faute à nous, les émigrés, comme on nous appelle : quand nous retournons de France, tout ce que nous faisons, tout ce que nous disons, c’est du mensonge ; c’est notre tort. »
Et il est fort probable que, chez les étudiants ayant réussi leur projet migratoire, une fois passée la période d’euphorie, l’illusion de l’émigré laisse la place à la désillusion de l’immigré, celle dont parlait Mohand :
« Quelle France j’ai découvert ! Ce n’est pas du tout ce que je m’attendais à trouver (…) Moi qui croyais que la France ce n’était pas le pays de l’exil (elghorba). Il faut vraiment arriver ici en France pour savoir la vérité. Ici on entend dire les choses qu’on nous dit jamais là-bas au pays ; on entend tout dire : « ce n’est pas une vie d’humains ; c’est une vie qu’on ne peut aimer ; la vie des chiens chez nous est meilleure que ça… »
Les choses ne sont peut-être aujourd’hui pas aussi dures car les étudiants sont sans doute mieux dotés que leurs prédécesseurs, notamment d’un capital culturel plus important. Ce pourrait une intéressante piste de recherche que de les rencontrer de nouveau, quelques temps après leur arrivée dans le pays d’immigration, afin de les interviewer et d’écouter leurs réactions. En effet, la parole enregistrée est une parole à un moment et dans un espace donnés. Il y a un avant et un après l’acte migratoire. De même, il serait intéressant d’interviewer ceux, qui malgré les possibilités objectives de partir, restent au pays. L’émigration est une question de mobilité. Il s’agirait alors de questionner l’immobilisme et l’enracinement. Une autre perspective consisterait à étudier l’émigration-immigration, non plus avec la France conçue comme destination finale, mais ainsi que le suggèrent nos interviews la France perçue comme espace rebond, qu’il soit géographique ou social.
105
Dans l’article sur les trois « âges », A. SAYAD attribue à l’émigration algérienne trois phases ayant chacune leur description propre et une caractéristique centrale. Nous trouvons intéressant de le confronter aux résultats de notre enquête réalisée quelques trente années plus tard. A. SAYAD définit le premier âge comme celui d’une émigration sur ordre, l’émigré étant désigné par son groupe pour ses qualités et son honneur. Il est en quelque sorte leur ambassadeur à l’étranger. C’est à cette phase que l’on attache le terme de « noria. » Le deuxième âge correspond à une perte de contrôle du groupe sur l’individu, parce qu’il ne peut maîtriser toutes les conséquences de l’émigration. C’est un processus de dépaysannisation et d’individualisation de l’émigration. Elle devient une aventure individuelle et une fin en soi. Cela ne va pas sans créer une tension entre l’individu et son groupe. Nous pouvons dire, dans un renversement de perspective, qu’il est devenu étranger dans son propre pays. Notons que ces deux premiers âges avaient pour caractéristique commune que l’émigration y était individuelle et masculine. A propos du troisième âge, A. SAYAD parle de « colonie » algérienne en France, d’une généralisation et d’un élargissement du phénomène à la famille, c'est-à-dire aux femmes et aux enfants. Nous nous posions la question, lors de notre problématique, de savoir si nous pouvions attribuer un quatrième âge à l’émigration algérienne. Ce dénominatif ne semble pas adéquat. Nous savons déjà que l’émigration actuelle est polymorphe. Elle utilise la voie de la naturalisation, du mariage et de la poursuite d’études à l’étranger. Contrairement aux « âges » précédents, l’émigration présente ne comprends pas une caractéristique centrale mais plusieurs. Comment pouvons-nous alors la nommer ? Et surtout, comment pouvons-nous qualifier l’émigration pour études eu égard aux considérations précédentes ? L’émigration estudiantine comporte en fait des caractéristiques des trois âges précédents, mais pas seulement. Il faudrait y ajouter une ou des dimensions supplémentaires. L’émigration pour études procède du troisième âge lorsqu’elle s’apparente à un regroupement familial. L’étudiant, et a fortiori une étudiante, bien que partant seul, est accueilli par sa famille plus ou moins éloignée (un oncle, un cousin, …). C’est encore le cas lorsque l’acte migratoire est doublé d’un enjeu matrimonial. Se marier et faire venir son conjoint en France est d’une certaine façon un regroupement familial à une personne159. L’émigration estudiantine procède également du deuxième âge selon A. SAYAD. Il s’agit bien d’un acte individuel envisagé comme une aventure et comme nous l’avons vu d’une fin en soi. Mais là où elle diffère, c’est à propos de la tension qui existait entre l’individu et son groupe. Non seulement cette tension disparaît, mais elle fait place à une complicité et en cela elle nous rappelle la caractéristique centrale du premier âge de l’émigration algérienne, lorsque l’individu était mandaté par son groupe. L’émigration présente permet à un enfant de la famille, celui qui a étudié - et curieusement il y en a souvent qu’un seul – de partir. C’est sur lui que vont se concentrer les efforts des parents dans l’organisation et l’aide à la réalisation du projet migratoire. C’est ainsi que nous pouvons dire que l’émigration estudiantine possède les caractéristiques des trois âges précédents. Mais elle diffère cependant en quelques points, et cela constitue-t-il peut-être une rupture avec les âges précédents. D’une part, elle confirme l’importance de l’émigration des femmes. D’autre part, les candidats à l’émigration, non seulement n’envisagent que rarement le
159 Le regroupement familial consistait, pour un homme marié arrivé seul dans le pays d’immigration, à faire venir sa femme ainsi que ses enfants après quelques années. Il consiste, dans le cas de notre étude pour un(e) étudiant(e), à se marier avec un(e) immigré(e) afin, grâce au contrat qui les lient, d’émigrer légalement.
106
retour160, mais ils pensent dès aujourd’hui leur vie en France, dans l’immigration. C’est pour cela, pensons-nous, qu’est apparue dans les entretiens avec autant d’importance la dimension matrimoniale de leur projet. Nous avions vu que l’émigration-immigration comportait une dimension sexuée évidente – elle était d’abord individuelle et masculine par exemple. Cette dimension sexuée est encore plus prégnante aujourd’hui. Les garçons abordent apparemment peu ce sujet avec leur proches, il est du domaine du non-dit ; leur marge de manœuvre étant supérieure à celle des filles. La question est certainement plus abordée par les filles, complicité féminine aidant, avec leur mère qui les encouragent dans leur projet. Nous avons vu également qu’il ne s’agit pas d’une simple dimension matrimoniale. Emigrer, c’est aller dans un au-delà. Cela implique un projet de vie. C’est penser dès aujourd’hui en terme de mode de vie. C’est souhaiter mettre en applications ses aspirations : aspiration à la liberté, liberté de la rencontre ( plus de la part des filles) et liberté sexuelle (plus formulée par les garçons). Cette dimension, matrimoniale, de la rencontre amoureuse, sexuelle, nous apparaît d’autant plus importante qu’elle n’était pas véritablement mise en question et qu’elle n’a semble-t-il pas fait l’objet d’études jusqu’à présent. Cela consisterait une perspective de recherche, la continuité intéressante de ce premier mémoire. Nous pensons, comme avant nous l’avait formulé A. SAYAD, qu’il faut pour étudier l’immigration, connaître ce qui se passe en amont, dans le pays d’émigration. C’est dans cette perspective que nous avons pensé cette étude et que nous envisageons les enquêtes futures, que ce soit à propos du différentiel cognitif auquel doit faire face l’émigré, de la dimension matrimoniale et sexuelle de l’émigration-immigration, de l’émigration en tant que projet de vie total.
160 Nous ne considérons pas le fait de venir seulement passer des vacances au pays comme un retour.
107
BIBLIOGRAPHIE AUSTIN J. L. (1970), Quand dire, c’est faire, Ed. du Seuil, Paris. BECKER H.S. ( 2002), Les ficelles du métier, Paris , La Découverte & Syros, Coll. Guides Repères. BLANCHET A. et GOTMAN A. (1992), L’enquête et ses méthodes : l’entretien, éd. Nathan, coll. 128, Paris. BORGOGNO V., SIMON V., STREIFF-FENART J. et VOLLENWEIDER-ANDRESSEN L. (1995), « Les étudiants étrangers en France : Trajectoires et devenir », Rapport de recherche pour la DP, Convention d’étude du 30 juin 1995, SOLIIS-Université de Nice. Premier volet de ce travail in Migrations études, Revue de Synthèse de travaux sur l’immigration et la présence étrangère en France, DPM/ADRI, n° 67, juillet-août 1996. Second volet de ce travail in Migrations études, Synthèse des travaux sur l’immigration et la présence étrangère en France, DPM/ADRI, n°79, janvier-février-mars 1998. Extraits in Les Cahiers du SOLIIS : « Les étudiants », Notes et Travaux Sociologiques, n°2-3, 1996/1997. BORGOGNO V., VOLLENWEIDER-ANDRESSEN L. (2000), « Etudiants du Maghreb en France : Spécificités du « rameau féminin » de la migration ? », in GEISSER V. (dir.), Diplômés maghrébins d’ici et d’ailleurs, trajectoires sociales et itinéraires migratoires, CNRS éditions, Paris, pp. 285-306. BOURDIEU P. (1993), « Comprendre », in BOURDIEU P. (dir.), La misère du monde, éd. du Seuil, Paris, pp. 903-925. BOURDIEU P. (2002), La domination masculine, éd. Du Seuil, Coll. Points Essais, Paris. BOURDIEU P. et SAYAD A. (1964) , Le déracinement, la crise de l’agriculture traditionnelle en Algérie, Paris, Minuit (rééd. 1996). CANDAU J. (1996), Anthropologie de la mémoire, PUF, Coll. Que-sais-je ?, Paris. CASTEL R. (1995), Les métamorphoses de la question sociale. Une chronique du salariat, Paris, Fayard. COSTA-LASCOUX C., LEBON A., BRAY C, Rapport 2002-2003 du Haut Conseil à L’Intégration, Observatoire des statistiques de l’immigration et de l’intégration, Groupe permanent chargé des statistiques. COULON A., PAIVANDI S. (2003), « Les étudiants en France : l’état des savoirs », Rapport pour l’Observatoire de la vie étudiante, Université Paris 8, Centre de Recherche sur l’Enseignement Supérieur, mars. COURDESSES L. (1971), « Blum et Thorez en mai 1936. Analyse d’énoncés », in Langue française, n° 9, février, pp. 22-33.
108
DE CERTEAU M. (1990), L’invention du quotidien : 1. Un art de faire, Gallimard, coll. Folio essais, Paris, 350p. DUMONT Gérard-François (1995), Les migrations internationales. Les nouvelles logiques migratoires, SEDES, Paris, 223p. DURKHEIM E. (1997), Le suicide, P.U.F., Coll. Quadrige, Paris. ELIAS N. (1987), La société des individus, Fayard, Presse Pocket, Coll. Agora, 1991 pour la traduction française. GEERTZ C. (1986), « Du point de vue de l’indigène : sur la nature de la compréhension anthropologique » in Savoir local, savoir global, PUF, Paris, pp. 71-90. GIDDENS A.(1984), La constitution de la société, P.U.F/Quadrige, Paris, 474 p., 1987 pour la traduction française. GILLETTE A. et SAYAD A. (1984), L’immigration algérienne en France, Paris, Entente, coll. « Minorités » (1ère édition 1976). GISTI (Groupe d’informations et de soutien des immigrés) (2005), Le guide de l’entrée et du séjour des étrangers en France, Paris , La Découverte, Coll. Guides. HAEM R. d’ (1999), L’entrée et le séjour des étrangers en France, Paris, PUF, Que sais-je ? (seule édition). HALBWACHS M. (1994), Les cadres sociaux de la mémoire, éd. Albin Michel, Paris. HOBSBAWM E. (1995), « Inventing tradition », in Enquête, n° 2, pp. 171-189. INSEE (1999), Recensement de la population, mars. KADRI A. (2000), « La construction historique de système d’enseignement supérieur en Algérie (1850-1995) » in GEISSER V.(dir.), Diplômés maghrébins d’ici et d’ailleurs, trajectoires sociales et itinéraires migratoires, CNRS éditions, Paris, pp. 35-55. KADRI A. (2000), « La formation à l’étranger des étudiants algériens : les limites d’une politique rentière (1962) » in GEISSER V. (dir.), Diplômés maghrébins d’ici et d’ailleurs, trajectoires sociales et itinéraires migratoires, CNRS éditions, Paris, pp. 209-219. KAUFMANN J.- CL. (2003), L’entretien compréhensif, Nathan, Coll. 128, Paris. KERBRAT-ORECCHIONI C. (2002), L’énonciation. De la subjectivité dans le langage, Coll. U, Armand Colin, Paris, pp. 267. LABDELAOUI H. (1996-97), « La migration des étudiants algériens vers l’étrangers : les effets pervers d’une gestion étatique », in Les Cahiers du SOLIIS : Notes et Travaux Sociologiques, n°2-3, 1996-97, pp. 107-124.
109
MALIKA C., SPINOUSA N. (1997), « Parcours d’adaptation des Algériens : Des dispositions aux acquisitions », in Migrations Etudes, n° 75, septembre. MASCHINO M.T. (2003), « La loterie des visas », in Le monde diplomatique, mars, pp. 4/5. MAUSS M. (1999), Sociologie et anthropologie, 8ème édition., Paris, PUF/Quadrige, 482 p. MERLLIE D. ( ), La mobilité sociale, Paris, La découverte, coll. « Repères » (1ère édition ). PERALDI M. (2003), « Droit de visite et principe d’humanité », La pensée de midi, n°10, Eclats de Frontières, été 2003. REA A. (2003), « Politiques d’immigration : criminalisation ou tolérance ? », La pensée de midi, n°10, Eclats de Frontières, été 2003. REA A., TRIPIER M. (2003), Sociologie de l’immigration, La découverte. ROSENTAL P.-A. (1999), Les sentiers de l’invisible : Espace, familles et migrations dans la France du 19e siècle, Editions de l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, Paris, 255 p. SAYAD A. (1975), « ELGHORBA : Les mécanisme de reproduction de l’émigration », Actes de la recherches en sciences sociales, n° 2, pp. 50-66. SAYAD A. (1977), « Les trois âges de l’émigration algérienne en France », Actes de la recherche en sciences sociales, n°15 pp. 59-89. SAYAD A. (1979), « Les enfants illégitimes », Actes de la recherche en sciences sociales, 1ère partie, n°25, pp. 61-81 ; 2ème partie, n°26-27, pp. 117-134. Cet article est également paru in SAYAD A. (1991), L’immigration ou les paradoxes de l’altérité, Bruxelles, éd. De Boeck Universté, 331p. SAYAD A. (1999), La double absence, Paris, Seuil. SAYAD. A. (1995), avec la collaboration de Eliane DUPUIS, Un Nanterre algérien, terre de bidonvilles, Paris, Autrement, coll. « Français d’ailleurs, peuple d’ici », HS N°85, avril 1995, pp. 125. SIMMEL G. (1903), « Métropoles et mentalité », in GRAFMEYER Y. et JOSEPH I. (1990), L’école de Chicago : Naissance de l’écologie urbaine, éd. Aubier, Paris, pp. 61-77. SIMON V. (2000), « La migration des étudiants maghrébins en France, une approche historique (1962-1994) », in GEISSER V. (dir.), Diplômés maghrébins d’ici et d’ailleurs, trajectoires sociales et itinéraires migratoires, CNRS éditions, Paris, pp. 245-259. SLAMA S. (1999), La fin de l’étudiant étranger, Paris, L’harmattan. SLAMA S.(1998), « Les étudiants algériens en France, Objectif zéro », in Plein Droit, n° 38, avril 1998.
110
STORA B. (2004), Histoire de l’Algérie coloniale (1830-1954), Paris, La découverte, coll. « Repères », (1ère édition 1991). STORA B., (2004), Histoire de l’Algérie depuis l’indépendance, t1. 1962-1988, Paris, La découverte, coll. « Repères », (1ère édition 2001) WEBER M. (1964), L’éthique protestante et l’esprit du capitalisme, Plon, Coll. Pocket, Paris. WIEVIORKA M. (2001), La différence, Paris, Balland, Voix et Regard. WITHOL DE MENDEN C. (2001), “Un essai de typologie des nouvelles mobilités” , Hommes et Migrations, N° 1233, sept – oct. 2001, pp. 5-12.
111
TABLE DES MATIERES INTRODUCTION 2 I – L’EMIGRATION ALGERIENNE 4 1 – Introduction 4
1.1 Sortir de l’ethnocentrisme 4 1.2 L’émigration : un fait social total 5 1.3 L’exemplarité de l’émigration algérienne 7 1.4 L’émigration post-migratoire : une émigration mixte de non-travail 8
2 – Eléments socio-historiques 10 2.1 La colonisation française en Algérie 10 2.2 Les premiers émigrés 11 2.2.1 La Kabylie surtout 12 2.2.2 Contribution à l’effort de guerre 12 2.3 La reconstruction 13 Le premier âge de l’émigration algérienne 2.4 La seconde guerre mondiale 14 Le deuxième âge de l’émigration algérienne 2.5 La guerre d’Algérie 16 2.6 Depuis l’indépendance 17 2.7 Premier arrêt officiel des migrations algériennes 18 2.7.1 Le regroupement familial 19 2.7.2 Le troisième âge de l’émigration algérienne 19 2.7.3 Au cœur des contradictions 20 2.7.4 Apparition de l’émigration clandestine 20 2.8 L’invention de l’émigré étudiant 22 2.8.1 L’émigré étudiant : la politique algérienne 23 2.8.2 Le non-retour des boursiers et réaction algérienne 24 2.8.3 Massification de la population estudiantine 25 2.9 La décennie noire : 1992-2002 26
Du côté de la France : l’objectif zéro de l’immigration algérienne 27
2.10 Partir étudier à l’étranger : un projet et une double raison de partir 28 2.11 Le retour de l’étudiant algérien 29 2.12 Spécificité de l’émigration féminine 30 3 – Actualité du projet d’émigrer 32 3.1 L’émigration post-migratoire 34 3.2 Le groupe et l’individu autour du projet d’émigration : duo ou duel ? 36 II – NOTE METHODOLOGIQUE 39 1 – Présentation de l’enquête 39
2 - Choix de la technique d’enquête 40 3 – Réflexions méthodologiques 40 4 – Enquête exploratoire et premiers constats 43
112
5 – Echantillon et présentation du corpus de l’enquête 44 6 – Exploitation de l’entretien 46
6.1 Les outils d’analyse 47 6.1.1. Les outils de J.- Cl. KAUFMANN 48 6.1.2 Le triangle de la différence de M. WIEVIORKA 49 6.1.3 Une question d’énonciation 51 6.2 La phase de saturation 53 III – ANALYSE DES ENTRETIENS 54
1- L’émigration estudiantine : une complicité familiale 54 1.1 L’émigration érigée en tradition 54 1.2 Les prédécesseurs 56
1.2.1 La primauté de la famille installée en France 57 1.2.2 L’émigration comme appel 57 1.2.3 Un silence sociologique 61 1.3 Par-delà le bien et le mal 63 1.3.1 L’Algérie, une limitation espace-temps 63 1.3.2 La ville versus le village 66 1.3.3 L’université de tous les savoirs 68 1.3.4 une dimension proprement politique 72
2- Le projet migratoire chez les uns les unes et les autres 74 2.1 Le choix de la filière 74 2.1.1 Le projet migratoire de l’étudiant : le « je » de l’acteur ? 77 2.1.2 Le jeu de l’acteur 79 2.1.3 Prévoir une issue de secours 81 2.2 L’investissement des parents dans l’émigration des enfants 82 2.2.1 Pour les garçons 83 2.2.2 Pour les filles 85 2.2.3 Le contrôle des filles selon le degré d’affranchissement 89
3- La question essentielle du mariage 93
3.1 Le mariage comme obstacle au départ, le départ comme obstacle au mariage 94 3.2 Le mariage comme stratégie d’émigration 94 3.3 Les genres contre les sexes 97
3.3.1 Un projet amoureux contradictoire chez les filles 99 3.3.2 Un projet sexuel contradictoire chez les garçons 99 3.4 L’importante question de la virginité 101 3.5 Une auto-interdiction 101
CONCLUSION 103 BIBLIOGRAPHIE 107 TABLE DES MATIERES 111