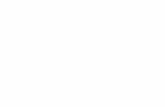Petrus Musandinus et son traité sur l’alimentation des malades dans La Scuola Medica Salernitana....
-
Upload
univ-tours -
Category
Documents
-
view
2 -
download
0
Transcript of Petrus Musandinus et son traité sur l’alimentation des malades dans La Scuola Medica Salernitana....
Bruno Laurioux
PETRUS MUSANDINUSET SON TRAITÉ SUR L’ALIMENTATION DES MALADES
Au spécialiste de l’alimentation médiévale les raisons ne man-quent pas de s’intéresser à la Summula de preparatione ciborum etpotuum infirmorum 1 que de nombreux manuscrits attribuent aumaître salernitain Petrus Musandinus. C’est tout d’abord la singu-lière importance que ce texte revêt dans l’histoire des rapports entrecuisine et médecine – et la position originale qu’il y occupe. D’autrepart, la Summula constitue un document de premier ordre pour uneépoque (la fin du XIIe siècle) où les informations sur l’alimentation,et encore plus sur la cuisine, restent maigres.
L’originalité du traité de Musandinus est ce qui m’a retenu à lapremière lecture que j’en ai faite, il y a maintenant une quinzained’années 2. Passé le prologue (qu’on trouvera reproduit à l’annexe B),il apparaît en effet comme une succession de recettes que l’on peutà bon droit qualifier de culinaires. À la suite de plats et boissons àbase d’amandes (la première notice est également donnée dans l’an-nexe B) sont ainsi décrites des préparations de légumes ou deviandes, chacune d’entre elles étant ajustée à une affection détermi-née: constipation ou au contraire fluxum ventris, et surtout différentstypes de fièvres 3. Le vocabulaire (ingrédients et ustensiles) toutcomme la syntaxe (techniques) sont semblables à ceux de la recetteculinaire; le lait d’amandes, la mie de pain et le souci de ne pas lais-ser la préparation attacher au plat, comme les termes recipe, tere, misce,
1. J’ai conservé le titre de Summula qui a été repris par De Renzi (cf. infra,n. 3) du manuscrit latin 6954 de la Bibliothèque nationale de France (désormaisabrégée BnF), et ceci bien que ce soit un titre rare.
2. B. Laurioux, «La cuisine des médecins à la fin du Moyen Age», dans Mala-die, médecines et sociétés, Approches historiques pour le présent, Actes du VIe col-loque d’Histoire au Présent, Paris 1990, Paris 1993, II, 136-48.
3. S. De Renzi, Collectio Salernitana (abrégé en CS),V, Naples 1859, 254-68.
235
ou encore olla: rien là qui puisse surprendre celui qui pratique leslivres de cuisine du Moyen Age – et leur latin du même tonneau 4!Je laisserai ici de côté la question de savoir si c’est la formulationculinaire qui a en la matière informé le texte médical ou l’inverse –question qui, à l’évidence, ne peut se résoudre par un simple constatde la chronologie 5.
Dans l’application de sa «cuisine médicale», Petrus Musandinus semontre extrêmement souple – et c’est également ce qui m’avaitséduit dans son traité. En témoigne, dans le passage ici reproduit, laconcession faite au goût avéré des mangeurs médiévaux pour les pré-parations blanches («Si vis quod lac predictum sit magis album, inquo magis delectetur infirmus»). D’autres recettes expliquent avecbeaucoup de soin comment composer la pâte d’une tourte si lepatient veut absolument la goûter 6 – ce qui en théorie ne lui estpoint permis – ou les différentes manières de parer à la contradictionfondamentale qui vient de ce que le malade souhaite consommerquelque chose de contraire à sa santé: si on le lui donne, on met endanger sa santé, mais qu’on ne lui donne rien et il va s’affaiblir 7. D’oùune cuisine de substitution, de contrefaçon (une poule, cuite etdécoupée de manière appropriée, passera pour de la viande de bœuf 8)qui, à l’instar de celle qu’on développa pour contourner le carême 9,eut une importance primordiale dans l’histoire de la gastronomie.
Mais, profitant du rassemblement des meilleurs connaisseurs dumoment salernitain, je voudrais proposer à leur appréciation une
BRUNO LAURIOUX
4. B. Laurioux, «Le latin de la cuisine», dans Les historiens et le latin médiéval,Colloque tenu à la Sorbonne les 9, 10 et 11 septembre 1999, éd. M. Goullet. M.Parisse, Paris 2001, 259-78; repris dans Laurioux, Une histoire culinaire du MoyenAge, Paris 2005, chap. 4.
5. R. Jansen-Sieben, «From Food Therapy to Cookery-Book», dans MedievalDutch Literature in its European Context, éd. E. Kooper, Cambridge 1994, 261-79.
6. CS,V, 260: «Si paciens de pasta comedere voluerit»; c’est la farce qui doitêtre théoriquement donnée au malade: «extrahe a furno illam pastam si coctaest et auferatur quod intus est et da comedere».
7. CS,V, 261: «De hiis qui contraria querunt. Restat dicere quod faciendumsit cum febriens appetit cibum sibi contrarium […]».
8. CS,V, 262: «Si vero petierit carnem bovis accipe gallinam et coque bene,postea pulpam de ala accipe et scinde in transversum, ut non possit eamcognoscere, nam ut caro bovina habet fila, et sic ei da».
9. B. Laurioux, «Le maigre: cuisine de substitution?», à paraître dans les Actesdu colloque Nourritures de substitution/substitution de nourritures en Méditerranée,Aix-en-Provence 14-15 mars 2003, éd. S. Bouffier-Collin, M.-H. Saunier.
236
autre lecture de la Summula de preparatione ciborum et potuum infirmo-rum en essayant d’inscrire à la fois la genèse de ce texte dans lemilieu salernitain et son développement dans le cadre de la méde-cine médiévale tout entière. Quoique plus attendue, cette approchen’a curieusement pas été tentée jusqu’ici, et je me contenterai deproposer quelques pistes de réflexion – dans l’espoir que d’autresvoudront bien les emprunter.
Je me posterai successivement à trois endroits, trois passages obli-gés – à mon sens – de l’éditeur de textes salernitains, et plus géné-ralement de textes médicaux, et plus généralement encore de textesmédiévaux. Mes premières remarques porteront sur la confection dutexte au regard de ce que l’on peut savoir de Petrus Musandinus, deses intentions et de sa formation. Donner à ce traité l’intangibilitétextuelle qu’il n’eut jamais serait de piètre méthode: un premierbalayage, limité à quelques manuscrits, laisse entrevoir de profondesvariations, dans la structure comme dans les formulations. Cesconstantes modifications ou recompositions expliquent-elles ledurable succès de la Summula entre le XIIIe et le XVe siècle? Àmoins qu’elles n’expriment un intérêt dont il faut peut-être allerchercher la clé dans les différentes configurations manuscrites quiassocient ce texte à bien d’autres.
Dans l’atelier de Petrus Musandinus
La Summula de preparatione ciborum et potuum infirmorum n’estcertes pas dans la littérature médicale du Moyen Age le seul exempled’un texte qui décrit avec précision les procédures culinaires. Le tra-vail de fond mené par Marilyn Nicoud sur la littérature diététique amontré l’importance croissante qu’occupait ce type de description –et plus généralement les préoccupations alimentaires – dans lesrégimes de santé et textes apparentés du XIIIe au XVe siècle 10.
La différence majeure avec ces régimes est qu’il s’agit ici de cui-siner pour des malades, de combattre la maladie et non de préserverla santé. La Summula est donc l’un des rares traités entièrement dévo-
PETRUS MUSANDINUS ET SON TRAITE SUR L’ALIMENTATION DES MALADES
10. M. Nicoud, Aux origines d’une médecine préventive. Les traités de diététiqueen Italie et en France (XIIIe-XVe siècle), thèse École Pratique des Hautes Études,IVème section, 3 vol., 1998 (abrégé en Nicoud).
237
lus à la fonction thérapeutique de l’alimentation, autrement dit à lanourriture des malades. Les seuls autres exemples que je connaissesont plus tardifs et / ou d’une orientation toute différente. Assezfameux parmi les historiens de l’alimentation depuis les travaux deMaxime Rodinson, le Liber de ferculis et condimentis a été tiré d’untraité du praticien bagdadien du XIe siècle Ibn Jazla, et ceci par lemédecin padouan Zambonino da Gazzo à la jointure des XIIIe etXIVe siècle; mais il s’organise par mets et non par maladie, l’indica-tion thérapeutique venant au terme de la recette 11. Plus proche dela perspective adoptée par Musandinus est le Liber de cibariis infirmo-rum, attribué à Albucassim Aharam ou Albucasim Azaravi 12, autre-ment dit le grand médecin d’al-Andalus au Xe siècle al-Zahrâwî,auteur d’une encyclopédie médicale dont la partie chirurgicale avaitété traduite par Gérard de Crémone et dont l’Occident latin connutaussi, sous le nom de Liber servitoris, la partie sur les médicamentssimples. Le traitement du Liber de cibariis infirmorum est toutefois plussystématique que celui de la Summula puisqu’il examine les alimentsà préparer non seulement pour ceux qui souffrent de fièvre ou deconstipation, mais aussi contre la phtisie, l’asthme et la colique, lalèpre, l’hydropisie, sans compter des régimes particuliers pour lesfemmes enceintes, pour augmenter le coït ou «De dessicantibusspermam et pollutionem aufferentibus», pour grossir ou maigrir,pour accélérer ou arrêter la lactation ou bien les règles, etc. Ce traitétrès complet se présente comme ayant été traduit indirectement del’arabe en latin, par l’intermédiaire du catalan – et par les soins deBerengarius Eymericus de Valence dit le manuscrit de Vienne. Tou-jours en péninsule ibérique, mais cette fois dès la deuxième moitié
BRUNO LAURIOUX
11. Laurioux, Une histoire culinaire, 325-32. La traduction de Zambonino daGazzo (Jamboninus de Crémone) n’est connue que par un manuscrit latin:Paris, BnF, lat. 9328, XIVe siècle, éd. E. Carnevale Schianca, «Ancora a propo-sito di Jambobino e del Liber de ferculis», Appunti di Gastronomia, 38 (giugno2002), 11-38; un autre manuscrit (München, Bayerische Staatsbibliothek, Cgm415, XVe siècle) a transmis une traduction allemande de cette version latine: éd.M. Martellotti, Il Liber de ferculis di Giambonino da Cremona. La gastronomiaaraba in Occidente nella trattatistica dietetica, Fasano 2001 (Biblioteca della Ricerca.Cultura straniera, 108).
12. A Catalogue of Incipits of Mediaeval Scientific Writings in Latin, éd. L.Thorndike, P. Kibre, Cambridge (Mass.) 1963 [abrégé en TK], 746 mentionnentle manuscrit Wien, Österreichische National-Bibliothek, 5434, f° 283-321auquel il faut ajouter Paris, BnF, n. a. lat. 343, f° 108r°a-129r°a.
238
du XIIe siècle, Gérard de Crémone avait traduit une partie du Livredes médicaments simples et des aliments d’Abenguefi 13 (Ibn Wâfid,médecin du XIe siècle, également originaire d’al-Andalus), decontenu toutefois assez différent 14. L’originalité de la Summula depreparatione ciborum et potuum infirmorum semble donc évidente dansle paysage médical de son époque, où Musandinus paraît avoir jouéle rôle d’un précurseur 15. La clé de cette nouvelle orientation setrouve peut-être dans le milieu salernitain. C’est l’occasion de rap-peler quelques repères sur un auteur dont l’existence est bienconnue des spécialistes – même si son œuvre l’est un peu moins.
Ce que nous savons de Petrus Musandinus lui-même se résumeà peu de choses. Gilles de Corbeil fait l’éloge de celui qui fut sonmaître dans son De laudibus et virtutibus compositorum medicaminum 16.D’autre part, le commentaire sur l’Isagoge de Johannitius que luiattribue le manuscrit de Winchester (datable des environs de 1200) 17
est peut-être une reportatio réalisée à partir des cours de Bartholo-maeus de Salerne 18; quant au commentaire sur le Tegni de Galien qui
PETRUS MUSANDINUS ET SON TRAITE SUR L’ALIMENTATION DES MALADES
13. L’attribution figure dans l’éloge funèbre annexé par les disciples deGérard de Crémone à la fin de sa traduction du Tegni de Galien (traductioncommode dans O. Guyotjeannin, Archives de l’Occident, 448-55). TK 530 signa-lent trois manuscrits auxquels il faut ajouter Città del Vaticano, BibliotecaApostolica Vaticana (abrégé désormais en BAV), Vat. lat. 4437 (Liber Albegafid;inc. «Ex antiquis libris hunc agregavi […]»), que Laurence Moulinier-Brogi aeu l’amitié de consulter pour moi; ainsi que Firenze, Biblioteca Medicea Lau-renziana, Strozzi 88 (qui contient également Musandinus).
14. C’est l’impression que j’ai retirée d’un rapide examen de l’éditiondonnée par Jean Schott: Liber Albengnefit philosophi de virtutibus medicinarum etciborum, à la suite du Tacuinum Sanitatis (Tacuni Sanitatis Elluchasemeli Mitharmedici de Baldath, Strasbourg 1531, 119-39).
15. Cette conclusion reste très provisoire étant donné l’existence de traitésnon encore identifiés. Cf. par exemple un De cibis vulneratorum (München,Bayerische Staatsbibliothek, Clm 161, f° 40v°, XIIIe siècle) attribué par TK 419à Albucasis.
16. De laudibus et virtutibus compositorum medicaminum, dans Ægidius Corbo-liensis, Carmina medica, éd. L. Choulant, Leipzig 1826, 51-52. Cf. M. Ausécache,«Gilles de Corbeil ou le médecin pédagogue au tournant des XIIe et XIIIesiècles», Early Science and Medicine, 3 (1998).
17. Winchester,Winchester College,The Warden and Fellows’ Library, ms. 24,f° 22v°: «Incipiunt Glosule Johannitii ad Tengni Galieni secundum magistrumPetrum Musandini»; cité d’après P. O. Kristeller, «Bartholomaeus, Musandinusand Maurus of Salerno and other early commentators of the Articella, with a ten-tative list of texts and manuscripts», Italia medioevale e umanistica, 29 (1976), 60.
18. Le même commentaire (incipit: «Rectus ordine doctrine») est attribuédans plusieurs autres manuscrits (Kristeller, «Bartholomaeus, Musandinus», 77)
239
lui est également attribué dans le même manuscrit, il l’est sûrementquisqu’il a été fait «ad locutionem Bartholomei summi theorici inarte phisica» 19: voilà qui confirme que Petrus Musandinus a étél’élève de ce dernier. Ces éléments ancrent clairement Musandinusdans le milieu salernitain de la fin du XIIe siècle, époque à laquelleon peut fixer sa mort 20. Il appartient ainsi à la seconde (ou troi-sième) génération des maîtres salernitains: les traductions constanti-niennes des textes arabes ont été assimilées et l’on se tourne depuisle milieu du XIIe siècle vers les œuvres de Galien 21. Dans cet effortde constitution de la médecine comme «science» sur des fondementsthéoriques solides, Bartholomaeus, le maître de Petrus Musandinus,a joué un rôle certain: il fut ainsi en relation avec Burgundio dePise 22, le traducteur, entre autres, du traité galénique Des complexionsqui eut une grande influence sur les conceptions physiologiques rat-tachant le fonctionnement du corps humain à celui de l’univers 23.
BRUNO LAURIOUX
à un magister Bartholomeus, Barth. ou B., dans lequel il faut probablement voirBartholomaeus de Salerne (et non de Bruges comme l’a démontré Kristeller,ibid., 63). Sur l’activité de commentateur menée par Bartholomaeus de Salerne,voir la contribution de Faith Wallis dans le présent volume.
19. Winchester, Winchester College, The Warden and Fellows’ Library, ms.24, f° 108 (colophon du texte; il est à noter que le début du texte, f° 52r°, qua-lifie Bartholomeus de «summi theorici in arte practiche»), cité d’après Kristel-ler «Bartholomaeus, Musandinus», 60. Trois autres manuscrits, datant d’après1250, attribuent la reportatio à Petrus Hispanus, remplaçant significativementlocutionem par lectionem, plus conforme aux pratiques du commentaire scolas-tique (Kristeller, «Bartholomaeus, Musandinus», 79).
20. Le seul point de repère est le De laudibus et virtutibus compositorum medica-minum dans lequel Gilles de Corbeil présente son maître comme déjà mort. Ordes indices internes ••••••• pender que ce poème a été progressivement écritentre 1180 et 1195: D. Jacquart, Supplément au dictionnaire biographique des méde-cins en France d’E.Wickersheimer (abrégé en DMBJ), Genève 1979, 239. Prudem-ment, P. O. Kristeller écrit que «surely Musandinus died some time before 1200»(Kristeller, «Bartholomaeus, Musandinus», 61 n. 2 [de la p. 60]), ce qui, en toutétat de cause, fait du manuscrit de Winchester un témoin contemporain de sonactivité.
21. À commencer par le Tegni qui, après 1150, est intégré à l’Articella.22. C’est à la demande de maître Bartolomeus que Burgundio traduisit un
passage du Tegni de Galien absent de la version latine «standard» (Kristeller,«Bartholomaeus, Musandinus», 63 n. 4).
23. D. Jacquart, «De crasis à complexio: note sur le vocabulaire du tempéra-ment en latin médiéval», dans Mémoires V,Textes médicaux latins antiques, éd. G.Sabbah, Saint-Étienne 1984, 71-76; repris dans Ead., La science médicale occiden-tale entre deux renaissances (XIIe s.-XVe s.), Aldershot 1997, n° VI. On n’oublierapas que Burgundio de Pise a aussi (incomplètement) traduit le De sanitatetuenda.
240
La formation de Petrus Musandinus et les orientations del’«École» de Salerne se reflètent dans les œuvres qui sont attribuéesà cet auteur 24. Outre le traité qui m’occupe ici et les reportationesque je viens d’évoquer, il faut citer un commentaire sur les Pronos-tics d’Hippocrate (un des composants de l’Articella) transmis par plu-sieurs manuscrits du XIIe siècle 25. D’autres manuscrits lui attribuentun Liber medicinae ou Cure 26, une Praxis medica 27, une Summa medi-cine 28, une Summa de opiatis et un De clisteribus 29. On notera qu’on
PETRUS MUSANDINUS ET SON TRAITE SUR L’ALIMENTATION DES MALADES
24. Je m’appuie ici sur la liste donnée dans le Dictionnaire biographique desmédecins en France au Moyen Age d’Ernest Wickersheimer, 2 vol., Paris 1936(rééd. 1979) (abrégé en DMBW), 652 et dans DMBJ, 239.
25. Mss Oxford, Bodleian Library, Digby 108, f° 91r°-106v° et Bern, Stadt-bibliothek, A.52, f° 68v°-84v° (attribution à Oribase par une main ultérieure),tous les deux signalés par TK 1277 («Quoniam humana corpora assidue inter-ius […]»), qui mentionnent d’autres manuscrits pour les XIIIe et XIVe siècles(cf. en outre TK 1619: «Ut in singulis valitudinis egritudinibus […]»). Ce com-mentaire n’a pas le même incipit que celui de Bartholomaeus de Salerne sur lesPronostics (TK 1587: «Tria sunt medicine subiecta […]»), qui est aussi contenudans le manuscrit de Winchester, f° 144v°-157r° (Kristeller, «Bartholomaeus,Musandinus», 78); la comparaison entre les deux, souhaitée par Kristeller, ibid.,71, reste toutefois encore à mener. Il faut noter que les manuscrits d’Oxford etde Berne s’ouvrent par l’un des plus anciens commentaires à l’Isagoge de Johan-nitius («The Digby commentary» pour Kristeller, ibid., 71 et 77), égalementcopié dans le manuscrit Cambridge University Library, Peterhouse College, 251(début XIIIe siècle, f° 49v°-80v°), qui s’ouvre, quant à lui, par le commentairede «Petrus Musandia» aux Pronostics.
26. Attribué à Petrus de Musanda. Ms. Edinburgh, University Library, 164,du XIIe siècle (f° 1r°-58v°) ainsi que d’autres manuscrits plus tardifs (TK 217:«Circa omnium egritudinum genera triplex […]»).
27. Ms. London, British Library (abrégé en BL), Sloane, 1124, f° 147-171,XIIIe siècle, attribué à Petrus de Musaria.TK 344 pour le prologue: «Cum sto-machus pro necessitate sui et humani corporis […]». Cf. aussi TK 550 pour lepremier chapitre: «Febris autem diffinitionem brevitatis causa […]». On noteraque le second de ces incipits est également celui d’un De febribus anonymecontenu dans un manuscrit des environs de 1200 (Cambridge UniversityLibrary, Additional 6865, f° 108r°-115v°b).
28. Ms. Kraków, Biblioteka Jagelliónska, 809, f° 124v°-143r°, XVe siècle,texte attribué à Petrus de Musana. L’incipit («Quia de radice sive fundamentosumme sumus tractaturi […]») ne figure pas dans TK.
29. Ces deux derniers traités sont contenus dans le ms. London, BL, Harley3719, du XIVe siècle, respectivement aux f° 14v°-18r° et 18v°-27r°. Dansd’autres manuscrits, le De clisteribus est attribué à Gérard de Crémone ou resteanonyme (TK 228: «Clisterium quatuor sunt genera mollificativum […]»),tandis que le seul autre exemplaire de la Summa opiatis mentionné par TK (999:«Omnis medicine opiate duplex est effectus […]») la présente égalementcomme anonyme; un troisième manuscrit de la Summa opiatis a été repéré par
241
ne dispose pas toujours pour ces œuvres de manuscrits anciens (c’estle cas pour la Summa medicine) et que, surtout, l’auteur y apparaîtsous des noms divers: si dans Mussandi, Musanda ou Musandia, onretrouve à peine déformé notre Petrus Musandinus, Mosanna, Musa-ria sont des formes plus problématiques; nous touchons là une diffi-culté qu’on retrouvera pour la Summula.
Quoi qu’il en soit, Petrus Musandinus apparaît comme un auteurtypique de la production médicale savante de la fin du XIIe siècle,ce qu’indiquent bien les sources dont il fait usage dans la Summulade preparatione ciborum et potuum infirmorum. Les autorités qu’il citesont précisément celles qu’il a commentées – Galien pour sonTegni 30 – ou bien celles qui, partie intégrante de la collection desti-née à l’enseignement et connue à la Renaissance sous le nom d’Ar-ticella, ont fait l’objet de commentaires de la part des maîtres saler-nitains: Hippocrate pour ses Aphorismes 31 ou le Liber urinarum deThéophile 32. Mais ces citations revendiquées sont rares 33 et ellesn’apparaissent que dans la version longue éditée par De Renzi. L’ex-trême variabilité textuelle du traité attribué à Petrus Musandinusmérite qu’on s’y attarde.
BRUNO LAURIOUX
P. O. Kristeller, Iter Italicum, 6 vol., Londres-Leyde 1963-1992, IV, 610b: Seo deUrgel, Archivo de la Catedral, 77, f° 111v°. Mireille Ausécache me signale laprésence de ce texte dans le ms. lat. 7035 de la Bnf (f° 135v° et sq.), qui datè duXIIIe siècle.
30. CS, 257: «nihil enim valet ei aliquid dare nisi natura se coadiuvet, undeGalienus in Tegni: ‘omnium natura operatrix medicus vero minister’». Cf. Tegni:«Omnium autem horum natura quidem operatrix medicum vero minister»(Articella, Padoue 1476, [document Gallica 59108, p. 444]). Plus loin, un longpassage met en scène Galien (CS,V, 262), mais je n’ai pu encore en déterminerl’origine.
31. CS,V, 261: «Quod appetit dari debemus, quia sepe contingit quod vitiumconfortatur eius nature ex hoc quod liberatur iuxta dictum Ypocratis inAmphorismis. Ait enim in secunda particula: ‘parum deterior cibus et potus etcetera’». Cf. Aphorismes II, 39: «Parum deterior cibus et potus delectabilior vero:melioribus quidem in delectabilibus magis appetendus» (Articella, [62]).
32. CS, V, 263: «Proprius enim color sanguinis, ut testatur Theophilus inUrinis, est rubicundus parum purpure». L’idée est sous-jacente au traité de Théo-phile mais je n’ai pas retrouvé dans le Liber urinarum cette formulation précise.
242
Une œuvre répandue mais très mouvante
On oublie trop souvent que, dans sa Collectio Salernitana, SalvatoreDe Renzi a édité par deux fois le traité de Musandinus: avant mêmela version longue, tirée d’un manuscrit du XIIIe siècle (Paris, BnF,lat. 6954, Pa3 dans la liste figurant ci-dessous en annexe A) 34, il en aen effet donné une version beaucoup plus courte que Theodor Hen-schel avait empruntée à un exemplaire du XVe siècle alors conservéà Breslau (Wr) 35. Il faut voir dans cette double publication non seu-lement le repentir d’un éditeur peu rigoureux et travaillant deseconde main mais le reflet de l’histoire complexe d’un texte soumisà de nombreuses modifications au long d’une abondante diffusionde plusieurs siècles 36.
Sans prétendre avoir mené une enquête exhaustive, j’ai pu retrou-ver au cours de mes lectures la trace d’environ 25 manuscrits trans-mettant de manière sûre le traité de Musandinus (cf. annexe A) –auxquels il faut ajouter quelques exemplaires plus ou moins douteuxdont je n’ai pas encore eu le temps de vérifier le texte 37. Cette
PETRUS MUSANDINUS ET SON TRAITE SUR L’ALIMENTATION DES MALADES
33. Ajoutons un renvoi à un certain Johannes (à propos des envies des femmesenceintes): «Dicit Iohannes: ‘vidi mulier desiderantem cineres’» (CS,V, 267).
34. CS,V, 254-68.35. CS, II, Naples 1853, 407-10. L’«éditeur» déclare explicitement avoir tra-
vaillé à partir de la transcription réalisée par son devancier et correspondant(ibid., 407 n. 1).
36. Du grand nombre de manuscrits, De Renzi avait parfaitement conscience(«Quasi tutte le principali biblioteche di Europa sono provvedute di copie piùo meno compendiose di questo trattato», CS, II, 407 n. 1) mais, outre les deuxqu’il reproduit, il n’utilise (fort brièvement) que Pa5 (ibid.,V, 254 n. 1).
37. Un manuscrit de Göttingen (Niedersächsische Staats- und Universtäts-bibliothek, Hist. nat. 30, f° 11r°-12v°, du XIIIe siècle) pourrait éventuellementconserver le traité de Musandinus (cf. l’incipit «Quales cibi debeant dari infir-mis. De cibis et potibus praeparandis infirmatibus febre acuta […]»: Verzeichnissder Handschriften im Preussischen Staate, 1, Hannover, 2, Göttingen, 2, Berlin 1893,295), tandis que le codex London, BL, Additional 22636, f° 117 ss. (XIIIe-XIVesiècle) contient un De dieta dont l’incipit se retrouve dans les débuts de la Sum-mula («Dieta vero accipitur large et stricte»; cf. infra, annexe 2) ainsi que l’aremarqué Nicoud, III, 651; le catalogue imprimé évoque, pour les f° 117 à 130,une «Collectio tractatuum de diaeta, de febribus, de clisteribus, suppositoriis etsiropis, etc.» (Catalogue of Additions to the manuscripts on the British Museum in theyears mdcccliv-mdccclx, Additional Mss 19,720-24,026, Londres 1875, 707-8). Lamême historienne (Nicoud, III, 666) signale dans le n° 536 du Wellcome Insti-tute for the History of Medicine la présence du traité de Musandinus duquel
243
grosse vingtaine de témoins place certes la Summula loin du «succèsde librairie» que fut le Pantegni 38 – pour ne rien dire des traités ras-semblés dans l’Articella 39 – et, dans le domaine proprement diété-tique, les «Diètes universelles et particulières» d’Isaac le Juif 40; maiselle autorise une approche sinon statistique au moins globale.
Plus que le nombre, ce qui frappe est la pérennité de cette diffu-sion, depuis les débuts du XIIIe siècle (c’est-à-dire non loin deMusandinus lui-même: Fi 3 41) jusqu’en plein cœur du XVe siècle (lemanuscrit Br étant datable des environs de 1470). La répartitionchronologique des exemplaires conservés – toute provisoire cardépendant encore trop souvent des descriptions de catalogueurs –est relativement équilibrée: 8 pour le XIIIe siècle, jusqu’à 10 pour leXIVe siècle et encore 7 au XVe siècle.
La Summula n’a donc pas cessé d’intéresser les lecteurs médiévauxet il faut se demander pourquoi car il n’en a pas été de même pourtous les textes salernitains des XIIe et XIIIe siècles. Cette œuvreoccupait-elle un «créneau»? Que pensaient y trouver ses lecteurs? Enréalité, ils n’avaient pas nécessairement tous affaire au même texte,
BRUNO LAURIOUX
le catalogue de Moorat ne souffle mot (S. A. J. Moorat, Catalogue of WesternManuscripts on Medecine and Science in the Wellcome Historical Medical Library, I,Manuscripts written before 1650, Londres 1962, 392). Un troisième manuscrit lon-donien, le BL Sloane 3149 (XVe siècle), contient des f° 38 à 40 (Nicoud, III,663) un De cibis et potibus conçu pour les malades selon TK 655 mais dont l’in-cipit («Ideo superscribendum est de cibis et potibus qui sunt calidi […]») n’arien à voir avec celui du traité musandinien. J’ignore la nature exacte du Die-tarius variorum morborum qui, dans le ms. München, Bayerische Staatsbibliothek,Clm 73 (ca 1413), fait suite (f° 292-294) au Collectorium totius medicine de Nic-colò Bertruccio (Nicoud, III, 676). Enfin si le De preparatione ciborum et potuumfebrientum contenu dans un ms. de Würzburg du XIIIe siècle (Universitätsbi-bliothek, Mp med. q. 2, f° 43r°-44v°) évoque par son titre l’œuvre de Musan-dinus, son incipit est fort différent: «In morborum curiationibus triplici» (Cf.TK 692, qui renvoie à Erfurt, Amploniana 4° 204, f° 81, XIIe-XIIIe siècle).
38. Une centaine de manuscrits plus ou moins complets du Pantegni ont étérecensés en appendice de l’ouvrage collectif dirigé par C. Burnett, D. Jacquart,Constantine the African and ‘Alı ibn al-‘Abba-s al-Magu-sı, Leyde 1994.
39. Au seul département des manuscrits occidentaux de la BnF, l’équipe deD. Jacquart a repéré 19 manuscrits de l’Isagoge Iohannitii (index établi par J.Chandelier et L. Moulinier-Brogi – que je remercie d’avoir bien voulu mecommuniquer ces données encore inédites).
40. M. Nicoud a décompté 60 manuscrits plus ou moins complets de cetteœuvre (Nicoud, III, 759-69).
41. Ce manuscrit pourrait remonter partiellement au XIIe siècle selon M.Green (cf. sa liste de manuscrits du XIIe siècle publiée dans ce même volume).
244
dont l’identification par un titre et l’attribution à un auteur estd’ailleurs demeurée assez fluctuante à la fin du Moyen Age.
Dans l’état actuel de mes informations, près d’un manuscrit surdeux (11) laisse l’œuvre anonyme. On peut être d’autant plus tentéde remettre en cause l’attribution à Petrus Musandinus que, parmiles manuscrits du XIIIe siècle, seuls deux (Pa 3 bien sûr mais aussiOx 3) ont la forme Musandinus, contre cinq qui ne donnent aucunnom d’auteur (Fi 1, Fi 2, Fi 3, Pa 2 et Va 1). C’est dans des exem-plaires tardifs, du XVe siècle, que l’on trouve la forme manifestementdérivée Petrus de Musanda (Br, Ox 1,Va 2,Wr) voire le très suspectPetrus de Marrono (Wi) – mais l’on n’est pas ici à l’abri d’unemélecture de la part d’un catalogueur qui a travaillé à partir de tablesélaborées bien après la transcription du texte: à cette époque, le nomde Petrus Musandinus était sans doute déjà bien oublié.
Que le titre de l’œuvre soit lui-même très fluctuant ne doit pas enrevanche surprendre: avant l’apparition (au XVe siècle) d’une pagespécialement destinée à mettre en valeur le titre – et qui contribuabien entendu à le fixer – celui-ci n’était en somme qu’un repèresoumis à l’appréciation de l’utilisateur et qui pouvait varier entre latable et la rubrique, voire, comme dans Wo, entre la rubrique initiale(«Summula de preparatione ciborum et potuum secundum Musan-dum») et le colophon («Explicit hic summa Musandinum»). Si l’on selimite aux exemplaires les plus anciens (XIIIe et XIVe siècles) et misà part le cas aberrant de Er (qui donne «Summula de purgatione cibo-rum et potuum infirmorum»), le titre résume bien le but de l’œuvre:la préparation des aliments et des boissons pour les malades, «de pre-paratione ciborum et potuum infirmorum», séquence qui figure dansau moins 6 manuscrits et plus si l’on y agrège les formules proches«de cibis et potibus praeparandis infirmis» ou «de modo preparandicibaria et potus infirmis»; la référence à des affections plus précises –par exemple les fièvres dans la version courte éditée par De Renzi –est déjà présente dans Fi 1, avec une allusion évidente à un célèbretraité hippocratique («De cibis et potibus preparandis in acutis egritu-dinibus»). Pour qualifier le résultat, il y a une hésitation, dès le XIIIesiècle, entre Summula (Ox 3, Pa 3), Tractatus (Va 1) et Liber (Fi 3) – quis’affirmera au siècle suivant. On note Musandina (Ma, Pa 1), qui com-bine auteur et titre, faisant le pendant à Rogerina par exemple. De cepremier balayage, on retire donc la nette impression qu’il est impos-sible de se contenter des éditions existantes si l’on veut appréhender
PETRUS MUSANDINUS ET SON TRAITE SUR L’ALIMENTATION DES MALADES
245
le traité de Musandinus dans sa véritable complexité. L’étude précisedu texte renforce cette impression.
Entre les deux versions publiées par De Renzi, les différences sontd’abord de taille: un peu plus de trois pages pour la rédaction courtetirée du manuscrit de Wrocl/aw, une quinzaine pour le texte trans-mis par le codex latin 6954 de la BnF. Mais la première ne peutmême pas être considérée comme un fragment du second: si les huitnotices initiales de Wr se retrouvent au début de Pa 3 42, la suite estpropre au manuscrit qui, par ailleurs, n’a pas repris toutes les recettesinitiales attestées par Pa 3 43, les a beaucoup résumées 44 et en aajouté de son cru 45; au final, ont été abandonnées les nombreusesrecettes expliquant comment détourner les prescriptions médicalespour le plus grand plaisir du malade et tout ce qui ne concernait pasles fièvres, point commun entre les extraits tirés de Musandinus etles ajouts transmis par Wr. La version courte est donc bien secondeet paraît devoir se rattacher à une expérience isolée, tandis que laversion longue est connue par au minimum 8 manuscrits 46 – tout aumoins si l’on en juge par les explicit, dont certains suggèrent dureste des rédactions intermédiaires 47.
Ces extensions ou ces réductions se comprennent davantage lors-qu’on porte attention aux découpages qu’attestent rubriques, ini-tiales, crochets interlinéaires et pieds-de-mouche – en un mot toutun système décoratif qui constitue également un système de repé-rage. De ce point de vue aussi, le travail effectué par De Renzi esttrompeur: les rubriques des manuscrits Pa5 et Pa6 apportent ainsi depertinentes ruptures à l’intérieur d’une interminable notice qui,dans Pa3, ne semblait guère avoir de cohérence 48.
BRUNO LAURIOUX
42. La séquence publiée dans CS, II, 407-9, jusqu’à la notice Ad calorem maxi-mum extinguendum, reproduit celle qui figure dans CS,V, 254-59.
43. Ont été abandonnées les lignes 13 à 30 de CS,V, 255 et les lignes 6-8 deCS,V, 256.
44. La notice de Cibus laxativus et febrium alterativus résume en 8 lignes (CS,II, 408) ce que la version longue développait en 15 lignes (CS,V, 255-56).
45. Par exemple Apozima laxativum (CS, II, 409), qui apparaît davantagecomme un médicament que comme une confection alimentaire.
46. Manuscrits Fi 3, Ma, Mü, Pa 2, Pa 3, Pa 6,Va 1,Va 3.47. «mementote tamen semper cum oleo eam servare» (Fi 2) ou «memento
eam semper cum oleo reservare» évoquent «memento autem cum oleo semperservare», qui figure aux trois-quarts de la version longue (CS,V, 265, l. 23-24).
48. Là où Pa 3 a «De dieta infirmorum qui habent febrem et apostema» pourqualifier le long passage allant de CS,V, 258, l. 20 à 261, l. 26, Pa 5, distingue «De
246
Les variantes textuelles concernent non seulement le nombre etl’ordre des notices mais leur contenu, comme l’on peut s’en rendrecompte à la lecture du bref passage reproduit en annexe B. Horsvariantes graphiques, près de 200 désaccords – parfois considérableset massifs – sont repérables, et ce pour un texte qui occupe un peuplus d’une page dans la seconde édition De Renzi. Et encore n’ai-je pas collationné tous les manuscrits disponibles (même les plusanciens) – ce qui, pour l’heure, m’interdit de proposer une quel-conque approche de la tradition 49, a fortiori un stemma.
On pourrait être ici tenté d’invoquer la variabilité inhérente à lalittérature des réceptaires: l’adaptation à la pratique impose d’inces-santes modifications – telles qu’insertion de nouvelles recettes etsuppression d’autres, ajouts ou substitutions d’ingrédients, réécri-tures qui épousent les préférences lexicales propres à une époque,une région ou un milieu 50. Toute exacte qu’elle soit, cette explica-tion ne suffit pas: preuve en est le fait que le prologue donne luiaussi l’occasion de variantes spectaculaires.
Faut-il le repéter? On ne saurait se contenter de l’édition – deséditions – De Renzi pour apprécier la Summula à sa juste mesure. Àbien des égards, les manuscrits Pa 3 et Wr, qu’il avait choisis, appa-raissent même comme atypiques. L’intégration de tous les témoinsdisponibles – et ils n’ont sans doute pas été entièrement recensés –est la priorité d’une future édition critique. Toutefois, comme cela
PETRUS MUSANDINUS ET SON TRAITE SUR L’ALIMENTATION DES MALADES
cibis et potibus preparandis febribus acutis qua comitatur apostoma» et «Decibis in apostematibus preparandis» (avant «Si vero apostema sit de calida mate-ria» CS,V, 259, l. 10). Pa 6 choisit de faire se succéder un chapitre 5, «De pre-parandis cibis febribus acutis cum apostomate», et un chapitre 6, «Qualiter pre-parentur cibi delicatus febribus cum apostomate» (avant «Sunt quidam delicati,qui non possunt comedere» CS,V, 259, l. 44).
49. Au moins peut-on déjà considérer certains témoins comme secondaires,tel Pa 2 qui apparaît au total comme une copie fautive (cf. variantes n° 32, 52et surtout n° 185 avec un probable saut du même au même) et transmettant untexte tronqué (n° 87 par exemple).
50. Comme cela a été observé pour la pharmacopée: I. Ventura, «Per unastoria del Circa Instans. I Secreta Salernitana ed il testo del manoscritto London,British Library, Egerton 747: Note a margine di un’edizione», Schola Salerni-tana. Annali, VII-VIII (2002-2003), 39-109; L. Mauro, A. Masturzo, «Elementi dioriginalità nel corpus botanico del Circa instans», dans Salerno nel XII secolo. Isti-tuzioni, società, cultura, Atti del convegno internazionale, éd. P. Delogu, P. Peduto,Salerne s.d. [2004], 408-28. À noter que l’appellation Nux sciarca pour désignerla maniguette/graine de paradis dans le ms. Egerton 747 (Mauro-Masturzo,«Elementi di originalità», 423 n° 292) renvoie, selon moi, à une source – sinonà une origine – catalane.
247
tend à devenir la saine habitude chez les éditeurs de textes scienti-fiques, il faudrait assortir ce classique travail philologique d’unescrupuleuse analyse codicologique, attentive notamment au contextemanuscrit de l’œuvre de Musandinus.
Comment lire la cuisine des malades? Le contexte manuscrit
La taille de la Summula ne lui permettant pas d’emplir un volume,elle s’est trouvée associée à d’autres textes dans des configurationsvariées. L’analyse de ce contexte manuscrit – certains parlent de«collocation» 51 – est un indice précieux de la conception que l’onse faisait du traité de Petrus Musandinus (était-il classé parmi lesauteurs récents ou archaïques? relevait-il de la doctrine ou de la pra-tique?, etc.) voire de l’usage que l’on comptait en faire. À condition,il est vrai, de combiner cette approche textuelle avec une étudematérielle des manuscrits (format, supports, notules), que je n’ai puencore mener complètement à bien.
Un premier recensement des textes associés au traité de PetrusMusandinus dans les manuscrits qui me sont connus aboutit à uneliste de plus de 300 titres. On ne doit pas cacher ce que ce résultat ad’imparfait: dépendant la plupart du temps des lectures des catalo-gueurs ou de leurs identifications, il ne tient pas assez compte, enoutre, de la variabilité des titres d’ouvrages au Moyen Age; enfin, fauted’une étude codicologique systématique, on n’est pas à l’abri d’unetrompeuse association, créée par la constitution d’un recueil factice 52.
C’est donc tout provisoirement qu’il faut noter quelques élémentsd’évolution. La première tendance de fond est l’augmentation dunombre de textes associés à la Summula: si on le rapporte au nombrede manuscrits produits pour chaque siècle, il passe de 12 par volumeau XIIIe siècle à 14 au XIVe siècle, enfin à 18 au XVe siècle. Cetteaugmentation traduit davantage un épaississement des manuscrits
BRUNO LAURIOUX
51. B. Roy, «Un art d’aimer: pour qui?», dans Id., Une culture de l’équivoque,Montréal-Paris 1992, 47-74.
52. C’est le cas de Nü, qui rassemble trois unités codicologiques accusantdes âges disparates; mais les deux premières étaient déjà reliées au XVe siècle,de sorte que le contexte de la Summula peut être défini de manière étroite parles œuvres qui furent copiées avec elle au XIVe siècle et au sens large par cellesqui furent réunies à cet ensemble initial par un lecteur médiéval.
248
qu’un renouvellement du stock des textes associés au traité deMusandinus: 17% de ceux du XIVe siècle l’étaient déjà au XIIIesiècle et, au XVe siècle, la part des héritages s’élève à presque unquart – sans que, pour autant, l’on puisse parler d’essoufflement 53.
Les contextes évoluent aussi thématiquement. Certains manuscritsdu XIIIe siècle associent le traité de Petrus Musandinus avecquelques-unes des principales productions que l’on peut qualifier de«salernitaines». Et ceci soit parce que, traduites par Constantin l’Afri-cain, elles étaient étudiées à l’école de médecine de Salerne: Diètesparticulières et Liber de febribus d’Isaac le Juif dans le ms. Er, Libergradum d’Ibn al-Jazzâr dans Fi 3. Soit encore parce qu’elles étaientune composante du canon de textes destiné à l’enseignement etdénommé Articella par les éditeurs de la Renaissance: Liber de pulsibusde Philaret (Er), Régime des maladies aiguës d’Hippocrate (Fi 3). Soit,enfin, parce que leur auteur relève, pour une raison ou une autre, dumilieu salernitain:Archimatthaeus (Ox 3), Nicolas, auteur du fameuxAntidotaire (Fi 3, Pa 3), Platearius (Er, Pa 3),Trotula (Ox 3,Va 1) – sanscompter les «Tables salernitaines» (Fi 1, Pa 3). D’abord, le traité dePetrus Musandinus apparut donc comme l’un des éléments de lanouvelle médecine qui triomphait dans les premières facultés; bienqu’il ne figurât pas au programme officiel des dites universités, ildevait être lu par les maîtres et les étudiants auxquels étaient vrai-semblablement destinés les plus anciens manuscrits qui l’ont transmis.
Au XIVe siècle, l’environnement manuscrit de la Summula s’élar-git aux grands noms de la médecine montpelliéraine, Bernard deGordon (Ox 2, Pa 1) et Arnaud de Villeneuve (Ox 2) 54. On noteaussi l’apparition des premiers Regimina Sanitatis (Va 2), dont legenre se définit vraiment au XIVe siècle 55, et la multiplication destextes de Galien (Ma, Ox 2,Va 3), qui tendent à remplacer les tra-ductions de l’arabe dans l’enseignement universitaire 56 – à la notableexception du Canon d’Avicenne, que son volume interdit cependantde côtoyer tout autre texte.Au XVe siècle, ce sont les Consilia d’An-
PETRUS MUSANDINUS ET SON TRAITE SUR L’ALIMENTATION DES MALADES
53. En chiffres absolus, les nouveaux textes du XIVe siècle dépassent le stockdisponible au XIIIe, et ceci légèrement plus que l’augmentation de la produc-tion des manuscrits concernés; au XVe siècle, le nombre de nouveaux textesdiminue légèrement moins que cette production.
54. Cf. aussi les Experimenta cancellarii Montispessulani (Pa 5).55. Nicoud, I, 127-237.56. D. Jacquart, F. Micheau, La médecine arabe et l’occident médiéval, Paris 1990,
179 ss.
249
tonio Cermisone ou d’Antonio Guaineri (Br,Wo), les traités contrela peste de Jean de Tournemire, Jean de Bourgogne ou Jean Jacme(tous rassemblés dans le manuscrit Pa 6) qui prennent le relais. Onvoit ainsi que la Summula de Petrus Musandinus s’est insérée dans lesévolutions successives de la production médicale de l’Occident latin.Utilisée et appréciée à chaque étape – Salerne, universités, explosionde la littérature pratique – elle est encore copiée au XVe siècle, alorsque certains de ses «compagnons» du XIIIe siècle ne le sont plusdepuis longtemps.
Au-delà de ces effets de génération, se distinguent quelques textes,associés à la Summula dans plusieurs manuscrits et sur plusieurssiècles. Ils forment un ensemble d’apparence hétérogène, même si sarépartition entre témoins suggère des généalogies, des traditions:Practica d’Archimatthaeus (Ma, Ox 1, Ox 3), Tractatus de urinis deBernard de Gordon (Pa 1, Wi, Wo), Secreta pseudo-hippocratiques(Ma, Pr,Va 3), Breviarium de Jean de Saint-Paul (Fi 2, Ox 1, Ox 3),divers traités uroscopiques de Maurus (Fi 1, Fi 2, Nü,Va 1) 57, De sim-plicibus medicinis de Platearius (Er, Pa 3, Pr) 58, Quid pro quo (Ma, Pa6,Va 1, Wr), Liber de signis pronosticis de Ricardus Anglicus (Ma, Ox3, Pa 3,Va 1), De morbis mulierum et le De ornatu mulierum de Trotula(Ma, Ox 1, Ox 2, Ox 3,Va 1) enfin De dosibus medicinarum de WalterAgilon (Mü, Ox 2, Ox 3, Pa 6,Va 1). Ce sont très clairement des pré-occupations pratiques qui s’affirment ici – comme d’ailleurs danstout l’environnement manuscrit du traité de Musandinus.
En-dehors de rares considérations sur la classification des sciences(De divisione scientiarium de Robert Kilwardby, Ox 2) ou de nonmoins rares commentaires sur les textes théoriques fondamentaux enmatière médicale (Notabilia super librum Tegni et supra librum regimineacutorum, Ma), le versant pratique est dominant dans les volumescontenant la Summula. On y compte de nombreuses Practicae, dontcelle de Bartholomaeus, le maître de Musandinus (Ox 1), desrecueils de traitements ou de médicaments (par exemple dans Pr Deapostematibus, De aquis et De oleis) et d’innombrables recettes (dansau moins 17 manuscrits). Du côté de la pharmacopée, des Antido-taires de toute nature (Nü, Pa 3, Pa 5,Va 1, sans parler même de celuide Nicolas) sont complétés par les œuvres, dont le Grabadin, du
BRUNO LAURIOUX
57. Cf. l’article de L. Moulinier dans ce volume.58. Cf. aussi Fi 3: Summa Antidotarii; Ma: Liber virtutum medicinarum.
250
pseudo Mesué (Pa 4, Wo) et le Quid pro quo. Les textes permettantl’établissement du diagnostic grâce à l’observation du pouls ou desurines – ces dernières aidant aussi à formuler un pronostic – sontévidemment destinés à l’exercice très concret de la médecine 59; il enest de même pour les traités qui précisent comment parvenir à undosage correct des médicaments (celui de Walter Agilon est présenttout au long de la période). En comparaison, la présence de la dié-tétique reste modeste: une seule attestation de l’Opusculum de sapori-bus de Maino de Maineri (Wo) ou des Diètes d’Isaac (Er); les Floresdiaetarum de Jean de Saint-Paul ont une diffusion à peine plusimportante (Fi 1, Ma) 60.
La proportion – le dosage dirait un professionnel – entre cesdivers types d’œuvres médicales définit le profil des manuscrits etlaisse entrevoir l’usage qu’on peut en faire. Ainsi Pa 3, d’où DeRenzi a tiré son édition de la version longue, comprend à la fois laSumma Medicinalis de Walter Agilon, la Rogerina maior et minor, le Designis pronosticis de Ricardus Anglicus, l’Antidotaire Nicolas et Platea-rius, la Practica de Roger de Parme, enfin les Tables salernitaines:ensemble manifestement destiné à un praticien et qui d’ailleursappartint au XVe siècle à un certain Jean Normani, maître ès arts etbachelier en médecine 61; celui-ci le vendit en 1465 à Pierre de Thu-mery, qui portait alors les mêmes titres, acquit plus tard le doctoraten médecine et possédait plusieurs livres actuellement conservés à laBibliothèque nationale de France 62. Le texte auquel Normani etThumery s’intéressaient (peut-être) était déjà fort ancien, mais lemanuscrit qui le transmettait était pourvu de tous les guides de lec-ture propres au livre universitaire (rubriques, initiales colorées) etd’abondants commentaires marginaux.
Quant au codex de Wrocl/aw – qui transmet la version courte – laplus que trentaine d’œuvres qui le compose offre une tonalité toutaussi professionnelle. Les recettes de fabrication de sirops, la pré-sence du Quid pro quo – qui permettait de remplacer dans un remède
PETRUS MUSANDINUS ET SON TRAITE SUR L’ALIMENTATION DES MALADES
59. Au titre de la sémiologie, signalons un traité sur les signes de la mortdans les maladies et les jours critiques (Fi 2) et le De signis mortis et vitae deGalien (Ma). Les Secreta Hippocratis (Ma, Pr,Va 2) relèvent du même genre: cf.le récent article de D. Jacquart, «Le difficile pronostic de mort (XIVe-XVesiècles)», Médiévales, 46 (printemps 2004), 11-22.
60. Sur cette œuvre, d’attribution douteuse, cf. Nicoud, I, 35-42.61. Ms. Pa 3, f° 277r°. Sur ce personnage, cf. DBMW, II, 456.62. DBMW, I, 664 et DBMJ, 243.
251
un produit manquant par un ingrédient disponible – et surtout delexiques bilingues (latin-allemand) pour la préparation des médica-ments: tout cela évoque l’activité d’un apothicaire.
Le manuscrit Va 2, également du XVe siècle, est le premier volumed’une compilation médicale qui, dans les deux autres, reproduit unrecueil de remèdes a capite ad calcem. Ce volume initial est dévoluaux bases de la profession médicale: il s’ouvre par un De necessitate,inventione, divisione artis medicinae qui en détermine la légitimité,aborde ensuite les thérapeutiques fondamentales que sont les purgeset la saignée, définit des notions essentielles comme les complexions,fournit les règles de l’hygiène à travers un régime de santé. Le traitéde Musandinus y précède immédiatement un recueil d’observationset de traitements concernant les fièvres: la continuité est ici évidentesi l’on veut bien songer qu’une bonne partie de la version longue dela Summula – et la totalité de la version courte – s’attache auxmalades atteints de fièvre.
Ces exemples, même s’ils n’épuisent pas les possibles configura-tions textuelles, montrent que la Summula était comprise comme unouvrage de praticien et non comme un vade mecum pour malades.Contrairement aux régimes de santé conservatifs ou préventifs –avec lesquels, du reste, on la trouve rarement associée – elle avait unefinalité thérapeutique, dirigée notamment contre la maladie généraleemblématique de l’«ancienne médecine», la fièvre, qui était restéesans doute un phénomène courant dans l’Occident médiéval 63.
La souplesse de la Summula, que sa nature fondamentale de récep-taire permettait d’adapter à bien des exigences ou à bien des cir-constances, eut peut-être une part dans un succès dont ne bénéfi-cièrent pas ses «concurrents». Les préparations que Petrus Musandi-nus était réputé avoir prescrit trouvèrent-elles un écho dans la cui-sine qui se pratiquait quotidiennement pour les malades? On pour-rait le penser à la lecture des livres de cuisine du XIVe ou du XVesiècle qui prévoient souvent des recettes «pour malades», à base depoules bouillies, de bouillon et de sucre; c’était là l’alimentationcaractéristique des convalescents dans les hôpitaux les plus médica-lisés, où l’on trouve également trace de cucurbitacées, ces alimentsextrêmement froids qui, selon la Summula, combattaient si bien lesaccès fébriles.
BRUNO LAURIOUX
63. On songe aux fièvres puerpérales et, pour le monde méditerranéenauquel appartient Musandinus, au paludisme.
252
Annexe A
Liste provisoire des manuscrits de laSummula de preparatione ciborum et potuum infirmorum
Br: Bruxelles, Bibliothèque Royale, 3204-3218, f ° 257v°-259v° (XVesiècle, 1469-1470?)Er: Erfurt, Wissenschaftliche Bibliothek der Stadt, Amploniana 4° 176, f °76r°-82r° (2ème moitié du XIIIe siècle)Fi 1: Firenze, Biblioteca Medicea Laurenziana, Gadd. Rel. 201, f ° 1r°-6r°(XIIIe siècle)Fi 2: Firenze, Biblioteca Medicea Laurenziana, Plut. 73, 33, f ° 92-95 (XIIIesiècle) Fi 3: Firenze, Biblioteca Medicea Laurenziana, Strozzi 88, f ° 82r°-85v°(XIIIe siècle) Le: Leipzig, Universitätsbibliothek, 1182, f ° 66v° et ss. (XIVe-XVe siècle)Ma: Manchester, Chetham’s Library, 11380 (Mun. A.4.91), f ° 73r°-78r°(2ème moitié XIIIe-début XIVe siècle)Mü: München, Universitätsbibliothek, 2° Cod. ms. 576, f ° 114r°b-117r°a(1383)Nü: Nürnberg, Stadtbibliothek, Cent.VI, 49, f ° 78r°b-83r°a (XIVe siècle)Ox 1: Oxford, Bodleian Library, Bodl. 361, p. 444-58 (1453)Ox 2: Oxford, Merton College, 230, f ° 53v°-55r° (XIVe siècle)Ox 3: Oxford, Pembroke College, 21, f ° 79v°-95v° (fin XIIIe siècle)Pa 1: Paris, Bibliothèque de l’Arsenal, 708, f ° 153v°a-155v°b (XIVe siècle) Pa 2: Paris, BnF, lat. 6907 A, f ° 117v°b-120v°a (XIIIe siècle)Pa 3: Paris, BnF, lat. 6954, f ° 84r°-87v° (XIIIe siècle)Pa 4: Paris, BnF, lat. 7016, f ° 13v°-16v° (XIVe siècle)Pa 5: Paris, BnF, lat. 7091, f ° 104v°-109v° (XIVe siècle)Pa 6: Paris, BnF, n. a. lat. 3035, f ° 131v°-140r° (XVe siècle)Pr: Praha, Universitní knihovna, XIII. F. 26, f ° 27v°-30v° (XIIIe-XIVesiècle)Va 1: Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Pal. lat. 1253, f ° 178v°a-183v°a (2ème moitié du XIIIe siècle)Va 2:Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Pal. lat. 1255, f ° 132r°-134r°(ca 1400)Va 3: Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Vat. lat. 2392, f ° 72r°b-v°b(XIVe siècle)Wi: Wien, Österreichische National-Bibliothek, 5313, f ° 142v°-146r°(XVe siècle)Wo: Wolfenbüttel, Herzog-August-Bibliothek, 12.4. Aug. fol., f ° 446r°-450v° (XVe siècle)Wr: Breslau (auj. Wrocl/aw), Bibliothèque universitaire, Ac., III. Q. 5, f°365r°-366r° (XVe siècle)
PETRUS MUSANDINUS ET SON TRAITE SUR L’ALIMENTATION DES MALADES
253
Annexe B
Petrus Musandinus, Extrait de laSummula de preparatione ciborum et potuum infirmorum
Nota: le texte de base est celui de l’édition De Renzi (DR),V, 1859, 254-68 (d’après le ms. Pa3). Les variantes exclusivement graphiques n’ont pasété retenues. L’ajout (add.) se situe après le mot répété au début de la note.
«Incipit summula 1 de preparatione ciborum et potuum infirmorum 2
secundum Musandinum 3.De cibis et potibus 4 preparandis infirmis 5 videamus et 6 qualiter eorum
malicia 7 reprimatur 8. Si aliquid 9 fuerit 10 in quo 11 delectetur infirmus 12
sed ingenium petimus 13 Musandinum 14, proprie 15 de febribus acutis, inquibus 16 dieta subtilis et tenuis 17 debet dari 18. Dieta 19 duobus modis 20
BRUNO LAURIOUX
1. summula om. Pa4; tractatus Pa5, Pa6,Va1; tractatulus Wr; Musandini add.Pa5 (marge, autre main).
2. preparatione ciborum et potuum infirmorum ] modo preparandi cibariaet potus infirmis Pa6; et potuum infirmorum om. Pa4; et potuum om. Va1; infir-morum ] febricitantium Wr, om. Pa5.
3. Incipit summula… secundum Musandinum om. Pa2. secundum Musandi-num om. Pa5, Pa6,Va1,Wr.
4. de cibus et potibus: ad opus infirmorum add.Va1.5. infirmis om. Pa4, Pa6,Va1.6. et om. Pa4,Va1.7. eorum malicia ] maliciam eorum Va1.8. qualiter eorum malicia reprimatur ] specialiter infirmis et Pa6.9. aliquid ] quid Wr, Pa2, Pa4, Pa5, Pa6.10. fuerit om. Pa6.11. quo ] loco Pa4; quisquam add.Wr.12. infirmus ] quem add. Pa5, qualiter eorum malicia reprimatur Pa6.13. sed ingenium petimus ] sec. Magistrum Wr, om. Pa6; petimus ] petiti Pa2.14. Si aliquid fuerit in quo delecteur infirmus sed ingenium petimus
Musandinum om. Va1. sed ingenium petimus Musandinum ] quam secundummorbum de morbis Pa4; Musandinum ] Petrum de Musanda Wr, om. Pa6.
15. proprie ] et proprie Pa2; et primo Wr, Pa5, Pa6, in primo Va1; et priusPa4.
16. quibus ] quibusdam Pa2.17. dieta subtilis et tenuis ] subtilis et tenuis dieta Wr, tenuis et subtilis dieta
Pa4,Va1.18. dieta… dari ] coveni[] est exibenda dieta. in quibus dieta… dari ] in
quibus tenuis debet dari dieta Pa6. debet dari ] dari debet Pa4. dari ] De cibisfebricitantium (rubr.) add.Wr.
19. Dieta ] Nota quod dieta Va1.20. duobus modis om. Wr, Pa2, Pa5, Pa6,Va1.
254
accipitur, scilicet 21 large et stricte: large 22 pro exhibitione sex 23 rerumnon 24 naturalium, quibus 25 impossibile est 26 corpus humanum nonapproximare ad hoc ut diu vivat 27; stricte 28 pro competenti 29 administra-tione 30 ciborum et potuum, et ita hic concipitur 31.
De amigdalis 32 vero 33 sic potest administrari cibus vel potus 34:Recipe 35 amigdalas dulces integras 36, et cave ne aliqua cariata et rancidasit 37, et mitte in paraxide et superpone 38 aquam 39 calidam 40 donec cortexincipiat 41 excoriari 42 a nucleo 43, et 44 post 45 munda bene 46, et si vis
PETRUS MUSANDINUS ET SON TRAITE SUR L’ALIMENTATION DES MALADES
21. scilicet om. Wr, Pa2, Pa5, Pa6,Va1.22. large om. Pa2.23. sex om. Wr; .vj. Pa2, Pa5,Va1.24. non om. Va1.25. quibus ] in quibus Va1.26. impossibile est ] est impossibile Va1.27. quibus impossibile est corpus humanum non approximare ad hoc ut diu
vivat om. Wr, Pa5, Pa6; ad hoc ut diu vivat om. Pa2,Va1.28. stricte: vero add.Wr, Pa6.29. competenti: exibitione vel add. Pa5.30. competenti administratione ] applicatione Pa6; administratione ] exibi-
tione Va1.31. Dieta duobus modis accipitur… ita hic concipitur om. Pa4. hic concipi-
tur ] hoc accidit utimur in acutis febribus hiis cibis Wr; accipitur hic Pa5, Pa6;hic accipitur cibus Va1. concipitur ] accipitur Pa2.
32. De amigdalis ] Recipe amigd. Pa2.33. vero om. Pa2, Pa4, Pa5, Pa6.34. sic potest administrari cibus vel potus ] sic cibus potest administrari vel
potus Pa2; aut cibus vel potus sic potest preparari Wr; potest cibus preparari hocmodo Pa4; potest cibus infirmis hoc modo preparari Pa5, Pa6. De amigdalisvero sic potest administrari cibus vel potus om.Va1.
35. Recipe ] Accipe Va1.36. amigdalas dulces integras ] nucleos amigdalarum integros Pa2, Pa4,
Pa5,Va1; nucleos amigdalarum Pa6. dulces integras om. Wr.37. et cave ne aliqua cariata et rancida sit om. Pa6; et cave ne aliqua amara
vel accida sit Pa2; ne in sunt aliqua de amigdalis amaris cave Va1; et nulla sitmarcida vel amara Wr; et nulla illarum sit amara vel rancida Pa4; et nulla eorumsint rancida vel amara Pa5.
38. et superpone ] super Pa4.39. aquam om. Pa5.40. et superpone aquam calidam: om. Pa2; ubi sit aqua calida Va1. calidam: et
demitte/dimitte add.Wr, Pa5, Pa6,Va1.41. incipiat: per se add.Va1.42. excoriari ] excorticari Pa2; sublevari Wr, Pa5, Pa6,Va1.43. donec cortex incipiat excoriari a nucleo ] et cortex a nucleo potest ele-
vari Pa4.44. et om. Wr, Pa4, Pa5, Pa6.45. post ] postea Pa5, Pa6,Va1; om. Pa2, Pa4.46. munda bene ] bene munda Pa4.
255
iterum 47 appone 48 aquam calidam, et dimittantur 49 donec crescant 50 ettunc 51 plus lactis 52 poteris 53 extrahere 54, quia 55 plus de 56 materia 57
resolvitur si 58 bene molles et tenere 59 fuerint. Postea 60 tere 61 eas 62 in 63
pulchro vase 64, quia 65 si 66 vas in quo preparatur, vel 67 datur 68 infirmo, ali-quid 69 pulchrum sit 70 infirmus 71 plus delectatur 72 et ad hoc 73 debemusconari 74. Cum 75 autem 76 bene trite fuerint 77 superasperge 78 aliquantu-lum aque calide 79 et tam diu ducas 80 donec sit 81 quasi lac 82; et 83 iterim
BRUNO LAURIOUX
47. munda bene et si vis iterum om. Pa2.48. si vis iterum appone ] iterum dimitte et suppone Wr, si vis iterum pone
Pa4, iterum si vis appone Va1, iterum si vis pone Pa5, Pa6. appone ]superponePa2.
49. dimittantur ] dimitte Wr, Pa2, Pa4, Pa5, Pa6,Va1.50. crescant (DR: arescant) grossescunt Wr.51. et tunc om. Va1; tunc ] tum Wr.52. plus lactis om. Pa6, prius lotis Pa2.53. poteris: iterum add. Pa5.54. extrahere ] abstrahere Pa4, Pa5.55. plus lactis poteris extrahere quia om. Va1. quia ] et Pa6.56. plus de om. Pa4.57. materia ] substancia Wr, Pa5, Pa6,Va1.58. si ] nec Va1.59. tenere: teneres Va1, bene add. Pa4.60. Postea ] post Wr, Pa4;Tunc Va1.61. tere: bene add. Pa4.62. eas: diu add.Wr.63. in: aliquo add. Pa5.64. pulchro vase ] vase pulchro Wr, Pa4.65. quia ] Nam Wr, om. Pa2, Pa4.66. si: in add. Pa4.67. vel ] et Pa4.68. datur: aliquid add.Wr, Pa5, Pa6.69. aliquid om. Wr, Pa4, Pa5, Pa6.70. sit ] fuerit Wr, Pa4, Pa5, Pa6.71. infirmus om. Wr, Pa4, Pa5.72. delectatur: eger add. Pa5, Pa6.73. ad hoc: multum add. Pa6.74. debemus conari ] conari debemus Pa6, debet corare Pa4; conari ] et Wr;
eas in pulchro vase… debemus conari ] et Va1.75. Cum ] Et cum Pa5, Pa6; et Pa4.76. autem om. Wr, Pa4, Pa5, Pa6,Va1.77. fuerint ] sunt Pa4.78. superasperge ] supersparge Pa2, Pa4, appone Wr.79. aliquantulum aque calide ] aquam aliquantulum bene calidam Pa6.80. ducas ] duras Wr.81. sit ] fiat Va1, om.Wr, Pa6.82. lac: fiat add. Wr, Pa6.83. et om. Pa6.
256
paulatim 84 superinfundas 85 aquam 86 semper miscendo et addendo 87
donec sufficiat. Postea 88 per pulchrum pannum 89 colando 90 exprime,que 91 colatura 92 quasi 93 lac exit 94; quam colaturam 95 mitte 96 in ollam 97
vel in 98 alio 99 pulchro vase 100, et 101 ad ignem super 102 prunas 103 leniterdimitte 104 bullire 105 et semper 106 permisce 107, et 108 cum bullierit ali-quantulum 109 micam panis 110 bene tere 111 inter 112 manus 113, et 114
PETRUS MUSANDINUS ET SON TRAITE SUR L’ALIMENTATION DES MALADES
84. paulatim om. Wr, Pa4, Pa6.85. superinfundas ] superfundas Pa4, infundas Wr, supersparge Va1; paulatim
add. Pa6.86. aquam ] parum aque Wr, calidam add.Va1.87. sit quasi lac… et addendo om. Pa2. semper miscendo et addendo ] et
includas bene Wr, et similiter ducas Pa4, et similiter tamdiu ducas Pa6, et beneducas hic tam diu facias Va1.
88. Postea ] post Wr, deinde Pa5.89. pulchrum pannum ] pannum pulchrum lineum album et mundum Va1.90. colando om. Pa5.91. que om. Pa2.92. colatura: erit add. Wr.93. quasi om. Wr, Pa4; id est Pa2.94. que colatura quasi lac exit om. Pa6,Va1; exit om. Wr, erit Pa2, Pa4.95. quam colaturam ] et illam Pa4, et eadem Pa5.96. mitte ] dimitte Pa4, pones Pa5, om. Pa6.97. ollam ] olla nova Pa6.98. quam colaturam mitte in ollam vel in ] quod Wr, et in Va1.99. alio ] aliquo Pa4, om.Va1.100. in alio pulcro vase ] aliud pulcrum vas; vase: imponas add. Wr; mitte
add. Pa6,Va1.101. et om. Wr, Pa5; que colatura lac amigdalis et amigdalarum erit. Dimitte
residere Va1.102. super: lentas add. Wr.103. super prunas ] et Pa5.104. leniter dimitte ] dimitte leniter Wr, Pa4, dimittas leniter Pa6.105. ad ignem super prunas leniter dimitte bullire ] pone in patella carboni-
bus medici. et pone super ignem et fac leniter bullire Va1; dimitte bullire ] bul-lire permitte Pa5.
106. semper ] sepe Wr, om. Pa4.107. semper permisce ] supermisce Pa6; permisce ] misce Wr, Pa5,Va1, mitte
Pa2.108. et om. Pa6.109. Cum bullierit aliquantulum ] in fine bullitionis Va1; bullierit aliquantu-
lum ] aliquantulum bullierit Wr, Pa4, Pa5, Pa6. aliquantulum ] inter manus Pa2.110. panis: candidi add.Va1.111. bene tere ] bene tritam Pa4, aliquantulum tritam Wr, om. Pa5, Pa6,Va1.112. inter ] in Wr.113. inter manus om. Pa4. manus ] manibus Wr, Pa5; contera[] add. Pa5, bene
tritam add. Pa6, teras add.Va1.114. et om. Pa6.
257
quasi 115 farinam factam 116 immitte 117. Nota etiam 118 quod panis 119 nondebet esse multum 120 durus vel 121 mollis, sed talis quod 122 bene teri 123
possit 124, et paulatim intus 125 mitte 126 in hoc 127 lac 128, sed 129 semper 130
misce 131 ne vasi adhereat, vel ne 132 fumum 133 sapiat 134 et pone 135 ali-quantulum salis 136, et 137 si infrmus delectetur in dulcibus adde 138
parum 139 zuccari 140, vel penidii 141 vel sirupi 142, deinde 143 ab igneremove 144 et infirmo in pulchro vase exhibeatur 145. Si 146 vis quod 147 lac
BRUNO LAURIOUX
115. quasi: in add. Pa4, Pa5, Pa6.116. factam ] effectam Wr, redactam Pa4, Pa5, Pa6,Va1.117. inmitte ] mitte Wr, Pa4, om. Pa6.118. Nota etiam ] Nota Pa2,Va1, Et memento Wr, Pa4, Pa5, Pa6.119. panis: iste add. Wr, Pa5, Pa6,Va1.120. multum ] minus Va1.121. vel ] nec Wr, Pa6; multum add. Pa6.122. quod ] qui Pa4, Pa6.123. teri om. Pa2.124. teri possit ] teratur Wr, Pa4, Pa5, Pa6, teritur Va1.125. intus om. Wr, Pa4, Pa5, Pa6.126. mitte om. Pa6.127. hoc ] predicto Pa5, om. Pa4, Pa6.128. lac ] lacte Wr, Pa4, Pa5, Pa6; mittatur add. Pa6.129. sed ] et Wr, Pa4,Va1, om. Pa6.130. sed semper ] et sepe Wr, defluent[] Pa5.131. misce ] miscendo Pa6, move Va1.132. ne om. Pa4.133. ne fumum ] de fumo Wr, Pa2, Pa5, de fundo Va1.134. vel ne fumum sapiat om. Pa6.135. pone ] appone Wr, Pa6; condias cum Pa5.136. et pone aliquantulum salis om. Va1.137. et om. Va1.138. adde ] appone Wr, ponatur Pa6, om. Pa5,Va1.139. parum ] pauc[] de Pa4.140. parum zuccari ] zuccari parum Pa6; zuccari ] zuccarum Wr, zuccaro
Pa4, commisceatur add. Pa5.141. penidii ] penidis Pa4, penidion Pa5, penidie Pa6, penidias spongo Wr.142. sirupi ] syrupum Wr, sciropim Pa5, cirudi Pa6; appone add.Va1.143. deinde ] et tunc Va1.144. remove ] depone Va1.145. deinde ab igne remove et infirmo in pulchro vase exhibeatur om. Wr;
infirmo in pulchro vase exhibeatur ] infirmo in vase pulcro exibeatur Pa4,pulcro vase infirmo propinetur Pa5.
146. Si: autem add. Pa6.147. Si vis quod ] quendam productum Wr; quod ] ut Pa4.
258
predictum 148 sit magis 149 album 150, in quo 151 magis 152 delectetur 153
infirmus 154 veluti 155 si medicina fuerit 156 pulchra 157 supradictos 158
nucleos 159 pone 160 in aqua frigida 161 tam diu 162 donec possint 163 excor-ticari 164 licet sit 165 tardius quam cum 166 calida 167. Hiis 168 excorticatis 169
sive 170 mundatis 171 superinfunde 172 aquam frigidam et sic 173 dimittedonec174 crescant175; postea176 aquam illam prohice177, et pista178 ut pre-dictum179 est, et bene pistatis180 aquam frigidam181 superasperge182 et tere
PETRUS MUSANDINUS ET SON TRAITE SUR L’ALIMENTATION DES MALADES
148. lac predictum ] predictum lac Pa2 (lac suscrit), Pa6.149. sit magis ] magis sit Pa4, Pa5.150. Si vis quod lac predictum sit magis album om. Va1.151. quo ] quoque Pa4.152. magis ] quisque Wr, om. Pa6.153. delectetur ] delectaretur Wr, delectatur Pa5.154. infirmus om. Pa4.155. veluti ] ut Pa4.156. fuerit ] sit Pa4.157. veluti si medicina fuerit pulchra ] sit in pulcro. Iterum Wr, veluti […]
pulcra fuerit Pa5, veluti si in pulcra mo[] sed fuerit Pa6, om.Va1158. supradictos ] predictos Pa4, ceteros Wr.159. supradictos nucleos ] nucleos supradictos Pa5,Va1.160. pone om. Pa4, Pa6.161. frigida: et add. Wr,Va1, pone add. Pa4.162. tam diu: dimitte add. Wr, Pa4, Pa5; superpones add. Pa6.163. possint ] possunt Wr, Pa6.164. excorticari ] excoriari Wr, Pa4, Pa5,Va1.165. licet sit ] sed hoc fit Wr, Pa5,Va1, sed hoc Pa4.166. cum ] si Wr, aqua add. Pa4, Pa5, Pa6,Va1.167. calida ] aqua superinfunderetur Wr.168. Hiis ] eis Wr.169. excorticatis ] desiccatis Wr, excoriatis Pa4, Pa5.170. sive ] atque Pa5.171. sive mundatis om. Pa6.172. superinfunde ] superius funde Pa4, infunde super Pa6.173. sic om. Pa6.174. donec: bene add. Pa6.175. crescant ] crescatur Pa4.176. postea ] post Pa4.177. prohice ] eice Pa5; Hiis excorticacis sive mundatis... aquam illam pro-
hice om. Va1.178. pista ] tere Pa6, prepara Va1.179. predictum ] dictum Pa4, supradictum Va1.180. pistatis ] tritus Pa6.181. et sic dimitte donec crescant… aquam frigidam om Pa2.182. et sic dimitte donec crescant; postea aquam illam prohice, et pista ut
predictum est, et bene pistatis aquam frigidam superasperge om. Wr. superas-perge ] superinfunde Pa4, superpone Pa6.
259
diu183 ut supra184 faciebas185 cum186 aqua187 calida188, et ideo quia189
minus190 resolvitur191 de substantia192 amigdalarum quam supra193, super-asperge194 aquam calidam195.
BRUNO LAURIOUX
183. diu: cum aqua frigida add. Pa6.184. supra ] contra Pa4.185. faciebas ] factam Pa6. et sic dimitte donec crescat predicta aqua illata
proice et pista ut predictum est et bene pistatis aqua frigida supersparge et terediu ut supra faciebas Pa2.
186. cum ] et Pa4.187. aqua om. Wr.188. Et bene pistatis… faciebas cum aqua calida om. Va1.189. et ideo quia ] sed nota quod in isto ultimo in Va1.190. et ideo quia minus ] Id albius est quod Wr.191. minus resolvitur ] resolvitur minus resolvitur (sic) hoc Pa5.192. resolvitur de substantia ] de substancia resolvitur Wr,Va1.193. supra ] si super Wr.194. superasperge ] super inspergatur Wr, superaspergitur Pa5.195. aquam calidam ] aqua calida Wr, Pa5. quam supra superaspergere aquam
calidam Va1. et ideo quia minus… aquam calidam om. Pa4, Pa6.
260