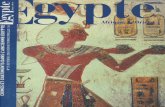« Enquête sur les lieux d’exécution dans l’Égypte ancienne », ÉAO 35, p. 31-40.
Patrimoine genevois. Etat des lieux
Transcript of Patrimoine genevois. Etat des lieux
remerciements
A Sabine Nemec-Piguet, qui m’a encouragée et soutenue dans l’achèvement de ce projet.
A Lionel Breitmeyer de la Collection iconographique genevoise (CIG) qui n’a pas compté son temps pour dénicher des photos inédites et relire les légendes de l’ouvrage.
A Andrée Gruffat, Nelson Lopez et Anne-Marie Viaccoz qui m’ont aidée à réunir l’iconographie provenant du Service des monuments et des sites (SMS) et des Monuments d’art et d’histoire.
A Daniel Muñoz de l’atelier Dominique Broillet (ADB) qui a conçu et mis au point avec talent la maquette de l’ouvrage.
Patrimoine genevoisEtat dEs liEux tExtEs réunis par lEïla El-Wakil
1 — 6 introduction par Leïla el-Wakil
7 — 28 Du paysage au monument. L’évolution de la notion de patrimoine dans les guides de la genève du XiXe siècle par Pierre Monnoyeur
29 — 56 La protection du patrimoine à genève. mise en place et évolution du système légal par Sabine Nemec-Piguet
57 — 80 1975-2005 trente ans de défense du patrimoine architectural genevois. Une évolution lente par Armand Brulhart et Erica
81 — 104 La liste genevoise des monuments classés. Un inventaire à la Prévert Par Leïla el-Wakil
105 — 118 De la protection du patrimoine en général et à genève en particulier par Pierre Vaisse
Comme l’avaient déjà relevé Jean-Pierre Babelon et André Chas-tel dans La notion de patrimoine (1980), l’être humain est tout oc-cupé à recenser ses biens dès lors qu’ils lui échappent ! Mais difficile est la prise de position claire au terme de ces pathétiques enquêtes : conflits d’intérêts, écartèlement entre sauvegarde et fuite en avant, opposition entre passé et présent. Désormais, la réflexion s’étend au patrimoine avec un grand P qu’est notre planète, et, qu’en cette circonstance, il n’y a plus à prouver que la garantie d’avenir repose sur la transmission, la conservation et la valorisation de l’héritage !
Dans notre époque écartelée entre fascination d’avenir et nos-talgie impuissante, entre refuge virtuel et fuite en avant, où situer encore l’héritage culturel auquel appartient le patrimoine bâti ? Dans un monde fébrile et mobile, quel sens donner à la permanence incarnée par l’architecture ? Objet de consensus mouvants et de soins variés, le patrimoine architectural n’échappe pas à un bal-lottage permanent. La culture d’une génération chasse celle de la précédente. L’attention et l’intérêt changent d’objet. Les doctrines et les principes mutent. Les méthodes de conservation et les savoir-faire évoluent. L’idée de ce recueil d’articles est née du constat qu’en ce domaine, la mémoire est particulièrement courte.
Une trentaine d’années après l’Année européenne du patrimoine architectural (1975), décrétée par le Conseil de l’Europe, la question de la sauvegarde ne s’est pas refermée. Elle est au contraire d’une actualité plus complexe que jamais. Le champ patrimonial s’est accru infiniment. Aux monuments exceptionnels se sont ajoutés les ensembles villageois et urbains, aux chefs-d’oeuvre incontestables des objets mineurs, aux ouvrages anciens des réalisations moder-nes. Tout ou presque dans la ville ou sur le territoire est susceptible d’être un jour promu au statut de patrimoine. Le corpus d’objets ou de sites dignes d’attention s’enfle jusqu’à l’inflation! Le patrimoine bâti genevois, qui nous intéresse ici, n’échappe pas à ce phénomène.
D’importantes avancées ont été réalisées ces trente dernières années dans la connaissance historique de l’architecture et du territoire. La multiplication des inventaires, des recherches fonda-mentales, des publications a mis en lumière de nombreux édifices, quartiers, villages et sites. Grâce aux travaux scientifiques des chercheurs, on peut reconstituer très finement la genèse d’un projet, décrire le déroulement du chantier, connaître les matériaux et les techniques employés, identifier les maîtres d’état, dater les transfor-mations. Des bâtiments qui n’existent plus peuvent être, tout aussi minutieusement, documentés. En un mot comme en mille, on en sait aujourd’hui davantage que jamais sur le patrimoine architectural et urbain.
La connaissance matérielle des objets a fait d’immenses progrès sous l’impulsion des restaurateurs d’art, des architectes et des ingé-nieurs spécialisés et des laboratoires scientifiques. Des techniques de pointe sont au service des professionnels : la dendrochronologie pour dater l’âge d’une charpente, les rayons X pour comprendre le nombre de surpeints, la photogrammétrie pour affiner le travail de relevé, divers types de reprises en sous-œuvre dont les micropieux
Introduction
ecole des arts Décoratifs restauration Franz graf et Julien menoudSabine Nemec-Piguet
12
Si le profit et la spéculation sont depuis l’époque des « bandes noires », stigmatisées par Victor Hugo, les plus sérieux ennemis du patrimoine, est-il normal par contre de redouter dans nos démocra-ties modernes les changements de législature ? On a vu trop souvent, en effet, le patrimoine dépendre des caprices du prince, c’est-à-dire, à Genève, du conseiller d’État en charge du département - que par commodité on aimerait bien continuer à nommer des Travaux pu-blics ! Malgré l’appareil légal et l’administration mise en place pour assurer la sauvegarde du patrimoine, certains élus, pour répondre aux attentes de leur électorat, ne peuvent s’empêcher de tenter de faire la pluie et le beau temps. Tel magistrat acquis à la cause du patrimoine favorisera donc la sauvegarde du patrimoine, tandis que tel autre, mécréant en la matière, courtisera les démolisseurs.
Alors que l’engouement public manifesté lors des Journées du patrimoine est très vif, le débat relatif à la sauvegarde reste une affaire d’initiés, issus de différentes écoles, et qui, il faut aussi le reconnaître, ne sont pas toujours entre eux à l’unisson. Quoiqu’il en soit, ce sont bien eux qui maîtrisent les termes de la discussion autour de l’authenticité, de l’introduction du neuf dans l’ancien, de l’architecture d’accompagnement …, si bien que le clivage entre spécialistes et grand public demeure immense. Dans un monde qui se précipite, il serait temps de vulgariser largement les fondements du respect du cadre bâti et naturel. Il serait temps de faire compren-dre à tout un chacun, aux enfants des écoles, à leurs maîtres, aux parents le caractère précieux et unique de leur cadre de vie, l’impor-tance de la conservation de l’image, de la substance, mais aussi de l’esprit, pour que chaque citoyen ait une réelle chance de participer au débat et ne se contente pas d’un patrimoine virtuel et frelaté. Les auteurs qui ont répondu à l’appel lancé en vue de la présente publication sont des historiens de l’art ou des architectes de la place que la question du patrimoine intéresse à divers titres. Tous ont fait partie d’instances de sauvegarde du patrimoine : ils ont siégé ou siègent encore dans les sociétés de sauvegarde, comme la Société d’art public (SAP) devenue Patrimoine suisse, ou Action Patrimoine Vivant, la Commission des monuments, de la nature et des sites (CMNS), la Commission des monuments historiques (France) ; ils reçoivent des mandats ou oeuvrent dans le Service des monuments et des sites (SMS) de la Direction du Patrimoine de l’actuel Départe-ment des constructions et des technologies de l’information (DCTI). Tous ont produit des écrits, de nature à documenter ou défendre les objets de patrimoine, à leur initiative, dans la presse, ou sur man-dat de la Ville ou de l’État de Genève. Ils ont travaillé dans le cadre des Monuments d’art et d’histoire de la Société d’histoire de l’art en Suisse (SHAS) ou mené des combats de protection du patrimoine au sein d’un parti politique ou dans l’enceinte du Grand Conseil. Presque tous ont été tantôt les témoins, tantôt les acteurs d’une sauvegarde en marche durant ces trente dernières années. Dans leur pratique professionnelle, ils ont expérimenté la difficulté de construire l’argumentation de sauvegarde, la précarité des dispo-sitifs de protection, la complexité des processus économiques et politiques, parties prenantes de la conservation du patrimoine.
pour renforcer des fondations, les carottages pour analyser des matériaux ... Des métiers d’art ont ressurgi, ressuscitant des savoir-faire perdus. Les tailleurs de pierre ont réappris à manier la laye et la boucharde. Les couvreurs ont redécouvert la multiplicité des ardoises et l’infinie variété des tuiles. Des zingueries d’art peuvent produire des épis de faîtage à l’ancienne. Des écoles enseignent les techniques des trompe-l’œil, comme celle du marbre ou du bois peint. On commence à bien connaître aussi les problèmes liés aux matériaux modernes et la carbonatation du béton a ses remèdes. De sorte qu’il n’y a pour ainsi dire plus de problèmes techniques que l’on ne sache résoudre.
Les instances chargées du patrimoine bâti ont été mises sur pied. À Genève, l’État compte une Direction du patrimoine qui héberge notamment le Service cantonal des monuments et des sites et l’équipe des chercheurs de l’Inventaire des Monuments d’art et d’histoire, tandis que la Ville possède un Conseiller en conservation du patrimoine, chargé de veiller en priorité au patrimoine munici-pal. En Suisse, des formations universitaires spécialisées consa-crées au patrimoine artistique et monumental ont été mises sur pied ; l’Institut d’architecture et la Faculté des Lettres de l’Univer-sité de Genève ont dispensé deux formations de troisième cycle, le Diplôme d’études approfondies en Sauvegarde du Patrimoine moderne et contemporain ainsi que le diplôme d’études supérieures en patrimoine et muséologie. Les spécialistes de ce domaine sont plus nombreux qu’ils n’ont jamais été.
Comment se fait-il alors que la réunion de tous ces facteurs et la possession de toutes ces données ne servent que trop faiblement à une sauvegarde raisonnée du patrimoine ? Avérés ou dissimulés, nombreux sont les obstacles et les oppositions à la préservation des biens communs d’intérêt général que sont la ville et le paysage, ces objets patrimoniaux qui ne sont pas des invariants. Des inventaires tant attendus, - mais pas achevés sur le canton de Genève -, n’ont pas été extraites les classifications préalables à une conservation raisonnée. Trop souvent encore la sauvegarde émane de choix aléa-toires ou de circonstances occasionnelles, et ne s’ancre pas vérita-blement sur le savoir scientifique existant. En France, on constate pareille impasse de l’Inventaire Général lancé par André Malraux – l’inventaire étant devenu un pléthorique but en soi -, et la digestion de l’accumulation d’informations en vue d’une hiérarchisation des patrimoines restant à faire.
La pesée des intérêts face aux pressions économiques et politi-ques est rarement sereine. Plus que jamais dans l’étroit microcosme qu’est le territoire genevois, le patrimoine monumental et paysager se mesure en droits à bâtir que des propriétaires, même éclairés, cherchent à concrétiser, quitte à déréglementer un appareil légal qui s’est patiemment constitué au fil des décennies.
34
Le sentier des saules, c. 1930CIG, Jean Cadoux
Le tandem constitué par Armand Brulhart et Erica Deuber-Zie-gler, tous deux historiens de l’art, impliqués de longue date dans l’histoire et la sauvegarde du patrimoine bâti genevois, signe un article qui se veut, une trentaine d’années plus tard, une manière de réponse à leur « Paisibles démolitions » paru en 1975 à l’occasion de l’Année européenne du patrimoine architectural. Pierre Monnoyeur, historien de l’architecture indépendant, travaille de longue date sur mandats à des sujets d’architecture genevoise ; il suit ici pour nous l’évolution de la notion de monuments à travers les guides genevois. Sabine Nemec-Piguet, architecte et cheffe du Service des monu-ments et des sites, attachée à la Direction du patrimoine (DCTI), nous fait part d’une réflexion nourrie sur l’évolution du cadre légal genevois en matière de protection du patrimoine depuis la création de la loi sur les monuments de 1920 jusqu’à nos jours. Elle enrichit cette contribution de son long engagement au sein du Service des monuments et des sites de la Direction du Patrimoine du canton de Genève. Pierre Vaisse, professeur honoraire du département d’histoire de l’art de l’Université de Genève, livre un point de vue personnel qui a le mérite de nous décentrer un peu de nos strictes considérations locales. Son expérience en matière de patrimoine monumental et sa participation à la Commission française des Monuments historiques soutiennent son point de vue de sauvegarde. La soussignée, historienne de l’architecture et architecte, investie depuis plus d’un quart de siècle dans le champ de la conservation du patrimoine, se questionne sur le caractère somme toute aléatoire des listes de monuments classés, d’un point de vue général et du point de vue particulier du cas genevois.
Patrimoine genevois: état des lieux a donc pour but de dresser un état de la question de quelques aspects touchant au patrimoine genevois. Il ne prétend aucunement clore le débat à propos d’un champ, qui, plus que jamais, suscite de vives discussions et qui, dans la perspective du développement durable, s’inscrit comme une pièce du grand dispositif à mettre en place pour répondre à de nou-velles préoccupations. Puisse cet ensemble de textes donner matière à réflexion aux décisionnaires et aux politiques et nourrir les spécu-lations intellectuelles des spécialistes !
Leïla el-Wakil
56
1 Eugène Labiche, Le Voyage de Monsieur Perrichon, Livre de Poche, 1987, pp. 34-35. Acte I, scène 9. L’oeuvre est donnée pour la première fois à Paris en 1860. 2 La référence à Defoe montre qu’à cette période Robinson Crusoé est désormais catalogué comme une lecture enfantine et imagée et non plus comme un grand roman.3 Ibid., p. 38. Acte II, scène 14 Daniel Nordman, « Les Guides-Johanne », in Les Lieux de Mémoire (sous la direction de Pierre Nora), vol. I, Gallimard, coll. « Quarto », Paris, pp. 1035-1072
Les gUiDes sont FaUX ! Depuis le deuxième tiers du XIXe siècle, les guides de Genève à l’usage des étrangers et des voyageurs se succèdent, montrant, d’édition en édition, des pay-sages et des monuments sous un aspect changeant. Normatifs et répétitifs, ils produisent une image qui se veut arrêtée, cohérente, organisée et documentée. Mais les guides sont faux, on le sait, et parfois même totalement futiles. On se souvient du Voyage de Monsieur Perrichon, un périple qui conduit les protagonistes du vaude-ville de Paris à Genève, puis à Chamonix et enfin à l’auberge de Montanvert, prélude à la Mer de Glace, en passant par Ferney-Vol-taire. La citation sonne quasiment comme une définition du genre :
« Perrichon, à la marchande de livres. Madame, je voudrais un livre pour ma femme et ma fille... un livre qui ne parle ni de galanterie, ni d’argent, ni de politique, ni de mariage, ni de mort. « Daniel, à part, Robinson Crusoé !« La marchande. Monsieur, j’ai votre affaire. Elle lui remet un volume« Perrichon, lisant. Les Bords de la Saône : deux francs ! (payant). Vous me jurez qu’il n’y a pas de bêtises là-dedans ? »1.
Pensez : « un livre avec des images » ! Une littérature appropriée aux femmes, truffée d’informations inintéressantes et ennuyeuses2 : ainsi le jugent en tous les cas les deux amoureux de Mlle Perrichon, Daniel et Armand, les seuls personnages de la pièce à l’esprit réellement clair et délié.3Au mieux, les guides sont partiaux, sélectifs et péremptoires ; leur géographie
est de papier et d’encre. Ils sont le fruit d’un travail livresque qui consiste d’abord à compiler les textes précédents et à les actualiser. Ils ne visent pas l’originalité, puisque leur public cherche les poncifs de l’art : les sites inoubliables et les monu-ments de première importance. Suivant des critères le plus souvent mal définis, ils classent les lieux communs énumérés, pe-sant les uns à l’aune de critères esthéti-ques, jugeant les autres à leurs styles et à leur ancienneté, accordant de l’importance à ceux-ci, minimisant ceux-là. Montages taxinomiques et artefacts, les guides sont essentiellement un exercice d’écriture et un jeu combinatoire. Science oblige, dans le dernier tiers du XIXe siècle, ils inté-greront progressivement l’archéologie et l’histoire de l’art : d’autres classements, d’autres discriminations, sous des formes souvent tout aussi naïves ...
Les textes présentant Genève aux étrangers n’échappent pas à cette règle5. Ils sont inégaux en qualité et foison-nant, des indicateurs souvent très brefs ou des guides prolixes, en passant par toutes sortes de fascicules, plaquettes et autres opuscules. Dans cette diversité, une constante demeure. À un degré ou un autre, ils se divisent tous en deux parties : d’un côté, les excursions aux alentours de la ville, avec des courses plus lointaines, dans la vallée de Chamonix ou autour du lac Léman, de l’autre, la Cité de Calvin avec ses promenades et ses bâtiments remar-quables.
La lecture de ces itinéraires pour-rait n’être que bien plate, si elle se faisait ligne après ligne, guide après guide. Mais, comme la littérature à l’usage des voya-geurs est affaire de répétitions et de re-
DU Paysage aU monUmentl’évolution dE la notion dE patrimoinE dans lEs guidEs dE gEnèvE au xixe sièclE piErrE monnoyEur
78
5 Voir plus généralement sur le sujet, Bertrand Lévy, Rafael Matos et Sven Raffestin, Le tourisme à Genève : une géographie humaine, Metropolis, Genève, 2002.6 H. Hentsch, Guide genevois à l’usage des étrangers, Genève, 18307 Ibid., p. 27. Le seul monument inscrit comme tel dans la liste est le « Monument aux 17 citoyens genevois tués en 1602, derrière le temple de Saint-Gervais. Monument antique et fort simple », p. 30.
8 Nouveau guide de l’étranger à Genève et ses environs, Genève, 1845, p. 389 A l’instar des Guides Conty. Guide-Pratique des étrangers dans Genève et ses environs, Paris, 1872, p. 2510 Guide historique et descriptif de Genève et le tour du lac, Genève et Lausanne, 1873, pp. 21-2211 Guide historique et descriptif de Genève et les rives du lac Léman, Genève, 1880, pp. 36-4012 Guide illustré de Genève, Association des intérêts du commerce et de l’industrie, Genève, 1887, p. 6113 Pierre Monnoyeur, « Le collège Saint-Antoine : une histoire monumentale et urbaine », in Bulletin de la Société d’Histoire et d’Archéologie de Genève, à paraître14 Cette vue par-dessus les Tranchées a d’ailleurs fait l’objet de nombreuses aquarelles.15 Peupleuraie ou mail en espagnol. Ce terme exotique apparaît dès 1844, dans le Nouveau guide de l’étranger à Genève et dans ses environs, Genève, 1844, p. 10.16 Ibid. éd. de 1856, p. 10
prises, elle peut être lue par transparence, une édition ne cachant jamais complète-ment l’autre, comme dans un palimpseste. C’est entre les couches, entre les feuillets, que réside l’intérêt du texte. Surprises, repentirs, corrections, caviardages pren-nent alors tout leur relief : ils forment des parcours hésitants, empruntant là des grandes voies, ici des sentiers de traverse, rebroussant chemin au besoin devant des laies oubliées et perdues. Après tout, le voyage est une affaire d’ima-gination et la lecture est un vagabondage de l’esprit ...La période couverte par cette étude va des années 1830 au début du XXe siècle, avec deux moments clé : le démantèlement des fortifications en 1850 et l’arrivée du che-min de fer à Cornavin en 1858. C’est une histoire qui commence avec les voyages à pied, à cheval, en chaise, en poste, en dili-gence et se poursuit avec les déplacements en train, ce grand moyen de communica-tion de l’ère industrielle. Elle s’achève avec l’avènement de l’automobile et du monde moderne, qu’illustrent la carte postale et la photographie amateur.
Les vUes natUreLLes et Les PersPectives aLPines
Au début, tout est affaire de mesure et de juste poids. Dans les anciens guides, la part consacrée à la visite de Genève est très différente de celle accordée aux randonnées dans les campagnes circonvoi-sines et aux courses alpines. La descrip-tion de la ville intra-muros est sommaire. En 1830, le Guide genevois à l’usage des étrangers recense vingt objets dignes
d’intérêt, de la cathédrale au manège, le tout réparti en onze pages. Les excursions et les promenades viennent ensuite. Vingt-sept buts de courses sont proposés en quatorze pages, du « tour de la Tranchée » à une « course à la Dôle », en passant par une « promenade à Plainpalais », au bois de la Bâtie, à Monnetier, Chambésy, Ferney-Voltaire, etc6. Les guides suivant confir-ment cette disproportion de traitement, comme si la ville et son univers minéral intéressaient moins les voyageurs que les paysages environnants. Une étude plus attentive des textes confirme cet état de fait. On constate en premier lieu que le substantif de « monu-ment » peine à s’imposer comme élément constitutif de l’espace urbain. En 1830, la cathédrale, l’hôtel de ville, la bibliothèque publique et les autres bâtiments-phares de l’urbanisme genevois sont regroupés sous une rubrique intitulée « Indication des principaux établissements publics, monuments et curiosités, qui peuvent offrir quelque intérêt à un étranger »7. Vraisemblablement édité en 1835, le Guide du voyageur à Genève et aux environs parle lui simplement de « Curiosités » ; un an après, un opuscule anglais, Genava and Chamonix préfère utiliser une péri- phrase et sélectionne pour ses lecteurs la liste des « objets de valeurs à visiter ». En 1845, le nom de « monument » réapparaît dans le vocabulaire des vade-mecum genevois, mais de manière encore timide puisque le substantif est précédé du terme « curiosités », dont la valeur d’usage et l’ancienneté sont clairement destinées à atténuer la portée sémantique du nouveau nom introduit. Un pas supplémentaire est franchi en 1872, quand, par inversion des termes, l’expression « monuments et curio-sités » vient désormais chapeauter la liste
des édifices touristiques de la ville9. Un an après, le Guide historique et descriptif de Genève, introduit dans le corps de son texte, le « Monument national » inauguré en 186910. Quant au « Monument Brunswick », il est cité dès 1880. Enfin, le renverse-ment décisif se produit en 1887, lorsque le Guide illustré de Genève, regroupe sous le titre « monuments, musées, etc. » toutes les architectures et les sculptures cen-sées intéresser un touriste12. Cette for-mule entérine la disparition définitive du substantif « curiosité », cet archaïsme des voyages romantiques et pittoresques. Elle donne aussi clairement à entendre que les monuments deviennent des pièces isolées et uniques qui s’alignent dans un musée de plein air, des objets d’art et d’histoire qu’il convient d’admirer au même titre que les peintures de chevalet. Si le monument peine à s’imposer, si les guides témoignent du peu d’empres-sement à décrire la ville et ses bâtiments, c’est que l’étranger, tel qu’il est présenté par les textes, est adepte d’autres sensa-tions et recherche d’autres plaisirs : ceux que procure la vision des paysages et des larges dégagements aux alentours de la ville. La vue est l’expérience esthétique par excellence. Ainsi, pour le « tour de ville », partie obligée dans le plan des premiers guides, la visite commence-t-elle le plus souvent par la terrasse de Saint-Antoine, non pas tellement parce que son collège est encore apprécié13, mais bien plutôt parce que, depuis sa promenade ombragée, on découvre une vaste perspective en direc-tion du lac : la plus belle depuis la ville disent les textes, « un superbe point de vue », rapporte en 1844 le Nouveau guide de l’étranger à Genève. Une perspective
souvent reproduite ! Si cette « alameda »15 n’est pas toujours en tête de la liste des lieux et des monuments insignes à visiter, elle se place au troisième ou quatrième rang, ne perdant sa valeur panoramique et touristique qu’au moment où le déman-tèlement des fortifications survient et que l’agglomération urbaine s’étend. C’est ce que note le même guide dans son édition de 1856 : « on y jouissait autrefois d’un superbe point de vue, aujourd’hui gâté par les nouvelles constructions »16.De l’extrémité de la promenade Saint- Antoine, le voyageur regarde vers l’extérieur, vers le lac : l’observation est une activité centrifuge. Il suffit d’un belvédère et les environs de la ville en re-gorgent. En 1830, toutes les courses ont la « vue » pour prétexte. Ce plaisir esthétique trouve d’ailleurs de nombreux synonymes : « panoramas », « regards »17, « coups d’oeil » ou « points de vue » qualifient presque tous les sites, qu’il s’agisse du Bastion de Cornavin, du village de Vandoeuvres, d’Hermance ou des autres lieux remar-quables des environs. Ce topos est encore plus insistant dans le guide de 1835. Si une perspective naturelle manque, comme à Douvaine, cette particularité est aussitôt mentionnée : le village « ne jouit d’aucune vue » ; mais le texte d’ajouter six lignes plus bas, comme pour se rattraper, qu’à Massongy, tout près, « le voyageur repose agréablement sa vue sur la belle et large vallée qui se déploie aux regards ». Quant à l’excursion du Grand-Saconnex, elle est entreprise dans le but de voir tout à son aise le Mont-Blanc : c’est le lieu consacré à cet effet qui, par convention, permet d’observer la montagne sous son meilleur jour. Dans cet esprit, la promenade se
910
17 Guide du voyageur à Genève et aux environs, Audin, Paris, s.d. (1835), p. 6918 Ibid. p. 4519 A l’instar des Guides Conty. Op. cit., pp. 34-3520 Collection des Guides Verésoff. Agenda du touriste. Le lac de Genève et le Mont-Blanc, Genève, 1875-1876, pp. 147-14921 Guide de l’étranger à Genève et ses environs, Genève, 1880, pp. 28-2922 Cette prédominance de la montagne sur les monuments se retrouve aussi à propos de l’acception du terme « guide ». En 1821, ce substantif désigne la personne menant des ascensionnistes en course ; et 1842 celle qui conduit des visiteurs dans des lieux d’intérêt touristique. Alain Rey, Dictionnaire historique de la langue française, Le Robert, Paris, 1992, s.v. « guide ».23 Bernard Comment, Le XIXe siècle des panoramas, Adam-Biro, Paris, 1993
24 Hippolyte Taine, Voyage aux Pyrénées, Hachette, Paris, 1880, pp. 440-451, première édition 1858. Ce passage est citépar Pierre Larousse, dans son Grand dictionnaire universel de la langue française du XIXe siècle, Paris, 1866-1879, s.v. « touriste »25 Comme Xavier de Maistre qui, dans son Voyage autour de ma chambre, se déplaçait en fauteuil, le touriste sédentaire de Taine voyage en chaise, manière de jouer sur les mots. Dans la deuxième moitié du XIXe siècle, le substantif de « chaise » s’entend encore au sens de voiture hippomobile.26 H. Hentsch, Guide genevois à l’usage des étrangers, Genève, 1830, p. 3527 Nouveau guide de l’étranger à Genève et dans ses environs en 1845, Genève, 1845, p. 928 Nouveau guide de l’étranger à Genève et dans ses environs, Genève, 1855, pp. 45-46. En 1872, le nombre des arbres passera brusquement à 600000.
continue jusqu’à Ferney, évidemment pour avoir le plaisir de mettre ses pas dans ceux de Voltaire, mais tout autant pour avoir le loisir de contempler, depuis la terrasse du château, au soleil couchant, la silhouet-te rosie du sommet des Alpes :
« Vue du Mont-Blanc. – Je conseille à tous les étrangers de quitter Genève vers le soir, lorsque le ciel et l’air se-ront bien purs et bien sereins, et d’aller environ 1 h. 1/2 avant le cou-cher du soleil, en suivant le chemin qui mène à Ferney par le Grand-Saconnex, jusqu’à la hauteur que l’on rencontre à 1/4 de l. en avant de ce dernier village, pour y jouir de l’aspect du Mont-Blanc, éclairé par les derniers rayons de l’astre du jour »18.
Les mêmes recommandations sont encore répétées dans le guide anglais de 1838 et dans ceux de 187219 et 1875-7620 ; elles sont abrégées dans celui de 188021.Cette esthétisation du paysage et surtout des Alpes est somme toute logique22. Elle procure au voyageur rêverie et éva-sion, tout en relevant encore d’un goût romantique : le spectateur s’absorbe dans le spectacle de la nature.
Le sPectacLe Des rePrésentations aLPines Entrepreneurs et artistes vont rapi- dement récupérer ce spectacle de la nature. Ils vont le ramener en ville et l’exposer à des fins lucratives sous trois
formes différentes : le relief alpin, sorte de maquette en trois dimensions ; le diorama montrant, par le truchement de savants jeux de lumières, des portions de paysages passant tour à tour des cou-leurs de l’aube à celles du crépuscule23 ; en-fin, la « nature à coup d’oeil » ou le « tableau sans borne », autrement dit, le panorama. Dans ces trois types de représentations, la position de l’observateur est sensiblement la même. Debout et accoudé à une ramb- arde, ou assis sur un banc, celui-ci se pen-che sur une partie de territoire représen-tée sous une forme miniaturisée et idéale ; dans son esprit, le temps est suspendu ; l’infiniment grand se mêle à l’infiniment petit. Offrant l’occasion d’un dépayse-ment à moindre frais, ces trois genres de représentations s’adressent à la sixième et dernière variété de voyageurs caricaturée par Taine :
« Sixième variété, très nombreuse : touristes sédentaires. Ceux là regar-dent les montagnes de la fenêtre de leur hôtel ; leurs excursions consis-tent à passer de leur chambre dans le jardin anglais, du jardin anglais à la promenade. Ils font la sieste et lisent leur journal étendus sur une chaise ; après quoi, ils ont vu les Pyrénées24. »
Pour ces voyageurs en chaise25, les gui-des genevois s’attardent donc à décrire les « curiosités » mettant en scène la nature et la montagne : se succèdent ainsi le Plan en relief de la Suisse, la Table d’orientation, le Grand Relief du Mont-Blanc, l’Alpineum et le Panorama des Alpes bernoises.
La première attraction est ainsi décrite : « Sur la promenade du pont de fil de fer des Pâquis. C’est un ouvrage fort exact. Mr. Gaudin, qui en est l’auteur, donne les explications que l’on pour-rait désirer. La Suisse entière, avec ses lacs et ses glaciers, ses routes et ses rivières, se déploie aux yeux des voya-geurs. L’on peut aisément reconnaître les endroits que l’on a déjà visités, et parcourir d’avance les lieux où l’on a l’intention de se rendre. Un léger droit d’entrée est réclamé à la porte »26.
Le guide de 1845 s’attarde lui à une autre attraction visible au bastion de Chantepoulet. C’est une « table d’orien-tation indiquant la direction et les noms des montagnes et des contrées circonvoi-sines »27 Des deux reliefs, le second est le plus abouti. Il réunit tous les ingrédients inhérents aux représentations à venir : situation dans un lieu de passage fré-quenté par les étrangers, abri dans un pavillon fermé, entreprise lucrative pour son propriétaire, visite nécessitant des explications, représentation miniaturisée et méticuleuse de la réalité du terrain, manière idéale de prolonger ou de préparer un voyage. La découverte de ce spectacle constituait enfin un plaisir visuel.
Le Grand Relief du Mont-Blanc, cité pour la première fois en 1855, réunit, à peu de choses près, les mêmes caractéris-tiques que celui représentant la Suisse. La réclame qu’en fait le guide est précise : elle met l’accent sur les dimensions, l’échelle et la hauteur du sommet factice et souligne la prouesse des détails et la méticulosité du travail. « Le nombre des arbres plantés est de plus de 400 000 et celui des maisons
de 5000 »28. Une publicité placée à la fin du Guide dans Genève et ses environs (1862) est plus explicite encore, détaillant la pré-ciosité, les conditions, l’esprit et le but de l’exécution :
« On ne saurait trop inviter les étran-gers en passage à Genève à visiter, dans le pavillon installé au Jardin an-glais, vis-à-vis l’hôtel de la Métropole, l’admirable ouvrage dont le nom pré-cède ces lignes. Travail de patience et d’art, cette étonnante miniature du roi des monts et de toutes les chaînes et sommités qui l’entourent, a coûté dix années de minutieuses recherches et d’infatigables excursions à son auteur, M. Sené [...]. Nulle occasion ne saurait être mieux venue pour le Touriste de se faire une idée complète et exacte jusqu’au moindre détail, de cette région si vaste et si extraordinaire que tous n’ont pas le temps ou la force de parcourir en réalité. La personne char-gée d’expliquer ce magnifique tableau est des mieux qualifiée pour cette tâche, et les visitants auront toute satisfaction à se laisser guider par elle dans l’intéressante exploration dont il s’agit. [...]. Une légère rétribution est à considérer, en vue de jouir à son aise de ce spectacle unique et vraiment merveilleux ».
Très clairement l’art et l’illusion sup-plantent la réalité à telle enseigne qu’en 1873, le relief est tout bonnement assimilé à un « incomparable panorama »30 . En 1880 sa popularité est telle que le pavillon qui l’abrite devient avant l’heure une espèce d’office du tourisme, où sont en vente des « vues de la Suisse et du Mont-Blanc, gui-
1314
29 Guide dans Genève et ses environs, manuel du touriste, Genève, 1862, appendice final30 Guide historique et descriptif de Genève et le tour du lac, suivi du voyage à Chamonix, avec carte, panorama et plan, Genève et Lausanne F. Richard, 1873, p. 23, et 1880, p. 2731 Guide historique et descriptif de Genève et les rives du lac Léman, Genève, 1889, p. 2732 Guide dans Genève et ses environs, Genève, 1862, pp. 32-3333 INSA, Inventaire Suisse d’Architecture, 1850-1920, vol. 6, Lucerne, Orell Füssli, Société d’Histoire de l’Art en Suisse, Berne, 1991, pp. 451-45234 La villa Santoux est construite dès 1861. Voir Catherine Courtiau, « Les débuts des projections cinématographiques à Genève et le boom des années 1910-1920 », in Art et Architecture en Suisse, Société d’Histoire de l’Art en Suisse, année 47, n. 3, 1996, pp. 269-279.35 Notice descriptive de la ville de Genève et ses environs, Genève, 1895, pp. 12-13.36 La Patrie Suisse, 45, juin 1895, pp. 143 et 144
Panorama des alpes bernoises, esquisse par A. Baud-Bovy (coll. privée)
des, cartes, plans à l’usage des voyageurs, minéraux, etc. »31, destinés à augmenter et à faire durer l’expérience esthétique pro-posée.
En 1862, à la fin du Guide dans Genève et ses environs, une double page de promotion vante l’intérêt d’une autre attraction alpine32. Une gravure illustre sur la page de droite le « Musée zoologique des Alpes », installé dans la « Villa Hippo-lyte Santoux, Plainpalais, Genève », tandis que, sur la page de gauche, sont énumé-rées les principales curiosités : « Grand panorama dioramique et cycloramique du Righi-Koulm, représenté selon les effets de lumière aux différentes parties du jour. Au Chalet Panorama à Plainpalais ». Publicité faite, cette attraction quitte ensuite la littérature touristique. C’est en marge des guides que nous retrouvons sa trace. En prévision de l’Exposition nationale, en 1895, l’Alpineum proprement dit est élevé dans le prolongement de la villa. Il propose trois dioramas réalisés par Ernst Hödel (1852-1902), peintre de paysages et entrepreneur de panoramas. Celui-ci vient de racheter à Lucerne l’ancien Löwendenk- malmuseum, un pavillon élevé en 1885 qui abritait jusqu’à son rachat le diorama présentant la garde suisse défendant le palais des Tuileries en 1792. A la reprise du bâtiment, il remplace l’ancien spectacle historique par ses perspectives alpines et rebaptise l’ensemble du nom d’Alpi-neum33. A Genève, l’architecture élevée pour accueillir ses peintures alpestres est de style néogothique ; elle est construite rapidement en maçonnerie et en fer34. A l’intérieur sont montrés, dans une am-biance crépusculaire, trois dioramas : les vues du Stanserhorn, du Rohthal et du Burgenstock. La Notice genevoise de cette année ajoute :
« Sur le chemin du Mail est placé l’Alpineum ... Ce nouvel établissement, qui a été inauguré ces jours derniers,
sera certainement visité par les per-sonnes épuisées des grandes scènes de la nature. Ses toiles, dont chacune me-sure 100 mètres carrés, reproduisent les plus beaux sites de la Suisse »35.
En s’adressant aux spectateurs potentiels, La Patrie Suisse complète la description en disant :
« Montez l’escalier, pénétrez et instal-lez-vous confortablement ; vous serez amplement payé des peines que vous n’aurez pas prises (...) La vérité est telle qu’il n’est plus besoin de faire le voyage. (...). L’Alpineum mérite la vi-site de tous les amis de la montagne et de tous ceux que l’âge ou les infirmités empêchent d’en jouir : ils auront l’il-lusion complète d’une excursion dans notre merveilleux pays »36.
De la villa Santoux à l’Alpineum les conditions de vision avaient en fait bien changé. Au savant jeu de lumière qui caractérisait le premier établissement avait succédé un dispositif simplifié : une même source d’éclairage fixe donnait de l’éclat aux grandes toiles exposées, sans plus de variations irisées mobiles - ce principe prévaut d’ailleurs encore à l’Alpineum de Lucerne. En bordure de la Plaine de Plainpalais, « tous les amis de la montagne » pouvaient donc s’ébahir à loisir devant le spectacle de l’art, devant la précision, les détails et la couleur réaliste des peintures de Hödel. Un voyage virtuel et imaginaire, sans effort, pour celui qui voulait bien l’entreprendre ...
En 1896, dans le cadre de l’Exposition nationale, le Panorama des Alpes ber-noises s’inscrit dans cette tradition des grandes vues alpines. Il vient se loger sous la montagne artificielle du Village Suisse. Peint par A. Baud-Bovy, E. Burnand et F. Furet en 1891, il offre aux visiteurs une vision sur 360 degrés prise depuis l’éperon naturel du Maennlichen37. Ce spectacle
1516
37 Valentina Anker, Auguste Baud-Bovy, Benteli, Berne, 1991, pp. 147-16538 Parcours du guide officiel, sans numéro. Cité d’après, Bernard Crettaz et Juliette Michaelis-Germanier, Une Suisse en miniature ou les grandeurs de la petitesse, Musée d’ethnographie de Genève, 1984, p. 145.39 L’Impartial de la Chaux-de-Fonds, 7, 5, 1896, p. 14840 Tribune de Genève, 25, 9, 1896, p. 16041 A l’instar des Guides Conty. Op. cit., pp. 46-47.42 Agenda du touriste. Le Lac de Genève et le Mont-Blanc, Genève, 1875, pp. 197-198.
43 En 1822, avant la mise au point du premier procédé photographique, Louis-Jacques-Mandé Daguerre (1787-1851) ouvre à Paris le premier Diorama, en collaboration avec Charles-Marie Bouton. Cet engouement pour l’artefact n’est pas propre à l’activité touristique. À ce jeu art et création d’illusion sont supérieurs à la nature. Les visiteurs des panoramas et des reliefs allaient avec délices contempler le spectacle de l’art (cf. Le Panorama des Alpes bernoises) et pas les Alpes bernoises.44 Eugène Labiche, op. cit. p. 20. Le verbe « rayonner » prend ici le sens de « faire voir de manière panoptique », comme si le regard, depuis un point donné, traçait des rayons sur 360 degrés.45 Guide Pol. Guide pratique. Genève. Le tour du lac, route du Mont-Blanc, Lyon-Paris, s.d. (1910 ?), p. 6446 Guide de l’étranger à Genève et ses environs, Jullien, Genève 1880, pp. 28-2947 Genève. Lac Léman. Chamonix, Genève, 1904, p. 58.
à succès est d’ailleurs bien décrit par les contemporains :
« Au Village Suisse, le Panorama aura un caractère exceptionnel : le visiteur passera sans transition de la région alpestre habitée au refuge des neiges éternelles, en s’engageant dans une simple fissure de rochers, analogue à la grotte de l’Elben-Alp, dans le canton d’Appenzell »38.
Ailleurs on peut aussi lire :« Suivant un chemin sinueux et som-bre, éclairé par des lanternes fumeu-ses, le visiteur se trouve tout d’un coup sur la plate-forme en face de cet admirable Panorama de Baud-Bovy, Burnand et Furet. Un vacher des Alpes vous explique cette admirable nature dans tous ses détails. Ceci est un des clous de l’Exposition ; personne ne voudra se rendre au Village Suisse sans l’aller voir et se croire un instant au milieu même de la grande nature alpestre »39.
À d’autres moments, pour animer ces étendues désertes, des jodlers appenzellois viennent entonner leurs chants tradition-nels : « Dans ce milieu particulièrement favorable à ce genre de production. L’effet obtenu est considérable, et ceux qui ont pu assister aux premières auditions en ont remporté une profonde émotion »40.La nature s’essaie aussi à cette forme de mise en scène, mais avec plus de peine. Après Bonneville et Cluse, dans la vallée de l’Arve, la Grotte de la Balme propose une sorte de diorama naturel. Dès 1838, les guides proposant une excursion chamo-niarde, relatent cette expérience du sortir du goulet resserré, lorsque la vallée de
l’Arve s’ouvre sur les glaciers et les grands sommets alpins. C’est là que, pour l’étran-ger, commence le grand spectacle des mon-tagnes environnantes. En 1872, le Guide Conty brosse le paysage des lieux :
« Balme (1 h.), hameau situé au pied de la montagne de ce nom […] À gauche de la route, sur la coupe verticale du rocher, on aperçoit deux ouverture semi-circulai-res, ce sont les entrées de la Grotte de la Balme ; un chemin en zigzag conduit à un escalier pratiqué dans le roc d’où l’on pé-nètre dans l’antre obscur, dont la profon-deur est de 400 à 450 mètres ; au milieu se trouvent un puits très-profond et un petit lac ; l’intérieur est tapissé de stalactites. […] À partir d’ici l’horizon va s’élargissant de chaque côté de l’Arve, et l’on ne tarde pas à arriver à Magland, un des plus beaux villages de la contrée ; il est entrecoupé de bosquets, de prairies, de vergers, etc. »
S’ensuit la description de la Cascade d’Arpennaz et des paysages jusqu’à Cha-monix : c’est un vaste cirque naturel qui s’ouvre devant les yeux des promeneurs41 et rappelle l’expérience vécue devant un panorama ou un diorama. Il y a d’abord le prix à régler pour jouir de la mise en scène sonore et visuelle. Il y a ensuite l’ascension nécessaire pour arriver à « l’antre obscur » et profond, duquel on découvre la vue claire et ensoleillée de la vallée dont « l’ho-rizon va s’élargissant de chaque côté de l’Arve ». Cette course est un lieu commun des excursions du temps42. Deux oeuvres du védutiste Jean Dubois rendent compte de l’effet esthétique et lumineux que le site propose en s’inspirant des grands décors du théâtre romantique et des lithographies pittoresques. Cette mise en scène sera reprise plus tard dans les dioramas.43
Désintérêt Des vUes aLPines Bientôt, dans les guides et les différen-tes notices touristiques, cette prédominan-ce des vues panoramiques et des perspec-tives alpines s’estompe progressivement au profit de la ville et de ses monuments. Le point de départ du traditionnel « tour de ville » se déplace désormais de l’habituelle vue depuis la promenade Saint-Antoine au nouveau quartier des Bergues et à l’île Rousseau. Si en 1837, dans ses Mémoires d’un Touriste, le narrateur oscille entre ces deux pôles urbains, en 1844, le Nouveau guide de l’étranger à Genève et dans ses environs inaugure officiellement ce nou-veau point de départ. La terrasse excentrée garde encore une place importante dans le parcours, place qui ne cessera de s’étioler au fil des années. Ce recentrage des guides sur la ville se généralise. En 1862, le Guide de Genève et ses environs enregistre ce phénomène en consacrant plus de place à la Cité de Calvin qu’à sa proche région, dix-huit pages pour l’une, dix-sept pour l’autre. Au fil du temps cette tendance ne fait que s’accroître : en 1880 par exemple, le Guide de l’étranger à Genève consacrera vingt pages à la ville et seulement huit à sa campagne. Par voie de conséquence, « promenades », « excursions », « tours » et autres courses vont petit à petit disparaître, et avec elles les « vues », les « coups d’oeil », « les perspectives » et autres « panoramas ». En 1887, cette mise à l’écart est consommée : dans son titre, le Guide illustré de Genève, n’ajoute plus « et de ses environs », comme c’était jadis la coutume.
De leur côté, les vues et les grandes perspectives alpines connaissent une désaffection croissante et irréversible. Hormis Monsieur Perrichon, qui veut encore faire « rayonner devant [sa fille] le grand spectacle de la nature »44 ? En 1860 déjà un voyage ayant pour but les Alpes relève d’un romantisme éculé et les guides refoulent ces expériences esthétiques d’un autre âge. Ainsi la Grotte de la Balme dis-paraît-elle progressivement des itinéraires proposés aux étrangers. En 1910, elle n’est plus citée que dans un style télégraphique qui exclut désormais toute prolongation visuelle et esthétique sur le reste de la vallée de l’Arve : « Grotte de la Balme (all. et ret. 2h. 1/2 ; 3 fr.) profonde de 300m., belles stalactites »45.
L’excursion de Ferney-Voltaire par le Grand-Saconnex ne s’entreprend plus pour avoir le plaisir de contempler le Mont-Blanc. En 1880, l’intérêt de cette course se résume désormais uniquement à l’évocation du philosophe et au nouveau monument qui commémore sa mémoire : « Le Conseil municipal de Ferney a voté en 1876 l’érection sur la place du château d’une statue de Voltaire réduite d’après celle de Houdon ». Plus prosaïquement, en 1904, pour se rendre à cette localité fran-çaise, une brochure conseille au touriste d’emprunter « le tramway électrique ». Il glisse ensuite, qu’au château, il faut se rendre dans le parc où, de « la terrasse, on jouit d’une très belle vue »47. Mais laquelle d’ailleurs ? La plaquette ne prend même plus la peine de le préciser. Le tourisme thermal genevois et ré-gional, qui fait sa publicité dans plusieurs guides48, supplante le spectacle des mon-tagnes, tout en valorisant les bains alpins
1718
56 Catherine Courtiau, op. cit., p. 271.57 Almanach du Vieux Genève, 1931, « Nos panoramas », pp. 5-8 ; et Valentina Anker, op. cit.58 Ferdinand Hodler und die Weltausstellung 1894. Geschichte der Gemälde « Aufstieg » und « Absturz », 25 Juni 1999 - 31 Oktober 1999, Schweizerischen Alpinen Museum, Bern, 1999.59 En 1914, lors de l’Exposition Nationale de Berne, le chemin de fer-panorama montrant la Suisse et ses montagnes fait polémique. Ce spectacle est devenue une simple « attraction » d’un goût douteux : dans La Patrie Suisse, les guillemets relativisent et minorent la portée du terme. Du Village Suisse où il aurait du être installé, il est déplacé en limite des installations, près du Parc des Sports. Nous sommes bien loin de l’esprit qui avait présidé à l’érection du Village Suisse à l’Exposition Nationale de Genève en 1896, de la montagne factice et du Panorama des Alpes bernoises de Burnand, Bovy et Furet, in La Patrie Suisse, 1914, 538, pp. 97-100.60 André Corboz, à propos des promenades et aménagements touristiques des villes de Zurich, réalisés relativement tardivement par rapport aux infrastructures genevoises, et en premier lieu ses quais, note : « L’histoire de la Bahnhofstrasse révèle que la dimension esthétique et affective du paysage n’avait plus la même valeur dans les années soixante du XIXe siècle que pour les générations précédentes, celle de l’opération des Bergues », André Corboz, « La « Refondation » de Genève en 1830 (Dufour, Fazy, Rousseau) », in Genava, n.s. 1992, p. 77.61 C’est l’expérience décrite par Gérard de Nerval dans Les Nuits d’octobre (1852) et Promenades et Souvenirs (1854-1855) lors de ses périples qui le mènent de Saint-Germain au Valois.62 Voir Georges Schivelbusch, Histoire des voyages en train, Le Promeneur, Paris, 1990.
48 Ainsi dans L’agenda du touriste. Le lac de Genève et les environs, Genève, 1875-1876.49 Pierre Monnoyeur, « Les villas suburbaines de Champel-sur-Arve : 1874-1897, de l’éclectisme à la banalisation de l’architecture », in David Ripoll (dir.) Champel-les Bains : architecture et hydrothérapie, DCTI, Direction du Patrimoine et des Sites, Genève, à paraître.50 A l’instar de Guides Conty. Op. cit., p. 25.51 Le Cicerone de Poche. Indicateur des rues de Genève, Genève, 1893, p. 5.52 Souvenirs de Genève. Notice illustrée, Genève, 1896, p. 33.53 Petit guide de Genève, s.d. (1901 ?), Genève.54 Livio Fornara, Le Relief de Genève en 1850, Maison Tavel, Musée d’Art et d’Histoire de Genève, Genève, 1990.55 Voir les deux articles consacrés à cette enquête parus dans la presse genevoise et conservés dans la collection Gottraux, CIG, cl. 62.
blin57. En 1894, à l’Exposition universelle d’Anvers, le diorama alpin de Hödel n’obéit plus aux lois du genre, quand bien même il explore une voie plus symbolique, mon-trant parallèlement l’Ascension et la Chute d’une cordée58. Avant la Grande Guerre, le spectacle des grandes illusions alpines n’attire plus le public59...
et PUis vint La raDe Dans les guides, aux périphéries, aux excursions en montagne et aux vues de paysages, on préfère désormais la ville : le minéral prime désormais sur le végétal60. A ce recentrage touristique plusieurs rai-sons. Le changement de mode de dépla-cement y est pour beaucoup. Le cheval, les voitures hippomobiles, les postes, les bateaux, les bacs obligeaient autrefois les voyageurs à suivre des voies variées et des itinéraires souples. Attendre, se perdre, s’égarer, retrouver son chemin étaient les expériences consécutives à tout dépla-cement : le voyageur avait toute latitude d’inventer son périple. Le chemin de fer restreint incontes-tablement cette liberté de mouvement et profite à certaines villes desservies, condamnant les autres à l’oubli61. Jusqu’à l’introduction de l’automobile, le tourisme devient activité spécifiquement urbaine62. À Genève, la première gare est construite à Cornavin entre 1856 et 1858, celle des Vollandes, porte de la vallée de l’Arve par Annemasse, en 1888.
En feuilletant les vade-mecum gene-vois c’est d’abord l’ « ombilic » de la Genève restaurée, c’est-à-dire la réunion du lac, des quais, de l’ancienne Ile des Barques et de la statue de Rousseau, qui fait l’objet d’attention. Vingt ans plus tard, les choses ne sont déjà plus les mêmes. En amont, au lieu des berges jadis encore instables et des anciens fossés, un nouveau décor est planté : l’urbanisation gagne, les limites primitives sont repoussées. Sur la rive droite, c’est le quai du Mont-Blanc (1851-1857), le square (1853-1858) et le nouveau pont (1861-1862) ; à l’opposé, sur la rive gauche répondent l’hôtel de la Métropole (1852-1854) et la Promenade du Lac (à partir de 1854). Enfin, en 1856, deux jetées, l’une aux Pâquis et l’autre aux Eaux-Vives, établissent sur le lac une sorte frontière : le « téménos » originel s’est déplacé. Face à ce paysage urbain inédit, au fur et à mesure que les infrastructures avancent, les guides peinent à qualifier la surface d’eau nouvellement annexée à la ville. Au début, ils parlent tantôt « des ports », tantôt du « Lac », une terminologie répétée par les cartes de la Cité de Calvin. Bientôt, le singulier est privilégié et cette étendue lacustre est définie comme étant « le port ». En 1862, le Guide dans Genève et ses environs propose pour la première fois le substantif de « rade », sans que l’on sache exactement ce que ce nom désigne réellement63. Cette entrée lexicale ne fait pas recette et il faut attendre 1887 pour que le substantif refasse son appari-
de la Caille, au plus profond du torrent des Usses, ou de ceux de Saint-Gervais, près de Chamonix. Dès 1874 un institut thermal inspiré de ces réalisations s’installe à Champel, tout près de Genève. À sa tête, le docteur Glatz vante les bienfaits des eaux froides de l’Arve qui descendent tout droit des gla-ciers. Auprès des bains, un décor alpin est sciemment recréé : des sapins sont plantés, une cascade et des rocailles sont aména-gées en contre-haut, sur la falaise abrupte, pour évoquer les hauteurs montagneuses. Comme en écho, l’iconographie accompa-gnant les publicités de l’établissement de Champel ne manque pas de faire ressortir les escarpements de l’Arve et ses rives sau-vages, mais accueillantes, avec les Alpes dans le lointain. Dans les années 1880 l’ac-tivité balnéaire commence à péricliter et les notices n’évoquent plus désormais que le cadre charmant, les ombrages profonds et les promenades variées du site. Les gravures et les affiches rendent compte de cette nouvelle douceur des lieux, allant même jusqu’à faire de Champel-les-Bains, vers 1900, une station aux charmes pres-que exotiques. Comme s’il s’agissait d’un jardin d’hiver, la végétation environnante se peuple de palmiers et de plantes gras-ses49.
Ce déclassement touche également les représentations alpines proposées aux étrangers de passage en ville. Le Relief de la Suisse disparaît avec le Bastion de Chantepoulet en 1850, comme la Table d’orientation toute proche. Au Jardin anglais, le Grand Relief du Mont-Blanc résistera plus longtemps. En 1872 encore, le Guide Conty place cette attraction, « pro-
priété municipale », en tête de la liste des édifices cités dans la partie « Monuments et curiosités »50. En 1893, le Cicerone de poche l’inclut encore dans le corps de son texte, mais déjà presque à contrecoeur. La maquette n’y fait plus l’objet d’une entrée propre ; le « R » majuscule du relief s’est mué en une minuscule ; enfin - contraire-ment aux autres objets dignes d’intérêt, comme les Pierres du Niton évoquées juste à côté -, le substantif n’est même plus en italiques51. En 1896, à l’occasion de l’Expo-sition Nationale, les Souvenirs de Genève brossent un large répertoire des attrac-tions genevoises. Le Relief du Mont-Blanc a disparu des notices ; il reste cependant indiqué sur le plan attenant. C’est encore la situation qui prévaut en 1901 : la ma-quette alpine est inscrite sous le numéro 54, et son nom reporté sur la liste corres-pondante, juste après le Relief de Genève en 185054. Cette marginalisation progres-sive aboutit en 1919 à la destruction du pa-villon qui abritait au Jardin anglais cette curiosité. Dans l’indifférence générale, cette relique étonnante s’évanouit, sans laisser de traces, malgré les recherches effectuées pour la retrouver. Les dernières tentatives datent de 197655. En bordure du Mail, la Villa Santoux et l’Alpineum connaissent le même sort en dépit des efforts de reconversion. L’Alpineum tiendra en effet lieu de salle de cinéma, abritant en 1896, l’une des premières projections cinématographiques de Suisse56. L’édifice de la Plaine disparaît définitivement en mai 1899. Le Panorama des Alpes bernoises quitte Genève en 1896. Il est remonté dans le Village Suisse de l’Exposition de Paris en 1900 ; puis est détruit en 1903 à Du-
2122
Panorama de genève de st-antoine par Jean Dubois (BGE)
Panorama de genève en description du lacpar Jean Dubois (BGE)
2324
63 Cette dénomination découle certainement du fait que le 27 décembre 1856 le Grand Conseil a approuvé le projet de travaux intitulé : « Port général soit Rade de Genève. Sur la formation historique et matérielle de la rade voir Les Monuments d’Art et d’Histoire du Canton de Genève : tome I, La Genève sur l’eau, Wiese, Bâle, 1997, pp. 62, 71, 98, 133-135, 187-193.64 Genève. Lac Léman. Chamonix, R. Burkhart, Genève, s.d., (1904), pp. 47 et 48.65 Le contresens devient cocasse quand, à une date indéterminée, l’usage vint de parler de « petite rade » ou « de grande rade »...66 A Genève le substantif « agglomération » apparaît en 1894. Voir François Walter, La Suisse urbaine, Zoé, Genève, pp. 37-38.67 Ce phénomène touche aussi les représentations des villes en général. Voir Pierre Monnoyeur, « Les villes tentaculaires. Paysage urbain et représentation d’architecture », in Analog(ue)-Dialog(ue), Kunstmuseum de Soleure et Musée jurassien des arts de Moutier,, 15. 9. 2001 – 11. 11. 2001, pp. 85-9468 Armand Brulhart, « Naissance du concept de vieille ville au XIXe siècle à Genève » in Aspects de l’art à Genève au XIXe siècle, Musée d’Art et d’Histoire, Genève, 1979, pp. 7-31.69 André Corboz, op. cit.
l’île rousseau et le squaredu mont-Blanc. c. 1870 CIG
tion dans le Guide illustré de Genève : il désigne la zone située au-delà des deux jetées. En cela, le texte ne fait que suivre la définition des dictionnaires : avant les infrastructures portuaires, la rade est une large anse ouverte sur le large qui, proté-gée naturellement, peut aux besoins servir de lieu de mouillage et d’attente pour les navires. Une illustration de ce guide est particulièrement intéressante : tournant le dos à la rade, la vue est exécutée à partir de la jetée des Pâquis et présente le port de Genève, le pont du Mont-Blanc et, plus loin, la silhouette de la ville. Etonnam-ment, la gravure porte le titre de « pano-rama de Genève », comme si, embarrassée, elle préférait une formule passée de mode pour qualifier l’étendue d’eau qui constitue l’essentiel de l’image. En fait, la terminolo-gie ne se fixera qu’avec la fin du siècle. En 1899, le Plan de Genève et ses environs par Charles Bobiller adopte le terme de « rade » dont les quatre lettres viennent s’inscrire à la hauteur des Pierres du Niton. Cinq ans plus tard, l’opuscule Genève. Lac Léman. Chamonix a entériné cette entrée : « fermant la rade que nous avons en face de nous, les deux jetées semblent deux im-menses bras qui s’entrouvrent pour laisser passer le lac »64.
L’usage est pris, sans souci du contre-sens opéré65. D’hésitations en atermoie-ments, en quelques années, le vocabulaire s’est adapté aux changements advenus. Alors que les premiers guides parlaient « des ports », faisant ainsi implicitement allusion à l’activité marchande et aux infrastructures lacustres populeuses, les seconds font de cet éparpillement une
unité. Ils préfèrent le singulier au pluriel : « le port » s’impose. Enfin, tournant défini-tivement la page du XIXe siècle, oubliant l’agitation commerciale qui régnait autour des bateaux, les derniers guides adoptent le substantif « rade » pour désigner le nou-veau plan d’eau aménagé et gagné sur le lac. Cette requalification vient sanctionner un espace métamorphosé et organisé pour la navigation de plaisance, avec des quais dévolus aux voyageurs, à l’hôtellerie, et rapidement à la publicité.
Au moment où la ville se dépouille de ses bastions et de ses murs, où elle devient en somme une agglomération, un espace ouvert – avoué comme tel dès 189466 -, le paysage culturel et touristique genevois se concentre à l’intérieur de frontières étroitement définies67. A la dilatation de l’espace urbain répond un resserrement identitaire, un réflexe presque banal : l’histoire et l’art servent de rempart au « cosmopolitisme ». D’une autre manière, c’est la « Naissance du concept de vieille ville au XIXe siècle à Genève »68. Du « témé-nos » et de « l’ombilic » de la « refondation » genevoise69, le concept de centre se déplace un peu en amont et trouve son incarnation dans la rade, une création artificielle ne s’ancrant sur aucune tradition.
2526
72 La découverte, « l’invention » archéologique de la cathédrale est à cet égard très parlante.73 Walter Benjamin, « L’Oeuvre d’art à l’époque de sa reproduction mécanisée », in Wolfgang Schivelbusch, op. cit., pp. 45-47.74 Histoire passionnante d’un système : une révolution pneumatique en 1899 ; des itinéraires conseillés à partir de 1908 ; des cartes imprimées dès 1910 ; la numérotation des routes de France lancée à l’instigation de l’entreprise de Clermont-Ferrand en 1912 ; les Guides Rouges édités pour la première fois en 1926 ; sans compter la signalisation routière et touristique Michelin en ciment plantée à certains carrefours importants...75 A Genève, la voiture automobile ne devient un moyen de transport réellement usité qu’à partir des années 1906-1908. C’est de cette période que datent les premières autorisations importantes de construction des garages. Ce sont les zones suburbaines et les périmètres de villas qui connaissent le plus de demandes de cet ordre. Après le tram et le chemin de fer, l’automobile permet d’étendre la ville et de construire de nouveaux lotissements. Pierre Monnoyeur, « Le lotissement des chemins du Mont-Blanc et du Jura », avril-juin 2005, manuscrit.
70 Stendhal, op. cit., vol. II, p. 190.71 Ibid., p. 64.
cède rapidement un mouvement centri-fuge. Bientôt, cyclistes ou conducteurs se mettent à parcourir d’autres itinéraires, cherchant d’autres plaisirs, avec d’autres guides en main. Sur leurs vélos ou au volant de leur voiture automobile, délais-sant les voies ferrées, ils redécouvrent les hasards, les circonvolutions et les aléas des voyages anciens. Dans cet esprit, le Touring-Club de France, dès 1900, lance sa fameuse série Sites et Monuments, oeuvre comparable aux Voyages pittoresques et romantiques dans l’ancienne France du baron Taylor, mais bénéficiant de plus de reproductions grâce à l’utilisation raison-née et systématique de la photographie. Puis, c’est l’aventure Michelin74. À Genève, dès 1910, cette attirance transparaît dans un des guides de la collection Pol75. Le texte illustré s’adresse encore au touriste se déplaçant en train, mais aussi et d’abord au cycliste et au conducteur, au « voyageur avec sa machi-ne ». Son titre complet marque à lui seul le renversement qui s’est produit et la liberté nouvelle dont jouit à nouveau l’amateur de dépaysement : Guide pratique. Genève. Le tour du lac. La route du Mont-Blanc. Avec : 7 cartes géographiques kilométrées, 5 plans, 6 panoramas, 9 profils de pente des routes, 20 gravures (Lyon, 1910).
Les itinéraires se multiplient, les ima-ges aussi. A la facilité de déplacement, à la prolifération des parcours touristiques fait écho le foisonnement de la photographie souvenir. Tout ou presque devient un sujet digne d’être fixé par un objectif. Désormais, les cartes postales enregistrent aussi bien la ville et ses monuments, que la campa-gne, les vallées et les sommets alpins.
de Guide historique et descriptif de Genève est un bon exemple du poids grandissant de l’érudition dans ce qui était avant essentiellement un divertissement. Mais le texte est abstrait et la description, un exer-cice malgré tout difficile. Le monument va réellement s’incarner quand son image pourra être imprimée facilement. En 1874, l’un des premiers guides accompagnés de représentations gravées paraît, montrant évidemment une vue de l’île Rousseau et du pont du Mont-Blanc en tête de son volu-me. La formule est définitivement fixée en 1887 avec le Guide illustré de Genève qui est accompagné de photographies ; édition qui scelle d’ailleurs la réunion du substan-tif de « monument » et celui de « musée ».
Dans les guides l’avènement du monu-ment coïncide avec celui de la gravure et, surtout, de la photographie. Sa forme tou-ristique naît vraiment au moment où son image se multiplie. Les différentes estam-pes des Antiquités de Rome depuis le XVIIe siècle avaient donné le ton et les célèbres planches de Piranèse ne feront que consa-crer un genre établi. Mais c’était l’Anti-quité qui était vantée, avec ses ruines, ou la Renaissance, avec ses architectures : des évocations lointaines et nostalgiques. A la fin du XIXe siècle, avec les moyens techniques sophistiqués introduits dans l’édition, le monument devient un objet commun, le fruit de la reproductibilité, de la mécanisation et de la consommation : un produit adapté aux besoins compulsifs du touriste.
Ce resserrement sur la ville, sa « rade » et ses monuments marque la fin d’un chapitre. À ce mouvement centripète suc-
La monUmentaLisation DU PLan D’eaU
La ville se minéralise et se monu-mentalise. À son inauguration en 1835, le bronze de l’auteur des Confessions inau-gure un nouveau type de figuration dans la ville. Les guides l’enregistrent immédia-tement, comme vient de le faire Stendhal dans ses Mémoires d’un touriste parues en 1837 : « Je vais voir la statue de Rousseau dans la petite île au milieu du nouveau pont, c’est une nouveauté pour moi ; hon-neur à M. Pradier, artiste genevois ! »70. Le texte rappelle non seulement le souvenir de l’écrivain genevois, mais aussi celui de l’artiste contemporain qui a réalisé la sculpture. En une phrase, c’est une double célébration, celle du passé et du présent, couplée à celle de l’histoire et de l’art. L’effigie de Rousseau par Pradier occupe le centre de Genève, comme celle de Voltaire, par Houdon, campée sur la place de Ferney en 1876. En 1835 le bronze n’est encore qu’une « statue » - qualification qui lui restera dans tous les guides étudiés, soit jusqu’en 1910 -, alors même que le substantif de « monument » est porté sur son socle, dans l’inscription commémorative. L’oeuvre de Pradier est tournée vers le passé. A l’origine, placé au milieu de l’ancienne île des Barques, l’exilé genevois regardait vers l’aval, vers l’épicentre pri-mitif et le pont de la Machine71. A l’avène-ment de la rade en 1862 la sculpture fait une volte-face vers l’amont, en direction du pont du Mont-Blanc. Qui plus est, quittant son emplacement central, elle remonte à la proue de ce restant de fortification immergé, comme si cette position avan-cée devait la projeter vers l’avenir. Mais, malgré ce revirement, l’effigie de Rousseau ne se hisse pas au rang de monument. L’île Rousseau évoque par trop Ermenonville, l’élégant marquis de Girardin et la poésie
de l’île des Peupliers, un ensemble de traits désuets empreints de l’esprit de la Restau-ration genevoise qui préside à l’opération des Bergues ! La figure de l’écrivain, même tournée vers la rade, n’en impose guère. Assis et rêveur, l’auteur des Confessions est drapé dans sa toge, comme jadis les philosophes. Sa chevelure, artistement ébouriffée, rappelle celle de Chateaubriand peint par Girodet. Le Rousseau de Pradier respire un romantisme passé de mode. Le siècle avançant, les esprits vont être captés par des réalisations plus viriles et plus historiques, bien ancrées dans le ca-dre urbain. L’ère des monuments s’ouvre. 1869 voit l’érection des deux figures sym-bolisant la réunion de Genève à la Suisse, deux femmes fièrement et solidement cam-pées sur un socle, regardant vers le large et l’Helvétie. En 1879 est inauguré le mauso-lée du duc de Brunswick, une construction néogothique rappelant l’essor des villes italiennes du XIVe siècle, l’incarnation d’un homme, d’un titre de noblesse et du pou-voir de l’argent. La première réalisation est installée sur la rive gauche, la seconde sur la rive droite. A dix ans de distance, par delà le plan d’eau qui les sépare, ces deux monuments ont en commun de se tourner résolument vers le large.
Contrairement aux expériences es-thétiques précédentes, aux « vues » et aux « curiosités », à ces délassements paysagers gratuits dont les voyageurs jouissaient avec nonchalance, les monuments sont difficiles d’approche et nécessitent des explications, demandent des précisions, des descriptions, des noms, des dates. Ainsi, dans le guide de 1880, celui du duc de Brunswick est-il présenté sur quatre pages pleines, alors qu’une notice normale ne fait d’ordinaire l’objet que de quatre à six lignes en moyenne. Le tourisme devient une affaire laborieuse. L’historicisation de la ville est progressive, mais continue72. En 1873 et 1880, la parution de deux éditions
2728
maisons rurales du village de Bernex, début XXe CIG
Dans la culture européenne, la transmission du patrimoine aux générations futures est une des valeurs fondamentales de la société, qu’il soit de l’ordre de la pensée, ou qu’il s’agisse des choses matériel-les. C’est la raison pour laquelle particuliers et collectivités locales se sont généralement engagés naturellement à sauvegarder les bâti-ments hérités, témoignant ainsi d’un attachement à leurs ancêtres ou à l’histoire de la communauté. Cependant, la très forte expansion économique de la société industrielle, puis postindustrielle, tout comme le phénomène de globalisation accompagnant la révolution informatique ont bouleversé les valeurs sociales ainsi que le paysage rural et urbain à l’échelle de la planète. Dans ce contexte, la notion de patrimoine prend des sens multiples et sa conservation est souvent assimilée aux questions d’environnement, de cadre de vie, plutôt qu’au seul respect de symboles historiques. L’appareil juridique appliqué à la protection du patrimoine reflète le rôle progressivement attribué à l’Etat, au cours des XIXe et XXe siècles, pour défendre, au nom de l’intérêt public, l’héritage historique menacé par toutes sortes d’intérêts particuliers. Comme le rappelait André Chastel : « Dans toute société, le patrimoine se reconnaît au fait que sa perte constitue un sacrifice et que sa conservation suppose des sacrifices »1. Au cours de la seconde moitié du XIXe siècle, la Confédération helvétique s’implique dans la sauvegarde du patrimoine national. Les toutes premières réglementations portent sur les forêts et les eaux, dans le but initial de préserver les ressources du pays et de prévenir les catastrophes naturelles. A partir de 1886, des mesures sont prises pour la conservation des monuments historiques et l’acquisition d’antiquités nationales2. A Genève, dans les premières années du XXe
siècle, à la faveur des chantiers de restauration des temples de Saint-Gervais (PF n° 353 du 13 mai 1904) et de la Madeleine (PF n° 99 du 2 septembre 1913), la Confédération place ces deux monuments, situés à l’intérieur du périmètre de la ville ancienne intra muros, sous protec-tion fédérale, avant même l’établissement d’une législation cantonale. Pour la conseiller dans ses tâches, la Confédération dispose de deux commissions d’experts : la Commission fédérale des monuments historiques, créée en 19153, qui a joué un rôle actif sur plusieurs chan-tiers de restauration genevois, tels que la cathédrale St-Pierre, la Mai-son Tavel, l’église de Saint-Gervais …et la Commission fédérale pour la protection de la nature et du paysage, instituée en 1936. Cependant, conformément au fonctionnement d’un Etat fédéral, la responsabilité de protéger le patrimoine du pays est déléguée aux cantons4, la Confé-dération établissant les bases légales à partir desquelles ceux-ci sont tenus d’adapter leur législation cantonale. La loi fédérale actuelle sur la protection de la nature et du paysage5 a été adoptée en 1966. Depuis sa révision en 1995, elle concerne également les ensembles bâtis et les monuments historiques. La Section des monuments historiques, rattachée à l’Office fédéral de la culture, participe financièrement aux coûts de restauration des immeubles classés et prioritairement de ceux qui ont une valeur nationale6. L’Office fédéral de l’environnement est, quant à lui, responsable des questions relevant de la protection de la nature, des ensembles bâtis et du paysage. La Confédération a établi trois grands inventaires du paysage naturel et bâti : celui des paysages, sites et monuments naturels (IFP), lancé en 1977, celui des
Introduction
La Protection DU Patrimoine à genèvemisE En placE Et évolutiondu systèmE légalsabinE nEmEc-piguEt
2930
8 En 1908, le Fribourgeois conservateur Georges de Montenach fait paraître son ouvrage Pour le Visage aimé de la patrie ! (Lausanne, Th. Sack-Reymond). Cette expression sera reprise dans le rapport du Conseil d’Etat introduisant la loi de 1920 au Grand Conseil genevois. 9 Son nom actuel est Patrimoine suisse.10 Le Heimatschutz, une ligue pour la beauté. Esthétique et conscience culturelle au début du siècle en Suisse, Diana Le Dinh, Histoire et société contemporaines, Lausanne, 1992.11 Au sujet de la première loi vaudoise, voir Autour de Chillon. Archéologie et restauration au début du siècle, Denis Bertholet et alii, Musée cantonal d’archéologie et d’histoire, Lausanne, 1998. Cette publication a été réalisée à l’occasion de l’exposition commémorant le 100ème anniversaire de la loi du 10 septembre 1898 sur la conservation des monuments et des objets d’art ayant un intérêt historique ou artistique. 12 Loi pour la conservation des Monuments et la protection des Sites, du 19 juin 1920. Son article 4 sera complété le 28 janvier 1922 pour interdire au propriétaire d’apporter des modifications à son immeuble pendant la procédure de classement, ceci dans un délai n’excédant pas deux mois. Puis une nouvelle modification le 25 janvier 1930 porte de neuf à onze le nombre des membres de la commission des monuments et des sites.13 Annexes des Registres du Conseil d’Etat, 1er semestre de 1904 OD 557, p. 954. Henri Juvet (1854-1905) a beaucoup construit à Genève. Il a réalisé, entre autres, l’hôpital psychiatrique de Bel-Air (1892) ; un immeuble pour la Caisse d’Epargne à St-Gervais, avec J.-E. Goss et G. Brocher (1899) ; l’école primaire des Pâquis (1902) ; le conservatoire du Jardin botanique (1904).14 Ces termes sont repris d’un commentaire publié en 1905 à propos de l’adoption de la loi neuchâteloise de 1902, voir « Ricochets neuchâtelois : la loi de 1902 et les restaurations dirigées par Charles-Henri Matthey », Claire Piguet, in Autour de Chillon, op.cit., p. 63.
1 André Chastel, « La notion de patrimoine », dans Les lieux de mémoire, vol. II La Nation, 1986.2 Arrêté concernant « la participation de la Confédération à la conservation et à l’acquisition d’antiquités nationales » 30 juin 1886.3 En 1886, le Conseil national avait délégué à la Société pour la conservation des monuments de l’art historique suisse la fonction de commission fédérale d’experts chargée de l’inventaire, de l’entretien et de la sauvegarde des monuments. (cf. A. Knoepfli, op. cit.). Après diverses tentatives infructueuses pour la nationaliser, il crée, en 1915, une Commission fédérale d’Etat pour la sauvegarde des monuments.4 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, art. 78, Protection de la nature et du patrimoine, al. 1 : « La protection de la nature et du patrimoine est du ressort des cantons ».5 LPN du 1er juillet 1966 et révisée en 1995.6 Le montant annuel des subventions fédérales: Fr. 69’287.- en 1915 ; de Fr. 32’501’000.- en 2000.7 En allemand, les termes Heimatschutz et Denkmalpflege font la distinction entre la protection des sites bâtis et naturels, pour le premier, et celle des objets bâtis, pour le second, alors que la langue française n’utilise pas une terminologie spécifique.
La mise en PLace Des instrUments LégaUX
Dès la fin du XIXe siècle, les actions se multiplient en Suisse, comme en Europe, en faveur de la sauvegarde d’un patrimoi-ne national. Des associations de défense « du visage aimé de la patrie »8 se créent et mobilisent le public. La société du Hei-matschutz, Ligue pour la conservation de la Suisse pittoresque9, organise son assem-blée constituante en juillet 1905. La Société d’Art public, qui s’est formée en 1901 sous l’impulsion de l’écrivain Philippe Mon-nier et de l’historien Guillaume Fatio, en devient la section genevoise10.
En matière de législation sur la protection des monuments historiques, la France, rappelons-le, donne l’exemple. Après la création d’un poste d’inspecteur général des monuments historiques en 1830 et d’une Commission des monuments historiques en 1837, elle adopte, en 1887, les premières dispositions légales de protection des monuments historiques. Sa loi actuelle en vue du classement d’édifices au titre de monuments historiques date de 1913 ; la protection des monuments na-turels et des sites, de 1930 ; la loi Malraux sur les secteurs sauvegardés, de 1962 ; les zones de protection du patrimoine archi-tectural, urbain et paysager (ZPPAUP),
de 1983. En Suisse, le canton de Vaud fait figure de pionnier en disposant d’une loi de protection du patrimoine en 1898 déjà11, suivi rapidement par Berne (1900) et Neu-châtel (1902). Au bout du lac, Genève ma-nifeste très peu d’empressement à se doter des instruments légaux et des services de l’administration nécessaires à la protec-tion de son patrimoine bâti et naturel.
1920 : La Loi sUr La conservation Des monUments et La Protection Des sites
La première loi genevoise sur la pro-tection des monuments et des sites ne voit le jour qu’en 192012, retard que le Conseil d’Etat relève alors qu’il est, depuis 1904, en possession d’un projet de loi que lui a adressé le président de la section des Beaux-Arts de l’Institut national gene-vois, l’architecte Henri Juvet13. Ce retard s’explique par la réticence des citoyens genevois à accepter les restrictions à la propriété induites par des mesures légales ; plutôt que de légiférer, ceux-ci préfèrent compter sur le bon goût et à la bonne volonté de tout un chacun14. Ayant pu s’enrichir de l’expérience des autres, la loi genevoise tire avantage de son retard. Elle innove en ajoutant à la protection des
sites construits à protéger en Suisse (ISOS) et celui des voies de com-munications historiques de la Suisse (IVS). A Genève, contrairement à la pratique de la majorité des cantons, la protection du patrimoine - comme l’aménagement du territoire et la délivrance des autorisations de construire - est du ressort canto-nal et non pas communal. Par ailleurs, le Service des monuments et des sites, qui est chargé d’appliquer la loi, est rattaché au Départe-ment des constructions et des technologies de l’information, l’ancien Département des travaux publics, historiquement responsable de la réalisation des routes, puis des autorisations de construire et enfin de la planification territoriale, alors que, dans plusieurs cantons suisses ou en France, la protection du patrimoine dépend du ministère de la culture ou de l’éducation. La particularité genevoise n’est pas sans effet sur les pratiques. La protection du patrimoine bâti, naturel et paysager relève de mesures légales dont l’application s’effectue à trois niveaux diffé-rents : le territoire, les ensembles, les objets particuliers. A l’échelle la plus large, les moyens mis en œuvre visent à exercer un contrôle géné-ral sur l’aménagement du territoire, en fixant très précisément les rè-gles de gestion du sol national. En plus de la loi spécifique mentionnée plus haut, de nombreuses dispositions poursuivent un but commun : les lois fédérales sur les forêts, les eaux, l’agriculture, l’aménagement du territoire, la protection de l’environnement, ont contribué assu-rément à la protection du paysage helvétique. Le zoning, concrétisé par le plan des zones, ou plan d’affectation, est l’instrument cantonal pour appliquer les objectifs de l’aménagement du territoire définis au niveau fédéral. C’est également par des plans d’affectation (zones protégées ou plans de site) que la protection des ensembles peut être réalisée. A l’échelle la plus réduite, celle des objets particuliers, bâtis ou naturels, des mesures ponctuelles s’avèrent nécessaires. Toutes ces dispositions doivent reposer sur une base légale qui autorise l’ap-plication de restriction à l’usage d’un bien immobilier pour un motif reconnu d’intérêt public, en l’occurrence la protection du patrimoine historique, culturel, naturel et paysager7. Comme nous le verrons dans le cas genevois, la mise en place des instruments légaux de protection du patrimoine a constamment joué sur ces différents niveaux en tirant parti d’un appareil légal complexe. Ceux-ci relèvent aujourd’hui de trois grandes lois cadres cantonales : la loi d’application de la loi fédérale d’aménagement du territoire (LALAT), la loi sur les constructions et les installations diverses (LCI, zones protégées) et la loi sur la protection des monuments, de la na-ture et des sites (LPMNS).
3132
15 « Projet de loi pour la conservation des monuments et la protection des sites. Rapport du Conseil d’Etat », Annexe du Mémorial du Grand Conseil, Genève, 1920, p.270.16 Règlement d’application du 25 avril 1921.17 Cette mesure connaît un seul cas d’application dans le cadre de la loi de 1976. 18 Code civil suisse du 10 décembre 1907. V. Restrictions de droit public, 1. En général, Art. 702 « Est réservé le droit de la Confédération, des cantons et des communes d’apporter dans l’intérêt public d’autres restrictions à la propriété foncière, notamment […] les mesures destinées à la conservation des antiquités et des curiosités naturelles ou à la protection des sites […] ».19 Le Heimatschutz, une ligue pour la beauté, op.cit.20 La première commission des sites est nommée par le Conseil d’Etat le 5 novembre 1920 et comprend les membres suivants : Louis Blondel, chef du service municipal du « Vieux Genève », Waldemar Déonna, directeur du Musée d’Art et d’Histoire, Adolphe Guyonnet, architecte, John Lachavanne, licencié en droit, Camille Martin, directeur du plan d’extension, Eugène Pittard, Dr ès sciences, professeur à l’Université, Burckhardt Reber, conservateur du Musée épigraphique, Louis Roux, député, président de l’association Intérêt Genève, Albert Sylvestre, artiste peintre.
rue de la Pélisserie, état 1978 CIG
rue de la Pélisserie, état 2007 Sabine Nemec-Piguet
monuments historiques celle des sites. Le Conseil d’Etat annonce clairement vouloir réaliser pour Genève les buts auxquels se voue le Heimatschutz15. Il joue d’habileté et de pragmatisme en confiant l’application de la loi au Département des travaux pu-blics16, en faisant ainsi, avant l’heure, un instrument d’aménagement du territoire.
lE classEmEnt
Cette première loi charge le Conseil d’Etat de « veiller à la conservation des monuments, des objets et des sites, ayant un caractère historique, scientifique ou esthétique et classés comme tels » (art.1). Les immeubles et meubles ainsi classés ne peuvent être détruits. Il convient de souligner que plusieurs règles fondamen-tales applicables dès 1920 aux immeu-bles classés le sont encore aujourd’hui : il s’agit de l’obligation d’entretien imposée aux propriétaires, de la participation financière de l’Etat aux frais de conserva-tion, d’entretien et de restauration (art.7) (subvention), du droit d’acquisition d’un immeuble classé par l’Etat (art. 9) (droit de préemption) ainsi que de la possibilité d’expropriation pour cause d’utilité publi-que (art.11)17. Cette dernière disposition a pour base légale le Code civil suisse de 1907, qui octroie aux cantons le droit de li-miter la propriété foncière pour des motifs d’intérêt public, tels que la conservation des antiquités et des curiosités naturelles ou la protection des sites18. La loi de 1920 réglemente également les fouilles archéo-logiques, en conformité avec l’article 724 du Code civil.
Par ailleurs, il est un domaine où le législateur étend considérablement le contrôle de l’Etat : la pose d’affiches, an-nonces et réclames de toutes sortes qui, pour la première fois, peut être interdite, lorsque celles-ci sont contraires à l’esthé-tique ou portent atteinte à la beauté d’un site. Les « ravages de la réclame » étaient dénoncés par le Heimatschutz, au tournant du siècle, comme un des signes néfastes et manifestes de la société de consommation émergente19. En effet, les publicistes de l’époque n’hésitaient pas à placarder d’im-menses affiches sur les surfaces disponi-bles et en particulier sur les murs peu per-cés des châteaux ou des remparts ou dans des sites naturels bien exposés à la vue du public. A Genève, cette mesure est adoptée plusieurs années après que de nombreux cantons eurent légiféré en la matière.
La loi de 1920 instaure une commis-sion, dite des monuments et des sites, composée de neuf membres20, augmentée à onze dix ans plus tard ; son secrétaire porte le titre et exerce la fonction, toute nouvelle, d’archéologue cantonal. Elle est présidée par le chef du Département des travaux publics, département chargé de l’application de la loi. Pour siéger dans la commission, le Conseil d’Etat fera appel à deux personnalités marquantes de l’urba-nisme genevois : Louis Blondel (1885-1967), comme premier archéologue cantonal et secrétaire, qui le restera jusqu’en 1961, et Camille Martin (1877-1928), architecte et urbaniste, directeur depuis une année du bureau du plan d’extension au
3536
27 « Rapport de la Commission chargée d’étudier le projet de loi pour la conservation des monuments et la protection des sites »Annexe du Mémorial du Grand Conseil, 12 juin 1920, p. 398.28 « Projet de loi pour la conservation des monuments et la protection des sites. Rapport du Conseil d’Etat », Annexe du Mémorial du Grand Conseil, Genève, 1920, p. 270.29 Guillaume Fatio, La campagne genevoise d’après nature, illustrations de Fréd. Boissonnas, Genève, 1899.
21 Hoechel quitte le bureau du plan d’extension en 1932, mais restera membre de la commission jusqu’en 1945.22 Camillo Sitte, Der Städte-Bau, Vienne, 1889. Première traduction française : L’art de bâtir les villes, Genève et Paris, 1902. Nouvelle traduction : éditions L’Equerre, Paris, 1980.23 Le groupe comprend : Horace de Saussure, président, Louis Blondel, Henry Baudin, Ernest Odier, Frantz Fulpius, Camille Martin et Maurice Braillard. 24 Camille Martin, « Pour le développement rationnel et harmonieux de Genève », Bulletin de la Société pour l’amélioration du logement, n°9, 1917, p. 90.25 Il s’agit de la première conférence internationale sur la conservation des monuments, organisée par la Société des Nations. La suivante sera la fameuse Charte de Venise (ICOMOS, 1964).26 Victor Horta, « L’entourage des monuments. Principes généraux », ds. La Conférence d’Athènes sur la conservation artistique et historique des monuments (1931), édition établie par Françoise Choay, 2002. Cet architecte belge novateur (1861-1947), qui a construit ses plus fameuses réalisations représentatives de l’Art Nouveau entre 1892 et 1903, était un disciple de Viollet-le-Duc.
La Protection Des sites et Des Paysages : émErgEncE dE la valEur d’EnsEmblE Genève innove donc en introduisant dans la loi de 1920, à côté de la protection des monuments, celle des sites. « Nous estimons que la sollicitude de l’Etat doit s’étendre non seulement à l’histoire, à l’art et à la science (curiosités naturelles, faune, etc.) mais aussi aux ensembles, aux motifs divers qui par leur réunion confèrent à un site, qu’il s’agisse de la ville ou de la cam-pagne, sa beauté et sa valeur. Ces éléments propres aux ensembles, aux paysages seront donc, dans l’ordre esthétique : tout ce qui contribue à la beauté du site, à son aspect général, au respect de ses lignes et de ses monuments, à sa végétation, à ses eaux et à son sol, à l’étendue de sa vue, etc. ; dans l’ordre historique : ce qui fait son importance historique et sa valeur documentaire ; dans l’ordre scientifique : tout ce qui constitue l’intérêt de son exis-tence naturelle passée ou sa vie actuelle (réserves de faune et de flore, documents géologiques, etc.). » 28
Le concept de site figurant dans la loi ne se réfère pas explicitement aux valeurs naturelles ; cependant, à l’examen de la liste des objets classés, on observe que les termes « esthétique », « caractère scientifi-que », « beauté d’un site » énoncés dans le texte légal évoquent non seulement l’archi-tecture, mais également la nature. Toute-fois, en ce début du XXe siècle, c’est surtout comme objet d’une expérience esthétique et artistique que la nature préoccupe les défenseurs du patrimoine. Le paysage, me-nacé par les progrès de l’industrialisation, ne l’oublions pas, a cristallisé les inquié-
tudes du public à la fin du XIXe siècle. L’électricité et la maîtrise de l’énergie hy-draulique, la canalisation des cours d’eau, le chemin de fer, les usines, l’intrusion du tourisme dans les Alpes avec ses palaces immenses, mais aussi l’emprise sur la campagne des quartiers de villas périur-bains, toutes ces transformations, perçues comme autant d’agressions du monde moderne contre les « beautés » du paysage rural et montagnard, ont été à l’origine de la protection du patrimoine bâti et naturel, dans le but de préserver le « visage aimé de la patrie ».
Dans son ouvrage La campagne genevoise d’après nature publié en 1899, Guillaume Fatio, un des fondateurs de la Société d’Art public, explique bien pour-quoi il a voulu confier à l’artiste Fréd. Boissonnas le soin de photographier la campagne genevoise : « … la valeur du présent ouvrage, c’est la reproduction de la nature elle-même […]. C’est à l’artiste de nous révéler les trésors qui s’y trouvent et, en nous les présentant sous la forme de petits tableaux détachés, d’enlever les écailles qui voilent si souvent notre vue ; en nous ouvrant ainsi des horizons nouveaux, il fera d’abord notre éducation et nous préparera ensuite des jouissances nouvelles sans nombre. »29 En fait, pour ce qui concerne les sites, la loi de 1920 ne contient pas de disposition à la hauteur de l’ambition annoncée. La seule et unique mesure de protection, le classement, reste une démarche exclusivement ponctuelle, mal adaptée à la préservation des sites. Albert Bodmer, chef du Service d’urbanis-me du Département des travaux publics, relève, dans les années 1930 déjà, l’ineffi-cacité de la loi de 1920 pour la sauvegarde des beautés naturelles du canton et plaide en faveur d’un nouveau plan de zones arti-culé sur la notion de paysage.30
Département des travaux publics, comme vice-président. Camille Martin qui décède en 1928 est remplacé par Arnold Hoechel (1889-1974), son successeur à la direction du bureau du plan d’extension21.
Très jeune, Camille Martin montre de l’intérêt pour l’urbanisme en tradui-sant en français l’ouvrage de l’architecte viennois Camillo Sitte, L’art de bâtir les villes22. Publié en 1889, ce livre passe pour une contribution capitale relative au débat sur les systèmes modernes d’organisation des villes ; Sitte incite à puiser dans l’étude des ordonnancements urbains du passé des règles propres à guider l’urbaniste praticien. En 1917, Camille Martin crée un groupe « Pour le développement rationnel et harmonieux de Genève », réunissant autour de lui six personnalités, parmi lesquelles Louis Blondel et Maurice Braillard23. Le manifeste qui en résulte pose aux points 7 et 8 deux questions relatives au patrimoine bâti et naturel : « Quelles sont les anciennes agglomérations (ville et faubourgs), les édifices et les quartiers qui méritent d’être conservés en raison de leur importance his-torique, de leur valeur d’art, ou de leur rôle dans le décor urbain ? Quels sont les points de vue, paysages, emplacements remar-quables par leur situation qu’il convient de respecter et d’aménager d’une façon spéciale (bords du lacs, fleuves et rivières, collines, etc.) ? ». Egalement très concerné par la question brûlante du logement social, Camille Martin fonde en 1920 la Société coopérative d’habitation, dont il est le premier président. C’est lui qui met au point les deux lois de 1929, celle sur l’exten-
sion des voies de communication et l’amé-nagement des quartiers ou localités et celle sur les constructions et les installations diverses ainsi que le plan des zones qui lui est annexé24. En assurant la vice-pré-sidence de la Commission des monuments et des sites, Camille Martin y apporte une sensibilité et des préoccupations liées aux questions urbanistiques, sociales et écono-miques : la protection du patrimoine ne se cantonne pas dans les seules valeurs d’art et d’histoire, mais rejoint la problématique du développement et de l’aménagement de la ville et du territoire. Une telle approche revient à considérer le patrimoine dans un processus de mutations et d’adhésions aux besoins de la société. La question de la nécessaire transformation d’un édifice ou d’un quartier et de son adaptation à de nouveaux usages ou à l’évolution des modes de vie se situe au cœur du débat entamé au XIXe siècle, qui opposait déjà Ruskin à Viollet-le-Duc. Comme le relevait Victor Horta à la toute première conférence sur la conservation des monuments à Athènes en 193125, « la vie active de l’ensemble de la ville exige la transformation constante »26.
Au moment de l’adoption de la loi gene-voise sur la conservation des monuments et la protection des sites, les députés avaient d’ailleurs donné un signal dans ce sens en signifiant qu’il faut « conserver, non pas uniquement pour sacrifier à des sentiments de piété nationale, non pas pour glorifier ce qui fut, mais pour donner au présent et à l’avenir des possibilités d’intérêt et de plaisir que notre patrie peut, aussi bien que toute autre, procurer. »27
3738
30 (p.36) Cette information est tirée d’un article d’Elena Cogato Lanza, Le plan des zones du canton de Genève, 1936 : le projet paysager, disponible sur le site internet de la Fondation Braillard architectes.31 Les sites et objets naturels classés sont les suivants : — blocs erratiques : la Pierre aux Dames (1921), les Pierres du Niton (1923), la Pierre à Pény, Versoix (1961), les menhirs de la Pierre aux Dames à Troinex (1966), la Pierre à Bochet à Thônex (1970) ; — arbres : deux chênes à Gy (1927, déclassés en 1954), cinq tilleuls à Cologny (1941), trois chênes à Genthod (1942), deux noyers à Bernex (1947), cinq ifs à la route de Villette à Thônex (1961), trois arbres à Versoix(1962), alignement de chênes à Lancy (1966), un noyer de Californie au chemin de la Florence à Genève (1953, abattu en 1994) ; — sites naturels caractéristiques de la campagne genevoise : les bois au bords de l’Aire (1923,1934,1935), grève du lac à la Belotte (1928), les falaises de Saint-Jean (1929), le coteau du Signal de Bernex (1933, 1935), la Pointe-à-la-Bise (1933), le Signal de Bonvard (1939), les bords de la Drize (1949), les bords de l’Allondon (1952), l’ancienne boucle du Rhône au Moulin-de-Vert (1956), les bords du Rhône à Vernier, occupés par l’ancien domaine de Hauterive (1957, 1975), bois et marais à Choulex (1958), le vallon de l’Aire (1958), site rural et bords de la Seymaz à Choulex (1961), bois à Meyrin à proximité de la cité (1961), mare de la Petite-Grave à Cartigny (1961) ; — parcs : le parc de la Grange pour ses arbres remarquables et les vestiges archéologiques d’une villa romaine (1921) ; en outre, plusieurs maisons de maître entourées de parcs seront également classées.
Les arbres classés de Lancy SMS, Max Oettli
Il est vrai que jusqu’en 1976, la loi pro-tégera essentiellement des édifices ou ob-jets singuliers, à caractère monumental ou exceptionnel. Un seul arrêté de classement est adopté expressément pour un ensemble bâti : la place du Bourg-de-Four et les faça-des qui la bordent (1929). Pourtant, entre 1921 et 1970, 29 arrêtés visant des sites et objets naturels - sur un total de 194, ce qui en représente quand même le 15 % – témoi-gnent de l’intérêt porté à la préservation de la campagne genevoise . En outre, le Conseil d’Etat procède, au coup par coup, à l’inscription au registre foncier de servi-tudes au profit de l’Etat pour assurer la protection de certains sites ; c’est le cas d’un groupe d’arbres à Lancy (1946) (MS-c 113) et du port de la Bécassine à Versoix (1958). Après 1976, la possibilité d’établir des plans de site fait renoncer à l’adoption de mesures de classement pour des sites naturels.
règLements sPéciaUX et PLan Des zones : la loi sur lEs constructions Et lEs installations divErsEs dE 1929 Sans entrer dans un examen détaillé, il convient néanmoins de mentionner, ici, les jalons posés, en matière de protec-tion du patrimoine bâti et des sites, par
la loi cantonale de 1929 réglementant les constructions. Moins de dix ans après son institution, la Commission des monuments et des sites se voit attribuer - pour une courte durée - de nouvelles tâches, qui étendent considérablement son champ d’action. Celles-ci relèvent de la loi sur les constructions et les installations diverses du 9 mars 1929, élaborée par le bureau du plan d’extension, dirigé par Camille Martin, vice-président de ladite commis-sion. Ainsi, sur la base du préavis motivé de la Commission des monuments et des sites, le Département des travaux publics « peut interdire, ou n’autoriser que sous réserve de modifications, toute nouvelle construction qui, soit par ses dimensions, soit par sa situation, soit par son aspect extérieur, peut nuire au caractère ou à l’intérêt d’un quartier, d’une rue ou d’un chemin, d’un site naturel ou de points de vue accessibles au public » (article 3), ceci dans n’importe quel lieu du canton. Dans les mêmes circonstances et en poursuivant le même but, le Conseil d’Etat peut adopter des règlements spécifiques, qui fixent des hauteurs de construction différentes de celles qui sont prescrites par la loi (article 12). C’est sur cette base légale, par exem-ple, que les premières mesures sont prises en 1930 « en vue de conserver le caractère des quais et l’aspect de la rade »32. En 1934, ces compétences attribuées à la commis-sion des sites, qui sortaient du cadre de la loi pour la conservation des monuments et la protection des sites, lui sont retirées et transférées à la commission d’urbanisme
3940
carte postale de l’ensemble De Budé, années 1960 SMS
Détail montrant la maison de maîtres du Xviiie
SMS
32 (p.38) Plan d’aménagement adopté par le Conseil d’Etat le 27 mai 1930 (plan n° 1150-247), appliqué aux constructions sises entre les actuelles places du Rhône et du Port (quai du Général-Guisan). La hauteur des corniches et du faîte ainsi que le nombre de niveaux sont fixés. Toute démolition et toute demande d’autorisation de transformer et de construire doivent être soumises au préavis de la Commission des monuments et des sites. Un autre règlement spécial, limitant notamment les hauteurs des bâtiments, sera adopté le 6 novembre 1935 pour les immeubles du quai Gustave-Ador (plan n° 4198-259). 33 Loi instituant une commission d’urbanisme et modifiant certaines dispositions de la loi sur les constructions et installations diverses du 9 mars 1929, de la loi sur l’extension des voies de communication et l’aménagement des quartiers et localités du 9 mars 1929, et de la loi sur les routes, etc., du 28 mars 1931, adoptée le 2 juin 1934, Mémorial, 1934.34 Proposition pour l’introduction du système des zones dans le projet de loi sur les constructions en discussion au Grand Conseil, présenté par les sociétés d’Art public, de l’Amélioration du logement et d’Utilité publique, Genève, février 1914. Un premier découpage du canton en deux zones est introduit dans la LCI du 6 avril 1918.
nouvellement créée.33 Si ces règlements permettent de contrôler les gabarits, le caractère architectural, le genre et la destination des bâtiments, ils ne peuvent statuer sur le maintien des édifices, que seul le classement est en mesure d’imposer.
A la LCI de 1929 est annexé le premier véritable plan des zones de construction du canton, réclamé depuis longtemps par plusieurs associations, dont la Société d’Art public. Cet instrument paraît indis-pensable pour sauvegarder le bon aspect des constructions, en ville, dans la ban-lieue et dans la campagne, tout en tenant compte des nécessités pratiques et des conditions hygiéniques et esthétiques34. Le plan de 1929 fixe cinq zones, plus une zone industrielle, dans lesquelles des construc-tions peuvent être édifiées conformément au contenu de la loi. Il comprend, en outre, des surfaces de bois et forêts ainsi que de vastes secteurs hors zones de construc-tion, sans toutefois que la loi ne précise les mesures qui y sont applicables.
Le souci de préserver le caractère des quartiers est exprimé pour la première fois dans la LCI de 1929 en accordant au Conseil d’Etat un pouvoir dérogatoire dans ce but. De plus, le découpage du canton en cinq zones de construction tend à reconnaître certaines particularités du paysage bâti : ainsi, la quatrième zone, qui comprend les terrains situés en bordure de quelques artères de grandes communica-tions (Chêne-Bourg, Chêne-Bougeries), la partie ancienne de Carouge et les agglo-mérations rurales est réservée à de petites maisons locatives, empêchant l’explosion des gabarits des décennies précédentes
et limitant la pression foncière. Hormis ces dispositions générales, le texte légal ne contient aucune règle de protection des bâtiments eux-mêmes. Au début du XXe siècle, le Conseil d’Etat, usant du pouvoir accordé par le législateur, prend plusieurs mesures applicables aux quartiers de la vieille ville de Genève. Dès 1920, il classe un nom-bre élevé d’édifices, - sur la rive gauche uniquement, à l’exception de l’église de St-Gervais - et promulgue, en 1929, un arrêté « en vue d’assurer une protection convenable du caractère architectural de la vieille ville », dont le périmètre englobe tous les quartiers intra muros. A vrai dire, la « protection » se limite à exiger l’adoption préalable d’un plan d’aménagement pour toute démolition-reconstruction. Mais la dynamique urbaine impose sa pression : abandonnant Saint-Gervais aux projets de modernisation de la rive droite, le Conseil d’Etat - Braillard est alors à la tête du Département des travaux publics - adopte, le 4 juillet 1934, un règlement de construc-tion qui restreint le périmètre d’applica-tion au seul secteur de la « Haute Ville », sur la rive gauche. Ce règlement prévoit le maintien des gabarits en cas de démoli-tion-reconstruction, l’harmonisation avec « l’architecture ambiante », l’assainisse-ment des îlots et le contrôle de la publicité qui ne doit pas nuire à l’esthétique du quartier.
Avec la loi de protection de 1920 et cel-le sur les constructions de 1929, l’ébauche des deux grands axes de la protection du patrimoine bâti et naturel est tracée : celle des objets dans leur matérialité, d’une
4142
40 Sur les démolitions, transformations et la mise en place de mesures de protection à Carouge, voir Leïla el-Wakil, Sabine Nemec-Piguet et Pierre Baertschi, « La fatale ignorance des plans royaux » dans Carouge, édité par la Ville de Carouge, Carouge, 1992, p. 301 et ss ; sur les modifications du périmètre protégé, voir ibidem p. 318. Sur la démolition des îlots intra muros voir « Rénovation urbaine, le cas de Genève », Werk- Archithèse, n° 15-16, 1978 ; sur l’évolution des dispositions légales dans la vieille ville de Genève, voir Sabine Nemec-Piguet, « La sauvegarde de la vieille de Genève » dans Patrimoine et architecture n°14-15, décembre 2005, Direction du patrimoine et des sites, Département de l’aménagement, de l’équipement et du logement. 41 Sur la protection des villages, voir : Jacques Revaclier, « La protection des villages en droit genevois », dans Revue de droit administratif et de droit fiscal et Revue genevoise de droit public, N°6, 1974.42 Projet de loi modifiant la loi sur les constructions et les installations diverses du 27 avril 1940 et prévoyant la protection des villages de la campagne genevoise et de leur zone d’expansion, Mémorial, 1959, p. 660.43 Loi sur les constructions et les installations diverses du 25 mars 1961, article 176. Cet article, dont le contenu n’a pas changé, a pris le numéro 106 après la révision de 1988.
35 A. Bodmer, dans Elena Cogato Lanza, op. cit.36 Recueil authentique des lois et actes gouvernementaux de la République et Canton de Genève, 1934, p. 105.37 Loi du 19 décembre 1952.38 Une nouvelle révision de la LCI interviendra le 14 avril 1988.39 Article 11, alinéa 9 de la loi sur les constructions et les installations diverses (L 5 1) du 25 mars 1961, « Zones protégées », dans Recueil authentique des lois et actes du Gouvernement de la République et Canton de Genève, fascicule n°4, avril 1961, p.222. Lors de la révision de la LCI en 1940, le plan des zones de construction comprenait pour la première fois « une zone spéciale pour la haute ville et le vieux Carouge » dont le régime applicable à ces deux régions devait faire l’objet d’une loi parti- culière (article 13 alinéa 13) . Le règlement de la Haute Ville de 1934 devint alors une loi spéciale, qui, elle-même, sera intégrée à la loi sur les constructions et les installations diverses lors de sa révision en 1961, sous le chapitre « Zones protégées », tout comme la loi de protection du vieux Carouge adoptée en 1950.
l’état sanitaire des quartiers insalubres, la modernisation des habitations anciennes, l’adaptation des rues aux exigences de la circulation automobile sont des préoccu-pations constantes qui guident, dès la fin du XIXe siècle, les choix des autorités en matière d’aménagement du territoire et de protection du patrimoine. Ainsi, initiale-ment dimensionné pour englober l’entier des îlots anciens édifiés à l’intérieur des fortifications sur les deux rives du Rhône, le périmètre de protection de la vieille ville de Genève est considérablement réduit, au moment de l’adoption des zones protégées en 1961. Il en est de même pour le vieux Carouge40.
Les villages, petites localités rurales placées en quatrième zone en 1929, sont également inclus dans une zone protégée à partir de 196141. Au cours des années cin-quante, la forte croissance de la popula-tion a quelques conséquences sur les villa-ges qui voient surgir des immeubles d’une architecture sans qualité. De deux étages sur rez-de-chaussée - conformément aux gabarits légaux - leur volumétrie, mais aussi les programmes de logement collec-tif et leurs habitants citadins détonnent dans un environnement rural relativement intact, encore composé de fermes et de granges. Alors qu’à la même époque, Ge-nève déclasse sa zone agricole pour édifier les cités satellites de Meyrin et Onex, des associations de sauvegarde, appuyées par la Commission des monuments et des sites s’engagent pour la défense des villages anciens, exprimant leurs vives critiques face aux interventions qui en bouleversent l’esthétique, comme à Meinier, Anières,
Bernex ou Chancy, exemples cités dans le rapport accompagnant le projet de loi pour la protection des villages de 195942.
Les périmètres de protection, qui ont tous été adoptés entre 1961 et 1962 ( !), sont tracés sommairement et ne tiennent souvent malheureusement pas compte des caractéristiques morphologiques des lieux. La loi délègue au département la tâche de fixer, dans chaque cas particulier, les règles d’intervention, à savoir « l’im-plantation, le gabarit, le volume et le style des constructions à édifier, de manière à sauvegarder le caractère architectural et l’échelle de ces agglomérations ainsi que le site environnant »43. Paradoxalement, la zone dite « protégée » ne protège pas formel-lement les bâtiments qui composent le vil-lage. Alors que le projet initial distinguait clairement les objectifs de protection, de sauvegarde, de reconstructions ou de constructions neuves, les députés adoptent une loi qui reste imprécise, par crainte de figer la situation existante et d’assister à un abandon des vieilles bâtisses. En fait, le Grand-Conseil a adopté la loi cadre fixant la zone protégée et a délégué au Conseil d’Etat la mise en œuvre de mesures d’application, telles que plan d’aménagement ou règlement de construc-tion, classement, inscription à l’inventaire, puis, à partir de 1976, plan de site. Dans les années 1970 et 1980, de nombreuses communes mettent en place des ins-truments de planification qui prennent parfois la forme de plans directeurs, de plans d’aménagement ou de règlements de construction. Ceux-ci imposent des
part, et celle du caractère des quartiers, ensembles et sites naturels d’autre part. Ensuite, la législation va se compléter et se complexifier au fur et à mesure. Les étapes majeures interviennent en 1961, avec l’in-troduction du concept de zones protégées dans la LCI, et en 1976, avec la nouvelle LPMNS.
1961 :La Loi sUr Les constrUctions et Les instaLLations Diverses (Lci) : lEs zonEs protégéEs Dès les années 1930, le souci de la sauvegarde des paysages a orienté les ré-flexions sur le « zonage » du canton. Dans le plan des zones de 1936, le territoire gene-vois est interprété comme une composition de « paysages », chacun ayant son caractère propre. Les villages, par exemple, y sont considérés comme des « sites à classer » qui, « ouverts sur des horizons admirables, devraient garder leur caractère actuel intact »35. Il est certain que le plan des zo-nes de construction qui, en 1961, reprend les dispositions adoptées antérieurement comme la zone de bois et forêt, constituée en 193436 et la zone agricole en 195237, a limité la dispersion des constructions et, de ce fait, contribué de manière significa-tive à la protection du paysage genevois. L’application de ces mesures d’aménage-ment du territoire, complétées par diver-ses lois spécifiques telles celles sur les forêts (1954) et sur les eaux (1961), a eu des résultats manifestes sur la préservation de
la campagne, effets d’autant plus remar-quables que la croissance de la ville exerce une pression constante sur un territoire cantonal très exigu.
La LCI élaborée en 1929 est entière-ment revue en 196138. Le concept de « zones protégées » y est alors introduit : « Les zo-nes de la vieille ville, du vieux Carouge, de même que celles des villages protégés font l’objet de dispositions particulières qui ont pour but la protection de l’aménagement et du caractère architectural des quartiers et localités »39. La distinction entre « zones de protection » et « zones de construction » clarifie les objectifs de la sauvegarde, d’une part, et du développement, d’autre part : la vieille ville, le vieux Carouge et les villages de la campagne genevoise sont désignés comme les sites bâtis constitutifs du patrimoine historique cantonal. Les zo-nes protégées seront étendues, entre 1973 et 1983, à une partie des quartiers fazys-tes édifiés à l’emplacement des anciennes fortifications et aux ensembles urbains du XIXe et du début du XXe siècle.
La mise en place des dispositions lé-gales destinées à protéger les quartiers et localités ne s’est pas faite en une fois. Bien au contraire ! Soumise aux pressions des constructeurs et urbanistes, d’une part, et aux émois des défenseurs des valeurs historiques, d’autre part, la conservation des ensembles bâtis suscite de nombreux débats. Au fil des années, les pouvoirs publics choisissent une voie médiane, oscillant entre la démolition des îlots vétustes pour moderniser la ville et la sau-vegarde des sites historiques pour conser-ver la mémoire du passé. L’amélioration de
4546
44 P.L. Cervellati, R.Scannavini, C.de Angelis, La nouvelle culture urbaine, Bologne face à son patrimoine, Paris, 1981. Première édition : Mondadori Editore, Milano, 1977.45 Sur l’approche typo-morphologique, voir Sabine Nemec-Piguet, « Pour une nouvelle culture urbaine », Patrimoine et architecture, n°14-15, Genève, décembre 2005.
Le quartier de la tour 1964 CIG, Jean Gottraux
densités, souvent basses (0.2 et 0.5 selon les secteurs) et des gabarits d’un étage sur rez-de-chaussée, inférieurs aux dix mètres à la corniche de la 4ème zone rurale. Contrairement à la loi sur la protec-tion des monuments, les mesures inscrites dans la LCI ont initialement eu pour but le respect du caractère des quartiers et localités et non le maintien des édifices qui les composent. Elles sont un héritage de l’esprit des lois des années vingt. Un tel principe n’est modifié qu’en 1981, lors-que le législateur introduit, pour la zone protégée de la vieille ville et du secteur sud des anciennes fortifications, le maintien des bâtiments comme une règle générale, les démolitions devenant des dérogations. Il en va de même avec la loi de protection des ensembles du XIXe et du début du XXe siècle, adoptée en 1983 et figurant dans la LCI au chapitre des zones protégées (LCI, articles 89 et suivants). Cette disposition légale a longtemps été appelée « loi Blon-del », du nom de son auteur, Denis Blon-del, fils de Louis, le premier archéologue cantonal et premier secrétaire de la CMS. Aucune modification n’est apportée à la zone protégée des villages.
1975 : La « Protection intégrée »
Depuis le milieu des années 1960, le Conseil de l’Europe travaille à la mise en œuvre d’un programme de sauvegarde du patrimoine architectural européen. Plusieurs réunions et conférences ont pour but d’éveiller l’intérêt des populations. A cette fin, l’année 1975 est déclarée « Année européenne du patrimoine architectural » ; l’accent est très nettement mis sur la sau-vegarde, la restauration et la mise en va-leur des ensembles bâtis, en particulier les
villes et les villages. Dix ans après l’adop-tion de la Charte de Venise par l’ICOMOS (1964), qui marque durablement de son esprit les méthodes de conservation et de restauration des monuments historiques, la campagne de sensibilisation lancée par le Conseil de l’Europe produit des effets significatifs sur le développement urbain européen.
Cette campagne veut promouvoir de nouvelles politiques de défense du patri-moine, qui ne doivent plus se limiter à la conservation de quelques monuments exceptionnels, mais qui, s’inscrivant dans une approche globale du développement urbain, doivent concourir à élever la qua-lité du cadre de vie. Elle rejoint un courant de pensée très critique de l’urbanisme issu du mouvement moderne, qui veut encoura-ger la réhabilitation des quartiers histori-ques, à l’exemple de l’expérience réalisée à Bologne, au début des années 197044. La ville du passé, redécouverte grâce aux études typo-morphologiques des univer-sités italiennes45, symbolise les valeurs d’une société qui semblent s’être perdues dans l’anonymat des grands ensembles de l’après-guerre. Toutefois, le respect des formes bâties anciennes a pour corollaire leur adaptation aux modes de vie moder-nes. Ainsi le concept d’une protection dite intégrée doit-il encourager la conservation du tissu urbain ancien tout en favorisant l’apport d’une architecture contemporaine. Les espaces libres, jardins, parcs, places, qui composent la ville doivent également être préservés. La conférence internationale prépa-ratoire à l’Année européenne du patri-moine architectural se tient à Zurich en juillet 1973 ; elle réunit plus de trois cents délégués de vingt-huit pays européens. Le Conseil fédéral invite, dès le début, les
4748
50 Programme de mise en valeur des monuments et des sites du canton de Genève, juin 1968, Département des travaux publics, République et canton de Genève.51 Projet de loi sur la protection des monuments, de la nature et des sites (Proposition du Conseil d’Etat). Exposé des motifs. Mémorial 1974, p. 3243.
46 Année européenne du patrimoine architectural 1975, Informations et propositions, Comité national suisse, 1974.47 Les seules modifications apportées l’ont été en 1922 et 1930 (voir note 8).48 Loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites.49 Le canton de Vaud est le premier en Suisse à avoir institué, dans son administration cantonale, « un poste de chef de service comportant les fonctions d’Archéologue cantonal », à l’article 2 de la Loi sur la conservation des monuments et des objets d’art ayant un intérêt historique ou artistique du 10 septembre 1898. Neuchâtel le fera en 1904. Toutefois, la majorité des servi- ces cantonaux helvétiques seront créés après la Deuxième Guerre mondiale.
service de l’administration cantonale, lui préférant le seul exercice d’une commis-sion d’experts. Les nouvelles dispositions légales, en élargissant considérablement les instruments de protection, imposent une redéfinition de leur mise en applica-tion : à la demande du Grand Conseil, elles seront accompagnées par la création d’un service de l’Etat rattaché au DTP, le Ser-vice des monuments et des sites.
L’élaboration de la nouvelle loi est laborieuse : il faudra six ans d’études et de nombreux amendements à la commission parlementaire pour qu’elle soit finalement adoptée. Or, depuis le 1er juillet 1966, la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage (LPN) définit clairement les responsabilités des cantons. Aussi, en octobre 1970, le Conseil fédéral adresse-t-il une note aux gouvernements cantonaux au sujet de l’organisation et du financement de la protection de la nature et du paysage à l’échelon cantonal. La même année, les conseillers d’Etat, Jaques Vernet, à la tête du DTP, et Gilbert Duboule, à la tête du département de l’Intérieur, forment un groupe de travail pour étudier une révision de la loi de 1920, en réponse à la demande des milieux de protection de la nature et à la CMS50.
« Au fil du temps, le cercle des biens dignes de protection, et dont la sauvegarde revêt un caractère croissant d’intérêt général, s’est considérablement élargi pour s’étendre à de nouvelles composantes du patrimoine commun que menacent ou détruisent les nuisances de notre société. L’augmentation de la population, le déve-loppement des villes, l’accroissement des zones d’activité, l’extension des voies de communication, etc., soit en substance l’utilisation toujours plus dense du sol, lè-sent l’intégrité des sites. Ce phénomène est particulièrement sensible dans notre can-
ton dont le territoire fort exigu abrite une agglomération en expansion »51. C’est par ces mots qu’en novembre 1974, le Conseil d’Etat soumet enfin le projet aux députés qui, tous partis confondus, l’attendent avec impatience. Le contexte international est propice à la sauvegarde du patrimoine, puisqu’en 1970 est célébrée l’année euro-péenne de la conservation de la nature et en 1975, celle du patrimoine architectural, dont nous avons parlé plus haut.
La nouvelle loi entend remédier aux manques de la loi de 1920. Elle augmente et diversifie les moyens d’action des pou-voirs publics en instituant des mesures mieux adaptées à la sauvegarde des en-sembles et sites bâtis et naturels. Ainsi, le classement est complété par deux mesures supplémentaires : l’inscription à l’inventai-re des immeubles dignes d’être protégés et le plan de site, instrument applicable aux sites bâtis et naturels. Enfin, les valeurs naturelles - la faune et la flore - et non plus seulement paysagères occupent une place reconnue. Le nombre de membres de la commission, qui prend le nom de Commis-sion des monuments, de la nature et des sites (CMNS), est porté à dix-neuf, parmi lesquels se trouvent des représentants des partis politiques siégeant au Grand Conseil, des communes et des associations d’importance cantonale auxquelles les députés ont souhaité attribuer la qualité pour agir dans le domaine d’application de la loi. Les deux départements qui ont initié la loi sont responsables de son application. Des moyens financiers sont accordés afin de réaliser les buts de la loi, par la création d’un fonds cantonal des monuments, de la nature et des sites. Ce fonds sera complété en 2002 par une ligne de crédit de 20 mil-lions destinée à encourager la restauration de bâtiments d’habitation dignes d’intérêt (article 42A et suivants de la LPMNS).
gouvernements cantonaux à participer ac-tivement à l’évènement. Il met sur pied un comité national chargé de l’organisation de la manifestation, dont le secrétariat est confié à la Ligue suisse du patrimoine national (Heimatschutz). Par la voix du chef du département de l’intérieur, Hans-Peter Tschudi, il annonce clairement quel patrimoine doit être sauvegardé : il s’agit « moins de monuments dont l’importance n’est pas contestée, que d’édifices plus mo-destes dont la position, dans la silhouette du village et de la ville, surpasse souvent de beaucoup leur importance artistique et architecturale46 ». Il décrit également les qualités qu’une localité historique peut offrir à « l’homme moderne » : « un cadre de vie qui, au temps de la normalisation et des ordinateurs, porte encore la marque de la main d’œuvre humaine », un cadre propre à favoriser les liens sociaux et familiaux, contrairement aux immeubles locatifs anonymes. De son côté, la Confé-rence demande à tous les pouvoirs locaux de s’assurer que la responsabilité de la sauvegarde de l’héritage du patrimoine culturel devienne partie intégrante de l’aménagement et du développement com-munautaires.
Plusieurs actions sont exposées, qui deviendront des pratiques courantes des politiques de protection du patrimoine, telles que dresser un inventaire des en-sembles historiques ; les intégrer dans la planification générale de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme ; dégager des fonds publics pour soutenir les dépen-ses des particuliers ; sensibiliser le public ; améliorer les bases légales ; prendre en compte les aspects sociaux pour conser-ver dans les centres anciens la population existante ; à cet effet, accorder des aides financières publiques à la restauration
des immeubles anciens analogues à celles consenties en faveur de l’habitation nou-velle ; préserver les centres anciens des excès du trafic automobile et favoriser les zones piétonnes ; reconquérir l’espace ur-bain au bénéfice de l’homme par la conser-vation, la restauration et la revalorisation des ensembles anciens. Cette conférence intervient à un tour-nant des conceptions de l’aménagement et du développement des villes européennes, soulignées par une prise de conscience des valeurs de la ville ancienne. Elle définit la nécessité d’intégrer sa sauvegarde dans les objectifs de la planification territoriale. A titre d’exemple, de tels changements se manifestent à Genève par l’abandon, ex-primé dans le plan directeur de 1975, des voies urbaines express le long de la rade ou dans la sauvegarde des quartiers des Grottes et de Coutance.
1976 : La Loi sUr La Protection Des monUments, De La natUre et Des sites
La loi de 1920 est appliquée sans mo-dification majeure47 jusqu’en 1976, où elle est alors remplacée par LPMNS, toujours en vigueur aujourd’hui. Une fois de plus Genève est à la traîne par rapport à l’évolu-tion de la pensée et des pratiques. Neu-châtel a révisé sa loi en 1964, le canton de Vaud en 196948. En France, la loi Malraux sur les secteurs sauvegardés date de 1962. Genève est aussi le dernier canton suisse à se doter d’un service cantonal de protection du patrimoine49. Jusque là les députés genevois ont repoussé l’idée de confier l’application de la loi sur la pro-tection des monuments et des sites à un
4950
53 Mémorial, 1976, p. 192252 Mémorial, 1976, p. 1903.
Hôtel de la métropole, vers 1960CIG
rénovation de l’hôtel de la métropole 1976 CIG
en complément à la zone protégée. Malheu-reusement, le Conseil d’Etat s’est arrêté dans son élan après avoir adopté les plans de site d’Hermance en 1979 et de Dardagny en 1981. Au cours des vingt ans qui sui-vront, aucun autre village ne bénéficiera d’une telle réglementation.
lE rEcEnsEmEnt
La connaissance est nécessaire pour opérer des choix et décider ce que notre so-ciété souhaite transmettre aux générations futures. Dresser des inventaires et recen-ser le patrimoine qui mérite protection est donc une des tâches essentielles de toute politique de protection du patrimoine. De-puis un quinzaine d’années, le Service des monuments et des sites a développé des recensements qui ne portent pas unique-ment sur la valeur intrinsèque de l’objet mais qui prennent en compte le contexte dans lequel il se trouve. Les recensements sont un instrument de la planification urbaine et de l’aménagement du territoire. Bien qu’il ne dispose pas de base légale, le recensement est un instrument essentiel pour l’application d’une politique de pro-tection du patrimoine.
BiLan Depuis les premières mesures de classement prises par l’Etat pour assurer la sauvegarde des monuments et du paysage et préserver « le visage aimé de la patrie », le sens du mot « patrimoine » a pris une extension considérable, allant bien au-delà de l’appellation initiale de « monuments his-toriques ». Cette évolution est particulière-ment sensible dans le dernier quart du XXe siècle. En fait, la notion même de paysage qui mobilise, pour sa défense, l’opinion publique de la fin du XIXe siècle comporte déjà une dimension bien plus vaste que ne l’autoriserait l’attention portée aux seuls monuments.
Contrairement aux intentions initiales de la loi, la procédure d’inscription à l’in-ventaire autorise le propriétaire à recourir contre la décision du département, ce qui alourdit considérablement l’acte adminis-tratif. Par conséquent, elle n’a pas permis de dresser l’inventaire général espéré qui aurait pu fonctionner comme une démar-che préparatoire. Ainsi, en 30 ans, des campagnes systématiques d’inscription à l’inventaire n’ont été effectuées que dans seize communes sur les quarante-cinq que compte le canton !
lE plan dE sitE
Pour la protection de la nature et des sites, la nouvelle loi permet de complé-ter le régime des zones protégées, exis-tant dans la LCI, par deux propositions : d’une part diverses mesures générales de protection édictées par le Conseil d’Etat, d’autre part - c’est là toute l’innovation de la loi - l’adoption de plans de site, instru-ment analogue au plan d’aménagement mais poursuivant un but de protection. Ces plans s’appliquent autant à des sites naturels qu’à des sites bâtis. Un député relève que « c’est là un progrès qui va dans le sens de l’évolution logique des notions contemporaines de l’urbanisme par la pro-tection de l’environnement et l’intégration de l’architecture dans un complexe bâti »53. Cette disposition particulièrement bien adaptée à la sauvegarde des ensem-bles bâtis intervient à un moment où la population s’inquiète de démolitions dans les quartiers historiques de la ceinture fa-zyste, du rond-point de Rive ou des quais, comme celle de l’ancien Hôtel de Russie. La menace qui pèse sur l’hôtel de la Métro-pole a un impact déterminant. Aussi, le premier plan de site adopté par le Conseil d’Etat le 20 décembre1978, moins de deux ans après la promulgation de la LPMNS, a pour but la protection de la rade. Le plan de site apparaît également comme un moyen adéquat pour protéger les villages,
l’inscription à l’invEntairE
Le classement est perçu comme une mesure rigide, destinée principalement à un patrimoine monumental ou exception-nel. Les députés souhaitent mettre en œu-vre une politique de protection plus souple et plus dynamique, qui puisse s’appliquer à des domaines beaucoup plus étendus et contribuer à la sauvegarde du cadre de vie, davantage qu’à celle d’une collection d’ob-jets singuliers. Dans cet esprit, l’établisse-ment d’un inventaire général doit favoriser une action préparatoire à la conservation des monuments historiques, sans entrer formellement dans une procédure de clas-sement. « Pour tout objet digne d’intérêt, l’auto-rité peut prendre des mesures conservatoi-res en cas d’atteinte ou de danger immé-diat. Mais, la protection réelle commence par l’inscription d’un objet à l’inventaire. La notion nouvelle d’inventaire est de nature à pallier les inconvénients du classement. En effet, aujourd’hui, très peu d’objets sont classés, à cause de la rigidité de cette mesure et de la lourdeur admi-nistrative de la procédure qui y conduit. L’inscription à l’inventaire est au contraire un acte simple, rapide, qui n’offre pas de possibilité de recours52 », la nécessité de classer ces immeubles n’intervenant qu’en cas de menace. A partir de l’année 2000, une modification importante est apportée à la loi : les immeubles inscrits à l’inven-taire sont désormais maintenus (LPMNS, art. 9). Ce changement vient en fait confir-mer l’interprétation qui en a été faite en 25 ans d’application de la loi. Les travaux de restauration et de transformation ont, en règle générale, été exécutés dans le respect des qualités historiques et architecturales des bâtiments et en suivant les recomman-dations de la commission et du Service des monuments et des sites. Ainsi, aucun bâtiment inscrit à l’inventaire n’a dû être classé pour contrer une éventuelle démo-lition.
4152
54 Voir Diana Le Dinh, Le Heimatschutz, une ligue pour la beauté, op. cit., p. 23.
Comme certains députés l’ont déclaré au moment de l’adoption de la LPMNS, les meilleures lois ne sont rien sans une politique qui en règle l’application. C’est donc sur le terrain qu’il faudrait mesurer les succès et les échecs de près d’un siècle d’application des mesures de protection du patrimoine à Genève. Il serait impor-tant d’étudier et d’évaluer les effets sur l’utilisation de l’espace et l’usage du sol, à l’échelle de la ville, de certaines mesures comme la création des zones protégées ou la limitation de la circulation automobile dans des rues héritées du tissu médiéval. A l’échelle du canton, Genève peut s’enorgueillir de la préservation de sa campagne. On le doit à une politique rigou-reuse d’aménagement du territoire et en particulier de contention des zones à bâtir et de respect de la zone agricole. Il faut, à cet égard, saluer les choix politiques des années cinquante, qui ont privilégié la création de cités nouvelles, à la périphérie de la ville, comme solution à la croissance urbaine. Plus délicate est la sauvegarde des villages. La « rurbanité », néologisme qui conjugue rural et urbain, caractérise aujourd’hui la campagne aux abords des métropoles. Chemins, forêts, cours d’eau sont les lieux de détente des citadins, les anciennes fermes leurs habitations. C’est tout le mode de fonctionnement villa-geois ancestral qui est remis en cause, la pression foncière s’exerce sur les granges désaffectées, les espaces de cours, de jardins, d’anciens vergers. Les grandes parcelles sont morcelées et occupées par des villas groupées. Des villages comme Satigny n’ont plus d’ancien que quelques mas le long de la rue principale. En 1959, les associations de sauvegarde alarmées proposent pour les villages la création de zones protégées. Le Grand Conseil y ré-pond très rapidement. Mais l’évolution des modes de vies prend une telle ampleur que les mécanismes de transformation sont difficilement compatibles avec la conser-vation de la substance historique.
En ville, à partir des années 1980, grâce à leur intervention dans les opéra-tions de « sauvetage » des quartiers histo-riques, comme aux Grottes et à Coutance, les pouvoirs publics se sont efforcés d’y maintenir du logement à loyer modéré afin de limiter la tertiarisation du centre amor-cée au cours des décennies précédentes. Les mesures de protection des ensembles du XIXe et du début du XXe siècle adop-tées en 1983 sont appliquées avec succès ; elles permettent, dans la plupart des cas, la conservation des typologies d’appar-tements de grande qualité, des décors architecturaux, motifs peints ou sculptés, ferronneries ornementales, concourrant à une qualité urbaine élevée, dont profitent les habitants des quartiers et les citadins en général.
Les zones protégées urbaines, complé-tées parfois par des plans de site, répon-dent bien au double objectif de la protec-tion du patrimoine : préserver la substance bâtie en pratiquant des restaurations et des travaux d’entretien qui respectent les qualités des bâtiments, accorder toute l’attention voulue aux dossiers de transfor-mation, de construction et de démolition pour assurer la préservation des sites.
de vie, la protection du patrimoine, comme celle de l’environnement, est devenue un fait de société.
A partir des années 1890, de nom-breux Genevois célèbrent les beautés du canton et s’inquiètent de leur sauvegarde. Pourtant, les pouvoirs publics ne montrent aucun empressement à mettre en place les lois destinées à leur protection. Il faut la mobilisation répétée de l’opinion publique à l’occasion de démolitions retentissantes pour accélérer l’engagement des autorités. Le retard pris permet de tirer parti des expériences faites ailleurs. Ainsi, au cours des années, un appareil légal très complet, bien conçu est mis en place, s’articulant sur deux dispositifs majeurs : la LPMNS (classement, inventaire, plan de site) et la LCI (zones protégées). Il existe, par ailleurs, de nombreuses dispositions qui complètent ces lois et d’autres qui exercent un effet indirect sur la protection du patri-moine bâti et naturel. En 1976, le législateur a souhaité réunir dans une seule loi, la LPMNS, les mesures de protection applicables au pa-trimoine monumental, aux sites bâtis, aux paysages et aux milieux naturels, évitant ainsi une sectorisation des problémati-ques. Une seule commission, la CMNS, doit conseiller l’autorité dans l’exécution de ses tâches ; un seul fonds, le fonds cantonal des monuments, de la nature et des sites, permet d’apporter un soutien financier. Ce-pendant, le Grand Conseil n’a pas voulu se départir du pouvoir de contrôle que le « zo-nage » permet d’exercer sur l’aménagement du territoire cantonal et auquel appartien-nent les « zones protégées ». De manière très avisée et certainement innovante, il a mis en mains du Conseil d’Etat un instru-ment d’aménagement du territoire destiné à la protection des sites bâtis, naturels et paysagers, le plan de site, parfaitement adapté à la mise en œuvre d’une politique de protection dite intégrée.
Réservée à ses débuts aux édifices prestigieux, sinon exceptionnels, la pro-tection s’étend aux sites, puis peu à peu à des catégories d’objets plus utilitaires ou à des œuvres plus modestes, qui ont acquis une signification culturelle ou sociale. C’est ainsi, par exemple, que sont dignes d’intérêt, à côté des jardins et des voies de communications historiques, les témoins de la révolution industrielle, manufac-tures, installations ferroviaires, etc. Par ailleurs, la valeur historique se rapporte à des époques de plus en plus proches de la nôtre : la production architecturale ca-ractéristique de la seconde moitié du XXe siècle, dont certains grands ensembles, est désormais concernée. Certes, les paradoxes ne manquent pas. Parmi ces « nouveaux patrimoines », dont on vient d’énumérer quelques exem-ples, se trouvent des réalisations issues de la « modernité » qui ont été, elles-mêmes, dénoncées, vers 1900, par les premières as-sociations luttant contre l’enlaidissement de la Suisse. « Il n’est pas besoin d’une culture bien étendue pour comprendre que les monuments anciens, les travaux d’art de tous genres, les arbres séculaires, les beaux paysages à l’état de nature sont, par ce qu’ils suggèrent, plus doux à contempler que les usines, les poteaux et les chemins de fer », déclarait Marguerite Burnat- Provins dans le premier numéro de la Ligue suisse du patrimoine national, paru en 190654. A vrai dire, le champ des objets dignes d’intérêt croît proportionnellement aux dangers qui les menacent, mais aussi en fonction de la reconnaissance que la so-ciété leur accorde. On ne peut ignorer dans l’attachement aux valeurs patrimoniales la recherche du sentiment d’appartenance à un lieu et à une histoire, ni les vertus morales attribuées à un passé idéalisé qui se confond souvent avec le souvenir de l’enfance. Les valeurs émotionnelles rejoi-gnent les qualités esthétiques et histori-ques. Assimilée à la préservation du cadre
5556
1 Armand Brulhart, « Camille Martin e la versione francese », in Guido Zucconi (dir.), Camillo Sitte e suoi interpreti, Milan, Franco Angeli, 1992, pp. 19-23. 2 Camillo Sitte, L’art de bâtir les villes, Genève-Paris, s.d. [1903], pp. 133.3 Pour le développement rationnel et harmonieux de Genève, Genève, 1917 (extrait du Bulletin de la Société d’Amélioration du Logement, n° 29, 1917, pp. 122-124). 4 La Voix du Faubourg. N° 1. Cahiers d’urbanisme. Organe d’intérêt genevois, Genève 1933. Sur les diverses opérations de Saint-Gervais, voir Armand Brulhart, « Pas de quartier pour St-Gervais ! », in L’autre Genève, Genève, 1992, pp. 91-125.5 Sur les diverses associations ou groupements concernant le patrimoine et leurs fondateurs, voir Raoul Montandon, Genève foyer intellectuel, Genève, s.d. [1950], pp. 117 et 130-133.
cage d’escalier, 44 rte de Frontenexrestauration des faux-marbres: maria greco SMS, Gil Chuat
Le destin des villes reste fragile. C’est l’impression que dégage l’immense litté-rature qui a fleuri dans la seconde moitié du XXe siècle sur la ville et la naissance d’institutions internationales tournées vers la protection des sites et des centres histo-riques. Dans le contexte européen, Genève constitue un cas intéressant.
Partagé au début du XXe siècle entre une petite élite internationale fortement attachée à la tradition calviniste et à son image culturelle et une puissante corpora-tion bénéficiant de capitaux et de crédits importants, le canton de Genève s’est long-temps situé dans une position d’attentisme, pour ne pas dire de méfiance vis à vis du patrimoine et de l’urbanisme. La publication, à Genève et à Paris en 1903, de l’ouvrage de Camillo Sitte sous le titre L’art de bâtir les villes fut principa-lement conçue comme un instrument de combat contre le courant destructeur qui menaçait les centres-villes1. Son tra-ducteur genevois, l’architecte et historien de l’architecture Camille Martin, « adapta » clairement l’ouvrage jusqu’à faire entrer sa propre ville dans la séquence des 106 plans de villes qui constituaient la nouveauté de l’ouvrage. Le contre-exemple de l’art de bâtir les villes est dénoncé laconiquement : « …Chicago. C’est le système des cubes de maisons dans toute leur pureté. Toute pen-sée d’art en est absente »2. Le courant d’Art public qui s’organisait à Bruxelles, à Paris, à Rome s’est défini à Genève autour du plan d’extension de la ville de 1900 et participait à la construc-tion d’une autre vision de la ville et de la campagne. Des ouvrages luxueux cherchè-rent à célébrer, au moyen de « photogra-phies artistiques », les beautés du paysage.
Sur le plan légal, les projets de loi sur la protection du patrimoine avortèrent et ce n’est que vers la fin de la Première Guerre mondiale qu’un second élan d’information et de propagande se manifesta en faveur d’un développement harmonieux de la ville, de la rationalisation3. L’ouvrage de Sitte fut réédité en 1918, un bureau du plan d’ex-tension fut institué avec Camille Martin à sa tête en 1919 et la première Loi pour la conservation des monuments et la protec-tion des sites fut promulguée en 1920. Un pas était franchi, mais l’insuffisance de cette loi se révéla rapidement au regard des grands projets de démolition et reconstruc-tion de l’entre-deux-guerres, simultané-ment sur la rive droite, rive internationale, et dans la Vieille Ville de la rive gauche. La « crise » économique des années 30, en radicalisant les positions politiques, conduisit à une certaine stérilisation de tous les grands projets de rénovation, même si les divers achats et démolitions préparaient les opérations des années 50. Il est assez symptomatique que durant cette période politiquement troublée les réactions d’opposition provenaient d’ar-chitectes et de milieux plutôt proches de Maurras. En 1930, la création du Guet réunit des hommes comme Pierre Guinand ou Jean-Jacques Dériaz en réaction contre le plan de développement de la rive droite, tandis qu’Alfred Chabloz faisait paraître en 1933 son journal La Voix du Faubourg contre la démolition de Saint-Gervais4. En 1937, le Groupement de défense de la Vieille Ville réunit plusieurs personnes du même cercle, tels Pierre Guinand et le patricien genevois Paul Naville, futur président de la Société d’art public, ce dernier allant jusqu’à lancer le mot d’ordre : « Genevois, résistez … ».5
1975-2005trente ans De DéFense DU Patrimoine arcHitectUraL genevois unE évolution lEntEpar armand brulhart Et Erica dEubEr-ziEglEr
5758
6 Braillard, « L’aménagement de la vieille ville », Connaître, 1937, n° 5, pp. 14-15.7 A noter qu’aujourd’hui la Société d’art public a demandé le classement de la « verrue de Chantepoulet », l’ensemble de Plaza-Centre de M.-J. Saugey.
site classé des rives du rhône SMS, Max Oettli
Le Conseil d’Etat à majorité socialiste prit « en date du 4 juillet 1934, un arrêté déterminant une zone spéciale dénommée zone de la Vieille Ville. Cet arrêté prévoit dans la dite zone le maintien des aligne-ments actuels, ou en tout cas impose aux constructions de telles obligations qu’elles impliquent ce maintien ; en outre les trans-formations, reconstructions, etc. doivent s’harmoniser avec l’architecture ambiante, tant au point de vue des volumes qu’au point de vue des couleurs ». L’architecte Maurice Braillard, alors conseiller d’Etat aux Travaux publics, commentait quel-ques années après cette décision : « en agissant ainsi, le Conseil d’Etat de 1934 a procédé selon un principe d’urbanisme logique, adoptant une formule qui de-vrait être employée non seulement pour la vieille ville, mais pour toute la zone de l’agglomération urbaine ».6
On voit par là que la leçon de Sitte et de Martin concernant le maintien des tracés historiques s’imposait alors de manière apparemment contradictoire avec le plan régulateur de 1935 du même Braillard où la sauvegarde de la Vieille Ville apparaît de manière si minimaliste ! Le Seconde Guerre mondiale fut domi-née par une planification générale des vil-les et des campagnes à l’échelle nationale et par les idées de constructions nouvelles, d’assainissement, de « dénoyautage », de « curetage » des centres historiques. Entre 1946, date du retour à Genève de l’ONU, et 1964, date de la Charte de Venise, la situa-tion de la construction fut essentiellement bouleversée par la création de plusieurs cités satellites, Meyrin, première cité sa-tellite de Suisse, Onex, La Gradelle, puis Le Lignon, tandis qu’au centre-ville, trois ty-pes d’interventions se distinguaient assez nettement. Premièrement, à Saint-Gervais, se réalisèrent des opérations longuement préparées mais dont la mise en œuvre rapide et l’architecture ultra-moderne
constituaient un réel bouleversement de l’image du quartier. Deuxièmement, sur la rive gauche, dans la basse ville et sur les bords du Rhône les démolitions-reconstructions, tout en s’apparentant sur le plan architectural aux réalisations de Saint-Gervais, s’inscrivaient dans un pro-cessus différent, celui de la « rénovation diffuse », du coup par coup, pour ne pas dire de « l’excellente spéculation ». Enfin, dans la Vieille Ville, plusieurs opérations de dénoyautage et de reconstruction d’envergure, qualifiées d’assainissement et de réhabilitation alors même qu’elles effaçaient la substance du tissu médiéval, furent réalisées sans heurt et même à la satisfaction générale des contemporains. Les réactions publiques et notables face à ces trois types d’intervention se manifestèrent aussi bien dans la presse que dans des brochures avec leurs échos repérables au niveau politique dans les mémoriaux du Grand Conseil et du Conseil municipal. Pour Saint-Gervais, la vio-lence du vocabulaire utilisé par certains membres actifs de l’Art Public et du Guet contraste avec la redécouverte récente des qualités de l’unique architecte incri-miné : Marc-Joseph Saugey. On y lisait la naissance de termes péjoratifs, presque toujours liés à la vision biologique de la ville, tel la « verrue de Chantepoulet ».7 Dans les Rues-Basses et sur les quais, les manifestations de protestation se concentraient sur la disparition d’un patrimoine important comme l’hôtel de l’Ecu, l’ancienne maison Baszanger, réaction d’impuissance face à l’inéluctable modernité. On peut d’ailleurs expliquer la relative faiblesse des protestations par une certaine convergence des intérêts dans les partis politiques : la gauche, avec ses syndicats, comme dans les années 30, soutenait le progrès, la démolition des tau-dis, l’architecture moderne ; la droite, avec ses entrepreneurs et ses promoteurs,
5960
5162
8 Le Congrès des urbanistes suisses de 1944 tenu à Genève en 1944 a fait reconnaître l’extraordinaire caractère de cette ville neuve, modèle d’urbanisme.9 ICOMOS Bulletin (dès 1971) la revue Monumentum (dès 1967), les sections nationales et les Congrès annuels sont les organes principaux de cette institution. 10 Pierre Braillard fit appel à d’autres architectes pour la mise au point des façades et ceux-ci se livrèrent à une étude plus ou moins approfondie sur une proposition de nouvelle échelle. Cette étude est conservée aux Archives d’Etat de Genève.
maison Bonnet, début XXe
CIG
reconstruction de la maison Bonnet, 1972 CIG
investissait dans une ville internationale ouverte à un marché de plus en plus at-tractif, pour le bénéfice duquel elle souhai-tait le moins d’entraves possibles. Malgré toutes les bonnes intentions affichées par les architectes et leurs affirmations sur le caractère monumental de la Vieille Ville, aucune des opérations effectuées sur le tissu de l’ancienne ville dans les années 40-50 ne répondaient aux exigences de la conservation, comme on le verra ci-dessous. Les architectes eux-mêmes ont ce-pendant travaillé à la reconnaissance de la ville néoclassique de Carouge, qui fut placée sous protection légale dès 19508 ; la protection de la Vieille Ville s’étendit au pourtour de la place du Molard dès 1958 ; enfin, les villages ruraux bénéficièrent d’une zone spéciale de protection dès 1961.
La Charte de Venise, rédigée en 1964 par le Congrès international des architec-tes et techniciens des monuments histori-ques, fut le premier signe d’une réflexion sur le gâchis. Elle peut être considérée comme la première prise de conscience des architectes eux-mêmes de la nécessité de sauvegarder les sites urbains. Il s’agissait d’élargir le champ de la conservation en étendant la notion de monument histo-rique au « site urbain ou rural qui porte témoignage d’une civilisation particu-lière, d’une évolution significative ou d’un événement historique ». Cette conception prenait en compte une partie du patri-moine négligée jusqu’alors, en particulier les ensembles architecturaux mineurs. La prise de position des architectes visait manifestement aussi à donner des occa-sions de travail à toute une partie des pro-fessions du bâtiment, pour les stimuler à améliorer leurs savoir-faire et à maintenir les métiers artisanaux. Elle fut relayée par
la création en 1965 de l’ICOMOS (Conseil international des monuments et des sites), qui prodigua tous ses soins à doter la conservation du bâti de recommandations, de documentation, d’échanges d’expérien-ces et de procédures.9
Premières résistances : lEs associations Il ne suffit pas d’édicter des recom-mandations pour que les habitudes et les processus se modifient. La spéculation urbaine prit une allure de provocation vers la fin des années 1960 en s’attaquant à des ensembles urbains majeurs. C’est ainsi que Pierre Braillard fut à l’origine de plu-sieurs réalisations litigieuses et fortement contestées aussi bien par leur médiocrité architecturale que par l’importance des lieux d’intervention. En s’attaquant à la démolition du premier édifice construit pour James Fazy sur les terrains des anciennes fortifications, soit son hôtel particulier devenu l’hôtel de Russie,il sus-cita un premier scandale.10
A vrai dire, le pari consistant à n’accorder à l’architecture du XIXe siècle qu’un intérêt tout à fait mineur se trouvait contesté dans le climat des années 1968-1969. Il le fut d’autant plus que la popu-lation de la Ville de Genève fut appelée à s’exprimer sur la démolition d’un autre bâtiment du XIXe siècle, inauguré en 1842, le Crédit Lyonnais, démolition jugée abso-lument nécessaire à la reconstruction de la Caisse d’Epargne à la Corraterie. Malgré l’appui de l’Etat et celui de la presse, non seulement le référendum lancé par le parti de droite Vigilance aboutit, mais la population genevoise se prononça en 1969 contre l’achat du Crédit Lyonnais et contre
6364
13 Voir Nadine Bolle, Armand Brulhart, Tita Carloni et al., Pour les Grottes, Genève, Ecole d’architecture de l’Université de Genève, 1979. 14 Jean Rossiaud, « Le mouvement squat à Genève. Luttes urbaines, expériences communautaires, affirmation locale d’une contre-culture globale », Equinoxe (Genève), 2004, no 24, p.103.
11 L’histoire de cette opération particulièrement croustillante n’a pas fait l’objet d’étude historique. On relira avec amusement l’argumentaire publié par A. R., « Le rachat du Crédit Lyonnais rendra service à tous », Journal de Genève, 21 juin 1968 : « […] le Conseil d’État de Genève, qui a poussé très avant l’étude de l’aspect urbanistique, a décidé qu’il devait participer pour un quart, soit deux millions, à la suppression de l’obstacle constitué par l’immeuble du Crédit Lyonnais. […] la Caisse d’Épargne cherchait depuis des années une solution satisfaisante pour son relogement. Cet établissement d’intérêt public a pris une réjouissante extension. […] il lui faut nécessairement pouvoir construire non seulement en profondeur (le maximum d’étages en sous-sol sont prévus) mais également en hauteur. Sur ce dernier point, il y a un empêchement légal à cause de la proximité du Crédit Lyonnais. Si le siège de ce dernier pouvait être démoli, l’objection tomberait du même coup : la Caisse d’Épargne pourrait édifier un immeuble aussi haut que le Crédit Suisse. […] Pour obtenir ce résultat, la Caisse d’Épargne a décidé d’investir, elle aussi, deux millions, soit le quart de la somme nécessaire, pour faire place nette. C’est ainsi que la collectivité pourrait récupérer à son profit pour un prix considérablement moindre que sa valeur un terrain qui servira à dégorger un des nœuds les plus serrés du trafic ». Le verdict des urnes fut assez clair : 8826 non contre 7314 oui.12 Voir Conrad-André Beerli, « Histoire d’une place », et Erica Deuber-Pauli, « L’affaire du Molard », Alliance culturelle romande. Pour notre patrimoine (Genève), no 21, octobre 1975, pp. 115-120 et 121-125. Ce numéro, paru à l’occasion de l’Année européenne du patrimoine architectural, comporte aussi divers articles interrogeant les notions controversées impliquées dans la défense du patrimoine et la rénovation urbaine.
(Le Boulet), à la destruction du quartier des Grottes (l’APAG, Action populaire aux Grottes), à celle des Halles de l’Ile (AS-PSA), à la disparition des immeubles du XIXe siècle du quartier des Pâquis (GAIP), etc. L’API (Association pour la défense du patrimoine industriel) vit le jour dans les mêmes années pour sauvegarder les témoignages de l’industrie, alors en pleine déconfiture. Afin d’opposer une résistance efficace aux puissantes spéculations foncières et immobilières, il importait de réunir non seulement des historiens, mais encore des compétences architecturales, juridique et politique aux côtés d’une population menacée d’expulsion. Le coup d’arrêt de la croissance provoqué par la crise pétro-lière de 1973 fut l’occasion d’une réduction de tous les projets (la Genève de 800’000 habitants) et le début d’une revendication, « construire la ville en ville », qui n’allait pas sans poser de nouveaux problèmes aux défenseurs du patrimoine.
La défense du quartier des Grottes déclencha, à partir de la création de l’APAG en 1975, dix ans de combat.13 Ce quartier ouvrier s’était formé dans les années 1870 à l’arrière de la gare Cornavin. Mais, à cause de sa proximité du centre, il fut l’objet dès 1900 de plusieurs projets de démolition-reconstruction, à la faveur desquels les terrains furent progressive-ment acquis par la municipalité, tandis que les maisons étaient largement laissées à l’abandon. Pourtant, la démesure même du projet de remplacement, imaginé pour implanter près de la gare un quartier de grand standing voué aux affaires, au commerce et au trafic routier, finit par ruiner l’entreprise, même si, au départ, tous les partis présents au Conseil muni-cipal comme au Grand Conseil s’étaient ligués pour l’emporter. L’originalité de
cette lutte urbaine se traduisit aussi par l’engagement de l’Ecole d’architecture et par le développement des premiers squats, jusqu’à « devenir un laboratoire d’action et une lutte symbolique pour les futures gé-nérations d’occupants »14. En fin de compte, une large partie du quartier fut conser-vée, aussi bien sur le plan architectural que sur la plan social et les rénovations proprement dites respectèrent l’échelle des constructions du XIXe siècle. On observe que les habitants continuent aujourd’hui de faire vivre dans les espaces préservés un esprit culturel rebelle. Le cas des Grottes illustre bien la manière dont la défense du logement réussit à focaliser l’attention sur tout un pan de l’archi- tecture modeste du XIXe siècle, avec la possibilité de défendre des ensembles de bâtiments relativement étendus.
1975 : année eUroPéenne DU Patrimoine arcHitectUraL Lorsqu’en 1975, le Conseil de l’Europe, alarmé par la poursuite des destructions dans les centres historiques urbains, décréta une Année européenne du patri-moine architectural, le gouffre existant entre théorie et pratique était immense. La situation genevoise offrait une illustra-tion cruelle de l’incompréhension des valeurs architecturales de la ville par-tagées par tous les décideurs. La plupart des professeurs des écoles d’architecture considéraient encore qu’il n’existait de telles valeurs qu’à Florence, Rome ou Paris. Pour tirer un bilan de l’Année européenne parut en mars 1976 un article retentissant, intitulé « Paisibles démoli-tions »15, qui dressait l’inventaire de toutes
sa démolition.11 Cette victoire représentait sans doute un premier signe du change-ment d’attitude de la population et confir-mait un intérêt nouveau pour l’architec-ture du XIXe siècle.
On retrouve Pierre Braillard dans l’« affaire du Molard » entre 1970 et 1975 à propos de la maison Caille (construite en 1723) et du célèbre café du Commerce. Ici la contestation et la résistance rassem-bla un public populaire qui se voyait dé-possédé d’un lieu d’échanges et de convi-vialité. La place était doublement atteinte par le projet dévastateur de la maison Bonnet (construite en 1690-1698) qui supprimait les logements et des commer-ces aussi prestigieux que Davidoff et la librairie Payot au profit de bureaux et de commerces plus rentables. A priori, tout paraissait jouer en faveur de la conser-vation de cette place historique dominée par l’imposante présence des Halles et où les bâtiments des XVIIe et XVIIIe siècles témoignaient d’une architecture rigou-reuse. L’habileté des architectes fut de se conformer à une loi qui ne tenait compte que de la préservation des façades et non de la substance. Inutile d’exposer ici dans le détail ce qui fut une expérience « ratée » à presque tous les niveaux, un fiasco sur le plan ar-chitectural et un échec pour les défenseurs du patrimoine qui avaient pourtant réussi à récolter quelque 16’000 signatures dans leur pétition et à réunir des opposants al-lant de l’extrême gauche à l’extrême droite.
À distance, les arguments des pro-moteurs et des architectes de l’époque apparaissent comme autant de miroirs aux alouettes, pour ne pas dire de mensonges grossiers. Mais le manque de clarté théo-rique des opposants, dans un débat où se retrouvaient pêle-mêle quantité de notions subtiles, a sans aucun doute profité aux promoteurs et cela malgré l’appui des historiens fortement engagés dans la bataille. En effet, les notions de valeurs esthétique, artistique, architecturale, urbaine, les définitions de style, d’authen-ticité, de rénovation, de conservation, de restauration, d’assainissement, de classe-ment, de protection, sans oublier celle de valeur sociale du lieu, manquaient encore de précision et de nuances suffisan-tes pour démontrer les effets dévastateurs d’une opération purement spéculative.12
Le contexte genevois très particulier des années 1970 explique sans doute le réveil et la mobilisation d’une population jusqu’alors très passive. Lors de la vota-tion fédérale de 1970 sur le droit au loge-ment, la population genevoise se prononça à plus de 70% en faveur du oui, tandis que la majorité du peuple suisse se prononçait pour le non. Néanmoins, forts de l’expérience du Groupement pour la défense du Molard et en dehors des associations de sauvegarde, se créèrent de nombreuses associations de quartier. Formées d’habitants qui dé-fendaient leur espace de vie, leurs immeu-bles, elles allaient successivement s’op-poser aux démolitions du vieux Carouge
6566
immeubles 18—22 rue des grottes, 1 rue de la Faucille, réhabilitation grand, Praplan associés Leïla el-Wakil
22 Ibid., p. 90.23 Armand Brulhart et Erica Deuber-Pauli, « Payez ou partez : hypothèse de réhabilitation dans une ville bancaire », Nos Monuments d’art et d’histoire, No 4, 1984, p. 405-412.24 Jacques Vernet, « L’urbanisation du canton », Actes de l’Institut national genevois, 22. 1978, p. 14.25 Voir en particulier « Une commission contre les monuments et les sites », Domaine public, no 428, 26 janvier 1977, qui accusait ouvertement le président de la CMNS Jean-Pierre Dom de profiter de son siège à la CMNS pour ses propres opérations de démolition-reconstruction : « Dom décidait, en tant que vice-président, une mesure de conservation minimum et engageait les banques à poursuivre en toute quiétude leurs ravages ». Voir aussi Armand Brulhart, « Genève détruit ses grands magasins », Werk-Archithèse, 1977, no 9, p. 43. 26 Hubert de Senarclens, Journal de Genève, 7 février 1978.
15 (p.62) « Paisibles démolitions : Genève, Carouge, Chêne-Bourg », Nos monuments d’art et d’histoire (Berne), XXVII, 2, 1976, pp. 201-215. Le titre provocateur de cet article était emprunté à une exposition réalisée à Kassel en Allemagne dans le cadre de l’Année européenne du patrimoine architectural : Ruhige Zerstörungen. Le séminaire d’histoire de l’art dirigé par Enrico Castelnuovo à Lausanne l’avait remarqué. Parmi les chercheurs qui ont participé à l’établissement du texte, on trouve Conrad-André Beerli, Théo-Antoine Hermanès, Marcel Grandjean, Jacques Gubler, Geneviève Paschoud, Edmond Charrière et les signataires du présent article, qui devaient tous, à divers titres, jouer un rôle dans les années suivantes pour la défense du patrimoine.16 « Paisibles démolitions. Genève, Lausanne et la région », Habitation (Lausanne), 49e année, avril 1976, pp. 10-19.17 « Paisibles démolitions », Tout va bien (Genève), été 1976, pp. 2-7.18 Henri Lefèbvre, Le droit à la ville, Paris, 1968.19 Il est impossible de citer tous les cas importants, comme le référendum pour le sauvetage de l’hôtel Métropole en 1977, où le non à la démolition l’emporta avec plus de 75% des suffrages.20 Paisible sauvegarde, Genève, Département des travaux publics, 1977.21 Gabriel Aubert, « La protection du patrimoine architectural en droit genevois », Revue de droit administratif et de droit fiscal et Revue genevoise de droit public, Nos 1 et 2, 1977, p. 89.
patrimoine dépend moins des règles de droit que d’une volonté politique ferme, d’une organisation efficace et de ressour-ces financières suffisantes ».22 Parmi les nouveautés introduites par la nouvelle loi, il faut néanmoins citer le recensement architectural du canton, destiné à fournir au nouveau service un outil de surveillan-ce et offrant la possibilité d’inscrire à l’inventaire les bâtiments de valeur, ainsi que le plan de site permettant d’étudier et de protéger tout un périmètre. À Saint- Gervais, ce qui restait du noyau histo-rique, menacé de démolition depuis des décennies, objet d’une mobilisation popu-laire, devint un test.23 Jacques Vernet lui-même dut bien l’admettre : « Dans la Vieille Ville, le centre historique est protégé, mais à l’époque, on avait oublié Saint-Gervais, et l’on est en train d’examiner de quelle manière Saint-Gervais pourrait être pro-tégé également à titre de centre historique de la rive droite ».24 Le plan de site finale-ment adopté pour tout un îlot de ce quar-tier se révéla opérant, même si plus d’un quart de siècle devait s’écouler avant la réhabilitation plus ou moins respectueuse des vestiges du tissu médiéval. Ces mesures tardives ne parvinrent pas à enrayer le processus d’une rénova-tion planifiée depuis plusieurs années. La CMNS, où siégeait un historien et un conservateur des monuments, fut en-core l’objet de virulentes attaques qui dénonçaient non seulement son apathie, mais l’accusaient de collusions.25 Ainsi les deux législatures du conseiller d’Etat libéral aux Travaux publics furent-elles catastrophiques du point de vue de la sauvegarde du patrimoine. Après 1975, deux opérations d’envergure défigurè-rent définitivement les Rues-Basses et le
quartier des Bergues. Dans le premier cas, c’est une partie de la Genève médiévale et les grands magasins et cinémas du début du XXe siècle qui disparurent. Tout le flanc sud de la rue de la Confédération au pied de la haute ville, comportant plus d’une douzaine d’immeubles, fut rasé de manière expéditive, sans aucune attention au relevé des bâtiments anciens et sans fouilles archéologiques, alors même que le site constituait un gisement d’exception. Les promoteurs, l’UBS, la SBS, M. Stein, l’Hospice général et la Ville de Genève, pensaient sans doute que le projet des architectes Favre et Guth pour Confédéra-tion-Centre, avec ses faux dômes en métal, voulus par eux comme un hommage aux anciens dômes en bois des rues marchan-des de Genève, une sorte de concession à l’histoire, serait une compensation suffisante. Dans le second cas, c’est encore Pierre Braillard qui se distingua. Le quar-tier de séjour de Dostoïevski, un ensemble néoclassique créé en 1829-1834 sur la rive droite, avec l’hôtel et le pont des Bergues, fut partiellement rasé. L’opération de dé-molition qui comportait non seulement les immeubles à l’arrière du quai, mais sur-tout celui de la place des Bergues, souleva l’indignation : Cet immeuble, « l’immeu-ble des Intérêts de Genève, même s’il ne constitue pas un joyau d’architecture – la question n’est pas là – s’intègre à merveille dans le site du quai des Bergues auquel les Genevois tiennent énormément. Ces derniers, consultés, refuseraient certaine-ment aujourd’hui sa destruction. Et c’est la seule chose qui compte ».26 Et le journaliste du Journal de Genève de conclure : « Et surtout les Genevois sont de plus en plus irrités de voir leur ville se transformer pour le seul intérêt d’une infime minorité. »
les opérations en cours menaçant le patri-moine de Genève, de Carouge et de Chêne-Bourg. En publiant une liste illustrée presque sommaire des démolitions effecti-ves ou en projets, les auteurs mettaient en évidence l’incapacité des pouvoirs publics et de la population à « freiner un processus d’appropriation, de dégradation et de dé-tournement insidieux de l’espace urbain ». Or, l’Année européenne du patrimoine architectural venait de populariser deux concepts, celui d’ensemble architectural à conserver et celui de patrimoine urbain considéré comme un bien social dont les bouleversements étaient vécus par le plus grand nombre de gens comme une vérita-ble frustration. L’article fut repris sous le même titre, mais en étendant les exemples à Lausanne et à la région lémanique, dans la revue romande Habitation16, puis dans Tout va bien, mensuel suisse de contre-informa-tion et de lutte17. La nouvelle génération des historiens de l’art, dans la mouvance de 1968, s’engageait dans la défense des biens culturels (i beni culturali), avec des préoccupations politiques et sociales. Elle avait appris d’un Henri Lefèvre que le droit à la ville concerne tous les habitants et nécessite des forces politiques pour se concrétiser.18
L’article « Paisibles démolitions » pointait toute une série de bâtiments qui auraient dû faire l’objet d’attentions minutieuses avant d’être livrés aux démolisseurs. Il révélait très clairement l’absence de toute politique de conserva-tion et l’ignorance des inquiétudes qui se
manifestaient à l’égard du patrimoine en Europe. Les critiques ne s’adressaient pas seulement à la tiédeur de la Commission des monuments, de la nature et des sites (CMNS), l’instance publique chargée de prodiguer des conseils et de délivrer des préavis en vue de l’application de la loi, elles atteignaient directement le conseiller d’État chargé des Travaux publics.19
Conscient du danger que pouvait susciter dans la population une négligence manifeste à l’égard du patrimoine, Jacques Vernet, conseiller d’État libéral, prit alors le parti de la contre-attaque et fit éditer une brochure sur papier glacé dont le titre ne pouvait que réjouir ceux qui voyaient dans sa politique l’assoupissement de la CMNS. À feuilleter Paisible sauvegarde on voit apparaître tout le retard, et donc le décalage existant entre la réalité et des in-tentions affichées bien tardivement.20 Il en fallait beaucoup plus pour convaincre des Genevois qui avaient sous les yeux, dans la rade, la façade de l’hôtel de Russie ou, à la Corraterie, celle de la Caisse d’Epargne ! Pour donner plus d’efficacité à la CMNS, Jacques Vernet, poussé dans ses retranchements, consentit en 1976 à créer un Service des monuments et des sites, puis, en 1977, à soumettre au Grand Conseil un projet de loi modifiant la loi sur la conservation des monuments et la protection des sites. Ce projet adopté le 4 juin 1977 « n’apporte guère d’innova-tions essentielles », notait à cette époque le juriste Gabriel Aubert, alors président de la Société d’art public.21 Il commentait ainsi son appréciation : « La gestion du
6768
27 L’épisode du sauvetage de la ville Edelstein de 1904, commencé avec une proposition de classement en 1981, suivie de recours, de séances au tribunal, d’un incendie, s’acheva par une rénovation contestable pour le nouveau siège de la Fondation Jeantet en 1998. Il demeure emblématique de la violence des confrontations déchaînées par ce tournant. A ceux qui ont dénigré ce classement, la découverte récente du dossier de l’exceptionnelle villa Hélios apporte un sec démenti. 28 Voir Ensembles XIXe-XXe s., Genève, Département des travaux publics, Service des monuments et sites, septembre 1988, et Répertoire des ensembles du XIXe et début du XXe siècle, Genève, DTP, Service des monuments et sites, août 1991. En 1987, la protection de la Vieille Ville fut étendue au secteur sud des fortifications.29 Architectures, sites et patrimoines, Répertoire et fiches conseils, Département des travaux publics, Service des monuments et sites, Genève, dès 1991.
Les amandoliers d’e. Fatio à genthod, état d’origine, avant la transformation pour Frank müller coll. privée
1981 : vers Une meiLLeUre Protection DU Patrimoine L’élection du socialiste Christian Grobet au Conseil d’État en 1981, à la tête des Travaux publics, marqua un tournant fort dans la sauvegarde du patrimoine.27 Cofondateur de l’ASLOCA (Association de défense des locataires), il allait prendre en compte la substance locative des bâti-ments du XIXe siècle dans sa politique de protection du patrimoine, appuyer ses dé-cisions sur une concertation permanente avec la Société d’art public, en particulier avec son président Denis Blondel, député libéral au Grand Conseil, et contribuer à l’aboutissement en 1983 de deux projets de loi d’importance majeure. La première, la loi sur les démolitions, transformations et rénovations de maisons d’habitation (LDTR), avait pour but de « préserver l’habitat et les conditions de vie dans les quatre premières zones de construction ». Elle interdisait, sauf dérogation, de trans-former des logements en bureaux, quel que soit l’âge des bâtiments, et encourageait les rénovations sans hausse majeure des loyers. Ces dispositions formaient une pre-mière manière de protection générale du bâti. La deuxième loi, modifiant la loi sur les constructions et installations diverses (art. 89 à 93), dite « loi Blondel », du nom de son auteur, visait à protéger les ensem-bles du XIXe et du début du XXe siècle.28 C’était un pas de géant dans la recon-naissance de la qualité des ensembles urbains, célébrée jusque dans le milieu des architectes, même si certains y voyaient la dilution de toute créativité, la mort de la liberté de projeter. La politique offensive
de Christian Grobet concrétisait cette vo-lonté que Gabriel Aubert avait appelée de ses vœux : il sut être un frein à la spécu-lation immobilière, utiliser tous les outils de protection du patrimoine, favoriser les inscriptions à l’inventaire, développer les inventaires, publier des répertoires, des fiches et des conseils à l’usage des praticiens.29 Il appuya sa politique sur une CMNS renouvelée, où les délégués des associations de défense du patrimoine bâti et de la nature pouvaient enfin faire pièce aux représentants des milieux de l’architecture et de la construction.
Genève prit donc le train en marche et sut enfin préserver, grâce à la « loi Blon-del », le patrimoine le plus précieux de la seconde moitié du XIXe siècle, cette ville nouvelle contemporaine des opérations de Paris et de Vienne et dont les architectes genevois reconnaissaient enfin publique-ment la valeur. Ce furent ensuite les plans de site de la rade et des rives du Rhône, si importants pour tous les Genevois profon-dément attachés à la beauté de leur ville et surtout à la rade, au point de la défendre âprement lors de deux référendum popu-laires, contre la démolition des bains des Pâquis le 25 septembre 1988 et contre la traversée de la rade le 9 juin 1996.
1976-2006 : etUDes et inventaires
L’inventaire lancé en 1976 par le Département des travaux publics, qui de-vait englober l’ensemble du canton, s’éten-dit principalement aux villages et ha-meaux genevois. Il reste, à l’heure actuelle, inachevé. Confié à un mandataire privé,
6970
7172
30 Dans l’échelonnement des valeurs allant de 1 à 6, les valeurs 1, 2, 3 et 4+ entraînent une certaine protection, tandis que les valeurs 4 et 5 permettent une éventuelle démolition, quand celle-ci n’est pas carrément encouragée par l’attribution infamante d’une valeur 6 (« dépare le site »).31 Leïla el-Wakil, « Architecture et urbanisme à Genève sous la Restauration », Genava, n.s., tome XXV, 1977, pp. 153-198. Rolf Pfaendler, « Les Tranchées et les Bastions, premier quartier résidentiel de la Genève moderne », Genava, XXVII, 1979, pp. 33-82.32 Armand Brulhart, Elisabeth Rossier, Bibliographie critique de l’urbanisme et de l’architecture à Genève, 1798-1975, 2 vol., Université de Genève, Ecole d’architecture, Centre de Recherche sur la Rénovation urbaine (C.R.R.), 1978-1982. Armand Brulhart, Répertoire de cartes et plans, 1798-1975, Idem, 1982. Alain Léveillé, Atlas du territoire genevois, Genève, Département des travaux publics, Service des monuments et sites, Chêne-Bourg, Genève, 1993-1997.33 Recensement genevois d’architecture, Ville de Genève, Atelier du recensement du domaine bâti, 1986-1991, sur une initiative d’Yves Cassani.34 Kunstführer durch die Schweiz, Zurich-Wabern, Bücherverlag, 1976.
ancien hôtel edouard vii, quai général guisan. avant intervention A. Sartorio 1982 (CIG)
l’architecte Monique Bory, il se poursuivit jusque dans les années 90 en se fondant sur un principe pragmatique inspiré par le modèle vaudois : une visite sur place, une fiche descriptive élémentaire avec une photographie et l’attribution d’une valeur à chaque bâtiment, confirmée par la CMNS.30 Ce recensement s’est déplacé à la fin des années 80, avec plusieurs archi-tectes mandataires successifs, sur des quartiers périphériques de la ville et, plus spécialement, sur des quartiers de villas largement inconnus et soumis alors à de nombreux projets de densification. Cette nouvelle étape reste également inachevée. Quant aux inscriptions à l’inventaire qui devaient découler de ces opérations de reconnaissance, elles n’ont été que partiel-lement réalisées. Parallèlement aux engagements et à l’action des associations, commença une relecture de l’histoire de la ville, d’abord à l’Université où des étudiants se mirent à réaliser des travaux loin des préoccu-pations académiques traditionnelles, sur le patrimoine genevois : par exemple sur l’architecture de la Restauration et sur le quartier des Tranchées.31 Puis suivirent une exploration des sources et la redé-couverte des plans originaux, qui survint à un moment où tout le fonds accumulé depuis l’existence des procédures moder-nes d’autorisation de construire en 1848 était tombé dans l’oubli le plus complet. En 1976, les professeurs Italo Insolera et André Corboz lancèrent une recherche du fonds national pour étudier les proces-sus de la rénovation urbaine en créant le Centre de recherche de rénovation
urbaine de l’École d’architecture (C.R.R.). Celui-ci se livra à une recomposition des traces de l’histoire, par une relecture des mémoriaux du Grand Conseil et du Conseil municipal pour en extraire le suc politi-que, par des analyses cartographiques appropriées ainsi que par l’établissement d’une bibliographie en deux volumes, ins-trument de base pour les étudiants.32 La Ville de Genève mit à son tour sur pied, dès 1978, un « Atelier de recensement du domaine bâti » qui documenta pendant une douzaine d’années les principaux immeubles urbains sous formes de fiches publiées entre 1986 et 1991 offrant une excellente documentation.
La Société d’histoire de l’art en Suisse (SHAS), au travail depuis 1927 pour as-surer la publication, canton par canton, des sévères livres noirs des « Monuments d’art et d’histoire de la Suisse », ainsi que de guides et de plaquettes consacrées à des monuments, commença durant cette période par publier une nouvelle version du Kunstführer durch die Schweiz qui parut en 1976.34 L’élaboration du chapitre « Genève » permit d’effectuer une sélection qui ne tenait qu’imparfaitement compte de la richesse et de l’étendue du patrimoine genevois tel qu’il se révélait alors. La vi-sion touristique qu’il proposait se nourris-sait d’une haute exigence dans l’intention avouée de faire partager les connaissances engrangées par les inventaires détaillés des « Monuments d’art et d’histoire ». Dans la foulée, la SHAS accepta le principe de guides cantonaux plus étoffés. Il fallut dix ans pour faire aboutir Arts et monuments.
35 Armand Brulhart, Erica Deuber-Pauli, Arts et monuments. Ville et canton de Genève, Berne, 1985m 2e édition, Berne, 1993. Depuis trente ans, la SHAS avait sollicité successivement pour lancer cet inventaire Louis Blondel, Conrad-André Beerli et André Corboz, mais avait chaque fois buté sur le refus de l’aide financière du canton.36 Philippe Broillet et al., La Genève sur l’eau, Bâle, 1997, et Anastazja Winiger-Labuda et al., Genève Saint-Gervais : du bourg au quartier, Genève, 2001. Parallèlement des travaux de thèse ont pris la suite des grandes monographies d’André Corboz, L’invention de Carouge, Lausanne, Payot, 1968, et de Conrad-André Beerli, Les Rues-Basses de Genève, Genève, Georg, 1983, Leïla el-Wakil, Bâtir la campagne 1800-1860, 2 vol., Genève, Georg, 1988-1989, et Christine Amsler, Maisons de campagne genevoise du XVIIIe siècle, 2 vol., Genève, Domus Antiqua Helvetia, 1999 et 2001.37 Voir le chapitre « Genève » rédigé par Gilles Barbey, Armand Brulhart, Georg Germann et Jacques Gubler, vol. 4, Zurich, Orell Füssli, 1984. Pour l’architecture du XIXe siècle, voir aussi Le Grand siècle de l’architecture genevoise. Un guide en douze promenades, Genève, Société d’art public, 1985. Pour l’architecture industrielle, voir Armand Brulhart et Erica Deuber-Pauli, « Genève. L’industrie à la jonction des eaux », in Il était une fois l’industrie, Genève, API, 1984, pp. 12-49.38 Isabelle Charollais, Jean-Marc Lamunière, Michel Nemec, L’architecture à Genève 1919-1975, 2 vol., Lausanne, Payot, 1999. Cet inventaire a stimulé les associations professionnelles à conserver la mémoire des architectes qui se sont illustrés à Genève, au-delà des monographies des grands, Le Corbusier, Maurice Braillard, Marc-Joseph Saujey, déjà parues ou en cours d’élaboration.
La vierge de miséricorde, st-gervais. après intervention de théo-a. Hermanès CIG, René Steffen
Ville et canton de Genève, instrument in-dispensable pour l’histoire du territoire et de l’architecture genevoise.35 En 1985, les auteurs de cet ouvrage prirent l’initiative de rédiger un programme en dix volumes de l’inventaire des Monuments d’art et d’histoire du canton de Genève36 dont les deux premiers volumes sont désormais parus.37 En même temps, pour répondre à la sensibilité nouvelle pour l’architecture du XIXe et du XXe siècle la SHAS com-manda les travaux de l’INSA. Inventar der neueren Schweizer Architektur - Inven-taire suisse d’architecture, 1850-1920, qui prenait le relais des Monuments d’art et d’histoire de la Suisse arrêtés jusque là en 1850.38 L’Ecole d’architecture de Genève en créant la revue Faces en 1985 offrit un moyen de stimuler la critique architectu-rale et de revisiter l’architecture moderne. Enfin citons plus récemment, sans pouvoir être exhaustifs, la publication par des architectes de l’EPFL de L’architecture à Genève 1919-1975, sous les auspices des Travaux publics de Genève et de l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne.39 Au niveau national, d’autres inventaires vin-rent encore consolider les appréciations sur certains projets, tels l’Inventaire des sites construits à protéger en Suisse (ISOS) ou l’Inventaire des voies de communica-tion historiques de la Suisse (IVS).
vers Une conservation De qUaLité
Si les historiens et les architectes ont fourni depuis les années 1975 une quantité impressionnante de connaissances nouvel-les qui ont parfois permis de préserver des bâtiments importants, les questions relati-ves aux modes d’intervention, aux maté-riaux, à leur mise en œuvre, aux techniques de conservation ont elles-mêmes soulevé d’autres questions variant en fonction de périodes s’étendant du haut moyen âge jusqu’aux constructions de verre et béton. Pour s’attaquer à des monuments comp-lexes, les connaissances architecturales ne pouvaient plus relever des seuls archi-tectes, même aidés de quelques historiens ou archéologues. Les méthodes d’interdis-ciplinarité et de transdisciplinarité qui dominaient la recherche scientifique à la fin des années 60 s’imposèrent bientôt comme la seule alternative aux solutions souvent brutales à peine adoucies par le catalogue de prescriptions des Travaux publics. Les colloques de l’ICOMOS ont transmis cet esprit nouveau qui réunissait les disci-plines et les compétences les plus variées pour les confronter à des exemples précis. En Suisse romande fut créé au début des années 70 un Colloque régional réunissant régulièrement, et très démocratiquement, des spécialistes chevronnés ou des jeunes professionnels en formation travaillant sur, ou en collaboration avec des chantiers de conservation. Ses initiateurs, le restau-
7576
7778
44 Les deux premiers bâtiments, d’abord squattés, ont finalement été pris en charge par la Ville de Genève pour y loger les arts et le spectacle vivants. Des mécènes sont également intervenus au BFM et au Manhattan. 45 L’API a su attirer toute l’attention sur la richesse de ce patrimoine industriel et recevoir le soutien d’Action patrimoine vivant.46 Cette professionnalisation a impliqué toute une série d’historiens, tels Leïla el-Wakil, Bernard Lescaze, Rolf Pfaendler, Catherine Courtiau, Bernard Zumzhor, Pierre Monnoyeur, Véronique Palfi, Anastazja Winiger-Labuda, Isabelle Brunier, Philippe Broillet, Nicolas Schätti, Martine Koelliker, Christine Amsler, et al.47 Un poste occupé tour à tour par les historiens de l’art Bernard Zumthor, et Martine Koelliker et l’architecte Philippe Beuchat.48 Bains des Pâquis, quai du Mont-Blanc, Ville de Genève, 1995.
40 Le chantier de transformation de cet élégant palazzo des années 1817-21, laisse un souvenir amer. Pour y installer la Mairie, et tournant le dos à toutes les recommandations en matière de conservation, la municipalité et son architecte gardèrent les façades et les salons de l’étage noble aux dépens du reste de la substance du bâtiment, avec un résultat des plus médiocres.41 L’entreprise d’Hermanès, le CREPHART, a été active pendant 30 ans en Suisse romande et à Genève et possède des archives, actuellement en dépôt privé, non exploitables, qui constituent un véritable trésor. Un de ses anciens collaborateurs, Eric Favre-Bulle, de l’Atelier Saint-Dismas, reste aujourd’hui le seul restaurateur actif à Genève dans les monuments.42 Voir en particulier Théo-Antoine Hermanès, Saint-Pierre, cathédrale de Genève. Chantiers et décors, Genève, Clefs de Saint-Pierre 1991. Voir aussi ses travaux sur le portail peint de la cathédrale de Lausanne. 43 Catalogue de l’exposition Saint-Pierre cathédrale de Genève, un monument, une exposition, Genève, 1982, pp. 146-147.
Les initiatives culturelles ont égale-ment joué un rôle non négligeable dans cette effervescence, avec le Théâtre Mobile ou Etat d’Urgence, respectivement sau-veteurs du Grütli et de l’Usine en 1988, le MAMCO qui investit l’usine de la SIP ré-novée en 1994, le Grand Théâtre qui ouvrit une deuxième scène lyrique à l’Usine des forces motrices de la Coulouvrenière (BFM) en 1997, les cinémas Manhattan et Bio sauvés par des comités d’action.44 L’API, après une première période de récolte d’appareils et d’outils de travail en-combrants, s’attela avec des chômeurs à la remise en usage de presses et de turbines et sauva l’Usine des eaux d’Arve de Vessy en convainquant les SIG de la remettre en route.45
La résultante de ce renouveau fut sans doute une certaine recrudescence des métiers d’art et le commencement d’un changement dans les mœurs d’une partie des architectes. Elle fut aussi, dès la der-nière décennie du XXe siècle, une tentative de créer un véritable enseignement de la restauration en architecture et dont la réa-lisation devait s’inscrire dans la création de l’Institut d’architecture de Genève. En-fin, les historiens ne furent plus seulement amenés à œuvrer bénévolement pour dé-fendre une cause, mais ils furent sollicités, contre rémunération, pour accompagner de leurs recherches, de nombreux projets de transformation et de restauration.46
1993 : mise en Danger De La conservation DU Patrimoine On a vu que la conservation du patri-moine était d’abord une affaire de volonté politique. Elle supposait une continuité, une sorte de contrat entre le politique et le patrimoine, contrat rompu en 1993, lorsque la droite réussit à s’emparer de la totalité des sièges au Conseil d’Etat et à nommer à la tête des Travaux publics l’ar-chitecte, Philippe Joye. Allait-on assister à la revanche des architectes amers devant l’intransigeance de l’ancien conseiller d’Etat ? Le danger paraissait imminent et devant l’apathie momentanée de la Société d’art public, une nouvelle association vit le jour, Action patrimoine vivant, qui recruta d’abord ses membres dans les milieux de la gauche et des associations de quartiers et d’habitants. Elle fut incapable de s’op-poser à la démolition de la villa Blanc à Sécheron, mais elle réussit à lancer le plan de site du quartier de Jean-Violette, celui de la Roseraie, à sauvegarder l’intégrité de la Grand-Cour à Troinex, et à réaliser, parfois en collaboration étroite avec les architectes ou les propriétaires, des sauve-tages moins visbles, en laissant l’initiative à la Société d’art public sur son terrain traditionnel. De son côté, la Ville de Genève, qui s’était doté d’un conseiller en conservation du patrimoine en 198347, entama une série de publications en 1993 pour démontrer la qualité de ses interventions réalisées sur son patrimoine, sans craindre de faire paraître Les bains des Pâquis dont elle avait promu la démolition.48 Elle prit l’initiative d’emprunter à la France dès
rateur Théo-Antoine Hermanès, l’histo-rien des monuments Marcel Grandjean et l’architecte Claude Jacottet, poursuivirent pendant plusieurs années bénévolement le travail de secrétariat de cette entité informelle transcantonale, qui contribua à former sur le tas de nombreux acteurs romands de la conservation, notamment des architectes. Ceux-ci, ne bénéficiant que d’une formation académique élémentaire, furent amenés à conduire des chantiers avec des précautions toutes nouvelles, dans un esprit d’intelligence avec les représen-tants d’autres disciplines et avec des corps de métiers mieux préparés. Il apparaît inutile de s’appesantir sur les opérations désastreuses qui ont encore marqué les années 1980, comme celle du Palais Eynard.40 Les chantiers qui ont rendu compte des nouvelles exigences en matière de conservation et qui ont conduit à des degrés exceptionnels la finesse des ana-lyses se sont déroulés à la cathédrale Saint-Pierre dès 1976, au temple de Saint-Gervais dès 1987 et, dans une moindre mesure, à la maison Tavel réouverte en 1986 en musée. Il faut rendre ici un hommage particu-lier à Théo-Antoine Hermanès, restaurateur et à Charles Bonnet, archéologue cantonal.41 Rien ne prédisposait un restaurateur de peinture et de sculpture et un archéologue à jouer un rôle majeur dans la conservation des monuments. Non seulement Hermanès a imaginé le colloque régional cité plus haut, imposé l’usage des collaborations avec des historiens de l’art et des chimis-tes, mais il a réussi à s’imposer comme leur égal dans les publications et comme l’égal des architectes sur les chantiers. Ses découvertes et celles du service d’archéo-logie cantonale, né au cours des années 70, restent uniques à l’échelle européenne.42
Les planches de la polychromie intérieure de Saint-Pierre exposées au Musée Rath en 1982 furent une révélation pour le public genevois comme pour les étrangers.43 Quant au site archéologique de Saint-Pierre, il prend place aux côtés des réalisations les plus intelligentes de l’archéologie de la seconde moitié du XXe siècle, une archéologie qui fait partager les joies du spécialiste au public le plus large possible. Les coûts importants de ces opérations se sont révélés des investisse-ments rentables sur les plans historiques, scientifiques, esthétiques et touristiques.
Sans faire de parallèles abusifs, on peut cependant remarquer qu’au cours des années 1980 on assista à un regain d’intérêt pour la réhabilitation des immeu-bles du XIXe et du début du XXe siècle et que la promotion immobilière s’est mise à considérer avec un œil différent la mise en valeur de ce patrimoine. Peu à peu, se développa une attention pour les détails d’architecture et pour les décors intéri-eurs. La conservation d’un immeuble avec les caractéristiques de sa façade et de sa toiture, de sa cage d’escalier, de son as-censeur, de sa typologie, de ses boiseries, de ses cheminée entrèrent dans les mœurs de l’architecte qui pouvait convaincre son client que la conservation constituait une sorte de plus-value. Il faudrait analyser ce phénomène à la lueur de la conjoncture de la construction, de la « crise » qui toucha gravement les architectes, des nouvelles formes de spéculation qui se développè-rent durant cette décennie et du recours à la contraignantes LDTR, bête noire des promoteurs et des architectes.
49 L’organisation de ces Journées réunit depuis lors tous les acteurs de la conservation, de l’Université aux associations de quartier.50 Successivement confiée à l’architecte Pierre Baertschi et à l’historien de l’art Bernard Zumthor, elle organise des colloques et a commencé en 1996 la publication d’une revue Patrimoine et architecture, avec des numéros consacrés au paysage, aux jardins historiques, à l’archéologie, au décor peint, au patrimoine industriel.
villa Blanc à sécheron CIG
1994 ses Journées du patrimoine dont le succès fut immédiat.49 Le Département des travaux publics, lorsqu’il fut à nouveau dirigé par un conseiller d’Etat socialiste a réorganisé ses services et créé une Direc-tion du patrimoine et des sites regroupant le Service des monuments et des sites, l’archéologie, l’inventaire des monuments d’art et d’histoire et le fonds cantonal d’art contemporain.50 Celle-ci organise des col-loques et commence en 1996 la publication d’une revue Patrimoine et architecture, avec des numéros consacrés au paysage, aux jardins historiques, à l’archéologie, au décor peint, au patrimoine industriel.
Dans ce bilan des trente dernières an-nées, à la lumière d’une histoire qui révèle de multiples tergiversations face au patri-moine, des retards permanents, l’élément le plus prégnant est le changement inces-sant, cette sorte de tourbillon qui rend difficile tout travail de communication et d’information. Cette situation est à la fois due à la pression financière, à l’investisse-ment très rentable dans l’immobilier, mais aussi à la fluctuation des valeurs patrimo-niales, à une formidable capacité d’oubli. Tous les efforts entrepris pour assurer une qualité d’intervention sur des objets patrimoniaux peuvent être ruinés du jour au lendemain. Rien n’est acquis et l’une des grandes difficultés aujourd’hui dans la conduite des chantiers provient souvent des entreprises générales dont le rythme de travail, dicté par le prix du travail, la concurrence internationale, laisse de côté tous les aspects qualitatifs, tout le temps de la réflexion.
Ce constat amène à s’interroger sur la poursuite d’une aventure qui a été celle d’une génération. Le relais est difficile à imaginer et, pourtant, il est indispensa-ble. Dans l’équilibre instable du moment, des énergies nouvelles sont requises, car la conjoncture est en train de produire à nouveau des menaces analogues aux an-ciennes, mais différentes, dont on ne sait quelles formes elles vont prendre et com-ment les conservateurs du patrimoine de demain y répondront. Dernière menace en date, le projet de surélever la ville de deux étages, projet éminemment destructeur du patrimoine.
7980
aérodrome de cointrin années 1950 CIG, Max Chiffelle
La Liste genevoise Des monUments cLassés : un invEntairE à la prévErtpar lEïla El-Wakil
8182
6 Jean-Paul Benzecri, L’analyse des données. La taxinomie, Dunod, 19737-9 Id., p. 4, p.15, p.1610 « Au sujet des sept merveilles du monde » selon Nicole BLANC, « Les Sept Merveilles et la genèse d’un mythe », pp. 4-11 ds. Les Dossiers d’Archéologie, n° 202, avril 1995.11 De architectura libri decem, (II, 8) ds. Jean-Pierre ADAM, Nicole BLANC, Les sept merveilles du monde, Paris, 1989, p. 1212 Id., p.
1 Répertoire des immeubles et objets classés, Service des Monuments et des Sites, Travaux publics et énergie, Genève, 1994.2 Le cas du patrimoine de l’Humanité de l’UNESCO. En l’absence d’une étude comparative de l’histoire du patrimoine dans les différents pays d’Europe et du monde, en l’absence d’une telle étude dans les différents cantons de Suisse, notre approche manque de points de comparaison et pêche par son caractère unilatéral.3 Vaud 1898, Neuchâtel 1902, Valais 1907, Genève 19204 Carte du Patrimoine mondial 20065 André MUSSAT, « Rapport de synthèse », ds. Actes du colloque sur les inventaires des biens culturels en Europe [1980], Paris, 1984, p. 507.
Faire figurer un immeuble sur la liste des monuments classés fut pendant long-temps considéré comme le faire entrer au Panthéon de l’architecture. Or, il se trouve qu’aujourd’hui, le panthéon est encombré de héros disparates, dont le sacre résulte tout autant de consensus mouvants que de questions de survie. A cette hétérogénéité patrimoniale, plusieurs causes : l’absence fréquente de vraies campagnes de classe-ment, la nouvelle conception « phylogénéti-que » du patrimoine devenu champ ouvert et en constante évolution, enfin, -il faut peut-être bien l’admettre-, la faillite de la mesure de classement comme mesure de protection.
L’iDée De Liste L’idée même d’une classification sous forme de liste mérite qu’on s’y arrête un ins-tant. Dans son ouvrage, L’analyse des don-nées. La taxinomie6 Jean-Paul Benzecri ex-plique que « la tâche la plus nécessaire pour l’intelligence humaine est sans doute la synthèse »7. Le patient collationnement des faits fournit matière à comprendre et « la no-tion de forme ou de modèles devrait émerger d’une mer de données, non par des postulats nominatifs ou des axiomes a priori »8. On y explique aussi que « si les classifications ont joué un rôle prépondérant dans l’histoire des sciences, c’est qu’elles sont davantage adaptées à la mémoire et aux opérations du cerveau » ; mais on y conclut que « les hiérarchies taxinomiques ne paraissent pas avoir le plus grand avenir »9, ceci en raison de l’avènement des ordinateurs, à même de classer facilement.
C’est à un rhéteur tardif (Ve siècle ap. J.-C.) du nom de Philon que l’on doit, pense-t-on, attribuer le court manuscrit grec
intitulé : « Péri tôn hépta théamatôn »10 ; les six feuillets, qui le composent, recensent et commentent brièvement la liste restreinte des sept merveilles du monde, les sept mo-numents les plus remarquables de l’Anti-quité, nommés et promus au rang d’objets légendaires et mémorables. Le manuscrit de Philon s’appuie sur une liste établie depuis longtemps, puisque Vitruve en fait état dans ses dix livres en évoquant le Mausolée « qui est l’une des sept merveilles du monde »11. Cette liste comporte la pyramide Chéops, seule merveille encore en place, les jardins suspendus de Sémiramis et les murailles de Babylone, le temple d’Artémis à Ephèse, la statue chryséléphantine de Phidias repré-sentant Zeus à Olympie, le mausolée d’Ha-licarnasse, le colosse de Rhodes. La liste de Philon recense des objets situés dans un pé-rimètre relativement circonscrit du monde de l’Antiquité, c’est-à-dire en Grèce, en Asie Mineure, à Alexandrie et dans l’ancienne Mésopotamie, mais elle ne comporte par le phare d’Alexandrie, généralement reconnu comme une des sept merveilles. Ceci porte à croire qu’il y aurait plusieurs listes en circulation dont celle-ci ne serait qu’un avatar tardif. D’autres listes sont établies par des écrivains comme le poète alexan-drin Catulle ou l’historien Pline l’Ancien qui mentionne dans son Histoire naturelle (livre XXXVI) une autre liste des merveilles du monde, comprenant le Mausolée d’Halicar-nasse, les Obélisques d’Egypte, le Sphynx et les Pyramides de Gizeh, le Phare d’Alexan-drie, les labyrinthes (d’Hérakléopolis en Egypte, de Crète, de Lemnos et de Clusie en Etrurie), les jardins suspendus de Thèbes en Egypte, le Temple de Diane à Ephèse et le Temple de Cysique en Asie Mineure. Pline ajoute ensuite une liste des dix-huit merveilles de Rome12 qui « dans ce domaine a aussi vaincu le monde entier ».
Les ruines du château de Rouelbeau, le Parc La Grange et sa maison de maître du Grand Siècle, les bois du bord de l’Aire, la cloche du temple de Genthod, la Maison Clarté, les pierres du Niton, trois chênes centenaires, un temple pas si neuf … Nous ne sommes pas très loin de l’inventaire humoristique de Jacques Prévert dressé en 1957 : « Une triperie, deux pierres, trois fleurs, un oiseau, vingt-deux fossoyeurs, un amour, le raton-laveur … » Qu’y a-t-il de commun entre l’inventaire de Prévert et une liste de monuments classés ? Une forme d’aléatoire, fort divertissante dans le premier cas, mais fort déroutante dans le second. Si Prévert a donné libre cours à son imagination de manière surréaliste et associé des réalités qui n’ont rien à voir les unes avec les autres, il serait légitime de penser qu’une liste de monuments classés constitue l’ensemble raisonné du patri-moine immobilier et naturel le plus digne de protection. En stigmatisant la notion de liste par une liste aberrante, le poète dévoilait-il une vision prémonitoire du reflet chaotique et fragmentaire du monde que sont aujourd’hui les listes d’objets classés ?
Il me semble intéressant d’interroger la pertinence du « répertoire des immeu-bles et objets classés »1 de Genève. Le comparer à d’autres répertoires similaires, qu’ils soient cantonaux, nationaux ou pla-nétaire2, dans l’état où ils nous sont parve-nus, met en évidence le caractère somme toute disparate des objets recueillis ; bien davantage que des recensements exhaus-tifs, ces collectes d’objets, certes signifi-catifs, semblent à première vue relever du plus pur hasard. Porter sur une liste les monuments exceptionnels en vue de les
protéger est une invention du XIXe siècle. La création en France de la Commission des monuments historiques en 1837 en-traîne l’établissement de listes de bâti-ments subventionnés, qui deviennent dès 1887 les listes de bâtiments classés. Dès 1898 les cantons romands suivent ce mo-dèle3. D’un pays à l’autre, si la terminologie change, la réalité qu’elle recouvre est la même : les Italiens procèdent au catalogage des biens culturels (Beni Culturali), les Anglais listent leur patrimoine bâti (Listed Buildings), tandis qu’au pays de Goethe les monuments culturels (Kulturdenkmale) sont inscrits dans le « livre des monu-ments » (Denkmalbuch). La « liste du patri-moine mondial », établie par l’UNESCO et qui compte aujourd’hui 834 objets, entend protéger tant des sites (le terme de monu-ment a complètement disparu) construits que naturels, « de valeur universelle excep-tionnelle […] et présentant une importance pour les générations futures »4.
Des sept merveilles du Monde, premier inventaire de monuments fabuleux, re-montant à l’Antiquité, nous voici désor-mais enlisés dans une pléthore d’objets pa-trimoniaux prolétarisés et dont nous nous imposons la sauvegarde. A l’heure actuelle la notion même de patrimoine, distendue, recouvre, dans le seul domaine monumen-tal et paysager, des réalités d’une infinie variété. L’extension du champ patrimonial a fait dire à André Mussat dans le rapport de synthèse publié dans les Actes du Collo-que sur les inventaires des Biens culturels en Europe (1980) que nous étions passés de « l’inventaire de la rareté à l’inventaire de la surabondance »5. Aux 7 merveilles du monde antique répondent aujourd’hui les 834 sites classés de l’actuel patrimoine mondial sélectionné par l’Unesco.
8384
13 www.aibl.fr/fr/seance/discours/disc_recht.html14 Selon cette conception les monuments donneraient l’explication des civilisations.15 www.aibl.fr/fr/seance/discours/disc_recht.html16 « Parcourir successivement tous les départements de la France, s’assurer sur les lieux de l’importance historique ou du mérite d’art des monuments, […] de manière à ce qu’aucun monument d’un mérite incontestable ne périsse par cause d’ignorance et de précipitation […] et de manière aussi à ce que la bonne volonté des autorités ou des particuliers ne s’épuise pas sur des objets indignes de leurs soins. » www.aibl.fr/fr/seance/discours/disc_recht.html17 Françoise BERCE, Des Monuments historiques au patrimoine : du XVIIIe siècle à nos jours ou « Les égarements du cœur et de l’esprit », Paris, 2000, p. 2518 Ibid.
Le triangle de montbrillant avec le restaurant edouard ier, années 1960 CIG
Dans son discours d’intronisation à l’Académie française13, Roland Recht explique comment, dès le siècle des Lu-mières et dans une perspective d’un art illustratif14, la notion de liste se déplace de l’exceptionnel à l’exemplaire : la quête de la « série complète15 « qui est propre au XVIIIe siècle produit dans divers domaines d’études le classement par espèces sous forme de tableaux, de familles, de séries. Le patient travail de classification du vi-vant mené par le botaniste Carl von Linné, qui conduit au fameux Systema naturae établi en 1735, un système fixe et fermé aujourd’hui dépassé, est le probable mo-dèle du genre de la taxinomie. Ce système coïncide avec la naissance du catalogage dans les musées qui relève de la même volonté classificatoire, où les œuvres sont rangées par écoles et par artistes. Acquis à l’idée de systèmes ouverts, les biologistes contemporains préfèrent à la taxinomie de Linné une classification phylogénétique. Aux listes ouvertes des scientifiques ac-tuels correspondent les listes sans fin des biens culturels.
Félix Vicq d’Azyr (1748 – 1794), profes-seur de médecine et pionnier de l’anatomie comparée, nous a laissé un intéressant mémoire de son activité de membre de la Commission temporaire des arts, intitulé « Instruction sur la manière d’inventorier et de conserver, dans toute l’étendue de la République, tous les objets qui peuvent servir aux arts, aux sciences et à l’ensei-gnement, proposée par la Commission temporaire des arts et adoptée par le Co-mité d’instruction publique de la Conven-tion Nationale ». Ce texte est éclairant par la méthode quasi scientifique qu’il propose
pour dresser, durant cette époque révolu-tionnaire qui se signale par des destruc-tions massives, la liste systématique de l’ensemble des champs de connaissance par un codage descriptif qui préfigure la démarche de l’inventaire général et des listes de classement.
C’est à François Guizot (1787-1874) que revient, dans une perspective positiviste, l’idée de faire parcourir à un inspecteur unique l’entier du sol de France pour dres-ser la liste de la juste série des monuments représentatifs de la Nation.16 L’inventaire s’entend ici comme le repérage absolu des custodienda, des objets ou des lieux d’importance historique ou artistique in-contestable, inventaire que l’on imagine fini et fermé, comme le système de Linné. En 1840 on est déjà en mesure de dresser la liste des édifices subventionnés, ancê-tres des monuments classés, « précédée d’un long rapport rédigé par Mérimée sur les choix opérés, les difficultés rencon-trées, les demandes à satisfaire. »17 La liste comportait en pourcentage selon Fran-çoise Bercé18 0,4% de monuments celtiques (dolmens ou menhirs), 8,4% de monuments gallo-romains, 7,3% de cathédrales, 68% d’églises médiévales, 9,5% de châteaux ou de fortifications médiévales, 4,08% d’archi-tecture civile.
La conception de l’inventaire exhaustif préside aux débuts de la sauvegarde et ce travail d’arpentage du territoire demeure à la base de l’établissement des listes. C’est en ratissant les Länder allemands les uns après les autres, que Max Dehio pose en une Allemagne récemment unifiée les ja-lons de la Kunsttopografie. De 1905 à 1912
8586
22 Denis BERTHOLET, « La loi de 1898 » ds. Autour de Chillon. Archéologie et Restauration au début du siècle, Lausanne, 1998, pp. 41-4823 Claire HUGUENIN, « Les effets de la nouvelle législation », ds. Id., p.49 selon le plan d’Archéotech, p. 50
19 Ministère de l’instruction publique et des beaux-arts, Direction des Beaux-Arts, Monuments historiques. Lois et décrets relatifs à la conservation des monuments historiques. Liste des monuments classés, Paris, 1900, p. 1 L’exemplaire conservé à la Bibliothèque d’art et d’archéologie de Genève a certainement servi d’exemple aux Genevois.20 Id., p. 13
serres rothschild, restauration Jean-Louis Dubochet SMS
La naissance Des Listes en sUisse romanDe C’est aux alentours de 1900, sous l’égi-de des sociétés savantes locales, que voient le jour en Suisse romande les dispositions légales à même de sauvegarder le patri-moine architectural et naturel. Dans le canton de Vaud l’archéologue Albert Naef, nommé architecte du château de Chillon en 1897, est l’instigateur de la loi de 1898, « loi sur la conservation des monuments et des objets d’art ayant un intérêt historique ou artistique » qui entre en application au début 189922. Voué au patrimoine vaudois et helvétique, Naef fera une double car-rière d’homme de terrain et de professeur d’université : architecte cantonal de 1899 à 1934, président de la Société suisse des monuments historiques dès 1905, membre de la Commission fédérale des monuments historiques entre 1915 et 1934, il jouera un rôle important dans l’établissement du cadre légal des cantons de Vaud, Neuchâtel et Valais.
Dans le cas du canton de Vaud, comme en France du temps de Mérimée, c’est à l’instigation d’un seul homme que s’établit la liste des monuments classés. En 1900 cent onze objets sont classés pour l’en-semble du canton sur une liste présentée de 253 objets23. Les hésitations de Naef en disent long sur le caractère somme toute aléatoire des listes dès leur origine. Il dresse en effet en 1897 une première liste qui comprend des châteaux et résidences particulières, une vingtaine d’églises et quelques ruines. Cette liste bute sur la difficulté majeure et récurrente de la pro-priété privée. La sélection définitive écarte par conséquent les monuments privés au profit des tumuli et des stations lacustres,
paraissent les cinq livres ou Hand- bücher der deutschen Kunstdenkmäler. Ce travail sera imité dès 1907 en Autriche par Max Dvorak au travers de l’Öster- reichische Kunsttopografie, puis en Suisse avec les Monuments d’art et d’histoire mis en œuvre par la Société d’histoire de l’art en Suisse à partir de 1927. Si ces grandes entreprises, issues du positivisme du XIXe siècle, tablent sur la conception d’un cor-pus fermé de monuments, les nombreuses mises à jour, qu’ils ont les uns et les autres subies, démontrent le contraire. La série suisse de l’inventaire scientifique que l’on pensait finie est en constante réélabora-tion.
Ce sont les Français qui, les premiers, inventent la notion du classement d’objets monumentaux à des fins conservatoires. La « Loi pour la conservation des monu-ments et objets d’art ayant un intérêt historique et artistique », promulguée le 13 mars 1887, est suivie du « Décret portant règlement d’administration publique pour l’exécution de la loi … » du 3 janvier 1889. L’article premier de ladite loi stipule que « les immeubles par nature ou par desti-nation dont la conservation peut avoir, au point de vue de l’histoire ou de l’art, un intérêt national, seront classés en totalité ou en partie par les soins du Ministre de l’instruction publique et des beaux-arts »19. « La Commission des monuments histori-ques, instituée près le Ministère de l’ins-truction publique et des beaux-arts, a pour mission d’établir la liste des monuments et objets ayant un intérêt historique et artis-tique (…) »20. La loi et le décret sont suivis d’une liste des monuments historiques de France et d’Algérie, publiée en 1900, l’an-née même de l’Exposition Universelle de Paris qui célèbre Fée Electricité.
La liste, établie par la Commission des monuments historiques, est organi-sée selon une double classification. La chronologie fixe un cadre général et se subdivise en trois périodes : 1° monuments mégalithiques, 2° monuments antiques, 3° monuments du moyen âge, de la Re-naissance et des temps modernes. Dans ce cadre les monuments apparaissent par départements. La liste compte environ 1700 objets d’intérêt national, chiffre qui demeure constant entre 1887 et 1907. Les alignements, dolmens, menhirs de Carnac, du Morbihan et du reste de la France, les arènes, amphithéâtres et théâtres, tem-ples d’Arles, de Nîmes, d’Orange, du Sud de la France, des vestiges de remparts, de camps, des hypogées, des mosaïques de toute la nation sont listés. Une grande majorité d’églises médiévales, des pier-res tombales, des peintures murales, des vitraux, des jubés, des tapisseries constituent l’essentiel du fonds des objets classés. Les hôtels de ville, les châteaux et palais médiévaux ou modernes alimentent la liste des bâtiments civils. Le patrimoine classique de la Renaissance et du Grand Siècle nourrit une collection encore mince d’architecture civile moderne ; parfois seules les façades sont classées, comme à Paris, celles de la place Vendôme dessinées par Jules Hardouin Mansart ou de la très classique place de la Concorde, inventée par Ange-Jacques Gabriel.
8788
27 C’est-à-dire tardivement par rapport à d’autres cantons romands comme Vaud (1898), Neuchâtel (1902), Valais ou Fribourg. 28 Waldemar DEONNA, « La protection des monuments historiques dans le canton de Genève », ds. Genava, 1923, 1, pp. 118-128, en particulier pp. 118-119.29 Id., p. 11930 Compte-rendu de la séance plénière de la CMS du 20 mai 1933, DTCI, Archives
24 Claire PIGUET, « Dites-nous quels sont les bâtiments que vous conservez et nous vous dirons qui vous êtes », ds. Un siècle de protection des monuments historiques dans le canton de Neuchâtel, pp. 49-5125 Patrick ELSIG, « La protection du patrimoine bâti en Valais au tournant du XXe siècle », ds. Autour de Chillon, Op. cit., pp. 67-6826 Id., p. 68
Liste Des monUments cLassés genevois : historiquE Comparativement aux autres can-tons romands et suisses, Genève fait une apparition tardive dans le domaine de la protection légale du patrimoine monu-mental. Comme si le patrimoine, autre que financier, ne faisait fondamentalement pas partie des valeurs genevoises. L’adoption tardive de la première « loi sur les monu-ments et les sites » prend place en 192027, si bien que la première liste de custodienda ne s’établit qu’en 1921. Les témoignages re-latant les débuts de la légalisation du patri-moine à Genève, les doléances des Déonna, des Blondel, des Bertrand procurent une profondeur historique aux comporte-ments de résistance à la protection des monuments qui caractérisent sans doute fortement Genève parmi les villes de Suisse à toute époque. Genève est aussi le dernier canton suisse à emboîter le pas helvétique de la publication des Monuments d’art et d’histoire en partenariat avec la Société d’histoire de l’art en Suisse dans les années 1980’ ! Déni d’art protestant ? Agnosticisme relativement aux valeurs monumenta-les ? Excès d’aisance financière durant les Trente Glorieuses ? Illusion paternaliste, partagée par les responsables d’autres cantons, que le patrimoine ne saurait être en meilleures mains que celles de proprié-taires attentifs et scrupuleux !
Directeur du Musée d’art et d’histoire, Waldemar Déonna explique28 le long ch- min qui mène à la loi relative à la pro-tection des monuments et des sites. On apprend l’échec de plusieurs tentatives dès le début du siècle, comme celle faite au Conseil d’Etat par la section des Beaux-Arts de l’Institut national genevois en
1904 d’un projet de loi sur la conservation des monuments et des objets d’art, projet longuement étudié mais pourtant fina-lement rejeté. L’ouvrage est remis sur le métier en 1915 par un groupe de « citoyens éclairés » au sein desquels figurent notam-ment Waldemar Déonna, l’archéologue Louis Blondel, l’historien d’art Camille Martin ; le débat de spécialistes est porté auprès du grand public dans l’aula de l’Université de Genève en une conférence intitulée : « Les monuments historiques genevois. Leur valeur nationale et leur in-térêt éducatif : les mesures de conservation qu’ils réclament. »29
Une fois la loi votée, la Commission des monuments et des sites, dont l’une des missions définies par la jeune loi de 1920 est d’établir l’inventaire des custodienda, n’aura véritablement les moyens de cam-pagnes de classement qu’au tout début de son existence, entre 1921 et 1923, sous la présidence d’Albert Perrenoud, conseiller d’Etat aux Travaux publics. On assiste très vite ensuite à une dilution des tâches qui conduit les commissaires jusque sur le terrain des urbanistes. Déjà le classement, qui aurait dû être une mesure d’anticipa-tion, est relégué dans l’arsenal des moyens de défense. On classe alors dans l’urgence des objets menacés de disparition, ce que déplore l’architecte John Torcapel à propos du classement accidentel de quelques ar-bres menacés d’être abattus : « Une discus-sion générale s’engage au terme de laquelle M. Torcapel s’étonne que l’on attende des incidents semblables pour classer un bel arbre ou une partie de site. Il lui semblerait désirable d’organiser un tour du canton et de faire en bloc un classement général des monuments d’arbres ! »30 La proposition, que bien des commissaires réitéreront par la suite s’agissant des monuments de pierre, ne sera que moyennement suivie d’effets.
administrativement plus faciles à classer puisque libres de propriétaires. Les blocs erratiques et vestiges préhistoriques et romains pris en considération ne repré-sentent qu’un petit pourcentage des objets classés par rapport à une majorité d’égli-ses médiévales. Les bâtiments du XVIIIe siècle sous influence française ne trouvent aucune grâce aux yeux de Naef pas plus que ceux plus récents. L’archéologue tente par contre d’introduire quelques chalets du pays d’Enhaut, qui ne sont pas retenus à cause du fait qu’ils appartiennent à des privés. Dans le canton de Neuchâtel il revient à la Société d’histoire et d’archéologie du canton, guidée par l’écrivain Philippe Godet, de présenter en 1899 un projet de « loi sur la conservation des monuments historiques », projet reçu fraîchement par le Conseil d’Etat et largement amputé par la commission législative. C’est vidé de sa substance et privé d’efficacité qu’il est adopté en novembre 1902 et rendu effectif en 1903. L’une des tâches prioritaire de la première commission est néanmoins l’éta-blissement de la liste d’objets proposés au classement. Sur les quelques 467 objets signalés en 1904, seuls 307 sont finalement retenus en 1905-190624 et la situation ne change pas considérablement jusqu’en 1950, ce qui dénote l’inertie fréquente après la ou les campagne(s) fondatrice(s) ! Les bâtiments publics et religieux forment la majorité des objets classés, quand bien même quelques propriétés privées, de même que des sites naturels, des zones archéologiques ou des blocs erratiques entrent dans la liste aux côtés de l’em-blématique château de Valangin autour duquel s’est cristallisée la sauvegarde en pays neuchâtelois. En ville de Neuchâtel tant les immeubles médiévaux de la rue de la Collégiale et des abords du Château
(ainsi que la Collégiale et le Château) que les hôtels XVIIIe siècle de l’avenue du Pey-rou, du Faubourg ou de la rue de l’Hôpital sont classés tout ou partie en 1905, qu’ils appartiennent à la Commune, à l’Etat ou à des privés. L’arrêté de classement précise s’il s’agit du classement des volumes, des façades et des escaliers ou intérieurs, salons, etc. Les fontaines et puits anciens de la ville et leurs abords sont également protégés dans cette liste de 1905. En Valais c’est le Conseil d’Etat qui incite le Grand Conseil à promulguer une loi à l’imitation du celle du canton de Vaud. Cette « loi concernant la conservation des objets d’art et des monuments histori-ques » voit le jour en novembre 1906. Une commission de sept membres est créée pour procéder à « l’inventaire du patrimoi-ne cantonal et proposer […] le classement des objets majeurs »25, lesquels classe-ments vont trop souvent être contrecar-rés. On achoppe ici aux mêmes difficultés qu’ailleurs et seuls les propriétés de l’Etat ne posent pas problème. L’inventaire du patrimoine valaisan, qui progresse rapi-dement grâce au zèle du secrétaire de la Commission des monuments, le peintre Jo-seph Morand, n’aboutit malheureusement, à en croire Patrick Elsig, qu’à un classe-ment au coup par coup qui engendre la disparité du patrimoine classé valaisan.26 Dans la première liste établie entre 1907 et 1910 apparaissent quarante-trois ob-jets, essentiellement des châteaux, tours, églises et ruines médiévales situés à Sion, Sierre, Martigny, Monthey, St-Maurice, Loèche ou Entremont. Cette liste canto-nale ne connaîtra pas d’ajouts significatifs avant le début des années 1950.
8990
31 La Pierre à Bochet (Thônex), quant à elle, ne sera retrouvée fragmentaire, lors du creusement d’une route, qu’en 1968 et classée en 1970 seulement.32 Décret du 3 janvier 1889, art. 4, p. 14 : « Sont membres de droit [de la Commission des monuments historiques] : Le directeur des beaux-arts ; Le directeur des bâtiments civils et palais nationaux ; Le directeur des cultes ; Le directeur des musées nationaux ; Le préfet de la Seine ; Le préfet de police ; Les inspecteurs généraux des monuments historiques ; Le contrôleur des travaux des monuments historiques ; Le directeur du musée des Thermes et de l’hôtel de Cluny ; Le conservateur du Musée de sculpture comparée. »33 Il fut le premier président de la Commission des Monuments et des Sites. Voir dans la contribution de Sabine Nemec-Piguet et Luc Weibel, « Camille ou Camillo ou les deux portes du paradis », ds. Parallèles, Genève, n° 1, 1978, pp. 9-17
Le château de Dardagny début XXe siècle CIG
mières listes comme Albert Naef dans le canton de Vaud, Philippe Godet dans celui de Neuchâtel, Joseph Morand en Valais ? Faut-il imaginer au contraire que les membres de cette première Commission des monuments et des sites auraient agi collégialement ? Nommée en novembre 1920, constituée de spécialistes à l’ins-tar du modèle français32, la commission genevoise comprenait en effet un cercle d’experts compétents : à savoir Louis Blondel, archéologue, à la tête du « Vieux Genève », Waldemar Déonna, directeur du Musée d’art et d’histoire, Adolphe Guyon-net, architecte épris de tradition mais capable de modernité, John Lachavanne, licencié en droit, Camille Martin, historien de l’art et directeur du plan d’extension33, Eugène Pittard, professeur à l’Université, Burckhardt Reber, conservateur du Musée épigraphique, Louis Roux, député et prési-dent agissant de l’Association des intérêts de Genève, Albert Sylvestre, artiste peintre concerné par le patrimoine.
Tracer l’histoire de la constitution de cette liste au fil du temps, l’échelonnement ou l’espacement des classements dans le temps, les choix opérés et le pourquoi de ces choix, est d’un grand intérêt. Si les pre-miers classements ne surprennent guère et s’alignent sur les usages cantonaux et étrangers, on apprécie davantage de voir apparaître des séries d’objets qui forment des sous-ensembles cohérents au sein de cette liste en constitution : de véritables campagnes de classement portent sur les bâtiments de culte, les bâtiments publics de l’ancienne Genève, les hôtels et immeu-bles du XVIIIe siècle, les fontaines histori-ques. Une trentaine d’églises et de temples de ville et de campagne, de plus ou moins
Les deux premières campagnes de classement entreprises à Genève sont les plus importantes de l’histoire de la liste. Il s’agit en effet de constituer le corpus de base des objets jugés dignes d’être protégés de manière efficace, le fonds de commerce du patrimoine genevois. Ces campagnes prennent place au lendemain de l’adoption de la loi, entre 1921 et 1923, et désignent près de cent objets, 63 objets entre mai et décembre 1921, 31 en 1923. Ces deux premières campagnes de clas-sements obéissent à un double repérage, à la fois chronologique et topographique. Conformément aux exemples étrangers, bien qu’à l’échelon cantonal, ce sont d’abord les monuments les plus anciens, de la préhistoire au moyen âge, qui attirent l’attention en vue d’une protection, ce que favorise bien sûr la présence marquante de Louis Blondel comme secrétaire de la Com-mission des Monuments et des Sites. Les fouilles qu’il mène et les publications qu’il réalise induisent entre autres le classe-ment de six stations lacustres préhistori-ques, auxquelles on peut ajouter des blocs erratiques ou menhirs préhistoriques et gallo-romains, comme la Pierre-aux- Dames, partie d’un ensemble mégalithique à Troinex et devenue en 1942 pièce de mu-sée, ou les Pierres du Niton31. Les pierres dressées excitent il est vrai l’imaginaire des archéologues dès le début du XIXe siècle : Jean-Daniel Blavignac s’en émou-vait déjà lors de ses communications devant la Société d’histoire et d’archéolo-gie de Genève, tandis qu’en ville de Neu-châtel un décret était voté en 1838 pour protéger la Pierre-à-Bot. Faut-il considérer Louis Blondel comme la cheville ouvrière de la première CMNS et l’instigateur de ces deux pre-
9192
39 « Le patrimoine genevois : entre ignorance et vénération », ds. Aspects du patrimoine architectural Genève 1977-1993, Département des travaux publics, Service des Monuments et des Sites, Genève, 1993, pp. 15-32. Voir également Louis BLONDEL, « Liste des monuments et des sites classés dans le canton de Genève, ds. Genava, IX, 1931, pp. 47-59 « la tour a été conservée par un vote populaire du 19 février 1897 »40 Dans Genava, IX, 1931, pp. 47-59.
34 Comme l’immeuble de Tournes au numéro 7 de la Taconnerie racheté par l’Etat en 1917, l’immeuble Budé, 4 rue du Puits St-Pierre, racheté par l’Etat en 1920, l’ancien hôtel Lullin, 11 rue Calvin, acquis par l’Etat en 1876, ancienne maison de campagne Dunant, hors de l’ancienne enceinte, 28 rue Prévost Martin, ayant d’abord servi au XIXe siècle d’annexe à l’hôpital cantonal, l’ancien hôtel municipal, 4 rue de l’Hôtel de Ville, racheté par la Ville en 1874, l’immeuble Roques, 5 rue de l’Hôtel de Ville, légué à la Ville en 1847 par le baron Grenus, l’immeuble Duquesne, 2 cour St-Pierre.35 Louis BLONDEL, « Liste des monuments et des sites classés dans le canton de Genève », Genava, IX, 1931, pp 47-59.36 Fontaines du Bourg-de-Four, du Puits St-Pierre, de la rue Beauregard, du Grand-Mézel, du Molard, de la Fusterie et de Longemalle. Puis Beauregard et Grand Mézel, qui sont des fontaines du XIXe siècle, réalisées par Guillebaud et Collart.37 André LAMBERT, Les fontaines anciennes de Genève, Genève, 1921. Dans les années 1920 André Lambert publie les anciennes fontaines de différents cantons suisses.38 (nos 6-8-10 et 1-3)
puisque sauvée de la destruction par la vox populi en 1897 par les adeptes locaux du patrimoine, constitués ensuite en une Com-mission pour la beauté (1901) portant en germe l’embryon du Heimatschutz à venir.
En 1931 Louis Blondel publie dans la revue Genava une récapitulation des objets classés, soit « Liste des monuments et des sites classés dans le canton de Genève »40. Il ordonne cette liste géographiquement en trois chapitres que sont la Ville, la Ville haute et le Canton. Ces trois zones sont illustrées par un plan sur lequel sont reportés les monuments classés. Par Ville Blondel désigne la rive gauche de la Vieille Ville intra muros, même si le temple de Saint-Gervais est le seul monument classé pour la rive droite et figure sous canton, par Ville haute il désigne la colline à l’exception de la ville Basse. 21 objets pour la ville, 45 pour la ville haute et 58 pour le canton soit 124 objets en tout en 1931 parmi lesquels dix-sept sont en instance de classement, soit 107 objets classés seule-ment 12 objets de plus qu’en 1923.
Le réPertoire genevois Des monU-ments cLassés : évolution Et état actuEl Après les classements massifs de 1921 et 1923 ne s’opèrent plus que quelques classements sporadiques jusque dans les années 1950. Pourtant, dès 1928, apparais-sent les classements de sites naturels, le premier étant la Belotte, sorte de Nogent sur Marne lémanique où les Genevois en canotiers s’adonnent à la pêche, au cano-tage et aux régates à voile dès le XIXe siè-
cle et où prolifèrent alors les hôtels-pen-sions, dont ne subsiste aujourd’hui que le restaurant de la Belotte et sa remarquable terrasse ombragée de platanes. Les sites classés ensuite sont les emblématiques falaises de l’Arve, représentées sur les gravures du XVIIIe siècle déjà, les bords de la Drize et leurs rangées de peupliers, les rives de l’Allondon, pour ce que l’on appel-lerait aujourd’hui leur biodiversité.
Au lendemain des concours de la SDN et de la Gare Cornavin, la querelle des Anciens et des Modernes (dont Genève ne s’est toujours pas remise) conduit à un durcissement des sensibilités. Ingénieurs et architectes ressentent négativement le poids de l’histoire et rêvent de table rase. Les législatures d’Edmond Turret-tini (1931-1934) et de Maurice Braillard (1933-1936), sous la Genève Rouge de Léon Nicole, coïncident avec une suspension des classements, puisque entre 1935 et 1945 on ne classe, sous menace de démolition ou d’abattage, que cinq objets, dont deux groupes d’arbres. Durant le deuxième mandat de Louis Casaï, successeur de Braillard aux Travaux publics, pendant vingt ans conseiller d’Etat (1933-1954) et trois fois président du Conseil d’Etat, les classements reprennent lentement. Cependant Pierre Bertrand, historien des monuments à la CMNS, déplore dans les années 1950’ les mentions par trop spora-diques du patrimoine monumental dans les chroniques de Genava.
En 1935 le classement du château de Dardagny, longtemps après celui du châ-teau de Lancy, anticipe une brève série des classements de domaines. Cette mesure sanctifie un monument privé de dépen-dance41 et qui vient à l’époque de faire l’objet d’une rénovation lourde par Henri Mezger, toutes choses qui aujourd’hui
grande ancienneté, font partie des deux premières campagnes de classements : cela va de l’ancienne cathédrale romano-gothi-que de Saint-Pierre à l’église néo-classique St-Pierre-aux-Liens de Soral. Parmi les bâtiments civils anciens apparaissent en priorité ceux appartenant à la collectivité et dont on peut aisément garantir l’accord du propriétaire. Les principaux bâtiments publics encore existants de l’ancienne Genève figurent d’ailleurs en tête de la première liste établie en 1921 : l’hôtel de ville, l’arsenal, le Collège Calvin, le Palais de Justice, suivis par des propriétés de la Vieille Ville appartenant à la collectivité, essentiellement d’anciennes demeures du XVIIIe siècle rachetées par la Ville ou par l’Etat34. Les édifices formant ensemble oc-cupent rapidement une place dans la liste de classement.
Quelques monuments fameux par leur histoire et la gloire de leur propriétaire viennent s’ajouter à cela : le Palais « édi-fié par le célèbre philhellène35 » Eynard, alors propriété de la Ville, le Musée Rath, construit par la Société des Arts « main-tenant à la Ville », le château de Charles Pictet de Rochemont à Lancy et son parc (ce qui n’a pas empêché la transformation radicale menée par René Schwertz en 1957 pour en faire la mairie de Lancy, ni l’expro-priation récente d’une partie de la parcelle faite non sans heurts par les TPG pour la nouvelle ligne de tramway n° 15), ainsi que le parc de la Grange légué à la Ville en 1917. Les anciennes fontaines de la ville36, qui viennent alors de faire l’objet d’une publication par André Lambert37, ainsi que les quatre fontaines de Carouge érigées par Jean-Daniel Blavignac entrent également
dans la liste des monuments classés. Objet d’attention nationale, les fontaines helvéti-ques, dont certaines se signalent par leurs représentations allégoriques ou historiées, figurent dans la plupart des premières listes cantonales. Evocation de la citadelle calviniste, les plus spectaculaires vesti-ges des anciennes fortifications encore visibles, soit le mur de la Treille, le bastion de St-Antoine et les murs d’enceinte de l’île Rousseau figurent également sur la liste des monuments classés. Dans la liste de 1923 on distingue une volonté de protéger des ensembles de la Vieille Ville, comme la place de la Taconne-rie, où plusieurs immeubles représentatifs de l’architecture du XVIIIe siècle38 sont classés simultanément, l’ensemble consti-tué par la maison Tavel et la maison Ca-landrini, plusieurs maisons donnant sur le parvis de Saint-Pierre donnant la réplique au monumental portique d’Alfieri, l’exem-plaire alignement des nos 2 à 16 de la rue des Granges, issu de l’influence de Jules Hardouin Mansart, l’étonnant ensemble « Louis XVI » constitué des quatre immeu-bles de la rue Beauregard et du n° 18 de la promenade Saint-Antoine situé vis-à-vis.
On peut parler alors de classements systématiques dans ces deux premières campagnes, même, si, ici ou là, apparaît dans la série un objet singulier, mais emblématique. Ainsi les ruines du château de Rouelbeau, alors récemment fouillées et publiées par l’archéologue Louis Blondel, qui figurent comme premier objet sur la liste des monuments classés genevois. Ou la Tour de l’Ile, fragment de l’ancien château de l’Ile et monument-clé à l’origine de l’histoire de la sauvegarde à Genève39,
9394
43 On peut dire la même chose de la situation des autres cantons romands et de la France.44 Isabelle Roland, Isabelle Ackermann, Marta Hans-Moevi, Dominique Zumkeller , Les maisons de campagne du canton de Genève, Genève, Slatkine, 2006
41 Le maintien de la dépendance avait pourtant été demandé par une CMNS clairvoyante refusant un isolement « haussmanien »du château, mais refusée par le Conseil d’Etat en raison de son état de délabrement42 Il était une fois l’industrie : Zurich - Suisse romande : paysages retravaillés, ss. la dir. de Marc-Antoine Barblan, Genève, Association pour la patrimoine industriel, 1984.
sur la liste des monuments classés entre 1976 et les années 1990 sont également des bâtiments du XIXe siècle, soit inscrits dans le Ring comme la basilique Notre-Dame, l’église russe, la Holy Trinity Church, la Synagogue, qui a fait l’objet d’une belle restauration de son enveloppe polychrome, l’église St-François de Sales néo-byzantine, soit en Vieille Ville comme la chapelle de Pélisserie, soit en campagne comme l’église St-Maurice de Bernex ou la chapelle d’Eco-gia, toute deux de remarquables exemples néo-gothiques.
Le patrimoine moderne du XXe siècle, auquel les architectes sont immensé-ment attentifs aujourd’hui, ce qui au plan international se signale par la création de l’association DOCOMOMO. La dérive du classement appliqué à des objets qui viennent d’être livrés, comme l’ont été les bains du grison Peter Zumthor inaugurés à Vals en 1996 et classés deux ans plus tard mérite le questionnement. Prévu à l’origine pour sauver de la destruction et de la ruine des objets tombés dans l’oubli, en mal de réhabilitation, le classement doit-il concer-ner des objets qui sortent de terre, de sorte à les prémunir de possibles atteintes ? A Genève quelques objets modernes ont ainsi rejoint le panthéon : la maison Clarté (1986) dont le sort et la conservation semblent en voie d’être réglés, le Cinéma Manhat-tan de Marc-Joseph Saugey, menacé de démolition et au bénéfice d’un soutien international en 1993, la Maison Ronde dont le classement a été introduit par la Fondation Braillard architectes en 1995 et Miremont-le-Crêt du même Saugey, classé en 2004. D’autres objets du XXe siècle, en marge de la modernité, ont aussi bénéfi-cié de protection, comme l’église St-Paul, œuvre majeure du renouveau de l’art sacré ou le cinéma Alhambra de Paul Perrin, situé dans une zone déstructurée par les démolitions des années 1920’.
Telle qu’elle se présente aujourd’hui la liste des monuments classés genevois est d’une grande hétérogénéité43 ; il n’y manque que le raton-laveur ! Hormis les séries du début, les objets introduits récemment pour de strictes raisons de sauvegarde dénotent une politique du coup par coup. On peut affirmer à juste titre que la sélection des quelques 259 objets n’est pas représentative de l’éventail des richesses du patrimoine genevois. Certains objets sont sous-représentés comme l’ar-chitecture autour de 1900, de l’éclectisme à la modernité douce, l’architecture rurale (depuis longtemps recensée par le Service des Monuments et des Sites et qui vient pourtant de faire l’objet d’une publica-tion44), architecture rurale au contraire bien représentée dans le canton de Vaud et dans celui de Neuchâtel, l’architecture hô-telière dans une ville par tradition touris-tique, l’architecture résidentielle de toutes époques, les domaines et leurs mille villas déjà célébrées par Alexandre Dumas père !
Par ailleurs l’état de conservation d’un grand nombre d’exemples du parc des custodienda laisse à désirer : certains immeubles anciennement classés ont été totalement dénaturés, empaillés ou lourdement rénovés. Alors que la ques-tion de l’authenticité matérielle des objets taraude l’esprit des actuels défenseurs du patrimoine, force est de constater que le classement n’a, des décennies durant, aucunement prémuni les monuments des dénaturations. Aux listes de monuments classés s’ajoutent donc beaucoup de coquilles vides et quelques simulacres !
décourageraient quiconque d’introduire une demande de classement ! Les morcel-lements des grands domaines de Varembé, Vermont, Beaulieu dans les années 1950’ coïncident avec une campagne de classe-ments de domaines puisque, entre 1954 et 1960, on classe dix-huit domaines alors que de 1960 à nos jours on n’en classera seulement quinze. Certains classements tiennent lieu de sauvetages : la maison de maître de Château Banquet est classée en 1954 avant que ne surgisse le luxueux complexe résidentiel de Pierre et Maurice Braillard. Plusieurs domaines de la route d’Aïre à Vernier sont classés en 1957, alors que les projets pour la cité du Lignon de Julliard, Addor & Bolliger sont sur le point de voir le jour. En 1960 c’est la campagne de Budé qui, à la veille d’être lotie, est à son tour classée.
Une nouvelle série d’objets, celle des maisons fortes et tours médiévales en campagne, fait l’objet d’attentions nouvel-les. Si les premières manifestations de cet intérêt remontent à 1921 avec le clas-sement de la commanderie de Compesière et de la tour d’Hermance, il faut attendre 1945 pour voir ratifié le classement d’une grande partie du bourg médiéval d’Her-mance. Puis ce sont successivement la tour de Saconnex d’Arve en 1955, la maison forte d’Adda à Corsinge en 1956, la mai-son forte de Laconnex la même année, la maison forte d’Arare et la tour de Troinex dessus l’année suivante, l’ancien château de Veyrier en 1961. Tandis que les mai-res convoitent de plus en plus les vieilles tours et les maisons fortes pour y établir leurs bureaux, et ce non sans mal, malgré le suivi de la Commission des monuments et des sites (comme à la Tour de Meinier), d’autres classements s’opèrent dans les années 1980 comme ceux de la maison forte de Bardonnex en 1985 et de celle de Vésenaz en 1987.
Le patrimoine du XIXe siècle, apparu à titre exceptionnel dans la première cam-pagne de classement avec le palais Eynard et le Musée Rath, bénéficie d’attentions nouvelles dès la fin des années 70’. Les me-naces portant sur l’hôtel de la Métropole et le Musée de l’Ariana, menacé l’un de dé-molition, l’autre de transformation lourde, ouvrent alors les yeux du public sur ce patrimoine mal-aimé : le palais de l’Athé-née, palais de la vénérable Société des Arts née à la fin du XVIIIe siècle déjà, et le Conservatoire de musique sont classés tant pour leurs valeurs artistiques que pour leur rôle historique dans l’histoire gene-voise. De ces deux affaires et de quelques autres naîtra la loi Blondel votée en 1983 qui désormais permettra de protéger les ensembles urbains d’immeubles du XIXe et du début du XXe siècle. Ceci explique en partie le petit nombre de classement de ce patrimoine protégé par d’autres mesures. En 1987-1988 toutefois, l’ancien arsenal et l’école de médecine vis-à-vis sont classés ensemble, alors que se décide la démolition de l’ancien Palais des expositions tout près de là. L’Usine des Forces motrices, désaf-fectée, mobilise le soutien des amateurs de patrimoine industriel42, dont les effectifs, nés de la démolition des Halles Baltard à Paris, se solidarisent internationale-ment. La maison Eynard dont on découvre les richesses vient agrandir le quartier Eynard d’un néo-classique de bel aloi. A travers le classement du délicat monu-ment Brunswick, façonné à l’imitation de celui des Scaligeri à Vérone, les Genevois rendent un juste hommage au Duc, l’un des plus grands bienfaiteurs que Genève ait connu. Un lot assez hétéroclite d’im-meubles et maisons (Maison de la Tour, château El Masr à Cologny, Maison Royale sur le quai Gustave Ador, Maison Choffat à Lancy, Palais Wilson) est classé à la fin des années 1990 et au début des années 2000. Les églises qui font leur apparition
9798
45 Répertoire des immeubles et objets classés, Service des Monuments et des Sites, Travaux publics et énergie, Genève, 1994, p. 7.46 Même si la loi française a rapidement mis en place l’idée d’un diamètre de protection de 500 m. autour des monuments classés.
troUver Un sens aU cLassement
Si les listes actuelles d’objets classés ne constituent de notre point de vue pas le corpus des custodienda, elles nous en apprennent cependant beaucoup sur l’évolution du goût et de la sauvegarde mo-numentale et paysagère. L’étude des listes nous révèle des « classements d’époque » : les mégalithes et les stations lacustres, les antiquités gréco-romaines, les églises mé-diévales rallient le consensus des commis-saires jusqu’aux années trente. Les monu-ments reconnus de la Renaissance et des « Temps modernes » apparaissent selon les cas dès le début du XXe siècle, tandis que les monuments du XIXe siècle peinent à fi-gurer jusque dans les années 1970’. Depuis une vingtaine d’années le patrimoine du XXe siècle trouve aussi une place, toujours discutée, dans les listes. Parallèlement à ces grandes tendances, un échantillonnage hétéroclite de varia classés, peut-être dans l’idée du Musée imaginaire à la Malraux qui légitime la collection impossible, illus-tre une forme de désarroi et d’impuissance dans laquelle nous nous trouvons encore aujourd’hui. Comme le rappelle le Répertoire des immeubles et objets classés « le classement d’immeubles, de sites et d’objets considé-rés comme remarquables et dignes de pro-tection constitue à Genève la plus ancienne mesure de sauvegarde, entrée en vigueur en même temps que la première loi can-tonale sur la protection des monuments et des sites de 1920. »45 Sans doute cette mesure prenait-elle tout son sens face à un corpus restreint d’objets élus. La perte de vitesse du monument n’est plus à établir. Tout comme l’histoire structurelle a remplacé l’histoire événementielle, les en-sembles, l’architecture mineure et le quoti-dien de la ville se sont substitués aux ob-
jets singuliers. L’actuelle prolifération du patrimoine et l’apparition de ce qu’on peut nommer des valeurs patrimoniales diffuses conduit à une situation où ce n’est pas tant le monument46 singulier qui intéresse que les ensembles, les quartiers, les cités, les sites naturels, des cadres de vie aux contours malaisés à définir. La mesure de classement, qui peine à protéger les abords d’un monument, est a fortiori plus inadéquate encore pour sauvegarder ces combinaisons de construit, de vide et de végétalisé, qui passent pour de vraies valeurs face à un environnement délité et dégradé par des décennies d’intérêts aveugles et de promotions déréglementées. C’est pour cette raison que, dès les années 1970’, dans le canton de Genève, la mesure de classement et la mise à l’inventaire ont été supplantées par de nouveaux dispo-sitifs de protection. Les premiers plans de site ont vu le jour à Genève, successi-vement le plan de site de Saint-Gervais, quartier de Vieille Ville de la rive droite jusqu’alors sans protection, le plan de site de la rade, celui des rives du Rhône, etc.
La multiplication des mesures de protection, de la mise à l’inventaire au classement, des zones protégées aux plans de sites, pose la question de la pertinence et de l’actualité du classement, premier dispositif de protection de l’histoire de la sauvegarde. L’enrichissement du sys-tème légal conduit à une surprotection de certains objets bénéficiant tout à la fois d’une protection de zone, d’une inscription dans un plan de site et d’un classement à titre individuel. Paradoxalement d’autres objets significatifs ne bénéficient d’aucune mesure légale de protection. Et ce n’est pas faute de connaissances, d’inventaires et de recensements, puisque de nombreuses séries d’inventaires ont ratissé le canton, qui n’est pas bien grand. Mais les inven-taires n’ont pas été suivis des synthèses qui eussent été seules à même de désigner
La tour de l’ile, état 2006Leïla el-Wakil
99100
47 www.international.icomos.org/risk/2002/france2002.htm48 www.senat.fr/rap/r01-378/r01-37848.html49 « A moyen terme, il convient de réfléchir à une remise à plat de la distinction entre monuments classés et monuments inscrits pour des raisons financières certes, mais aussi dans la mesure où la ligne de partage actuelle tient parfois plus à des accidents de l’histoire ou à des raisons fiscales qu’à l’intérêt des bâtiments du point de vue de l’histoire ou de l’art. www.senat.fr/rap/r01-378/r01-37851.html
L’ancienne salle du cinéma rialto CIG, Ed. Boesch
les objets significatifs à protéger. De la mer de données, pour paraphraser Jean-Paul Benzecri, aurait dû naturellement émerger la liste des monuments classés, non de postulats, d’à priori, ou d’actions défen-sives ! En Grande-Bretagne, malgré une loi instaurée en 1950 seulement, le critère chronologique dicte une ligne de conduite infaillible puisque tous les bâtiments datant d’avant 1700 sont automatiquement classés.
Malgré ses limites, le classement continue pourtant d’exercer une fascina-tion sur les défenseurs du patrimoine qui pensent rarement à remettre en question cet outil. Comme si, dans une société com-pétitive qui se complaît dans le prestige de la nomination et du hit parade, le classe-ment promouvait les objets élus au rang de merveilles du canton ou du pays, non pas du monde ! Si bien que l’on continue de classer … de manière assez chaotique ; la liste, plutôt que d’être pensée et construi-te, se constitue par défaut. Ainsi à Genève ces vingt dernières années a-t-on classé par souci de sauvetage successivement la Villa Edelstein (1983), incendiée depuis et mise à neuf, sans avoir pour autant été déclassée, la maison forte de Bardonnex, la ferme Wuarin à Cartigny, qui était promi-se à la démolition, l’immeuble Clarté, seule réalisation de Le Corbusier à Genève, en très mauvais état de conservation, l’église St-Paul, remarquable témoin du renou-veau de l’art sacré, l’arsenal et l’Ecole de Médecine située vis-à-vis, la belle maison Guinand de la fin du XVIIIe siècle à Ca-rouge (déjà protégée par le plan de site de Carouge), l’usine des forces motrices avant sa transformation en salle de spectacle, la maison forte de Vésenaz, la maison Habel à Meinier, la Synagogue, étudiée et mise en couleurs depuis. Certains bâtiments
en instance de classement ont fait les frais d’incendies demeurés inexpliqués comme le Pavillon du Désarmement d’Adolphe Guyonnet, dévasté une nuit de 1er août des suites présumées d’un feu d’artifice. D’autres ont été démolis comme la maison Mirabaud (alias Maison Blanc) à Sécheron anéantie par de matinales pelles mécani-ques sous la législature de conseiller d’état Philippe Joye : un terrain vague recyclé en parking tient encore de lieu de mémorial à cette action d’éclat !
La « dilation indéfinie » de la notion de patrimoine « jusqu’aux frontières du flou et de l’incertain », pour reprendre la formule de Pierre Nora, met en crise la notion même de sélection. En France où les objets patrimoniaux classés sont nombreux, environ 15.000 pour l’ensemble du pays, près d’un cinquième des monu-ments sont, faute de volonté et d’argent, en « état de péril ».47 Si, comme le relève Bruno Foucart, « le patrimoine qu’il faut préserver pour les générations à venir est celui qu’il faut maintenir comme une richesse artistique ... dans la démocratie des arts »48, une mise à plat et un ques-tionnement renouvelé et perspicace devrait permettre tant de purger les listes que de les augmenter selon les critères qui sont les nôtres aujourd’hui49. La procédure lé-gale qui prévoit le classement prévoit tout aussi bien le déclassement. On s’étonne par conséquent de voir figurer sur la liste des objets à protéger des objets détruits ou dénaturés, qu’il serait après tout simple d’ôter. Mais à Genève on ne touche guère à la sacro-sainte liste des custodienda, si ce n’est pour l’ajout sporadique de tel ou tel objet. Serait-on arrivé à ce piège paradoxal de la patrimonialisation : la liste elle-même devenue objet de sauvegarde !
101102
Prison de st antoine, 1975CIG, Jean Gottraux
ancienne prison de st antoine, extention du Palais de Justice. intervention archiconcept a3 et moor, état 2007Sabine Nemec-Piguet
Palais de Justice, vers 1930CIG
103104
vue de genève de la place sturm, debut XXe
CIG
Comme le droit, la protection du pa-trimoine bâti ne repose sur aucun principe absolu, mais sur l’opinion et la pression des faits. Elle est, comme lui, un phénomène historique, mais à sa différence un phé-nomène apparu tardivement. Sans doute ses plus anciennes manifestations remon-tent-elles à l’antiquité ; sans doute peut-on encore mentionner les mesures prises à Rome à la fin du Quattrocento, ou au XVIe siècle par le roi François Ier pour la conser-vation des antiquités de Nîmes ; mais il s’agissait de décisions isolées, sporadiques, dénuées du caractère systématique que revêt aujourd’hui cette protection. Celle-ci, dit-on souvent, serait née de la prise de conscience qu’auraient entraînée les destructions ou les aliénations provoquées par la Révolution française. Il est indé-niable qu’elles jouèrent un rôle de cataly-seur, mais l’idée même était née de l’esprit des Lumières, comme en témoignent les règlements édictés dans plusieurs Etats al-lemands dès avant 1789. A cela s’ajouta au XIXe siècle l’importance accordée à l’his-toire, en particulier à l’histoire nationale, intérêt qui n’est lui-même pas étranger à la rupture introduite par la Révolution dans le cours du temps. Il faut de plus compter avec la mise en place, depuis la Révolution et l’Empire napoléonien, et cela même dans des pays qui leur avaient été hostiles, d’une organisation administrative beaucoup plus développée, beaucoup plus rationnelle, donc plus efficace aussi, qu’elle ne l’était auparavant, organisation qui, en raison même de son efficacité, se maintint après 1815 malgré la volonté de restauration affi-chée par les vainqueurs et s’étendit à tous les domaines de la vie publique. Aujourd’hui, donc, le principe d’une protection des monuments historiques paraît une évidence, du moins dans tous les pays occidentaux, qui ont tous élaboré une législation ad hoc et mis sur pied une administration chargée de la mettre en œuvre. Cette unanimité n’exclut pourtant pas d’importantes disparités entre les dif-férents pays, disparités dans la législation
et dans le fonctionnement des instances chargées de la protection du patrimoine qui tiennent aux traditions politiques et juridiques de chaque pays, mais aussi disparités dans la façon dont la loi est comprise et appliquée. Contrairement à d’autres domaines, en effet, dans lesquels les objets visés par le législateur sont susceptibles d’une définition objective et précise, la notion de monument historique, ou plus exactement la mesure de l’ « inté-rêt archéologique historique, artistique, scientifique ou éducatif » présenté par un monument et qui le rend digne d’être conservé (pour reprendre les termes de la loi vaudoise de 1969 ou de la loi genevoise de 1977 sur la protection des monuments) reste éminemment, ne disons pas subjec-tive, mais relative à certaines sociétés ou à certains groupes sociaux et varie beaucoup selon les époques. L’observateur venu de France, par exemple, ne peut qu’être frappé en Suisse, et plus particulièrement à Genève par l’audience dont jouissent et le rôle que jouent les associations de droit privé ayant pour but la défense du patrimoine, telles Patrimoine suisse (le Schweizerischer Heimatschutz) et sa section genevoise, la Société d’Art public, pour mentionner la plus ancienne d’entre elles. Sans doute de telles associations existent-elles aussi en France, mais quels que soient leurs méri-tes, elles pèsent peu face à l’administration et à ses fonctionnaires : il serait impensa-ble, en particulier, qu’elles pussent exercer un droit d’initiative et de recours – droit d’ailleurs malheureusement contesté en Suisse même par certains partis. La raison en tient évidemment aux différences de traditions politiques entre la France, où l’administration se sent investie d’un pouvoir régalien, et la Confédération, où les citoyens participent plus activement, et plus directement aux affaires de la cité. Cette différence se retrouve dans la composition des commissions compétentes. Alors que la Commission supérieure des monuments historiques, à Paris, comprend
De La Protection DU Patrimoine en généraL Et à gEnèvE En particuliErpar piErrE vaissE
105106
2 Le Centre des Hautes Etudes de Chaillot fait suite au Centre d’études supérieures pour la connaissance et la conservation des monuments anciens créé en 1920, qui avait pour origine la chaire d’histoire de l’architecture française créée en 1887 auprès du Musée de sculpture comparée (devenu par la suite Musée des Monuments français), et confiée à Anatole de Baudot. Il a pour but de former des architectes spécialisés dans la restauration architecturale.
1 C’est pourquoi l’Institut d’Architecture de l’Université de Genève avait créé, sous la direction de Bruno Reichlin, un diplôme de 3e cycle en conservation et restauration du patrimoine moderne et contemporain (c’est-à-dire du patrimoine du XXe siècle), diplôme qui apportait aux architectes désireux de se spécialiser dans ce domaine un nécessaire bagage de connaissances préalables. Il est regrettable que les réformes actuellement envisagées au sein de l’Université de Genève conduisent à l’abandon de ce cursus.
ailes / Je suis souris, vivent les rats »), cumulent les avantages de l’exercice d’une activité libérale lorsqu’ils assurent la maîtrise de travaux commandés par une clientèle privée et ceux d’agents de l’Etat lorsqu’ils interviennent sur des monu-ments historiques – tache pour laquelle ils sont rétribués par des vacations et des honoraires calculés en fonction du mon-tant prévisionnel des travaux. Les can-didats, qui doivent posséder un diplôme d’architecte, ont, en principe, suivi avant le concours une formation au Centre des hautes études de Chaillot, de sorte que les lauréats possèdent déjà, lorsqu’ils sont nommés, un sérieux bagage en matière de théorie et de pratique de la restauration2. A côté de ses avantages indiscutables, le système a pourtant des inconvénients. Si le recrutement par concours passe pour démocratique et assure la compétence des personnes ainsi recrutées, la nature même des épreuves du concours risque de favori-ser le conformisme, quand ce n’est pas l’op-portunisme ; par ailleurs, le recrutement par concours d’un corps de fonctionnaires développe la formation d’un esprit de corps qui conduit souvent à couvrir des erreurs ou des partis pris. C’est ainsi qu’au sein de la Commission supérieure des monuments historiques, les architectes en chef répugnent confra-ternellement à s’opposer au projet d’un confrère, fût-il des plus discutables. D’où, par exemple, l’avis favorable donné il y a une vingtaine d’années à la dérestau-ration de Saint-Sernin de Toulouse. Sans doute le chevet tel qu’on le voyait depuis le troisième quart du XIXe siècle était-il une invention de Viollet-le-Duc, qui prétendait, non d’ailleurs sans quelque apparence de raison, avoir rétabli son état primitif. Malheureusement, la mauvaise qualité de la pierre qu’il avait choisie avait été la cause de graves désordres auxquels il était
urgent de remédier ; mais sous prétexte qu’une simple restauration n’était pas techniquement possible, l’architecte en chef chargé de l’édifice proposa de détruire ce qui était, esthétiquement parlant, un chef-d’œuvre pour rétablir l’état ancien, c’est-à-dire, en fait, celui de l’église avant l’intervention de son illustre prédéces-seur, un état qui résultait manifestement d’adjonctions aussi tardives que malencon-treuses, et qui était au demeurant fort mal documenté. Il pouvait certes s’appuyer en cela sur l’article 11 de la Charte de Venise, qui dit que « les apports de toutes les épo-ques à l’édification d’un monument doivent être respectées, l’unité de style n’étant pas le but à atteindre au cours d’une restaura-tion », prescription radicalement opposée à ce que Viollet-le-Duc, un siècle plus tôt, avait cru devoir faire ; mais outre sa valeur esthétique, sa restauration appartenait elle-même à l’histoire du monument et devait à ce titre être respectée - d’autant plus que la prétention de rétablir un état antérieur était vaine et que ce qu’on voit aujourd’hui n’est jamais qu’une invention de la fin du XXe siècle. Dans cette affaire, l’architecte était largement sorti du rôle de simple exécu-tant, d’agent technique pour imposer une option entre deux états de l’édifice, option fondé, malgré le prétexte invoqué, sur un jugement d’ordre historique. En cela, il ne dépassait pas le cadre de ses compéten-ces dans la mesure où la formation des architectes en chef ne porte pas que sur les procédures de restauration des édifices anciens, mais comporte également une part importante d’histoire de l’architecture. Il convient cependant d’observer que dans cette affaire, si les architectes des Monu-ments historiques firent corps derrière leur confrère, à peu près tous les historiens de l’architecture médiévale ayant étudié le dossier s’élevèrent avec vigueur contre
presque exclusivement des experts, histo-riens de l’art (inspecteurs des Monuments historiques et universitaires) et architectes en chef des Monuments historiques, la législation genevoise procède d’un esprit plus démocratique, puisqu’elle fait large-ment place, dans la Commission des mo-numents, de la nature et des sites aux élus membres du Grand Conseil (fréquemment, par ailleurs, architectes ou historiens) ainsi qu’aux délégués « d’associations d’importance cantonale poursuivant par pur idéal les buts énoncés à l’article 1 ». On peut toutefois se demander si cette dispo-sition ne repose pas sur une double erreur d’appréciation. La commission, d’une part, comme toutes les commissions chargées de donner des avis dans un domaine spécial, n’a ni pouvoir de décision, ni non plus qua-lité pour prendre position sur les éventuels conflits d’intérêt entre ce qui ressortit à sa compétence et ce qui relève d’autres instances : si de tels conflits se présentent, c’est à un autre niveau qu’ils doivent être tranchés, par arbitrage entre les différen-tes directions du département dont dépend la Direction du patrimoine, si ce n’est entre plusieurs départements (il est d’ailleurs aberrant, à ce propos, que la Direction du patrimoine dépende encore du même département que les Travaux publics, alors que l’administration des Monuments his-toriques est rattachée, en France et dans beaucoup d’autres Etats, Länder allemands ou cantons helvétiques, au département ministériel chargé des affaires culturelles) C’est donc se tromper sur la fonction de la CMNS que de la vouloir représentative, par sa composition, des différents courants d’opinion entre lesquels se partagent le peuple et le Grand Conseil. Par ailleurs (et le succès des journées du patrimoine auprès du grand public ne saurait faire illusion), si les mesures prises en faveur de la conservation des monuments histo-
riques le sont en principe dans l’intérêt du peuple tout entier, il est exceptionnel qu’elles aient pour origine un vaste mou-vement d’opinion. Prendre conscience de la valeur du patrimoine bâti et veiller à sa sauvegarde n’a jamais été le fait que d’une minorité possédant des lumières dans ce domaine. Qui donc appeler à siéger dans une commission appelée ayant à formuler des avis sur la protection des monuments historiques, sinon des représentants de cette minorité, c’est-à-dire, principalement, des historiens de l’architecture et des ar-chitectes ? La présence des premiers semble aller de soi, bien qu’ils ne soient pas toujours, hélas ! insensibles au goût du jour et aux modes intellectuelles. Il n’en va pas de même pour les architectes. Sans doute sont-ils nécessaires à un certain niveau, dans la mesure où ils sont seuls compé-tents pour intervenir sur le bâti, donc pour mener à bien les restaurations qui s’im-posent ; mais à ce titre, leur rôle est celui d’exécutants qui n’ont à donner d’avis et à prendre de décisions que pour répondre à des questions d’ordre technique. Même à ce niveau, une compétence particulière s’impose que ne possèdent pas tous les architectes, car on ne restaure pas un château fort comme on construit un im-meuble ou un garage : il est indispensable de connaître les procédés constructifs en usage à l’époque où fut édifié l’objet sur lequel on intervient. Or l’enseignement de l’architecture ne comprend pas, en général, cette formation spéciale, bien que quelques efforts aient été accomplis récemment pour pallier cette lacune.1
La France, on le sait, a résolu le problème autrement, par la création d’un corps des architectes en chef des Monu-ments historiques recrutés sur concours qui, comparables à la chauve-souris de La Fontaine (« Je suis oiseau, voyez mes
107108
3 Pierre de Nohlac, « La défense des monuments historiques. Architectes et historiens », Revue des Deux Mondes, 1934/3 (15 juin), p. 829 et 831
The new world headquarters of Rolex in Genevacarte postale du siège rolex aux vernets années 1960 CIG
l’absurdité de cette restauration. Un tel clivage n’est pas nouveau : en 1934, Pierre de Nolhac, conservateur en chef du palais de Versailles, dénonçait déjà dans la grave Revue des Deux Mondes les restaurations abusives :
« C’est une grave erreur de l’Etat fran-çais de confier les édifices qui témoi-gnent de notre passé à des hommes, fort savants par ailleurs, mais qui n’ont pas reçu la moindre formation historique. Ils voient presque toujours, dans le monument confié à leurs soins, non l’œuvre de conservation prudente à accomplir, mais un chapitre per-pétuellement ouvert à leur initiative d’artiste…. Le malheur est que les uns et les autres, également bien intention-nés et informés dans des domaines différents, ne parlent pas la même langue et ne peuvent jamais s’entendre. Où les uns demandent la conservation la plus fidèle du passé par un entretien respectueux, les autres rêvent de réfec-tions définitives, de remises en état et de restaurations intégrales. Ainsi peu à peu, et morceau par morceau, tel de nos grands édifices se voit mutilé ou défiguré, avec une entière bonne foi et une triomphante maladresse. »3
S’il avait tort de prétendre que les architectes chargés de la restauration des monuments historiques n’avaient pas reçu la moindre formation historique, du moins Pierre de Nohlac dénonçait-il un travers professionnel qui ne s’explique que trop bien, sinon par l’appât du gain, du moins par le besoin d’exercer son talent au-delà de ce qui serait strictement nécessaire. Dans le cas de Toulouse, on peut soupçon-ner l’architecte responsable d’avoir, en se posant comme le correcteur de Viollet-le-Duc, nourrit l’ambition de s’élever au même niveau que son illustre prédécesseur – niveau dont il resta pourtant fort éloigné.
On connaît la célèbre définition donnée par Viollet-le-Duc de la restaura-tion dans son Dictionnaire raisonné de l’architecture française du XIe au XVIe siècle : « Restaurer un édifice, ce n’est pas l’entretenir, le réparer ou le refaire, c’est le rétablir dans un état complet qui peut n’avoir jamais existé à un moment donné. » Sans voir qu’il propose une définition pré-cise d’un mot employé encore aujourd’hui à tort et à travers pour désigner n’importe quelles interventions, y compris de sim-ples mesures d’entretien ou de réparations (qu’il ne condamne nullement, bien au contraire), et sans avoir la patience de lire la suite du texte, où il donne des exemples concrets qui témoignent d’un esprit très pragmatique, on dénonce aujourd’hui avec vigueur une telle conception à laquelle on oppose la prudence et le respect de l’état dans lequel le monument nous a été trans-mis qui prévaudraient actuellement. Or il faut bien avouer que les mérites dont notre époque se plait ainsi à s’enor-gueillir ne correspondent pas entièrement à la pratique, mieux illustrée, en France du moins, par l’anecdote suivante : il y a une quinzaine d’années, lors d’une séance de la Commission supérieure des monuments historiques, tandis qu’un inspecteur présentait un rapport sur un manoir breton proposé au classement, un architecte en chef s’empressa de déclarer mezzo voce qu’il conviendrait de suppri-mer sur le toit d’un commun des lucarnes (qui lui semblaient un ajout postérieur à la construction, parce que trop riches pour cet emplacement), mais d’en rétablir sur le toit du manoir lui-même – où il n’en avait peut-être jamais existé. Ce réflexe digne d’un Viollet-le-Duc, ou plutôt de la caricature qu’on en donne habituellement, se rencontre rarement à Genève, peut-être en raison de l’absence d’un corps spécifique d’architectes char-gés de la restauration des monuments. Il y sévit par contre un autre travers que
109110
4 Bruno Foucart, « L’œil de l’architecte », dans le catalogue de l’exposition Les concours des Monuments historiques de 1893 à 1979, Paris, Caisse nationale des Monuments historiques et des Sites, 1981, pp. 28-36
ensemble rue sénebier, état 2007 Leïla el-Wakil
la France, malheureusement, n’ignore pas, mais qui y semble proportionnellement moins répandu, malgré quelques scanda-leux exemples : le goût d’un style délibéré-ment moderne pour les adjonctions à un édifice ancien. Les architectes et les autres partisans de cette pratique s’appuient, pour la justifier, sur l’article 9 de la Charte de Venise, où il est dit que « sur le plan des reconstitutions conjecturales, tout travail de complément reconnu indispensable pour raisons esthétiques ou techniques relève de la composition architecturale et portera la marque de notre temps », et accessoirement de l’article 12, concer-nant les éléments destinés à remplacer les parties manquantes, qui doivent se dis-tinguer « des parties originales, afin que la restauration ne falsifie pas le document d’art et d’histoire ». Mais cette dernière prescription ne concerne que des éléments de la construction, éléments tels qu’une ou plusieurs colonnes, un chapiteau, les marches d’un escalier …. Elle trouve son analogue dans la restauration, ou plus précisément la réintégration des parties manquantes d’une peinture, qui se fait, du moins sur les panneaux du Trecento ou du Quattrocento, par la technique du trat-teggio, destinée à rendre sa lisibilité à la composition sans prétendre se confondre avec la couche picturale d’origine. Cette méthode, cependant, exclut les techni-ques et les caractères stylistiques de l’art contemporain : aussi bien les restaurateurs de tableaux, comme les restaurateurs d’autres catégories d’objets d’art, ne sont-ils pas des artistes et ne prétendent-ils pas faire œuvre originale. En ce qui concerne « les éléments destinés à remplacer les parties manquantes » d’un édifice, au de-meurant, l’article 12 prescrit d’abord qu’ils « doivent s’intégrer harmonieusement à l’ensemble », ce qui exclut tout effet de rupture aussi bien dans le style que dans le choix des matériaux.
Il est vrai que la restauration architec-turale se trouve confrontée à des difficul-tés qu’ignore le restaurateur de tableaux, dans la mesure où l’édifice possède en général une fonction pratique – comme habitation, musée ou autre -, et se trouve soumis de ce fait à un certain nombre d’exigences qui nécessitent plus que de simples réintégrations : des reconstitu-tions et même des adjonctions. Ces derniè-res sont concernées par l’article 13 de la Charte de Venise. Or lui aussi insiste sur la nécessaire conservation d’une harmonie d’ensemble, puisqu’elles « ne peuvent être tolérées que pour autant qu’elles respec-tent toutes les parties intéressantes de l’édifice, son cadre traditionnel, l’équilibre de sa composition et ses relations avec le milieu environnant ». On s’étonne alors du sort particulier que l’article 9 semble réserver aux reconstitutions conjecturales. Passons sur l’affirmation qu’elles relèvent de la composition architecturale, car il s’agit d’une évidence ; mais qui dit com-position architecturale ne dit pas encore recherche de l’originalité ou de l’expression personnelle : composer une façade dans le goût de Mansart ou de Palladio est encore composer. Quant à la marque de notre temps, ou plutôt de l’époque où la recons-titution est exécutée (car les auteurs de la Charte de Venise semblent croire ici que l’histoire s’arrête avec eux), elle autorise toutes les interprétations. « Il faut être de son temps » est l’une des injonctions qui reviennent le plus souvent dans les discours sur l’art depuis bientôt deux siècles ; elle n’en est pas moins absurde, car on est toujours de son temps, auquel on ne saurait échapper, sinon dans les contes pour enfants. Bruno Foucart a naguère montré que même dans les relevés d’architecture les plus consciencieux et qui se voulaient les plus objectifs se reconnaît le style de dessin de l’époque à laquelle ils furent exécutés.4 A plus forte raison en va-t-il de même pour toute restauration.
111112
Projet 107 La boîte à Gifles, un des 249 projets du concours organisé par Darier Hentsch & cie pour le relookage d’UniDufour
L’acier ni le béton n’ont fait disparaître la brique et la pierre, qui sont encore, elles aussi, de notre temps, et pour beaucoup de programmes plus pratiques et plus économiques que ces nouveaux matériaux. Aussi l’exigence formulée à l’article 9, que toute reconstitution architecturale portera la marque de notre temps, se réduit-elle à celle de l’article 12, selon laquelle les élé-ments nouveaux doivent se distinguer des anciens ; en aucun cas, elle n’autorise que soit ignorée l’exigence d’harmonie formu-lée au même article et reprise à l’article suivant. On criera, n’en doutons pas, au pas-tiche. Mais, outre que le terme n’est plus depuis longtemps qu’une de ces inju-res destinées à discréditer l’adversaire sans autre forme de procès, il permet de confondre deux choses bien distinctes : une imitation destinée à tromper (ce qu’on appelle en peinture un faux), donc à falsi-fier le document d’art et d’histoire, et une composition qui, sans prétendre se faire prendre pour ce qu’elle n’est pas, respecte en toute modestie l’emploi des matériaux, les techniques de construction et l’esthé-tique d’une époque antérieure. De plus, en fonction du goût du moment et du milieu auquel on appartient, l’imitation un peu trop fidèle du style de telle époque sera dénoncée comme pastiche, tandis que celle du style d’une autre époque suscitera des éloges à la mesure de l’admiration qu’on porte au modèle. En 1996, le concours organisé pour … ne disons pas l’embellis-sement d’Uni Dufour, concours qui aurait fait de nombreuses victimes si le ridicule tuait encore, a donné un bel exemple de cet état d’esprit. Quiconque a fréquenté le bâtiment connaît la qualité de ses espa-ces intérieurs, en particulier du grand hall d’entrée, aujourd’hui encombré de constructions parasites qu’il eût été conve-nable de faire disparaître, mais que le concours ne concernait malheureusement pas. Dès que le projet en fut connu, par contre, certains milieux de l’architecture genevoise, qui ne se trompaient peut-être
pas sur les intentions premières des pro-moteurs du concours, s’élevèrent contre ce qu’ils interprétaient comme une tentative de porter atteinte au caractère d’un édifice auquel ils attribuaient une valeur insigne. Mais le principal argument ne concernait pas le traitement des espaces intérieurs ; il tenait au lien que son apparence extérieure entretenait avec l’architecture de Le Corbu-sier. De fait, les façades, qui n’ont jamais reçu le revêtement de verdure prévu à l’ori-gine, rappellent de si près certains édifices bien connus de ce grand poète des formes architecturales que l’on serait habilité à parler de pastiche si ce prestigieux modèle n’auréolait de gloire sa pâle imitation. Nous semblons nous être éloignés des problèmes de restauration. Il n’en est rien. Le choix des objets à restaurer, le parti adopté pour la restauration furent toujours liés à la pratique architecturale d’une époque. La vogue du néo-gothique et du néo-roman n’est pas dissociable de l’intérêt presque exclusif alors porté aux monuments de l’époque médiévale, intérêt qui se traduisait par les efforts consen-tis pour leur sauvegarde, mais aussi par les études dont ils firent l’objet. Ce furent souvent les mêmes hommes, les mêmes architectes qui construisirent des églises en style gothique, qui restaurèrent des cathédrales et qui firent œuvre d’archéo-logue et d’historiens de cette architecture. Si le nom de Viollet-le-Duc vient aussitôt à l’esprit, longue est la liste des architectes qui, comme lui, firent preuve d’une double compétence : qu’il suffise de rappeler le Genevois Camille Martin, architecte et urbaniste, mais aussi auteur de nombreux ouvrages consacrés à l’histoire de l’ar-chitecture, en particulier d’une célèbre monographie de la cathédrale Saint-Pierre. Par comparaison, les peintres ne sont plus, depuis longtemps, des historiens de l’art qu’ils pratiquent : le cas de Milliet, auteur du très beau plafond qui orne le foyer (heu-reusement conservé) du Grand Théâtre de Genève et promoteur d’un célèbre recueil d’inscriptions latines et grecques concer-
113114
5 fonctionaliste avec un seul n, évidemment, comme rationalisme et nationalisme, l’orthographe qui s’est imposée n’étant qu’un témoignage d’inculture.
gare cornavin, état d’origine CIG, Cadoux
nant l’art de peindre reste une exception – mais il abandonna très tôt le métier de peintre. C’est pourquoi il y a plus d’un siè-cle qu’on ne recrute plus les conservateurs de musées parmi les artistes, alors que les architectes continuent à siéger dans les commissions compétentes pour la conser-vation des monuments. Un changement, pourtant, s’était produit avec l’avènement du mouvement moderne et le rejet qu’il entraîna, non seu-lement de l’histoire, mais de son enseigne-ment dans les écoles d’architecture. La pré-tention fonctionaliste (qui n’a pas toujours inspiré, tant s’en faut, une architecture vraiment fonctionnelle) s’accompagnait non seulement d’un refus de toute référen-ce au passé, mais aussi, en l’espace d’une génération, d’une ignorance largement ré-pandue5. Mais les principes pèsent peu face au besoin de s’appuyer sur une autorité qui légitime et consacre. Le Mouvement moderne hypostasié, doté d’une majus-cule, devint pour beaucoup ce qu’avait été l’Antiquité pendant plusieurs siècles : la référence absolue, avec, cependant, une innovation pour le moins curieuse dans l’emploi du vocabulaire : si l’expression de maniera moderna avait désigné la maniera gotica par opposition à la maniera antica, elle en vint, avec l’évolution de l’art de construire, à désigner la maniera antica telle que la pratiquaient les artistes de la Renaissance, alors que la modernité, au XXe siècle, semble s’être arrêtée, comme si l’architecture était parvenue à la fin des temps – d’où l’expression absurde, parce que contradictoire, de post-modernité, dont l’existence même montre combien le sens de la rigueur sémantique s’est effacé devant le désir de se montrer spirituel. Aujourd’hui, la proportion des architec-tes est insignifiante parmi les historiens de l’architecture médiévale ou classique, mais largement prépondérante parmi les historiens de l’architecture du XXe siècle, et surtout du mouvement moderne.
On ne saurait méconnaître les consé-quences positives d’un tel intérêt : il a largement contribué au progrès de nos connaissances dans ce domaine, tout comme les études menées par certains architectes du XIXe siècle avaient contri-bué au progrès des connaissances sur l’architecture gothique, et, de même que ces derniers avaient œuvré pour la conser-vation et la restauration des cathédrales, leurs successeurs actuels œuvrent pour la conservation et la restauration de l’archi-tecture moderne ou contemporaine. Parti-culièrement sensible à Genève en raison de l’importance prise par les architectes dans les instances de protection du patrimoine, cette action ne laisse pas, toutefois, de sus-citer quelques réserves. Un premier danger réside dans l’exclusivisme. Sans doute nul ne remet-il en cause la nécessité de proté-ger les édifices anciens ; mais pour le XXe siècle, la tentation existe, dans une ville où le concours pour le siège de la Société des Nations, en 1927, n’est toujours pas consi-déré avec la distance critique qui sied à l’historien, de confondre l’architecture du siècle avec celle du mouvement moderne et de vouer aux oubliettes de l’histoire tout ce qui ne ressortit pas à celui-ci – en d’autres termes de lui dénier le droit à l’existence et de l’abandonner au bras des démolisseurs. Certains propos tenus naguère sur la gare de Cornavin, dont la façade, très mal mise en valeur par l’aménagement de la place, ne mérite certes pas un excès d’honneur, mais ne méritait pas non plus une telle indigni-té, illustraient bien cet état d’esprit – com-parable en tous points à celui qui faisait, naguère encore, dans les musées français, envoyer pourrir en réserve les tableaux de peintres coupables de n’avoir pas été des adeptes convaincus de l’impressionnisme. En dehors même de cet exclusivisme, qui reste heureusement minoritaire, le be-soin d’ancêtres dont on puisse se réclamer, celui de légitimer par l’histoire sa propre
115116
echafaudage pour le maintiende la façade no5 rue de la corraterieSMS
immeuble camoletti, état 2006Leïla el-Wakil
création ou les principes théoriques sur lesquels on prétend la fonder risque de pousser à la protection d’objets dont la conservation serait sans doute souhaitable s’il était possible de tout conserver. Nous touchons ici à la question fondamentale sur laquelle repose la protection du pa-trimoine monumental : pour quelle raison conserver ? Or, nous le savons, elle ne peut recevoir de réponse absolue parce que la réponse est toujours relative à une époque et à un milieu social. Il existe des monu-ments dans lesquels semble s’incarner aux yeux du plus grand nombre le passé de la nation. Ils sont rares. La plupart des édifi-ces protégés le sont, nous l’avons dit, par la volonté d’une minorité. Encore faut-il que celle-ci prenne ses décisions ou donne ses avis dans ce qu’elle pense être l’intérêt de la plupart, et en particulier des générations à venir, et non pas pour des motifs qui ne concernent, ne peuvent et ne pourront ja-mais concerner qu’une étroite corporation. S’il importe, par exemple, de protéger un ancien moulin de pâte à papier comme unique ou rare témoin visible d’un pro-cédé de fabrication en usage pendant des siècles, quels sacrifices la communauté doit-elle consentir pour conserver tel mur-rideau dont se réclament quelques archi-tectes parce que le procédé de construc-tion en était neuf en son temps, même si, indiscernable à la vue de qui regarde l’immeuble, il ne peut être efficacement documenté que par l’écrit et le dessin ou la photographie, et s’il n’a connu aucune pos-térité ? En d’autres termes, certains efforts de protection, louables en soi et qu’on sou-haiterait couronnés de succès si tout était possible, risquent fort, dans la mesure où les exigences matérielles et financières que l’on connaît imposent des choix, d’apparaî-tre un jour comme des excès susceptibles de discréditer la cause même au nom de laquelle ils furent entrepris.
117118
Publié grâce au soutien de :
institut d’architecture de l’Université de genèveFondation Hans Wilsdorfville de genèveBanquiers Privés Lombard odier Darier Hentsch & ciemirabaud & cie, banquiers privésservice des monuments et des sites (Dcti)