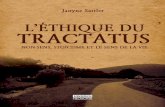Où il est montré qu’en arabe classique la racine n’a pas de sens et qu’il n’y a pas de...
Transcript of Où il est montré qu’en arabe classique la racine n’a pas de sens et qu’il n’y a pas de...
LA RACINE EN ARABE CLASSIQUE 1
OÙ IL EST MONTRÉ QU'EN ARABE CLASSIQUE
LA RACINE N'A PAS DE SENS ET QU'IL N'Y A PAS DE SENS A DÉRIVER D'ELLE *
par
Pierre Larcher
0. « Or, contrairement aux langues européennes, les mots arabes dérivent le plus souvent, de façon évidente, d'une racine. Maktūb, maktab, maktaba, kātib, kitāb, par exemple, sont tous construits à partir d'une racine k.t.b. “écrire”, alors que le français pour désigner [c'est moi qui souligne] les mêmes objets, a recours à cinq mots sans lien les uns avec les autres : écrit, bureau, bibliothèque, secrétaire, livre. Les mots français sont tous les cinq “arbitraires”, les mots arabes soudés, par une transparente logique, à une racine qui seule est arbitraire » (Jacques Berque, Les Arabes, Sindbad, 1973, p. 42). Si je cite d'emblée cet extrait d'un illustre orientaliste français, c'est parce qu'il résume la thèse qui sera ici contestée, en me donnant tous les moyens de le faire. Selon cette thèse, une famille lexicale arabe (où arabe = arabe classique) se définit comme l'ensemble des mots dérivés d'une même racine (ici KTB), sur laquelle ils sont construits sur le plan morphologique et qui garde, à travers ses avatars formels, un même sens (ici “écrire”). A cette thèse, fort répandue parmi les arabisants et qu'il illustre par l'exemple le plus répandu parmi eux, Berque ajoute le sentiment, fort répandu aussi, d'une opposition radicale entre le système de l'arabe et celui du français. Cette opposition repose ici et plus particulièrement sur une confusion grossière de la signification et de la désignation, contre laquelle Benveniste (1969) mettait en garde : si le mot kātib désigne un “secrétaire”, c'est dans le cadre d'un emploi nominal d'une part et dans un contexte historique particulier d'autre part. Dans le cadre d'un emploi nominal, mais dans un autre contexte historique, il désignera un “écrivain” et dans le cadre d'un emploi nominalo-verbal, il signifiera “écrivant”. Contexte verbal et contexte non-verbal jouent donc un rôle dans l'interprétation d'un mot. On pourrait dire que cela n'intéresse pas directement la morphologie lexicale si aux différences syntaxiques et historiques ne correspondaient des différences morphologiques : à l'emploi participial
* Version remaniée d'une conférence faite au séminaire de DEA “Sciences du langage” de l'Université de Provence le 26 Mai 1992, à l'invitation de Christian Touratier et sous le titre “La “racine” a-t-elle un “sens” en arabe classique ?”. Le système de transcription de l'arabe est celui d'Arabica, sauf dans les sources secondaires, où est conservé le système propre à la source citée.
2 PIERRE LARCHER
de kātib correspond le pluriel externe diptote kātibūn (īn) 1, à l'emploi nominal de kātib les pluriels kataba ou kuttāb selon qu'on l'entend au sens “classique” de “secrétaire de chancellerie” ou moderne d'“écrivain”. On voit tout de suite que la traduction de kātib par “écrivant” ou “écrivain” rétablit en français un lien avec le verbe “écrire” (celui qui unit un participe présent et un nom d'agent au verbe correspondant) aussi “nécessaire” que celui que Berque pose entre kātib (l'arabe n'a qu'une forme là où le français en a deux) et la racine KTB/“écrire”. A ce jeu, pourquoi ne pas traduire maktab, plutôt que par “bureau”, par “écritoire” qui en français médiéval a le sens du latin scriptorium, autrement dit le sens étymologique de maktab (“lieu où l'on écrit”) ? Inversement, si on substitue “librairie” à “bibliothèque” pour traduire maktaba (c'est le français qui distingue, non l'arabe), on rétablira en français un lien sémantique et formel avec “livre”, traduction de kitāb, mais on établira du même coup qu'en arabe maktaba ne se rattache à la racine KTB/“écrire” que par l'intermédiaire du nom kitāb/“livre”... 1. « Une illusion d'optique semble avoir déformé l[a] perception [qu'ont les nationalismes arabe et juif] de l'Etat-nation des lumières. Alors que celui-ci s'édifie sur les ruines de l'Ancien Régime, eux aspirent à relever les “royaumes” anciens. Là où il innove, ils se rémémorent, là où il instaure, ils restaurent. Cela correspond, curieusement, à l'étymologie du mot “progrès”, Taqadum [sic : en fait taqaddum] en arabe, Qadima en hébreu, de la même racine Qdm signifiant indistinctement avance et arrière, devant et antique » (Slimane Zeghidour, “Quel Juif, quel Arabe est-ce là ?”, in Autrement n° 85, Islam : le grand malentendu, 1987, p. 181). Cette seconde citation montre, de manière presque caricaturale, à quelles propositions linguistiquement inacceptables peut conduire une conception par trop “radicale” (si j'ose dire !) du rôle de la racine en sémitique : il suffit d'un instant de réflexion, en effet, pour apercevoir qu'une langue comme l'arabe —en entendant toujours par là, bien sûr, sa variété dite “classique”— n'a pas une racine QDM ayant la signification indistincte que lui prête l'auteur ; ce que l'arabe, ou plutôt son lexique, a —ou a eu—, en revanche, ce sont trois verbes qadama-yaqdumu, qadima-yaqdamu, et qaduma-yaqdumu : le premier, verbe d'action transitif, dénote une antériorité spatiale (“être devant quelqu'un, le devancer, le précéder”) ; le troisième, verbe d'état intransitif, dénote une antériorité temporelle, le plus souvent spécifiée d'ailleurs comme “ancienneté”, dans l'acception “polaire” et non pas “catégorielle” de ce terme 2 ; quant au second, il a le sens d'“arriver”, de “venir” : je
1 en arabe dialectal seul susbsiste le cas régime, sur lequel se règlent les emprunts du français à l'arabe, tant anciens (Assassins) que modernes (fedayin). 2 pour emprunter une distinction à Ducrot (1972 : 214). Si je demande à quelqu'un quelle est son ancienneté dans son grade, c'est un emploi “catégoriel”; si en revanche je parle de l'ancienneté d'une famille, le même terme désigne le pôle positif de la catégorie.
LA RACINE EN ARABE CLASSIQUE 3
suppose qu'il signifie à lettre quelque chose comme “(s')avancer”. Il ne s'agit donc pas de transférer abusivement à la “racine” un ensemble de significations dont chacune est déterminée par la forme particulière où cette “racine” apparaît et, éventuellement, son environnement syntaxique : si une signification peut être attribuée dans le cas d'espèce à la “racine” —hypothèse que je mettrai plus loin en doute sur un exemple concret—, c'est exclusivement celle d'“antériorité”. De la manière la plus distincte qui soit, la signification “arrière” ne fait nullement partie du champ sémantique de la “racine” QDM : elle appartient au contraire à celui de la racine antonyme ’ḪR ; cette erreur, où se retrouve le goût pour l'énantiosémie qui fit jadis les délices, épinglées par Reig (1971), d'un certain orientalisme, est due au fait que l'auteur ne se contente pas de superposer sens de la marche et axe du temps, où se déterminent l'une par rapport à l'autre “antériorité” et “postériorité”, encore comprend-t-il ces relations purement “objectives” comme des relations “subjectives”, où l'énonciateur, de tiers observateur, devient “repère” : l'avenir est en marche et notre héros traîne tout son passé après soi... Conclusion : au politologue de déterminer si les “progressistes” arabes entrent dans l'avenir à reculons ; au linguiste de rappeler qu'il ne saurait en fonder la thèse, pour piquante qu'elle soit, sur des hypothèses linguistiquement aussi fragiles que la prétendue signification indistincte d'une “racine”... 2. « Le mot arabe shahīd qui (...) connote [la notion de martyre] dérive d'une racine signifiant “témoigner, porter témoignage”, que l'on peut rapprocher du grec martyros » (Bernard Lewis, Juifs en terre d'islam, Calman-Lévy, Paris, 1986, p. 104, tr. fr. de The Jews of Islam, Princeton University Press, 1984). Là encore, le linguiste renâcle ! Tout d'abord, le mot šahīd ne “connote” pas la notion de martyre, mais la dénote : qu'est-ce qu'un martyr (sens de šahīd), en effet, sinon quelqu'un qui a subi le martyre (šahāda, istišhād) ? Ensuite si calque il y a (le grec martys-martyros signifiant “témoin”, l'hypothèse est vraisemblable), il faudrait remarquer qu'il opère en utilisant l'opposition fā‘il/fa‘īl : à la différence du grec qui a un seul mot signifiant tout à la fois “témoin” et “martyr”, ce qui fait apparaître le second sens comme une spécialisation du premier (le “martyr” comme “témoin de Dieu”), l'arabe a deux mots apparentés : šāhid, qui signifie “témoin” et šahīd, qui signifie “martyr”, le second étant considéré, dans la tradition grammaticale arabe, comme l'une des “formes intensives” (’abniyat al-mubālaġa) du premier. Enfin et comme dans l'extrait précédent, la relation de dérivation est posée entre la “racine” et le mot et, bien entendu, ordonnée de la première vers le second (“racine” → mot). J'ai proposé ici-même (Larcher, 1983) d'appeler “déradicative” cette “dérivation-à-partir-de-la-racine” (désormais D-Rad). Il y a toutefois entre les deux extraits une double différence : en ne parlant pas d'“étymologie”, le second n'oblige pas à faire de cette relation une interprétation
4 PIERRE LARCHER
historique, ou, comme disent les linguistes, diachronique ; en second lieu, le transfert de sens est moins abusif que dans le premier cas : n'est ici attribué à la “racine” que ce qui constitue l'un des deux sens du verbe šahida-yašhad- ; sens que l'on saurait d'autant moins confondre l'un avec l'autre que leur correspondent deux maṣdar-s (nomen verbi) : šuhūd pour šahida = “voir, observer, assister à, être présent à...”, mais šahāda pour šahida = “attester, témoigner de quelque chose”. La polysémie est embarrassante pour la D-Rad. De deux choses l'une, en effet : ou bien il n'y a aucune relation entre les différents sens et l'on peut se tirer d'affaire en posant des “racines” homonymes (cf. infra) ; ou bien il existe entre eux une relation évidente ou que l'on peut mettre en évidence et, là encore, il y a deux possibilités : ou bien l'on attribue à la “racine” un sens suffisamment général pour être compatible avec les significations particulières qu'introduira sa “mise en forme” (cf. supra, l'exemple de QDM = “antériorité”) ; ou bien on choisit parmi ces sens l'un que l'on considère comme logiquement, sinon historiquement, “premier” et que l'on attribue à la “racine”. Mais c'est alors d'emblée reconnaître que si la “forme” détermine la signification grammaticale du mot régulier, la “racine”, elle, ne détermine pas, à tout le moins ne détermine plus, l'entièreté de la signification lexicale de celui-ci : le sens de la “racine” peut en fait être relu à travers celui d'un mot qui en est donné comme dérivé. Dans le cas particulier de la famille lexicale actualisant la “racine” ŠHD, on voit tout de suite que si on lui attribue directement le sens de “témoigner, porter témoignage”, on ne pourra même pas rendre compte de l'autre sens du verbe šahida ! C'est pourquoi je partirai, quant à moi, non pas de la “racine” ŠHD mais du verbe šahida dans son sens de “voir, observer” (désormais šahida1). Et pour rendre compte du sens de “témoigner” (désormais šahida2), je supposerai un double mouvement, dont le pivot est pour moi la valeur intermédiaire, dont je n'ai soufflé mot jusqu'ici intentionnellement, de “être témoin de quelque chose” : celle-ci peut être décrite tout à la fois : 1) comme le résultat de l'action désignée par šahida1, suivant un processus décrit par Benveniste (1969, 2 : 173-4) pour les langues classiques : « le témoin, à date très ancienne, est témoin en tant qu'il “sait”, mais tout d'abord en tant qu'il a vu » ; 2) comme la base d'un mouvement de type “auto-délocutif” (selon la terminologie de Cornulier, 1976 : pour des exemples en arabe, cf. Larcher 1983, 1985) : “témoigner, c'est se dire témoin de quelque chose” 3. Bien qu'il ne s'agisse que d'une hypothèse, on peut produire en sa faveur deux séries d'arguments, les uns tirés de la morphologie et les autres des textes. šahida est un verbe fa‘ila, intermédiaire entre les verbes d'action fa‘ala et les verbes d'état fa‘ula. Intermédiaire, parce que l'ensemble des verbes fa‘ila se définit, en extension, comme l'intersection des 3 cf Lisān al-‘Arab = LA, art. ŠHD : ’aṣl al-šahāda al-’iḫbār bi-mā šāhada-hu (“témoigner a pour origine affirmer ce que l'on a vu”. Le verbe III šāhada conserve jusqu'à aujourd'hui le sens originel de šahida.
LA RACINE EN ARABE CLASSIQUE 5
deux ensembles “verbes d'action” et “verbes d'état”, fournissant des exemples des uns et des autres. Intermédiaire, parce que cet ensemble est définissable en intension comme celui des verbes moyens : mais alors que Fleisch (1979 : 231), qui, pour l'essentiel, applique à l'arabe des idées développées par Benveniste (1950[1966]) pour le grec les interprète comme des “moyens” entre l'actif fa‘ala et le passif fu‘ila, je les interprète pour ma part comme des “moyens” entre verbes d'action fa‘ala et verbes d'état fa‘ula, le même verbe fa‘ila pouvant être, selon qu'il est intransitif ou transitif, indirect ou direct, l'un ou l'autre : cf. ‘alima = “être savant”, ‘alima bi-hā = “être savant en quelque chose”, ‘alima-hā = “savoir quelque chose” 4. Or šahida est transitif direct dans son sens 1, transitif direct ou indirect (bi-) dans son sens 2. Nous considérons cette dernière construction comme l'état intermédiaire du verbe, tant sur le plan syntaxique que sémantique (“être témoin de (qqchose)”). Avec une telle hypothèse, il est alors possible de comprendre : 1) qu'à šahida correspondent, avec šahīd et šahāda, un nom fa‘īl et un nom fa‘āla, situation attestée pour maint verbe d'état fa‘ila (e.g. salima “être sain et sauf”, salīm “sain et sauf”, salāma “santé, salut”) ou fa‘ula (e.g. karuma “être généreux”, karīm “généreux”, karāma “générosité”), mais bizarre si šahida est un verbe d'action : il suffit d'ouvrir le Coran (e.g. II, 282 etc.) pour vérifier qu'avant même de signifier “martyr”, šahīd signifie “témoin” ; mais on posera qu'il ne signifie pas “témoin” comme “personne qui témoigne” (rôle dévolu à šāhid), mais comme “personne qui est témoin”, en tant qu'elle a vu quelque chose ou y a assisté 5 ; et : 2) que le même nom šahāda, au départ nom substantif renvoyant au nom adjectif šahīd, renvoie au sens le plus actif du verbe šahida, celui de “témoigner, attester” : le mouvement “auto-délocutif” précité introduit un sens d'activité dans une forme dont ce n'est pas le sens “normal”. Une telle “incorporation” (qui porte en arabe le nom technique de taḍmīn) est cependant un phénomène banal, même sans “autodélocutivité”. Ainsi quand ḫaṭīb passe du sens de “(homme) éloquent” à celui d'“orateur”, le nom correspondant ḫaṭāba passe de celui d'“éloquence” comme qualité à celui d'“activité de ḫaṭīb”. C'est sur l'ambiguïté de šahida (“être témoin de”/“se dire témoin de”) que nous serions tenté d'articuler la dualité de forme du tašahhud, telle que rapportée par le Muwaṭṭa’ de Mālik (m. 93/179). Le tašahhud désigne la partie de la prière canonique (ṣalāt), où
4 on a compris que je faisais du verbe qadima cité en 1 un verbe “moyen”. 5 on pourrait unifier la description de fa‘īl en posant que le fa‘īl “intensif” de fā‘il, le fa‘īl forme principale de l'“adjectif assimilé [au participe actif]”, lié aux verbes d'état fa‘ila et fa‘ula, et le fa‘īl bi-ma‘nā maf‘ūl, lié au passif des verbes d'action (ex. qatīl = “tué”) ont tous en commun sur le plan syntaxique d'être lié à un verbe intransitif (ou ayant un emploi intransitif, où intransitif = non transitif direct) et sur le plan sémantique de marquer l'aspect accompli par opposition à fā‘il marquant l'aspect inaccompli.
6 PIERRE LARCHER
l'attestation de la foi (šahāda) est précédée du performatif (Austin, 1962)’ašhadu ’an (“j'atteste que”). Mais Mālik (n° 146, p. 68 de l'éd. ‘Abd al-Wahhāb ‘Abd al-Laflīf, Beyrouth, Dār al-kutub al-‘ilmiyya 1399/1979) rapporte une variante en šahidtu ’an, qui signifierait donc, non pas “j'atteste que...”, mais “je suis témoin que...” et serait ainsi, non pas un performatif, mais, en appliquant à ce cas d'espèce l'hypothèse de Ducrot (1975), l'usage à l'origine du sens performatif de šahida. Notons enfin que la même ambiguïté se retrouve aux formes augmentées IV (factitif de I) et X (réfléchie indirecte de IV). A l'actif ’ašhada et istašhada renvoient à šāhid (“témoin”) signifiant respectivement “faire témoin quelqu'un” et “prendre à témoin quelqu'un”, tandis qu'au passif ’ušhida et ustušhida renvoient à šahīd (“martyr”) signifiant respectivement “être fait martyr” et “subir le martyre”. 3. Les trois citations qui précèdent nous ont permis de poser la thèse ici contestée, de prendre la mesure des dégâts qu'elle occasionne, de proposer, déjà, des moyens d'y remédier. Cette thèse comprend au vrai deux propositions. L'une, essentielle, est commune aux trois citations ; l'autre, accessoire, est propre à la seconde : la “racine” —en entendant par là un n-uplet ordonné de consonnes (auxquelles j'assimilerai ici et par commodité les glides w et y — peut-elle être considérée comme la base de la dérivation lexicale en arabe et, accessoirement, comme l'étymon du (ou des) mot(s) qui en serai(en)t dérivé(s) ? Des deux, la seconde me paraît avoir un caractère aussi éminemment poétique que franchement absurde : tenir pour une racine-étymon revient en quelque sorte à faire des « mots de la tribu » une tribu de mots, où la racine serait l'ancêtre commun de la famille et les membres de celle-ci ses rejetons ! Cantineau (1950 : 121) met en garde contre une telle interprétation : « il ne faudrait pas croire que la notion de racine ait en sémitique un caractère historique, que ce soit un élément plus ancien et originel d'où les mots auraient été successivement dérivés ». Et on relève chez Fleisch (1961 : 248) cette forte proposition : « une racine ne préexiste ni n'existe par elle-même, elle fait partie de mots différents les uns des autres, son existence est manifestée par l'analyse ». On serait tenté d'aller plus loin et de dire que c'est parce qu'elle n'existe pas indépendamment du mot dont elle fait partie qu'une racine ne saurait lui préexister. Est-il besoin de rappeler ici qu'en elle-même, c'est-à-dire comme suite discontinue de consonnes, elle constitue une séquence imprononçable ? Seuls des arabisants non linguistes ont pu, semble-t-il, concevoir l'idée folle d'une D-Rad en un sens historique, mais, pour le reste, ils peuvent s'autoriser des grammairiens, philologues et linguistes arabisants. Car ceux-ci, même s'ils ne font pas de la racine la base historique du processus dérivationnel, n'en font pas moins et non moins généralement de la racine la base logique de ce processus, à commencer par Cantineau (1950) et Fleisch (1961), déjà cités, avec cependant d'importantes nuances de l'un à
LA RACINE EN ARABE CLASSIQUE 7
l'autre. Pour le premier, qui a lu Saussure (1916), tout mot régulier de l'arabe s'analyse en une « racine » et un « schème », dégagés par une double association de ce mot aux mots de même racine d'une part, aux mots de même forme d'autre part. Ce que Cantineau représente (p. 124) par le schéma saussurien suivant 6 :
Schéma 1
Mais s'il dit comment un mot s'analyse en une racine et un schème, Cantineau ne dit pas comment s'opère la synthèse des deux. Il qualifie cependant de «croisés» les deux systèmes dégagés par l'analyse associative, celui des racines et des schèmes : un linguiste comme D. Cohen (1970[1964] : 31) a alors compris (et on a beaucoup repété après lui) que, pour Cantineau, un mot était le produit du croisement d'une racine et d'un schème (formule mot = racine x schème), ce qui peut se représenter par le schéma suivant, symétrique du précédent (il représente la composition du mot comme le précédent en représentait la décomposition) :
Schéma 2
Maintenant qu'est-ce que croiser une racine et un schème ? Paradoxalement, c'est par la bande qu'il est loisible de s'en faire une idée. Pour attester le caractère actuel et vivant du système des racines et des schèmes, Cantineau note (p. 121) que « cela se voit bien dans les mots d'emprunt : par exemple en arabe, si d'un mot tel que qamīṣ “tunique, chemise”, emprunt au bas-latin camisa, on veut tirer un verbe dénominatif, ce n'est pas à ce mot lui-même qu'on a recours, mais à sa racine qmṣ, dégagée aussitôt pour les besoins de la cause, et sur laquelle on forme, selon un procédé qu'on étudiera plus loin, le verbe qammaṣa “il a revêtu quelqu'un d'une tunique” ». Le procédé est effectivement étudié plus loin (p. 124) : « quand on veut tirer un mot d'un autre mot, on ajoute rarement au radical du premier un préfixe ou un suffixe : on préfère en général remonter 6 en réalité, je le simplifie : entre racine et mots figurent les mots de même racine mais de schème différent, entre schème et mot les mots de racine différente mais de même schème.
8 PIERRE LARCHER
à la racine et en tirer, sur le modèle d'un schème connu, un autre mot dont le radical sera tout différent de celui du premier mot. Ainsi, quand d'arabe qiṭṭ- “chat” on veut tirer un diminutif, on n'ajoute pas un suffixe comme dans français “chaton”, mais de la racine qṭṭ et sur le modèle du schème fu‘ayl- de diminutif, on tire un mot quṭayṭ- “chaton” dont le radical est tout différent de celui de qiṭṭ- » 7. Autrement dit, pour Cantineau, dériver un mot, c'est le tirer d'une racine sur le modèle d'un schème connu, bref le “former” sur une “racine”. Et il en donne pour preuve le fait que quand on veut tirer un mot d'un autre on ne peut faire autrement que de “remonter à sa racine”, expression qui montre que la racine a une priorité sinon historique du moins logique (exemple de quṭayṭ), ou d'en extraire une “pour les besoins de la cause”, expression qui confirme le caractère incontournable de la racine (exemple de qammaṣa). La “théorie” de Cantineau, malgré son habillage “saussurien”, n'est qu'une simple variante de l'enseignement arabisant en la matière (c'est ainsi que l'auteur de ces lignes a appris), à savoir qu'un mot régulier avait telle forme dérivée de telle racine. Que le mot soit dit dérivé de la racine, ou dérivé de la racine sur le modèle de telle forme, ou de telle forme dérivée de la racine, cela revient partout au même : à donner à la racine la première place. Il en va de même de Fleisch (1961 : 249) : « l'arabe part d'une racine, carcasse consonantique, sorte de squelette qui prend différents corps par l'introduction des voyelles ». Mais alors que Cantineau, semble-t-il, dérive l'ensemble des formes de la racine, s'interdisant d'emblée de représenter les relations entre formes sans retour à celle-ci, Fleisch, pour sa part, n'en dérive que les formes les plus simples —celles obtenues par alternance vocalique de timbre. De celles-ci sont ensuite dérivées les formes plus complexes —celles obtenues par allongement et/ou gémination et/ou affixation (cette dernière elle-même soumise à la “flexion interne”, sous laquelle Fleisch regroupe les deux processus de l'alternance vocalique et de la gémination, cf., en particulier, 1961 : 250-1, 362-8, 405-69). Ainsi comprise, la D-Rad, de la manière la plus claire qui soit, ne ressortit pas à l'ordre des “faits”, mais à celui des hypothèses. Or la validité d'une hypothèse se mesure à sa capacité à rendre compte, au moindre coût, du maximum de “faits”. A cet égard, il ne me paraît pas exagérément difficile de (dé)montrer le coût proprement exorbitant de la D-Rad. 4. Considérons un mot comme maktab. En vertu de la D-Rad, telle que formulée par Cantineau (1950), un tel mot est tiré de la racine KTB, sur le modèle du schème maf‘al. La racine est explicitement traitée (p. 121) comme un signe linguistique, ayant pour
7 ce même passage est cité par Bohas (1979[1982] : 238). Mais ce dernier, poursuivant en linguistique arabe d'expression française la guerre transatlantique menée en linguistique générale par les “générativistes” contre le “structuralisme”, en fait une lecture purement polémique. Nous verrons en conclusion que le modèle de Cantineau n'est pas un effet nécessaire du “structuralisme”.
LA RACINE EN ARABE CLASSIQUE 9
signifiant « les éléments formels qui la constituent » et pour signifié « le concept, plus ou moins précis, commun au groupe » (ici donc le concept d'écrire) 8. Le schème est lui aussi explicitement traité (p. 123) comme un signe linguistique, ayant pour signifiant « la forme même du schème » et pour signifié « la valeur grammaticale commune à chacun des mots rangés sous ce schème » (ici celui de “nom de lieu”). Autrement dit si un mot régulier de l'arabe est structurellement un couple de deux éléments, l'un radical et l'autre formel, sémantiquement le premier est le support de la signification lexicale et le second le support de la signification grammaticale. On voit alors combien est arbitraire l'opposition radicale que croient devoir faire certains grammairiens arabisants, comme Fleisch (1961 : 247-8), entre morphologie lexicale des langues sémitiques et des langues indo-européennes : il est clair que la racine est à la forme ce que le radical est aux pré/suffixes. La différence ne tient ni au nombre d'éléments ni à leur nature sémantique, mais à la façon dont s'opère leur conjonction : par juxtaposition ici, par entrecroisement là... Nul doute que l'hypothèse de Cantineau permet de prédire correctement le sens général effectif de maktab (“lieu où l'on écrit”) et, partant, de rendre compte de ses sens particuliers (“bureau”, “école” etc.). Mais considérons maintenant un mot comme maktaba. En vertu de la D-Rad, on s'attendrait à ce qu'un tel mot ait un sens voisin de celui de maktab : n'est-il pas « formé » sur la même « racine » et sur un « schème » qui est une simple variante du précédent ? Il ne manque d'ailleurs pas dans le lexique de l'arabe de paires maf‘a(i)l/maf‘a(i)la, où le second terme a le même sens que le premier ou bien s'oppose à lui à peu près comme “abstrait” à “concret” : e.g. maḥall/maḥalla, makān/makāna, manzil/manzila etc. Opposition dont le poète (ici ‘Antara en sa Mu‘allaqa) peut tirer un grand effet : après avoir évoqué, dans une série de vers parallèles, la séparation géographique des amants contraints de suivre leurs groupes respectifs de campement en campement (manzil, dans la poésie antéislamique), il clôt cette série par un vers qui, par un brusque passage à l'ordre sentimental, signalé et souligné par l'apostrophe corrélative, donne la clef de tous les autres : la-qad nazalti minnī wa-lā taẓunnī ġayra-hu bi-manzilati l-muḥabbi l-mukrami (« tu es descendue, en mon coeur, et ne la présume autre, à la place de l'être aimé, honoré »). De toute évidence, le couple maktab/maktaba n'est pas sémantiquement superposable au couple manzil/manzila, bien qu'il lui soit formellement semblable. Si maktaba doit être mis en rapport avec quelque chose, c'est compte tenu de son sens (“librairie” ou “bibliothèque”) avec le nom kitāb-kutub (“livre(s)”). Une telle formation est reconnue en grammaire arabe et, à sa suite, en grammaire arabisante comme
8 s'il ne donne pas l'exemple de la racine ktb, Cantineau donne celui de la racine qtl qui a pour signifié « le concept de tuer ». Je doute que pour un philosophe écrire et tuer soient des concepts : ce sont des actes, dont il peut se faire une idée. On verra plus loin que l'attribution d'un signifié de type conceptuel à la racine n'est pas un simple effet de la lecture de Saussure.
10 PIERRE LARCHER
dénominative 9. Bien qu'on la rencontre dans à peu près tous les schèmes verbaux et nominaux de l'arabe, la dérivation dénominative (désormais D-nom) est généralement considérée par les grammairiens arabisants comme “secondaire” (cf., par exemple, Blachère et Gaudefroy-Demombynes, 1952 : 51), sans qu'on sache s'il faut entendre ce mot en un sens logique, historique ou statistique. Mieux (ou pis) : alors qu'on s'attendrait à la voir utilisée comme argument contre la D-Rad, on la voit au contraire retournée en faveur d'une telle dérivation ! Cela nous est apparu clairement dans Cantineau (1950) avec les exemples de qammaṣa et quṭayṭ. Tout en admettant explicitement que ces mots sont dérivés de qamīṣ et qiṭṭ, il n'en pose pas moins qu'ils sont formés sur leurs racines qmṣ et qṭṭ. En somme dériver un mot, c'est toujours le former sur une racine, même si parfois c'est le former sur la racine d'un autre. Ainsi se trouve apparemment sauvegardée l'unité du modèle... Apparemment, car les linguistes arabisants en général et Cantineau en particulier ne me paraissent pas avoir prêté une attention suffisante aux conséquences théoriques de l'existence de dénominatifs en arabe. On voit tout de suite que ceux-ci ne peuvent pas être présentés comme les simples produits d'un croisement entre une « racine » et un « schème » : pour rendre compte de leur sens, sinon de leur forme —une théorie de la dérivation lexicale doit évidemment rendre compte des deux— il faut en effet faire intervenir un quatrième élément —le mot-source— qui vient ainsi s'ajouter aux trois éléments du schéma 2, lequel doit alors être amendé de la manière suivante :
Schéma 3
ce qui se lit : le mot2 est formé sur la racine du mot1, les deux mots étant tout à la fois en relation formelle et sémantique. Ainsi la dérivation du verbe qammaṣa, qui est dit formé sur la racine qmṣ du nom qamīṣ sur le modèle du schème fa‘‘ala, de valeur “faire”, d'où le sens de “revêtir quelqu'un d'une chemise”, sera représentée par :
9 cf. Ġalāyīnī, I, 211 « le nom de lieu peut être construit, à partir des noms, sur le schème maf‘ala pour indiquer la multiplicité de l'objet dans le lieu » (wa-qad yubnā ism al-makān min al-’asmā’ ‘alā wazn maf‘ala li-dalāla ‘alā kaṯra al-šay’ fī l-makān). Ġalāyīnī est cité ici non comme une “autorité”, mais comme un bon résumé de la grammaire arabe traditionnelle. Cf. églt. Fleisch (1961 : 431).
LA RACINE EN ARABE CLASSIQUE 11
Schéma 4
Et de même la dérivation du nom quṭayṭ qui est dit formé sur la racine qṭṭ du nom qiṭṭ sur le modèle du schème de diminutif fu‘ayl sera représentée par :
Schéma 5
Or appliquons à maktab et à maktaba les schémas 2 et 3 dont ils relèvent :
Schéma 6
Ce schéma donne aussitôt à voir —ce qui constitue une sérieuse entorse au principe de généralité dont doit se prévaloir toute approche théorique— que sont ici attribués à la racine une double place et un double statut : dans le cas de maktab, la racine est logiquement première et lui est directement associée une signification apparemment lexicale, mais en réalité infra-lexicale (“idée d'écrire”) ; dans le cas de maktaba, la racine est logiquement seconde et une signification lexicale ne lui est associée que par l'intermédiaire d'un nom ; dans les deux cas, la racine est un signe, mais, dans le second, la face signifiée de ce signe est elle-même un signe. On voit tout de suite qu'il y aurait un moyen aussi simple qu'élégant d'éviter cette aporie et, en unifiant le modèle, de sauvegarder, au moins provisoirement, le modèle lui-même : il suffirait d'admettre que là où la racine ne représente pas un nom, elle représente en fait un verbe. Notons d'ailleurs qu'en paraphrasant les racines KTB et ŠHD par “écrire” et “témoigner, porter
12 PIERRE LARCHER
témoignage” des orientalistes comme Berque ou Lewis reconnaissent implicitement ce qu'un grammairien comme Lecomte (1968 : 28) reconnaît explicitement à propos des formes verbales dites “dérivées” : « l'arabe possède un procédé original pour exprimer par dérivation des procès de plus en plus nuancés par rapport au sens de la racine, représentée le plus souvent par le verbe (...) “de première forme” [c'est moi qui souligne] ». On ne saurait mieux dire que le prétendu “sens de la racine” est en réalité, « le plus souvent », celui du verbe de base ! Ce faisant, on retrouve la position qui était celle des grammairiens arabisants avant, sinon “l'invention”, du moins la vulgarisation de la racine consonantique (à partir d'Ewald, selon Rousseau, 1984) : ils dérivaient toujours d'une racine verbale, représentée par la 3e personne du prétérit (fa‘ala). Et on retrouve, sous une autre forme, la position la plus répandue parmi les grammairiens arabes : pour ceux-ci, quand un mot n'est pas dérivé d'un nom, il l'est du maṣdar, et, plus particulièrement de celui du verbe “trilitère nu” (cf. Ġalāyīnī, I, 167 et II, 3). Or, le maṣdar, s'il est un nom, est un nom verbal et appartient de ce fait au paradigme du verbe. La dérivation démaṣdarative (désormais D-Maṣ) est donc bien une dérivation déverbative. Et comme un bonheur ne vient jamais seul, en évitant cette première aporie, on en éviterait une seconde. Le même exemple de maktab/maktaba permet de mesurer le caractère aléatoire de la proposition de Cantineau, selon laquelle « il y a, en principe, autant de signes que de signifiés bien distincts » : c'est ce principe qui le conduit à voir (pp. 121-2), dans le cas de ǦML, plusieurs « racines homophones » : une verbale (« celle de jamala, “réunir” »), deux ou trois substantives (« celles de jamal- “chameau” (...) ; celle de jamal- “câble de navire” (...) ; celle de jamīl- “graisse fondue” ») et une qualificative (« celle de jamīl- “beau” »), qui toutes fournissent un nombre n (où n ≥ l) de dérivés. Le même principe (le fait qu'à la racine KTB correspondent dans maktab et maktaba deux signifiés distincts, “écrire” d'une part, “livre” d'autre part) ne conduit pourtant aucun arabisant à poser deux racines homophones, ni même une racine polysémique : s'il donnait cet exemple, Cantineau préfèrerait lui attacher une signification générale et abstraite du type “concept, idée, notion... d'écrire”, dont on a non seulement rappelé qu'elle était philosophiquement incertaine, mais encore linguistiquement inopérante. Et alors même qu'en qualifiant, dans le cas de ǦML, une racine de verbale, substantive ou qualificative, il reconnaît lui-même que la signification de la racine, ce n'est pas ici « un concept général, plus ou moins précis », mais celle d'un verbe ou d'un nom, substantif ou adjectif, précis ! Objectivement, il n'y aucune différence entre KTB et ǦML : à une racine (du point de vue du signifiant) correspondent deux ou plusieurs signifiés. C'est seulement subjectivement qu'il y en a une : entre les deux signifiés de KTB une relation est si bien sentie qu'on croit pouvoir ne pas les distinguer, entre ceux de ǦML une relation est si peu sentie qu'on croit devoir les rapporter à des racines différentes. Une théorie “raisonnée” de la dérivation
LA RACINE EN ARABE CLASSIQUE 13
lexicale en arabe ne doit pas représenter la subjectivité de l'arabisant, mais les relations objectives existant entre mots d'une même famille et, selon moi, elle peut le faire. 5. « Qasam [vient] de la racine q s m qui signifie partager, couper en deux ou plusieurs parties, mais aussi jurer, vraisemblablement à cause du rite sacrificiel qui accompagne le serment, afin de sceller une alliance, lui donner plus de solennité et d'efficacité » (J. Chelhod, “La foi jurée et l'environnement désertique”, Arabica 38-3 : 292, 1991). En fait, il n'y a pas de racine qsm signifiant à la fois “partager, couper en deux ou plusieurs parties” et “jurer”. Ce qu'il y a, ce sont trois verbes, de même racine qsm, mais de forme différente, dont le premier qasama signifie “partager, couper en deux”, le deuxième qassama signifie “partager, couper en plusieurs parties” et le troisième ’aqsama signifie “jurer”. Or, il est clair qu'en synchronie, alors qu'il existe entre I qasama et II qassama, le même rapport formel et sémantique qu'entre qaṭa‘a (“couper”) et qaṭṭa‘a (“découper”), qatala (“tuer”) et qattala (“massacrer”), kasara (“casser”) et kassara (“briser”) etc., il n'existe pas entre I qasama et IV ’aqsama le même rapport formel et sémantique qu'entre ḫaraǧa (“sortir”) et ’aḫraǧa (“faire sortir”), daḫala (“entrer”) et ’adḫala (“faire entrer”), ‘alima (“savoir”) et ’a‘lama (“faire savoir”) etc : autrement dit, alors que qassama est un déverbatif-intensif de qasama, ’aqsama est tout ce que l'on voudra, mais certainement pas un déverbatif-factitif de qasama. Inversement, s'il existe entre le nom qasam et le verbe ’aqsama un rapport sémantique, sur le plan formel le nom qasam relève de la forme de base, alors que le verbe ’aqsama est une forme augmentée. On est alors très tenté de faire du verbe ’aqsama un dénominatif de qasam, avec une valeur “faire” et donc de sens “faire un serment”. Cela veut dire que s'il y a une seule et même entrée radicale qsm, celle-ci se dédouble en deux sous-entrées, l'une verbale et l'autre nominale. Dans le premier cas, la racine qsm est celle du verbe de base qasama (ou du maṣdar qasm) ; dans le second celle du nom qasam. Du verbe I sont dérivés, outre II qassama (intensif de I) et, via II, V taqassama (réfléchi de II) : III qāsama (réciproque implicite de I de sens “partager qqchose avec quelqu'un”) et, via III, VI taqāsama (réfléchi de III et donc réciproque explicite de sens “se partager”) ; VII inqasama (“passif” de I, de sens “être divisé, partagé”) 10 ; VIII iqtasama (réfléchi de I de sens “se diviser, se partager”) 11 et X istaqsama (“pétitif” de I de sens “demander le partage”) 12. Du nom qasam, sont dérivés, outre IV ’aqsama, III qāsama (“se lier par 10 “passif” est exclusivement employé ici pour éviter l'emploi du terme “réfléchi” que nous réservons aux formes à préfixe (ou infixe) t. 11 s'il y a un sujet pluriel ou une pluralité de sujets, le verbe prend une valeur réciproque : cf., en français, Pierre se regarde (réfléchi) et Pierre et Marie se regardent (réciproque). 12 ce verbe se trouve dans le Coran (5, 3) wa-’an taqtasimū bi-l-’azlāmi. Sa construction et la paraphrase qu'en donne LA (art QSM) ’an taṭlubū min ǧihat al-’azlāmi mā qusima la-kum min ’aḥadi l-’amrayn (“que vous demandiez, par les flèches, celle de deux choses qui vous est donnée comme lot”) montrent
14 PIERRE LARCHER
serment à quelqu'un”) et, via III ,VI taqāsama (réfléchi de III) et X istaqsama (“pétitif” de qasam de sens “demander un serment à quelqu'un”) 13, soit :
Schéma 7
Ce tableau fait aussitôt apparaître que les deux dérivations subsumées sous la racine qsm ont en commun un certain nombre d'unités (III, VI et X) et que ces unités ont exactement la même signification grammaticale (réciproque, réfléchi, pétitif) par rapport à deux bases lexicales qui pour la catégorie et le sens n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Ce qui montre qu'elles sont parfaitement autonomes l'une par rapport à l'autre. Mais qasam étant une forme possible de maṣdar de verbe I, il est légitime de se demander s'il ne serait pas possible de relier en diachronie le nom qasam au verbe qasama, bref de chercher si le serment n'avait pas quelque chose à voir avec le fait de couper. Chelhod, qui a certainement lu Benveniste (1969, II : 165), pense que le lien est un rite sacrificiel accompagnant le serment (cf. églt, p. 301 : « le serment qasam (...) semble supposer, comme le suggère la racine qsm, qu'il était accompagné d'une immolation sanglante »). Qasam désigne ce qu'Austin (1962) appelle un acte illocutoire, i.e. un acte accompli dans le fait même de dire quelque chose. Mais étymologiquement, les mots désignant de tels actes désignent souvent un geste les accompagnant, voire l'organe impliqué dans ce geste —à commencer par yamīn, autre nom du serment en arabe, mais dont le sens même (la droite) suggère qu'il a été relu
que X est lié en réalité au passif du verbe de base, ce qui est un argument en faveur de la D-maṣ. C'est le maṣdar, neutre quant à la diathèse, qui apparaît un peu plus loin dans une autre paraphrase (istaqsama ’ay ṭalaba bi-l-’azlām al-qasm = demander, au moyen des flèches, de faire la part [entre deux choses]) et le nom qism dans une troisième al-istiqsām ’ay ṭalab al-qism allaḏī qusima la-hu (le istiqsām, c'est demander la part qui vous est échue). Qism s'oppose à qasm comme la part au partage, c'est-à-dire comme le résultat au procès. L'emploi de ce nom et du passif qusima dans la relative contiguë confirme que X est bien lié au passif du verbe de base (cf. sur cette relation, Larcher, à paraître). 13 dans la mesure où X est transitif direct, son objet représente le sujet du verbe ’aqsama : demander un serment à quelqu'un, c'est demander à quelqu'un de faire un serment, c'est-à-dire se faire faire un serment par quelqu'un. Dire que X est un dénominatif-pétitif de qasam revient au même que dire qu'il est un réfléchi-factitif de ’aqsama : en ce cas, la racine représente une forme augmentée du verbe, phénomène d'une extrême banalité (cf. Larcher, 1994).
LA RACINE EN ARABE CLASSIQUE 15
comme l'acte que l'on accomplit en faisant telle chose avec la main droite, par exemple la prendre, comme le suggère Lisān al-‘Arab, art. YMN : wa-sammaw al-ḥa(i)lf yamīnan li-’anna-hu yakūnu bi-’aḫḏ al-yamīn « on a nommé le serment yamīn parce qu'il se fait en prenant la main droite » 14. On ne peut cependant exclure pour qasam un mouvement autodélocutif, c'est-à-dire une métonymie mettant en jeu, non le geste, mais la parole. Chelhod décrit lui-même (p. 296) un serment, jadis très usité (...) qu'on appelle yamīn al-namla wa-l-šamla : « avec une épée, on trace un cercle sur le sol, au milieu duquel on place un couteau, un peu de cendre et des fourmis. Celles-ci représentent la postérité qui serait coupée [c'est moi qui souligne] et réduite en cendres en cas de parjure ». On peut alors imaginer une imprécation, valant serment, telle que « Que ma postérité soit coupée et réduite en cendres, si je suis parjure ». On est d'autant plus fondé à en faire l'hypothèse que c'est le nom qasam et non le verbe qasama qui est atteint, celui-ci n'étant pas passé du sens de “couper” à celui de “*jurer = faire ce que l'on fait en coupant telle chose”, comme on peut penser que ‘aqada est passé du sens de “nouer” à “s'engager”, via ‘aq(q)ada al-’aymān (“faire ce que l'on fait en nouant les mains droites, i.e. prendre des engagements”). Or, dans la déclaration que nous imaginons, c'est le passif du verbe de base qui apparaîtrait, lequel pourrait être facilement remplacé par le nom verbal, neutre sur le plan de la diathèse et en position initiale d'objet résultatif (maf‘ūl muṭlaq) qasaman : qasaman est justement bien attesté comme performatif de serment... Quoi qu'il en soit, la seule différence entre les deux signifiés de QSM et les deux signifiés de KTB est qu'il est impossible de relier les deux premiers en synchronie, le lexicographe étant réduit à faire une hypothèse sur la façon dont ils pourraient se relier en diachronie, alors qu'il est non seulement possible, mais encore nécessaire de relier les seconds en synchronie. 6. A cet égard, un lecteur informé aura remarqué qu'à partir des mêmes prémisses (l'existence des dénominatifs) nous tirions une conclusion diamétralement opposée à celle de Halff (1972). Celui-ci n'étudie pas l'ensemble de la morphologie lexicale de l'arabe, mais seulement un fragment de celle-ci, qui passe pour relativement bien structuré, celui des formes verbales dérivées, en les limitant aux dix formes les plus usuelles. En précisant « dérivées des racines trilitères », Halff explicite ce que la présence de I impliquait. Il admet cependant que les unes en sont dérivées « au premier degré » et les autres « surdérivées », I, II, III et IV produisant respectivement VII et VIII, V, VI, X. Mais il note que ce classement laisse de côté IX d'une part et ne précise pas l'origine de II, III et IV d'autre part. Il serait tentant de les dériver de I, si II, III et IV ne pouvaient être aussi dénominatives, ce qu'est également IX, ou éventuellement
14 On a exactement le même mouvement en latin avec dextra.
16 PIERRE LARCHER
délocutives 15. Or la prise en considération de l'origine du verbe (déverbative, dénominative ou délocutive) constituerait un facteur de « complication », puisqu'il faudrait autant de classements des formes verbales que celles-ci comptent de dérivations (en effet, cf. supra, schéma 7). Pour éviter cette « complication », Halff propose de prendre la racine comme origine dérivationnelle unique et de faire de I une forme dérivée de la racine au même titre que II, III, IV et IX, les surdérivées restant en seconde ligne, en justifiant ainsi sa proposition (p. 430) : « verbes de forme I et noms trilitères ont en commun un élément abstrait, qui n'est en lui-même ni nominal ni verbal, leur racine de trois lettres, qui sera sous-jacente aussi à tous leurs dérivés » [c'est moi qui souligne : leurs dérivés = les dérivés des verbes de forme I et des noms trilitères]. Cette formulation montre que la proposition de Halff n'est en réalité qu'une variante de la théorie de Cantineau : si la racine est partout première sur le plan morphologique, comme chez Cantineau, elle est partout seconde sur le plan sémantique, Halff admettant que la racine représente soit un verbe, soit un nom, soit une locution, alors que Cantineau ne l'admet qu'occasionnellement. Incontestablement le modèle est unifié et c'est cette unification qui déplaît à Fleisch (1979 : 272-3, n. 2) : pour l'illustre philologue, il y a deux systèmes, l'un primaire, où l'on dérive de la racine, d'abord les formes les plus simples puis, de celles-ci et par divers procédés les formes les plus complexes (c'est pourquoi Fleisch ne dérive de la racine que la forme I, dérivant de celle-ci les neuf autres, soit directement (II, III, IV, VII, VIII et IX) soit indirectement (V, VI et X de II, V et IV); l'autre secondaire où l'on dérive de la racine d'un nom (ou d'une locution). De manière très caractéristique, Fleisch (1979 : 328), critiquant l'idée que la forme IX serait exclusivement dénominative, estime qu'il n'est légitime de rechercher son origine dans un nom ou un adjectif que quand elle existe sans forme I correspondante, mais il ne parle pas pour autant en ce cas de ’af‘alla déverbatif, mais de ’af‘alla « formatif » (1979 : 315, n. 4) ! Or, adaptons le raisonnement de Halff au cas de maktab/maktaba. Pour concilier D-Rad et interprétation déverbative de l'un et dénominative de l'autre, on n'a que deux solutions : ou traiter KTB « sous-jacent » à l'un et à l'autre comme deux racines homonymes ou le traiter comme une racine, mais se réalisant dans deux séries, l'une de sens verbal et l'autre de sens nominal, soit (en adaptant le schèma donné par Halff, p. 430) :
15 le terme de délocutif, dû à Benveniste (1958), n'apparaît pas chez Halff mais seulement l'expression de dérivé d'un énoncé nominal (ex. sallama = dire as-salāmu ‘alay-kum) ou verbal (ex. raḥḥama = dire raḥima-hu llāhu). En réalité, sallama est un dénominatif de salām et c'est sa construction (‘alay-hi) qui en fait, pour le sens, un délocutif de (al)-salām ‘alay-ka (kum). De même raḥḥama est venu relayer en arabe moderne le classique taraḥḥama que LA (art RḤM) présente déjà comme un dénominatif de sens délocutif (souhaiter à quelqu'un la miséricorde (de Dieu)). Noter qu'à la place de raḥima-hu llāhu on peut dire raḥmatu llāhi ‘alay-hi, cf. Larcher 1983, 1985.
LA RACINE EN ARABE CLASSIQUE 17
Schéma 8
Dans les deux cas, on a alors le revers de la médaille dont la citation initiale fournissait l'avers : on ne distinguait pas entre deux signifiés pourtant distincts (“écrire” et “livre”), on distingue maintenant si bien qu'on ne les relie plus ! Or, il n'est pas difficile de les relier : si kitāb désigne un livre, c'est parce qu'il signifie “écrit” (dans d'autres états de l'arabe classique ou dans d'autres variétés de l'arabe, il désigne d'ailleurs une lettre, autre sorte d'écrit). Et cette signification résulte elle-même d'un emploi purement nominal d'un mot qui, au départ, est un maṣdar 16 et, en arabe classique, a encore des emplois comme maṣdar, par exemple Cor. 4, 24 : wa-l-muḥṣanātu mina n-nisā’i ’illā mā malakat ’aymānukum kitāba-llāhi ‘alaykum “[vous sont interdites], parmi les femmes, les femmes mariées, hormis les esclaves [de guerre], par prescription de Allāh à votre encontre” : par sa construction, kitāb fait ici référence au verbe kataba dans le contexte kataba llāhu ‘alay-kum (plus souvent au passif kutiba ‘alay-kum), même si, comme maf‘ūl muṭlaq, il a déjà un sens résultatif, désignant non “le fait pour Allāh de vous prescrire (quelque chose)”, mais “ce qui vous est prescrit par Allāh”. C'est donc la syntaxe qui règle le passage du “procès” à son “résultat”. Mais c'est la morphologie qui achève le processus sémantique. Dans le sens résultatif d'“écrit”, kitāb devient quantifiable. Apparaît alors le pluriel kutub, qui fait non seulement de kitāb un singulier morphologique (et non plus seulement syntaxique), mais encore est fonction de ce singulier. Mais dire que le pluriel kutub est fonction du singulier kitāb, c'est dire que kitāb et kutub ne sont pas deux mots de forme différente, l'un à l'autre indifférents, ni deux formes construites sur une même racine, mais deux formes d'un même mot, deux allomorphes (concrets) d'un même morphème lexical (abstrait). C'est la syntaxe et la morphologie qui ont fait entrer dans la racine KTB une nouvelle signification lexicale (celle de “livre”), à laquelle renvoie à son tour le nom de lieu dénominatif maktaba. Mais, dira-t-on, pourquoi maktaba renvoie à kitāb-kutub et non à kataba-yaktub ? Même si maf‘ala est la forme normale des noms de lieu dénominatifs en arabe
16 cf LA, art KTB, qui donne kataba l-šay’a katban wa-kitāban wa-kitābatan et, plus loin, cette citation de ’Azharī : al-kitābu ism li-mā kutiba maǧmū‘an wa-l-kitābu maṣdar (kitāb est le nom de ce qui a été écrit, globalement, et kitāb est un maṣdar).
18 PIERRE LARCHER
classique 17, celle-ci n'est pourtant pas exclusivement dénominative (cf. madrasa = lieu d'étude, d'où école). Et il ne suffit pas que la forme maf‘ala coexiste avec la forme maf‘al, pour que, celle-ci étant déverbative, celle-là soit dénominative. Là encore, la réponse est que maktaba n'est pas seulement associé à la racine KTB ou à la forme maf‘ala, ni même au nom kitāb-kutub, mais encore au pluriel maktabāt, alors que maktab l'est au pluriel makātib. En revanche manzil et manzila sont associés au même pluriel manāzil. Autrement dit, c'est la différence des pluriels qui signale la différence des formations, tandis que l'unité de pluriels signale que manzil et manzila ne sont pas deux formes différentes, mais deux variantes d'une même forme, ou encore que manzila peut s'analyser comme manzil + a, ce qui me paraît largement confirmé par le vers de ‘Antara... 7. Cantineau, Fleisch et Halff ont en commun de dériver à partir de la racine. Mais alors que les deux premiers maintiennent l'unité morphologique du système dérivationnel, au prix d'un dédoublement sur le plan sémantique (la racine a tantôt un sens “en elle-même” et tantôt comme racine d'un autre mot), le troisième dissocie systématiquement aspect morphologique (le mot est formé sur la racine) et sémantique (la racine est celle d'un verbe, d'un nom ou d'une locution) du processus dérivationnel. Les deux systèmes sont donc en relation d'intersection et c'est pourquoi on peut les considérer comme les simples variantes d'un seul et même système. Je voudrais montrer, avant de conclure, que l'exemple de qiṭṭ/quṭayṭ cumule les inconvénients de l'une et de l'autre, tant en ce qui concerne l'élément “racine” que l'élément “schème”. Dire que pour tirer quṭayṭ de qiṭṭ il faut “remonter à la racine” revient à dire que qiṭṭ en “descend”, autrement dit que le mot qiṭṭ est le croisement d'une racine qṭṭ (à laquelle s'attacherait la signification lexicale “chat”) et d'une forme fi‘l, dont Cantineau affirme lui-même (page 123) qu'elle est doublement indéterminée, tant du point de vue du signifiant (pourquoi fi‘l, plutôt que fa‘l ou fu‘l ?) que du signifié (puisqu'elle n'a d'autre valeur ou fonction que “substantif singulier”, « notion vague à souhait ») 18 : qiṭṭ ne signifie donc pas “chat” mais “un chat”. On voit tout de suite que fi‘l n'est indéterminé que pour autant qu'il est isolé : mais on a vu ci-dessus (n. 10) qu'un mot comme qism (de schème fi‘l) s'opposait à un mot qasm (de schème fa‘l) comme la “part” au “partage”. Ce qui n'est évidemment pas le cas de qiṭṭ par rapport à qaṭṭ (maṣdar d'un verbe qaṭṭa = “trancher”), auquel correspond un ... qiṭṭ, dans le même rapport à qaṭṭ que qism à qasm, et dont on a une 17 mais non en arabe moderne où l'on trouve maqhā (café, comme lieu de consommation) et matḥaf (musée) qui quoique de forme maf‘al sont seulement rapportables aux noms qahwa (café, comme boisson) et tuḥfa, pl. tuḥaf (“chef d'oeuvre”). 18 cette dernière assertion est fausse : fu‘l peut être une forme de pluriel soit comme variante de fu‘ul (exemple kitāb, pour lequel LA donne, à côté de kutub, kutb), soit comme pluriel associé au ’af‘al de couleur et d'infirmité.
LA RACINE EN ARABE CLASSIQUE 19
attestation dans le Coran (38, 16) : qālū rabbanā ‘aǧǧil qiṭṭanā qabla yawma l-ḥisābi (« ils ont dit : “Notre Seigneur, envoie nous vite notre part, avant le jour du Jugement” »). Ces deux qiṭṭ homonymes révèlent que qiṭṭ/chat est sans doute lui-même un emprunt au bas-latin cattus 19. Et si racine qṭṭ, support de la signification lexicale “chat”, il y a, elle ne résulte pas directement de cet emprunt, mais de l'association au mot qiṭṭ résultant de cet emprunt d'un pluriel qiṭāṭ, là encore fonction du singulier qiṭṭ, ce qui rend inutile le détour par la racine pour rendre compte de sa formation. D'autant qu'on n'aura pas manqué d'observer que ce pluriel était de même « schème » fi‘āl que le singulier kitāb. C'est dire si un schème n'est pas en lui-même singulier ou pluriel, mais à raison de ses associations syntaxiques (accord) et morphologiques. Si la racine QṬṬ est une illusion, il en va de même du schème fu‘ayl : il suffit d'observer que šā‘ir (“poète”), kitāb, ‘aqrab (“scorpion”), ‘uṣfūr (“oiseau”) ont respectivement pour diminutifs šuway‘ir, kutayyib, ‘uqayrib, ‘uṣayfīr pour conclure qu'il n'existe pas en arabe classique un schème ni même des schèmes de diminutifs, mais en réalité un processus régulier de formation du diminutif à partir de la forme non diminuée... Conclusion. Voir un « schème », là où ce prétendu schème est le résultat d'un processus de formation d'un mot, soit à partir, soit en fonction d'un autre ; voir une « racine » ayant un sens là où ce prétendu sens de la racine est le résultat des rapports associatifs et syntagmatiques du mot qui l'actualise, cela revient en réalité à une seule et même chose : figer en une langue statique le mouvement du discours. On pourrait penser qu'il s'agit là de l'effet d'une “théorie” linguistique particulière qui serait le “structuralisme”. En effet, Saussure, bien qu'il n'emploie pas lui-même le terme de “structure” mais celui de “système”, oppose la “langue” à la “parole” comme une institution sociale à une activité individuelle. Mais l'opposition langue/parole n'est qu'une retombée malheureuse d'une distinction initiale heureuse, celle du langage comme “matière” et de la langue comme “objet”, construit par le linguiste. Rien n'empêche un “structuraliste” de construire un objet “langue” intégrant le mouvement du discours, comme l'a fait admirablement, en linguistique générale, au travers des langues indo-européennes, Benveniste. Et, pour organiser le lexique de l'arabe classique, que proposons-nous d'autre, sinon une utilisation extensive des rapports syntagmatiques de Saussure (totalement négligés par les arabisants) 20 et une utilisation intensive de ses rapports
19 Littré (art. chat) s'interrogeant sur l'étymologie de cattus, à l'origine du mot désignant un chat dans mainte langue européenne, signale qu'il existe en arabe un qittoun, mais que « Freitag doute que ce mot appartienne à l'arabe ». Ce qui permet d'en douter c'est évidemment l'isolement sémantique de qiṭṭ au sein de la série associative des mots de « racine » qṭṭ. Situation banale, cf. ṭāwila “table” (< tabula/tavola) évidemment “intrus” dans la famille ṭwl. 20 extensive, car Saussure, considérant que la phrase relève de la parole, ne les étend pas au delà du “synthème”. Pour nous, c'est la syntaxe qui fait de sallama ‘alay-hi un dénominatif de sens délocutif et de
20 PIERRE LARCHER
associatifs, i.e. paradigmatiques (absusivement limités par les arabisants à deux parmi beaucoup d'autres) 21 ?
Université de Provence (Aix-Marseille I) et IREMAM
BIBLIOGRAPHIE
Austin, John Langshaw (1962[1970]). How to do things with words. London : Oxford University Press [tr. fr. Quand dire, c'est faire. Paris : Le Seuil. 1970].
Benveniste, Emile (1950[1966]). “Actif et moyen dans le verbe”, Journal de Psychologie, janv.-fév l950. Paris : PUF [repris dans Problèmes de linguistique générale, I, pp. 168-175. Paris : Gallimard]
Benveniste, Emile (1958[1966]). “Les verbes délocutifs”, Mélanges Spitzer pp 57-63 [repris dans Problèmes de linguistique générale, I, pp. 277-285. Paris : Gallimard]
Benveniste, Emile (1969). Le vocabulaire des institutions indo-européennes, I et II. Paris : Minuit.
Blachère et Gaudefroy-Demombynes (1952). Grammaire de l'arabe classique, 3ème édition. Paris : Maisonneuve et Larose.
Bohas, Georges (1979[1982]). Contribution à l'étude de la méthode des grammairiens arabes en morphologie et phonologie d'après des grammairiens arabes “tardifs”, thèse de doctorat d'état, Université de Paris III [ANRT, Université de Lille III, 1982].
Cantineau, Jean (1950). “Racines et schèmes”, dans Mélanges William Marçais, pp. 119-124. Paris : G.P. Maisonneuve et Cie.
Cohen, David (1964[1970]). “Remarques sur la dérivation nominale par affixes dans quelques langues sémitiques”, Semitica [repris dans Etudes de linguistique sémitique et arabe, pp. 31-48. The Hague-Paris : Mouton. 1970].
Cornulier, Benoît de (1976). “La notion de dérivation délocutive”, Revue de linguistique romane 40 : 116-144.
Ducrot, Oswald (1972). Dire et ne pas dire. Paris : Hermann Ducrot, Oswald (1975[1980]). “Je trouve que” Sémantikos 1-1 : 63-88 [repris dans
Ducrot, Oswald et alii, Les mots du discours, pp. 57-92. Paris : Minuit. 1980] Fleisch, Henri (1961 et 1979). Traité de Philologie arabe, t. I Morphologie nominale et
t. II Pronoms, morphologie verbale, particules. Beyrouth : Imprimerie catholique. Ġalāyīnī, Muṣṭafā al- (1385/1966[1912]). Ǧāmi‘ al-durūs al-‘arabiyya, 10e édition.
Manšūrāt al-maktaba al-‘aṣriyya li-l-ṭibā‘a wa-l-našr. Sidon-Beyrouth, 3 vols. Halff, Bruno (1972). “Grammaire arabe. Remarques sur le système des formes verbales
dérivées; la syntaxe des noms de nombre; la détermination”, Langues modernes, 64e année, fascicule 4, 427-437. Paris : Association des Professeurs de Langues Vivantes.
Ibn Manẓūr. Lisān al-‘Arab al-muḥīṭ. Ed. par Yūsuf Ḫayyāṭ, 4 vols. Beyrouth : Dār Lisān al-‘Arab. S.d.
sallamu-hu min-hā ("préserver quelqu'un de quelque chose”) un déverbatif-factitif de salima min-hā (être préservé de qqchose). 21 même la dérivation “autodélocutive” n'est qu'un rapport associatif particulier, associant le sens d'un mot à un emploi locutionnel de ce mot...
LA RACINE EN ARABE CLASSIQUE 21
Lecomte, Gérard (1968). Grammaire de l'arabe, coll. Que sais-je. Paris : PUF. Larcher, Pierre (1983). “Dérivation délocutive, grammaire arabe, grammaire arabisante
et grammaire de l'arabe” Arabica 30 : 246-266. Leiden : Brill. Larcher, Pierre (1985). “Vous avez-dit ‘délocutif’?”, Langages 80 : 99-124. Paris :
Larousse. Larcher, Pierre (1994). “Un phénomène de “surdérivation” en arabe classique. A propos
de la Xe forme verbale istaf‘ala”, Annales islamologiques, t. XXVIII. Le Caire : Institut Français d'Archéologie Orientale.
Larcher, Pierre (à paraître). “Sur la valeur “expositive” de la forme ’af‘ala de l'arabe classique”. A paraître dans Zeitschrift für arabische Linguistik 29, 1995. Wiesbaden : Harrassowitz.
Reig, Daniel (1971). “Antonymie des semblables et corrélation des opposés en arabe”, Bulletin d'Etudes Orientales, tome XXIV, pp. 135-156. Damas : Institut Français d'Etudes arabes.
Rousseau, Jean (1984). “La racine arabe et son traitement par les grammairiens européens (1505-1831)”, Bulletin de la Société de Linguistique de Paris, t. LXXXIX, fasc. 1, pp. 285-321. Paris : Klincksieck
Saussure, Ferdinand de (1916[1972]). Cours de linguistique générale, publié par Charles Bally et Albert Sechehaye, avec la collaboration de Albert Riedlinger, édition critique préparée par Tullio de Mauro. Paris : Payot.