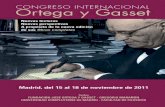Material metálico. José Ramón Ortega Pérez, Inmaculada Reina Gómez y Marco Aurelio Esquembre Bebia
Ortega y Gasset, lecteur de la philosophie diltheyenne de la vie
-
Upload
usaintlouis -
Category
Documents
-
view
4 -
download
0
Transcript of Ortega y Gasset, lecteur de la philosophie diltheyenne de la vie
ORTEGA Y GASSET, LECTEUR DE LA PHILOSOPHIE DILTHEYENNEDE LA VIE Anne Bardet Presses Universitaires de France | Les Études philosophiques 2015/1 - n° 112pages 101 à 124
ISSN 0014-2166
Article disponible en ligne à l'adresse:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------http://www.cairn.info/revue-les-etudes-philosophiques-2015-1-page-101.htm
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pour citer cet article :
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bardet Anne, « Ortega y Gasset, lecteur de la philosophie diltheyenne de la vie »,
Les Études philosophiques, 2015/1 n° 112, p. 101-124.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Distribution électronique Cairn.info pour Presses Universitaires de France.
© Presses Universitaires de France. Tous droits réservés pour tous pays.
La reproduction ou représentation de cet article, notamment par photocopie, n'est autorisée que dans les limites desconditions générales d'utilisation du site ou, le cas échéant, des conditions générales de la licence souscrite par votreétablissement. Toute autre reproduction ou représentation, en tout ou partie, sous quelque forme et de quelque manière quece soit, est interdite sauf accord préalable et écrit de l'éditeur, en dehors des cas prévus par la législation en vigueur enFrance. Il est précisé que son stockage dans une base de données est également interdit.
1 / 1
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
Fac
ulté
s un
iver
sita
ires
Sai
nt-L
ouis
-
- 19
3.19
0.25
0.2
- 23
/02/
2015
17h
37. ©
Pre
sses
Uni
vers
itaire
s de
Fra
nce
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - F
acultés universitaires Saint-Louis - - 193.190.250.2 - 23/02/2015 17h37. ©
Presses U
niversitaires de France
5 janvier 2015 10:16 - Jules Vuillemin et les systèmes philosophiques - Collectif - Études philosophiques - 155 x 240 - page 100 / 160 - © PUF -
5 janvier 2015 10:16 - Jules Vuillemin et les systèmes philosophiques - Collectif - Études philosophiques - 155 x 240 - page 101 / 160 - © PUF -
Les Études philosophiques, n° 1/2015, pp. 101-123
oRteGA y GAsset, LeCteuR De LA PhILosoPhIe DILtheyenne De LA VIe1
En prenant récemment pleinement contact avec l’œuvre philosophique de Dilthey, j’ai expérimenté une surprise pathétique : les problèmes et positions signalés dans toute mon œuvre – j’entends ici les problèmes et positions strictement et décisivement philosophiques – s’inscrivent dans un étrange et effrayant parallélisme2 avec ceux qu’aborde la sienne. Rien n’est plus effrayant, en effet, que de se rendre compte, à un stade déjà avancé de la vie, soudainement, de ce qu’un autre homme qui, pour l’essentiel, était soi-même, existait et se promenait de par le monde. La littérature a donné forme à cette frayeur médullaire dans le thème de l’alter ego3.
Les termes que choisit ortega y Gasset pour caractériser la philosophie de Wilhelm Dilthey sont généralement à double tranchant. D’un côté, il le décrit comme cet « alter ego », ce « génie »4 victime d’un manque de reconnaissance anormal5. De l’autre, il le présente comme ce « bègue de
1. nous nous appuierons en grande partie, dans cette présentation, sur l’étude qu’ortega y Gasset consacre à la pensée diltheyenne – « Guillermo Dilthey y la Idea de la vida », in José ortega y Gasset, obras Completas, t. VI (1941-1955), madrid, taurus, Fundación José ortega y Gasset, 2006. Dans la mesure où ce texte n’est pas traduit en français, nous traduisons. Les autres écrits d’ortega y Gasset que nous citons, pour l’essentiel, font également l’objet de traductions qui sont les nôtres, à moins que nous ne mentionnions explicitement le nom du traducteur.
2. très vite, le philosophe madrilène précise ce qu’il entend par cette notion de « parallé-lisme », insistant sur le fait qu’il ne pense à aucun moment à une coïncidence entre sa pensée et celle de Dilthey, mais bien plutôt à une correspondance : « Le parallélisme exclut précisément la coïncidence et ne signifie que stricte correspondance. Les parallèles ne peuvent se toucher en aucun point parce qu’elles viennent d’une origine indépendante. Leur convergence dans l’infini exprime cette contradiction selon laquelle ce sont la même ligne, et, en même temps, la plus différente. seules deux pensées parallèles peuvent être certaines de ne jamais coïncider matériellement, parce que c’est ce qui est le plus fondamental qui les sépare ; un point de démarrage distinct et distant, parce qu’elles prennent évidemment le problème à un niveau différent, l’un plus avancé et plein que l’autre » (José ortega y Gasset, « Guillermo Dilthey y la Idea de la vida », op. cit., p. 231). et nous verrons, dans cet article, comment ortega y Gasset caractérise le point de départ de chacun, et comment il justifie l’idée selon laquelle le sien serait « plus élevé » que celui de Dilthey.
3. José ortega y Gasset, « Guillermo Dilthey y la Idea de la vida », op. cit., p. 230.4. Ibidem, p. 251.5. et ortega y Gasset, à partir de ce constat d’une « faible résonnance » de l’œuvre de
Dilthey, précise : « Il est clair que cette disproportion entre importance et résonnance d’un nom, bien qu’elle se produise parfois dans l’histoire, implique toujours un coefficient d’anor-malité » (José ortega y Gasset, « Guillermo Dilthey y la Idea de la vida », op. cit., p. 222).
.ortega y Gasset, lecteur de la philosophie diltheyenne de la vie
Anne Bardet101123
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
Fac
ulté
s un
iver
sita
ires
Sai
nt-L
ouis
-
- 19
3.19
0.25
0.2
- 23
/02/
2015
17h
37. ©
Pre
sses
Uni
vers
itaire
s de
Fra
nce
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - F
acultés universitaires Saint-Louis - - 193.190.250.2 - 23/02/2015 17h37. ©
Presses U
niversitaires de France
102 Anne Bardet
5 janvier 2015 10:16 - Jules Vuillemin et les systèmes philosophiques - Collectif - Études philosophiques - 155 x 240 - page 102 / 160 - © PUF -
5 janvier 2015 10:16 - Jules Vuillemin et les systèmes philosophiques - Collectif - Études philosophiques - 155 x 240 - page 103 / 160 - © PUF -
la philosophie6 », incapable de conquérir l’esprit de ses contemporains7, auteur au style maladroit d’un travail à la fois prématuré et inachevé8. Pourtant, tous les commentateurs d’ortega y Gasset s’accordent pour dire que sa lecture de Dilthey a été absolument décisive. C’est pourquoi nous nous proposons ici de poser les éléments pour comprendre la manière dont ortega y Gasset s’inspire, lorsqu’il forme son concept central – le concept de vie –, de la philosophie diltheyenne et jusqu’à quel point il la modifie. Car les éloges que formule ortega y Gasset à l’égard de Dilthey, ainsi que la reconnaissance qu’il lui adresse, tournent autour de cette seule Idée de vie. C’est en tant que Dilthey l’initie et la consacre comme telle qu’ortega y Gasset dit être si admiratif. mais, dit-il, si Dilthey en est bien le précurseur, il ne la développe pas assez ni ne la radicalise suffisamment. Il l’effleure plus qu’il ne s’en saisit pleinement, il l’aperçoit, ou l’entrevoit, plus qu’il se l’approprie.
Ce qui est caractéristique de Dilthey, c’est qu’il n’est jamais parvenu à penser lui-même, à façonner ni à dominer sa propre intuition9.
Ainsi, s’il a amorcé l’Idée de vie, il ne s’est jamais installé en elle10. Le tra-vail d’ortega y Gasset autour du concept de vie pourrait donc apparaître comme une poursuite du geste esquissé par Dilthey. et, effectivement, le philosophe madrilène s’approprie la pensée de Dilthey sur l’Idée de vie en la prolongeant : il s’accorde avec lui sur le primat à accorder à la vie, cette réalité radicale, dans la mesure où celle-ci constitue le point de départ et le point d’arrivée de la philosophie ; il reprend, en la radicalisant, l’idée diltheyenne selon laquelle la vie est le lieu de la relation entre expérience vécue, éprouvée dans l’intériorité, et monde historico-social, extérieur au moi11 ; il prend acte du fait que la vie, fondamentalement, est énigme, et que, par conséquent, elle consiste à s’interroger ; la vie que pense ortega y Gasset, enfin, est, comme chez Dilthey, fondamentalement temporalisée, et, plus précisément historique. mais, au-delà de ces « correspondances » troublantes12, et au-delà du fait qu’ortega y Gasset s’inspire sans aucun doute de la philosophie dil-theyenne, nous verrons qu’il modifie considérablement le concept de vie que propose le philosophe allemand, au point de le transformer tout à fait. en effet, la vie telle que la présente Dilthey n’est pas fondamentalement régie par
6. Ibidem, p. 251.7. Ibidem, p. 223.8. Ibidem, p. 229.9. Idem.10. une note précise cette idée, dans José ortega y Gasset, « Guillermo Dilthey y la Idea
de la vida », op. cit., p. 254.11. nous verrons comment ortega y Gasset parle de la vie comme lieu d’une fusion entre
vivance et circonstance.12. et ortega y Gasset parle de « frayeur » (José ortega y Gasset, « Guillermo Dilthey y
la Idea de la vida », op. cit., p. 230) plutôt que de trouble, lorsqu’il raconte sa rencontre « par hasard » avec les textes de Dilthey (José ortega y Gasset, « Guillermo Dilthey y la Idea de la vida », op. cit., pp. 227-228).
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
Fac
ulté
s un
iver
sita
ires
Sai
nt-L
ouis
-
- 19
3.19
0.25
0.2
- 23
/02/
2015
17h
37. ©
Pre
sses
Uni
vers
itaire
s de
Fra
nce
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - F
acultés universitaires Saint-Louis - - 193.190.250.2 - 23/02/2015 17h37. ©
Presses U
niversitaires de France
5 janvier 2015 10:16 - Jules Vuillemin et les systèmes philosophiques - Collectif - Études philosophiques - 155 x 240 - page 102 / 160 - © PUF -
103 ortega y Gasset, lecteur de la philosophie diltheyenne de la vie
5 janvier 2015 10:16 - Jules Vuillemin et les systèmes philosophiques - Collectif - Études philosophiques - 155 x 240 - page 103 / 160 - © PUF -
la raison, alors même qu’elles ne fonctionnent jamais l’une sans l’autre chez le philosophe madrilène.
Commençons par examiner le statut qu’ortega y Gasset, dans la lignée de Dilthey, accorde à la vie. Lorsqu’il fait l’éloge de Dilthey en tant que celui-ci, dit le penseur espagnol, a initié une nouvelle Idée, il donne à ce der-nier terme un sens bien particulier. Il ne s’agit pas là d’une simple idée, d’une occurrence de la pensée, ni même d’une construction de l’esprit. L’Idée, au sens où l’entend le philosophe madrilène, constitue un moment nécessaire13 de l’histoire de l’humanité, et dessine un contexte – et ortega y Gasset préfé-rera le terme de circonstance – où se meuvent les hommes.
tout ce qu’ils [les hommes] font, pensent et sentent, qu’ils s’en rendent compte ou non, émane de cette inspiration de base qui constitue le sol historique sur lequel ils agissent, l’atmosphère qu’ils respirent, la substance14 qu’ils sont. C’est pourquoi les noms de ces Idées matrices désignent des époques15.
A titre d’exemple, ortega y Gasset mentionne une série d’Idées qui ont, littéralement, fait époque : le stoïcisme, le christianisme, le rationalisme, l’idéalisme ou le positivisme16 montrent bien à quel point les hommes sont véritablement installés dans – voire, jusqu’à certain point, sont – ces Idées en vigueur17 plus qu’ils ne les ont ou ne les forment. et, dit ortega y Gasset, Dilthey est donc le précurseur de la nouvelle Idée : celle de vie. L’Idée de la raison est en crise, elle ne régit plus les actions, les pensées, les sentiments des hommes ; elle perd de sa vigueur. elle ne disparaît pas, mais n’est plus, à proprement parler, matrice.
une Idée nouvelle émerge toujours dans le contexte de l’affaiblissement concomitant d’une Idée ancienne, dit par ailleurs ortega y Gasset, si bien que quelque chose de l’ordre de la filiation s’établit entre les différentes Idées. Ainsi, l’Idée de vie s’inscrit dans le sillage de celle de la raison, qu’elle garde en elle sous le mode de l’avoir été.
13. Cette nécessité dont parle ortega y Gasset n’est cependant à aucun moment prédéter-minée, ni finalisée.
14. La mobilisation de ce vocabulaire ontologique peut surprendre ici, dans la mesure où, à aucun moment, l’homme n’est pensé en termes de substance chez le penseur espagnol. L’homme, dit ortega y Gasset, n’est aucune chose, il n’a pas de nature. Cependant, il est ques-tion chez lui d’un certain « caractère ontologique de la vie ». Il en fait notamment mention dans son étude sur Dilthey, justifiant en ces termes ce glissement vers un terrain dont il met d’habitude un point d’honneur à se démarquer : si la philosophie, dit-il, n’est « pas stric-tement une science de l’être en tant qu’être, elle est néanmoins une science de ce qui est » (José ortega y Gasset, « Guillermo Dilthey y la Idea de la vida », op. cit., p. 264).
15. José ortega y Gasset, « Guillermo Dilthey y la Idea de la vida », op. cit., p. 223.16. Ibidem, p. 223.17. Le concept de vigueur, vigencia, est absolument central dans la pensé de José ortega y
Gasset. Ainsi, c’est la vigueur d’une Idée qui détermine l’époque, ou la forme historique – et l’histoire, cette vie élargie au niveau de la collectivité, sera conçue par le philosophe madrilène comme un passage à travers une succession de formes historiques.
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
Fac
ulté
s un
iver
sita
ires
Sai
nt-L
ouis
-
- 19
3.19
0.25
0.2
- 23
/02/
2015
17h
37. ©
Pre
sses
Uni
vers
itaire
s de
Fra
nce
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - F
acultés universitaires Saint-Louis - - 193.190.250.2 - 23/02/2015 17h37. ©
Presses U
niversitaires de France
104 Anne Bardet
5 janvier 2015 10:16 - Jules Vuillemin et les systèmes philosophiques - Collectif - Études philosophiques - 155 x 240 - page 104 / 160 - © PUF -
5 janvier 2015 10:16 - Jules Vuillemin et les systèmes philosophiques - Collectif - Études philosophiques - 155 x 240 - page 105 / 160 - © PUF -
Voilà pourquoi, de nos jours, on commence à découvrir la grande réalité qu’est la vie en tant que telle, dont l’intellect n’est pas plus qu’une simple fonction, et [le fait] qu’elle possède par conséquent un caractère de réalité plus radical que tous les mondes construits par ledit intellect. nous nous trouvons donc dans une disposition que l’on pourrait appeler celle du « cartésianisme de la vie », et non de la cogitatio18.
Cette Idée ne surgit pas de nulle part. elle s’inscrit dans une continuité, une suite logique. « L’histoire est parfaite continuité19 », dit ortega y Gasset. Ainsi, c’est parce que l’homme a été stoïcien, parce qu’il a vécu dans cette Idée, époque ou atmosphère, qu’il a pu devenir chrétien, et ainsi de suite. et le penseur madrilène poursuit :
toute idée à moi vient d’une autre idée à moi ou de l’idée d’un autre homme. Il n’y a pas de générations spontanées. omnis cellula e cellula. que le lecteur tente d’imaginer une idée à lui qui ne vienne d’aucune autre, ni n’aille vers une autre, qui ne débouche pas sur une autre. Venir de et aller vers sont des attributs constitutifs de toute idée. Il est donc essentiel à toute idée d’avoir une source et une embouchure, des images hydrauliques à la validité ferme20.
La continuité historique apparaît comme une continuité d’Idées, au même titre que la continuité vitale, au niveau individuel, réside dans cette suite d’idées dont il est question ici. Les deux types d’idées – idées et Idées – que mentionne ortega y Gasset se rejoignent en tant qu’elles s’inscrivent dans un tout qui les dépasse et qui, fondamentalement, est la condition de possibilité du sens. Ce n’est qu’en tant qu’on la réfère à un tout qu’une Idée fait sens. mais si cette Idée nouvelle qu’est la vie s’inscrit dans un sens21 – elle naît de la perte de vigueur de l’Idée de raison et se dirige vers une autre Idée sur laquelle ortega y Gasset ne se prononce pas –, il s’agissait néanmoins de la faire ressortir à la lumière. et c’est là le grand mérite de Dilthey : avoir vu cette Idée émerger, et l’avoir montrée22.
De la dimension matricielle de l’Idée de vie naît, chez ortega y Gasset, toute une série de considérations sur le primat à lui accorder dans l’ordre des connaissances, mais aussi dans l’ordre des réalités. Premièrement, la connais-sance doit partir de la vie, d’ailleurs décrétée condition de possibilité du savoir par ortega y Gasset qui s’inscrit sur ce point dans la continuité de Dilthey, pour qui la vie constitue le fondement ultime de la connaissance.
18. José ortega y Gasset, Historia como Sistema, in obras Completas, t. VI, op. cit., p. 79.19. José ortega y Gasset, « Guillermo Dilthey y la Idea de la vida », op. cit., p. 224.20. Ibidem, p. 224.21. un sens d’une espèce bien particulière chez ortega y Gasset, dans la mesure où il n’est
défini par le penseur madrilène que négativement : les formes historiques passées sont révo-lues et ne peuvent se répéter. C’est là le seul sens historique – non orienté, non finalisé, non déterminé – qu’ortega y Gasset prenne en compte. La seule limite assignable au possible est le passé : je ne peux pas être ce que j’ai été autrement que sur le mode d’un héritage accumulé dans ma vie, et qui agit négativement sur ce que je peux être.
22. José ortega y Gasset, « Guillermo Dilthey y la Idea de la vida », op. cit., pp. 222-225.
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
Fac
ulté
s un
iver
sita
ires
Sai
nt-L
ouis
-
- 19
3.19
0.25
0.2
- 23
/02/
2015
17h
37. ©
Pre
sses
Uni
vers
itaire
s de
Fra
nce
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - F
acultés universitaires Saint-Louis - - 193.190.250.2 - 23/02/2015 17h37. ©
Presses U
niversitaires de France
5 janvier 2015 10:16 - Jules Vuillemin et les systèmes philosophiques - Collectif - Études philosophiques - 155 x 240 - page 104 / 160 - © PUF -
105 ortega y Gasset, lecteur de la philosophie diltheyenne de la vie
5 janvier 2015 10:16 - Jules Vuillemin et les systèmes philosophiques - Collectif - Études philosophiques - 155 x 240 - page 105 / 160 - © PUF -
La vie, le fait même de vivre au-delà duquel je ne puis remonter, contient des enchaînements au contact desquels s’explicitent toute expérience et toute pensée. Voilà le point qui décide de la possibilité de la connaissance. C’est seulement parce que la vie et l’expérience contiennent tout l’enchaînement qui apparaît dans les formes, les principes et les catégories de la pensée ; c’est seulement parce que cet enchaînement peut être décelé analytiquement dans la vie et l’expérience – qu’il y a une connaissance de la réalité23.
mais au-delà du fait que la vie doive constituer le point de départ de la connaissance et de la philosophie, elle détient également le statut de réalité radicale. Dans ses Notes de travail, ortega y Gasset précise le sens qu’il donne à cette expression :
Une réalité est ultime ou radicale dans la mesure où il [le philosophe] résiste à la tentative délibérée de la transcender, c’est-à-dire quand elle se présente avec le caractère express de ne pas avoir un « au-delà », de ne rien laisser dans son dos ou derrière elle24.
C’est donc dans la mesure où il n’existe aucun au-delà de la vie, où aucune transcendance ne vient s’opposer à son immanence fondamentale que « toute autre réalité que celle de ma vie est une réalité secondaire, virtuelle, interne à ma vie et qui a sa source en elle25 ». ma vie est le contexte de toutes les autres réalités.
La vie est une réalité qui est la plus proche à chacun – cette réalité que chacun appelle « sa vie » et dont la science ne s’est jamais occupée, ne la voyant pas, ne lui donnant pas d’importance, la considérant comme évidente, la laissant, ignorée, dans son dos, faisant fi d’elle. et pourtant, cette réalité si peu importante, si triviale, la vie, notre vie, au sens le plus courant que cette expression a normalement, pos-sède sans aucun doute cette condition formidable : toutes les autres réalités, quelles qu’elles soient, sont incluses en elle ; toutes existent pour nous dans la mesure où nous vivons, c’est-à-dire dans la mesure où elles apparaissent dans notre vie […]. Personne ne peut sauter hors de sa vie, et, par conséquent, tout ce avec quoi nous serons en contact, tout ce qui prétendra exister, devra d’une manière ou d’une autre, se présenter dans notre vie26.
Ce primat de la vie sur lequel ortega y Gasset insiste à de nombreuses re-prises dans son œuvre est également central chez Dilthey, et c’est en ce sens
23. Wilhelm Dilthey, cité par Georg Lukacs, La Destruction de la raison, t. II : « L’irrationalisme moderne, de Dilthey à toynbee », trad. A. Girard, A. Gisselbrecht, J. Lefebvre, e. Pfimmer, Paris, L’Arche éditeur, coll. « Le sens de la marche », 1959, p. 21.
24. José ortega y Gasset, cité par Jean-Claude Leveque, « notas de trabajo de las carpetas Alrededor de la razón vital », in Revista de Estudios orteguianos, 19, 2009, p. 54.
25. José ortega y Gasset, « Prólogo a una edición de sus obras », in obras Completas, t. V (1932-1940), madrid, taurus, Fundación José ortega y Gasset, 2006, p. 93.
26. José ortega y Gasset, cité par manuel Diéguez muñoz, ortega y Gasset, la Razón vital y la realidad radical, el desvelamiento del ser, Bloomington, Palibrio, 2013, p. 65.
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
Fac
ulté
s un
iver
sita
ires
Sai
nt-L
ouis
-
- 19
3.19
0.25
0.2
- 23
/02/
2015
17h
37. ©
Pre
sses
Uni
vers
itaire
s de
Fra
nce
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - F
acultés universitaires Saint-Louis - - 193.190.250.2 - 23/02/2015 17h37. ©
Presses U
niversitaires de France
106 Anne Bardet
5 janvier 2015 10:16 - Jules Vuillemin et les systèmes philosophiques - Collectif - Études philosophiques - 155 x 240 - page 106 / 160 - © PUF -
5 janvier 2015 10:16 - Jules Vuillemin et les systèmes philosophiques - Collectif - Études philosophiques - 155 x 240 - page 107 / 160 - © PUF -
que celui-ci la définit comme l’« ensemble contenant le genre humain27 ». Le fait, d’autre part, que Dilthey, en 1911 – l’année de sa mort – choisisse pour sous-titre à l’édition de ses œuvres principales Philosophie das Lebens28 n’est pas moins révélateur de ce statut central accordé à la vie dans la philosophie diltheyenne. enfin, si la vie fait figure d’élément à la fois central et premier, chez le philosophe allemand comme chez ortega y Gasset, elle constitue également, ou doit constituer, le point d’arrivée de la philosophie.
Vie et expérience vitale sont les sources toujours fécondes et renouvelées de la compréhension du monde sociohistorique ; la compréhension pénètre, à partir de la vie, dans des profondeurs toujours nouvelles ; c’est seulement dans leur réper-cussion sur la vie et la société que les sciences de l’esprit obtiennent leur plus haute signification29.
La vie apparaît donc comme ce contexte où tout se meut de manière fonda-mentalement circulaire – elle est point de départ, centre, et point d’arrivée de la philosophie. La pensée ne peut lui être extérieure, la transcender, l’obser-ver du dessus ou du dehors30. elle est irrémédiablement prise en elle, si bien que la vie, d’une certaine manière, fait limite. en effet, dans la mesure où elle est ce au-delà de quoi il n’y a rien, ce au-delà de quoi la pensée ne peut remonter, elle dessine un tout, le seul tout que la philosophie ait à prendre en compte, et marque quelque chose qui est de l’ordre de la limite. elle fixe les confins de la connaissance.
Venons-en à présent aux caractéristiques précises de la vie telles que la définissent Dilthey et ortega y Gasset. et voyons comment c’est à ce niveau que le penseur madrilène commence à se détacher de celui qu’il considère comme « le philosophe le plus important de la seconde moitié du dix- neuvième siècle31 ».
La première chose à noter est que la vie ne se donne jamais indépen-damment d’un vécu chez les deux auteurs. elle se loge dans cet Erlebnis que traduit très justement ortega y Gasset par le terme de vivencia lorsqu’il décide, en 1913, de faire connaître la philosophie husserlienne en espagne. C’est l’accent sur la dimension de l’« en train de » qu’il s’agit de souligner dans le choix ortéguien du terme de vivencia – vivance. Le français, en utili-sant le participe passé32, est incapable d’exprimer cette idée d’une spontanéité
27. Wilhelm Dilthey, L’Edification du monde historique dans les sciences de l’esprit, Œuvres III, trad. s. mesure, Paris, éditions du Cerf, coll. « Passages », 1988, p. 86.
28. nous reviendrons sur cette expression controversée.29. Wilhelm Dilthey, L’Edification du monde historique dans les sciences de l’esprit, op. cit.,
p. 92.30. Francisco Javier Cortes sanchez, « ensayo sobre la Idea de vida en Dilthey », in
Scientia helmantica, Revista internacional de filosofía, 1, marzo 2013, p. 24.31. José ortega y Gasset, « Guillermo Dilthey y la Idea de la vida », op. cit., p. 222.32. La traduction choisie le plus généralement pour le terme d’Erlebnis est l’expression
d’expérience vécue.
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
Fac
ulté
s un
iver
sita
ires
Sai
nt-L
ouis
-
- 19
3.19
0.25
0.2
- 23
/02/
2015
17h
37. ©
Pre
sses
Uni
vers
itaire
s de
Fra
nce
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - F
acultés universitaires Saint-Louis - - 193.190.250.2 - 23/02/2015 17h37. ©
Presses U
niversitaires de France
5 janvier 2015 10:16 - Jules Vuillemin et les systèmes philosophiques - Collectif - Études philosophiques - 155 x 240 - page 106 / 160 - © PUF -
107 ortega y Gasset, lecteur de la philosophie diltheyenne de la vie
5 janvier 2015 10:16 - Jules Vuillemin et les systèmes philosophiques - Collectif - Études philosophiques - 155 x 240 - page 107 / 160 - © PUF -
agissante de l’homme, d’un pur événement d’exister qui transparaît dans le gérondif espagnol. La vie est un faciendum, et non un factum33.
en allemand, on dit erlebnis. en espagnol : vivencia. mis il n’y a pas de mot français pour saisir d’un seul trait la vie comme expérience d’elle-même. Il faut alors employer des périphrases. ou alors utiliser le mot « vécu » qui est approximatif. et contestable. C’est un mot fade et mou. D’abord et surtout, c’est passif, le vécu. et puis c’est au passé. mais l’expérience de la vie, que la vie fait d’elle-même, de soi-même, en train de la vivre, c’est actif. et c’est au présent, forcément. C’est-à-dire qu’elle se nourrit du passé pour se projeter dans l’avenir34.
La vie qui intéresse Dilthey et ortega y Gasset est fondamentalement expéri-mentée, et si elle s’inscrit dans un « cours35 », elle est en même temps toujours pensée comme étant immanente et immédiate36. et au-delà de cette expé-rience que je fais ici et maintenant, et qui porte en elle un passé dont elle hérite, le regard tourné vers le futur, la vivencia est également vie pour moi, et mes vivances, pensées au pluriel, ne désignent finalement pas autre chose que mes états de conscience.
La vivance est un mode caractéristique distinct dans lequel la réalité est là pour moi […] je la possède de manière immédiate comme m’appartenant en un certain sens37.
en outre, la saisie de la vivance, ou expérience vécue, se fait toujours de l’intérieur. Il n’y a aucune distance entre celui qui expérimente et ce qu’il expérimente, dans la mesure où l’on n’est jamais dans un rapport de face à face avec l’Erlebnis, comme le souligne n. Zaccaï-Reyners dans sa réflexion sur la différence entre expérience et expérience vécue chez Dilthey38.
La vie est, en effet, expérience de soi-même – cela est évident. mais, en outre, ce qui, en elle, est expérimenté, est la racine de tout, de sorte que c’est la réalité
33. on retrouve fréquemment cette idée dans les textes d’ortega y Gasset. Pour exemple, voyez Historia como Sistema, op. cit., pp. 47-81.
34. Jorge semprun, L’Écriture ou la vie, Paris, Gallimard, Folio, 1994, p. 184, cité par nathalie Depraz, article « erleben », Vocabulaire européen des philosophes, dictionnaire des intra-duisibles, sous la direction de Barbara Cassin, tours, editions du seuil, coll. « Dictionnaires Le Robert », 2004, p. 369.
35. nous reviendrons sur cette idée centrale d’un cours de la vie.36. L’immédiateté est une dimension que souligne Dilthey à plusieurs reprises : dans la
mesure où il n’y a pas d’intermédiaire entre ma vie et moi-même, ni aucune distance non plus, celle-ci n’est jamais envisageable comme une expérience médiate. et la tâche de la philosophie est d’atteindre cette immédiateté. Ainsi, Dilthey écrit dans L’Édification du monde historique dans les sciences de l’esprit qu’« il s’agit, par-delà le travail scientifique, de revenir à ce fait [la vie] et de saisir le fait lui-même dans son immédiateté » (Wilhelm Dilthey, L’Édification du monde historique dans les sciences de l’esprit, op. cit., p. 86). nous soulignons.
37. Wilhelm Dilthey, cité par Francisco Javier Cortes sanchez, « ensayo sobre la Idea de vida en Dilthey », op. cit., p. 23.
38. nathalie Zaccaï-Reyners, Le Monde de la vie, t. I : « Dilthey et husserl », Paris, édi-tions du Cerf, coll. « humanités », 1995, pp. 33-39.
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
Fac
ulté
s un
iver
sita
ires
Sai
nt-L
ouis
-
- 19
3.19
0.25
0.2
- 23
/02/
2015
17h
37. ©
Pre
sses
Uni
vers
itaire
s de
Fra
nce
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - F
acultés universitaires Saint-Louis - - 193.190.250.2 - 23/02/2015 17h37. ©
Presses U
niversitaires de France
108 Anne Bardet
5 janvier 2015 10:16 - Jules Vuillemin et les systèmes philosophiques - Collectif - Études philosophiques - 155 x 240 - page 108 / 160 - © PUF -
5 janvier 2015 10:16 - Jules Vuillemin et les systèmes philosophiques - Collectif - Études philosophiques - 155 x 240 - page 109 / 160 - © PUF -
radicale. on a pris d’elle tel ou tel autre composant abstrait, « amputé » ; cela lui fait perdre son caractère de réalité effective, parce que la vie est intégrité – tout, en elle, est interdépendant39.
Cette formule est révélatrice à plusieurs égards. on y lit le statut de réa-lité radicale que nous avons mentionné plus haut. on y lit également l’idée d’un tout non divisible, sur laquelle nous reviendrons. enfin, et c’est ce qui retiendra notre attention pour le moment, on voit ici apparaître l’idée d’une expérience de la vie comme racine. La vie est à ce point vécue que c’est par là qu’ortega y Gasset justifie le primat qu’il lui accorde. C’est parce que nous sentons la vie comme étant la racine de tout le reste que nous sommes en mesure d’affirmer qu’elle est la réalité radicale. Autrement dit, il semble que nous nous situions ici dans une perspective de type empiriste.
Cette vie qui s’éprouve se saisit en même temps elle-même dans un retour réflexif sur soi, une autoréflexion immédiate et non réfléchie. Cette dimension réflexive et l’idée d’une conscience immédiate de soi dans l’Erleb-nis dépasse très largement l’œuvre de Dilthey. Ainsi, « la phénoménologie s’est donné pour tâche de décrire ce sursaut de la vie sur elle-même en lequel je m’aperçois consciemment en train de40 vivre tel moment de ma vie41 ». et si ortega y Gasset critique à plusieurs reprises la dimension par trop « psycho-logisante » de la philosophie diltheyenne, il reconnaît néanmoins l’existence d’un lien indissoluble entre vie et savoir – un savoir immédiat qui s’expéri-mente essentiellement par les sens.
Vivre, c’est […] ne pas se contenter d’être, mais comprendre, ou voir que l’on est, se rendre compte. C’est la découverte incessante que nous faisons de nous-mêmes et du monde alentour. […] notre vie est nôtre, parce que nous nous rendons compte de ce qu’elle est et de la manière dont elle est. en nous percevant, en nous sentant, nous prenons possession de nous-mêmes et du fait de se trouver toujours en possession de soi-même, d’assister perpétuellement et radicalement à ce que nous sommes42.
J’éprouve la présence de ma vie à moi-même dans la mesure où je la vois et je la sens, dit ortega y Gasset. Le savoir lié à la vie est un savoir empirique et intime, intériorisé.
s’il reconnaît une cohésion immédiate entre la vie telle qu’elle s’éprouve intimement et un savoir immanent et non réfléchi, Dilthey veut, quant à lui, bâtir, à partir de cette autoréflexion, un véritable ensemble de sciences. Il dépasse la conception ortéguienne du vivre comme un « se rendre compte »,
39. José ortega y Gasset, cité par Jean-Claude Leveque, « notas de trabajo de las carpetas Alrededor de la razón vital », op. cit., p. 48.
40. et l’on retrouve ici le sens du gérondif espagnol.41. nathalie Depraz, Article « erleben », Vocabulaire européen des philosophes, dictionnaire
des intraduisibles, op. cit., p. 370.42. José ortega y Gasset, cité par manuel Diéguez muñoz, ortega y Gasset, la Razón vital
y la realidad radical, op. cit., p. 15.
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
Fac
ulté
s un
iver
sita
ires
Sai
nt-L
ouis
-
- 19
3.19
0.25
0.2
- 23
/02/
2015
17h
37. ©
Pre
sses
Uni
vers
itaire
s de
Fra
nce
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - F
acultés universitaires Saint-Louis - - 193.190.250.2 - 23/02/2015 17h37. ©
Presses U
niversitaires de France
5 janvier 2015 10:16 - Jules Vuillemin et les systèmes philosophiques - Collectif - Études philosophiques - 155 x 240 - page 108 / 160 - © PUF -
109 ortega y Gasset, lecteur de la philosophie diltheyenne de la vie
5 janvier 2015 10:16 - Jules Vuillemin et les systèmes philosophiques - Collectif - Études philosophiques - 155 x 240 - page 109 / 160 - © PUF -
il amplifie l’idée d’une simple présence de sa vie à soi-même pour, à partir de là, rechercher un fondement solide pour les sciences de l’esprit.
Vie, expérience de la vie et sciences de l’esprit se trouvent ainsi constamment en un rapport de cohésion interne et de dépendance réciproque. Ce n’est pas une démarche conceptuelle qui constitue le fondement des sciences de l’esprit, mais la saisie d’un état psychique dans sa totalité et la capacité de le retrouver en le revivant. C’est la vie qui ici saisit la vie43.
Cependant, la vie (Leben), chez Dilthey, n’est pas réductible à l’Erlebnis – ni la vida réductible à la vivance chez ortega y Gasset. Car si la vie se caractérise par l’immédiateté et l’immanence, il faut néanmoins toujours la référer à son contexte, qui, jusqu’à un certain point, vient la constituer comme vie.
Chaque mot, chaque phrase, chaque attitude ou formule de politesse, chaque œuvre d’art et chaque fait historique ne sont compréhensibles que dans la mesure où une communauté relie celui qui s’y extériorise et celui qui comprend ; l’individu vit, pense et agit dans une sphère de communauté et il ne parvient à la compréhension que dans une telle sphère. tout ce qui est compris porte en soi pour ainsi dire la mar-que du fait que c’est à partir d’une telle communauté qu’il est connu. nous vivons dans cette atmosphère44, elle nous entoure continuellement. nous sommes plongés en elle. Dans ce monde de l’histoire et de la compréhension, nous sommes partout chez nous, nous comprenons le sens et la signification de tout ce qui en fait partie, nous sommes nous-mêmes imbriqués dans ces dimensions de communauté45.
Pour comprendre la vie de l’homme – au sens où Dilthey entend ce terme de compréhension – il faut donc, outre le fait de s’assumer comme être his-torique appartenant à une communauté donnée, l’inscrire dans son monde historico-social, ou dans sa circonstance pour le dire en termes ortéguiens. Le philosophe espagnol s’oppose ainsi à l’idée, développée par teilhard de Chardin notamment, que l’homme, pensé par différence avec les autres ani-maux attachés chacun à leur habitat et incapables de survivre en dehors de celui-ci, serait capable de vivre n’importe où sur la planète. ortega y Gasset maintient au contraire l’idée que la circonstance vient définir l’homme, et orienter sa vie. La circonstance est si constitutive de la vie humaine que le philosophe madrilène en fait un des deux éléments qui participent de la défi-nition essentielle de l’homme.
C’est là que la distinction devient intéressante : alors que Dilthey parle de la vie humaine comme d’une relation entre le moi et le monde, ortega en
43. Wilhelm Dilthey, L’Édification du monde historique dans les sciences de l’esprit, op. cit., p. 90.
44. un terme que reprend ortega y Gasset pour désigner la circonstance – cet autour de que respirent les hommes (José ortega y Gasset, « Guillermo Dilthey y la Idea de la vida », op. cit., p. 223. Voyez également la note 3).
45. Wilhelm Dilthey, L’Édification du monde historique dans les sciences de l’esprit, op. cit., p. 100.
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
Fac
ulté
s un
iver
sita
ires
Sai
nt-L
ouis
-
- 19
3.19
0.25
0.2
- 23
/02/
2015
17h
37. ©
Pre
sses
Uni
vers
itaire
s de
Fra
nce
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - F
acultés universitaires Saint-Louis - - 193.190.250.2 - 23/02/2015 17h37. ©
Presses U
niversitaires de France
110 Anne Bardet
5 janvier 2015 10:16 - Jules Vuillemin et les systèmes philosophiques - Collectif - Études philosophiques - 155 x 240 - page 110 / 160 - © PUF -
5 janvier 2015 10:16 - Jules Vuillemin et les systèmes philosophiques - Collectif - Études philosophiques - 155 x 240 - page 111 / 160 - © PUF -
vient à l’idée d’une confusion entre vivance et circonstance. en effet, Dilthey fait de la résistance du monde extérieur la condition de la construction de l’identité du moi, il fait de ce qu’il appelle la relation vitale (Lebensbezug) un élément qui, finalement, semble plus fondamental que la vie considérée isolément, coupée de son contexte46. Le point au-delà duquel la pensée ne peut pas remonter glisse de la vie dont il était question plus haut à la relation entre moi et monde.
[…] ce milieu, ce monde extérieur, autrement dit ce quelque chose qui est dis-tinct du moi, qui est autre que lui et s’offre à lui en tant qu’objet, n’exprime rien d’autre qu’un rapport de résistance à notre volonté, résistance liée à la multiplicité de nos sens. Dans cette proposition, n’allez pas voir une démonstration de la réalité du monde extérieur : une telle démonstration est absolument impossible. mais c’est une donnée de notre expérience que, à notre moi, s’oppose quelque chose qui lui est extérieur. La pensée reste absolument incapable de remonter plus haut que cette donnée qui, constamment, partout dans notre vie, ne cesse d’affirmer cette oppo-sition comme la plus élémentaire de toutes les relations47.
sans cet autre terme qu’est le monde, le moi n’aurait pas d’existence ; c’est en effet dans la résistance que lui oppose le monde extérieur – la relation entre moi et monde étant pensée par le philosophe allemand en termes d’oppo-sition – qu’il se découvre lui-même, et c’est par rapport à ce monde que s’affirment les états sentimentaux et les désirs d’action48. La vie, pour le dire encore autrement, est cette relation d’opposition entre l’intériorité de la vie psychique du moi et l’extériorité du monde49. L’intériorité du moi est si affec-tée par le monde que c’est lui qui vient véritablement le constituer dans son identité50. et non seulement la relation entre moi et monde est-elle qualifiée de vitale, mais c’est également d’un rapport vivant dont il est question.
46. De fait, une telle vie serait une abstraction pure pour le philosophe allemand.47. Wilhelm Dilthey, Théorie des conceptions du monde, essai d’une philosophie de la philo-
sophie, trad. L. sauzin, Paris, Puf, coll. « Bibliothèque de philosophie contemporaine », 1946, p. 18.
48. Wilhelm Dilthey, Théorie des conceptions du monde, essai d’une philosophie de la philo-sophie, op. cit., p. 21.
49. Les propos de Jean-Claude Gens sont particulièrement éclairants sur ce point : « La vie telle que l’entend Dilthey n’est jamais que pour la conscience, vie en tant qu’elle est vécue, vue ou conçue. mais la vie ne se réduit pas pour autant à ce qui s’éprouverait dans l’intériorité d’une vie psychique ou d’une conscience, puisque celle-ci ne se déploie que dans sa relation à ce dont elle est consciente ou dont elle fait l’épreuve, en tant que conscience incarnée. Il n’est en ce sens pas anodin que, pour décrire l’expérience la plus primitive de tout sujet, Dilthey parte de l’expérience de l’enfant enfermé dans une chambre, c’est-à-dire de la résistance que lui oppose la porte fermée – et non, par exemple, de la résistance que constitue, pour la pen-sée, un paradoxe logique. Cette expérience de la résistance que lui oppose la porte à laquelle “il frappe en vain”, c’est celle de la pression du monde extérieur, de sa volonté entravée, qui est indissociable de la conscience du moi » (Jean-Claude Gens, « L’herméneutique diltheyenne des mondes de la vie », Philosophie, editions de minuit, p. 67).
50. C’est d’ailleurs peut-être sur ce point que Dilthey se démarque le plus de la phéno-ménologie husserlienne. Car si le geste qu’ils mettent chacun en place peut être rapproché l’un de l’autre, et si certaines des conclusions auxquelles ils parviennent – comme le fait que le plan du « moi pur du vivre » (edmund husserl, Ideen, § 80) et celui du monde vécu ne
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
Fac
ulté
s un
iver
sita
ires
Sai
nt-L
ouis
-
- 19
3.19
0.25
0.2
- 23
/02/
2015
17h
37. ©
Pre
sses
Uni
vers
itaire
s de
Fra
nce
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - F
acultés universitaires Saint-Louis - - 193.190.250.2 - 23/02/2015 17h37. ©
Presses U
niversitaires de France
5 janvier 2015 10:16 - Jules Vuillemin et les systèmes philosophiques - Collectif - Études philosophiques - 155 x 240 - page 110 / 160 - © PUF -
111 ortega y Gasset, lecteur de la philosophie diltheyenne de la vie
5 janvier 2015 10:16 - Jules Vuillemin et les systèmes philosophiques - Collectif - Études philosophiques - 155 x 240 - page 111 / 160 - © PUF -
Les données que nous recevons n’appartiennent pas exclusivement à notre seule vie intérieure ou au seul monde extérieur ; ces données ne font d’ailleurs pas qu’être simultanées, elles sont en rapport extrêmement vivant entre elles.51
Le rapport entre le moi et le monde, outre la nécessité vitale qu’il représente – au sens le plus littéral du terme, dans la mesure où la vie dépend de ce rap-port, où il n’y a de vie que logée dans cette relation – est donc un rapport vivant, épais et mouvant.
Au-delà, force est de constater que la question des rapports occupe une place centrale dans la philosophie diltheyenne. Ainsi, lorsqu’il présente sa Théorie des conceptions du monde, il insiste bien sur ce point : il ne s’agit pas tant, dans cette « philosophie de la philosophie » que Dilthey veut mettre en place52, d’énoncer ce qu’est le monde, ni non plus de déterminer ce qu’est l’homme, que d’interroger le rapport entre les deux qui, considérés indépen-damment l’un de l’autre, n’apparaissent d’ailleurs que comme de pures abs-tractions53.
tout ce que l’homme est capable d’apercevoir dans le monde se ramène toujours au rapport qui lie sa vie intime à certaines qualités du monde, qualités qu’il est inca-pable de modifier. une loi inébranlable le lie à cette relation, et c’est la loi fondamen-tale qui régit sa situation. Ce qu’il contemplera, rêvera ou pensera sous ce nom de monde, ce sera toujours ce rapport, et rien d’autre. Le monde, son monde n’est pas plus un produit de sa vie intime qu’il n’est une donnée de fait, un fait objectif54.
La vie, chez Dilthey, ce point de départ – et d’arrivée – de la philosophie, ce contexte où tout se meut, est toujours entendue comme vie relationnelle entre le moi et le monde qui, fondamentalement, n’ont d’existence que l’un par rapport à l’autre. Comme le formule remarquablement Jean-Claude Gens, « la vie est donc ce donné primitif qui s’articule progressivement dans le cadre d’une relation, c’est-à-dire d’une expérience, dans le contexte de
soient rien l’un sans l’autre, au point d’être deux « corrélats nécessaires » (edmund husserl, Ideen, § 81) chez husserl, et que Dilthey conclue à une co-implication indépassable entre le moi et le monde – présentent d’indéniables similitudes, il n’en reste pas moins qu’une différence radicale se fait jour : le principe égologique husserlien, que le phénoménologue définit au § 57 des Ideen comme « une transcendance originale, non constituée, une trans-cendance au sein de l’immanence » – une transcendance que critiquera Dilthey, qui taxera au passage husserl d’idéalisme – est ce qui vient unifier le monde vécu, caractérisé comme fluctuant, changeant ; chez Dilthey, au contraire, le moi a besoin du monde pour se consti-tuer dans son identité dans la mesure où c’est le monde qui vient donner sa cohérence au moi.
51. Wilhelm Dilthey, Théorie des conceptions du monde, op. cit., p. 19.52. Dilthey précise le sens du sous-titre qu’il donne à sa Théorie des conceptions du monde,
« essai d’une philosophie de la philosophie », en ces termes : « La philosophie doit se prendre elle-même pour objet, se considérer comme un fait appartenant à l’histoire de l’humanité » (Wilhelm Dilthey, Théorie des conceptions du monde, op. cit., p. 35).
53. Aucun sang réel ne coule dans les veines du sujet transcendantal kantien, dit par exemple Dilthey. D’autre part, le monde n’est rien s’il n’est pas monde pour moi, et plus précisément monde vécu par moi.
54. Wilhelm Dilthey, Théorie des conceptions du monde, op. cit., p. 35.
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
Fac
ulté
s un
iver
sita
ires
Sai
nt-L
ouis
-
- 19
3.19
0.25
0.2
- 23
/02/
2015
17h
37. ©
Pre
sses
Uni
vers
itaire
s de
Fra
nce
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - F
acultés universitaires Saint-Louis - - 193.190.250.2 - 23/02/2015 17h37. ©
Presses U
niversitaires de France
112 Anne Bardet
5 janvier 2015 10:16 - Jules Vuillemin et les systèmes philosophiques - Collectif - Études philosophiques - 155 x 240 - page 112 / 160 - © PUF -
5 janvier 2015 10:16 - Jules Vuillemin et les systèmes philosophiques - Collectif - Études philosophiques - 155 x 240 - page 113 / 160 - © PUF -
laquelle se constituent simultanément et interactivement la subjectivité d’un sujet et l’objectivité d’un monde55 ».
ortega y Gasset reprend à son compte cette idée centrale de la philo-sophie diltheyenne – la vie est ainsi pensée, dès 191056 comme « ensemble de relations » – allant jusqu’à faire du moi une moitié de ma vie, et du monde la seconde, au sein d’une inséparabilité constitutive.
notre vie est un dialogue où l’individu est un interlocuteur ; l’autre, c’est le paysage, le circonstant57.
mais, au-delà de l’inséparabilité qui règne au sein cette cohabitation58 entre un soi et un monde, ortega y Gasset parle d’une indissociabilité irréductible. Ainsi, dans sa célèbre formule : Je suis moi et ma circonstance. Au-delà du fait que la circonstance constitue pour moitié ma vie, je suis elle dans la pensée du philosophe madrilène. ortega y Gasset prolonge ainsi le geste diltheyen, rendant plus prégnante encore la co-imbrication entre moi et monde. La vie devient ainsi le lieu du lien entre un moi – toujours mondain – et un monde – ou plus exactement mon monde, c’est-à-dire le monde en tant qu’il constitue ma circonstance et qu’il est vécu par moi. elle devient le contexte où se produit cette interaction59 entre intérieur et extérieur.
mais cette vie qui fait se rejoindre ce que l’on pourrait considérer comme deux pôles est loin d’être duale. elle est, plus qu’une union entre le moi et le monde, le lieu de leur fusion. La vie, chez ortega y Gasset, n’est pas pola-risée, si bien que la philosophie qu’il développe est fondamentalement non dualiste.
et, au-delà du fait qu’elle est non duale, la vie ortéguienne n’est pas divisible non plus. elle se donne dans un flux unifié qui rappelle les textes
55. Jean-Claude Gens, « L’herméneutique diltheyenne des mondes de la vie », op. cit., p. 68.
56. José ortega y Gasset, « Adán en el Paraíso », in obras completas, tomo II (1916), madrid, taurus, Fundación ortega y Gasset, 2004.
57. José ortega y Gasset, cité par manuel Diéguez muñoz, ortega y Gasset, la Razón vital y la realidad radical, op. cit., p. 16.
58. une cohabitation qui, fondamentalement, soulève des enjeux d’ordre politique, comme le révèle bien cette longue citation : « Vivre, c’est cohabiter, et l’autre qui cohabite avec nous, c’est le monde alentour. ne comprenons pas, donc, un acte vital, quel qu’il soit, mais ce que nous mettons en connexion avec le contour auquel il s’adresse, en fonction duquel il est né […] À toute heure, nous commettons des injustices envers nos prochains, jugeant mal leurs actes, oubliant que peut-être, ils s’adressent à des éléments de leur contexte qui n’existent pas dans le nôtre. Chaque être possède son paysage propre, en relation avec lequel il se comporte. Ce paysage coïncide, parfois plus, d’autres fois moins, avec le nôtre. La supposition qu’il existe un milieu vital unique, où se trouvent immergés tous les sujets vivants, est capricieuse et inféconde […] Évitons, donc, de supplanter par notre monde celui des autres. Car cela mène irrémédiablement à l’incompréhension de son prochain » (José ortega y Gasset, cité par manuel Diéguez muñoz, ortega y Gasset, la Razón vital y la realidad radical, op. cit., p. 16). nous reviendrons sur les différences d’enjeux que soulèvent les philosophies diltheyenne et ortéguienne autour de cette question de la vie.
59. Cette notion d’interaction connaît d’ailleurs un usage très prolifique dans la pensée diltheyenne.
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
Fac
ulté
s un
iver
sita
ires
Sai
nt-L
ouis
-
- 19
3.19
0.25
0.2
- 23
/02/
2015
17h
37. ©
Pre
sses
Uni
vers
itaire
s de
Fra
nce
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - F
acultés universitaires Saint-Louis - - 193.190.250.2 - 23/02/2015 17h37. ©
Presses U
niversitaires de France
5 janvier 2015 10:16 - Jules Vuillemin et les systèmes philosophiques - Collectif - Études philosophiques - 155 x 240 - page 112 / 160 - © PUF -
113 ortega y Gasset, lecteur de la philosophie diltheyenne de la vie
5 janvier 2015 10:16 - Jules Vuillemin et les systèmes philosophiques - Collectif - Études philosophiques - 155 x 240 - page 113 / 160 - © PUF -
de Bergson sur la durée60, dont l’intuition révèle qu’elle est « une succession qui n’est pas juxtaposition, une croissance par le dedans, le prolongement ininterrompu du passé dans un présent qui empiète sur l’avenir » ; en somme, une « continuité indivisible »61.
Ce qu’il y a de plus évident et de plus clair dans tout fait de conscience, c’est qu’il se présente toujours et constitutivement en connexion avec d’autres faits de conscience. si je crois quelque chose, je le crois parce que je pense telle autre chose. si je veux quelque chose, c’est pour tel motif et pour telle fin. en somme, le plus essentiel du fait de conscience est qu’il se donne dans un complexe, une connexion, une interdépendance et un contexte avec d’autres faits de conscience. Celle-ci est un ensemble où tout est joint62.
si le « tout psychophysique » qu’est l’individu se donne également chez Dilthey de manière unifiée, dans une continuité non divisible, ortega y Gasset reproche tout de même au philosophe allemand de penser l’homme sur le mode de l’union d’une âme, ou d’un esprit, et d’un corps – ou plus exactement, pour le dire dans les termes de Dilthey lui-même, d’un psy-chique et d’un physique – là où lui parlera de l’homme comme d’un drame. Cela dit, il est bien question chez Dilthey de quelque chose de l’ordre du flux. en témoigne cette formule :
Chaque vécu singulier ne devient ainsi pleinement signifiant qu’à partir du tout. et comme les mots sont liés à la compréhension de la phrase entière, c’est de la cohérence même de ces vécus que provient la signification du cours de la vie63.
mais ortega y Gasset considère que Dilthey n’est pas assez radical sur ce point. sa tendance à s’appuyer sur la psychologie est critiquée de manière plus ou moins déguisée par le philosophe madrilène : outre le fait que l’indi-vidu est conçu comme ce « tout psychophysique » dont parle Dilthey, et qui, déjà, fait problème en tant que l’individu semble scindé, de par cette expression, en deux entités distinctes, c’est essentiellement contre l’idée d’une divisibilité de la vie que s’inscrit ortega y Gasset. même si Dilthey parle de l’homme en termes d’un flux indivisible, un « tout » dont on ne
60. son Essai sur les données immédiates de la conscience, notamment, démontre magis-tralement cette indivisibilité du flux de la vie, pensé par analogie avec la phrase musicale. L’organisation des différents moments révèle une « solidarité », une « pénétration mutuelle » qui nous échappe dès lors que nous pensons le temps en termes d’espace et la durée en termes d’étendue. Ainsi, le moment n’est compréhensible que si on l’inscrit dans le flux, de la même manière que la note n’est juste ou fausse que par rapport à d’autres notes qui, ensemble, constituent une mélodie.
61. henri Bergson, La Pensée et le mouvant, Paris, Puf, p. 27.62. José ortega y Gasset, « Guillermo Dilthey y la Idea de la vida », op. cit., pp. 246-
247.63. Wilhelm Dilthey, cité par servanne Jollivet, Heidegger, Sens et histoire, Paris, Puf, coll.
« Philosophies », 2009, p. 45.
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
Fac
ulté
s un
iver
sita
ires
Sai
nt-L
ouis
-
- 19
3.19
0.25
0.2
- 23
/02/
2015
17h
37. ©
Pre
sses
Uni
vers
itaire
s de
Fra
nce
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - F
acultés universitaires Saint-Louis - - 193.190.250.2 - 23/02/2015 17h37. ©
Presses U
niversitaires de France
114 Anne Bardet
5 janvier 2015 10:16 - Jules Vuillemin et les systèmes philosophiques - Collectif - Études philosophiques - 155 x 240 - page 114 / 160 - © PUF -
5 janvier 2015 10:16 - Jules Vuillemin et les systèmes philosophiques - Collectif - Études philosophiques - 155 x 240 - page 115 / 160 - © PUF -
peut détacher les parties au risque de « mutiler » son objet64, ortega y Gasset dit de la psychologie en général que, si elle parvient à dire quelque chose des mécanismes avec lesquels on vit, elle reste incapable d’atteindre le vivre lui-même. et, pire encore, elle désintègre65 la vie, cet integrum, en parties qui sont, chacune à leur tour, substantivées et faites substances, au point qu’on en oublie l’indivisibilité fondamentale de la vie66.
Cette indivisibilité, outre qu’elle est réelle, doit être prise en compte et respectée comme telle par le philosophe, sans quoi il tomberait dans la mécompréhension la plus absolue. La liaison en question est décrétée comme le fait fondamental de la vie de l’esprit chez ortega y Gasset. encore une fois, le lien, la relation prennent plus d’importance que les éléments reliés.
Le fait fondamental de la conscience immédiate est la connexion. L’esprit est en tout point connexion : tout en lui se donne enlacé, articulé, relié. La relation, le lien, l’unité intégrative et organique sont, dans le monde mental, un pur et simple fait. Le tout est dans la vie spirituelle avant les parties […]. tout ce qu’on essaiera de penser est déjà dans cette connexion radicale, ou unité organique de notre esprit, et sera la conséquence de celle-ci. Il n’y a aucune manière de sauter en dehors, et il est absurde de vouloir expliquer par un autre lien originaire cette connexion radicale où vit et qu’est notre pensée. elle est justement le présupposé pour expliquer tout le reste. expliquer quelque chose, c’est, en dernière instance, montrer son lieu et son rôle dans l’économie vivante de notre conscience, fixer le « sens » qu’elle a dans la source originaire de tout sens – la vie67.
La vie, si elle ne se donne pas indépendamment du vécu, si elle ne se donne pas hors de la circonstance, se donne également toujours dans un flux tem-porel, dans une histoire. L’importance de la thèse diltheyenne du cours de la vie est capitale, comme il le reconnaît lui-même textuellement68. Cette tem-poralité est aussi essentielle à avoir à l’esprit que le fait de la relation entre le moi et le monde si l’on veut comprendre la vie.
64. La critique diltheyenne du positivisme comtien va dans ce sens : Ainsi, dans son « Avant-propos » de 1911 : « Lorsque j’abordai la philosophie, le monisme idéaliste de hegel était battu en brèche par la domination des sciences de la nature. quand l’esprit de ces sciences se transforma en philosophie, comme chez les encyclopédistes, chez Comte, et en Allemagne chez les naturalistes qui se voulaient philosophes, il tenta de concevoir l’esprit comme un produit de la nature – et il mutila » (nous soulignons) (Wilhelm Dilthey, Critique de la raison historique, op. cit., p. 37).
65. si Dilthey parle à certains moments du fait que les positivistes, en voulant penser l’esprit sur le mode de la matière, découpent, divisent, mutilent leur objet (voir n. 67), il ne va pas néanmoins jusqu’à parler de « désintégration ». Ici encore, ortega y Gasset radicalise les propos du philosophe allemand.
66. Cette critique apparaît notamment dans les Notes de travail d’ortega y Gasset, citées par Jean-Claude Leveque, « Notas de trabajo de las carpetas. Alrededor de Dilthey desde la razón vital », op. cit., p. 53.
67. José ortega y Gasset, « Guillermo Dilthey y la Idea de la vida », op. cit., p. 263.68. Dilthey écrit : « C’est dans le cours de la vie, dans la façon dont elles surgissent du
passé et se profilent dans l’avenir que résident les réalités qui constituent l’ensemble actif et la valeur de notre vie […]. Dans mes cours d’introduction à la philosophie, aucune thèse n’a sans doute autant de poids que celle-ci » (Wilhelm Dilthey, Critique de la raison historique, op. cit., pp. 39-40).
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
Fac
ulté
s un
iver
sita
ires
Sai
nt-L
ouis
-
- 19
3.19
0.25
0.2
- 23
/02/
2015
17h
37. ©
Pre
sses
Uni
vers
itaire
s de
Fra
nce
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - F
acultés universitaires Saint-Louis - - 193.190.250.2 - 23/02/2015 17h37. ©
Presses U
niversitaires de France
5 janvier 2015 10:16 - Jules Vuillemin et les systèmes philosophiques - Collectif - Études philosophiques - 155 x 240 - page 114 / 160 - © PUF -
115 ortega y Gasset, lecteur de la philosophie diltheyenne de la vie
5 janvier 2015 10:16 - Jules Vuillemin et les systèmes philosophiques - Collectif - Études philosophiques - 155 x 240 - page 115 / 160 - © PUF -
Chaque élément passé, dans la mesure où sa réminiscence inclut une reconnais-sance, est structurellement rapporté, en tant que reproduction, à une expérience vécue d’autrefois. Le possible qui est à venir est également rattaché à la série par le champ des possibilités qu’elle détermine. Ainsi dans ce processus l’intuition de l’ensemble psychique survient dans le temps qui définit le cours de la vie. Dans ce cours de la vie, chaque expérience vécue particulière est rapportée à une totalité. […] À partir du présent, nous parcourons de façon régressive une série de souvenirs jusqu’au point où notre petit moi non encore fixé et formé se perd dans les limbes, et à partir de ce présent nous nous élançons vers des possibles inscrits en lui et qui prennent des dimensions vagues et lointaines69.
La vie, cette conjonction du moi et du monde, n’est donc pas pensable indépendamment de sa temporalité, ou de son historicité fondamentales70. L’homme est un être historique, et ortega y Gasset reconnaît d’ailleurs que sa célèbre idée, répétée à plusieurs reprises dans ses ouvrages, selon laquelle « l’homme n’a pas de nature, mais il a une histoire », lui vient de Dilthey71. et cette idée se décline sur plusieurs registres72. Premièrement, la nature de l’homme est remplacée par son histoire dans la mesure où sa constitution n’est pas immuable, mais présente des formes diverses et variées. L’histoire, à ce stade, ne désigne rien d’autre que le simple fait des variations de l’être humain73. Deuxièmement, l’homme a une histoire dans le sens où, à cha-que moment, il inclut toujours déjà un passé : dans l’actualité de chaque homme particulier intervient le souvenir de ce qui lui est arrivé et de ce qu’il
69. Wilhelm Dilthey, L’Édification du monde historique dans les sciences de l’esprit, op. cit., pp. 94-95.
70. De fait, ortega y Gasset va jusqu’à défendre l’idée d’une causalité historique, là où Dilthey faisait du lien de cause à effet un processus à l’œuvre dans les sciences de la nature, mais absent des sciences de l’esprit. « La vie, qui est création permanente du futur, est, en même temps, réforme permanente du passé ; je m’explique : elle vit le passé en tant que tel, de manière différente à chaque époque. L’histoire, bien plus que la physique, est une science des causes et, comme la physique, elle ne recherche rien d’autre que cela. Ce qui n’est pas processus d’effectuation n’a pas de réalité historique, de la même manière que ce qui ne donne pas lieu à établir une fonction n’a pas de réalité en physique » (c’est ce qu’explique le penseur madrilène dans une note, in José ortega y Gasset, « Guillermo Dilthey y la Idea de la vida », op. cit., pp. 225-226). ortega y Gasset sauve donc l’idée d’une causalité historique par la temporalité constitutive de la vie, c’est-à-dire par cette double projection dans le futur et dans le passé, à partir de son immanence radicale.
71. José ortega y Gasset, « Guillermo Dilthey y la Idea de la vida », op. cit., p. 251.72. nous reprenons ici point par point l’analyse que propose ortega y Gasset de l’homme
comme être historique dans « Guillermo Dilthey y la Idea de la vida », op. cit., pp. 251-252.73. « L’histoire – écrit Dilthey –, c’est la multiplicité toujours grandissante des formes
que revêt la vie humaine, cette multiplicité de formes dont l’origine se trouve dans la force génétique de la nature humaine et qui, sous l’influence des conditions géographiques, clima-tiques, sociales, prend cette variété vivante que nous lui voyons » (Wilhelm Dilthey, Théorie des conceptions du monde, op. cit., p. 4). Dans la même idée, ortega y Gasset écrit : « La vie humaine est métamorphose perpétuelle. Chaque forme apparaît dans un lieu déterminé dans la série où les formes se succèdent de manière temporelle. Il n’y a pas de “conscience histo-rique” tant qu’on ne voit pas chaque forme dans sa perspective temporelle, dans son lieu du temps historique, émergeant d’une autre forme antérieure, alors qu’une autre forme posté-rieure en émane » (José ortega y Gasset, « Guillermo Dilthey y la Idea de la vida », op. cit., p. 235). C’est à partir de la variation, du passage par les formes, de cette vie-métamorphose, qu’ortega y Gasset conclut à son historicité fondamentale.
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
Fac
ulté
s un
iver
sita
ires
Sai
nt-L
ouis
-
- 19
3.19
0.25
0.2
- 23
/02/
2015
17h
37. ©
Pre
sses
Uni
vers
itaire
s de
Fra
nce
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - F
acultés universitaires Saint-Louis - - 193.190.250.2 - 23/02/2015 17h37. ©
Presses U
niversitaires de France
116 Anne Bardet
5 janvier 2015 10:16 - Jules Vuillemin et les systèmes philosophiques - Collectif - Études philosophiques - 155 x 240 - page 116 / 160 - © PUF -
5 janvier 2015 10:16 - Jules Vuillemin et les systèmes philosophiques - Collectif - Études philosophiques - 155 x 240 - page 117 / 160 - © PUF -
a précédemment été dans sa vie. troisièmement, ce passé, présent dans le souvenir, influe sur l’actualité ; se souvenir, c’est déjà interpréter sa vie. Ainsi, l’homme est une histoire dans la mesure où il assiste à une reconstruction en continu de la vie par elle-même. quatrièmement, ces trois sens de l’histoire – variations, passé, interprétation –, trois sens qui découlent d’ailleurs les uns des autres et sont intimement liés, en produisent un quatrième : celui d’une histoire commune, qui transcende le niveau de la vie individuelle.
À partir du constat de cette historicité fondamentale de la vie humaine74, une ferme opposition aux grands systèmes à prétention universelle naît chez Dilthey, qui dénonce, par-dessus tout, les principes transcendants à l’œuvre dans les philosophies traditionnelles de l’histoire. Ils proposent un « schéma impuissant75 » et agitent des « concepts morts76 ». La philosophie que pro-pose Dilthey est bâtie sur le contre-pied de ces systèmes : dans la Théorie des conceptions du monde, il explique que c’est justement à restituer « l’expé-rience vivante de ce qu’est une conception générale de la vie et du monde77 » qu’il s’attèle. À exprimer « le caractère vivant », parfois transformé en « sen-timent vivant, dont nous faisons l’expérience »78, à l’œuvre dans la conception religieuse. À révéler « ce qu’il y a de vivant en nous79 », que l’art s’évertue à rendre visible et que nous pouvons appréhender via l’étude de la conception poétique. À montrer comment l’origine de la conception philosophique se trouve non pas « dans la pensée conceptuelle, mais dans la vie profonde des personnes qui ont édifié ces systèmes80 », au point que nous avons affaire, avec la philosophie, « à quelque chose de vivant, dont la structure rappelle celle d’un organisme81 ». nous sommes à l’opposé, dans la philosophie diltheyenne de la philosophie – cet exposé des conceptions religieuse, poétique et philoso-phique du monde – de ces « concepts morts » que l’auteur allemand dénonce. son opposition aux grands systèmes métaphysiques est très prégnante dans toute son œuvre. Ils « ne tiennent pas debout face à l’examen inductif de tout ce qui s’est réellement produit82 ». Les métaphysiciens peuvent proposer des schémas sublimes83, mais qui ne « collent » pas à la réalité – à ce qui s’est
74. et Dilthey et ortega y Gasset, s’ils reconnaissent les mérites indéniables de l’école historique, prendront leurs distances avec ce mouvement, en tant qu’il ne postule pas de fon-dement solide, d’assise ferme selon Dilthey, en tant qu’il rate l’Idée de vie qui aurait dû servir de fondement ou d’assise, dit ortega y Gasset.
75. Wilhelm Dilthey, Théorie des conceptions du monde, op. cit., p. 6.76. Wilhelm Dilthey, Critique de la raison historique, Œuvres I, trad. s. mesure, Paris,
éditions du Cerf, coll. « Passages », 1992, p. 97.77. Wilhelm Dilthey, Théorie des conceptions du monde, op. cit., p. 38. nous soulignons.78. Ibidem, p. 37. nous soulignons.79. Ibidem, p. 34. nous soulignons.80. Ibidem, p. 39. nous soulignons.81. Ibidem, p. 43. nous soulignons.82. Wilhelm Dilthey, Critique de la raison historique, op. cit., p. 90.83. Ainsi, Dilthey salue la grandeur d’esprit des métaphysiciens en ces termes : « Dans la
mesure où l’esprit métaphysique rassemble, en une unité qui évoque la puissante harmonie d’un triple accord, les fins dernières de toute notre action et notre pensée, les vérités des sciences, les valeurs et idéaux de notre conscience, les normes et les règles que notre volonté a créées, il confère aux personnalités dans lesquelles il s’incarne une perfection unique et
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
Fac
ulté
s un
iver
sita
ires
Sai
nt-L
ouis
-
- 19
3.19
0.25
0.2
- 23
/02/
2015
17h
37. ©
Pre
sses
Uni
vers
itaire
s de
Fra
nce
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - F
acultés universitaires Saint-Louis - - 193.190.250.2 - 23/02/2015 17h37. ©
Presses U
niversitaires de France
5 janvier 2015 10:16 - Jules Vuillemin et les systèmes philosophiques - Collectif - Études philosophiques - 155 x 240 - page 116 / 160 - © PUF -
117 ortega y Gasset, lecteur de la philosophie diltheyenne de la vie
5 janvier 2015 10:16 - Jules Vuillemin et les systèmes philosophiques - Collectif - Études philosophiques - 155 x 240 - page 117 / 160 - © PUF -
« réellement produit » –, ici pensée par équivalence totale avec la vie. C’est pourquoi la métaphysique est devenue « impossible ». Il faut y renoncer84, dit Dilthey. elle ne donne ni réponse, ni même illusion de réponse, si bien que Dilthey veut voir la métaphysique appartenir « à des temps révolus85 ».
Je crains qu’aux yeux de l’isolé qui lève les yeux vers les étoiles et voudrait bien lier à ce monde inconnu la valeur de son existence et le but de ses actions, un tel système n’apparaisse que comme une élucubration de pédant86.
ortega y Gasset se réclame entièrement de Dilthey sur cette idée que la méta-physique, en tant qu’elle ne prend pas en compte l’historicité fondamentale de la vie humaine, et du fait de ses prétentions à déceler des vérités univer-selles, est devenue « impossible ».
néanmoins, dit également Dilthey, la métaphysique, si elle est « impos-sible », est également « inévitable ». Car la vie est une énigme et l’homme ne peut pas ne pas chercher à la résoudre, ou, du moins, adopter une attitude face à elle. Le fait de rechercher un principe qui unifie et intègre ensemble nos connaissances, mette de l’ordre dans nos sentiments et nous permette d’expliquer l’orientation de nos désirs est naturel et immédiat pour toute conscience vivante chez Dilthey87 : c’est naturellement que nous aspirons à une unité de notre savoir, notre sentir, notre vouloir88. La tendance de l’esprit à généraliser et systématiser la totalité de ce qui est à penser, pour la rat-tacher à « une vérité du plus haut degré possible d’universalité89 » est donc inévitable. ortega y Gasset suit tout à fait Dilthey sur ce dernier point éga-lement. De la même manière que Dilthey parle de la vie en termes d’« étran-geté90 », d’« énigmaticité91 », au point de faire de l’énigme de la vie l’énigme de toute philosophie92, ortega ouvre son texte sur l’histoire93 par l’affirmation suivante : « La vie humaine est une étrange réalité94 », répétant la dimension mystérieuse de cette réalité, qui reste, malgré tout, et peut-être justement en
sublime : le caractère, la conscience et l’intelligence, en elles, ne font qu’un ; elles pensent ce qu’elles vivent, elles vivent ce qu’elles pensent. Le problème qui les meut est le plus humain de tous les problèmes, sa solution dépasse les forces de tout homme. Là réside la grandeur unique grâce à laquelle ces personnalités émeuvent l’esprit » (Wilhelm Dilthey, Critique de la raison historique, op. cit., p. 93).
84. Wilhelm Dilthey, Introduction à l’étude des sciences humaines : essai sur le fonde-ment qu’on pourrait donner à l’étude de la société et de l’histoire, trad. L. sauzin, Paris, Puf, coll. « Bibliothèque de philosophie contemporaine », 1942, p. 495.
85. Wilhelm Dilthey, Introduction à l’étude des sciences humaines, op. cit., p. 472.86. Wilhelm Dilthey, Théorie des conceptions du monde, op. cit., pp. 5-6.87. telle est la lecture qu’en propose José ortega y Gasset dans « Guillermo Dilthey y la
Idea de la vida », op. cit., p. 265.88. Idem.89. Wilhelm Dilthey, Critique de la raison historique, op. cit., p. 91.90. Wilhelm Dilthey, Théorie des conceptions du monde, op. cit., p 102.91. Ibidem, p. 261.92. Ibidem, 176.93. José ortega y Gasset, Historia como Sistema, op. cit., pp. 47-81.94. Ibidem, p. 47.
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
Fac
ulté
s un
iver
sita
ires
Sai
nt-L
ouis
-
- 19
3.19
0.25
0.2
- 23
/02/
2015
17h
37. ©
Pre
sses
Uni
vers
itaire
s de
Fra
nce
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - F
acultés universitaires Saint-Louis - - 193.190.250.2 - 23/02/2015 17h37. ©
Presses U
niversitaires de France
118 Anne Bardet
5 janvier 2015 10:16 - Jules Vuillemin et les systèmes philosophiques - Collectif - Études philosophiques - 155 x 240 - page 118 / 160 - © PUF -
5 janvier 2015 10:16 - Jules Vuillemin et les systèmes philosophiques - Collectif - Études philosophiques - 155 x 240 - page 119 / 160 - © PUF -
vertu de cette insondabilité fondamentale, la réalité radicale. À partir de là, vivre consiste toujours à s’interroger pour le philosophe espagnol :
L’homme, de par les nécessités de sa vie, se voit forcé de penser à propos de ce qu’est le monde, ce qu’est l’État, ce qu’est le juste, ce qu’est la société, ce qu’est la beauté du tableau qu’il peint ou contemple, de la musique qu’il compose ou écoute, ce qu’est le langage qu’il utilise95.
L’homme ressent sa vie comme un « problème96 » et correspond à cet « animal métaphysique » que décrit schopenhauer. Le lien entre vie et attitude méta-physique est indépassable. et ce lien – que l’on peut élargir à celui que décrit ortega y Gasset entre vie et philosophie – est si prégnant chez l’auteur madri-lène que, de la même manière que la relation entre le moi et la circonstance était si forte qu’elle effaçait tout type de polarisation, de dualisme, et, par conséquent, de tension, vie et métaphysique en viennent à se confondre.
on philosophe parce qu’on vit, la théorie a son début et ses racines essentielles dans la vie, elle est vie, mais en même temps, on ne peut vivre sans théoriser97.
ortega y Gasset s’oppose ici à l’idée diltheyenne d’une philosophie de la vie, qui, dit-il, sépare l’une de l’autre, pour faire de la réalité radicale un simple objet de la philosophie98. Le refus d’une telle expression ne s’opère donc pas à la manière d’un heidegger, qui souligne le caractère tautologique qu’elle véhicule – l’expression, « philosophie de la vie », dit heidegger, « a autant de sens que “botanique des plantes”99 » dans la mesure où toute philosophie porte toujours sur la vie et où il est donc redondant de mentionner la vie, toujours fondamentalement déjà là, lorsqu’on parle de philosophie. Pour ortega y Gasset, cette expression n’est pas tautologique. en revanche, elle est dangereuse. La philosophie ne peut mettre la vie à distance, elle est toujours prise en elle, et plus que d’une philosophie de la vie, c’est d’une philosophie depuis la vie dont nous devrions parler. ortega y Gasset est particulièrement critique envers Dilthey sur ce point. Il lui reproche de ne pas avoir suffi-samment développé le fait que la vie n’est pas un objet.
Dilthey était historien. telle fut sa vocation décisive. mais pour lui, faire de l’histoire était une opération rigoureusement scientifique100, et le contraposto à la
95. José ortega y Gasset, « Guillermo Dilthey y la Idea de la vida », op. cit., p. 238.96. on trouve cette expression, entre autres, dans « Adán en el Paraíso », op. cit., p. 64.97. José ortega y Gasset, Cours de 1940, cité par Jean-Claude Leveque, « Notas de trabajo
de las carpetas. Alrededor de Dilthey desde la razón vital », op. cit., p. 48. nous soulignons.98. Pourtant, Dilthey est justement très critique vis-à-vis de ceux qui, à la manière des
scientifiques de la nature, veulent explorer la vie comme un objet extérieur et mis à distance.99. martin heidegger, Être et Temps, § 10, trad. e. martineau, édition numérique hors
commerce, http://www.rialland.org/heidegger/, p. 57.100. C’est d’ailleurs là, dans la tentative diltheyenne de « concilier la rigueur de la psycho-
logie comme science descriptive et la philosophie de la vie », dans cette volonté de scientificité, que, d’après Gens, réside la grande originalité de Dilthey par rapport aux autres philosophes de la vie (Jean-Claude Gens, « L’herméneutique diltheyenne des mondes de la vie », op. cit., p. 73).
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
Fac
ulté
s un
iver
sita
ires
Sai
nt-L
ouis
-
- 19
3.19
0.25
0.2
- 23
/02/
2015
17h
37. ©
Pre
sses
Uni
vers
itaire
s de
Fra
nce
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - F
acultés universitaires Saint-Louis - - 193.190.250.2 - 23/02/2015 17h37. ©
Presses U
niversitaires de France
5 janvier 2015 10:16 - Jules Vuillemin et les systèmes philosophiques - Collectif - Études philosophiques - 155 x 240 - page 118 / 160 - © PUF -
119 ortega y Gasset, lecteur de la philosophie diltheyenne de la vie
5 janvier 2015 10:16 - Jules Vuillemin et les systèmes philosophiques - Collectif - Études philosophiques - 155 x 240 - page 119 / 160 - © PUF -
physique. si bien que, pour lui, l’histoire commence par être une théorie de la vie et de la connaissance de la vie – comme la physique commence par être mécanique rationnelle101.
La vie, pour Dilthey, est, selon la lecture qu’en fait ortega y Gasset, un objet, un thème, au même titre que les phénomènes de la nature sont des objets pour les physiciens102. et ainsi conçue, la vie ne peut avoir le statut de réalité radicale. elle ne vient pas suffisamment remodeler les concepts fondamentaux. elle continue de « flotter de manière indécise dans “l’espace ontologique” traditionnel103 ». L’idée d’une philosophie de la vie, donc, est une expression incorrecte, irresponsable, indécise et dangereuse, dit ortega y Gasset.
Plus fondamentalement encore, ortega y Gasset reproche à Dilthey d’avoir délaissé la vie comme processus de survenance de soi à soi et hori-zon de possibles – pensée sur le mode du présent et du futur – pour lui préférer une vie objectivée, sédimentée dans des œuvres. ortega y Gasset insiste beaucoup, quant à lui, sur la vie entendue comme pure activité, pur devoir faire, même si cette spontanéité agissante hérite toujours d’un passé qui vient l’orienter, déterminant cet horizon de possibles que le philosophe madrilène veut mettre en avant, en même temps que l’horizon de sens qui intéresse Dilthey dans ses recherches104. La conception dramatique de la vie humaine chez ortega y Gasset le fait s’élever contre ce qu’il nomme « la manie épistémologique de Dilthey105 ». Le philosophe espagnol préfère penser la vie comme ce qui offre de pures possibilités.
La dimension épistémologique n’est pas pour autant absente de la pensée ortéguienne. et, inversement, la dimension pratique est loin d’être absente de la philosophie de Dilthey. Ainsi, l’auteur allemand écrit, présentant son projet philosophique fondamental :
J’ai voulu étudier la façon dont des éléments tout à fait dispersés dans la culture sont, dans l’atelier d’un esprit marquant, rassemblés pour former un tout qui réagit sur la vie. J’ai entrepris alors la fondation des sciences particulières de l’homme, de la société et de l’histoire. Je cherche pour elles un fondement et une articulation indé-pendants de la métaphysique, susceptibles d’être trouvés dans l’expérience. Car les
101. José ortega y Gasset, cité par Jean-Claude Leveque, « notas de trabajo de las carpetas. Alrededor de la razón vital », op. cit., pp. 45-46.
102. Ibidem, p. 46.103. Idem.104. nous ne voudrions pas donner l’impression au lecteur que le passé est relégué à un
plan secondaire dans la philosophie ortéguienne. Il y occupe au contraire une place centrale. on lit ainsi, dans « Guillermo Dilthey y la Idea de la vida » : « Il ne suffit pas de renoncer à ce que les résultats de notre connaissance soient “absolus” ; c’est, en outre, une erreur crasse de présumer que nous pourrions nous mettre à penser quoi que ce soit dans une indépendance “absolue” du passé humain, de ce qui s’est pensé, aimé et senti dans les prétérites millénaires de l’humanité. non : la vérité est tout autre. nous pensons avec notre passé et depuis la hau-teur à laquelle notre passé nous a menés » (José ortega y Gasset, « Guillermo Dilthey y la Idea de la vida », op. cit., p. 256).
105. José ortega y Gasset, « Guillermo Dilthey y la Idea de la vida », op. cit., p. 264.
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
Fac
ulté
s un
iver
sita
ires
Sai
nt-L
ouis
-
- 19
3.19
0.25
0.2
- 23
/02/
2015
17h
37. ©
Pre
sses
Uni
vers
itaire
s de
Fra
nce
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - F
acultés universitaires Saint-Louis - - 193.190.250.2 - 23/02/2015 17h37. ©
Presses U
niversitaires de France
120 Anne Bardet
5 janvier 2015 10:16 - Jules Vuillemin et les systèmes philosophiques - Collectif - Études philosophiques - 155 x 240 - page 120 / 160 - © PUF -
5 janvier 2015 10:16 - Jules Vuillemin et les systèmes philosophiques - Collectif - Études philosophiques - 155 x 240 - page 121 / 160 - © PUF -
systèmes des métaphysiciens se sont écroulés, et pourtant la volonté réclame toujours à nouveau des buts stables pour la conduite de la vie de l’individu et la direction de la société106.
Le domaine épistémologique dont part la philosophie diltheyenne est élargi à la conduite de l’homme et de la société107. si l’on ne peut restreindre la philo-sophie diltheyenne à un terrain strictement épistémologique, donc, dans la mesure où des préoccupations d’ordre pratique sont présentes dans toute son œuvre, force est de constater, malgré tout, que Dilthey n’explore pas vérita-blement cette dimension pratique. elle est présente à titre d’horizon, plus que de dimension pleinement assumée.
Car ce sont bien plutôt les manifestations de la vie que la vie elle-même que Dilthey prend en compte. Finalement, Dilthey s’intéresse assez peu à la vie entendue comme source. La compréhension, cette saisie rétrospective du passé à partir de la vie objectivée, extériorisée dans des œuvres, retient plus son attention – la grande question que pose Dilthey est celle de savoir si une théorie de la connaissance de l’histoire est possible, et il présente ses écrits en termes de recherche d’un fondement gnoséologique des sciences humaines – que l’action que je dois faire à chaque instant pour me maintenir dans la vie, dont parle ortega y Gasset dans une perspective très pragmatique où la vie humaine apparaît comme exercice de la liberté, ouverture au possible.
La différence d’enjeux des philosophies diltheyenne et ortéguienne de la vie est révélatrice du fait que les deux penseurs commencent à s’éloigner l’un de l’autre. mais le point culminant de la séparation est ailleurs : il réside dans la tentative ratiovitaliste d’ortega y Gasset, qui s’inscrit clairement contre l’antagonisme entre vie et raison auquel conclut Dilthey. Cet antagonisme s’inscrit au moins dans une double perspective chez le philosophe allemand : premièrement, c’est la raison telle que les rationalistes la mettent en avant que critique Dilthey : la vie humaine ne peut être appréhendée par une rai-son qui découperait la vie comme un objet qu’elle trouverait face à elle, ou devant elle, et c’est en ce sens que la vie ne peut comparaître devant le tribunal
106. Wilhelm Dilthey, « Discours inaugural à l’académie des sciences », in Critique de la raison historique, op. cit., p. 20.
107. Cette dimension morale point déjà dans le texte « sur l’étude de l’histoire des sciences humaines, sociales et politiques » (1873), où Dilthey explique la déchéance de la philosophie morale par le fait que, comme les grands systèmes métaphysiques, elles se meut dans des sphères trop abstraites et ne s’appuie pas assez sur l’expérience. si bien, dit Dilthey, que le scepticisme en matière de moralité se trouve légitimé : « La philosophie morale, écrit Dilthey, en tant que science abstraite, apparaît incapable, aux yeux d’un grand nombre de penseurs, d’exercer une influence sur la régularité de la vie ; dans ces conditions, la grande conception qui consistait à vouloir régler de mieux en mieux la société, ses intérêts et ses affects par l’intelligence et les idées serait dépourvue de réalité » (Wilhelm Dilthey, Critique de la raison historique, op. cit., p. 46). et Dilthey fait appel, pour étayer son propos, à la volonté plato-nicienne d’une réforme morale et politique dans la République et le Gorgias, à l’Éthique de spinoza (IV, proposition 7), aux Fragments posthumes de Kant, à l’idée aristotélicienne selon laquelle l’analyse de la vertu ne vise pas tant la connaissance que le devenir vertueux (Éthique de Nicomaque, II, 2, pp. 46-47). C’est parce que la philosophie morale, comme la métaphysique, est abstraite, donc, et la vie fondamentalement concrète, qu’elle ne fonctionne plus.
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
Fac
ulté
s un
iver
sita
ires
Sai
nt-L
ouis
-
- 19
3.19
0.25
0.2
- 23
/02/
2015
17h
37. ©
Pre
sses
Uni
vers
itaire
s de
Fra
nce
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - F
acultés universitaires Saint-Louis - - 193.190.250.2 - 23/02/2015 17h37. ©
Presses U
niversitaires de France
5 janvier 2015 10:16 - Jules Vuillemin et les systèmes philosophiques - Collectif - Études philosophiques - 155 x 240 - page 120 / 160 - © PUF -
121 ortega y Gasset, lecteur de la philosophie diltheyenne de la vie
5 janvier 2015 10:16 - Jules Vuillemin et les systèmes philosophiques - Collectif - Études philosophiques - 155 x 240 - page 121 / 160 - © PUF -
de la raison. La vie n’est pas fondamentalement une donnée rationnelle, dit Dilthey. Deuxièmement, c’est l’idée d’une raison universelle qui régirait l’histoire que dénonce Dilthey. Car au sein de la tension entre inévitabilité et impossibilité de la métaphysique que nous avons mentionnée plus haut, c’est essentiellement contre la tentative hégélienne de penser le mouvement de la vie de l’esprit à travers l’histoire sur un mode strictement rationnel que s’élève Dilthey. Le grand reproche qu’il adresse à hegel est formulé dans les termes suivants :
La méthode de hegel postule, au fond, que le concept n’atteindra jamais la vie108.
Dilthey refuse de poser quoi que ce soit qui remonte au-delà de cette vie pre-mièrement donnée. on retrouve cette même idée à de nombreuses reprises ; ainsi, on lit dans l’Édification du monde historique dans les sciences de l’esprit :
Dans la mesure où, à la place de la raison universelle hégélienne, ce qui inter-vient ici, c’est la vie dans sa totalité, l’expérience vécue, la compréhension, l’ensemble vital historique, la puissance de l’irrationnel qui s’y manifeste, surgit le problème de savoir comment la science historique est possible109.
outre la question, centrale pour la philosophie diltheyenne, de l’objectivité historique, la dimension irrationnelle de la vie est à nouveau soulignée par Dilthey ici. si cela ne fait pas de lui un antirationaliste à proprement parler, si on ne peut réduire la vie telle qu’il la conceptualise à une pure irrationalité, ni faire de l’absence de raison son principe explicatif suprême, il n’en reste pas moins que la raison n’est pas à même de coexister, dans la philosophie diltheyenne, avec la conscience historique. or, dit ortega y Gasset, c’est là une position classique qui peut aisément être dépassée. Dans son étude sur Dilthey, il écrit :
Le dix-huitième siècle est fidèle à son maître le dix-septième dans sa conviction selon laquelle l’homme possède ultimement une « nature », un mode d’être défi-nitif, permanent, immuable. L’homme est « raison » dans sa substance radicale, et par conséquent, il pense, sent et veut rationnellement ; il n’est d’aucun temps ni d’aucun lieu110. temps et lieu ne peuvent qu’embrumer la raison, cacher à l’homme sa propre rationalité. Il y a une religion naturelle – c’est-à-dire rationnelle, iden-tique à elle-même sous ses déformations historiques. Il y a un droit naturel et un art essentiel et une science unique et invariable. Cela revient donc à déclarer que la véritable « nature » humaine n’est pas historique, que les formes historiques sont,
108. Wilhelm Dilthey, Théorie des conceptions du monde, op. cit., p. 89.109. Wilhelm Dilthey, L’Édification du monde historique dans les sciences de l’esprit, op. cit.,
p. 105.110. Cette formule bien connue rappelle l’affirmation bien connue de Fénelon selon
laquelle « le bon historien n’est d’aucun temps ni d’aucun pays », contre laquelle Dilthey éla-borera sa philosophie, plaçant le fait que l’historien soit justement de son temps, de son lieu, de son monde historico-social, la condition pour faire l’histoire. Car le passé ne s’interprète qu’en fonction du présent.
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
Fac
ulté
s un
iver
sita
ires
Sai
nt-L
ouis
-
- 19
3.19
0.25
0.2
- 23
/02/
2015
17h
37. ©
Pre
sses
Uni
vers
itaire
s de
Fra
nce
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - F
acultés universitaires Saint-Louis - - 193.190.250.2 - 23/02/2015 17h37. ©
Presses U
niversitaires de France
122 Anne Bardet
5 janvier 2015 10:16 - Jules Vuillemin et les systèmes philosophiques - Collectif - Études philosophiques - 155 x 240 - page 122 / 160 - © PUF -
5 janvier 2015 10:16 - Jules Vuillemin et les systèmes philosophiques - Collectif - Études philosophiques - 155 x 240 - page 123 / 160 - © PUF -
rigoureusement parlant, des déformations de l’homme. Ce résidu du dix-septième siècle annule finalement pour les mêmes esprits qui la découvrirent, la « conscience historique », et fait qu’ils ne s’arrêtent pas sur les variations historiques déjà évidentes à leurs yeux, mais, au contraire, les traversent rapidement, cherchant derrière elles l’homme substantiel et invariable. La forme historique, je le répète, est vue, mais, en même temps, est pensée comme une simple déformation de l’humain111.
Cette description volontairement schématique met en avant la difficulté à concilier raison et histoire – et, plus largement, raison et vie. mais, fonda-mentalement, la conscience historique n’a pas à s’inscrire contre la raison. C’est là l’erreur fondamentale de Dilthey, selon ortega y Gasset qui précise dans une note112 :
La pure vérité est que celui-ci est resté prisonnier de l’irrationalisme vital face au rationalisme intellectuel et qu’il n’est pas parvenu à découvrir ce nouveau ratio-nalisme de la vie. on peut expliquer ainsi que dans ses dernières années encore, il écrivît des phrases telles que celles-ci : « dans toute compréhension de la vie, se trouve quelque chose d’irrationnel, de la même manière que la vie elle-même l’est ».
ortega y Gasset s’inscrit lui aussi contre le rationalisme dans la mesure où il perd de sa vigueur, d’une part, dans le sens où il est incompatible avec l’Idée de vie, qu’il regarde toujours de manière figée – sans prendre en compte le flux, ou pour le dire autrement, son caractère fondamentalement vivant – et morcelée, menaçant son indivisibilité constitutive. mais la raison, ce tribunal devant lequel la vie ne peut comparaître chez Dilthey, est loin de faire l’objet de réticences ou d’attaques de la part du philosophe espagnol. Car « est rai-son dans le sens vrai et rigoureux du terme toute action intellectuelle qui nous met en contact avec la réalité113 ». et le fait que, traditionnellement, vie et raison n’aient pas fonctionné ensemble ne doit pas empêcher d’envi-sager un rassemblement. C’est ainsi que le philosophe madrilène propose de concilier ces deux entités au sein du ratiovitalisme, une philosophie qui réconcilie vie et raison.
si Dilthey, donc, est perçu par ortega y Gasset comme celui qui a initié une nouvelle ère en faisant ressortir l’Idée de vie – et heidegger, de fait, reconnaît lui aussi que Dilthey est le premier à faire de la vie le centre de la philosophie114 –, le philosophe madrilène radicalise et transforme considéra-blement la position diltheyenne, et ce notamment par son idée de la raison vitale, qui, loin d’entrer en contradiction avec la conscience historique, la sert. Dilthey, d’après ortega y Gasset, aurait formulé trop tôt – dans une circonstance qui, historiquement, n’était pas encore prête – le primat absolu
111. José ortega y Gasset, « Guillermo Dilthey y la Idea de la vida », op. cit., p. 236.112. Ibidem, op. cit., p. 250113. José ortega y Gasset, Idées et Croyances, trad. J. Babelon, Paris, stock, 1945, pp. 113-
114.114. on lit cette idée dans Être et Temps aussi bien que dans les Conférences de Cassel.
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
Fac
ulté
s un
iver
sita
ires
Sai
nt-L
ouis
-
- 19
3.19
0.25
0.2
- 23
/02/
2015
17h
37. ©
Pre
sses
Uni
vers
itaire
s de
Fra
nce
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - F
acultés universitaires Saint-Louis - - 193.190.250.2 - 23/02/2015 17h37. ©
Presses U
niversitaires de France
5 janvier 2015 10:16 - Jules Vuillemin et les systèmes philosophiques - Collectif - Études philosophiques - 155 x 240 - page 122 / 160 - © PUF -
123 ortega y Gasset, lecteur de la philosophie diltheyenne de la vie
5 janvier 2015 10:16 - Jules Vuillemin et les systèmes philosophiques - Collectif - Études philosophiques - 155 x 240 - page 123 / 160 - © PUF -
de la vie. et probablement sans se rendre compte, poursuit le philosophe espagnol, de l’importance de cette découverte.
[s’il fut] l’un des premiers à débarquer sur cette côte inconnue et à s’y promener […] Dilthey ne sut jamais qu’il était parvenu à un nouveau continent, à une nou-velle terre ferme. Il ne parvient jamais à posséder ce sol qu’il foulait115.
mais, dit également ortega y Gasset, la première apparition d’une Idée est toujours prématurée116, et, d’autre part, n’est jamais pleinement formulée. elle est là, déjà en marche, sous-jacente, mais cachée ; et le rôle du philosophe consiste à la révéler.
Le philosophe parle de ce dont personne ne parle mais que tout le monde tait, et que tout le monde tait précisément parce que cela est inclus dans tout ce dont nous parlons et constitue ce dont nous parlons117.
mais quand elle est formulée pour la première fois, elle n’est pas encore intégralement vue. elle est entrevue, « intuitionnée ». et, dit misch, « c’est dans la transition entre intuitio et ratio, dans ce lieu épineux de toute philo-sophie, qu’est la cause de l’aspect apparemment fragmentaire, et, en réalité, inachevé de son œuvre [l’œuvre de Dilthey]118 ». Cette idée, qu’ortega y Gasset partage avec le disciple de Dilthey, peut être entendue dans deux sens distincts : un premier sens, qui est celui qu’y met misch. et un second, qui s’inscrit dans une perspective plus directement ortéguienne : que c’est à côté de la ratio comme concept, en outre, que serait passé Dilthey.
Anne BardetCentre Prospéro, Langage, image et connaissance, université saint-Louis
Bruxelles
115. José ortega y Gasset, « Guillermo Dilthey y la Idea de la vida », op. cit., p. 223.116. José ortega y Gasset, « Guillermo Dilthey y la Idea de la vida », op. cit., p. 223.117. José ortega y Gasset, cité par Jean-Claude Leveque, « notas de trabajo de la carpetas.
Alrededor de la razón vital », op. cit., p. 54.118. Georg misch, cité par José ortega y Gasset, « Guillermo Dilthey y la Idea de la vida »,
op. cit., pp. 229-230.
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
Fac
ulté
s un
iver
sita
ires
Sai
nt-L
ouis
-
- 19
3.19
0.25
0.2
- 23
/02/
2015
17h
37. ©
Pre
sses
Uni
vers
itaire
s de
Fra
nce
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - F
acultés universitaires Saint-Louis - - 193.190.250.2 - 23/02/2015 17h37. ©
Presses U
niversitaires de France
5 janvier 2015 10:16 - Jules Vuillemin et les systèmes philosophiques - Collectif - Études philosophiques - 155 x 240 - page 124 / 160 - © PUF -
5 janvier 2015 10:16 - Jules Vuillemin et les systèmes philosophiques - Collectif - Études philosophiques - 155 x 240 - page 125 / 160 - © PUF -
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
Fac
ulté
s un
iver
sita
ires
Sai
nt-L
ouis
-
- 19
3.19
0.25
0.2
- 23
/02/
2015
17h
37. ©
Pre
sses
Uni
vers
itaire
s de
Fra
nce
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - F
acultés universitaires Saint-Louis - - 193.190.250.2 - 23/02/2015 17h37. ©
Presses U
niversitaires de France