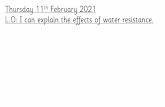On the Legitimacy of 'Insurgency': Rise and Fall of the Idea of Resistance to Occupation (Grandeur...
Transcript of On the Legitimacy of 'Insurgency': Rise and Fall of the Idea of Resistance to Occupation (Grandeur...
Electronic copy available at: http://ssrn.com/abstract=1296060Electronic copy available at: http://ssrn.com/abstract=1296060
1
Grandeur et déclin de l’idée de résistance à l’occupation :
Réflexions à propos de la légitimité des « insurgés »
Frédéric Mégret1 Résumé: Cet article tente de faire le point sur la question de la légitimité des insurgés en droit
international, notamment face à une occupation illégale. L’idée d’une résistance légitime a
considérablement évolué depuis les conférences de Bruxelles et la Haye au point d’être
partiellement reconnue par les Conventions de Genève dans sa dimension humanitaire puis,
dans le cadre de la décolonisation, dans son principe fondamental de jus insurrectionis.
Cependant, cette reconnaissance est menacée par la perception du rôle humanitaire majeur de
l’occupation, ainsi que de la place croissante de l’occupation comme mécanisme de maintien de
la paix et de la sécurité internationales, et comme outil de la reconstruction/transformation post-
bellum. On cherchera au contraire à dégager les éléments d’une théorie de la résistance légitime
à l’occupation illégale. Celle-ci écarte la logique purement humanitaire, pour considérer que la
légitimité d’une insurrection n’est pas seulement fonction de son rattachement à un souverain
légitime, mais bien plutôt de sa capacité à être la manifestation en même temps d’un droit
d’auto-détermination et d’un exercice non-étatique de la légitime défense. Si seuls certains
groupes insurgés satisferont aux critères exigeants du droit international en matière de
représentativité et de proportionnalité, l’article plaide néanmoins pour une réévaluation du rôle
des acteurs non-étatiques dans la mise en œuvre du droit international.
1 Professeur-adjoint, faculté de droit, Université McGill. La recherche nécessaire à cet article a été rendue possible par une subvention du Conseil de recherches en sciences humaines du Canada ainsi que le programme des Chaires de recherche du Canada. Je souhaite remercier Mathieu Kissin et Amr Omran pour leur précieuse assistance, ainsi que les organisateurs et participants du panel du Groupe de réflexion sur la paix et la sécurité internationale de la Société européenne de droit international sur « l’insurrection et le droit international » à Heidelberg le 4 septembre 2008. Les commentaires d’Olivier Corten et de Théodore Christakis, ainsi que ceux d’un évaluateur anonyme, m’ont été d’un grand secours.
Electronic copy available at: http://ssrn.com/abstract=1296060Electronic copy available at: http://ssrn.com/abstract=1296060
2
« This has been about liberation, not occupation » General T. Franks2
Peu de questions font l’objet d’autant d’approximations que l’idée d’un « droit de résistance »,3 notamment à l’occupation.4 Le droit international, à cause en partie de ses présupposés étatiques mais sans doute aussi d’une certaine frilosité, s’est assez peu préoccupé de la question de la résistance.5 A tout le moins, la question n’est entrée dans le champ de vision du droit des gens qu’à intervalles assez espacés, et de manière souvent insuffisante pour durablement en affecter les catégories de pensée. Le conflit irakien fait à ce titre figure d’illustration assez frappante parmi d’autres. Il y a peu de doute que les insurgés y ont été décrits systématiquement en des termes très négatifs, c'est-à-dire essentiellement sous le vocable univoque du terrorisme. Le choix pour de nombreux « combattants illégaux » semble avoir été entre la privation des droits incarnée par Guantanamo, et la peine capitale imposée par certains tribunaux irakiens pour actes d’insurrection. Pourtant, même si une partie de la résistance irakienne s’est clairement engagée sur le chemin du terrorisme (assassinat de civils), une lecture plus fine du conflit lié à l’occupation montre que certains insurgés au moins ne s’en prennent qu’aux troupes d’occupation, et souvent selon des modalités quasi-militaires.6 Surtout, il fait peu de doute, en droit international, que l’invasion de l’Irak fut illégale et que l’occupation qui en résulte, au moins dans les premiers temps, ne saurait être moins illégale (au niveau du jus ad bellum). La tension qui en résulte est apparue de manière particulièrement éclatante lorsque le premier ministre irakien, Maliki, se rendit à Washington en 2007 avec un plan de réconciliation prévoyant une amnistie pour tous les insurgés s’étant rendus coupables d’actes violents contre les troupes américaines, à l’exclusion de ceux ayant pris pour cible des civils irakiens.7 L’amnistie était présentée non seulement comme nécessaire à des fins de réconciliation et de paix, mais aussi comme plus fondamentalement juste en termes de justice transitionnelle. Il semble qu’un temps l’administration Bush ne se soit pas particulièrement ému de cette possibilité, comme si l’insurrection, aussi problématique qu’elle ait été militairement et politiquement pour les autorités américaines, était en définitive compréhensible. N’était-ce pas George Bush lui-même
2 Katherine BUTLER, Donald MACINTYRE, « The Iraqi Conflict: General Frank Strides into His Baghdad palace », The Independent, 17 avril 2003. 3 Mario TURCHETTI, « Droit de Résistance, à quoi? Démasquer aujourd’hui le despotisme et la tyrannie », Revue historique, 2006, p. 256. 4 La question a surtout été dominée depuis quelques années par la discussion de la problématique palestinienne, mais fait parfois l’objet d’affirmations trop générales et peu étayées pour enrichir le débat. Pour un des articles plus sérieux sur la question, voir Richard FALK, « Azmi Bishara, the Right of Resistance, and the Palestinian Ordeal », 31, Journal of Palestine Studies, 2002. Le professeur Falk envisage la possibilité d’une résistance plus largement légitime face à l’oppression, là où nous nous contenterons de l’examen de la résistance à une occupation illégale. Le cas palestinien présente cependant de nombreuses spécificités (territoire au statut ambigu avant occupation, longueur de l’occupation, forte implication de la communauté internationale) qui mériteraient un article différent. On y fera donc peu allusion. 5 Pour une critique générale de ce manque d’intérêt, voir Frédéric MÉGRET, « Le droit international peut-il être un droit de résistance? Dix conditions pour un renouveau de l'ambition normative internationale », XXXIX, Etudes internationales, 2008. 6 Lassa Francis Lawrence OPPENHEIM et Hersch LAUTERPACHT, International law, a treatise, 6th éd., (London, New York, Longmans, 1940). 7 Timothy William WATERS, « Guilty of Fighting a War », New York Times, 15 August 2006.
3
qui, comme le faisait remarquer avec malice Sadr, le leader de l’insurrection chiite, avait affirmé qu’il se battrait sans relâche si son propre pays devait être occupé ?8 Cependant, le Congrès américain ayant eu vent de la possibilité d’amnistie, plusieurs sénateurs eurent à son égard des réactions d’une rare virulence, forçant l’abandon du projet, au motif que toute résistance à l’occupation était illégitime d’office.9 Venant de la puissance occupante ce genre de raisonnement ne surprend guère, et il faut remarquer que la résistance irakienne n’a pas toujours trouvé que de très dignes représentants. Mais il est surprenant que l’illicéité de la résistance semble aller de soi, et ce apparemment quelles que soient ses méthodes,10 alors que selon les observateurs avertis la population irakienne était par ailleurs très hostile aux troupes d’occupation11 Il semble notamment que les juristes internationalistes se soient très largement désintéressés de la question, alors même qu’ils avaient un temps été à la pointe de la résistance normative à l’invasion de l’Irak. Parti pris étatique tenace ? Incapacité des mouvements insurgés à capter à leur profit les catégories et le discours du droit international ?12 Retombées extrêmement négatives de l’usage de méthodes terroristes par certains groupes insurgés ? Motivations douteuses de certains groupes plus intéressés par des combats fratricides ou l’extrémisme islamique que la lutte pour l’auto-détermination irakienne ? Il est très possible que les crimes commis par certains, et notamment les attentats suicides contre des civils, suffisent à expliquer dans le cas irakien une bonne partie du discrédit dont est entachée la résistance à l’occupation américaine. Il convient de souligner cependant que le paradigme de la « guerre contre le terrorisme » est également prompt à couvrir d’opprobre l’action de tout mouvement s’élevant contre certaines visées hégémoniques inspirées par l’idéologie néo-conservatrice. Surtout, il semble exister une véritable contradiction entre l’affirmation sans cesse répétée de l’illégalité de l’invasion de l’Irak et ce que l’on sait de la réalité d’une occupation violente et souvent abusive d’une part, et l’idée qu’une insurrection qui s’élèverait elle-même contre cette occupation serait nécessairement illégitime. Le discours international dominant semble poser une dissociation complète entre la problématique de la licéité de l’occupation et la lutte contre ses conséquences. Selon cette vision, la population irakienne est en quelque sorte sommée de ne pas être l’actrice de sa libération et d’attendre passivement et stoïquement un destin qui est désormais décidé par un occupant par ailleurs largement présenté comme illégitime, sous le contrôle distant de la communauté internationale. On voudra prendre ici l’exemple particulièrement emblématique de l’Irak comme manifestation d’une tension plus large et révélatrice concernant le statut des insurgés en droit international, qui se pose à intervalle régulier, des franc-tireurs belges contre l’envahisseur prusse aux résistants à l’occupation nazi, des mouvements de libération nationale aux mudjahedeen afghans sous le joug soviétique, de SWAPO à la résistance du Timor oriental. Il paraît en effet utile de s’interroger plus généralement sur le rôle du droit international dans le renforcement tacite du pouvoir de l’occupant, y-compris lorsque celui-ci est agresseur ou fortement oppressif. Là où le régime
8 « Resistance in Iraq 'legitimate' », BBC News, 18 juillet 2005, en ligne: http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/4691865.stm (consulté le 25 février 2009). 9 Rep. Stupak on “Anti-Amnesty Resolution” in 2 Cong. Rec. 152(2006) (H4524), 26 juin 2006. 10 Jonathan STEELE, « Only negotiation with Iraq's resistance can bring peace », The Guardian, 16 décembre 2005. 11 Haifa ZANGANA, « The Iraqi resistance only exists to end the occupation », The Guardian, 12 avril 2007. 12 Il existe cependant tout un discours au sein de l’insurrection irakienne qui se réclame de la mise en oeuvre du droit international dans des termes parfaitement clairs. Pour une série de textes pertinents, voir http://brusselstribunal.org/resistance.htm (consulté le 25 février 2009).
4
humanitaire de l’occupation est présenté comme protecteur, on voudra au contraire mettre à jour, dans une veine critique,13 ce qu’il peut avoir de spécifiquement violent et porteur d’injustice. Derrière la question de l’insurrection et de l’occupation, se posent en effet des questions de tout premier plan pour le droit international actuel, dont celle de la violence légitime dans les relations internationales, du rôle des acteurs non-étatiques, et des objectifs d’ordre ou de justice qu’entend se donner le droit. Il est tout à fait notable que la question de la résistance à l’occupation ne soit, à l’époque actuelle, pratiquement pas posée par la doctrine internationale, alors qu’elle fut longtemps une cause célèbre du droit international, qui donna lieu dès la fin du XIXème et pendant tout le XXème siècle à d’innombrables débats, et sur laquelle de nombreux grands internationalistes – Halleck,14 Oppenheim,15 ou de Visscher16 comptent parmi eux - se prononcèrent. Il y a peut être là lieu de s’inquiéter sur un certain appauvrissement du discours internationaliste, l’accent mis sur l’humanitaire et le sécuritaire allant souvent de pair avec un pragmatisme scrupuleux. Il est possible en particulier que, face à aux menées hégémoniques de certaines grandes puissances, le droit international soit un peu trop enclin à « désarmer » à l’avance les résistances, là où celles-ci devraient pourtant avoir leur place. La question du statut normatif de la résistance à une occupation illégale mérite donc d’être posée à l’époque contemporaine, ne serait-ce que pour mieux comprendre comment certains groupes ne peuvent en effet pas se targuer d’une quelconque légitimité. On veut ici la poser non pas tant comme une simple question de légalité (« droit à l’insurrection »), mais comme mettant en jeu plus largement une problématique de légitimité à la limite entre ce que le droit international cautionne explicitement et ce que son interprétation dynamique comme projet historique peut suggérer. On voudra, à l’instar de Vasuki Nesiah, s’interroger sur les possibilités d’un discours de résistance aux visées impérialistes de l’après 11 septembre,17 mais dans une perspective « d’histoire des idées » du droit international, plus attentive aux contradictions qu’aux réponses apportées par celui-ci. On supposera ici, pour les besoins de la discussion, qu’une occupation donnée est en effet illégale au-delà du doute, car résultant d’un usage illicite de la force, ou car se prolongeant au-delà de son terme de légalité. On supposera en outre que les insurgés se conforment largement au droit de la guerre, en d’autres termes que leurs moyens ne sont pas par eux-mêmes terroristes. Ces hypothèses de travail serviront à simplifier le débat et à se concentrer uniquement sur la question de la légitimité en soi de l’usage de la force par certains acteurs non-étatiques en situation d’occupation. On structurera ici notre analyse en trois temps. Premièrement, on examinera l’émergence et l’évolution de la conceptualisation juridique de l’insurrection en situation d’occupation. Deuxièmement, on s’interrogera sur les conditions qui font qu’à l’époque actuelle l’idée d’un droit de résistance à l’occupation semble avoir été largement marginalisée. Enfin, troisièmement,
13 C’est surtout David Kennedy qui a à l’époque actuelle attiré l’attention sur ce « dark side » du projet humanitaire. Voir David KENNEDY, The Dark Sides of Virtue : Reassessing International Humanitarianism, (Princeton, N.J., Princeton University Press, 2004). Egalement Frédéric MÉGRET, « From'Savages' to'Unlawful Combatants': A Postcolonial Look at International Humanitarian Law's' Other' », in Anne ORFORD (ed.), International Law and its Others, Cambridge University Press, 2006). 14 Henry Wagner HALLECK, International law, (New York, D. Van Nostrand; [etc., 1861), p. 793. 15 Lassa Francis Lawrence OPPENHEIM, « On War Treason », 33 Law Quarterly Review, 1917, p. 284. 16 Charles DE VISSCHER, « L'Occupation De Guerre », 34 Law Quarterly Review, 1918, p. 79. 17 Vasuki NESIAH, « Resistance in the age of empire: occupied discourse pending investigation », 27, Third World
Quarterly, 2006.
5
on envisagera les conditions d’un renouveau des idées de résistance à l’occupation illégale, en inscrivant notre propos dans une réflexion sur le devenir normatif du droit international.
I. Les trois « époques » de l’idée de résistance Sans céder à l’historicisme, il est évident que la question de l’insurrection en situation d’occupation est indissociable d’une évolution complexe de la conception que se fait le droit international de l’usage de la force et de l’occupation, et est également sensible à un environnement normatif général plus ou moins favorable notamment au rôle des acteurs non-étatiques. En grande partie, l’histoire dominante de l’idée de résistance est imbriquée avec celle du droit international humanitaire, même si le choix de ce paradigme, comme on le montrera, est loin d’être neutre sur la construction normative de l’idée d’insurrection.
A. Déni de la protection humanitaire à Bruxelles et La Haye
L’occupation, pourrait-on dire, « revient de loin » comme concept juridique. L’occupation fut en effet longtemps perçue comme résultant d’une œuvre de conquête (peut être illégitime, mais sans doute pas illégale), et ayant un effet acquisitif. Il en découlait que la population occupée devait transférer son allégeance à l’occupant qui devenait le « nouveau » souverain. L’insurrection était dès lors condamnée comme l’aurait été n’importe quelle rébellion interne (on parle de « rébellion de guerre »), aucune concession n’étant faite aux insurgés du fait du caractère au moins semi-international de la situation dans laquelle ils se trouvaient. La seule chose que la Belgique obtient des conférenciers de la Haye est la clause de Martens, dont il est parfois oublié aujourd’hui qu’elle fut spécifiquement adoptée pour traiter de la question des insurgés. Les conférences de Bruxelles et de la Haye accouchent ainsi d’une vision de l’occupation qui fait la part belle aux pouvoirs de l’occupant, dont le pouvoir de répression à l’égard des insurgés est consacré au nom du maintien de l’ordre. Par une sorte de ruse intellectuelle assez sophistiquée, en effet, l’occupation effective est présentée comme nécessaire pour les besoins de l’humanitaire. L’idée est que pour pouvoir prétendre civiliser l’occupation, encore faut-il que la Puissance occupante ne soit pas mise en danger alors même qu’elle tente d’assurer un minimum de bon fonctionnement des services. Même réduits à leur plus simple expression de « gestion des affaires courantes » ou de « tuteur » (et on verra que l’occupation viendra à être conçue comme beaucoup plus), les pouvoirs de l’occupant sont donc conséquents. L’humanisation de l’occupation est aussi paradoxalement l’occasion de son renforcement normatif, puisque d’univoquement négative pour la population, l’occupation devient l’occasion de l’imposition d’obligations internationales relativement importantes à la charge de l’occupant. Derrière cette exaltation des nécessités humanitaires, se cache également une certaine compréhension du projet internationaliste. En partie, ce déséquilibre en faveur de la Puissance occupante est le fruit du poids politique des puissances « occupantes » ou agressives (l’Allemagne s’illustre particulièrement à l’époque), qui n’entendent pas d’avance légitimer les « franc-tireurs ». Les petits Etats comme la Belgique, la Suisse et les Pays Bas auront beau en appeler à la sacralité de « l’esprit patriotique » pour ne pas d’avance condamner une résistance dont ils se savent absolument dépendants, leurs appels ne seront guère entendus (en dehors du cas de la « levée en masse » au moment même de l’invasion).
6
Mais en partie le pouvoir de l’occupant est aussi la consécration d’une certaine conception de l’usage de la force et de l’occupation qui en résulte. Tout d’abord, l’époque est à l’exploration de modes de réconciliation des différends, mais encore éloignée de l’interdiction de l’usage de la force dans les relations internationales. En d’autres termes, le droit international n’est pas porteur d’un message fort sur l’illicéité de l’occupation, celle-ci étant donc plus perçue avant tout comme un état de fait – à gérer et humaniser sans doute, mais pas nécessairement à combattre par tous les moyens. Ensuite, l’occupation elle-même est conçue, sinon sur le mode du transfert d’allégeance, du moins sous l’angle du « quasi-contrat » ou « contrat implicite », idée un peu oubliée aujourd’hui mais qui lie la fourniture de « services » humanitaires à la population occupée à leur passivité. Pour Bray, par exemple, « Après que la lutte a cessé, tous ceux qui restent dans le pays, ceux surtout qui y continuent leur commerce, leurs affaires ou leurs travaux, acceptent implicitement pour leurs personnes et leurs biens la protection de l’occupant. En échange de la sécurité qui leur est garantie, ils sont tenus de respecter l’autorité de fait établie sur le territoire ».18 Cette réciprocité inscrit fondamentalement la résistance à l’occupation dans une perspective très précaire puisque les insurgés seront rapidement rendus responsables des risques qu’ils auront fait encourir au reste de la population en prenant les armes.
B. La reconnaisance d’un statut humanitaire du résistant à Genève
Les conditions à l’issue de la Seconde guerre mondiale sont singulièrement différentes. Comme le rappelle le CICR, « Les premières années de la deuxième guerre mondiale virent de profonds changements survenir dans l'ordre politique européen » qui menèrent à ce que « des groupements nationaux continuèrent à prendre une part effective aux hostilités, alors que l'adversaire leur déniait la qualité de belligérants ».19 Là où seuls certains Etats militaient pour une plus grande reconnaissance des insurgés au tournant du XIXème siècle, l’Europe libérée doit une dette significative aux mouvements de résistance, et ceux-ci sont d’ailleurs représentés à la Conférence de Genève. En outre, il est clair que le Règlement de la Haye a failli à protéger les mouvements insurgés. La clause de Martens, en particulier, est une bien faible protection dès lors qu’en tant que civil on a pris les armes contre la Puissance occupante. Celle-ci est en effet tout à fait légitimée à imposer une répression sévère, qui n’est nullement tempérée par l’idée que le résistant menait un combat de nature politique. La capacité de l’occupant à traiter le résistant comme, en quelque sorte, un vulgaire criminel, ouvre la porte à des phénomènes de répression et de représailles violentes. Il faut ajouter qu’elle n’encourage sans doute guère les résistants à respecter le droit humanitaire puisque, exclus d’office de sa protection comme combattants, ils encourent quoiqu’il en soit un danger maximum. Les Conventions de Genève font alors un pas significatif en étendant la protection qui avait jusque là été accordée principalement aux armées régulières et accessoirement aux milices et levées en masse, aux mouvements de résistance à l’occupation. En effet, les « mouvements de 18 Joseph BRAY, Essai sur le droit pénal militaire des romains: de l'occupation militaire en temps de guerre; ses
effets sur les personnes et sur l'administration de la justice, (Paris, Université de Paris, 1894). Egalement, Jules Charles GUELLE, Précis des lois de la guerre sur terre; commentaire pratique à l'usage des officiers de l'armée
active, de la réserve et de la territoriale, (Paris, G. Pedone-Lauriel, 1884), p. 130. « …il y a comme une espèce de quasi-contrat entre l’occupant et l’occupé, ce dernier s’engageant tacitement à rester neutre en retour de la protection qu’il reçoit et de la sécurité qu’on lui garantit »). 19 Jean PICTET, Les conventions de Genève du 12 août 1949, Commentaire, (Genève, Comité international de la Croix-Rouge, 1952), p. 61.
7
résistance organisé (…) agissant en dehors ou à l’intérieur de leur propre territoire, même si ce territoire est occupé »20 bénéficient du statut de prisonniers de guerre s’ils tombent au pouvoir de l’ennemi. Il est tout à fait caractéristique, à ce titre, que cette protection soit accordée à l’intérieur de la IIIème Convention de Genève relative aux prisonniers de guerre, et non pas dans le cadre de la IVème relative à l’occupation. C’est dire que, bien qu’elle survienne en situation d’occupation, la résistance est avant tout conçue comme relevant d’une conflictualité plus classique et non de la simple gestion de l’ordre par la Puissance occupante. Même dans un contexte comme celui qui fait suite à la Seconde guerre mondiale cependant (et on est, en 1949, déjà un peu éloigné de l’immédiat après guerre), il faut bien souligner que la reconnaissance du statut de combattant demeure limitée tant dans ses conditions que dans sa nature. En termes de conditions exigées pour que soit accordé le statut de combattant, aucun « cadeau » n’est fait aux résistants. Ceux-ci devront notamment « appartenir à une partie au conflit », « avoir à leur tête une personne responsable pour ses subordonnés », « avoir un signe distinctif fixe et reconnaissable à distance », « porter ouvertement les armes », et « se conformer, dans leurs opérations, aux lois et coutumes de la guerre ». Sans entièrement disqualifier la résistance, ces exigences en sont objectivement des limitations importantes dans un univers d’occupation où les insurgés sont relativement moins puissants.21 L’octroi du statut de combattant aux résistants fait ainsi un peu figure de marché de dupe puisque comme le faisait remarquer un auteur, « Partisans in occupied territory are not likely to be very effective if they comply with the requirements of Article 4 ».22 A s’en tenir à ces critères d’ailleurs, de nombreux groupes de partisans dont l’histoire a pourtant reconnu la valeur n’auraient jamais reçu le statut de belligérant.23 En outre, les résistants « non-organisés », dans cette optique assez traditionnelle, sont privés du statut de combattant quelle que soit la légitimité de leur cause et peuvent, comme cela a été reconnu tant par la doctrine,24 certains gouvernements25 que certains tribunaux,26 être considérés comme de simples criminels ne
20 Troisième Convention de Genève, article 4.2. 21 Le Manuel de droit militaire britannique reconnaît d’ailleurs clairement que « the provisions of Art. 4 do not go so far as may seem at first sight. They do not seriously impede action by the Occupant against resistance movements. For the conditions stated in this article are somewhat stringent inasmuch as they rule out to a large extent the elements of secrecy and surprise which normally accompany resistance movements”. Egalement Gerald Irving A. Dare DRAPER, et al., Reflections on law and armed conflicts : the selected works on the laws of war by the late
professor colonel G.I.A.D. Draper, OBE, (The Hague ; Boston, Kluwer Law International, 1998), p. 201. (“(The) Geneva (POW) Convention is based upon conditions sufficiently stringent as to preclude any effective military resistance to the armed forces of the occupant”). 22 Gerald Irving A. Dare DRAPER, The Red Cross Conventions, (London, Stevens, 1958), p. 112. Baxter faisait remarquer que la véritable guerrilla était un « secret warfare » assez éloigné de la guerrilla juridiquement anticipée par la quatrième Convention. Richard R. BAXTER, « So-Called Unprivileged Belligerency: Spies, Guerrillas, and Saboteurs », 28 British Yearbook of International Law, 1951, p. 328. (“It is reasonable to suppose that guerrillas and members of resistance movements will more frequently than not fail to conform to these standards, since secrecy and surprise are the essence of such warfare”). 23 David L. LASALLE, « Positive Law, Natural Law, and the French Resistance in the Second World War », 6 Journal of Legal Studies (United States Air Force Academy), 1995, p. 27. Voir également Ingrid DETTER DELUPIS, The law of war, 2nd ed., (Cambridge [England]; New York, Cambridge University Press, 2000), p. 141. (“Scarcely any of the Second World War resistance movements would have qualified as combatants under the four stringent criteria of the Geneva Conventions”). 24 Alan STONE, Regulation and its alternatives, (Washington, D.C., Congressional Quarterly Press, 1982). 25 Memorandum from Jay S. BYBEE, Assistant Attorney, General, to Alberto R. Gonzales, on the Status of Taliban Forces under Article 4 of the Third Geneva Convention of 1949, p. 2 (7 février 2002). 26 Procureur militaire c/. Omar Mahrmut KASSEM et al., International Law Reports, 1971.
8
jouissant d’aucun privilèges (en dehors de celui d’un procès équitable, par exemple). Cette position est clairement reprise par les organismes humanitaires dans le cadre de l’occupation de l’Irak par exemple,27 où les militaires américains ont par ailleurs bien vu le potentiel du droit de l’occupation pour réprimer la résistance.28 En outre, il convient de bien noter que toute reconnaissance du statut de combattant des résistants n’est bien jamais que cela, et ne vaut a priori pas validation de la légitimité plus fondamentale de leur cause, ou d’un droit d’insurrection. Les juristes du CIRC allèrent à l’époque de l’adoption des Conventions de Genève jusqu’à souligner que celles-ci avaient bien pour effet de « démentir les allégations de certains auteurs et commentateurs de la Convention qui voient, dans la présente disposition, un véritable ‘ius insurrectionis’ reconnu à la population du territoire occupé ».29 Du point de vue droit humanitaire, l’idée d’une occupation illégale est d’ailleurs un non-sens puisqu’il n’y a, en quelque sorte, que des occupations effectives, l’illégalité étant fonction de ce qui se passe dans le cadre de l’occupation, jamais l’occupation elle-même. C’est pourquoi le Tribunal de Nuremberg avait clarifié à propos de l’occupation de la Grèce et de la Yougoslavie par les allemands que tant pour l’occupant que pour l’occupé, la question de l’illicéité de l’occupation (ou des actions armées y ayant abouti) ne change en rien à leurs obligations.30 C’est bien la motivation humanitaire de la reconnaissance du statut de combattant qui domine ici, l’octroi du statut de prisonnier de guerre étant présenté, toutes choses égales par ailleurs, comme une meilleure manière de sauvegarder notamment l’objectif de protection des populations civiles. Par exemple le memorandum adressé par la Croix Rouge en 1944 aux belligérants révèle un souci traditionnel d’humanité, arguant que « les principes fondamentaux du droit international et de l’humanité doivent être également appliqués quand surgissent au cours de la guerre, des situations qui ne sont pas explicitement mentionnées dans les Conventions internationales ».31 Cette notion de « situation », dans sa neutralité normative, trahit bien l’idée que c’est un état de fait auquel se trouve confronté l’organisation humanitaire, qui ne cherche pas à porter un jugement sur les parties en cause. Le Comité ajoute que « les principes énoncés ci-dessus doivent être appliqués en dehors de toute argumentation juridique portant sur l'existence reconnue ou la belligérance des Autorités desquelles les combattants en présence se réclament ».32 Considérer que certains agissements doivent bénéficier d’une protection humanitaire n’équivaut donc pas à les envisager comme spécifiquement légaux, mais simplement comme appréhendables par le droit. Par exemple, pour Oppenheim, « since International Law is a law between States only and exclusively, no rules of
27 “The insurgent forces in Iraq are not part of the Iraqi armed forces, and so under IHL they are thus not entitled to the so-called combatant's privilege.” « Legal Aspects of the Ongoing Fighting in Iraq », Human Rights Watch, en ligne: <http://www.hrw.org/campaigns/iraq/ihlfaq042904.htm>, 15 October 2008. 28 James W. FRIEND, Military Occupation and the Law of Armed Conflict: Discouraging Resistance, (2003). 29 Jean PICTET., Les conventions de Genève du 12 août 1949. Commentaire, (Genève,, Comité international de la Croix-Rouge, 1952), p. 65. 30 Unied States Military Tribunal at Nuremberg, The Hostages Trial, Case No. 47. Reproduit dans UNITED NATIONS WAR CRIMES COMMISSION, Law Reports of Trials of War Criminals, Volume VIII, 1949, p. 59 (“At the outset we desire to point out that international law makes no distinction between a lawful and unlawful occupant in dealing with the respective duties of occupant and population in occupied territory. There is no reciprocal connection between the manner of the military occupation of territory and the rights and duties of the occupant and population to each other after the relationship has in fact been established. Whether the invasion was lawful or criminal is not an important factor in the consideration of this subject”). 31 Jean PICTET., Les conventions de Genève du 12 août 1949. Commentaire, (Genève,, Comité international de la Croix-Rouge, 1952), p. 65, note 14. C’est nous qui soulignons. 32 Ibid, p. 60.
9
International Law can exist to prohibit private individuals from taking up arms, and committing hostilities against the enemy ».33 Il en résulte que les obligations du droit de l’occupation sont des obligations d’Etat à Etat, pour le bénéfice certes des populations, mais qui n’impliquent pour celles-ci aucune obligation particulière de passivité en droit international.34 De meme, Human Rights Watch, par exemple, souligne soigneusement à propos de l’Irak que mais “… consistent with our position of neutrality in armed conflicts, takes no position on the legality under international law of the U.S.-led invasion of Iraq or the resulting insurgency”.35 En outre, la reconnaissance humanitaire du combattant irrégulier semble également consacrer le caractère minimalement public (condition nécessaire mais pas suffisante de la légitimité) du combat par eux mené. Sinon la légitimité des fins, c’est du moins la légitimité de la nature d’un certain combat qui est reconnue. Les insurgés ne poursuivent peut être pas une cause juste, mais du moins ont-ils une cause et ne sont ils pas de simples brigands de grand chemin. A tout le moins, le droit international humanitaire n’interdit-il pas la résistance,36 et si celle-ci peut être réprimée selon le droit interne lorsqu’elle ne satisfait pas aux critères humanitaires de belligérance, elle n’est pas pour en tant que telle un crime de droit international. L’on dirait même plus, a résistance est “récompensée” humanitairement car elle manifeste une forme de patriotisme légitime auquel un droit international d’Etats ne saurait rester insensible. Il y a là une tradition ancienne d’arguments qui sont de plus en plus pris en compte. Le délégué britannique à la conférence de la Haye insistait déjà sur « the right belonging to the population of countries subjected to invasion to do their duty – to show the interventionists the most energetic patriotic opposition with all permissible means »,37 alors qu’Auguste Lambermont s’inquiètait à Bruxelles de ce que « if citizens are to be punished for the sole reason that, in risking their life, they wished to defend their country, on the post where they are to be shot they should find the article of the treaty, signed by their government, condemning them to death in advance ».38 Si ces arguments n’avaient pas été retenus à l’époque, ils ont une influence beaucoup plus nette après la Seconde guerre mondiale. La doctrine soviétique, représentée notamment par Trainin, exalte les efforts consentis sous occupation par la population “for the defense of Soviet statehood”.39 On retrouve l’impact de ces idées dans certaines dispositions de la Quatrième Convention de Genève relatives aux civils détenus en zone occupée et qui ne bénéficient pas du statut de prisonnier de guerre (notamment car ils n’appartiennent pas à un mouvement « organisé »).
33 Lassa Francis Lawrence OPPENHEIM and Hersch LAUTERPACHT, International law, a treatise, 1940, Sec. 254. 34 Egalement Lassa Francis Lawrence OPPENHEIM, « Legal Relations Between an Occupying Power and the Inhabitants », 33 Law Quarterly Review, 1917, p. 367. (“The duty imposed upon the occupant by section 3 of the Hague Regulations is indeed imposed upon him in the interest of the inhabitants, but no international law relations are thereby created between him and the inhabitants. The duty imposed upon him creates international law relations between him and the legitimate government”). 35 Human Rights Watch, A Face and a Name: Civilian Victims of Insurgent Groups in Iraq, (2005), p. 119. C’est nous qui soulignons. 36 Voir par exemple HUMAN RIGHTS WATCH, A Face and a Name: Civilian Victims of Insurgent Groups in
Iraq, (2005), p. 119 (“insurgency is not in itself a violation of international humanitarian law”). 37 James BROWN SCOTT and CARNEGIE ENDOWMENT FOR INTERNATIONAL PEACE. DIVISION OF INTERNATIONAL LAW., The proceedings of the Hague Peace Conferences : translation of the original texts, (New York, Oxford University Press, 1920), p. 550. 38 Cité par I.P. TRAININ, « Questions of Guerrilla Warfare in the Law of War », 40 American Journal of
International Law, 1946, p. 542. 39 Ibid, p. 559.
10
L’article 67, notamment, enjoint les tribunaux d’occupation à « prendre en considération le fait que le prévenu n’est pas un ressortissant de la Puissance occupante ».40 Cette disposition doit être lue en conjonction avec l’article 68 qui prévoit que « La peine de mort ne pourra être prononcée contre une personne protégée que si l'attention du tribunal a été particulièrement attirée sur le
fait que l'accusé, n'étant pas un ressortissant de la Puissance occupante, n'est lié à celle-ci par
aucun devoir de fidélité ». De fait, l’imposition de la peine de mort contre des individus ayant résisté à l’occupation a depuis longtemps fait l’objet de manifestations d’indignation.41 Il y a dans ces deux dispositions une sorte de début de reconnaissance de ce que la résistance à l’occupation, tout en étant largement punissable au nom du maintien de l’ordre humanitaire, doit l’être avec une certaine indulgence. Pour le CICR, les articles 67 et 68 « … consacre(nt) le principe fondamental selon lequel l’occupation laisse subsister le lien entre les habitants et l’Etat vaincu ».42 Même si les conséquences de cette reconnaissance de l’insurrection demeurent limitées au plan et pour des raisons humanitaires, elles n’attirent pas moins l’attention sur la possibilité que l’insurrection « patriotique » soit, dans son principe « ad bellum », fortement légitime. Les Conventions de Genève ne sauraient de toute façon dénier un jus insurrectionis qu’il ne leur appartenait pas de conférer, même si elles peuvent à bon droit considérer que sa reconnaissance ne doit pas altérer le régime spécifiquement humanitaire de l’occupation.
C. L’exaltation du ius insurrectionis dans le cadre de la décolonisation
L’apologie de l’esprit de résistance atteindra son sommet dans les années 60 et 70 avec l’adoption du Protocole I aux Conventions de Genève, mais surtout avec le vote de toute une série de résolutions exaltant la lutte contre la « domination étrangère », sous l’impulsion du groupe des Etats non-allignés.43 Plus clairement encore qu’après la Seconde guerre mondiale, c’est la question de la légitimité fondamentale d’un certain type de résistance qui semble posée en premier, le droit humanitaire étant ensuite sommé de s’adapter aux circonstances changeantes du monde. A ce niveau, si la protection humanitaire des résistants à l’occupation a pu un temps paraître isolée, une concession obtenue au monde inter-étatique suite aux circonstances très particulières de la Seconde guerre mondiale, elle est par la suite renforcée par une reconnaissance tout à fait explicite du droit de résistance – exprimé ici fondamentalement comme jus insurrectionis - par rapport à certaines grandes situations de violation du droit international. Certains instruments semblent limiter cette possibilité de résistance légitime en droit international aux situations coloniales et d’Apartheid,44 et ont particulièrement à l’esprit certaines luttes géographiquement
40 C’est nous qui soulignons. 41 Le cas le plus célèbre, à ce propos, est celui d’Edith Cavell, infirmière anglaise exécutée par l’armée allemande pour avoir aidé des centaines de soldats alliés à s’échapper de la Belgique occupée vers les Pays-bas. Le premier secrétaire de la légation américaine à Bruxelles, Hugh Gibson, était alors intervenu auprès du gouvernement allemand pour indiquer que son exécution serait considérée un crime à l’égal de la destruction de Louvain ou le torpillage du Lusitania. 42 Jean PICTET, Les conventions de Genève du 12 août 1949, Commentaire, Vol. III, p. 371. 43 Wil D. VERWEY, « Decolonisation and ius ad bellum », in RJ AKKERMAN, et al. (eds.), Declarations on
Principles: A quest for universal peace
1977). 44 Voir définition de l’agression, résolution 3314 (XXIX), 14 décembre 1974, article 7.
11
situées (notamment en Afrique),45 ce qui semblerait exclure les modes d’occupation plus classiques de nature moins pérenne et ne comprenant pas nécessairement d’objectif colonisateur ou raciste. Mais plusieurs sources semblent également suggérer que l’occupation peut par elle-même conférer un droit de résistance. La colonisation, après tout, n’est jamais qu’une forme d’occupation illégale,46 si bien que la consécration de la légitimité des guérillas de libération devrait rejaillir au moins indirectement sur celle des résistants « classiques ». Par exemple, la célèbre résolution 3171 de l’Assemblée générale sur la « souveraineté permanente sur les ressources naturelles déclare « appuy(er) résolument les efforts … des peuples des territoires soumis à la domination coloniale et raciale et à l’occupation étrangère dans la lutte qu’ils mènent pour recouvrer le contrôle effectif de leurs ressources naturelles ».47 La résolution 3746 du 3 décembre 1982, se référant à une longue série de précédents, « réaffirme la légitimité de la lutte des peuples pour l’indépendance, l’intégrité territoriale, l’unité nationale et la libération et de la domination étrangère et coloniale et de l’occupation étrangère par tous les moyens disponibles incluant la lutte armée ».48 Enfin, certaines définitions de l’agression excluent clairement que celle-ci « porte préjudice au droit à l’autodétermination, à la liberté et à l’indépendance, tel qu’il découle de la Charte, des peuples privés par la force de ce droit … notamment les peuples qui sont soumis … à d’autres formes de domination étrangère ».49 C’est également l’époque où le juge Ammoun écrit une longue opinion dissidente dans l’affaire du Sud ouest africain prenant vigoureusement partie pour SWAPO, l’organisation de libération namibienne.50 Certains auteurs voient également dans la résistance menée par les afghans à l’occupant soviétique une lutte de libération nationale.51 L’occupation étrangère « classique » semble ici partager avec les situations de domination coloniale et raciale d’être contraire aux principes fondamentaux des Nations Unies et de comporter un fort élément international.52 Surtout, elle est susceptible d’être considérée comme contraire au droit à l’auto-détermination qui désormais, bien plus que la protection de la souveraineté, constitue le fondement implicite de la résistance légitime à l’occupation. Le droit international humanitaire de l’occupation, à ce titre, est perçu comme un droit a-démocratique, qui insiste plus sur la tutelle humanitaire de la puissance occupante que sur la nécessité de
45 Résolution 2674 (XXV), para. 4 (« Afrique Australe »). 46 Surtout alors que les connaissances historiques et anthropologiques contemporaines confirment que de nombreuses colonies, bien loin d’être « terra nullius » au moment de leur conquête, étaient bien des formes d’occupation de souverainetés ayant déjà existé. Voir notamment {Merle, 1998 #3863} 47 Résolution 3314 (XXIX), 14 décembre 1974, annexe, article 7. 48 Hana ALBAYATY, et al., « Seule la résistance est légale », StopUSA, en ligne: <http://www.stopusa.be/scripts/texte.php?section=BD&langue=1&id=24984>, 10 octobre 2006. 49 Résolution 3314 (XXXIV), 14 décembre 1974. 50 Opinion individuelle de M. AMMOUN, Vice-Président, « Conséquences juridiques pour les Etats de la présence continue de l'Afrique du Sud en Namibie (Sud-Ouest africain) nonobstant la résolution 276 », (1970) Conseil de sécurité, 21 juin 1971. 51 W. Michael REISMAN, « The Resistance in Afghanistan Is Engaged in a War of National Liberation », 81, American Journal of International Law, 1987. 52 On remarquera que la question de la souveraineté sur les ressources naturelles en situation d’occupation étrangère est loin d’être étrangère à la problématique irakienne. Maurice VOYAME, « The Use of Hydrocarbon Resources Under Belligerent Occupation-the Question of the Iraqi Oil », The Journal of Humanitarian Assistance, 2004. Egalement, Greg MUTTIT, « Oil Privatisation Through the Back Door », Niqash, en ligne: <http://www.niqash.org/content.php?contentTypeID=28&id=1259&lang=0>, 25 février 2009.
12
réaliser les vœux de la population.53 Même lorsque l’occupation est présentée comme une occupation « transformative » visant à établir la démocratie et donc allant dans le sens du droit à l’auto-détermination, c’est souvent (au mieux) à la manière d’un gouvernement despotique « éclairé », et l’enjeu participatif est rarement – et peut être d’autant moins - au premier plan. Le régime de l’occupation est alors, selon l’intuition de Fraenkel « … the rule of a foreign government which does not even pretend to represent the will of the governed population ».54 C’est ce fort parti pris en faveur des luttes de libération nationale qui aboutit par la suite à une demande insistante de la part du tiers monde de leur reconnaissance par le droit international humanitaire. La résolution 3103 indique notamment que « la lutte des peuples soumis à la domination coloniale et étrangère … est légitime et entièrement conforme aux principes du droit international »55 pour mieux réclamer que soit accordé le statut de prisonnier de guerre aux guérilleros. Le Protocole I transformera non seulement les luttes de libération nationales mais également la lutte contre des situations « d’occupation étrangère »56 en l’équivalent de conflits armés internationaux57 L’élévation des luttes de libération nationales au statut de conflits armés internationaux fait sortir de l’ombre de l’article 3 commun et du désormais Protocole II, ce qui n’auraient été autrement, justement, que des « armées de l’ombre ». L’internationalisation, en effet, est un formidable éclairage car elle fait accéder l’insurrection à une sorte de légitimité proto-étatique. En outre, les conditions de reconnaissance du statut du combattant sont assouplies à l’égard des guérillas.A une époque où la légitimité fondamentale des luttes insurgées est mise en exergue et où parallèlement la nécessité humanitaire de protéger les combats opposants armées régulières et irrégulières est particulièrement criante, le droit s’adapte en n’exigeant par exemple des guérilleros qu’ils se distinguent de la population civile dans les situations où « en raison de la nature des hostilités, un combattant armé ne peut se distinguer de la population civile », tant qu’il porte ses armes ouvertement pendant la durée de l’engagement.58 Le droit humanitaire vient ici plus amplifier une reconnaissance de fond de la légitimité de la résistance à l’occupant, qu’il ne tente de la limiter.
II. Déclin de l’idée de ius insurrectionis L’idée d’un ius insurrectionis avait atteint un sommet relatif avec les luttes de libération nationale, mais il s’agissait d’une idée qui restait sans doute assez précaire notamment car, en dehors de l’hypothèse de la décolonisation, la reconnaissance « humanitaire » d’une certaine légitimité demeurait fort ambiguë. Or certains facteurs, tant traditionnels que contemporains,
53 Sur l’exemple éclairant de Cyrenaica et la manière dont les britanniques utilisèrent le Règlement de la Haye pour s’opposer à l’auto-détermination, voir Eyal BENVENISTI, The international law of occupation, (Princeton, N.J., Princeton University Press, 2004), pp. 77-78. 54 Ernst FRAENKEL et CARNEGIE ENDOWMENT FOR INTERNATIONAL PEACE, Military occupation and
the rule of law; occupation government in the Rhineland, 1918-1923, (London, New York [etc.], Oxford University Press, 1944), p. 298. 55 Résolution 3103, 12 décembre 1973. 56 Le Protocole I, ne s’applique certes qu’aux conflits armés internationaux et non aux situations d’occupation. Mais l’on reconnaît qu’une insurrection, en ce qu’elle empêche l’occupant de se comporter comme Puissance occupante à part entière, peut rendre applicable à nouveau le régime des conflits armés internationaux. Voir Commentaire Protocole I, paras. 1699-1702. 57 Article 1. 4. 58 Protocole I, article 44.3.
13
aboutissent à une sur-légitimation de l’occupation (même en cas d’illégalité), ce qui contribue à fragiliser l’idée d’un droit de résistance légitime à l’occupation.
A. Indifférence ou hostilité du jus ad bellum
Il a très peu été question en droit international, et ce bien que l’usage de la force soit de plus en plus régulé depuis l’adoption de la Charte des Nations Unies, de se prononcer fondamentalement sur la question de l’usage de la force légitime par les acteurs non-étatiques (autrement que de manière très indirecte par le biais humanitaire). En la matière, il convient de rappeler que le jus ad bellum comprend une dimension explicite et une dimension implicite.59 La dimension explicite, la plus évidente, est celle qui se consacre à l’élucidation des modalités du recours à la force (légitime défense, autorisation du Conseil de sécurité). La dimension implicite, peut être si évidente qu’elle n’est jamais particulièrement soulignée, est celle qui s’attache à définir les sujets légitimes de tout droit de recours à la force. Or dans cette seconde dimension, il ne fait aucun doute que le droit international n’entend le jus ad bellum qu’au sens où celui-ci s’applique à des Etats, la guerre étant par définition l’exercice d’une violence légitime par les souverains. Comme le stipulaient sans ambiguïtés les Instructions de Francis Lieber aux armées des Etats Unis, « Public war is a state of armed hostility between sovereign nations or governments ». Trainin, un juriste soviétique, notera après la Seconde Guerre Mondiale (pour mieux le déplorer) que pour la doctrine occidentale « a state fights only against a state and those of its organical parts which are officially recognized. »60 De fait, pour Oppenheim, la « petite guerre » (menée par les résidus de l’armée régulière contre l’occupant) ne saurait être qualifiée de guerre, surtout en situation de debellatio, car « there are no longer the forces of two States … in the field », si bien que « the victor need no longer treat the guerrilla bands as a belligerent Power ».61 A fortiori, on peut imaginer que ces « minuscules guerres » menées par des individus qui ne sauraient même pas se réclamer de la légitimité éparse d’une armée vaincue ne seraient que très improprement appelées « guerres » pour ces auteurs. Il n’existe donc pas, du moins classiquement et à l’intérieur de la constellation de sens définie par la notion de « recours à la force en droit international », un équivalent non-étatique du jus ad bellum qui définirait les conditions d’un recours légitime, en droit international, à l’insurrection (un « ius insurrectionis »). Les peuples sont bien « considered as non-participating spectators »62 par la doctrine classique, non seulement à des fins humanitaires, mais bien de manière plus profonde comme n’ayant pas le droit en tant que tels au recours à la force, et ce quelle que soit la légitimité ou l’inscription légale de leur cause. Cette absence de cautionnement reflète aussi le parti-pris traditionnel du droit international de ne pas se mêler des affaires internes aux Etats, et donc de ne pas soutenir n’importe quel mode d’utilisation de la force par des acteurs non-étatiques au nom de l’idée de non-ingérence dans les affaires internes. Mais il est intéressant qu’il s’applique y-compris à une situation plus typiquement pour partie internationale comme celle de l’occupation. Cette tendance foncière à exclure les acteurs non-étatiques du jeu de la violence légitime, doit être lue parallèlement avec un autre développement dans la seconde moitié du vingtième siècle
59 Frédéric MÉGRET, « Jus In Bello As Jus Ad Bellum », ASIL Proceedings, 2006. 60 TRAININ, supra (n39), p. 537. 61 Lassa Francis Lawrence OPPENHEIM and Arnold Duncan MCNAIR, International law, a treatise, 4th ed., (London, New York [etc.], Longmans, Green and co., 1928), Sec. 60. 62 TRAININ, supra (n39), p. 541.
14
consistant à les en exclure plus franchement, comme pour mieux les punir de l’impudence qui s’était manifestée à l’occasion des luttes de libération nationale. Les efforts pour aboutir à une plus grande reconnaissance de la violence légitime des acteurs non-étatiques sont en effet constamment concurrencés et parfois pris de vitesse par les efforts parallèles pour la réprimer et lui dénier toute légitimité. Comme on le sait, le régime de la répression et de la lutte contre le terrorisme est périodiquement tenté de pénaliser non pas seulement l’usage illicite de la force, mais bien tout usage de la force par les acteurs non-étatiques. Là où l’on pourrait penser que la définition la plus solide du terrorisme est celle qui met l’accent sur les moyens utilisés (commission de l’équivalent de crimes de guerre), voir sur la cause (mais reconnaître que certaines causes sont illégitimes c’est reconnaître que d’autres sont légitimes), une tendance persistante a pour vocation de réaffirmer le monopole de la violence légitime de tous les Etats contre toute tentative de le contester.63 Enfin, il convient d’ajouter à l’idée que le jus ad bellum ne s’applique de toute façon pas aux acteurs non-étatiques, la crise latente du jus ad bellum lui-même à l’époque contemporaine manifesté tant par la multiplication des tentatives de créer des exceptions à l’interdiction de l’usage de la force (légitime défense préventive, intervention humanitaire),64 la difficulté à définir un crime d’agression pour les besoins de la responsabilité pénale internationale,65 ou encore la curieuse tendance du Conseil de sécurité à récompenser a posteriori le contrevenant en consacrant son rôle d’occupant.66 En réalité, le jus ad bellum se désiste de plus en plus en cas d’occupation en faveur du droit international humanitaire, remettant à ce dernier le soin de réguler une problématique conçue sous l’angle de l’ordre, bien plus que comme une violation de l’interdiction (ou au contraire une autorisation) du recours à la force. Le déclin relatif du jus ad bellum et de l’interdiction absolue du recours à la force, en accouchant d’une vision beaucoup moins pugnace du droit international et de sa mise en œuvre, fragilise également toute prétention à la résistance infra-étatique.
B. Pragmatisme du jus contra bellum
La Charte des Nations Unies s’applique aux Etats et rien qu’aux Etats, et on chercherait en vain, quelle que soit pourtant leur contribution à la fin de la Seconde guerre mondiale et à leur propre libération, l’idée que les groupes résistants sont des auxiliaires légitimes de la communauté internationale dans le rétablissement de la paix ou de la légalité. Cette réticence, en outre, s’applique qu’une occupation soit légale ou non en droit international. En termes de jus contra bellum, c’est donc presque une évidence que la réaction à une situation de rupture de la paix et de la sécurité internationales est bien ou entre les mains de l’Etat agressé, ou entre celles de la
63 Frédéric MÉGRET, « When Terrorism Isn’t Terrorism : A Typology of Abuses » (à paraître). 64 Michael J. GLENNON, « Fog of Law: Self-Defense, Inherence, and Incoherence in Article 51 of the United Nations Charter, The », 25, Harvard Journal of Law & Public Policy, 2001. Quoique l’on pense de ces développements (que cet article n’a pas l’ambition de trancher), il faut convenir qu’ils traduisent de véritables tensions à l’intérieur de la conception du jus ad bellum et créent les conditions de polémiques entre acteurs internationaux. 65 Noah WEISBORD, « Prosecuting Aggression », 49, Harvard International Law Journal, 2008. 66 Voir sur ce point les diverses résolutions du Conseil de sécurité ratifiant le statut d’occupant des Etats Unis en Irak et, tout en exhortant la puissance occupante à s’acquitter de ses obligations, renforçant ainsi incontestablement le statut normatif de l’occupant. SC, Résolution 1483, 22 mai 2003.
15
communauté internationale (incarnée ici par le Conseil de sécurité), mais nullement de la population occupée. Il découle éventuellement d’une situation d’occupation illégale des conséquences en matière de mise en œuvre décentralisée de l’interdiction de l’agression, d’autres Etats où la communauté internationale par le biais du Conseil de sécurité étant susceptibles d’intervenir pour faire cesser l’occupation illégale. Le souverain occupé n’est en effet le plus souvent pas en mesure de se défendre (dans le cas d’une occupation totale) et est mis « hors jeu » en ce qui concerne les règles du jus ad bellum. Mais une des idées implicites à ce titre est que le droit de légitime défense tel que consacré par exemple par l’article 51 est inhérent à l’Etat et qu’une population occupée ne saurait l’invoquer à sa place. En outre, entre jus ad bellum, jus contra bellum, et jus in bello, il convient de prendre la mesure du rôle joué par l’intervention du Conseil de sécurité dans la relative inexistence du débat sur la résistance à l’occupation illégale. Le droit international de la sécurité collective a en effet aussi de plus en plus tendance à s’incliner devant des situations d’usage illégal de la force, notamment face à l’hyper-puissance, mais aussi face à divers projets hégémoniques régionaux. Il faut dire qu’un retour au régime renversé ne paraîtra parfois pas envisageable (par exemple dans le cas de l’Irak). Il en résulte néanmoins une légitimation supplémentaire (au-delà de celle du droit humanitaire) des responsabilités de la puissance occupante au nom de la stabilité, et ce y-compris dans des hypothèses où l’occupation est illégale. La résolution 1483 du Conseil de sécurité, par exemple, reconnaît « l’autorité, les responsabilités et les obligations » de la puissance occupante en Irak désignée comme les Etats-Unis. Cette reconnaissance se veut un rappel à la puissance occupante de ses obligations humanitaires et ne contient en tant que telle aucune validation de l’invasion,67 mais elle confère également une légitimité supplémentaire à l’occupation – désormais perçue comme inhérente à la paix et la sécurité internationales.68 L’amoindrissement de la vigueur du jus contra bellum se traduit donc ici par l’adaptation de l’idée de maintien de la paix et de la sécurité internationales au fait accompli de l’hegemon.69 Les exigences de paix et de sécurité internationales, doublées d’un fort réalisme stratégique, aboutissent ainsi dans la pratique, en instrumentalisant le rôle humanitaire de l’occupant, à fortement séparer une illégalité initiale de la détermination des responsabilités face à l’occupation. En désignant une autorité occupante et même en l’appelant à ses responsabilités, le droit international du maintien de la paix met en avant l’objectif de stabilité et donc d’une certaine manière de consolidation de l’illégalité par rapport à l’objectif de lutte contre ses conséquences. Par un curieux renversement, la menace à la paix et la sécurité internationales n’est plus (elle ne le fut jamais nommément de toute façon) l’agression initiale, mais bien les risques associés à une occupation qui serait insuffisamment effective (dislocation de l’appareil étatique, crise humanitaire, flux de réfugiés, intervention d’autres Etats, et bien sûr terrorisme). Le Conseil de sécurité se concentre sur la gestion des conséquences là où le droit international est incapable de sanctionner les responsabilités, et ce alors même que l’occupation sera souvent
67 Frederic L. KIRGIS, “Security Council Resolution 1483 on the Rebuilding of Iraq,” ASIL Insights (May 2003). On notera que les Etats ayant voté pour la résolution ont gardé contre toute interprétation qui y verrait une reconnaissance de la légalité de l’occupation. 68 Ce point a été renforcé par certaines decisions judiciaires. Voir Al-Jedda v. Sec’y of State for Defense, [2005] EWHC 1809. Egalement Mahmoud HMOUD, « The Use of Force against Iraq: Occupation and Security Council Resolution 1483 », 36 Cornell International Law Journal, 2003, p. 453. 69 Carlos L. YORDAN, « Why Did the U.N. Security Council Support the Anglo-American Project to Transform Postwar Iraq? The Evolution of International Law in the Shadow of the American Hegemon », 3 Journal of International Law and International Relations, 2007.
16
la cause de ce qu’elle est censée prévenir. En outre, l’ensemble des résolutions adoptées par le Conseil de sécurité dan le contexte irakien, et notamment la résolution 1546 (2004), semblent bien aller à l’encontre du droit à l’auto-détermination du peuple occupé, même si elles se présentent comme une manière de le faire aboutir.70 A ce titre, le jus contra bellum opère clairement au préjudice de toute velléité de résistance à l’occupation, même résultant d’une invasion illégale, en en marginalisant le principe et présentant toute résistance comme une partie du problème. L’idée d’auto-détermination, en particulier, est présentée comme devant résulter d’une transition gérée par l’occupant plus qu’un but à atteindre par les populations occupées, de haute lutte si nécessaire. Les insurgés seront désormais perçus non seulement comme une menace au bon déroulement humanitaire de l’occupation, mais encore comme un obstacle à un prompt rétablissement de la paix et de la sécurité internationales, lequel réclame un occupant fort capable de rétablir un semblant d’Etat. Cette représentation des insurgés comme implicitement une menace à la paix et la sécurité internationales (quelle paix ? quelle sécurité ?peut-on se demander lorsque l’on examine l’occupation de l’Irak) n’est jamais aussi forte qu’à l’époque actuelle lorsque s’y superpose la figure du terroriste international, attiré par les situations de déliquescence de l’Etat.
C. Distortion du jus post bellum
Enfin, une dimension partiellement nouvelle, mais qui a le potentiel de fondamentalement modifier la problématique classique de la relation occupé-occupant est celle de l’émergence, contestée et contestable mais néanmoins bien réelle, de la catégorie d’analyse connue sous le nom de jus post bellum.71 Le rapport de ce nouveau projet normatif à l’idée de résistance est peut être un des éléments les plus novateurs, mais aussi les plus incompris des régimes d’occupation contemporains. L’idée que l’occupation n’est pas seulement une sorte de tutelle temporaire, mais bien l’occasion de réformes en profondeur est ancienne. Déjà la révolution française avait élaboré l’idée que, dans la mesure où l’occupation de contrées hors de France avait pour but de leur apporter ses bienfaits, la charge de l’occupation devrait être assumée par les populations occupées. Ceux qui se rebellaient contre ce pillage institutionnalisé (le maraudage) étaient alors immédiatement assimilés à des contre-révolutionnaires rétrogrades. Après la fin de la Seconde guerre mondiale, confrontés à des Etats dont le régime politique avait été la cause du conflit, les puissances occupantes se sentirent habilitées, en Allemagne et au Japon, à aller bien au-delà du cadre des Règlements de la Haye pour se comporter en véritables réformateurs des Etats occupés. Cette transformation de la perception du rôle de l’occupant se traduisit très évidemment par un appel accru à l’obligation correspondante de la population de coopérer avec la puissance occupante, de plus en plus associée à son propre bien.72 Il est inutile de dire que la résistance allemande à l’occupation alliée, notamment soviétique,73 fut traitée avec
70 Steven WHEATLEY, « The Security Council, Democratic Legitimacy and Regime Change in Iraq », 17, European Journal of International Law, 2006. 71 Carsten STAHN, « Jus Post Bellum: Mapping the Discipline (s) », 23, AMERICAN UNIVERSITY
INTERNATIONAL LAW REVIEW, 2008. 72 Gerhard VON GLAHN, The occupation of enemy territory; a commentary on the law and practice of belligerent
occupation, (Minneapolis,, University of Minnesota Press, 1957), p. 5 et 37. Morris GREENSPAN, The modern law
of land warfare, (Berkeley, University of California Press, 1959). 73 E.dward Norman PETERSON, Russian Commands and German Resistance : The Soviet Occupation, 1945-1949, (New York, P. Lang, 1999).
17
d’autant plus de rigueur qu’elle était perçue non seulement comme un facteur de risque humanitaire, mais comme un obstacle à la dénazification qui s’imposait. Inspiré par une idéologie libérale74 et participant en lui-même de l’érosion du jus ad bellum classique,75 le jus post bellum contemporain est le projet de profiter de l’occupation pour reconstruire en profondeur un Etat au-delà de ce qui était traditionnellement permis par le droit humanitaire de l’occupation. Le concept a été déployé tant au Kosovo qu’en Afghanistan et en Irak,76 Il est lié à une extension significative de l’occupation réelle, au-delà de sa fin selon le droit international humanitaire, et la perpétuation de situation d’occupations de fait « à l’invitation » de gouvernements nominalement souverains, mais dont la réalité au pouvoir est largement dépendante de la force et des termes dictés par la puissance (ex) occupante.77 Surtout, le jus post bellum représente un investissement accru dans la responsabilité de l’occupant pour « transformer » le territoire occupé en vue de son éventuel retour à une pleine souveraineté. Cette vision d’une responsabilité post-bellum fait l’objet d’un début de reconnaissance par le droit international, comme lorsque le Conseil de sécurité en appelle à l’Autorité en Irak pour « promouvoir le bien-être de la population iraquienne en assurant une administration efficace du territoire, notamment en s’employant à rétablir la sécurité et la stabilité et à créer les conditions permettant au peuple iraquien de déterminer librement son avenir politique »,78 dans un langage bien éloigné de celui des règles de 1907 ou de la troisième convention de 1949 qui, inutile de le préciser, ne voyaient pas dans le droit de l’occupation une garantie de l’auto-détermination des peuples !79 On le voit, le jus post bellum et les « nécessités » de la reconstruction sont en passe d’opérer un rééquilibrage conséquent en faveur de la légitimité symbolique et du pouvoir réel de l’occupant. L’occupant, de simple gestionnaire des affaires courantes, devient par l’entremise du Conseil de sécurité une sorte de souverain de fait, certes transitoire mais bénéficiant d’un véritable mandat, et susceptible de « suspendre » le droit à l’auto-détermination du peuple irakien.80 Dès lors, une des conditions sine qua non de la vision post bellum articulée par les stratèges américains notamment est la coopération de la population locale. L’insurrection (qui peut être en partie une réaction aux réformes plus qu’au fait même de l’occupation) entre donc en conflit mortel avec le projet de reconstruction, encore plus qu’avec les exigences humanitaires, lesquelles s’accommodent traditionnellement plutôt bien de situations équivoques entre la violence et la paix. Une première conséquence stylistique en découle : la représentation en des termes encore plus teintés de négativité des insurgés. Un auteur phare de la mouvance post-bellum, par
74 Russel BUCHAN, « International Community and the Occupation of Iraq », 12, Journal of Conflict and Security Law, 2007. 75 Brian OREND, « Jus Post Bellum: The Perspective of a Just-War Theorist », 20, Leiden Journal of International Law, 2007. 76 Steven RATNER, Foreign Occupation and International Territorial Administration: The Challenges of Convergence, vol. 16, (2005). 77 Ce type de situation rappelle bien entendu l’Irak où la question du maintien de l’occupation au-delà de son terme légal selon le droit humanitaire est posée. A. ROBERTS, « The End of Occupation: Iraq 2004 », 54, International and Comparative Law Quarterly, 2008. 78 CS/RES/1483, Paragraphe 4. 79 Marten ZWANENBURG, « Existentialism in Iraq: Security Council Resolution 1483 and the law of occupation », 86, IRRC, 2004. 80 {Starita, 2004 #3706}
18
exemple, cautionne contre les « regime hold-outs, fanatics of various stripes, criminal elements, and foreign destabilizers (which) might all actively resist forcible change ».81 Dans ce contexte, le jus post bellum opère un double déplacement du droit de l’usage force classique,82 lequel a des conséquences importantes sur la possibilité théorique et pratique d’un droit de rébellion. Premièrement, le jus post bellum est en tension directe avec le jus ad bellum. Qu’il constitue une manière d’atténuer les conséquences de l’illégalité d’un usage de la force en fournissant, à la manière opportuniste, une cause rédemptrice de cette illégalité, ou bien que la possibilité même d’une reconstruction de l’Etat modifie les catégories du jus ad bellum en étendant les catégories de l’intervention humanitaire ou pro-démocratique, c’est l’interdiction du recours à la force qui se trouve émoussée dans le premier cas, remise en cause dans le second. Dès lors, l’Etat « renégat » est envahi pour son propre bien et surtout pour celui de sa population, dont l’esprit de résistance sera perçu moins comme une manifestation d’une aspiration à la résistance légitime, qu’un obstacle mal venu à une entreprise civilisatrice internationale.83 Deuxièmement, le jus post bellum opère un déplacement et une modification en profondeur du jus in bello. Dans la perspective humanitaire classique, et même si l’occupé doit obéissance à l’occupant, il existait tout de même une tolérance à la marge d’une résistance envisagée comme un phénomène inévitable, pour autant que celui-ci s’exerce selon les modalités du droit humanitaire. L’objectif humanitaire en effet est un objectif trop précaire et minimal, pour entièrement prendre le dessus sur la reconnaissance de la résistance patriotique dans un monde d’Etats. Dès lors en revanche que l’objectif humanitaire est absorbé et dépassé par un objectif de long terme de « mise à niveau » de l’appareil institutionnel et juridique de l’Etat occupé et, somme toute, « une œuvre de libération et de développement »,84 alors la résistance sera perçue comme une menace à l’organisation du processus de réforme, attentatoire à son principe même, voire même manifestation d’une « ingratitude » tout à fait mal venue.85 Bien entendu, la définition exacte du jus post bellum demeure une question amplement débattue. Peter Danchin, par exemple, a bien montré comment l’occupation de l’Irak oscille entre la tentation impériale d’imposer un régime libéral, et la nécessité d’obtenir une légitimation interne de ces changements, y-compris par la voie démocratique.86 Un jus post bellum dont l’unique ambition serait de donner aux populations occupées dans les plus brefs délais l’occasion de se prononcer sur leur avenir pourrait effectivement prendre de cours les efforts des insurgés, en contredisant fortement leur prétention à s’élever contre une imposition illégitime. Cela serait a fortiori le cas si l’occupation s’avérait plus démocratique que ne l’était le régime du « souverain légitime ». Mais il est également très possible que la promesse de réformes démocratiques post-bellum ne serve que de masque à une entreprise hégémonique.
81 Brian OREND, « Jus Post Bellum: The Perspective of a Just-War Theorist », 20, Leiden Journal of International Law, 2007, p. 589. 82 Carsten STAHN, « 'Jus ad bellum','jus in bello'...'jus post bellum'?-Rethinking the Conception of the Law of Armed Force », 17, European Journal of International Law, 2006. 83 Sur le caractère problématique de la prolongation de l’occupation dans un contexte où le retour de la souveraineté de l’Etat occupé est l’objectif traditionnel, voir Mark EVANS, « Balancing Peace, Justice and Sovereignty in Jus Post Bellum: The Case ofJust Occupation' », 36, Millenium: Journal of International Studies, 2008. 84 Madjid BENCHIKH, « L'occupation de l'Iraq: aspects juridiques et politiques », 5, Annuaire français de relations internationales, 2004, p. 304. 85 Rosa BROOKS, “Those Ungrateful Iraqis!”, Los Angeles Times, 7 avril 2006. 86 Peter DANCHIN, « International Law, Human Rights and the Transformative Occupation of Iraq », in Brett BOWDEN, Hilary CHARLESWORTH, AND Jeremy FARRALL (ed.), Great Expectations: The Role of
International Law in Restructuring Societies after Conflict, (Cambridge, Cambridge University Press, 2008).
19
Quoiqu’il en soit, l’émergence du jus post bellum n’en demeure pas moins une manière de considérer que les conditions qui président à l’application du jus in bello, à savoir l’existence d’une conflictualité minimale ou du moins la gestion immédiate de ses conséquences, ont été écartées, et que l’on se trouve dans une situation propice à la « contre-insurrection », au régime d’usage de la force prétendument spécifique.87 Pour Williams et Caldwell, par exemple, lesquels insèrent leur analyse dans le jus post bellum:
When hostilities end, all become noncombatants and have (or ought to have) their peace-time right to life restored. As a result, those who continue to kill are murderers, even if their victims are soldiers. Soldiers become, for as long as their presence is necessary, the moral (and sometimes the functional) equivalents of policemen.88
Là où le but devient de « restaurer les conditions de paix » plutôt que simplement gérer les affaires humanitaires, donc, les insurgés apparaissent moins comme les défenseurs patriotiques d’une souveraineté bafouée, que comme les sbires d’un régime condamné menant un combat d’arrière garde (possiblement contre l’intérêt bien compris de leur propre population) contre la reconstruction et l’avancée des nécessaires réformes. Comment se « libérer » en effet, d’une occupation présentée comme elle-même « libératrice » ? La réaction d’un membre du Congrès américain à la proposition Maliki d’amnistie pour les insurgés irakiens est ici instructive :
What are legitimate acts of resistance? Against a Nation that liberated that nation from a brutal dictator? Is it a sniper who shoots at a soldier who is trying to restore power and electricity to a Baghdad neighborhood? Is it placing a roadside bomb next to a convoy that was trying to repair a road in the Sunni triangle or fix a school? Is it detonating an improvised explosive device against a team of U.S. soldiers who are attempting to build a hospital in Iraq? I think not.89
On n’est pas loin de retrouver, sous un jour très différent, les théories de la « trahison de guerre » sur lesquelles Oppenheim décrivait déjà pendant la Première guerre mondiale,90 à la différence près que, la sensibilité changeant, le respect dû à la force de l’occupant est remplacé par celui dû à la mission civilisatrice de la reconstruction de l’Etat. Impudence, témérité et ingratitude sont, aujourd’hui comme hier, les plus sûrs ressorts d’un tenace processus de disqualification de l’insurrection.
III. Au-delà de la défense du souverain légitime et du droit à l’auto-détermination: un renouveau de l’idée de résistance à l’occupation est-il possible ?
87 Rebecca JOHNSON, « Jus Post Bellum and Counterinsurgency », 7, Journal of Military Ethics, 2008. 88 Robert E. WILLIAMS et Dan CALDWELL, « Jus Post Bellum: Just War Theory and the Principles of Just Peace », 7 International Studies Perspectives, 2006, p. 316. 89 Senator Reid, Congressional Record – Senate, 26 juin 2006, S6468. 90 Lassa Francis Lawrence OPPENHEIM, « On War Treason », 33, Law Quarterly Review, 1917.
20
L’architecture normative du droit international, particulièrement celle de sa mise en œuvre, reste très prisonnière, comme on l’a suggéré, d’une vision étatiste et supra-étatiste en matière d’occupation. Le modèle dominant de lutte contre l’illicite ou du moins la rupture de l’ordre, est un modèle de centralisation croissante et de dépassement de la décentralisation du système. Si conséquences il doit y avoir à une occupation illégale, celles-ci sont du ressort de l’Etat envahi, d’autres Etats ou de la communauté internationale, mais les acteurs de la résistance locale n’ont pas leur place dans la réaction à l’illicite. D’une manière plus générale, on peut dire que cette non-reconnaissance débouche sur une malencontreuse discordance entre la sociologie des acteurs des relations internationales et la théorie des sujets du droit international. Bien entendu, il est tout à fait possible de critiquer l’ensemble des constructions qui s’élèvent contre une plus grande reconnaissance de la légitimité de certaines insurrections (supra, II). De toute évidence, nombreux sont les juristes internationaux qui, à raison, ne se résignent pas devant les entorses faites au jus ad bellum et considèrent qu’il est plus urgent que jamais de raviver le projet de la sécurité collective ou encore de criminaliser l’agression. En outre, il est très possible d’insister ad nauseam sur la nécessité pour la puissance occupante de respecter ses obligations humanitaires. Enfin, quelles que soient les entorses que l’idée de jus post bellum a déjà faite au droit de l’occupation, on peut considérer qu’il s’agit là d’une évolution prématurée et sans bases juridiques solides.91 Cependant, il faut également convenir que la réticence à reconnaître le rôle potentiel d’acteurs non-étatiques dans la réaction à l’illicite participe d’une tendance beaucoup plus profonde et systémique que la fragilisation contemporaine du jus ad bellum ou l’émergence du jus post bellum. Quoiqu’il en soit, les efforts de réaffirmation du droit international ne sont pas incompatibles avec une reconnaissance simultanée du rôle des acteurs non-étatiques dans leurs efforts de protection et de libération. Il en va d’une certaine effectivité du droit international, ainsi que de la mise en œuvre de certain principes. Face à ces défis, il semble possible d’entrevoir les prémisses d’une théorie de la défense du droit international en situation d’occupation fondée sur une plus grande reconnaissance du rôle effectif des acteurs non-étatiques dans sa mise en œuvre (B). A un certain niveau, un groupe d’insurgés qui s’élève contre une occupation illégale fait partie d’une forme extrêmement décentralisée de lutte contre les conséquences de l’illicite. Toute percée significative en la matière dépend d’une capacité à défaire les nœuds enchevêtrés qui lient jus in bello et jus ad bellum et à dégager un espace propre pour un jus insurrectionis (A). Il s’agit également de s’affranchir en partie des justifications traditionnelles d’un droit de résistance (C), afin d’envisager l’insurrection sous l’angle d’un droit de légitime défense (D), qui doit s’articuler avec les prérogatives de la communauté internationale (E). Enfin, une résistance à l’occupation pour être légitime devra satisfaire un certain nombre de critères intrinsèques (F).
A. Nécessité d’une meilleure séparation conceptuelle entre jus in bello et jus ad bellum
Le mécanisme du déclin de l’idée d’un ius insurrectionis est complexe et s’abreuve tant à la source du jus in bello que du jus in bellum, ainsi que de certains préjugés plus profonds du droit
91 {Bhuta, 2005 #3697}; Alex J. BELLAMY, « The responsibilities of victory: Jus Post Bellum and the Just War », 34, Review of International Studies, 2008.
21
international à l’égard des acteurs non étatiques et de la question de la violence légitime. Mais il est indéniablement basé en partie sur une prioritarisation axiologique de l’humanitaire sur le jus ad bellum. Au nom de la séparation entre jus in bello et jus ad bellum, ce premier réclame un espace (« l’espace humanitaire ») au sein duquel les considérations de légitimité d’un conflit sont écartées. L’argument humanitaire classique pour écarter toute emprise du jus ad bellum est bien compréhensible : il ne faudrait pas que des combattants puissent exciper de la légitimité de leur cause pour mieux échapper à leurs responsabilités. Mais la séparation des sphères peut également être poussée à un point où elle exerce un impact substantiel, et pas toujours légitime, sur le jus ad bellum lui même. Le jus in bello de l’occupation en effet opère un rééquilibrage fort en faveur des acteurs étatiques qui joue objectivement contre les forces de résistance. Déjà en 1864, Beernaert, qui deviendra prix Nobel de la paix en 1909, et s’élève à ce propos contre l’humanitarisme d’un de Martens, avait pressenti ce danger:
Ici encore, je constate dans le projet de Bruxelles les mêmes préoccupations, profondément louables en elles-mêmes: réduire les maux de la guerre et les souffrances qu'elle entraine ; et lorsque semblable but est poursuivi par l'un des monarques les plus puissants du globe, rien n'est plus digne d'éloge. Mais à vouloir restreindre la guerre aux Etats seulement, les citoyens n'étant plus en quelque sorte que de simples spectateurs, ne risque-t-on pas de réduire les éléments de la résistance, en énervant le ressort si puissant du patriotisme?92
Cette critique sera bien sûr reprise au moment des luttes de décolonisation pour s’en prendre à l’impact proprement distributif93 du droit de la guerre sur la possibilité d’exercice de la violence légitime, largement perçue jusque là comme un monopole des Etats. Le développement clef intellectuellement consiste cependant ici à comprendre que le déni du statut de combattant aux insurgés à la Haye et le déni de cette qualité après les Conventions de Genève et le Protocole I à certains insurgés qui pour une raison ou pour une autre ne remplissent pas les critères humanitaires, n’épuisent nullement la question de la légitimité fondamentale de la lutte anti-occupation. On pourrait dire qu’à la limite, il ne fait qu’en augmenter le coût, mais en restant neutre sur la question des fins. La logique humanitaire, dans sa compréhension propre, est bien d’exiger des participants au conflit qu’ils se conforment à certaines exigences à des fins humanitaires. On demande aux combattants insurgés qu’ils portent l’uniforme, ou encore qu’ils soient sous un commandement responsable, pas car ces manifestations sont le signe d’un combat légitime – on peut bien entendu porter l’uniforme et même respecter le droit humanitaire tout en menant une guerre d’agression ou en tentant de renverser un gouvernement démocratiquement élu – mais car elles permettent de minimiser les victimes collatérales et protéger plus généralement la population civile en la distinguant des insurgés. Un groupe d’insurgés pourrait se conformer à toutes les exigences du droit humanitaire et par ailleurs être entièrement illégitime car cherchant à renverser un régime d’occupation parfaitement légal (par exemple car décidé par le Conseil de sécurité). L’important est que si l’on s’en tient à la distinction fondamentale entre jus in bello et jus ad bellum/insurrectionis, on peut considérer que la question fondamentale de la légitimité de la lutte
92 Conférence internationale de la paix, la Haye, 1899, (La Haye, Martinus Nijhoff, 1907), p. 90. 93 Pour utiliser un terme cher à David Kennedy. Voir {Kennedy, 2004 #3585}
22
contre l’occupant reste largement à l’écart de celle de sa protection humanitaire. Un « combattant illégal », pour utiliser la formule américaine, n’est illégal qu’au regard du droit humanitaire, et pas de la problématique plus générale de la lutte contre l’oppression, manifestée ici par une occupation illégale. Toute une tradition insiste en effet sur le fait que les limites imposées par le jus in bello ne doivent pas être interprétées comme modifiant les conditions fondamentales de la légitimité de l’insurrection. Comme le disait le délégué Britannique à la conférence de Bruxelles, à propos de l’article relatif à l’insurrection, « rien dans ce chapitre ne doit être considéré comme tendant à amoindrir ou à supprimer le droit qui appartient à la population d’un pays envahi de remplir son devoir d’opposer aux envahisseurs par tous les moyens licite la résistance patriotique la plus énergique”.94 Certaines remarques de de Martens à la Conférence de la Haye suggèrent d’ailleurs qu’il n’était question que de réglementer le comportement de ceux des résistants qui souhaitaient s’inscrire à l’intérieur de la légalité humanitaire pour bénéficier de ses protections. Comme l’a reconnu une cour d’appel norvégienne, un groupe de résistants peut s’adonner à des activités de résistance légales en droit international (jus insurrectionis), notamment car elles ne violent pas les usages fondamentaux du droit humanitaire, tout en ne bénéficiant pas du statut de belligérent (jus in bello), par exemple car ils ne portent pas d’uniforme.95 Dans l’affaire des otages, le tribunal allié avait considéré que « … guerrillas may render great service to their country and, in the event of success, become heroes even, still they remain war criminals in the eyes of the enemy and may be treated as such ».96 Le statut des résistants s’apparente ici à celui tout à fait paradoxal des espions: mode légitime de combat, ils s’exposent néanmoins à une répression sévère si appréhendés. Il paraît possible donc, de réellement découpler jus in bello et jus ad bellum, et d’envisager que des résistants qui pour une quelconque raison spécifiquement humanitaire ne devraient pas bénéficier du statut de combattant (car ne portant pas l’uniforme ou n’étant pas sous commandement responsable), pourraient néanmoins se targuer d’être engagés dans des actions légitimes sur le fondement du jus insurrectionis.
B. Rejet du lien avec un souverain comme vecteur de légitimité en situations d’occupation
La plus grande reconnaissance du rôle des acteurs de la résistance à l’occupation passe notamment par une critique de l’étatisme du droit international et notamment la tentation récurrente de dériver la légitimité d’une insurrection de son rattachement à un souverain. Un premier niveau de critique opèrera ici au niveau des considérations humanitaires qui ont longtemps vu dans ce rattachement une meilleure garantie de l’application du droit. Or l’exigence d’un lien à l’Etat peut en effet paraître arbitraire dès lors que ce rattachement est loin d’être une garantie de respect des règles du droit de la guerre (que certains Etats, de toute
94 Conférence internationale de la Paix, La Haye 1807, vol. III, p. 122-23. 95 In re Runs and others, 20 mars 1946, H. LAUTERPACHT and Christopher J. GREENWOOD, International Law Reports: Annual Digest of Public International Law Cases 1946 (London 1951). (« … their activities were permissible according to international law, but as long as the members did not wear uniform… they were not entitled to the privileges of belligerents »). 96 Affaire des otages, Trial of Wilhelm List and Others (Case No. 47), 8 L. Rpts. of Trials of War Criminals 34, 57-58 (U.N. War Crimes Comm. 1948).
23
évidence, ne respectent pas). En outre, à une époque de « failed states », c’est souvent s’assurer que la lutte se déroule ipso facto hors de la protection humanitaire due aux insurgés qui en satisfont les critères essentiels, dès lors que l’Etat n’existait déjà plus au moment de l’invasion du territoire, point qui n’a pas échappé à l’administration américaine par exemple dans le cas afghan.97 En termes de « jus ad bellum », la réactivation de la défense d’un droit de résistance à l’occupation comme manifestation d’une défense patriotique (supra, I) paraît également limitée dans les conditions actuelles. Pour commencer, l’occupation se traduit de plus en plus par une extinction de toute forme d’autorité souveraine dans le territoire occupé, même en exil. Dans ce cas, il n’existe plus de mandant dont le mouvement insurgé pourrait dériver un mandat « public » en bonne et due forme, un peu à la manière dont les forces françaises de l’intérieur pouvaient se réclamer de la légitimité du pouvoir incarné par de Gaulle et reconnu par les Alliés pendant la Seconde guerre mondiale. En outre, il est très possible que les insurgés de l’intérieur ne se reconnaissent pas dans un quelconque gouvernement en exil et cherchent donc ailleurs leur légitimité.98 De tels obstacles ne sont pas rédhibitoires, mais ils ne sont pas non plus nécessairement concluants au niveau normatif, et impliquent de reconstruire « de l’intérieur » le caractère plus ou moins public de l’insurrection, et la réalité de sa prétention à incarner une souveraineté virtuelle ou à venir. Cependant, on peut se demander si même modifiée, l’idée du rattachement « virtuel » à l’Etat comme vecteur de la légitimité des mouvements d’insurrection ne passe pas à côté de l’essentiel, et ne reproduit pas à l’excès une matrice étatique. Elle semble en effet ignorer plusieurs scenarios encore plus problématiques. Tout d’abord, il se peut très bien que le territoire occupé n’ait pas été un Etat au moment de son occupation, voir n’ait jamais été un Etat ou même ne le devienne pas par la suite. On pense notamment à la Pologne pendant la Première guerre mondiale, au Timor oriental ou encore aux territoires palestiniens occupés. La pratique internationale (reconnaissance d’un « comité national polonais » ou de l’OLP notamment) montre que, du moins dans cette hypothèse, un lien avec un souverain n’est pas une condition sine qua non de la légitimité. Une autre difficulté de taille survient lorsque que le gouvernement « légitime » avant-occupation est en fait lui-même illégitime du point de vue du droit international (ce qui bien sûr ne justifie pas en soi son renversement), car par exemple responsable de graves violations des droits humains ou tyrannique. En cela, le jus post bellum pose au moins la bonne question (l’aspiration à la démocratie), à défaut d’y apporter la bonne réponse (l’idée que la puissance occupante dût être l’artisan du « regime change »). Il ne s’agit en effet pas seulement de rétablir mécaniquement le souverain légitime. Enfin, l’idée d’un « patriotisme » qui justifierait de manière un peu mécanique une certaine indulgence à l’égard de l’insurrection paraît en outre problématique, dès lors que ce patriotisme
97 Memorandum from Colin L. Powell, Secretary of State, to Counsel to the President, on the Applicability of the
Geneva Conventions to the Conflict in Afghanistan 1 (25 January 2002). Cette exigence de rattachement étatique est aussi surprenante dès lors que le droit international humanitaire a par ailleurs reconnu que les membres des mouvements de libération nationale pouvaient eux bénéficier du statut de prisonnier de guerre, au titre du Protocole I, alors même qu’ils ne sont pas en mesure par définition d’établir une « appartenance » à un Etat. 98 Par exemple, l’idée d’un rattachement au souverain comme critère de légitimité humanitaire a pu paraître assez arbitraire dans le cas de la résistance timoraise, où n’existait effectivement pas de lien entre le Falintil et le Portugal, ce qui poussait à la conclusion que les membres du Falintil, malgré des décennies d’action contre l’occupant indonésien, n’étaient pas des combattants mais de simples civils. De même, la résistance titiste pendant la Seconde guerre mondiale n’a jamais été considérée comme illégitime du seul fait qu’elle ne reconnaissait pas le gouvernement royaliste en exil.
24
est susceptible de s’exprimer pour rétablir un régime inique (sans parler du fait que l’idée de « patriotisme » n’est guère une valeur proprement internationale). La réification ou la romantisation du patriotisme à laquelle se prêtait le droit international du XIXème siècle paraît aujourd’hui d’une utilité limitée. Il est possible en effet d’imaginer des « patriotismes » tout à fait mal venus, car menant à des projets contraires au droit international et aux droits humains. On ne songerait guère à qualifier de « patriotique » le combat d’anciens nazis dans l’Allemagne occupée après la Seconde guerre mondiale par exemple, et si on le faisait, ce serait pour mieux le disqualifier au nom de l’impératif international de la dénazification. Une réponse à cette difficulté pourrait consister à insister sur la nécessité d’assouplir l’exigence d’un lien avec l’Etat, notamment en situation de debellatio. Dans un article écrit sur l’occupation de l’Irak, deux auteurs travaillant pour le CICR ont par exemple suggéré que « Under a broader interpretation of the term ‘belonging to a party to the conflict’ it could be considered that, following the ousting and disappearance of a former regime, an organized resistance movement could act as de facto agent of the State and that such agent engages the responsibility of the State”.99 Le droit international général fournit également ici une manière de s’éloigner du formalisme de l’exigence d’appartenance à une partie au conflit en soulignant que « la nature de l’activité menée se voit attribuer plus de poids que l’existence d’un lien formel entre les auteurs de l’activité et l’appareil de l’Etat ».100 C’est donc qu’il faudrait s’attarder sur le caractère « public » d’un effort de résistance bien plus que sur l’existence d’un cordon ombilical avec un souverain hypothétique, virtuel, défait, et peut être de toute façon illégitime. Même si cette approche demeure ancrée dans une certaine vision étatique (la question de la responsabilité a posteriori de l’Etat auquel mène l’insurrection), elle ne s’en rapproche pas moins de pistes de réflexion plus fructueuses.
C. Vers une meilleur compréhension de la qualité de sujet du droit international de certains mouvements insurgés
99 Knut DÖRMANN et Laurent COLASSIS, « International Humanitarian Law in the Iraq Conflict », 47 German
Yearbook of International Law, 2004. Ces auteurs s’appuient notamment sur une interprétation intéressante de l’article 9 des articles sur la responsabilité de l’Etat adoptés par la Commission du droit international, lequel envisage la possibilité qu’une « personne ou (un) groupe de personnes exerce en fait des prérogatives de puissance publique en cas d’absence ou de carence des autorités officielles et dans des circonstances qui requièrent l’exercice de ces prérogatives ». Parmi les situations types envisagées justement par la Commission figurent celles exceptionnelles tel « un conflit armé ou une occupation étrangère au cours desquels les autorités régulières sont dissoutes, disparaissent, ont été supprimées ou sont temporairement inopérantes ». En outre la Commission décrit le principe comme « un peu l’héritier de la vieille idée de la levée en masse, l’autodéfense des citoyens en cas d’absence des forces régulières », c'est-à-dire « une forme de représentation par nécessité » - idée incontestablement proche de celle de la résistance en territoire occupé, que la Commission n’a peut être pas voulu exclure. Bien entendu, l’article 9 envisage cette possibilité uniquement sous l’angle de la responsabilité de l’Etat et pour conclure que dans une telle hypothèse l’Etat devient subséquemment responsable des actes entrepris en son nom par les « personnes » en question. En considérant que ces groupes sont suffisamment reliés à l’Etat pour que celui-ci endosse par après la responsabilité de leurs actes, cependant, la Commission renforce également l’idée qu’il existe bien un lien entre résistants et souveraineté, y-compris dans des cas où il est quelque peu artificiel puisque le souverain légitime est tout à fait « absent ». 100 Commission du droit international, Projet d’articles sur la responsabilité de l’Etat pour fait internationalement illicite, 2001, p. 116.
25
Le droit international est largement orphelin, traditionnellement, d’une théorie des acteurs non-étatiques. Si de grands progrès ont été accomplis en matière de reconnaissance de l’individu comme sujet de droit international, c’est sous l’angle assez réductionniste de la responsabilité pénale internationale ou relativement limité de la qualité de partie devant certaines juridictions internationales de protection des droits humains. Pour le reste, le droit international se borne à envisager un rôle policé et informel des acteurs non-étatiques (individus, mouvements sociaux, ONG, multinationales) dans le développement des normes internationales voir dans leur respect, mais très peu dans leur protection, et encore moins si celle-ci doit les amener à s’élever contre les Etats. Le droit international peine à penser sa fonction régulative à l’égard du monde non-étatique en dehors de la répression, du paternalisme, et du rappel incantatoire de la prévalence de l’Etat. Pourtant il est possible d’imaginer une théorie du droit international qui, en faisant une part plus grande au rôle des acteurs non-étatiques, préparerait une meilleure compréhension du rôle des insurgés. Contre l’étatisme qui semble prévaloir parfois, l’argument en faveur de la résistance se fonde sur une réévaluation des acteurs non-étatiques, et une nouvelle ambition à propos de leur rôle dans la mise en œuvre du droit international, y-compris lorsqu’aucun rattachement à un Etat ne peut être établi. Déjà en 1949, Preux notait que « Le citoyen d’aujourd’hui a un plus grand sens de la responsabilité personnelle vis-à-vis des événements politiques qu’autrefois. Au nom de quel principe éthique le droit international sanctionnerait-il dès lors des actes de résistance entrepris à titre personnel et que le monde considère généralement comme des actes d’héroïsme bien plus que comme des actes criminels ? ».101 La question a le mérite d’être posée et elle reconnaît implicitement tant l’autonomie que la responsabilité d’au moins certains mouvements de résistance, qui devraient peut être en dernier ressort un des plus sûrs déterminants de leur qualité de sujet.102 Le droit international a parfois donné des signes d’une disposition à s’orienter dans ce sens. C’est le cas notamment en matière humanitaire où tant la pratique que la réflexion doctrinale se sont depuis longtemps engagées sur la voie du pragmatisme, considérant que certains groupes non-étatiques pouvaient du moins unilatéralement se déclarer liés par des instruments auxquels ils ne sont et ne pourraient pas être formellement partie.103 Si les acteurs non-étatiques sont suffisamment sujets pour être titulaires d’obligations lourdes en matière humanitaire, alors du moins paraît-il plus difficile de leur dénier cette qualité lorsqu’il s’agit d’invoquer un droit à l’auto-détermination ou même un recours à la légitime défense en situation d’occupation. En effet, au-delà de la seule matière humanitaire, il existe également une tendance à la reconnaissance de certains groupes non-étatiques engagés dans un usage de la force en tant que tels, qu’il s’agisse de certains gouvernements en exil pendant la seconde guerre mondiale (qui n’avaient de gouvernement que le titre) ou de mouvements de libération nationale.104 Cette tendance a pour effet de reconnaître certains mouvements sur la base de leurs mérites propres
101 Jean de PREUX, « Etudes sur la IIIème Convention de Genève de 1949. Prisonniers de guerre », Revue internationale de la croix rouge, 1954, p. 37. 102 Inversement et par la même occasion Jean Preux nous fournit une clef qui peut permettre de comprendre pourquoi de nombreux groupe ne sauraient bénéficier de la reconnaissance comme acteurs légitimes : le fait que précisément, « le plus grand sens de la responsabilité personnelle » n’est pas toujours la donnée qui les caractérise. Ibid. 103 Michel VEUTHEY, « Learning from History: Accession to the Conventions, Special Agreements, and Unilateral Declarations », 27, Collegium, 2003. Rudiger WOLFRUM and Christiane E. PHILIPP, « The Status of the Taliban: Their Obligations and Rights under International Law », 6, Max Planck Yearbook of United Nations Law, 2002. 104 Malcolm SHAW, « The international status of national liberation movements », 5, Liverpool Law Review, 1983.
26
plutôt que comme l’incarnation d’une souveraineté qui, par hypothèse, n’a jamais existé. Elle se manifesta notamment à l’époque où le droit à l’auto-détermination commençait à occuper une place de premier plan. Pour le juge Ammoun dans l’avis sur le sud ouest africain, le « peuple namibien » avait bien la personnalité juridique. Cette personnalité des peuples aboutissait à ce qu’ils produisent le droit et que leurs luttes deviennent elles-mêmes, par un processus d’accumulation, la source de leur propre légitimité. Dans une interprétation audacieuse, Ammoun insiste que « s’il est une ‘pratique générale’ pouvant, de façon incontestable, créer le droit aux termes de l’article 38, paragraphe 1 b), du Statut de la Cour, c’est bien celle que constitue l’action consciente des peuples eux-mêmes luttant avec détermination ».105 Quoiqu’il en soit, le recours à l’idée d’auto-détermination, en ancrant la légitimité de l’insurrection dans une volonté populaire au lieu d’en faire l’exécutrice d’un pouvoir souverain virtuel constitue une avancée. Mais ce discours, tel qu’il fut développé notamment dans le contexte de la décolonisation, n’est pas non plus sans poser des problèmes, et pas uniquement car la notion d’auto-détermination est notoirement complexe. En particulier, l’existence d’un droit à l’auto-détermination en tant que tel ne nous renseigne guère sur le droit qu’aurait un groupe qui s’en réclame de recourir à la force. Un renouveau de l’idée de résistance à l’occupation passe peut être dès lors par une meilleure compréhension de son articulation avec l’idée de légitime défense en droit international.
D. Prisme de la légitime défense
L’exclusion d’un ius insurrectionis au sens fort remonte à une époque où le droit international était relativement neutre par rapport à l’usage de la force dans les relations internationales. Le droit d’insurrection était défendu non pas en ce qu’il concourrait à une quelconque mise en œuvre du droit international, mais car il était lié à l’idée de « patriotisme » ou, comme on l’a vu, incarnait une aspiration à l’auto-détermination. En réalité, le fondement d’un ius insurrectionis tant dans la défense de la souveraineté que celle du droit à l’auto-détermination, prend insuffisamment en compte le contexte international spécifique qui donne lieu à une situation d’occupation donnée, et surtout l’intérêt propre que le droit international en tant que tel peut avoir à la réguler. A partir du moment où le droit international se prononce de plus en plus non seulement contre l’agression, mais également contre l’impérialisme et le colonialisme, il paraît important de relancer une réflexion proprement internationale sur le ius insurrectionis. Un fondement en particulier mérite d’être exploré, celui de la légitime défense face à une attaque illégale. Le droit à la légitime défense semble en effet susceptible d’opérer à la jointure entre la défense de la souveraineté, le droit à l’auto-détermination, et la défense plus générale du droit international. Certains auteurs ont d’ailleurs d’ores et déjà considéré qu’en termes humanitaires « if the occupation is illegal, then the … duty to obey (the occupier) cannot exist because the sole basis of obedience extends from the superior military might of the occupier in spite of the unlawful character of the occupation ».106
105 AMMOUN, supra (n50), p. 74. 106 Samuel Vincent JONES, « Has Conduct in Iraq Confirmed the Moral Inadequacy of International Humanitarian Law? Examining the Confluence between Contract Theory and the Scope of Civilian Immunity », 16, Duke Journal
of Comparative & International Law, 2006.
27
La question de fond du jus insurrectionis demeure plus complexe. Bien entendu, dans la Charte des Nations Unies, le droit à la légitime défense est présenté implicitement comme un droit appartenant des Etats, et telle semble avoir été la compréhension que lui en a donné le droit international coutumier, ainsi qu’un grand nombre d’Etats occidentaux peu enclins à accepter un droit de recours à la force non-étatique. Face à ce qu’il présentait comme « an unorthodox exposition of the law of self-defence »107 dans le cadre des luttes anti-coloniales, John Dugard a notamment insisté sur le fait que “a sine qua non for (a right of self defense) is an ‘aggressor State’ and a ‘victim State’. In the case of self-defence against colonial domination this necessary requirement is absent,” au sens où il n’y a pas d’Etat victime puisque “the victim of colonial or racist aggression is not a State”.108 L’idée que les insurgés peuvent, face à une occupation illégale, se prévaloir du droit de légitime défense a cependant une histoire, qui parcours en filigrane le droit humanitaire. Dès le début du XXème siècle, Spaight décrivait les dispositions des Réglements de la Haye relatives à la levée en masse comme consacrant « the divine right of national defence ».109 La doctrine soviétique d’après guerre avait insisté sur le fait que, sous l’occupation hitlérienne, la légitime défense était « the moral duty of citizens devoted to their native land and its people”.110 Lors de la conférence menant à l’adoption des Conventions de Genève, le délégué danois avait exigé que le rapport officiel du Comité spécial II (qui traitait de la question du statut de prisonnier de guerre) mentionne le fait que l’article 4 « should not be interpreted in such a way as to deprive persons not covered by the provisions of… their right of self-defense against illegal acts ».111 Un amendement fut même déposé qui prévoyait de conférer le statut de prisonniers de guerre aux personnes civiles agissant en état de légitime défense, ou participant à la défense de leur patrie contre une agression ou une occupation illégales.112 C’est depuis notamment dans le contexte de la décolonisation que plusieurs argumentaires étoffés ont attribué un droit de légitime défense aux peuples sous domination étrangère au nom de l’auto-détermination. Par exemple, dans les années 60 et 70 de nombreux Etats non-allignés, contre l’avis des Etats occidentaux, insistèrent sur le fait que la légitime défense s’appliquait aux peuples privés de leur droit légitime à l’auto-détermination. L’avis d’une partie de la doctrine est alors qu’une hypothèse nouvelle de recours à la force a été créée.113 A ce propos, SWAPO insistait sur le fait que dans l’hypothèse où le droit à l’auto-détermination “is forcibly denied then, under article 51 of the Charter of the United Nations, they have a right to defend themselves and their territory; the more so, against an illegal occupier. A people’s liberation war can be clearly identified as defensive action within the meaning of the Charter”.114 Quoiqu’il en soit de l’argument de John Dugard dans le contexte de la colonisation s’en prenant à l’absence de souverain pre-existant, celui-ci semble moins pertinent pour une situation d’occupation plus classique où de toute évidence un Etat a bien été agressé.
107 John DUGARD, « SWAPO: The Jus ad Bellum and the Jus in Bello », 93 South African Law Journal, 1976, p. 147. 108 Ibid., p. 149. 109 James Molony SPAIGHT, War rights on land, (London, Macmillan, 1911), p. 54. 110 TRAININ, supra (n39), p. 559. 111 Jean PICTET, Les conventions de Genève du 12 août 1949. Commentaire, (Genève,, Comité international de la Croix-Rouge, 1952).. C’est nous qui soulignons. 112 Ibid. 113 Georges ABI-SAAB, « Wars of National Liberation and the Laws of War », 3, Annales d'études internationales, 1972. 114 Cité par John DUGARD, supra (n107), p. 145.
28
John Dugard reconnaissait à ce propos qu’une situation comme celle de la Namibie comportait bien des caractéristiques particulières, dont la reconnaissance par la Cour internationale de justice et le Conseil de sécurité de l’illégalité de l’occupation continue par l’Afrique du sud. Le juge Ammoun avait quant à lui considéré que l’occupation de la Namibie était une agression et que « (e)n droit, la légitimité de la lutte des peuples ne doit pas faire de doute, car elle découle du droit de légitime défense inné dans la nature humaine et consacré par l’article 51 de la Charte des Nations Unies ».115 On remarquera que cette tradition a été reprise à l’époque contemporaine dans le contexte de l’occupation, un auteur parlant du « droit fondamental » de la résistance irakienne « to resist the invasion and occupation of their country that is guaranteed by Article 51 of the United Nations Charter ».116 L’article 51 de la Charte de l’ONU fait bien allusion à un « droit naturel de légitime défense » dont l’inspiration naturaliste prenait pour modèle le droit de légitime défense de l’individu, et qui semble donc pouvoir connaître d’acceptions plus larges que celle qui le cantonne à l’Etat. Bien entendu, il n’est pas évident d’adapter des constructions adoptées parfois de manière ambigüe dans le cadre spécifique de la décolonisation (principalement africaine) à des situations d’occupation étrangère suite à une agression. L’illicéité fondamentale commune à ces deux types de situation milite néanmoins en faveur d’un rapprochement conceptuel. On peut imaginer, théoriquement, un processus au terme duquel le droit de légitime défense appartenant au souverain pourrait être transféré à sa population lorsque le souverain est incapable de l’exercer, notamment par analogie avec le régime de la Charte. La compréhension orthodoxe de l’article 51 est que ce droit est « suspendu » en cas d’intervention de la communauté internationale incarnée par l’ONU, mais qu’il peut redevenir effectif en cas d’inaction. On peut emprunter à cette construction en termes de subsidiarité certains de ses traits pour la transposer librement aux rapports entre le souverain et sa population. Le droit de légitime défense, qui réside prioritairement dans le souverain, serait alors transféré à la population, par analogie avec l’article 51, en cas de paralysie, faillite ou déficience de celui-ci. Si le but de l’association constituée par le contrat social est bien d’assurer la protection de tous par l’exercice de la souveraineté, c’est bien que la dissolution momentanée de ce contrat remet chacun des membres de l’association dans sa position initiale, et lui restitue une prérogative plus générale de légitime défense. Une compréhension complexe de la légitime défense en droit international pourrait également être une manière de mieux scruter et interpréter les prétentions de certains mouvements insurgés à se réclamer de la souveraineté de l’Etat déchu, ou du droit à l’auto-détermination de leur peuple.
E. Articulation avec les efforts de la communauté internationale
Poser la question de la légitime défense, en outre, c’est aussi réfléchir aux conditions de son articulation avec les efforts entrepris par la communauté internationale. Or, par analogie notamment avec le régime de la légitime défense de l’Etat, les insurgés ne pourront sans doute se prévaloir d’une légitimité que pour autant non seulement que l’Etat n’est plus en mesure d’exercer son droit de légitime défense, mais également que le Conseil de sécurité n’est pas saisi activement de la question. Si ces limites ne sont pas si importantes qu’elles dussent aboutir à un 115 AMMOUN, supra (n50), p. 70. 116 Nicolas J. S. DAVIES, « From Nuremberg to Fallujah », 17, Peace Review: A Journal of Social Justice, p. 433.
29
déni du droit de résistance, elles ne sont pas non plus si négligeables qu’elles confèrent aux insurgés une carte blanche. Elles circonscrivent sans doute le droit à l’insurrection à des hypothèses assez réduites où une intervention du Conseil de sécurité n’est pas venue étayer la prétention de la communauté internationale à se saisir de la question, fut-ce dans des termes critiquables. Dans l’hypothèse irakienne, le droit de résistance serait suspendu selon cette conception au moment de l’adoption de la résolution 1483, c'est-à-dire au moment de l’implication de l’ONU dans la question. Au même titre, cependant, que certains Etats ont prétendu continuer d’exercer leur droit « inhérent » dans des situations où l’action de la communauté internationale était ineffective ou paralysée, il n’est pas exclu que la déliquescence des efforts internationaux ravive normativement les prétentions à une insurrection légitime. Suggèrerait-on par exemple, que le Fralintin timorais aurait dû cesser son action de guérilla contre l’occupant indonésien au motif que le Conseil de sécurité s’était mollement saisi de la question timoraise, sans que les efforts de ce dernier n’aboutissent à quoi que ce soit en 30 ans d’occupation ? Toutes choses égales par ailleurs, on voit également mal en quoi les efforts onusiens pour régler le sort des territoires palestiniens encore sous occupation depuis 1967 devraient avoir un effet paralysant sur toute forme de résistance à l’occupation. En outre, la question est posée de savoir ce que devrait être la réaction des populations occupées lorsque la communauté internationale semble renier les principes du jus ad bellum en consacrant le rôle de la Puissance occupante, malgré l’illégalité flagrante d’une invasion. A ce titre, une résolution comme la résolution 1483, en affirmant aussi le droit à l’auto-détermination des irakiens et la nécessité de rétablir leur souveraineté est porteuse d’une considérable ambiguïté. Elle semble mettre en garde la puissance occupante tout en renforçant son assise, si bien que tout échec significatif de l’occupant à rétablir la démocratie pourrait raviver la prétention d’une insurrection à la légitimité.
F. Exigences propres aux mouvements insurgés
Si insurrection légitime il doit y avoir, encore faut-il qu’elle ne soit pas conduite uniquement au nom de la résistance aux violations du jus ad bellum, mais également pour le bénéfice de la population occupée, ou alors l’objectif de rétablissement de l’ordre international se paierait par le sacrifice de l’auto-détermination. En d’autres termes, le fait de résister à une invasion illégale ne confère pas une légitimité univoque, si celle-ci ne peut s’appuyer sur d’autres éléments intrinsèques aux mouvements insurgés. Or d’un côté, l’idée d’auto-détermination a été abondamment récupérée par les puissances occupantes, notamment en Irak où l’invasion et l’occupation sont présentées comme permettant justement d’apporter la démocratie au Moyen-Orient, et où une telle prétention paraît indissociable de certaines menées hégémoniques. D’un autre côté, l’auto-détermination de conception westphalienne est rejetée par certains insurgés qui se réclament de la recherche d’une « communauté des croyants » islamique à l’opposé de la souveraineté classique, et profondément perturbatrice de l’ordre international. Il n’y a, en la matière, pas de réponse facile à la question de savoir ce qu’est une insurrection légitime, et le détour par la politique et la morale paraît inévitable, ainsi que par un certain nombre de considérations circonstancielles extrêmement sensibles. Mais le droit international à tout le moins pourrait ne pas être un obstacle à ce processus en simplifiant abusivement le problème, et serait dans son rôle naturel en fournissant des critères d’évaluation de légitimité de l’insurrection, au-delà de sa cause immédiate.
30
Premièrement, envisager que les « insurgés » puissent avoir une cause légitime, n’est, rappelons le, bien entendu nullement justifier de quelconques abus de l’usage de la force dont ils pourraient se rendre coupables. De même que l’on impose au comportement des Etats de maintenir une stricte dichotomie entre jus ad bellum et jus in bello, la légitimité de certaines résistances à l’occupation n’affranchit nullement ceux qui se réclament de cette lutte de respecter l’ensemble des exigences humanitaires à leur charge. C’est pourquoi on a insisté dans l’introduction à cet article sur le fait que notre exemple type était l’exemple d’un groupe ne commettant pas de violations graves du droit de la guerre ou des droits humains. Deuxièmement, un certain respect devrait être dû à la puissance occupante dans les premiers temps de l’occupation, au titre d’une sorte de présomption de bonne foi. L’idée d’une « transition humanitaire », en effet, est une des plus importantes idées léguées par le droit de l’occupation, et elle se fonde sur l’hypothèse pragmatique et réaliste qu’en situation d’après-conflit la puissance occupante sera souvent la plus à même d’imposer un minimum de stabilité et de sécurité. Il faudrait donc que la puissance occupante montre des signes clairs de ne pas s’acquitter de ses obligations avant qu’une insurrection puisse prétendre à une certaine légitimité. Par exemple, si la justification traditionnelle des pouvoirs de la Puissance occupante était la nécessité de garantir le bon déroulement humanitaire de l’occupation, alors la faillite humanitaire de celle-ci, en révélant que le « contrat implicite » était un marché de dupe, dégage aussi la voie normative de la résistance.117 La résistance à l’occupation serait également légitime si l’occupation était entachée d’un fort soupçon de vouloir aggraver une violation initiale du jus ad bellum par une occupation de conquête ou de colonisation. Enfin, si la volonté de créer les conditions minimales pour une transition démocratique dans un contexte où un retour en arrière n’est ni envisageable ni souhaitable paraît légitime, une insurrection le deviendrait à son tour dès lors que l’occupation compromet cet objectif (par la mise en place de structures incompatibles avec la démocratie, par exemple). On peut également imaginer qu’une occupation deviendrait particulièrement illégitime, outre son illégalité initiale, du fait qu’elle est prétexte à la prise de décisions de long terme (notamment en matière économique et d’exploitation des ressources) qui devraient revenir au souverain post-occupation,118 au point que se dessine une véritable menace néo-coloniale. Troisièmement, tout mouvement souhaitant invoquer un droit de résistance à l’occupation devrait être en mesure de présenter des gages crédibles de représentativité de la population dont il prétend défendre les intérêts. On éviterait ainsi que des groupes qui n’incarnent guère qu’eux-mêmes ne s’arrogent un rôle auquel ils ne sauraient prétendre. La pratique internationale, notamment de l’OUA, en matière de luttes de libération nationale peut être ici d’une certaine utilité pour traiter de questions d’occupation illégale.119 La reconnaissance internationale, même partielle, de certains groupes serait un facteur important pour établir leur autorité, comme ce fut le cas à la grande époque de la décolonisation. Ceci milite contre des formes d’insurrection trop fragmentées comme celle en Irak, même s’il n’est pas inconcevable que plusieurs groupes représentent un même « peuple ». Les principes de légitimité internationale et de légitimité
117 Pour ne prendre que l’exemple de l’Irak, on peut se demander si après les scandales d’Abu Ghraib et maintes autres exemples d’abus de l’usage de la force et de violations des droits, une insurrection de pure « protection humanitaire » ne pourrait pas être justifiée. Sur les violations par les Etats-Unis comme puissance occupante en Irak des obligations à leurs charge au titre du droit humanitaire, voir David J. SCHEFFER, « Beyond Occupation Law », 97, American Journal of International Law, 2003. 118 Dave WHYTE, « The Crimes of Neo-Liberal Rule in Occupied Iraq », 47, British Journal of Criminology, 2007. 119 Voir notamment le chapitre « National Liberation Movements as Representative Authorities » dans Heather A. WILSON, International law and the use of force by national liberation movements, Oxford University Press, USA, 1988).
31
interne peuvent néanmoins entrer en contradiction, comme c’est clairement le cas dans les territoires palestiniens où une élection a abouti à la désignation du Hamas comme le groupe représentatif à Gaza, alors que la communauté internationale apporte son soutien à l’autorité palestinienne. Enfin, il n’est pas nécessaire que les forces de résistance soient entièrement autochthones, mais on se méfierait de groupes composés entièrement d’étrangers, a fortiori s’ils ne sont pas là à l’invitation des mouvements de la résistance interne. Enfin, quatrièmement, le recours à la force devrait être un dernier recours, conditionnel à l’absence de toute possibilité de dialogue avec la puissance occupante, et en tout état de cause proportionnel à l’objectif de mettre un terme à l’occupation, voir d’en adoucir les effets. La gradation dans les moyens utilisés paraît ainsi révélatrice d’une logique mesurée de recours à laviolence, qui permettra de distinguer l’insurgé légitime du mouvement terroriste. Il s’agirait également que la force utilisée ait des chances d’atteindre ses buts et ne mette pas excessivement en danger, même indirectement, les populations civiles, On conçoit que relativement peu d’insurgés satisfassent à tous ces critères, et c’est peut être là en définitive un des meilleurs arguments pour une supervision de l’occupation dans certains cas par la communauté internationale. Certains cependant (on pense aux diverses formes de résistance à l’occupation de l’Europe pendant la Seconde guerre mondiale, la résistance à l’occupation du Timor par l’Indonésie, où les divers mouvements de résistance du sud-ouest africain) se sont historiquement rapprochés de cet idéal politique, humanitaire et démocratique. Il paraît quoiqu’il en soit important pour le droit international de se donner les moyens de poser ces questions cruciales, et qui pourraient le devenir plus encore.
Conclusion On a voulu dans cet article réfléchir à cette espèce apparemment en voie de disparition qu’est le résistant légitime. Si l’idée d’un droit d’insurrection semble avoir fait l’objet d’une reconnaissance croissante tout au long du XXème siècle, cette évolution reflète certainement plus l’issue de conflits particuliers et l’échiquier du pouvoir international (les Etats sont contre l’insurrection lorsqu’elle affecte leurs intérêts, et pour lorsqu’ils exaltent leurs passés de résistance) qu’un parti pris de long terme en faveur des acteurs non-étatiques, ou qu’une innovation radicale des théories de la mise en œuvre du droit international. L’évolution demeure fragile et problématique pour le droit international, et est susceptible d’être fortement contrariée par des évolutions en sens contraire, à commencer par un déclin relatif des proscriptions du jus ad bellum et une légitimation croissante de l’occupation « transformative ». En définitive, on croit pouvoir discerner, telle qu’elle transparaît à travers la problématique de l’occupation, une tension forte entre une théorie de l’ordre, focalisée sur la notion d’acteurs légitimes du droit international, une théorie de l’effectivité, fondée sur la réalisation des fins substantives du droit international, et une théorie de la justice, fondée sur une reconnaissance du droit de certains groupes à être les acteurs de leur devenir juridique. La question qui se pose à l’occasion d’événements comme l’occupation de l’Irak est de savoir si l’attachement du droit international à sa théorie des acteurs légitimes ne devrait pas à l’occasion laisser la place à une poursuite plus vigoureuse des objectifs que le droit international proclame, et une plus grande reconnaissance des acteurs susceptibles de les incarner. Or historiquement le droit international a toujours peiné à établir une soudure normative avec les phénomènes réels concourant à sa mise
32
en œuvre objective,120 et tend à se détourner de toute prétention qui remettrait par trop en cause sa théorie des acteurs légitimes. Que le droit international s’éloigne à l’époque actuelle d’une théorie forte de la résistance des acteurs non-étatiques est un fait avéré, mais on n’a peut pas assez réfléchi aux causes de cet éloignement, et notamment au rôle spécifique de la communauté internationale. Il faut à cet effet souligner un certain légitimisme de certains juristes internationaux (d’aucuns préféreront l’expression « pragmatisme »), qui semble s’accommoder du fait accompli devant lequel la mettent les puissances et dont elle avait pourtant un temps critiqué la gestation de manière véhémente. La grande difficulté à accorder aspirations et conséquences, la volonté de se prêter au jeu des consolidations de fait, et la tentation de résoudre les problèmes juridiques dans les termes posés par d’autres plutôt que de poser les questions juridiques « dérangeantes », participent tous d’une forme d’abdication du droit devant l’apparence de son dysfonctionnement. Le recours à divers subterfuges juridiques et le recyclage de l’illégalité en légalité renforcent ainsi d’un mouvement de défiance plus large envers le non-étatique et le politique au profit de l’étatique et de l’institutionnel qui est peut être une des meilleures manières de s’assurer que les nouveaux acteurs du droit international ne se reconnaîtront pas, in fine, dans un droit qui ne fut pas créé pour eux, ne s’intéresse à eux que pour autant qu’ils demeurent dans la passivité et justifie volontiers leur répression au nom d’une certaine vision de l’ordre. Le droit humanitaire a ici également sa part de responsabilité. Même auréolée de certains succès, l’humanitarisation de l’occupation fait également partie intégrante d’un système pragmatique relativement peu sanguin par rapport au danger fondamental que constitue l’usage illégal de la force, sans parler de l’injustice que représente le déni du droit à l’auto-détermination. Il n’est sans doute pas faux, dès lors, que l’humanitarisme ambiant, par son conservatisme, contribue en sous-main au maintien du fléau dont il entend par ailleurs minimiser l’impact. La conquête d’un espace humanitaire contre la kriegsraison se paie historiquement de la limitation de l’espace dévolu au politique, c'est-à-dire de l’esprit de résistance, et le droit international humanitaire encourt toujours le risque d’accoucher d’un idéal gestionnaire et pragmatique, déconnecté des visées plus vastes du droit international. Il est ironique à ce titre que la question de la résistance légitime en droit international, qui figurait pourtant de manière proéminente dans les discours des pères fondateurs du droit international et jusqu’au XIXème siècle, soit à ce point reléguée au second plan, à une époque où reconceptualiser le rôle des acteurs non-étatiques en droit international n’a jamais semblé aussi important. Le discrédit jeté sur la résistance est à ce titre indissociable de l’émergence de pouvoirs hégémoniques capables de dicter les termes normatifs de l’occupation et d’orienter le droit dans des directions qui leurs sont favorables.121 En réalité, le droit international semble désormais de plus en plus incapable d’appréhender la question de la violence des acteurs non étatiques autrement que sous l’angle de la violence criminelle, incarnée par la figure du terroriste. Pourtant, définir le terrorisme implique également et inévitablement de s’interroger sur la question de la violence légitime, qui n’en est que le revers. C’est peut être à défaut de s’être suffisamment interrogé sur cette problématique émancipatrice, que le droit international semble aujourd’hui condamné à reproduire certaines
120 Balakrishnan RAJAGOPAL, International law from below : development, social movements, and Third World
resistance, (Cambridge, U.K., Cambridge University Press, 2003). 121 Sur le concept de « hegemonic international law », voir Detlev F. VAGTS, « Hegemonic International Law », 95, American Journal of International Law, 2001.
33
impasses – sauf à penser que tout usage de la violence par un acteur non-étatique, même respectant le droit humanitaire, est terroriste, ce qui est faire le jeu du pire étatisme. C’est pourquoi il peut paraître utile de réfléchir de manière plus dynamiquement normative à l’évolution de ces enjeux. Il en va, incontestablement, d’un enjeu de principe majeur. Le renforcement de l’idée que les peuples se doivent d’être les artisans principaux de leur libération, chère à Mill, est un principe démocratique fort, et va au cœur de l’idée d’auto-détermination. L’idée défendue ici selon laquelle le droit de légitime défense peut dans certaines hypothèses passer aux mains de la population en cas de défaite du souverain, est plus profondément en accord avec une tradition de pensée démocratique qui voit le peuple comme étant le dépositaire de la souveraineté, et une tradition du « peuple en armes » qui voit la population comme la garante de celle de l’Etat. Enfin, il existe une affinité entre l’idée d’auto-détermination des peuples et celle de légitime défense, les deux se renforçant mutuellement et pouvant être perçues comme se recoupant en partie.122 En même temps, en reproduisant (quitte à le renouveler) l’étatisme du droit international classique et en risquant de fétichiser la souveraineté, l’idée d’auto-détermination est peut être à elle seule un prisme un peu faible pour comprendre la reconfiguration des multiples résistances à l’« empire ». Comme le faisait remarquer Vasuki Nesiah, « Today self-determination discourse is a terrain whose critical energies are spent—spent by a politics whose terms were limited to the nation-state; it has few resources to take on the more difficult internationalized politics of empire ».123 Il est possible dans ce contexte que les luttes contre l’occupation se distinguent assez peu de tout un ensemble de luttes contre l’oppression, dont l’occupation ne serait qu’une modalité, voir que l’oppression soit au moins pour partie déjà devenue celle d’un droit international fondamentalement déboussolé par trop d’unilatéralisme et de compromissions. L’urgence est peut être plutôt de concevoir une théorie plus « totale » du devenir (plutôt que de la seule mise en œuvre) du droit international qui prendrait en compte la contribution y-compris d’acteurs relativement non-autorisés dans la poursuite de ses buts. Notons qu’à une époque où certains des grands interdits du droit international semblent régulièrement floués, la contribution d’acteurs non-étatiques présente des gages de dynamisme indéniables. Peu de situations d’occupation notamment ont connu un terme sans l’assistance robuste de mouvement de résistance de l’intérieur, et les interventions réussies de la communauté internationale en la matière (libération du Koweit suite à l’invasion irakienne par exemple) restent l’exception, face aux libérations gagnées de haute lutte par leurs artisans non-étatiques (libérations nationales, Afghanistan, Timor). Face aux échecs répétés d’une régulation « par le haut » incarnée par l’ONU (en matière de lutte contre l’usage de la force mais aussi, même si ça n’est pas notre propos, de lutte contre la commission de crimes de masse), on peut se demander s’il n’est pas temps de réhabiliter la figure des peuples en lutte, rempart du pluralisme contre l’hégémonie. Quelles que soient les réserves que l’on puisse nourrir à l’égard de tel ou tel mouvement insurgé, en effet, il faut bien considérer qu’en désarmant les résistances de manière générale on rend peut être le droit international plus vulnérable à des entreprises hégémoniques de grande ampleur,
122 Michael Walzer ne va-t-il pas jusqu’à considérer que le fait d’être disposé à recourir à la force est ce qui caractérise un peuple méritant l’auto-détermination. Michael WALZER, Just and unjust wars, Basic Books New York, 1977). 123 Vasuki NESIAH, supra (n17), p. 918.
34
dont l’occupation post-belligérente serait un des outils de prédilection.124 Le renforcement de la réflexion sur la résistance légitime à l’occupation peut aussi renforcer l’assise démocratique du droit international et aider à en développer une vision « anti-hégémonique » en rappelant à ceux tentés d’imposer le changement par la force que le droit international, avec toutes les ambiguïtés qui le caractérisent parfois, n’a pas toujours eu une position aussi attentiste face à de telles entreprises. La défense d’une légitimation de la résistance aux occupations illégales, rappelons-le, fait historiquement figure de défense des Etats les plus faibles contre les plus puissants. Lors de la conférence de Bruxelles, en 1874, c’est notamment la Belgique, la Suisse et la Hollande, petits Etats ayant souffert des guerres napoléoniennes et pour lesquels la menace d’une insurrection, souvent fondée sur l’organisation de milices en temps de paix, constituait une sorte de dissuasion du faible au fort, qui plaidèrent pour une plus grande reconnaissance des francs tireurs. La garantie d’une lutte continue, même en cas de victoire militaire initiale éclatante, constitue une extraordinaire forme de dissuasion du faible au fort, peut être à certains égards un complément naturel et indispensable aux mécanismes de la sécurité collective. L’assistance apportée par les mouvements de résistance à la lutte contre les conséquences de l’illicéité est-elle un simple fait objectif auquel le droit international devrait s’intéresser pour des raisons purement scientifiques et historiographiques, ou est-elle un fait juridique qui doit aboutir à une reconnaissance concrète, au-delà de la perception d’une vague communauté d’objectifs? Certes, la problématique traditionnelle du « sujet », passe peut être à côté de la question clef qui serait plutôt, pour utiliser l’expression de Rosalind Higgins, celle des participants.125 Il n’est pas évident, cependant, qu’elle soit une panacée pour appréhender un phénomène aussi diffus que la résistance. En réalité, le droit international prend déjà position en faveur ou contre certains phénomènes, sans qu’il soit nécessaire de légiférer excessivement à leur endroit. On peut néanmoins tout à fait concevoir qu’il pourrait découler des obligations juridiques positives à la charge des Etats tiers et de la communauté internationale d’une plus grande reconnaissance des mouvements de résistance. Outre celle de ne pas concourir à l’occupation, on pense à une obligation ne pas concourir à la répression des insurgés, voir de ne pas par tout autre moyen s’opposer à leur exercice d’une légitime défense.126 En outre, comme l’avait déjà reconnu la résolution sur les relations amicales entre Etats, les mouvements insurgés réagissant à une mesure de coercition internationale sont « en droit de chercher et de recevoir un appui conforme aux buts et principes de la Charte ».127 Par ailleurs, des conséquences juridiques plus précises pourraient s’attacher à la personne des insurgés en matière de qualification d’éventuelles poursuites engagées contre eux, ou encore en matière de droit d’asile. Il est notamment évident que la question du sort qui doit être réservé aux insurgés en matière de justice transitionnelle dépend plus fondamentalement de leur statut en droit international, et de la capacité à les concevoir comme ayant eu un rôle non seulement
124 Calos L. YORDAN, supra (n69). 125 Rosalyn HIGGINS, « Conceptual Thinking about the Individual in International Law », 24 New York Law School Law Review, 1978. 126 Les Etats Unis et l’Union Soviétique étaient allés sensiblement plus loin dans leur défense de divers « peuples en lutte » pendant la Guerre froide, avec des motifs parfois loin d’être clairs. Il est néanmoins intéressant que certaines doctrines d’aide à la résistance à l’occupation (par exemple la résistance afghane) se soient directement appuyées sur le droit international. Pour un article assez révélateur sur les ambiguïtés de l’intervention « pro-démocratie », voir Jeane J. KIRKPATRICK and Allan GERSON, « The Reagan Doctrine, Human Rights, and International Law », Right v. Might: International Law and the Use of Force. 127 Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre Etats, Res. 2625 (XXV), 24 octobre 1970.
35
nationalement mais internationalement légitime. L’insurrection ne devrait être perçue que comme une menace à l’ordre humanitaire de l’occupant, et non pas comme entachée des stigmates du crime, ce qui milite indéniablement pour une politique d’amnistie une fois passée l’urgence humanitaire. Une telle politique peut, en définitive, s’analyser comme une sorte de compromis entre la réticence à reconnaître formellement la légitimité des résistances à l’occupation, et une nécessaire indulgence face à un comportement que l’on se refuse à condamner comme entièrement répréhensible. Il y aurait quoiqu’il en soit quelque chose de quelque peu tragique à ce qu’un système normatif se refuse à cautionner des forces dont l’activité pourrait pourtant concourir de manière majeure à ses objectifs. Une vision plus militante du droit international et de la défense de son projet humain ne verrait pas d’objection à ce que les acteurs non étatiques soient occasionnellement investis de la responsabilité de le mettre en œuvre, notamment lorsque tant d’autres institutions ou mécanismes ont failli, et qu’un tel rôle semble manifester au plus haut point l’idée d’auto-détermination auquel est censé aboutir la résistance. Il n’est pas interdit de penser, que certains groupes insurgés, lesquels dans la pratique n’attendront de toute façon pas d’avoir été « autorisés » par le droit international, pourraient d’une certaine manière incarner l’ultime facette du « dédoublement fonctionnel ». En ce faisant, ils renoueraient avec une forme de décentralisation qui fut longtemps la caractéristique principale de la mise en œuvre du droit international, à la différence près que cette décentralisation ne serait plus source d’anomie inter-étatique mais, dans le cadre d’une dialectique forte entre acteurs non-étatiques et communauté internationale, un vecteur d’intégration cimentant le projet international. Georges Scelle lui-même s’était prononcé lors de débats de l’Institut de Droit International fortement en faveur du droit des partisans qui peuvent être « … la seule ressource d’un gouvernement surpris par l’agression, obligé à l’exil, et pour un peuple la seule façon de défendre son existence et son droit à disposer de lui-même », une position contraire étant décrite comme s’écartant « de la conception profonde de la Charte, du Droit des Gens nouveau et même de la morale juridique ».128
128 Annuaire de l’IDI, 1957, II, p. 557-58.