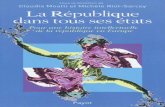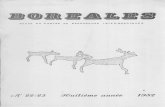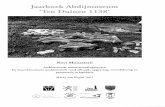Nouvelles recherches sur les demeures seigneuriales en Anjou XIIIe-XVe siècles
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of Nouvelles recherches sur les demeures seigneuriales en Anjou XIIIe-XVe siècles
Nouvelles recherches sur les demeures
Jean-Yves HUNOT - Emmanuel LITOUX
seigneuriales en Anjou XIIIe - XVe siècles
Patrimoine d'Anjou : études et travaux 4
NOUVELLES RECHERCHES SUR LES
DEMEURES SEIGNEURIALES EN ANJOU
XIIIe - XVe siècles
Jean-Yves HUNOT
Emmanuel LITOUX
Août 2010
Patrimoine d’Anjou - études et travaux 4
Première de couverture : Logis du Petit-Bitoir à Saint-Clément-de-la-PlaceQuatrième de couverture : Détail de la base du poinçon du logis de Longchamp à Miré
Département de Maine-et-LoireDirection des services scientifi ques du Patrimoine
Service de l’Archéologie114, rue de Frémur, 49000 Angers
Tél. 02 41 66 46 90Fax. 02 41 66 03 95
Jean-Yves HUNOT : [email protected]
Emmanuel LITOUX : [email protected]
Avertissements
Ce quatrième volume de la série « Patrimoine d’Anjou, études et travaux », intitulé Nouvelles recherches sur les demeures seigneuriales en Anjou (XIIIe-XVe siècles), s’inscrit dans le cadre d’un Field Seminar organisé en Anjou sous l’impulsion du Professeur Gwyn Meirion-Jones et de Pierre Garrigou Grandchamp, les 3, 4 et 5 septembre 2010. Il prolonge un premier séminaire de terrain qui s’était tenu en 2002 (G. Carré, E. Litoux, J.-Y. Hunot, Demeures seigneuriales en Anjou, XIIe-XVe siècles, Patrimoine d’Anjou : études et travaux 2, Service archéologique, Conseil général de Maine-et-Loire).
Il rassemble onze monographies d’importance variable en fonction des possibilités d’étude que nous avons eues. À l’exception de Longchamp à Miré, déjà évoqué en 2002, qui a bénéfi cié depuis d’une analyse plus approfondie et surtout de datations dendrochronologiques, les autres textes forment en l’état la première documentation mise à disposition des chercheurs préalablement à des travaux de synthèse.
Les textes, les relevés et les photographies présentés dans ce volume sont, sauf mention contraire, des auteurs. Nous tenons à signaler la forte implication de Gaël Carré dans l’étude, la réalisation des relevés et la préparation des textes des notices concernant les sites « Des Blouines » et de « Longchamp ». Qu’il trouve ici l’expression de notre gratitude pour son aide et sa collaboration.
Enfi n, nous tenons à remercier l’ensemble des propriétaires privés ou publics qui nous ont laissés librement accéder aux bâtiments pour les étudier. Nous leur sommes également reconnaissants d’avoir accepté d’ouvrir leur porte à l’ensemble de notre groupe parfois envahissant. Il faut souligner que ces lieux ne sont pas ordinairement ouverts au public à l’exception du château du Plessis-Macé, du manoir de Launay et du prieuré de Saint-Rémy-la-Varenne.
J.-Y. Hunot et E. Litoux
1
Baugé
Saumur
Angers
Cholet
segré
SOMMAIRE
SAINT-MARTIN-DU-BOIS - 32 rue du prieuré ............................ 3
CHÂTEAUNEUF-SUR-SARTHE - Manoir de La Vérouillère ............. 17
MIRÉ - Manoir de Longchamp ............................................ 23
MORANNES - Manoir de La Millasserie .................................. 31
CUON - Manoir de Vilbouvey ............................................ 33
BRION - Domaine des Blouines .......................................... 47
BOUZILLÉ - Château de La Bourgonnière .............................. 55
LE PLESSIS-MACÉ - Château ............................................. 73
SAINT-CLÉMENT-DE-LA-PLACE - Manoir du Petit Bitoir ............. 83
VILLEBERNIER - Manoir de Launay ..................................... 87
LE THOUREIL - Abbaye Saint-Maur de Glanfeuil - Logis «Plantagenêt» ..................................................... 93
Bibliographie ........................................................... 101
3
SAINT-MARTIN-DU-BOIS
32, RUE DU PRIEURÉ
Contexte de l’intervention
Cet édifi ce, visité dans le cadre d’une mission d’inventaire du patrimoine du Pays Segréen, nous a été signalé au début de l’été 2008 par C. Cussonneau et T. Pelloquet (Service départemental de l’Inventaire). Ces chercheurs avaient noté quelques éléments indiquant une structure ancienne et nous ont demandé une analyse plus détaillée pour tenter de restituer les dispositions originelles et d’approcher le statut et la datation de cet édifi ce dans le cadre des investigations préalables à la publication d’une « Image du Patrimoine » sur le Pays Segréen. La réfection du versant nord de la toiture au cours du mois d’août 2008, nous a fourni l’occasion d’accéder aux parties hautes de la charpente. Une analyse dendrochronologique des bois, rendue possible grâce à une subvention accordée par la Région des Pays-de-la-Loire, a été réalisée par Y. Le Digol de Dendrotech.
Présentation
Saint-Martin-du-Bois est un petit bourg situé à à 9 km au nord du Lion-d’Angers et à 5 km à l’ouest de la Mayenne. Le bâtiment sis au 32 rue du prieuré est implanté sur le bord de l’ancienne route partant du bourg de Saint-Martin-du-Bois pour rejoindre Le Lion-d’Angers. Il est actuellement localisé en limite de la zone urbanisée, à 600 m du centre paroissial. Toutefois, tant la composition de l’environnement bâti constitué essentiellement d’édifi ces récents (XIXe et XXe siècle) que l’absence de constructions anciennes autour du manoir permettent de supposer que son implantation s’est faite dans un contexte rural. Il ne semble avoir été rejoint par l’extension du village qu’au tournant des XVIIIe et XIXe siècles ; les plans cadastraux anciens, dressés en 1826, montrent qu’il s’agit alors sur cette route du bâtiment le plus éloigné du bourg.
Description du bâtiment
Le bâtiment se présente sous la forme d’un grand édifi ce de plan trapézoïdal assez compact constitué d’un volume central à étage contre lequel prennent appui deux bas-côtés. La structure à ossature bois a vu ses façades extérieures progressivement remplacées par des élévations en pierre.
La façade antérieure, orientée à l’est1, est implantée parallèlement à la rue. Elle présente dans l’axe trois baies superposées, deux fenêtres à meneau et traverse2 et un petit jour rectangulaire. Sur la droite se trouve une porte surmontée d’un arc en accolade et d’une niche à décor de fl euron. Des différences sensibles dans le traitement des moulurations posent la question de la contemporanéité de l’ensemble. Si la porte se rattache à une tradition gothique fl amboyante qui perdure jusque dans les premières décennies du XVIe siècle, la modénature des croisées suggère une datation sensiblement plus tardive. La présence d’enduits intérieurs et extérieurs empêche de pouvoir restituer l’histoire de la façade qui, en l’état, ne comporte aucun élément antérieur au xve siècle. L’ensemble est surmonté d’un gable de charpente sommé d’une demi-croupe. Des boulins à pigeons était aménagés en partie haute du pignon de part et d’autre de la petite baie3.
Les parties latérales de la façade sur rue, les murs gouttereaux ainsi que la façade arrière comportent des ouvertures de facture beaucoup plus récente qui montrent que le remplacement des élévations extérieures en pan de bois par des
1 Afi n d’alléger la description, les orientations ont été ramenées sur les principaux points cardinaux.2 La fenêtre du rez-de-chaussée, refaite à l’Époque contemporaine, a perdu son meneau et sa traverse mais conserve ses pierres d’encadrement moulurées analogues à celles de la croisée de l’étage.3 Une carte postale du début du XXe siècle les montre ainsi que quelques reprisess dans les maçonneries
4
P A T R I M O I N E D ’ A N J O U : É T U D E S E T T R A V A U X 4
murs de pierre s’est fait de façon progressive, sans doute dans le courant du XIXe siècle pour les gouttereaux mais seulement au milieu du XXe siècle pour la façade arrière. Ces modifi cations apportées aux bas-côtés ont également entraîné la disparition de leurs anciennes charpentes de couverture. Les fermes actuelles, à arbalétrier et panne soulagés par une contrefi che, montrent de nombreuses variantes qui traduisent une réalisation en plusieurs tranches, confortant l’hypothèse selon laquelle la reconstruction des bas-côtés s’est faite en plusieurs temps.
Les conditions d’accès et d’étude4
Le rez-de-chaussée abrite les pièces d’habitation actuelles. Des réaménagements récents occultent une bonne partie de la structure porteuse. Néanmoins, dans le bas-côté sud, à usage de dépendance, une partie des dispositions anciennes a pu être observée. À l’étage, la moitié ouest du volume central était
4 Les auteurs tiennent à remercier les propriétaires, M. et Mme Guérineau, pour leur avoir systématiquement facilité l’accès aux différentes parties du bâtiment.
aménagée lors de notre visite ; en revanche, la partie orientale et les combles du bas-côté nord, utilisés comme grenier, ont permis une bonne lecture de la structure ancienne du bâtiment. La réfection du versant nord de la toiture a fourni l’occasion d’une part d’accéder aux parties hautes masquées par les cloisonnements récents et d’autre part de procéder aux prélèvements par carottage pour la dendrochronologie, dans des endroits restant peu visibles.
La structure du bâtiment
Le toit en bâtière (50°) est prolongé par deux bas-côtés couverts en appentis présentant une pente nettement plus faible (29° au sud contre 27° au nord). Une demi-croupe forme l’extrémité du vaisseau central côté rue (extrémité est) au-dessus d’un gable tronqué. La façade postérieure présente un pignon couvert avec une couverture légèrement débordante. En l’état, il ne subsiste aucun élément d’un éventuel gable.
Le bâtiment se caractérise par une structure à nef centrale et bas-côtés en appentis. Deux portiques avec poteaux montant de fond, supportant chacun une ferme de comble,
Extrait du plan cadastral napoléonien de Saint-Martin-du-Bois, section C, feuille 2, ADML 3P4/318/10.
5
S A I N T - M A R T I N - D U - B O I S - 3 2 , R U E D U P R I E U R É
structurent le volume dans le plan transversal. Suivant les endroits, des murs de maçonnerie et des panneaux à ossature bois remplissent les espaces entre les poteaux. Du pan de bois se retrouve également en partie haute du refend. Ces deux portiques, encadrés par les pignons, dessinent trois travées de dimensions différentes. L’orientation biaise de la façade orientale crée une première travée dont la largeur varie entre 3,4 m et 5,2 m. Toutefois, la largeur de 4,4 m,
relevée au milieu, est proche de la suivante dont l’entraxe mesure 4,6 m. La troisième travée, à l’ouest, est plus longue avec 5,3 m.
Les poteaux de forte section (37 x 27 cm) reposent sur des dés de pierre aujourd’hui noyés dans le sol de la partie centrale du logis. À 2,35 m au-dessus du sol actuel (soit 2,75 m du sol ancien restitué), des retraits de 8 cm ménagés sur le côté des poteaux servent de support aux poutres de plancher (37 x 37 cm) dont les
0 10 m
Plan de l’étage.
6
P A T R I M O I N E D ’ A N J O U : É T U D E S E T T R A V A U X 4
Vue d’ensemble de la façade antérieure, côté rue (cliché B. Rousseau, Inventaire, Département de Maine-et-Loire).
Détail de la porte (cliché B. Rousseau, Inventaire, Département de Maine-et-Loire).
7
S A I N T - M A R T I N - D U - B O I S - 3 2 , R U E D U P R I E U R É
arrêtes inférieures sont chanfreinées. À chaque extrémité, un petit aisselier, appuyé sur un talon de 2 cm, en limite la portée qui se réduit ainsi de 6,3 à 5,3 m. Le solivage porte directement sur les poutres, sans assemblage ; les solives anciennes, de section légèrement rectangulaire (12 x 16 cm), sont posées à plat. Les entraits des deux fermes forment le sommet des portiques. Les éléments visibles montrent une forte similitude entre les deux portiques.
Les parois en pan de bois ne subsistent qu’à l’étage dans les deux travées ouest de la paroi nord et dans la travée centrale, côté sud5. Des colombes réparties tous les 0,8 m et raidies dans le plan longitudinal par des écharpes, se trouvent bloquées entre une sablière basse, positionnée au niveau du solivage, et une sablière haute assemblée au sommet des poteaux. Sablières
5 Dans la travée orientale, la mise en place de deux cheminées au XIXe siècle ou au début du XXe siècle, a entraîné la disparition complète des parois en pan de bois, sur les deux niveaux. Au rez-de-chaussée, la présence de doublages empêche de savoir si d’éventuels vestiges de pan de bois existent encore.
et écharpes des parois longitudinales viennent s’assembler à tenon et mortaise dans les faces latérales des poteaux. Les espaces entre colombes ont été garnis de barreaux de terrasse en chêne fendu entourés d’un mélange de terre et de paille. Les panneaux à ossature bois s’alignent sur le nu «extérieur» des poteaux et des sablières. Un enduit à base de mortier de chaux assure la fi nition en venant affl eurer avec la face latérale des bois qui restent visibles. Des variations dans la couleur du garnissage et l’absence d’enduit de fi nition permettent d’identifi er assez facilement les reprises.
Contrairement aux autres maçonneries qui correspondent à des remaniements, le mur de moellons remplissant la travée occidentale du mur sud du volume central semble contemporain de l’ossature en bois. Large de 0,55 m, il conserve sur sa face
sud les traces d’arrachement d’une large hotte pyramidale permettant de restituer une cheminée dans le bas-côté6. Au revers du mur, du côté du volume central, les transformations récentes interdisent toute observation. Cependant, le volume masqué par les doublages dépassant un mètre d’épaisseur sur presque quatre mètres de long, il est tentant de restituer une cheminée au rez-de-chaussée. Par ailleurs, il serait surprenant que la présence de ce pan de maçonnerie n’ait pas été mise à profi t pour installer une cheminée équipant l’étage, et prévenir ainsi des risques d’incendie.
La charpente de couverture
La charpente à fermes et à pannes conserve deux fermes d’allure et de fonction différentes. La ferme orientale est constituée
6 La hotte mesure au maximum 2,65 m de largeur. Le manteau et toute la partie inférieure ont été détruits par des aménagements postérieurs.
Poteau sud de la ferme est, vue depuis l’ap-pentis sud (cliché B. Rousseau, Inventaire, Département de Maine-et-Loire).
8
P A T R I M O I N E D ’ A N J O U : É T U D E S E T T R A V A U X 4
d’un entrait et d’un poinçon taillés dans des bois de section carrée, avec chanfreins et bagues, et de deux arbalétriers de section rectangulaire. Deux pièces courbes faisant fonction de faux entrait et d’aisselier prolongent les jambettes pour dessiner un intrados en demi-cercle. La position très avancée des jambettes, entraînant une charge sur l’entrait, justifi e la présence des aisseliers assemblés sur le poteau, selon des dispositions proches de celles déjà décrites pour le plancher. Le traitement de cette ferme, manifestement destinée à rester visible, incite à restituer dans les deux travées orientales une pièce de 58,5 m² montant sous charpente.
La ferme occidentale comporte également un entrait, un poinçon et deux arbalétriers mais les bois ne montrent aucune fi nition particulière (chanfrein, bague ou courbure). Deux potelets ou tournisses placés de part et d’autre du poinçon servent de support aux barreaux de terrasse entourés d’un mélange de terre et de paille. Des mortaises, réparties environ tous les 0,8 m en sous-face de l’entrait non chanfreiné, attestent la présence d’une cloison sur toute la hauteur du premier étage. Il ne subsiste de cette partition que deux aisseliers et un poteau d’huisserie sur lequel s’assemble un linteau. Ces éléments permettent de restituer une porte large de 1,1 m ouvrant vers la pièce orientale d’après
Ouest Est
0 5 m
Travée centrale, coupe longitudinale de l’étage carré et du comble.
9
S A I N T - M A R T I N - D U - B O I S - 3 2 , R U E D U P R I E U R É
l’emplacement de la feuillure. Une mortaise placée 0,65 m au-dessus du sol ancien sur la face ouest du poteau suggère de restituer la rampe d’un escalier qui aurait assuré la communication entre les deux niveaux. Au rez-de-chaussée, le plafond moderne qui masque le solivage du plancher empêche de vérifi er la présence d’une trémie qui viendrait confi rmer l’hypothèse de l’escalier. De la même façon, le coffrage de la poutre située au droit de la cloison interdit de se prononcer sur l’existence, plausible, d’une partition au rez-de-chaussée.
Dans le sens longitudinal, les panneaux à ossature bois séparant la partie centrale des bas-côtés participent au maintien des poteaux. Au niveau de la charpente, une faitière, renforcée par des liens et dont les abouts sont pris dans les maçonneries, limite le déversement les fermes. Il est à noter que les liens associés à la ferme orientale présentent un profi l légèrement courbe, alors qu’ils sont rectilignes au contact de l’autre ferme.
Un seul cours de panne sur chaque versant reprend la charge des couples de chevrons. Ces pannes sont maintenues en place, non pas par une classique échantignole, mais par une simple cheville renforcée insérée dans l’arbalétrier.
Le marquage des pièces de bois n’a été observé que partiellement, en fonction des possibilités d’accès, mais la cohérence de l’ensemble en permet la compréhension. Les poteaux des fermes orientale et occidentale portent respectivement la marque 2 (II) et 3 (III) sur la face «extérieure». Pour le contreventement, le sens du marquage des liens est inverse puisqu’il débute à l’ouest ; pour les parties conservées, les marques de 4 à 7 subsistent, soulignées par un petit cercle. Une troisième série de marques a été observée pour les couples de chevrons. Ils portent à la base, sur leur face ouest, un marquage qui va d’ouest en est, de 4 à 26, et qui se caractérise par un 5 prenant l’aspect d’une croche. Ce marquage, à l’aide d’au moins trois séries de numérotation, est à relier à l’ordre de levage. Après avoir dressé les poteaux et les parois en ossature bois des deux étages carrés, les entraits sont mis en place car ils participent au maintien de la cage. Sur cette base, les poinçons sont érigés avec la faîtière et ses liens. Les arbalétriers, les aisseliers , les jamettes et les pannes sont alors assemblés sur cette arête longitudinale, ce qui permet enfi n la pose des couples de chevrons.
L’intérêt du marquage des chevrons répond d’une part au plan trapézoïdal du bâtiment et d’autre part à la mise en place du chevronnage de la charpente des appentis. Les
Poteau nord de la ferme ouest et pan de bois longitudinal avec son hourdis de terre recouvert de son enduit au mortier de chaux médiéval.
10
P A T R I M O I N E D ’ A N J O U : É T U D E S E T T R A V A U X 4
05
m
sud
Nor
d
Coupe sud-nord du logis au droit de la ferme est.
11
S A I N T - M A R T I N - D U - B O I S - 3 2 , R U E D U P R I E U R É
chevrons des bas-côtés disposaient d’une coupe en siffl et à l’extrémité haute rendant possible leur fi xation à l’aide d’une cheville sur la base de ceux du volume central. La charpente des deux appentis peut être restituée à partir des mortaises subsistantes sur les poteaux. Cette structure simple se composait d’arbalétriers soulagés par des liens assemblés aux poteaux du volume central. La partie basse des arbalétriers devait s’insérer dans les poteaux de la paroi extérieure. Cette charpente ne comportait apparemment pas d’entrait, libérant ainsi un volume plus important. Sur le plan structurel, il paraîtrait logique de restituer un lien entre l’arbalétrier et
le poteau extérieur mais aucun élément ne vient actuellement le confi rmer.
Cette charpente est uniquement constituée de chêne à feuillage caduc. Après un abattage effectué au cours du repos végétatif (octobre-février), les arbres ont été équarris à la hache. Si les plus grosses pièces sont des bois de brin (un arbre = une pièce), les autres proviennent d’un débitage à la scie. Les arbalétriers de section rectangulaire ont été obtenus par le sciage manuel en long d’une grume en deux parties égales. Les chevrons sont issus de la division en quatre des billes de chêne. Pour les colombes
0 1 m
AB
0 1 m
C
Détails de la ferme est, A : base du poinçon, B : sommet du poteau et base de la ferme, C : base des chevrons sur la sablière haute des cloisons en pan de bois.
12
P A T R I M O I N E D ’ A N J O U : É T U D E S E T T R A V A U X 4
sud Nord
0 5 m
Ferme ouest avec restitution de la cloison de l’étage. Celle du rez-de-chaussée reste hypothétique.
Partie haute du poinçon de la ferme est avec la jonction des aisseliers de la ferme et les liens
de contreventement longitudinal (cliché B.
Rousseau, Inventaire, Département de Maine-
et-Loire).
13
S A I N T - M A R T I N - D U - B O I S - 3 2 , R U E D U P R I E U R É
des parois, le débitage est plus important et variable (grumes divisées en plus de 4 pièces) pour obtenir des sections de 9 x 12 cm.
Dix-sept échantillons ont été prélevés par carottage sur les parties hautes de la charpente du volume central pour réaliser une analyse dendrochronologique. Une chronologie de 86 ans a pu être corrélée sur plusieurs référentiels, permettant de dater l’abattage de bois après 1387[d. Toutefois, au regard du nombre de cernes d’aubier7 conservés et malgré l’absence du cambium8, il est possible de proposer une fourchette chronologique pour la coupe des arbres entre [1387 et 1389[d. La mise en œuvre s’est faite immédiatement après l’abattage, avec des bois non séchés, probablement entre 1388 et 1390.
Ainsi qu’il a été dit plus haut, les pignons en maçonnerie correspondent à des modifi cations de la structure primitive. Les sablières hautes des pans de bois conservent les mortaises correspondant aux liens et aux poteaux des deux pignons originels en ossature de bois. Un lien se trouve encore en place dans l’angle nord-ouest du volume central. Sur le pignon
7 Partie extérieure du bois où circule la sève.8 Assise de multiplication cellulaire entre le bois et l’écorce.
ouest, les mortaises des poteaux sont visibles à l’extérieur du bâtiment tandis qu’à l’est, les traces d’assemblages se trouvent au nu intérieur de la maçonnerie. Côté rue, il est intéressant de noter que les sablières de la charpente du comble se poursuivent au-delà du nu intérieur du pignon pour supporter deux couples de chevrons dont celui formant le gable visible en avant de l’actuelle façade antérieure. Sur le pignon opposé, le marquage des couples de chevrons débutant à 4 permet de restituer une disposition équivalente avec un couple de chevrons au droit des poteaux et deux autres couples de chevrons formant un débord de toiture.
Ferme cloison ouest avec son hourdis conservé dans le comble perdu actuel.
14
P A T R I M O I N E D ’ A N J O U : É T U D E S E T T R A V A U X 4
05
m
sud
Nor
d
Coupe transversale avec restitution des disposi-tions médiévales.
15
S A I N T - M A R T I N - D U - B O I S - 3 2 , R U E D U P R I E U R É
Synthèse et comparaisons
Malgré les modifi cations apportées au bâtiment, il reste possible de restituer l’essentiel de la structure charpentée dans son état originel daté de la fi n du XIVe siècle. L’édifi ce a été conçu dès le départ sur plan trapézoïdal ainsi que l’atteste la position des poteaux de la façade antérieure. L’ossature bois comportait 4 portiques – dont deux formant les pignons – reliés par des parois constituées de colombes assemblées entre les sablières. La cohérence de la numérotation des pièces de charpente indique que le bâtiment n’a pas été tronqué dans le sens de la longueur. Le vaisseau central, assez bien conservé, comprend deux niveaux superposés séparés par un plancher intermédiaire dont les poutres viennent s’assembler sur les poteaux des portiques. Des bas-côtés en pan de bois, à un seul niveau, s’adossaient au nord et au sud contre le grand volume central. La charpente en bâtière a été conçue pour rester visible depuis l’étage. Seules les 2 fermes centrales sont encore en place ; les différences de traitement s’expliquent par le rôle qu’elles jouent dans la différenciation des espaces. La ferme occidentale est organisée de façon à constituer une partition. La ferme orientale qui a fait l’objet d’un traitement beaucoup plus soigné avec des pièces courbes dessinant un cintre et un entrait chanfreiné sculpté de bagues, était de toute évidence destinée à rester apparente.
L’absence de sources écrites renseignant l’histoire de l’édifi ce et de ses habitants contraint à se tourner vers le traitement architectural du bâtiment pour tenter d’en déterminer le statut. La volumétrie de l’édifi ce, la présence d’équipements tels que des cheminées (au moins une dans le bas-côté sud mais sans doute plus), le soin apporté à la réalisation des structures charpentées supposent des moyens fi nanciers réservés à une certaine élite, noble ou apparentée. Du fait du contexte rural dans lequel s’inscrit ce grand corps de logis, du fait également des rapprochements qui peuvent être établis avec de nombreux autres édifi ces, la qualifi cation de manoir semble pouvoir être retenue.
Comme souvent, l’exercice de restitution des fonctions des différents espaces trouve rapidement ses limites. La question d’une
éventuelle partition au rez-de-chaussée, à l’aplomb de celle de l’étage, reste posée. Le départ d’un escalier à partir d’une chambre et une salle basse apparaît peu probable9. La présence d’autres cloisons à ce niveau poserait des problèmes d’éclairage car les seules sources de lumière naturelle se trouvent au niveau des murs pignons. Le mode de communication entre le volume central et les deux bas-côtés nous échappe complètement. La présence avérée d’une cheminée dans l’appentis sud désigne cet espace comme une pièce de vie. Son emplacement à l’extrémité ouest rend vraisemblable l’existence de cloisonnements scindant le volume de ce bas-côté. Un escalier intérieur semble avoir donné accès à la grande pièce du premier étage, que tout désigne comme la salle du manoir. L’hypothèse d’un autre accès à partir d’un escalier extérieur adossé à la façade orientale ne saurait être exclue, bien qu’aucun vestige matériel ne vienne l’appuyer. À l’étage, le positionnement de la cloison au tiers de la longueur correspond à des dispositions récurrentes dans les manoirs des XIVe et XVe siècles pour établir une séparation entre la salle et la chambre. Pour étayer cette hypothèse, il faudrait lever l’incertitude qui pèse sur l’existence – probable mais non démontrée – d’un plancher dans la partie ouest du volume central.
Par sa volumétrie extérieure, cet édifi ce se rattache à un type architectural bien identifi é : les manoirs à salle basse sous charpente avec appentis. De nombreux exemples ont été identifi és ces dernières années en Anjou10 mais surtout dans le Maine11 ; la majorité d’entre eux datent de la fi n du XIIe ou du XIVe siècle. En revanche, le fait que le volume central comprenne un étage constitue un unicum ; si l’on excepte le manoir de Clairefontaine qui superpose trois niveaux,
9 Du fait de la présence de bas-côtés, une fonction purement domestique du rez-de-chausseé de la nef centrale reste peu probable. 10 Les Vaux à Daumeray (2e quart du XIVe siècle), La Gortaie à Louvaines [1303-1304], Longchamp à Miré [1341-1342]. La forteresse de Berrie constitue un cas particulier lié à l’implantation d’une salle «basse» au XIVe siècle sur les restes d’un bâtiment antérieur (Carré et al. 2002).11 Manoirs de La Grande Courbe à Brée (logis du XIIIe siècle), de La Perrière à Voivres-lès-le-Mans (2e moitié du XIIIe siècle), de bois Richard à Vivoin (XIIIe-XIVe siècles), prieuré de Moullins à Saint-Rémy-du-Val (XIVe siècle).
16
P A T R I M O I N E D ’ A N J O U : É T U D E S E T T R A V A U X 4
tous les exemples connus de logis à l’étage ne comportent au mieux qu’un seul appentis adossé à un gouttereau12, comme si l’augmentation de la surface offerte par le volume central réduisait les besoins d’édifi er des bas-côtés pour héberger des espaces annexes. Cette évolution doit peut-être également se rattacher à un glissement du positionnement de la porte principale des logis qui, au XIVe siècle, occupe de plus en plus souvent un mur gouttereau dans lequel il devient possible d’ouvrir un plus grand nombre de fenêtres.
La seconde particularité du manoir de Saint-Martin-du-Bois est le très large recours au pan de bois. La présence de poteau de bois formant la structure a été observée au manoir des Vaux (Daumeray, 49, datation CNRS-Besançon [1328-1347[), mais la charpente à chevrons porteurs est d’une conception très différente (Carré et al. 2002). Des exemples plus récents de charpente sur portiques ont été reconnus dans l’architecture civile en Anjou dans la vallée de la Loire (manoir du Grand Boust et logis de la Cour Baudry à Longué-Jumelles), dans le sud de l’Indre-et-Loire (Bardisa et al. 1995), dans le sud-est de la Mayenne (Davy et Foisneau 2006), mais là encore, le type de charpente de comble qui est employé sur ces charpentes est différent. En revanche, le modèle de cette charpente à pannes est proche de celui récemment étudié à Longchamp, bien que dans ce dernier cas, la structure repose sur des maçonneries (Miré, 49, [1341-1342]) (Carré et al. 2002). La forme des fermes est très proche et présente par ailleurs la même différence de traitement. Mais le plus grand nombre de structures du type de celles de Saint-Martin-du-Bois se trouve en Bretagne, particulièrement sur les manoirs où ont été signalées de nombreuses charpentes à fermes et à pannes avec des arbalétriers rectangulaires, un intrados courbe et une partition spatiale soulignée par les fermes (Douard 1993). Les plus anciens exemples apparaissent au XIVe siècle mais la majorité des cas semblent dater du XVe siècle. Ce modèle va évoluer au cours de l’Époque moderne en se simplifi ant. Au XVe siècle, l’aire d’extension de ce type, qualifi é d’anglo-breton
12 Manoirs de La Cour à Asnières-sur-Vègre (1293-1295), de La Grande Courbe à Brée (logis du XIVe siècle), de La Roche Abilen à Saint-Georges-du-Bois (fi n du XIVe-début du XVe siècle).
par Alain Delaval, s’étend jusqu’en Mayenne et dans l’actuelle Sarthe, aux confi ns du Massif armoricain. Vers le sud, la Loire constitue une limite rarement dépassée. Dans la partie ouest du Poitou et la Vendée jusqu’à Bordeaux, un type adapté à la tuile canal a été employé aux XVIe et XVIIe siècles. En Maine-et-Loire, la chapelle de Sousigné (Martigné-Briand) constitue l’exemple le plus extérieur à l’aire de répartition mais tout à fait proche dans sa structure de la charpente du 32 rue du Prieuré à Saint-Martin-du-Bois. L’ordre de montage débutant par le contreventement longitudinal est proche de celui observé sur deux autres charpentes dont celle du prieuré du Lion-d’Angers (XIVe siècle) et celle de La chapelle Saint-Bibien à Échemiré [1376-1393[d. Tous les points de comparaison connus à ce jour conduisent à rapprocher le site de Saint-Martin-du-Bois d’exemples armoricains.
17
CHÂTEAUNEUF-SUR-SARTHE
MANOIR DE LA VÉROUILLÈRE
Le manoir de la Vérouillère est installé sur les hauteurs (42 m NGF) dominant l’ancienne ville fortifi ée de Châteauneuf-sur-Sarthe, à 1 km à l’ouest de la Sarthe. Ce fi ef implanté sur plusieurs paroisses est attesté avec certitude dès 1383, date à la quelle il appartient à Robin Le Roy. Toutefois cette famille est présente à Châteauneuf depuis longtemps puisque qu’un autre Robin Le Roy fut inhumé dans l’église Saint-André de Châteauneuf (aujourd’hui disparue) en 1209. Le manoir reste dans la même famille jusqu’au XVIIe siècle. En 1584, un aveu rendu à la seigneurie de Briollay décrit le «manoir et maison seigneuriale» ; le document énumère trois grands corps de logis habitables, des granges, un pressoir, un grand portail et une cour ; l’ensemble était clos de murailles et de
grands fossés. En 1675, le domaine est détenu par la famille Jallet qui le conservera jusqu’à la Révolution. Le déclassement du logis en ferme fait suite à la construction en 1831 d’un nouveau château. Dans le dernier tiers du XIXe siècle, une ferme modèle en brique et tuffeau est établie à proximité de l’ancien manoir. L’ensemble a aujourd’hui perdu toute dimension agricole ; d’importantes restaurations ont été engagées depuis le milieu des années 1980 sur le corps de logis qui est maintenant entièrement dédié à la fonction résidentielle.
Le manoir a été repéré en 2002 par Gaël Carré et Thierry Pelloquet, dans le cadre de l’Inventaire du canton de Châteauneuf-sur-Sarthe.
Extrait du cadastre ancien de 1827, section B (ADML 3P4/085/005).
18
P A T R I M O I N E D ’ A N J O U : É T U D E S E T T R A V A U X 4
L’ensemble des bâtiments délimite une cour carrée accessible par un portail situé à l’ouest. Toute la partie orientale de l’aile nord couverte par une charpente attribuable à la seconde moitié du XVe siècle ou au XVIe siècle, semble conserver une volumétrie médiévale, cependant en bonne partie occultée par les remaniements et les restaurations. L’archaïsme de certains traits architecturaux, en particulier le traitement des deux portes en plein cintre du rez-de-chaussée, sur les murs nord et ouest, indiquent très clairement l’existence d’un noyau ancien dont la datation serait comprise entre le XIIe et le XIVe siècle. L’étendue de ce bâtiment primitif ne peut être précisée.
L’étude s’est concentrée sur une petite salle non encore restaurée, située au premier étage dans la partie ouest du manoir médiéval. Cette partie de l’aile nord actuelle est accessible par une vis hors-œuvre. La pièce, montant sous charpente, mesure 5,95 m de large pour 7,3 m de long dans-œuvre. Elle prend le jour côté sud
par une fenêtre à croisée (meneau et traverse à simples chanfreins plats et larges ; les huisseries, portées par des gonds directement scellés dans la pierre, étaient bloquées en position fermée par deux colombes). Le rehaussement du plancher d’environ 0,6 m interdit de se prononcer sur la présence de coussièges. Le mur de refend ouest conserve les traces d’une cheminée jouxtée par un double placard mural (réinséré). Le mur gouttereau nord a été percé de trois portes qui ont toutes fonctionné avec le niveau de sol ancien ; seule la porte ouest a été adaptée au rehaussement du plancher.
La charpente étudiée est une structure à chevrons-porteurs tramée comportant 3 fermes principales et 8 fermes secondaires1. La ferme principale orientale est une ferme cloison sans
1 Les fermes principales sont numérotées de 1 à 3 d’est en ouest. La ferme-cloison porte la marque 1. Les fermes secondaires sont marquées en sous-face des chevrons et des faux entraits du versant nord de l’est vers l’ouest.
0 5 m
Plan de la partie étudiée du logis médiéval.
19
C H Â T E A U N E U F - S U R - S A R T H E - M A N O I R D E L A V É R O U I L L È R E
0 5 m
Sud Nord
0 5 m
Fermes principale et secondaire de la charpente.
Vue générale de la charpente vers le nord-ouest du bâtiment médiéval.
20
P A T R I M O I N E D ’ A N J O U : É T U D E S E T T R A V A U X 4
prolongement vers l’est. À l’ouest, le décalage de près d’1 m entre la ferme principale et le mur de refend s’explique par la présence de l’ancienne cheminée, aujourd’hui déposée, dont ne subsiste que le renfoncement du foyer et du conduit.
Les fermes principales, très sobres se composent d’un entrait, d’un poinçon de fond, d’un couple de chevrons et d’un faux entrait en deux parties. Le tout prend appui sur le mur par l’intermédiaire d’une sablière unique. Les entraits et la partie inférieure du poinçon sont délardés et les chanfreins se terminent par des congés très variables : de la presque absence à celui allongé et courbe ou droit. Les fermes secondaires présentent une structure encore plus simple avec un couple de chevron raidi par un faux entrait.
Le contreventement longitudinal avec faîtage et sous faîtage est renforcé d’une croix de Saint-André par travée. Le charpentier n’a pas prévu de liaison entre le sous-faîtage et les faux entraits des fermes secondaires.
Des trous de cheville dans la partie basse de plusieurs chevrons du versant nord
permettent de restituer un appentis ou une galerie d’au moins 3,8 m de long2. Ce type de mise en œuvre, observé au manoir du début du XIVe siècle de la Gortaie à Louvaines (49) suggère un aménagement contemporain de la charpente. De la même façon les chevrons des deux appentis du manoir en pan de bois du 32 rue du Prieuré à Saint-Martin-du-bois sont, lors de la construction vers 1387-1389, chevillés à la base de ceux du volume central.
Aucun indice fi able ne permet de penser que cette charpente fut un jour lambrissée ou hourdée. Les occupants médiévaux de cette pièce devaient évoluer dans un volume proche de l’actuel. En revanche les éléments de la ferme-cloison montrent que les colombes de bois recevaient un hourdis constitué de fusées garnies d’un mélange de terre et de végétaux recouvert ensuite d’enduit.
L’ensemble de la charpente n’est fait que de bois de brin qui présentent tous plus ou moins
2 La réfection de la charpente du volume oriental empêche de déterminer si l’appentis se prolongeait à l’origine vers l’est.
0 5 m
SudNord
porte ?
Ferme cloison est.
21
C H Â T E A U N E U F - S U R - S A R T H E - M A N O I R D E L A V É R O U I L L È R E
de fl ache. Le fort équarrissage des entraits et de poinçons n’a laissé que quelques rares traces d’aubier mais les nœuds restent bien visibles. Sur les chevrons et les faux entraits, le fl ache est d’autant plus visible que l’aubier était présent sur la majorité des arêtes. L’altération très avancée de cet aubier n’en n’a laissé que peu de parties en place et encore moins de d’éléments prélevables.
La présence de croix de Saint-André incite plutôt à placer cette charpente dans le XVe siècle. Cependant, le traitement des bois et des chanfreins, les sections rectangulaires à plat des chevrons font écho à des façons de faire des XIIIe et XIVe siècles. On soulignera par ailleurs que ces bois à croissance rapide avec beaucoup de fl ache deviennent de plus en plus rares dès le milieu du XVe siècle. Des comparaisons peuvent être proposées avec l’aile sud-ouest du château de Saumur [1385-1412[ et le manoir de Clairefontaine (Le Vieil Baugé, 49, [1392 et 1405[ qui sont les plus anciennes
attestations de croix de Saint-André connues à ce jour en Anjou. À La Vérouillère, l’analyse dendrochronologique permet de dater l’abattage des bois au cours de l’hiver [1416-1417]. Il en résulte, au regard des éléments connus montrant l’emploi de bois verts, que la réalisation de cette charpente s’est faite très probablement en 1417 ou l’année suivante. Cette analyse souligne aussi la jeunesse des arbres employés. À chaque pièce correspond un chêne âgé d’une soixantaine d’années. Les plus fortes sections ne proviennent pas d’arbres plus âgés ; il s’agit simplement d’individus ayant bénéfi cié de meilleures conditions de croissance. Ainsi les sablières de quelques 20 cm de large sont issues d’arbres d’à peine 30 cm de diamètre tandis que les chevrons résultent de l’équarrissage de billes proche de 20 cm de diamètre.
Même si l’ampleur du noyau primitif n’est pas connue, il apparaît certain que la charpente étudiée remplace une structure plus ancienne. Par ailleurs, le traitement de la ferme-
Contreventement de la charpente.
22
P A T R I M O I N E D ’ A N J O U : É T U D E S E T T R A V A U X 4
cloison orientale indique que la charpente refaite en 1417 est venue prolonger un volume existant plus à l’est. Les travaux du début du XVe siècle semblent avoir conservés l’organisation antérieure avec un logis organisé sur deux niveaux. Le premier étage, divisé par une cloison en pan de bois, abritait vraisemblablement une grande salle à l’est ; c’est du moins ce que suggèrent la présence d’une large porte sur le mur sud, probablement desservie par un escalier extérieur, et d’une cheminée — moderne dans son état actuel — adossée au gouttereau nord. En toute logique, la pièce occidentale de l’étage servait de chambre. Ce volume sous charpente était pourvu d’une cheminé sur le pignon et d’une croisée ouvrant au sud. L’appentis ou la galerie adossée au nord du logis ne semble avoir été en communication avec de dernier qu’au rez-de-chaussée. Ce programme architectural date selon toute vraisemblance du XIVe siècle si l’on se fi e au traitement de la croisée, mais intègre vraisemblablement des parties plus anciennes.
L’étude de bâti montre très clairement le caractère plus tardif de la tour d’escalier dont la construction entraîne des modifi cations sur la sablière et la ferme principale ouest de la charpente de 1417. L’examen des maçonneries incite à associer la construction de cet escalier en vis avec le prolongement du manoir vers l’ouest. Cette extension, malheureusement a été détruite, comprenait un rez-de-chaussée très bas de plafond et au moins un étage. Le traitement des deux portes du palier supérieur de l’escalier donne une certaine prééminence à la pièce occidentale nouvellement créée — une nouvelle salle ? —, avec un encadrement agrémenté de petits chapiteaux analogues à ceux de la porte d’entrée de l’escalier. Les arcs avec accolades très galbées et la présence des chapiteaux oriente ntvers la datation de ces travaux vers le milieu du XVe siècle (campagne des années 1450 au château du Plessis-Macé par exemple, grosse tour de la Bourgonnière à Bouzillé après 1446).
La réfection complète de la charpente de la « salle » orientale pourrait intervenir à la même époque, sans certitude toutefois. Les entraits placés à la base de chaque ferme jouent également le rôle de solives qui isolent du comble la pièce de l’étage. L’insertion de solives sous la sablière de la charpente de 1417 participe de la
même logique, sans qu’il soit cependant possible de se prononcer sur la contemporanéité de ces transformations. Aucune trace ne vient suggérer que les combles ainsi créés aient été habitables. On notera cependant que l’escalier en vis semble s’être à l’origine prolongé au-delà du premier étage ; ces dispositions plaident pour restituer une « salle » également plafonnée à l’ouest de l’escalier en vis3.
À l’étage, dans la pièce centrale, trois portes furent successivement percées pour établir des communications vers le nord. L’une d’entre elles donnait dans l’appentis, sauf à ce qu’il ait déjà été détruit à cette époque. Les deux autres semblent correspondre à des portes de latrines appendues sur la façade arrière.
La dernière modifi cation majeure du secteur étudié porte sur le rehaussement d’environ 0,6 m du plancher, sans doute de façon à augmenter le volume des pièces du rez-de-chaussée. Ces modifi cations pourraient s’inscrire dans le cadre des réaménagements du bâtiment à la fi n du XVIIe ou au début du XVIIIe siècle (lucarnes en pierre à fronton cintré).
3 Au droit de l’escalier en vis, la sablière à été coupée et la ferme secondaire modifi ée. Cet état laisse la possibilité d’un accès au comble depuis l’escalier sans qu’il soit possible d’en préciser la date de réalisation.
23
MIRÉ
MANOIR DELONGCHAMP
Le site est localisé à environ 2 km au nord-ouest du bourg, sur le versant sud-ouest d’un petit vallon au fond duquel coule le ruisseau de Mortron.
En l’état actuel des connaissances, nous ne disposons que de très peu d’informations sur l’histoire du site et de ses occupants. En 1540, René du Mar (ou du Matz) déclare détenir le manoir de Longchamp des seigneurs de Miré, de Château-Gontier et de Juvardeil (Pelloquet 2009b). Le site pourrait avoir été déclassé très tôt, dès le XVIe siècle, peut-être du fait de l’extinction d’une lignée et/ou de la diffi culté à adapter les volumes des bâtiments aux nouveaux modes de vie. La tradition orale voulant que le grand volume central ait été une chapelle est complètement contredite par le programme architectural de cet ensemble1.
L’édifi ce est implanté selon un axe nord-ouest/sud-est qui, pour alléger la description, a été ramené à un axe est/ouest. Les maçons ont utilisé pour le gros-œuvre des moellons de grès ou de siltites de provenance locale. L’origine du calcaire coquillier que l’on retrouve ponctuellement reste indéterminée. Plusieurs constructions juxtaposées forment l’édifi ce
1 Cet édifi ce a été repéré au printemps 2002 dans le cadre d’une mission d’inventaire portant sur le Pays Segréen (dossier d’Inventaire consultable au Service départemental de l’Inventaire de Maine-et-Loire). Une pré-étude et quelques relevés ont été effectués durant le mois d’août 2002 (Gaël Carré, Emmanuel Litoux, Ronan Durandière ; cf. Carré et al. 2002) ; l’analyse des charpentes et des bâtiments ainsi que des relevés complémentaires ont été réalisés en 2005 (Jean-Yves Hunot, Emmanuel Litoux, Arnaud Remy). À cette occasion une dendrochronologie a été fi nancée par le Centre de Recherche des Monuments historiques pour la préparation d’un ouvrage sur les charpentes de l’Ouest de la France (Hoffsummer à paraître). Perrault C., Girardclos O., Datation par dendrochronologie de charpentes (logis et bas-côté est) du manoir de Longchamp à Miré (49), CEDRE, Besançon, octobre 2005, 34 p.
actuel. Le bâtiment principal, en position centrale, n’a pas survécu dans sa totalité. Les deux tiers du mur gouttereau sud et la charpente originelle ont été détruits tandis que le mur pignon oriental ne subsiste plus que sur une hauteur de 4,6 m. Contre son mur gouttereau nord s’adosse une aile de plain-pied en appentis, elle-même prolongée à l’ouest par un corps de bâtiment à étage, jointif par l’angle avec le volume central.
L’état de conservation des maçonneries permet de restituer une bonne partie de l’organisation primitive du complexe résidentiel.
Le bâtiment principal constituait une grande salle seigneuriale de plain-pied montant sous charpente de 18,0 m x 8,3 m dans-œuvre. L’éclairage était au moins assuré, dans le pignon occidental, par une belle fenêtre haute que venait à l’origine subdiviser un réseau gothique dessinant deux lancettes surmontées d’un trilobe et de trois écoinçons. L’arc brisé était souligné à l’extérieur par une archivolte retournée. Le seul emplacement possible pour une cheminée se trouve sur le mur gouttereau sud, où s’observe un coup de sabre vertical puis oblique en partie supérieure. Quatre portes appartenant à l’état primitif ouvrent dans cet espace. L’accès principal s’effectuait a priori dans l’angle nord-ouest, depuis l’appentis nord, par une grande porte en arc brisé dont l’encadrement est souligné par deux tores séparés d’un cavet. La pièce qui la précède dans l’appentis nord pourrait avoir servi d’espace d’accueil.
Deux portes occupent l’angle sud-ouest de la pièce ; elles donnaient accès à des structures annexes en appentis dont ne subsistent plus que les corbeaux qui portaient la charpente. Des traces d’accroches de maçonneries apparentes sur l’angle extérieur sud-ouest suggèrent de restituer des murs périphériques en pierre, sans
24
P A T R I M O I N E D ’ A N J O U : É T U D E S E T T R A V A U X 4
Extrait du cadastre ancien de 1826 section A (ADML 3P4/213/004).
Vue depuis l’est du site de Longchamp avec l’annexe nord en appentis et le corps de bâtiments nord-ouest.
25
M I R É - M A N O I R D E L O N G C H A M P
certitude toutefois. Le sens d’ouverture des deux portes, couvertes d’arcs brisés chanfreinés et d’arrière-voussures segmentaires, montre que les annexes étaient principalement desservies depuis le volume central.
L’annexe nord en appentis, partiellement conservée dans son état d’origine, possède des murs en maçonnerie de moellons. Un refend en pierre paraît avoir été construit dès l’origine dans le tiers occidental de la longueur2. La pièce
2 Ce refend vient se plaquer contre le mur sud au rez-de-chaussée mais en partie haute, les deux maçonneries
orientale conserve au milieu du mur nord une très belle cheminée à hotte pyramidale. Les consoles à triple ressaut en quart de rond chanfreiné portent le manteau dont la plate bande à crossette présente un profi l légèrement saillant. Deux tablettes contribuent à maintenir latéralement les consoles. La charpente, constituée d’une succession de fermes non contreventées,
apparaissent parfaitement chaînées. Par ailleurs, la présence de ce refend s’accorde bien avec l’emplacement de la cheminée, centrée sur la pièce orientale. Ce collage peut résulter d’un phasage du chantier ou d’une évolution du projet au cours de sa réalisation (remplacement d’une cloison en pan de bois par un refend en pierre).
Ch.Ch.
Porte originelle à l'étage
Porte originelle à l'étage
0 15 m
Salle basse de plain-pied
Ch.
Ch.
Ch. ?
Appentisouest
Cellier ?
Appentissud
Appentis nord
Annexeest
Chambre ? Pièce souscharpente
Ch.
?
Ch. ?
Latrines ?Tribune/escalier ?
A B
Plan du manoir (avec en gris les parties médiévales) et hypothèses de restitution des dispositions du rez-de-chaussée (A) et de l’étage (B) ; (Ch. : Cheminée).
26
P A T R I M O I N E D ’ A N J O U : É T U D E S E T T R A V A U X 4
0 1 m
0 10 cm
S N
0 5 m
Proposition restitiontoiture à 50°
0 50 cm
Détail de l'assemblage des barreaux.
Rainure liée à la pose d'un vitrailEncoche pour fixer la grille
Salle de plain-piedAppentis sud Appentis nord
Bloc résidentiel
Coupe transversale du volume central et de l’annexe nord, avec le relevé de la cheminée et des restes de la fenêtre à croisée conservés dans l’appentis.
27
M I R É - M A N O I R D E L O N G C H A M P
possède des aisseliers, des jambettes et des faux entraits dont l’intrados dessine un berceau en arc brisé. Ce volume ne semble avoir été unifi é par un lattis hourdé qu’à une époque plus tardive. Au nord, l’éclairage était assuré, au minimum, par deux fenêtres chanfreinées, dont une petite croisée, toutes deux protégées par des grilles en fer forgé. L’extrémité orientale de cet appentis conserve, sur la face extérieure du mur, les traces d’une cheminée à hotte pyramidale permettant de restituer un volume supplémentaire dont l’emprise au sol n’est cependant pas connue.
Le corps de bâtiment situé dans l’angle nord-ouest, comprenait un niveau bas surmonté d’un étage dont le volume, au moins dans sa partie orientale, montait sous charpente.
Le rez-de-chaussée, probablement à usage de cellier, communiquait directement avec l’appentis nord par l’intermédiaire d’une porte en arc brisé chanfreiné. Le seul jour identifi é semble correspondre à un soupirail ouvrant au nord. Un refend porté au rez-de-chaussée par deux arcs surbaissés appuyés sur un robuste pilier octogonal monolithique en calcaire coquillier, scindait le volume du bâtiment en deux parties inégales. Au premier étage, ce refend — sans doute en pierre — a disparu mais le traitement du contreventement de la charpente laisse penser qu’une ou deux cheminées pouvaient s’y adosser. Cette charpente à ferme et à panne, bien que d’une hétérogénéité apparente, s’avère être d’une conception unitaire ainsi que l’attestent le marquage, le traitement des bois
O E
0 5 m
O E
Comble
Plafond hypothètique
Pièce montant sous charpenteChambre ?
Cellier ? Cellier ?Soupirail ?
Cheminées ?
Coupe longitudinale du bâtiment nord-ouest avec, en gris, une proposition de restitution des dispositions originelles.
28
P A T R I M O I N E D ’ A N J O U : É T U D E S E T T R A V A U X 4
N
0 5 m
?
Pièce en appentis
Salle de plain-pied
Cellier
S
N S
0 5 m
Chambre ?
Salle de plain-pied
Cellier
?
Plafond ?
Coupes transversales du bâtiment nord-ouest.
29
M I R É - M A N O I R D E L O N G C H A M P
0 25 cm
0 5 m
A
B
Fermes de la charpente du bâtiment nord-ouest ; A : ferme de la partie est avec le détail du poinçon, B : ferme de la partie ouest.
30
P A T R I M O I N E D ’ A N J O U : É T U D E S E T T R A V A U X 4
et l’analyse dendrochronologique. Les deux fermes occidentales, destinées à être visibles, comportent des jambettes et un faux-entrait cintrés de façon à former avec les arbalétriers un cintre légèrement outrepassé (Hoffsummer à paraître). Ce type de charpente se rattache à un modèle breton dont quelques exemples datés du XIVe siècle sont attestés en Anjou comme la charpente du manoir de la rue du prieuré à Saint-Martin-du-bois [1387-1389[d, celle de la chapelle Saint-Bibien à Échemiré [1376-1393[d. La chapelle de Sousigné à Martigné-Briand en est l’exemple le plus éloigné. Les deux fermes occidentales montrent un traitement beaucoup plus sommaire, posant la question d’un éventuel plafond. Cependant, cette même dichotomie se rencontre au manoir de la rue du prieuré à Saint-Martin-du-bois de part et d’autre d’une cloison séparant deux volumes montant sous charpente.
La pièce orientale d’environ 7,3 x 6,2 m dans-œuvre offrait un volume montant sous charpente. L’angle sud-est était aménagé de façon à permettre un double accès vers l’appentis ouest et vers le grand volume central. Ce dernier accès, avec linteau droit sur coussinets, débouchait vraisemblablement sur une structure en bois de type tribune ou sur un escalier permettant de rejoindre le niveau du rez-de-chaussée. La pièce occidentale présentait des dimensions un peu plus réduites (5,5 x 6,2 m). Sur le pignon ouest, une porte qui pouvait ouvrir sur une latrine, un escalier ou un balcon, aménagements pour lesquels on ne voit cependant aucune accroche. Ces éléments et la présence possible, mais non démontrée, d’un plafond plaident pour identifi er cette pièce comme un espace privatif de type chambre.
L’analyse dendrochronologique des charpentes a permis de déterminer que les bois avaient été abattus au cours de l’hiver [1341-1342]d pour la charpente du corps de bâtiment nord-ouest et après 1337[d (probablement entre 1340 et 1344) pour la charpente de l’appentis nord.
L’intérêt du manoir de Longchamp est de présenter un programme architectural relativement complexe avec une grande salle de plain-pied entourée sur 4 côtés par des annexes et jointive par l’angle avec un bloc résidentiel surmontant un cellier. L’ampleur du volume de la salle pose avec d’autant plus d’acuité la question de son éclairage que les appentis périphériques réduisaient considérablement les surfaces murales disponibles pour placer des fenêtres. Le probable plafond de la pièce occidentale du bloc résidentiel tout comme la fenêtre à croisée de l’appentis nord constituent pour le corpus angevin des exemples très précoces de solutions architecturales appelées à se généraliser par la suite.
Les principaux remaniements attestés dans le bloc résidentiel sont signalés par l’insertion, à une époque indéterminée, d’un plancher au niveau du comble de la partie occidentale de la charpente et la restructuration du bâtiment au XVIIIe siècle (cheminées, percements sur la façade nord). La destruction partielle des maçonneries de la grande salle, résultant de l’utilisation d’une partie de l’édifi ce comme ferme (construction d’une étable notamment), intervient avant 1826, date du cadastre napoléonien.
31
MORANNES
LA MILLASSERIE
Les sources documentaires relatives à la Millasserie restent relativement laconiques. Le manoir, détenu par la famille Aubry, dépendait aux XVe et XVIe siècles de la seigneurie de Chandemanche, dont le siège était situé 2,5 km au sud-ouest. Comme de nombreux domaines nobles, le manoir apparaît dans l’enquête de 1540 qui, suite à l’ordonnance de Compiègne de 1539, fait le recensement des détenteurs de fi ef à l’intérieur de la province angevine ; le document mentionne le « lieu, seigneurie, fi ef et closerie de la Millasserie ».
Le cadastre de 1830 fi gure deux plates-
formes entourées de douves. Les bâtiments se concentraient sur l’enclos oriental, dont l’accès
au sud était contrôlé par un ouvrage d’entrée — un « magnifi que et haut portail avec armoiries » d’après C. Port — détruit au milieu du XIXe siècle.
Toujours d’après l’état relevé en 1830, le corps de logis était établi parallèlement à la douve nord-ouest tandis que l’aile des dépendances adossée à la douve nord-est, faisait face à l’entrée du pourpris. Exception fait d’extensions ponctuelles, le plan masse des deux édifi ces n’a pas connu d’évolutions signifi catives ces deux derniers siècles.
Le logis se présente sous la forme d’un
corps de bâtiment rectangulaire, assez allongé,
Extrait du cadastre ancien de 1830 (section B3) (ADML 3P4/229/008).
32
P A T R I M O I N E D ’ A N J O U : É T U D E S E T T R A V A U X 4
couvert par un toit à double versant. L’examen des élévations extérieures et des dispositions intérieures révèle l’existence en partie centrale d’un noyau ancien constitué de deux pièces barlongues superposées ; l’accès à l’étage se faisait très vraisemblablement par le biais d’une porte ouverte sur la façade antérieure, que desservait un escalier extérieur (détruit).
Une extension importante, également à deux niveaux, vint prolonger ce premier bâtiment vers le sud-ouest. Équipée au rez-de-chaussée d’une cheminée sur gouttereau, elle prenait le jour à l’étage par des fenêtres géminées en plein-cintre avec coussièges.
La datation de ces deux premiers états reste diffi cile à préciser, les encadrements des ouvertures étant traités de façon très fruste, en moellons de grès. L’emploi du plein-cintre et la présence de fenêtres géminées suggèrent une datation assez haute, nécessairement antérieure au milieu du XIVe siècle.
Une seconde extension prolongea le noyau primitif vers le nord-est ; c’est semble-t-il à cette campagne de travaux qu’il convient de rattacher les deux cheminées adossées au premier étage, sur le mur de refend nord-est. Le traitement des hottes très saillantes portées sur des corbeaux assez massifs, rend très improbable une datation postérieure au XIVe siècle. La présence de latrines sur le mur postérieur, côté douves, en souligne la fonction résidentielle.
Le noyau primitif et l’extension nord-est conservent une charpente à ferme et à panne de tradition anglo-bretonne ; quelques très rares exemples récemment découverts et étudiés en Anjou, ont été datés des XIVe et XVe siècles.
Le logis fi t l’objet d’une restructuration, sans doute à la fi n du XVe ou au début du XVIe siècle. D’une part, les fenêtres reçurent des encadrements en pierre de taille de tuffeau. D’autre part, il fut procédé à l’insertion d’un plafond à la base de la charpente afi n de créer un étage de combles.
Vue de la façade principale du logis depuis le sud.
33
CUON
MANOIR DE VILBOUVEY
Contexte de l’intervention
Le manoir de Vilbouvey a été repéré par les chercheurs de l’Inventaire en 1984 mais la fi che réalisée à cette occasion est restée très succincte ; bien que mentionnant l’existence d’une cheminée médiévale, elle attribuait le gros œuvre du noyau central au XVIe siècle (Cussonneau et Kérouanton 1987 : 40). Lucie Gaugain, doctorante à l’université de Tours, a pu visiter l’édifi ce le 2 janvier 2007 et a attiré notre attention sur le fait que le site présentait de nombreux vestiges antérieurs au milieu du XVe siècle, dans un relativement bon état de conservation. Les auteurs de la notice tiennent à remercier le propriétaire, M. Nicolas Angeard, pour leur avoir laissé accéder librement aux parties les plus anciennes du site. L’étude a été effectuée les 16 et 24 septembre ainsi que les 10, 20 et 21 octobre 2007. Cette construction rentrant dans le cadre d’une prospection thématique sur l’habitat seigneurial antérieur au XVe siècle en Anjou, il a ainsi été possible de bénéfi cier d’un fi nancement de la DRAC des Pays de la Loire par le biais du Service régional de l’archéologie qui a permis la réalisation d’un analyse dendrochronologique par Y. Le Digol (Dendrotech à Rennes).
Présentation générale
Le manoir de Vilbouvey, sur la commune de Cuon, est implanté à 1 km au nord/nord-est du centre paroissial. Le lieu-dit apparaît dès la fi n du XIe siècle, vers 1080, dans le cartulaire de Saint-Aubin : Villa Bovea. Deux occurrences dans le cartulaire de Brion, Villa Boveia et Villla Bovei, datent respectivement de 1107 et 1127-1154. C. Port mentionne la découverte d’un silo aménagé dans une butte de terre, aplanie avant 1878 ; ce «tertre» ne fait malheureusement l’objet d’aucune localisation précise. Les sources
deviennent plus nombreuses à partir du XVIe siècle ; elles indiquent que Vilbouvey est alors le siège d’une petite seigneurie rurale tenue par des membres de la noblesse locale (Port 1878 : 723).
Le manoir est implanté à mi-hauteur — vers 60 m NGF — sur le versant nord-est d’une butte naturelle culminant à 82 m NGF, et sur les fl ancs de laquelle sont creusées de nombreuses cavités dans les bancs de tuffeau. La pierre, de relativement bonne qualité, a manifestement fait l’objet d’une exploitation importante. Un ruisseau dénommé Le Brocart coule 500 m plus au nord ; il a alimenté plusieurs moulins dont celui de Meslet attesté en 1575.
L’accès au site se fait actuellement depuis le sud-ouest. Le corps d’habitation se compose d’un volume central, de plan carré, à deux niveaux, coiffé par un toit en pavillon. Deux ailes en appentis s’appuient contre ses façades sud et ouest. Une extension couverte par un toit à deux versants prolonge l’édifi ce vers l’est1. Une grande étable se développe au nord-ouest, tandis que des soues ont été rejetées plus à l’est dans un bâtiment séparé. Des hangars modernes en bois délimitent à l’ouest une vaste cour. L’examen du cadastre de 1836 confi rme la datation tardive des hangars et fournit également un terminus post quem pour l’extension orientale du bâtiment d’habitation.
Description
Les vestiges médiévaux se concentrent sur le volume carré central, sur l’appentis ouest ainsi que sur l’étable. Ils se caractérisent par
1 Nous n’avons pas eu accès au rez-de-chaussée des deux appentis sud et ouest ni à l’extension orientale, qui ont été réhabilités pour constituer l’habitation du propriétaire actuel.
34
P A T R I M O I N E D ’ A N J O U : É T U D E S E T T R A V A U X 4
l’emploi de pierres de taille de tuffeau de moyen appareil posées avec un mortier de chaux orangé. La partie inférieure des maçonneries est traitée en moellons de pierres froides (grès siliceux du Sénonien), afi n de limiter les remontées d’humidité ainsi que les dégradations provoquées en bas de mur par les eaux de rejaillissement. Le relevé succinct de ces éléments ainsi que des structures en bois qui leur sont contemporaines, permettent de restituer une partie du programme architectural originel.
Le bâtiment central
Le bâtiment central de 9,00 x 9,05 m hors-œuvre superpose deux pièces de 50,2 m² (7,05 x 7,12 m). Les murs mesurent en moyenne 0,95 m d’épaisseur. Des solives de forte section, orientées nord-sud, soulagées par des aisseliers, reçoivent un plancher sur lequel repose le sol de ciment du premier étage.
Au rez-de-chaussée, l’actuelle porte du mur sud, caractérisée par un ébrasement légèrement dissymétrique, ne semble pas appartenir à l’état originel. Afi n d’éviter la mise en place d’un chevêtre, deux des aisseliers du plafond ont été plus fortement inclinés afi n de porter directement sur le linteau en bois de la porte, épais de 0,24 m. Une seconde ouverture, aujourd’hui obturée, est attestée plus à l’ouest2. Aucun arc de décharge ne vient surmonter l’arrière voussure segmentaire. La porte est nettement décentrée par rapport au chevêtre, par ailleurs plus large. Une autre porte contemporaine de l’édifi cation du bâtiment occupe l’extrémité sud du mur ouest. Large de 0,9 m, elle présente une arrière voussure segmentaire couverte par un arc de décharge. Le passage est condamné par une cloison montée entre les tableaux. L’embrasure droite ne présente aucune trace de barre de blocage.
Une cheminée à hotte pyramidale portée par un manteau cintré et deux consoles à double ressaut en quarts de ronds chanfreinés, est engagée dans le mur ouest3. Deux tablettes venaient initialement contrebuter les poussées exercées
2 La présence de meubles placés devant le bouchage de cette porte interdit d’en connaître la largeur.3 Les consoles ont été soulagées, sans doute tardivement, par la construction de deux jambages de section rectangulaire.
par l’arc du manteau4. La hotte s’interrompt une assise sous le plafond, ce qui permet au conduit de cheminée (intégré dans l’épaisseur du mur) d’échapper la solive de rive. La porte percée à l’extrémité nord du mur ouest correspond à un aménagement relativement tardif.
Une large fenêtre dans le mur nord constituait à l’origine la seule source de lumière naturelle. L’embrasure, aujourd’hui comblée par une maçonnerie, ne paraît pas avoir été pourvue de coussièges à l’origine. Un arc de décharge surmonte l’arrière voussure segmentaire. L’encadrement extérieur a été en grande partie restauré ; seules trois pierres conservées en place autorisent à restituer en partie haute un simple chanfrein. L’arc de couvrement, entièrement refait, adoptait sans doute le même profi l segmentaire que l’arc de décharge qui lui n’a pas été restauré. L’appui médiéval, qui se trouvait a priori deux assises plus bas, a été entièrement détruit préalablement à la reconstruction de l’allège.
Le mur oriental présente une porte qui paraît avoir été repercée. Le linteau en bois a été inséré à 3,17 m au-dessus du sol intérieur de façon à surmonter la porte d’une fenêtre en imposte.
Le plancher
Le plancher est seulement constitué de solives joignant les deux murs opposés, sans poutre porteuse. Les extrémités des solives sont insérées dans la maçonnerie et l’absence de reprise indique une mise en place contemporaine des murs. Deux aisseliers soulagent et réduisent la portée de chaque solive d’environ un tiers. Ces dernières se caractérisent par leur section rectangulaire (18 x 25 cm) posée à plat. L’équarrissage de ces bois de brin laisse peu de fl ache et peu d’aubier. Elles ont été façonnées dans du chêne, tout comme les planches d’entrevous. Il n’existe aucune trémie permettant une liaison directe entre les deux niveaux du bâtiment central.
Les planches d’entrevous, épaisses de 4 cm et de largeurs variables (20 à 41 cm), sont posées perpendiculairement aux solives. Une
4 La tablette nord a été bûchée à une date indéterminée.
35
C U O N - M A N O I R D E V I L B O U V E Y
étroite (0,85 m), occupe l’extrémité ouest du mur sud. Les battants de porte de ces deux accès pouvaient être bloqués en position fermée grâce à des barres coulissant dans deux trous barriers. Quatre empochements et une rainure verticale
0 10 m
Plan d’ensemble du rez-de-chaussée du logis avec l’étable. Les hachures signalent les maçonneries médiévales.
couche de nivellement a permis la pose d’un sol de terre cuite à l’étage.
Un linçoir, placé entre deux aisseliers, en reçoit deux autres pour éviter un appui sur l’arc de la baie nord. En vis-à-vis, un second linçoir, plus étroit, surmonte une porte aujourd’hui condamnée. Ces deux éléments sont assemblés à tenon et à mortaise, démontrant ainsi une mise en place contemporaine du plancher. En revanche, sur le mur sud, il n’y en pas au-dessus de la porte actuelle indiquant un percement plus récent. Cinq carottes effectuées pour la dendrochronologie montrent la parfaite contemporanéité du plancher avec la charpente du comble. Par ailleurs, le plancher étant lié avec la maçonnerie, la date s’applique également à l’édifi cation des parties en pierre. Les bois sont abattus au cours du repos végétatif de l’hiver [1343-1344[.
L’étage
La pièce du premier étage présente les mêmes dimensions que celle du rez-de-chaussée. L’accès principal se faisait par une porte en arc brisé large de 0,95 m, ménagée à l’extrémité sud du mur ouest. Une autre porte accessible depuis le sud, couverte par un arc segmentaire et sensiblement moins haute et plus
36
P A T R I M O I N E D ’ A N J O U : É T U D E S E T T R A V A U X 4
conservent le souvenir d’un aménagement léger de type cloison en torchis ou panneau en bois appartenant à un tournavent, installé dans l’angle sud-ouest de la pièce. Ce caisson, haut de 2,2 m, permettait de créer un espace tampon ou sas entre les portes et la pièce de l’étage, sans doute pour limiter les courants d’air ainsi que les échanges thermiques. Le fait que les deux portes aient été placées à proximité l’une de l’autre, dans un angle de la pièce, plaide pour l’ancienneté de ce tournavent. Une porte est
percée à une date tardive dans le mur oriental pour desservir le comble de l’extension est.
Une cheminée analogue à celle du rez-de-chaussée, légèrement décalée vers le nord, occupe le mur oriental. L’âtre mesure 2,1 m de large. Des mouvements importants de maçonnerie ont eu raison du manteau et de la hotte dont ne subsistent que les pierres d’ancrage. Selon les mêmes dispositions que celles décrites au rez-de-chaussée, la hotte se fond dans le mur juste
Vue du logis depuis le sud-ouest.
Détail du plancher au-dessus de la fenêtre nord du rez-de-chaussée.
37
C U O N - M A N O I R D E V I L B O U V E Y
Nord Sud
0 5 m
A B
Coupe nord-sud du logis avec la charpente ; A : demi-ferme de croupe, B : demi-ferme d’arêtier. La fenêtre nord au 1er étage a été restituée dans son état originel.
38
P A T R I M O I N E D ’ A N J O U : É T U D E S E T T R A V A U X 4
à la jonction entre la maçonnerie et la charpente de façon à ce que la souche passe en arrière de la sablière intérieure.
Le mur nord s’ouvre sur l’extérieur par une fenêtre à croisée équipée à l’origine de coussièges. Des désordres dans les maçonneries, ayant entraîné la rupture du linteau monolithe, expliquent l’obturation partielle de la fenêtre.
Les gonds conservés démontrent l’absence de châssis dormant. L’étroitesse des chanfreins contraste avec le caractère assez massif du meneau et de la traverse (respectivement 21 et 25 cm de large).
0 10 m
Plan d’ensemble de l’étage du logis. Les hachures signalent les maçonneries médiévales.
39
C U O N - M A N O I R D E V I L B O U V E Y
Vue des deux portes de l’étage avec les traces du tambour de porte.
Vue de la cheminée du premier étage.
40
P A T R I M O I N E D ’ A N J O U : É T U D E S E T T R A V A U X 4
La charpente
Ce bâtiment est coiffé d’un toit en pavillon, lambrissé, couvrant la pièce de l’étage qui, comme celle du rez-de-chaussée, présente un plan carré de 7,05 m de côté dans œuvre. La structure à chevrons-porteurs ne comporte qu’une ferme principale placée au milieu des murs sud et nord. Deux demi-fermes sont placées perpendiculairement. L’installation de quatre arêtiers donne la forme en pavillon à forte pente (59,5°). Dans l’enrayure, des empanons complètent les versants. L’aspect de roue est souligné par les huit goussets qu’encadrent les aisseliers.
La plate-forme comporte, côté intérieure, une sablière moulurée. Cette mouluration sert de solution de continuité entre les murs et le lambris qui recouvrait la sous-face des bois de la charpente, et dont ne subsistent plus que les clous.
L’ensemble est assemblé à tenon et mortaise, sauf les empanons qui sont seulement chevillés en tête. Il convient de souligner la présence, à la base du poinçon, d’un tenon en
demi-queue d’aronde bloqué dans la mortaise biaise de l’entrait par un rossignol.
Hormis quelques réparations autour des deux souches de cheminée, cet ensemble n’a pas subi de modifi cations, ce que confi rme la cohérence du marquage. Les huit sablières se croisent aux angles avec leur propre numérotation : le marquage fait de grands V avec le numéro à l’intérieur tourne dans le sens des aiguilles d’une montre à partir de l’angle sud-ouest. Les sablières intérieures sont mises en premier en débutant par la méridionale puis les 2 perpendiculaires et en dernier la sablière nord. Les blochets d’angle y sont assujettis. Les sablières extérieures viennent enfi n s’insérer dans les blochets à tenon et à mortaise. Pour les fermes, le marquage à la rainette indique une progression ordinale du sud vers le nord pour les 2 versants est et ouest et à partir de l’ouest pour les deux autres versants. La contremarque se trouve du côté du versant est ; une patte d’oie et un petit bâton distinguent respectivement le versant sud et le versant nord. Le levage n’a pu débuter que par la ferme principale (6 à la patte d’oie) suivi de l’installation des 2 demi-fermes perpendiculaires (6 franc et 6 contremarque), les empanons marqués venant ensuite.
Vue de l’enrayure de la charpente ; des liteaux cloués en sous-face des bois servaient à rattraper les défauts des pièces de charpente du bâtiment central pour poser le lambris.
41
C U O N - M A N O I R D E V I L B O U V E Y
L’ensemble est constitué de bois de brin fl acheux. Le fl ache reste concentré sur les faces non visibles. En revanche, les bois présentent de nombreux nœuds et cela dès la base des grands bois. La croissance rapide de nombreux chênes a limité les possibilités de prélèvement. La présence d’écorce et les fentes traversant le marquage indiquent l’emploi de bois vert.
Les dimensions des baies n’ont permis de monter qu’une échelle relativement courte (8 m), laissant hors de portée la partie supérieure de la charpente.
Onze échantillons ont été prélevés par nous-mêmes puis analysés en 2008 par le laboratoire Dendrotech de Rennes (Y. Le Digol). La chronologie moyenne du site met en évidence un dernier cerne complet sous l’écorce qui permet de placer l’abattage durant l’hiver 1343-1344. Compte tenu des observations indiquant l’emploi de bois vert, la mise en place peut être raisonnablement placée au cours de l’année 1344.
0 5 m
Plan de la plateforme de la charpente du bâtiment central avec le report du marquage des sablières (à l’intérieur) et des fermes (à l’extérieur). Le gris signale les réfections.
42
P A T R I M O I N E D ’ A N J O U : É T U D E S E T T R A V A U X 4
Les appentis
Le prolongement vers l’ouest du mur nord du volume central constitue le mur pignon de l’appentis ouest, percé à mi-hauteur d’une fenêtre rectangulaire plus large que haute (respectivement 0,68 x 0,53 m) soulignée par un simple chanfrein. L’embrasement intérieur, légèrement dissymétrique, est couvert par un linteau en bois. Des pierres saillantes en attente vers le nord laissent à penser qu’une extension était prévue de ce côté ; rien ne permet de penser qu’elle ait été réalisée. Si la partie basse du mur est strictement contemporaine du volume central, le pignon vient très nettement se plaquer contre l’extrémité nord de la façade ouest. Les techniques de mise en œuvre sont strictement similaires, aussi plus qu’un remaniement, il faut sans doute voir là un simple décalage dans l’avancement du chantier5.
5 Ce point particulier est important à souligner car il peut contribuer à expliquer l’absence d’arrachement du mur fermant au sud le volume de l’appentis.
Le mur ouest de l’appentis est conservé sur 8,55 m de long, sans que son extension originelle ne soit connue. Aucun arrachement susceptible de correspondre à un mur en retour n’a été observé sur le mur ouest du bâtiment central, ce qui pourrait signifi er que l’appentis se prolongeait vers le sud. La seule ouverture observée sur le mur ouest est une porte en arc brisé soulignée par un chanfrein. Bien qu’elle ait été partiellement détruite et condamnée lors du percement d’une fenêtre moderne, il est néanmoins possible de lui restituer une largeur relativement importante, de l’ordre d’1,2 m.
À l’intérieur de l’appentis, au premier étage, une série de trous rectangulaires sur le mur ouest du bâtiment central suggère de restituer un niveau de plancher constitué de solives avec un entraxe moyen de 0,78 m. Le traitement
du mur nord qui montre, à la même hauteur, un joint épais de 10 cm non lissé, confi rme la stricte contemporanéité entre les maçonneries et le plancher. À environ 1,6 m au-dessus de ce niveau de sol ont été bûchés des empochements destinés à recevoir des pièces de bois obliques, selon toute vraisemblance les aisseliers de la charpente médiévale qui couvrait ce volume en appentis. Une ligne de piquetage verticale, à l’aplomb d’un de ces empochements, marque l’emplacement d’une cloison. Une rainure creusée dans l’arc de la porte mais selon un profi l plus affaissé, pourrait résulter de la pose d’un lambris. Rien ne permet d’affi rmer que ces aménagements remontent à la période médiévale, même si l’hypothèse semble plausible.
Les parties accessibles de la façade sud du bâtiment central6 ne montrent aucune trace d’arrachement de maçonnerie ou de structure en bois.
6 Le parement sud du bâtiment central n’a pu être observé qu’à partir du comble de l’appentis sud.
Détail du raccord entre les sablières internes de l’angle sud-est du bâtiment central.
43
C U O N - M A N O I R D E V I L B O U V E Y
0 50 cm
0 50 cm
A
B
C
D
E
0 1 m
0 1 m
Détail de la charpente du bâtiment central. A : base des empanons, B : base du poinçon (en tiretés profi l du tenon avec son rossignol), C : profi l de la sablière interne, D : vue par le bout de l’arêtier, E : détail de l’angle de la plate-forme (le tireté indique le parement intérieur du mur).
44
P A T R I M O I N E D ’ A N J O U : É T U D E S E T T R A V A U X 4
L’étable
L’actuel bâtiment servant d’étable attenant à l’appentis ouest conserve dans ses élévations plusieurs pans de maçonneries montrant le même type de mise en œuvre de la pierre de taille de tuffeau et rendant très probable une datation médiévale, même en l’absence de tout autre critère de datation. Ces maçonneries, épaisses de 0,95 m, sont localisées sur les deux murs gouttereau et sur le pignon oriental, mais uniquement en rez-de-chaussée.
L’allongement de l’étable vers l’ouest, sur 6 ou 7 m de longueur, réalisé après 1836 a pu faire disparaître les vestiges du pignon médiéval. Les éléments subsistants donnent une largeur hors-œuvre de 9,85 m pour une longueur minimale de 19 m, Aucune trace d’ouverture primitive n’a été repérée. Le seul élément remarquable est un arrachement de maçonnerie sur la façade nord du bâtiment, pouvant aussi bien correspondre à un départ de mur qu’à un contrefort ou un coffre de cheminée.
O E
0 3 m0
Coupe transversale du comble de l’appentis ouest avec restitution des dispositions médiévales (tiretés).
45
C U O N - M A N O I R D E V I L B O U V E Y
Restitution de l’état originel
Toutes ces observations suggèrent de restituer un ensemble relativement homogène du milieu du XIVe siècle constitué d’un édifi ce à étage de plan carré couvert d’une toiture en pavillon contre lequel s’adosse à l’ouest un petit appentis, également à étage, jointif par l’angle avec un grand volume allongé d’au moins 145 m². Les éléments conservés ne permettent pas de savoir si ce dernier bâtiment était doté ou non d’un niveau supérieur. Tant l’ancienneté du site que la qualité du traitement architectural amènent à qualifi er cet ensemble de manoir, statut qu’il conservera d’ailleurs tout au long de l’Époque moderne. La salle occupait nécessairement le bâtiment ouest, ce qui incite à situer la chambre privative au premier étage du bâtiment carré, desservi par un escalier probablement logé dans l’appentis. À l’étage, la présence de la porte accessible depuis le sud pose la question d’un éventuel aménagement extérieur — escalier, galerie, balcon — ou bien de l’existence d’extensions édifi ées dans des matériaux plus légers, même si le sens d’ouverture de la porte plaide pour la première hypothèse.
La présence, à l’étage, d’un couvrement lambrissé accentue l’effet de verticalité de ce logis-tour, déjà perceptible de l’extérieur. Si les lambris se retrouvent très fréquemment sur les édifi ces religieux, leur présence en contexte d’habitation est nettement moins courante. Il existe néanmoins quelques exemples en Anjou comme au château des Ponts-de-Cé, au logis Plantagenêt à Saint-Maur de Glanfeuil, au manoir du Grand Chaussé à Seiches-sur-le-Loir, ou à celui de La Gortaie à Louvaines. Les quelques cas de lattis enduit observés au château de Baugé, au manoir de Launay à Villebernier et à celui de Belligan à Sainte-Gemme-sur-Loire, offrent une meilleure isolation. Un hourdis posé sur barreaux de terrasses isolait le comble du manoir du Plessis à Juigné-sur-Loire. Toutefois, dans les constructions civiles médiévales angevines, la majorité des charpentes reste apparente, particulièrement avant la seconde moitié du XVe siècle.
Vilbouvey constitue à ce jour le plus ancien exemple disposant d’arêtiers conservé en Anjou. Cet exemple montre une maîtrise de tracé préalable (l’art du Trait) qui a permis
d’obtenir la longueur et la coupe des empanons. Le charpentier a bien su gérer les problèmes de dispositions dans l’espace. Le château de Saumur montre, sur l’avant-corps adossé à l’aile sud-est, un pavillon légèrement plus récent (après 1357 et probablement avant 1380) où le charpentier a simplifi é le contreventement et n’a pas su concevoir l’enrayure des deux croupes. Toutefois sur l’aile sud-ouest de ce même site, la sablière porte une moulure tout à fait comparable à celle de Vilbouvey (Litoux et Cron sous presse).
Typologiquement, à partir des premières observations qui ont été faites et qu’il serait nécessaire d’approfondir, le site de Vilbouvey semble se rattacher aux manoirs à salle et bloc privatif séparé dont plusieurs exemples ont été identifi és ces dernières années en Anjou, en Touraine et dans le Maine. En l’état actuel des connaissances, tous les manoirs de ce type s’organisent autour d’une grande salle de plain-pied montant sous charpente. La salle peut parfois être complètement indépendante (L’Épinaie à Saint-Marceau et peut-être au Prieuré de Moullins à Saint-Rémy-du-Val, tous deux en Sarthe) mais cette disposition, fréquente Outre-Manche et bien identifi ée en Normandie, n’a pas été encore observée en Anjou. Le bloc résidentiel peut être jointif par l’angle (Longchamp à Miré, La Gortaie à Louvaines, et ici à Vilbouvey) ou prendre place dans le prolongement de la salle (Les Ligneries à Charentilly, 37 ou La Lucière à Vern-d’Anjou). La date obtenue à Vilbouvey s’inscrit au milieu d’une période couvrant tout le XIVe siècle et le début du siècle suivant, qui voit l’intégration progressive des principales fonctions résidentielles et d’apparat au sein d’un volume unique, généralement allongé et à étage.
Les modifi cations ultérieures
L’absence de modifi cations importantes sur le bâtiment central à étage est vraisem-blablement synonyme de déclassement rapide, au moins pour la fonction résidentielle qui s’est déplacée vers les deux ailes en appentis. La pièce libérée au rez-de-chaussée a été transformée en dépendance mais sa cheminée est restée en activité. L’étage n’a au mieux été utilisé que comme lieu de stockage annexe, ce qui explique son très bon état de conservation.
46
P A T R I M O I N E D ’ A N J O U : É T U D E S E T T R A V A U X 4
La date de construction de l’appentis adossé au sud du bâtiment central, dont il reprend la largeur, reste diffi cile à établir. L’élément datable le plus ancien se trouve sur le mur gouttereau sud : le jambage d’une porte et le départ de l’arc en plein cintre paraissent remonter à la fi n du XVIe ou au XVIIe siècle. Le cadastre de 1836 fi gure une excroissance, probablement un four, en saillie sur le pignon oriental.
L’appentis ouest est fortement remanié au XVIIIe ou au début du XIXe siècle avec la modifi cation des percements, le rabaissement probable des maçonneries et la pose d’une nouvelle charpente sur jambes de force. La présence d’une fenêtre aménagée dans le pignon sud pour éclairer le comble démontre
que les travaux sont réalisés alors que l’angle sud-ouest n’est pas encore construit. Dans un second temps, un pilier en pierres de taille de tuffeau implanté dans le prolongement des deux façades des appentis pourrait avoir supporté un petit toit de type auvent. La travée d’angle est fi nalement entièrement fermée de façon à relier les deux ailes en appentis ; dans le comble de l’appentis ouest, la suppression de l’entrait de la ferme sud permet le percement d’une porte donnant accès au comble sud-ouest. Le traitement des encadrements des ouvertures de la façade sud signe une importante campagne de restructuration à la fi n du XIXe siècle ou dans la première moitié du XXe siècle. L’édifi cation de l’extension orientale intervient probablement dans le même intervalle de temps.
Extrait du cadastre ancien, dit napoléonien, Section A, feuille 1, ADML 3P4/122/2, dressé en 1836.
47
BRION
DOMAINEDES BLOUINES
Le bourg de Brion s’est développé autour de l’église paroissiale, sur le versant sud-ouest d’une butte dégagée par l’érosion dans le plateau sédimentaire du Baugeois, à 10 km au nord de la Loire. L’origine du vicus, dont l’existence est attestée de façon formelle au VIIIe siècle, reste inconnue. La petite agglomération (Brionno vico, Brionnus en 775) semble en relation avec une ancienne voie de communication passant au sud de la butte. De très nombreuses cavités creusées à partir du coteau dans les niveaux du Turonien ont sans doute fourni une bonne partie des matériaux de construction utilisés pour bâtir les maisons de Brion (moellons et pierres de taille).
Un bâtiment conservant des éléments médiévaux faisait apparemment partie du domaine des Blouines situé en limite sud-ouest de l’ancienne agglomération, à environ une centaine de mètres de l’église1. Le premier propriétaire connu de la seigneurie des Blouines est le noble homme Jacques de la Barre, en 1553. La même famille détient ce domaine au moins jusqu’au milieu du XVIIe siècle. C. Port décrit deux écus sculptés sur le manoir portant la date de 1643 ainsi que le nom de la famille de la Barre. Au XIXe siècle, les bâtiments abritent un asile pour les pauvres (Port 1874) qui a été depuis transformée en maison de retraite. Le cadastre napoléonien réalisé en 1825, montre une occupation du sol proche de l’actuelle.
Le bâtiment qui fait l’objet de cette étude se trouve à une quarantaine de mètres au sud-ouest du logis, en milieu de parcelle, à une trentaine de mètres en contrebas de la Grand’Rue2 qui suit la même orientation nord-sud3. L’édifi ce, mesurant 12,75 par 8,25 m
1 Cet édifi ce nous a été signalé par P. Garrigou Grandchamp2 Anciennement rue des Fontaines.3 L’orientation des pignons au nord-ouest et au sud-est, a
hors-œuvre, est constitué d’un rez-de-chaussée surmonté d’un étage de comble à deux versants. Cette volumétrie résulte vraisemblablement d’un réaménagement de la seconde moitié du XVIe siècle, ou du début du siècle suivant, sans doute contemporain de la construction d’une aile en retour à l’ouest. Un appentis est venu se greffer au sud postérieurement à 1825.
L’ensemble des élévations témoigne d’une histoire architecturale complexe. Seuls les deux premiers états identifi és, datant de la période médiévale, ont fait l’objet d’une analyse détaillée.
État 1
Le mur gouttereau oriental conserve en plusieurs endroits les restes d’un premier bâtiment caractérisé par l’emploi de pierres de taille de tuffeau de moyen appareil et l’utilisation d’un mortier marron clair, fi n, présentant de nombreux incuits de chaux. Malgré plusieurs interruptions du fait de remaniements et de percements, le mur, dont l’épaisseur varie entre 0,95 et 1,1 m, est conservé sur 7,8 m de long, notamment dans l’étage de comble. Son extrémité nord marque un retour vers l’ouest sur 1,0 m. L’autre extrémité correspond à un arrachement qui empêche de connaître la longueur originelle de ce pan de mur. Sa hauteur résulte d’un arasement lié à la restructuration moderne du bâtiment. Près de l’angle nord-est s’ouvre une porte en arc brisé, soulignée à l’extérieur par un larmier à profi l en « V » Des trous quadrangulaires ont été bûchés dans le parement au-dessus de cette porte ; leur inclinaison incite à restituer des jambettes portant une toiture en appentis. Il reste diffi cile
été ramenée à une orientation nord et sud afi n de faciliter la description.
48
P A T R I M O I N E D ’ A N J O U : É T U D E S E T T R A V A U X 4
0 5 m
Emplacementdu four
Reprise de l'angle sud-est
Etat 2
Etat 1
Plan du bâtiment de la résidence des Blouines conservant des parties médiévales.
49
B R I O N - D O M A I N E D E S B L O U I N E S
de préciser si l’arrière voussure constituée de pièces de bois, est également associée à ce premier état.
État 2
Les deux pignons appartiennent à une phase de construction postérieure. Les modules de pierres de taille mises en œuvre sont proches de ceux du premier état. Des signes
lapidaires (X, I, II, III et IIII) correspondent de toute évidence à des modules de hauteur qu’il conviendrait de caractériser plus fi nement4. Le mortier, de couleur beige, assez dur, utilise une charge moyennement fi ne. En partie supérieure, les deux pignons conservent la même trace permettant de restituer une couverture à un seul pan, caractérisé par une pente relativement faible (34 G, soit 30,5°).
Le mur nord était percé à l’origine d’une petite fenêtre carrée à chanfreins ouverte à près
4 Les modules semblent espacés d’environ 2,5 cm ; cette valeur fréquemment utilisée pour distinguer les modules de hauteur se rapproche du pouce.
E O
0 3 m
Etat 2
Etat 1
Élévation du parement extérieur du pignon nord.
50
P A T R I M O I N E D ’ A N J O U : É T U D E S E T T R A V A U X 4
de 2,5 m au-dessus du sol intérieur. Le bouchage de cette baie interdit de savoir si des traces de fermeture subsistent (gonds, trous de grille...). Côté intérieur, un placard couvert par un arc segmentaire a été aménagé à l’extrémité ouest du mur. Au centre se trouve une cheminée large d’1,9 m dont le linteau en bois est porté par deux consoles à quatre ressauts en quart-de-rond chanfreinés. Le mauvais état de conservation
des piédroits, également chanfreinés, ne permet pas de se prononcer sur la présence ou non de bases décorées. La hotte droite a été refaite au XVIIe ou XIXe siècle, en conservant toutefois la légère infl exion du linteau, caractéristique des cheminées médiévales observées dans la région. Sur le contre-cœur se lit encore très bien la gueule d’un four, aujourd’hui bouchée. L’élévation extérieure conserve en négatif la
0 3 m
EO
Etat 2
Etat 1
Élévation du parement intérieur du pignon nord.
51
B R I O N - D O M A I N E D E S B L O U I N E S
trace de ce four construit en même temps que le pignon et la cheminée.
La souche a conservé 5 m d’élévation ; la dernière assise se trouve à plus de 8 m au-dessus du sol intérieur. Un glacis pyramidal assure la transition entre la base, de plan carré, et la partie supérieure octogonale. La réfection du sommet de la souche en briques mécaniques surmontées d’un manchon en terre cuite, empêche d’en connaître la hauteur originelle. En restituant au moins une assise de couronnement, il est possible d’affi rmer que la souche dépassait d’au moins 2 m le sommet de la toiture originelle couvrant ce bâtiment.
Les rampants intérieurs et extérieurs s’alignent et dessinent une pente rectiligne très régulière qui exclue un pignon à l’origine découvert. La couverture venait nécessairement par-dessus l’arase des pignons, ainsi que le confi rme le solin de toit encore lisible à la base de la souche. En l’absence de toute trace sur l’élévation extérieure du pignon, il reste diffi cile de se prononcer sur une éventuelle toiture couvrant l’extrados du four.
Aménagements modernes
Le bâtiment a fait l’objet d’importants travaux au XVIe ou XVIIe siècle, lors de sa transformation en maison d’habitation. Il est procédé à l’arasement du mur oriental et au rehaussement des pignons afi n de permettre
la pose d’une charpente à chevrons porteurs à deux versants, isolée du rez-de-chaussée par un plafond. Le mur sud semble entièrement repris. Une cloison sépare au rez-de-chaussée la partie habitable de la pièce probablement réservée aux animaux. Une porte percée en hauteur dans le pignon nord donne accès à l’étage nouvellement créé, vraisemblablement utilisé comme espace de stockage.
Les cavités troglodytes
Une descenderie au nord-est du bâtiment dessert une petite salle troglodyte ouvrant vers trois galeries creusées dans le tuffeau. L’une d’entre elles, qui se prolongeait à l’est sous la route, a été récemment obstruée. Une seconde galerie vers le nord est fermée par un mur. La galerie sud, peu profonde, se termine en cul-de-sac. Dans l’espace central, de grands arcs soigneusement appareillés en pierre de taille, portent une voûte percée d’un oculus. Cet aménagement ne semble pas antérieur au XVIIIe siècle. L’entrée n’est pas représentée sur le cadastre napoléonien.
Une cuisine médiévale ?
La présence de la cheminée dans laquelle s’ouvre un four d’assez grande dimension, l’absence de traces d’aménagements résidentiels et la relative étroitesse du volume (6,5 m dans-œuvre) incitent à interpréter ce bâtiment comme un espace utilitaire, sans doute dédié à la préparation des aliments. Toutefois, le soin apporté à la mise en œuvre des maçonneries, le traitement de la cheminée, le décor de la porte, supposent un programme architectural qui ne se limite pas à ce seul édifi ce. Un ensemble plus vaste, dont plus aucune trace ne semble subsister5, se développait forcément à proximité immédiate.
D’un point de vue organisationnel, l’hypothèse de cuisines physiquement séparées d’autres bâtiments, et notamment de la salle seigneuriale, est tout à fait plausible. Un tel schéma, déjà envisagé pour d’autres sites
5 Une analyse de toutes les constructions proches, et notamment du logis accueillant l’actuelle maison de retraite, serait intéressante à mener pour tenter de mieux appréhender quel pouvait être l’environnement architectural du bâtiment étudié.
Élévation intérieure du piédroit gauche de la cheminée.
52
P A T R I M O I N E D ’ A N J O U : É T U D E S E T T R A V A U X 4
manoriaux angevins, a été mis en évidence en Angleterre dans le Sussex pour des contextes tardi-médiévaux et modernes (Martin, Martin 1997). Dans le cas précis des Blouines, il reste toutefois délicat de restituer des cuisines isolées, principalement du fait du volume de la toiture. En effet, en l’état actuel des connaissances, aucun bâtiment médiéval de plain-pied couvert par un toit à un seul versant n’a été identifi é dans l’Ouest de la France. L’hypothèse d’un volume édifi é en appentis contre un bâtiment plus haut à l’est, détruit, expliquerait la faible pente du toit ainsi que le développement en hauteur de la souche de
cheminée. La présence d’appentis constitue une disposition récurrente en Anjou et dans le Maine, spécialement contre les grandes salles de plain-pied des XIIIe et XIVe siècles (Carré et al. 2002 : La Gortaie à Louvaines, Longchamp à Miré vers 1340, Les Vaux à Daumeray, vers 1330-1350). On objectera dans le cas des Blouines qu’aucun arrachement de maçonnerie ne vient confi rmer cette hypothèse ; le mauvais état de conservation, les nombreuses lacunes, les diffi cultés de lecture du fait de la présence d’une haie le long du mur nord incitent cependant à rester très prudent.
0 3 m
Proposition de restitution des dispositions médiévales de l’élévation intérieure nord du pignon.
53
B R I O N - D O M A I N E D E S B L O U I N E S
L’emplacement de ce plausible bâtiment oriental devait être décalé vers le sud-est, afi n de dégager l’angle nord-est de la cuisine, ainsi que la porte dont le larmier se trouvait nécessairement à l’extérieur. La descenderie des troglodytes, si elle est ancienne, débouchait quelques mètres en avant de cette porte. Une disposition de ce type existait au manoir de Clairefontaine (Le Vieil-Baugé, 49) construit à la transition entre le XIVe et le XVe siècle sur une base des XIIe-XIIIe siècles (Scheffer, Serre 1997).
Rares sont les cuisines antérieures au xve siècle à avoir été formellement identifi ées dans un contexte manorial, d’une part parce qu’il ne semble pas qu’un espace soit systématiquement dédié pour abriter les fonctions culinaires, et d’autre part du fait de l’absence d’équipements caractéristiques. On ne rencontre pratiquement jamais de pierre d’évier ni de fours dans les manoirs angevins. Ces derniers pouvaient toutefois se trouver dans un bâtiment spécifi que (boulangerie), voire dans un lieu distinct, afi n de permettre une utilisation collective et payante.
En Anjou, pour la période antérieure au milieu du xve siècle, le seul four à pain associé de façon certaine à la cheminée d’un logis se trouve au manoir de Clairefontaine (Le Vieil-Baugé, 49). Dans le cas de la cheminée avec four à pain encore en place dans les communs du château de Bois Guignot à Bécon-les-Granits (49), l’importance des remaniements ne permet pas d’affi rmer que l’on se trouvait en présence d’une cuisine détachée. Le manoir de Boissay à Meigné-le-Vicomte conserve les pignons d’un bâtiment de plain-pied interprété comme une cuisine/boulangerie tardi-médiévale, vraisemblablement séparée du logis (Litoux 2005).
La datation
La datation de cet édifi ce reste délicate. L’intervalle de temps entre les états 1 et 2 pourrait avoir été très court (interruption temporaire d’un chantier ?). Le motif des consoles en quart de rond chanfreiné, décliné sur un, deux ou trois ressauts, est employé très fréquemment pour orner les piédroits des cheminées médiévales
angevines6. Les exemples précisément datés font malheureusement défaut. Pas plus le profi l des consoles de la cheminée que le traitement de la porte ou le type de mise en œuvre des pierres de taille ne permettent de resserrer une fourchette de datation assez large qui couvre la seconde moitié du XIIIe siècle et l’ensemble du XIVe siècle.
Les souches de cheminées en Anjou
La conservation de la souche de cheminée des Blouines est exceptionnelle. Contrairement à d’autres régions comme le Sud-Ouest de la France (Napoléone 2003 : 248-250), les parties aériennes des conduits de cheminées que l’exposition aux intempéries rend plus fragiles sont rarement parvenues jusqu’à nous en Anjou. Sur de nombreux édifi ces antérieurs au xve siècle, le positionnement des cheminées contre les murs gouttereaux a poussé les constructeurs à élever des souches très hautes de façon à monter plus haut que le faîtage et permettre ainsi un bon tirage7. Le développement en hauteur de la hotte dont la partie pyramidale dépasse fréquemment du toit, s’explique au moins en partie par le souci de renforcer l’assise du conduit.
6 Parmi les exemples proches, signalons en Maine-et-Loire le logis de Juigné-la-Prée à Morannes, vers 1242, le manoir de Longchamp à Miré, vers 1342, le manoir de Vilbouvey à Cuon, vers 1344, le manoir du Vivier à Lézigné (XIVe siècle), la cheminée conservée dans les dépendances du château de Bois-Guignot à Bécon-les-Granits, celle de maison troglodytique avenue des Roches à Fontevraud. En Indre-et-Loire : manoir de Courchamp à Chinon (vers 1285-90). En Sarthe : manoir de La Cour (2e quart du XIIIe siècle), manoir de La Corbinière à Bazouges-sur-le-Loir (XIVe siècle). En Mayenne : manoir du Plessis à Marigné-Peuton (XIVe siècle), manoir de La Grande Coudrière à Mézangers (XIVe siècle). 7 Concernant le développement en hauteur des souches de cheminées construites sur des murs gouttereaux, voir les différentes représentations de châteaux dans les Très riches heures du duc de Berry (Poitiers, Saumur, Lusignan…). Voir aussi les exemples conservés en Bretagne (Douard et al. 1993 : 115 et 172-173). En Ille-et-Vilaine citons les deux cheminées de La Fontenay à Chartres de Bretagne au conduit polygonal en brique sur une souche pyramidale. D’un strict point de vue technique, afi n d’assurer un tirage suffi sant pour une cheminée, les normes actuelles préconisent un rapport de 1/10 à 1/14 entre la hauteur du foyer et celle du conduit. Ce dernier doit par ailleurs s’élever de 40 cm au dessus de la partie la plus haute du toit s’il n’y a pas d’obstacle au faîte dans un rayon de huit mètres.
54
P A T R I M O I N E D ’ A N J O U : É T U D E S E T T R A V A U X 4
Les deux souches romanes, vraisem-blablement de la seconde moitié du XIIe siècle, de Briollay (maison dite du «palais de justice») et d’Angers (logis des Tourelles, sur l’ancienne île des Carmes) présentent un fût circulaire sur base rectangulaire. La seconde conserve un décor de griffes ainsi qu’un cordon sculpté. Les lourdes restaurations effectuées par L. Magne à l’abbaye de Fontevraud au début du XXe siècle, empêchent de statuer sur l’historicité des lanternons qui coiffent les cuisines romanes. La représentation du château de Saumur dans les Très riches heures du duc de Berry montre des souches de la fi n du XIVe siècle qui semblent presque toutes cylindriques ; on remarque des couronnements en mitres tronconiques ou moulurés.
Une étude resterait à mener en archive pour mieux documenter l’histoire de la seigneurie et renseigner notamment toutes les modifi cations apportées au logis à l’Époque moderne. Ce bâtiment, qu’il soit un ancien appentis ou une construction séparée, reste un témoignage rare et précieux qui nous aide à mieux comprendre et restituer l’environnement des salles seigneuriales dont les trop rares exemples parvenus jusqu’à nous se limitent généralement à la seule partie centrale. Par ailleurs, la souche constitue en l’état actuel des connaissances, un cas unique dans le département.
Pignon nord.
55
BOUZILLÉ
CHÂTEAU DE LA BOURGONNIÈRE
La Bourgonnière appartient en 1340 à Raoul le Gaudi, chevalier, en 1370 à Hugues Pelaud et Marguerite de Savennières. Leur fi lle Lucette Pelaud se marie en 1384 à Jean Chapperon. En 1446, l’abbé de Saint-Florent, après s’y être opposé, accorde une autorisation de fortifi er le site à Jacques Duplessis et son épouse Alnette Chapperon. En 1475, un hommage est rendu à l’abbé de Saint-Florent-le-Vieil au regard de son chastel et chastellenie de St-Florent le viel. Jehan du Plessis, écuyer, seigneur du Plessis rend hommage pour raison de son hostel et fortifi cation de la Bourguygnière avecques les foussés jardins estanges et toux leurs appendances et deppendances etc1. Un aveu analogue est rendu en 15062. Entre 1481 et 1492, plusieurs arrêts du parlement de Paris maintiennent à l’abbé le droit de pratiquer la chasse avec chiens et autres animaux sur les terres de la Bourgonnière et Bouzillé (Port 1874).
La seigneurie de la Bourgonnière étendait sa domination sur presque toute la paroisse de Bouzillé3, ainsi que sur plusieurs fi efs des paroisses alentours. Le noyau médiéval, assis sur un substrat précambrien de micaschiste, est implanté en bas de pente, à 16 m NGF, sur la rive ouest du ruisseau des Haies, dans une position topographique défavorable si l’on considère la remontée brusque du terrain au nord du cours d’eau (sommet vers 25 m NGF) . La volonté de créer des aménagements hydrauliques défensifs justifi ent peut-être cette implantation. Le cadastre de 1830 fi gure en effet des douves contournant les bâtiments par le nord-est, alimentées en eau par une dérivation du ruisseau. Rien ne permet
1 ADML, H 3715, fol. 109 r°.2 ADML, H 3715, fol. 119 v°.3 Le château est implanté à 2,2 km à l’est du centre paroissial.
toutefois de les faire remonter avec certitude à la période médiévale.
Le corps de logis étudié forme l’aile nord d’une cour quadrangulaire dont la création résulte d’une restructuration du milieu du XVe siècle avec, pour élément dominant, la construction d’une grande tour résidentielle. Cette dernière occupe l’angle sud-est de la cour. Un autre organe de fl anquement se dresse à l’angle sud-ouest. Les deux portions de la courtine sud, qui conservent les traces d’un chemin de ronde sur mâchicoulis, prennent appui à mi-distance entre deux tours, sur une porterie manifestement plus ancienne. Le mur ouest, plus bas, est percé d’une large porte charretière accompagnée d’un passage piétonnier. Le mur oriental, dont se lit très clairement l’arrachement sur la tour résidentielle, subsiste sans doute en partie dans le cellier édifi é au XIXe siècle.
Le déclassement du logis seigneurial primitif est survenu assez tôt. Néanmoins, l’érection de la grande tour n’a pas entraîné immédiatement l’abandon de toute vocation résidentielle puisque des travaux de réaménagements semblent concerner, vers la même époque, l’aile nord. La transformation de l’ancien corps de logis en dépendances agricoles découle sans doute plus directement de l’édifi cation, à la Renaissance, d’un nouveau château implanté à quelques dizaines de mètres au sud de la cour médiévale. Dans son ensemble, le noyau médiéval a toujours été entretenu et fi nalement assez peu modifi é depuis sa construction. Ce fait, suffi samment rare pour être souligné, offre aujourd’hui la possibilité de restituer l’essentiel des dispositions originelles.
Des relevés en plan, coupe et élévation réalisés par P. Filâtre et L. Kientz et ont été utilisés pour reporter l’ensemble des
56
P A T R I M O I N E D ’ A N J O U : É T U D E S E T T R A V A U X 4
observations4. Sauf mention contraire, les autres documents sont des auteurs.
Le corps de logis se présente sous la forme d’un bâtiment très allongé (45,5 m hors-œuvre. L’observation des maçonneries, notamment l’absence de traces d’arrachements,
4 Les auteurs adressent leurs remerciements aux propriétaires, M. et Mme Emmanuel de Saint Pern, pour leur avoir laissé libre accès aux bâtiments, ainsi qu’à la Conservation des Régionale de Monuments Historiques pour avoir bien voulu leur communiquer une copie des relevés existants.
et la présence de contreforts à chaque extrémité, indiquent que le bâtiment est conservé en plan dans son intégralité. La disposition et le traitement des ouvertures permettent de situer la façade principale au sud. Le fait que l’angle sud-ouest soit chanfreiné en partie basse plaide également dans le même sens. La façade nord, scandée par les contreforts, les massifs de latrines et les coffres de cheminées, montre une élévation plus sévère.
Les murs en moellons de gneiss, de forme plus ou moins allongée, sont liés à l’aide
0 10 m
Plan du noyau médiéval avec le corps de logis primitif (aile nord) en gris foncé et les modifi cations du XVe siècle (tour résidentielle, tour de fl anquement et courtines) en gris clair. P. Filâtre, L. Kientz.
57
B O U Z I L L É - C H Â T E A U D E L A B O U R G O N N I È R E
Coupe transversale vers l’est du noyau médié-val. P. Filâtre, L. Kientz.
d’un mortier de chaux blanc assez grossier mais de bonne tenue mécanique. Le tuffeau, à l’évidence importé de carrières situées en amont sur la Loire, est réservé aux encadrements, à certaines parties des chaînes d’angle ainsi qu’aux éléments de décor (cheminée, lavabo). Les faibles dimensions des pierres de taille et leur utilisation parcimonieuse s’expliquent vraisemblablement par des coûts de transport importants (malgré la proximité du fl euve). Le granite se retrouve employé ponctuellement notamment pour certains encadrements de soupiraux liés à des remaniements. La charpente à fermes et à pannes, d’une pente de 16°, a été mise en place à une date tardive. Elle porte une couverture de tuiles canal.
58
P A T R I M O I N E D ’ A N J O U : É T U D E S E T T R A V A U X 4
Restitution de l’état originel
Le volume interne comprend un rez-de-chaussée surmonté d’un étage montant sous charpente. Si l’on excepte les subdivisions ajoutées ultérieurement, l’édifi ce montre un plan identique aux deux niveaux : une vaste grande salle centrale, longue de 26,25 m, encadrée à l’est et à l’ouest par deux pièces longues respectivement de 10,0 m et 5,75 m. Les murs mesurent 1,25 m d’épaisseur au rez-de-chaussée, contre 0,9 m à l’étage. Le plancher portés par des poutres disposées perpendiculairement aux murs gouttereaux, a été entièrement repris ; certaines des solives caractérisées par de fortes sections, pourraient toutefois provenir de la structure primitive. Les refends, au moins au premier étage, ont été construits postérieurement aux gouttereaux à en juger par l’absence de véritable liaisonnement. Il est toutefois exclu de les rattacher à une campagne de travaux plus tardive ne serait-ce qu’au regard de la distribution et
des différents aménagements préservés. D’une part, les piédroits des deux portes intérieures sont strictement contemporains des gouttereaux. Enfi n, le traitement de la cheminée localisée sur le mur de refend oriental est en tous points similaires à celui des autres cheminées du gouttereau nord.
Le rez-de-chaussée
Du fait de son affectation agricole, le rez-de-chaussée a fait l’objet de remaniements qui ont détruit ou masqué de nombreux éléments anciens. Au moins trois grandes baies couvertes par un arc segmentaire à double rouleau ouvraient sur la cour. Il reste impossible de déterminer s’il s’agissait de portes ou de fenêtres, même si la première hypothèse est privilégiée. Pour l’ensemble des ouvertures, même lorsque les encadrements extérieurs ont été refaits, le traitement caractéristique des arrières voussures
Vue générale de la façade sud du corps de logis nord.
59
B O U Z I L L É - C H Â T E A U D E L A B O U R G O N N I È R E
chanfreinées permet de pointer les ouvertures liées au premier état du bâtiment.
La pièce centrale, aujourd’hui subdivisée par un mur de refend et une cloison, s’ouvrait à l’origine au sud par au moins deux grandes baies et un soupirail5. Les deux portes du mur nord correspondent à des percements tardifs. Cependant, à côté de l’ouverture occidentale subsiste une pierre de taille prise dans le contrefort occidental, qui pourrait correspondre au sommier d’un arc de porte ancienne.
Une porte dans le refend mène vers la pièce orientale. Un accès semble avoir existé directement depuis la cour, mais il a été entièrement repris. La pièce prenait le jour par deux étroites fenêtres ouvrant en hauteur au sud et à l’est. Le mur nord comporte une cheminée faiblement saillante (0,2 m) ; la présence d’un arc de décharge a permis de maintenir la hotte en place, alors même que le manteau s’est effondré. Le contre-cœur conserve à la base un appareil de briques en épi (opus spicatum) ; il a été détruit en partie supérieure par l’installation d’un four à pain dont ne subsiste plus que la gueule. Une porte aujourd’hui bouchée, couverte par un arc en plein cintre, jouxte la cheminée, à droite. Ses faibles dimensions (0,6 m de large pour 1,4 m de haut) amènent à privilégier l’hypothèse d’une porte de latrine.
La pièce occidentale s’ouvre vers la cour par une grande baie et un soupirail. Sur le parement extérieur du pignon se lit l’encadrement d’une porte couverte par un arc brisé dissymétrique. Une dernière porte, à l’extrémité ouest du mur nord, donnait accès à une probable latrine adossée au contrefort occidental. Bien qu’ayant été détruite et masquée derrière un enduit, il est possible de restituer une cheminée sur le mur nord6.
5 Le soupirail a été par la suite transformé en porte, puis condamné par la construction du massif portant l’escalier extérieur.6 Le conduit de cette cheminée subsiste en arrière de celle de l’étage, dans l’épaisseur du coffre.
Elévation de la façade nord du corps de logis nord. P. Filâtre, L. Kientz.
60
P A T R I M O I N E D ’ A N J O U : É T U D E S E T T R A V A U X 4
015
m
Prem
ier é
tag
e
Rez-
de-
chau
ssée
Port
e ?
Latr
ines
?La
trin
es ?
Latr
ines
?
Gal
erie
?G
aler
ie ?
Latr
ines
Latr
ines
Latr
ines
Ch
emin
ée
Ch
emin
ée
Ch
emin
éeC
hem
inée
Plac
ard
Pisc
ine
Plac
ard
?
cham
bre
Salle
Ch
apel
le ?
clo
iso
n ?
Restitution des dispositions originelles du rez-de-chaussée et du premier étage du corps de logis nord ; en gris les volumes disparus.
61
B O U Z I L L É - C H Â T E A U D E L A B O U R G O N N I È R E
Le premier étage
L’analyse n’a livré aucune trace d’es-calier intérieur. L’accès à l’étage s’effectuait visiblement depuis l’extérieur, comme en té-moignent les deux portes ménagées au premier étage sur la façade sud. Le seuil de ces baies est associé à un ressaut continu d’une dizaine de centimètres de largeur qui forme un retour sur le pignon ouest. Ce dispositif autorise la restitution d’une galerie, vraisemblablement couverte par le prolongement du toit (Le manoir en Bretagne 1993 : 155-161).
La porte ouvrant à l’extrémité ouest de la grande salle constituait l’accès principal. Large d’environ 1,35 m, elle était couverte par un arc brisé, surmonté d’une archivolte. Le sommet des piédroits s’ornait d’éléments sculptés aujourd’hui bûchés. La pièce centrale, de près de 180 m², est caractérisée par un volume particulièrement allongé, relativement inhabituel dans ce type d’architecture7. La présence de cloisonnements ne peut être totalement exclue, par exemple pour
7 La pièce mesure 26,25 x 6,90 m, soit 80 x 21 pieds de 0,328 cm.
créer une sorte de pièce d’entrée à l’extrémité ouest de la salle ; un tel aménagement poserait toutefois des problèmes d’éclairage, sauf à envisager une paroi largement ajourée.
La disposition des quatre fenêtres à meneau et traverse laisse l’entrée dans la pénombre. Les encadrements extérieurs sont soulignés par un chanfrein large faisant retour sur l’appui. Les croisées disposent systématiquement de deux coussièges, relativement courts du fait de la faible épaisseur des murs. Les traces des barreaux horizontaux enchâssés dans les tableaux pourraient correspondre à des aménagements originels. Des huisseries, qui fermaient les parties hautes et basses des baies, ne subsistent que les gonds scellés au plomb. Comme au rez-de-chaussée, les arrière-voussures en tuffeau sont toutes chanfreinées.
Deux cheminées identiques, l’une vers le centre du mur gouttereau nord, l’autre centrée sur le refend oriental, équipent la pièce. Les manteaux et hottes pyramidales ont disparu mais peuvent être resitués à partir des traces visibles sur le mur. Les piédroits, largement chanfreinés prenaient naissance sur des bases quadrangulaires simples dont le seul élément de décor est constitué par les congés, surmontés d’une bague. Les corbeaux ont complètement disparu. Le manteau était constitué de pièces de bois profondément ancrées dans les maçonneries ; pour les deux cheminées, les poutraisons latérales de 40 cm de haut pour une largeur de 25 à 30 cm, ont été sciées et réduites à une largeur d’une quinzaine de centimètres pour la partie saillant du mur. Elles supportaient une corniche en tuffeau fi nement moulurée avec des retours sur les murs formant de petites tablettes latérales. D’une profondeur très faible, l’âtre se caractérise par une forte hauteur (près de 2,0 m de haut) avec une largeur de 2,5 m. Le contre-cœur est dressé avec des briques fi nes (chantignolles) disposées en épis sur près d’un mètre de hauteur. La présence d’un coffre saillant et montant de
Vue de la porte ouest ouvrant au rez-de-chaussée de la façade sud du corps de logis nord.
62
P A T R I M O I N E D ’ A N J O U : É T U D E S E T T R A V A U X 4
fond sur le mur nord, évite aux pièces de bois de la cheminée, longues de près d’1,2 m, de ressortir à l’extérieur.
À gauche de la cheminée orientale s’ouvrait, à 1 m du sol, une fente (de 0,2 m x 0, 6 m aujourd’hui bouchée) équipée d’un volet en bois. Par analogie avec des dispositions observées dans des manoirs bretons, il pourrait s’agir d’un judas destiné à surveiller l’activité dans la grande salle depuis la pièce orientale (Douard et al. 1993 : 79-80). Ce dispositif n’a pas d’équivalent connu à ce jour en Anjou sur des édifi ces de cette époque.
Dans l’angle nord-ouest, une petite porte desservait selon toute vraisemblance des latrines. Cette ouverture, aujourd’hui bouchée, est couverte d’un arc brisé (0,79 m de large pour une hauteur maximale d’environ 1,7 m). Sans doute afi n d’économiser le matériau, les tuffeaux de l’encadrement ont été disposés verticalement, en délit. L’arrière voussure, visible de l’extérieur, suit un plan oblique, de manière à éviter la superposition des latrines avec un petit contrefort raidissant la partie inférieure du mur.
L’unique accès à la pièce occidentale (10,1 x 6,8 m) s’effectuait par une porte ménagée à l’extrémité nord du mur de refend. La reconstruction de ce dernier, sans doute à une date relativement tardive (XIXe siècle ?) a fait disparaître cette ouverture dont ne subsiste que le piédroit nord pris dans le mur gouttereau. La pièce mesure 10,0 x 6,8 m. Une cheminée, comparable aux précédentes bien que moins large (2,17 m) occupe le mur nord. Elle s’adosse de la même façon à un coffre extérieur. L’extrémité sud du mur ouest conserve la trace d’un encadrement large de 87 cm. Le sommet de l’arc segmentaire se trouve à 2,5 m au-dessus du sol actuel. L’absence d’éléments observables au revers de ce mur incline à restituer un aménagement de type placard, même si une porte ne peut être exclue. Une porte en arc brisé large de seulement 52 cm, haute d’un peu plus d’1,5 m, donnait sans doute accès à des latrines
adossées à la façade nord, contre le contrefort d’angle. Trois fenêtres éclairaient cet espace. Deux fenêtres à croisée, sur les murs nord et sud, ont été fortement remaniées mais restent clairement lisibles. De la baie aménagée dans le mur ouest ne subsiste en revanche que quelques blocs de l’encadrement permettant de restituer une fenêtre étroite, ouverte dans la partie triangulaire du pignon.
La pièce orientale de 6,8 x 5,8 m disposait de deux accès distincts. Une porte, aujourd’hui murée, était accessible depuis la galerie ; l’encadrement extérieur en arc brisé et ses dimensions (0,9 m de large) en font l’accès principal à cet espace. Une seconde porte aménagée dans le refend, sensiblement plus étroite (0,7 m) permet un accès depuis la grande salle. Sur le mur oriental, une niche comportant une étagère en pierre et une cuvette percée d’un trou, remplissait vraisemblablement une fonction liturgique. L’arc de couverture, orné d’un trilobe aux écoinçons ajourés, est souligné d’une moulure torique à base prismatique. Immédiatement à droite, une lancette centrale, large de 0,44 m, s’étire pratiquement jusqu’au faîtage. Elle semble dès l’origine avoir été divisée en deux par une traverse située à mi-hauteur. Le traitement moins soigné de l’embrasure, en
Vue de la cheminée équipant la pièce située en rez-de-chaussée à l’extrémité orientale du corps de logis nord.
63
B O U Z I L L É - C H Â T E A U D E L A B O U R G O N N I È R E
Vue de la partie orientale de la façade sud du corps de logis nord.
Façade sud du corps de logis nord, détail de la porte origi-nelle ouvrant sur la salle.
64
P A T R I M O I N E D ’ A N J O U : É T U D E S E T T R A V A U X 4
partie inférieure, suggère des modifi cations que la présence d’un enduit empêche de lire.
Au nord, une porte murée débouchait sur un volume entièrement détruit interprété comme une latrine. L’encadrement en arc brisé, mesure 0,8 m de large, pour une hauteur restituée d’environ 1,55 m. L’ouverture jouxtait une cheminée stylistiquement très proche des précédentes. Ses dimensions sont toutefois plus modestes (1,74 m de large) ; d’autre part, le manteau, entièrement en tuffeau, portait une hotte en pierre. Enfi n, le traitement général est plus sobre : la base ne présente pas de bague et la tablette latérale est simplement chanfreinée. Enfi n, elle ne s’adosse pas à un coffre en saillie sur l’extérieur.
Un placard à deux niveaux, larges de 0,55 m et séparés par une étagère de pierre, est aménagé dans le mur de refend. Le niveau bas, condamné, correspond à un judas ouvrant sur la grande salle centrale ou un hagioscope dirigé vers la la chapelle. Le renfoncement supérieur couvert par un linteau taillé dans une pierre semi-circulaire, dispose d’une étagère en bois. La position très en hauteur de ce placard s’explique sans doute par sa superposition avec le judas.
Interprétation
Pour le rez-de-chaussée, la largeur des portes donnant sur la cour et, de façon concomitante, l’étroitesse des fenêtres plaident pour des espaces utilitaires. La grande pièce centrale, peut-être divisée par des partitions internes, semble avoir été dévolue au stockage, si l’on en juge par l’absence (apparente ?) de tout équipement, à l’exception de possibles latrines. Les deux pièces latérales, à peine mieux éclairées, étaient chacune pourvues d’une cheminée ainsi que de latrines. L’une de ces pièces servait très vraisemblablement de cuisine. L’autre pourrait avoir été dévolue à un offi cier du seigneur, éventuellement un intendant.
Les fonctions nobles se concentrent manifestement à l’étage ainsi qu’il est d’usage. La probable galerie, pour laquelle il est diffi cile de savoir si elle se prolongeait en retour le long du pignon occidental, devait être desservie par un escalier extérieur droit. La porte principale
débouchait sur la salle seigneuriale qui occupait une position centrale. L’emplacement des fenêtres à croisée et des cheminées désigne sans ambiguïté l’extrémité orientale comme le « haut bout ».
La pièce orientale semble voir eu une fonction religieuse. La niche est en tous points semblable aux piscines dans lesquelles les prêtres lavaient la vaisselle liturgique et rejetaient l’eau en terre consacrée. La fenêtre orientale, seule ouverture à prodiguer de la lumière, procède également d’une dialectique religieuse. La présence des éléments de confort (cheminée, probables latrines et placard) ne contredit pas l’hypothèse d’une chapelle privative, lieu de prière disposant des aménagements nécessaires à la célébration d’un offi ce.
La pièce occidentale, à l’opposé du haut bout de la salle, peut être identifi ée comme la chambre. Largement éclairée sur trois côtés, cette pièce possède ses propres latrines.
Salle du premier étage du corps de logis nord, détail du tableau de la fenêtre à croisée nord-est conservant des traces de scellement de grille, des gonds pour châssis
ouvrants et des encoches pour barres de blocage.
65
B O U Z I L L É - C H Â T E A U D E L A B O U R G O N N I È R E
Les murs sont recouverts d’un enduit grossier résiduel venu, dès l’origine, recouvrir les moellons des murs. D’éventuelles couches de fi nition ont pu disparaître sans laisser de traces.
La réfection complète de la charpente, à une date sans doute assez tardive, empêche de connaître le traitement des parties supérieures. Le positionnement de la baie dans le mur pignon oriental s’accorde assez bien avec la restitution de volumes montant sous une charpente apparente ou lambrissée. Par analogies avec d’autres sites du même type, la couverture d’origine devait présenter une pente beaucoup plus prononcée que la pente actuelle. Compte tenu de l’ampleur du programme architectural, une couverture en ardoise semble la plus probable.
En somme, le logis seigneurial primitif, exceptionnel par son état de conservation, présente une structuration fréquemment attestée aux XIIIe-XIVe siècles et pouvant perdurer jusque dans le milieu du XVe siècle (logis du Plessis Macé, vers 1450). La présence de fenêtres à croisées interdit, au regard des connaissances actuelles, une datation antérieure au 2e tiers du XIVe siècle. Ces éléments, couplés avec le type de mouluration des corniches des cheminées et
le traitement de la niche de la pièce orientale, orientent la datation vers la seconde moitié du XIVe siècle, en tous les cas antérieurement aux travaux de restructuration survenus vers le milieu du XVe siècle.
Salle du premier étage du corps de logis nord, détail de la poutre sciée qui portait la hotte de la cheminée adossée au mur de refend oriental.
Angle extérieur nord-ouest du corps de logis nord.
66
P A T R I M O I N E D ’ A N J O U : É T U D E S E T T R A V A U X 4
Vue de la pièce orientale du premier étage du corps de logis nord avec de gauche à droite une cheminée, une porte et une niche servant probablement de piscine liturgique.
Façade nord du corps de logis nord. Déplacement et trans-formation de la fenêtre éclairant la pièce orientale du premier étage.
67
B O U Z I L L É - C H Â T E A U D E L A B O U R G O N N I È R E
Les remaniements du XVe siècle
Au rez-de-chaussée, deux soupiraux sont percés dans le mur nord de la grande pièce. L’emploi du granite pour l’encadrement extérieur, l’absence de chanfrein au niveau de l’arrière voussure, l’ébrasement intérieur très prononcé, la présence enfi n de grilles, présentent des parentés très fortes avec le traitement des ouvertures sur la tour résidentielle.
À l’étage, les principales modifi cations du bâtiment en tant que logis résidentiel concernent les deux petites pièces du premier étage. La chambre occidentale voit deux de ses fenêtres modifi ées. La baie nord est bouchée afi n de permettre le percement d’une ouverture plus petite à deux battants mais dépourvue de meneau, immédiatement à droite de la cheminée. La mouluration torique soulignée par deux cavets, est très similaire à ce que l’on peut observer sur la grande tour résidentielle. La grande fenêtre occidentale est réduite en hauteur ; elle reçoit deux coussièges. Dans la pièce orientale, une seconde traverse est insérée dans la partie supérieure de la grande lancette.
Les modifi cations des deux ouvertures qui montaient très haut dans les pignons semblent imputables à l’insertion d’un plafond. Ce dernier fut vraisemblablement installé à un niveau trop bas pour conserver telles quelles les ouvertures originelles8. Dans la pièce orientale, l’enduit mural accompagnant ou du moins suivant de peu cette phase de travaux est venu mouler les poutres du plafond.
Des similitudes dans le traitement des ouvertures (mise en œuvre du granite, type de grilles) incitent à inscrire ces remaniements sur le logis dans le cadre plus général de la restructuration complète du site vers le milieu du XVe siècle (faisant suite à l’autorisation de fortifi er en 1446 ?). Des murs de courtine viennent délimiter une cour que domine la grande tour résidentielle édifi ée dans l’angle sud-est.
8 Le plafond se situe à respectivement 3,5 m et 3,65 m au-dessus des sols restitués des pièces ouest et est.
Lors de la reprise des charpentes, la cheminée de la pièce orientale était toujours en usage ; un chevêtre permet en effet le passage du conduit.
Le mur nord de la salle conserve à gauche de la croisée ouest les traces d’accroche de ce qui semble correspondre à la hotte pyramidale d’une cheminée construite au rez-de-chaussée. Outre son positionnement incongru dans la salle d’apparat de ce manoir, la faiblesse de l’ancrage dans les maçonneries plaide pour un aménagement relativement tardif.
Les huisseries de la tour résidentielle du XVe siècle
Cette tour de cinq niveaux, dont un de cave, et tourelle d’escalier hors-œuvre, conserve un certain nombre d’huisseries contemporaines de sa construction au XVe siècle (probablement dans le troisième quart). Il s’agit uniquement de portes et de tournavents ou tambours de porte. En effet, toutes les huisseries de fenêtre sur châssis sont à rapprocher de modèles de la fi n du XVIIIe siècle ou du début du siècle suivant. Dans l’escalier, outre les grilles encore en place, il est possible d’observer les gonds des vantaux originels scellés dans la maçonnerie.
Il subsiste cinq portes et deux tambours de porte qui vont être évoqués en débutant par l’entrée.
La porte d’entrée est composée de sept planches verticales épaisses à feuillure (environ 4 cm) maintenues par les ferrures et des traverses. Elle repose sur une crapaudine et un gond en partie haute. Des quatre traverses horizontales, seules les deux supérieures sont chevillées aux planches. En partie basse, deux traverses et une croix de Saint-André sont assemblées par de grands clous à tête pyramidale dont la pointe a été retournée en contre-parement. Sur la face extérieure, les trois traverses, de faible épaisseur, correspondent à des rajouts tardifs. Il n’y a pas de traverse haute ou basse sur le parement.
La porte d’accès à la salle du rez-de-chaussée est un vantail constitué de cinq planches verticales assemblées à feuillure droite permettant d’obtenir un parement plan sans traverse haute et basse. Deux ferrures de gond
68
P A T R I M O I N E D ’ A N J O U : É T U D E S E T T R A V A U X 4
Prem
ieré
tag
e
Rez-
de-c
haus
sée
Port
e ?
Latri
nes
Latri
nes
Latri
nes
Gale
rie ?
Latri
nes
Latri
nes
Latri
nes
015
m
Plans du rez-de-chaussée et du premier étage du corps de logis nord. Restitution de l’édifi ce dans la seconde moitié du XVe siècle.
69
B O U Z I L L É - C H Â T E A U D E L A B O U R G O N N I È R E
viennent maintenir la liaison que complètent des traverses carrées chevillées sur la face arrière. L’extrémité de ces pentures se termine par un décor fl eurdelisé assez grossier obtenu par une découpe à chaud. La planche coté serrure est le produit d’une restauration bien que la serrure à moraillon, posée à l’envers, soit médiévale.
La porte d’accès du premier étage constituée également de cinq planches verticales présente un léger relief. En effet, les montants extérieurs et médians présentent une surépaisseur de 10 mm soulignée par un chanfrein plat. Quatre traverses de 42 x 55 mm sont chevillées en contre-parement. Deux ferrures à œil, visibles en parement sur la presque totalité de la largeur, enserrent le montant. Outre les clous de fi xation, la ferrure s’encastre partiellement dans le panneau. Il s’ensuit que les ferrures ont été installées avant la pose de traverses bois sur le contre-parement. Cette porte, comme les précédentes, vient s’appliquer directement contre le tableau de pierre sans chambranle et les gonds à fi che sont scellés dans la
maçonnerie. Les traverses hautes et basses sont des restaurations tardives (XIXe siècle ?).
Appliqué sur le mur intérieur de la pièce, un cadre doté d’une porte forme un sas d’entrée dans l’épaisseur du mur. Ce sas, autrement nommé tournavent ou tambour de porte, est destiné à limiter les courants d’air venant de l’escalier. Deux montants larges (230 x 37 mm) avec traverses horizontales haute et basse composent le cadre. Une traverse intermédiaire forme le linteau de la porte. En partie supérieure, le tiers supérieur est scandé de deux montants verticaux plus étroits (90 x 37 mm) et des panneaux plats sans décor. L’ensemble, en chêne débité sur dosse, est assemblé à tenon et à mortaise puis fi xé au mur par le biais de six pattes-fi ches clouées au moyen de pointes à en relief tête
Vue d’ensemble de la face visible depuis la salle du tambour de porte du 1er étage.
Détail de la face visible depuis la salle du tambour de porte du 1er étage au niveau de l’angle supérieur droit
du vantail.
70
P A T R I M O I N E D ’ A N J O U : É T U D E S E T T R A V A U X 4
A B C
D
E F
BA
C
D
E F
0 10 cm
0 1 m0 1 m Salle
escalier
Plan et élévation de la face vi-sible depuis la salle du tambour de porte du 2e étage, le vantail récent n’a pas été relevé.
71
B O U Z I L L É - C H Â T E A U D E L A B O U R G O N N I È R E
allongée. Le battant de porte est lié au cadre par des charnières à trois nœuds clouées. Un joint de mortier limite le passage d’air entre le tambour et le mur. L’ensemble a été blanchi en même temps que les murs, le joint d’étanchéité à la chaux et le tambour. Aucune reprise n’est visible sur le cadre du tambour, en revanche la porte résulte d’une restauration récente (fi n XVIIIe siècle ou XIXe siècle) avec un cadre que divisent un montant et une traverse en chêne et des panneaux en peuplier non blanchis à la chaux.
L’accès à la courtine orientale conserve sa porte d’origine reprenant des dispositions observées au rez-de-chaussée et au premier étage avec ses planches verticales à feuillure, ses tasseaux chevillés en contre-parement et ses ferrures à emboitement. Elle possède encore sa serrure à moraillon du XVe siècle.
Au deuxième étage, l’accès à la salle conserve ses huisseries d’origine. Le traitement de la porte et du tambour de ce niveau présente quelques différences qui sont à rapprocher des soins particuliers apportés à la mouluration de la cheminée et au couvrement de la salle. La porte, composée d’un cadre, d’une traverse et d’un montant médian divisant la surface en quatre, est en chêne. Les panneaux plans sont constitués de planches débitées sur maille puis rabotées et non décorées. Seul le quart inférieur côté serrure a fait l’objet d’une restauration. Les ferrures à platine rectangulaire verticale sont clouées au seul montant.
Le tambour de porte présente quelques points communs avec celui de l’étage inférieur. Il diffère par la structure des montants, constitués de deux pièces accolées et le traitement de la partie haute. En effet, les deux montants se terminent par un petit pinacle à fl euron à quelque 20 cm au-dessus de la traverse haute. Cette dernière, comme la face intérieure des montants, présente une rainure large et profonde de 10 mm. Elle était destinée à recevoir un décor constitué d’un panneau ajouré et découpé comme cela peut être observé sur d’autres exemples.
Les montants latéraux viennent enserrer ceux de la porte dans une feuillure et des traverses horizontales. Des assemblages à tenon et à mortaise avec deux chevilles maintiennent l’ensemble. Les embrèvements de la traverse basse et de celle formant le linteau de la porte augmentent la rigidité de l’ensemble.
La porte est plus récente. La facture des cadres à mortaise traversante et des panneaux en peuplier signe une facture des XVIIIe ou XIXe siècles. De plus, sur le montant droit, il est possible de repérer l’emplacement des platines des anciennes charnières sans doute similaires à celles subsistant à l’étage inférieur. Lors de la réfection de la porte, les charnières ont été remplacées par des ferrures à platine et des gonds à fi ches retournées en contre-parement. Le poucier actuel de production récente a été substitué au simple loquet originel.
À la différence des quelques éléments de tambour de porte connus en France, les constructeurs de la tour ont utilisé l’épaisseur du mur (1,26 m entre les portes et 1,57 m au total) pour concevoir l’espace de dégagement nécessaire à l’ouverture des portes. La sobriété des structures conservées dans la tour du château de la Bourgonnière
Détail de la face visible depuis la salle du tambour de porte du 2e étage avec les traces d’une ancienne ferrure.
72
P A T R I M O I N E D ’ A N J O U : É T U D E S E T T R A V A U X 4
est un des caractères de ces tambours de porte qui les distingue des autres exemples connus à ce jour. Rares sont les menuiseries de ce type des XVe et XVIe siècles qui nous soient parvenues. Elles proviennent toutes de constructions seigneuriales. À partir de la seconde moitié du XVIIe siècle la plupart de ces aménagements conservés se rencontrent dans des églises. Ainsi, en Anjou un fragment a été identifi é au château de Montsoreau. Il s’agit d’un panneau latéral au décor de plis de serviette attribuable aux années 1460-1470. Outre la célèbre cloison de sa chapelle, le château du Plessis-Macé conserve également un tambour de porte complet en place. Le décor de panneaux à plis de parchemin est associé en partie sommitale avec un décor ajouré fl amboyant à mouchettes et souffl ets cantonnée de pinacles à crochets. Dans le Maine, provenant de l’ancien hôtel des abbés de Clermont à Laval, subsiste un panneau à décor de plis de parchemin avec sa porte. En partie supérieure, les poteaux se terminent par un pinacle plus complexe que ceux présentés ici, des fragments du décor sommital sont également conservés. Il faut s’éloigner du grand ouest pour trouver des exemplaires plus complets comme celui du château de Lussac-Les-châteaux dans la Vienne, ceux de Villeneuve-Lembron dans
le Puy-de-Dôme ou celui de la maison-forte de Rosières à Saint-Seine-sur-Vingeanne en Côte-d’Or. Il s’agit de tambour de porte décoré de plis de parchemin mais dont le dernier est dépourvu d’ornementation en partie supérieure. Les exemples plus récents du XVIe du château de la Roche du Maine en Vienne ou du XVIIe siècle au manoir de la Fleuriaie à Aviré en Maine-et-Loire sont constitués d’une grille de montants et traverses encadrant de simples panneaux plans. Dans ces deux cas, ils empiètent sur le volume de la salle desservie par le tambour de porte.
La tour du château de la Bourgonnière conserve donc un nombre important d’huisseries
de la seconde moitié du XVe siècle, qui bien qu’ayant subit les outrages du temps, témoignent des aménagements et du niveau confort que possédaient les édifi ces de cette importance. Les portes, bien que dépourvues de décor, autorise une meilleure approche des procédés des menuisiers médiévaux. Les différences de traitement, en particulier celle du second étage ,soulignent la hiérarchisation des espaces. Il se retrouve matérialisée dans le reste du programme architectural de la tour (couvrement des pièces ,ornementations des cheminées…). Mais c’est par la préservation des tambours de porte, où l’on retrouve la même hiérarchisation que dans les portes, que la Bourgonnière prend tout son intérêt. Ces éléments à double vantaux sont les seuls témoins actuellement connus dans les Pays-de-la-Loire. Cette tour présente par ailleurs de nombreux aspects intéressants pour l’histoire de l’architecture du milieu du XVe siècle dont, pour se limiter à l’utilisation du bois, des planchers à solives jointives en sous-face desquelles des liteaux de chêne cloués maintiennent un enduit ou, autre exemple, la barre d’appui de la bouche à feu du rez-de-chaussée.
Partie haute de la face visible depuis l’escalier du tambour de porte du 2e étage avec l’arrière voussure du passage.
73
LE PLESSIS-MACÉ
CHÂTEAU
Le château est attesté comme châtellenie entre 1089 et 1102 après que Mathieu ou Macé du Plessis, qui tenait le fi ef depuis le milieu du XIe siècle, l’ait laissé à son fi ls avant de se retirer à l’abbaye Saint-Serge d’Angers vers 1082. La seigneurie resta dans le même lignage jusqu’en 1303, date à laquelle Isabeau du Plessis épousa Hardouin de Fougeré, de la famille de la Haye-Joulain. Toujours par mariage, la seigneurie passa en 1434 à Louis de Beaumont à qui nous devons l’essentiel du château actuel. Conseiller et chambellan du roi de France, il fut un des premiers chevaliers à intégrer de l’ordre de Saint-Michel créé en 1469. Quelques années
avant son décès survenu en 1476, il reçut le roi au Plessis-Macé en 1472. En 1510, le château passa par héritage dans la famille du Bellay à laquelle appartenait le célèbre poète angevin ; elle le conserva jusqu’en 1649 lorsque le château rentra dans le domaine de Guillaume Bautru, seigneur de Serrant. En 1868, Sophie Le Grand, comtesse de Walsh de Serrant entreprit la restauration de la demeure qui sera vendue en 1888 à M. Gourault d’Ablancourt puis en 1908 à Charles-Victor Langlois, directeur des Archives de France. Ses descendants, M. et Mme Langlois-Berthelot, ont cédé le château au Conseil Général de Maine-et-Loire en 1967.
Plan général du château avec les dates dendrochronologiques (d’après Blomme 1998).
74
P A T R I M O I N E D ’ A N J O U : É T U D E S E T T R A V A U X 4
Inscrit à l’Inventaire des Monuments Historiques en 1926, il a été classé en 1959, la protection étendue entre autres au donjon, aux douves et au jardin en 1962.
Situé à une quinzaine de kilomètres d’Angers, le château du Plessis-Macé fait partie d’une ligne de défense mise en place aux Xe et XIe siècles, dans une bande forestière, pour faire face aux Bretons. Son implantation dans une ligne de défense faisant face aux bretons doit probablement beaucoup à la proximité de la voie antique reliant Angers à Rennes. La châtellenie du Plessis-Macé s’étend de la Mayenne à la Loire à la fi n du Moyen Âge et le domaine comprend aussi celles de Bitoire et de la Guillaumière.
L’essentiel du château actuel date de la fi n du Moyen Âge. Toutefois, la structuration du site qui juxtapose une motte, une vaste basse-cour et un bourg castral se développant autour d’un prieuré semble remonter au XIe
siècle, encore qu’il soit diffi cile d’en apporter la démonstration. Sur le plan architectural, seuls quelques éléments des courtines et le noyau de la porte nord, également appelée « porte des Champs », pourraient dater des XIIe-XIIIe siècles.
L’enceinte
Le mur d’enceinte polygonal, cantonnée de seulement quatre tours rondes, délimite une surface d’environ 1 ha dominée par la tour résidentielle édifi ée sur la motte. De larges fossés partiellement en eau défendent toujours les abords du site. Au sud, une simple porte dotée d’un double pont-levis à fl èche ouvre vers le village. En revanche, vers le nord-est la porte des Champs consiste en une tour carrée. La simple ouverture initiale dans la courtine, fut renforcé dans un deuxième temps, côté intérieur, par un passage voûté. Ce n’est que vers le milieu du XVe siècle (après 1429[d) que fut édifi ée la
Plan du premier étage de la tour maitresse.
75
L E P L E S S I S - M A C É - C H Â T E A U
partie de la tour saillant sur l’extérieur, dotée à cette occasion d’un pont-levis à fl èche. Un escalier droit appuyé contre la courtine donne accès au premier étage de cette tour-porche. Mais c’est du second étage que l’on accède au chemin de ronde. Un bloc de latrines avec trois niveaux y est adossé au nord. L’étage supérieur est desservi par le chemin de ronde tandis qu’un autre est accessible par le logis situé au dessus de la porte et le dernier au niveau de la cour.
Les tours, dans leur état actuel, correspondent à des reprises dont il semble raisonnable de placer la réalisation dans le troisième quart du XVe siècle si l’on en suit les datations des bois pris dans les maçonneries. Il est toutefois possible d’affi rmer la préexistence d’une tour à l’emplacement de celle située à l’angle sud de la basse-cour. La cheminée de l’étage supérieur, qui était couvert d’une charpente aujourd’hui disparue, a été réalisée après 14441. On notera l’absence de mâchicoulis
1 Entre 2004 et 2007 trois campagnes ont permis de dater 7 charpentes sur les logis et les communs de la basse cour ainsi que quelques éléments ligneux dont les poutres du linteau de cheminée de la tour sud et les restes d’un hourd de la tour est. Les datations ont été réalisées par Christophe Perrault du CEDRE (Besançon) avec des fi nancements du Conseil
tant sur les tours que sur l’ensemble des courtines. À l’image de la porte des Champs, les étages intermédiaires des tours ont été dotés d’une cheminée.
La tour construite sur la motte
Au nord-ouest, une large tour carré qualifi ée de donjon vient coiffer le sommet de la motte2. En l’absence de fouille archéologique, il n’est pas possible de dire s’il s’agit de la motte primitive ou d’une réalisation plus tardive. Un fossé aujourd’hui peu profond dans lequel se dresse les restes d’une pile de la passerelle d’accès, établit une séparation entre la motte et la basse-cour. Rien ne permet de déterminer si cette portion de fossé a, un jour, été doublée d’une courtine côté basse-cour, ou bien si l’enceinte venait se refermer en tenaille sur le fossé de la motte. Les deux pans de murs qui joignent les courtines de la basse-cour au donjon, sont postérieurs à ce dernier.
général de Maine-et-Loire.2 Cette partie doit beaucoup au mémoire d’Adrien Montigny, DESS (Nantes), 1998.
Vue du château depuis le nord, attribuée au XVIIe siècle (col. Château du Plessis-Macé)
76
P A T R I M O I N E D ’ A N J O U : É T U D E S E T T R A V A U X 4
La tour de plan rectangulaire (15,6 x 19,6 m hors-œuvre) est cantonnée de contreforts plats sommés d’échauguettes. Les trois murs tournés vers l’extérieur de la place sont relativement austères et dépourvus de mâchicoulis sauf les deux petites tours carrées fl anquant le milieu des faces nord et sud. À l’inverse, la façade tournée vers la basse-cour a fait l’objet d’un traitement monumental accentué par la présence du fossé intérieur. Des arcs segmentaires lancés entre la tour porche centrale et les contreforts plats peu débordants supportent une fi le continue de mâchicoulis. Une imposante lucarne en pierres de taille de tuffeau renforce l’élancement vertical de la composition. Le porche, défendu par un pont-levis à fl èches et un assommoir, débouchait sur une cour étroite (2,6 x 4,5 m) au fond de laquelle se dressait la tour d’escalier
polygonale concentrant toutes les distributions verticales. Les élévations intérieures en pan de bois des deux ailes latérales ont aujourd’hui complètement disparu ; les pièces inférieure abritaient vraisemblablement les servitudes (présence d’un four à pain et d’un puits). Un mur de refend en pierre subdivise en deux parties inégales la moitié arrière de la tour. Cette partition suggère d’identifi er aux premier et au deuxième étage une salle et une chambre que complétaient dans les petites tours carrées un espace équipé de canonnières (aux deux niveaux) et de latrines (uniquement au deuxième étage). L’entrée de la pièce principale au premier étage conserve dans l’enduit des traces évoquant la présence d’un tournavent. Un minimum de onze cheminées permettait de chauffer cette tour résidentielle.
L’adjonction de contreforts biais aux
Élévation de la façade de tour maitresse.
77
L E P L E S S I S - M A C É - C H Â T E A U
angles et contre les tourelles latérales, semble répondre à des problèmes de stabilité causés par le tassement des remblais. La datation de la courtine nord édifi ée en même temps que la chapelle et appuyée contre la tour résidentielle fournit un terminus ante quem de 1469 pour la construction de cette dernière. Par ailleurs, la parfaite homogénéité du « donjon » montre qu’il ne s’agit pas de la restructuration d’une tour maîtresse antérieure mais d’une réalisation que nous plaçons vers le milieu du XVe siècle. Seul un massif situé au sud-ouest pourrait appartenir à un édifi ce plus ancien.
Les logis
La basse-cour comporte deux ensembles bâtis communément appelé le « logis » au nord et les « communs » au sud. Leur examen archéologique, débuté il y a quelques années, s’est essentiellement cantonné aux plans et à l’examen des élévations extérieures. Les intérieurs du logis nord ont en effet été très lourdement restaurés à la fi n du XIXe siècle par la comtesse de Walsh. Ceux situés au sud de la cour ont également fait l’objet de restaurations entre 1984 et 1990 par le Conseil général de Maine-et-Loire sous la direction de Pierre Prunet ACMH. Les bâtiments montrent une histoire architecturale relativement complexe, parfois diffi cile à appréhender du fait de l’ampleur des remaniements. Entre 2004 et 2007, la reprise des études, après celle de la tour résidentielle en 1998, a permis d’étudier et de dater par dendrochronologie l’essentiel des charpentes.
Le logis nord 3 :
Dans son premier état, daté de 14514, le logis nord comprenait seulement deux niveaux : un rez-de-chaussée, dont nous savons rien des
3 Cette partie fut l’objet du mémoire de maitrise d’Ariane Martin soutenu à Tours en 2004 et d’un travail d’Arnaud Remy sur les charpentes de comble lors de son stage de DESS (Nantes) en 2004.4 La dendrochronologie met en évidence un abattage des bois au cours du repos végétatif [1450-1451] corroborant les sources : un arrêt du parlement de Paris du 6 mai 1452 parle à propos du Plessis-Macé du castrum quod de novo edifi catum extitit.
éventuelles subdivisions, et un étage montant sous charpente, divisé en trois pièces longues de 14,7 m, 10,1 m et 5,1 m. L’édifi ce ne comporte alors ni lucarnes ni tourelle d’escalier. Les trois espaces, dans lesquels il est possible de reconnaître une grande salle et deux « chambres », séparés par des cloisons en pan de bois, étaient accessibles directement depuis la cour par deux escaliers droits extérieurs ; des portes sur le mur gouttereau permettaient de pénétrer dans chacune de ces trois pièces sans qu’il soit nécessaire de traverser un autre espace. L’aspect monumental de ces pièces, en berceau polygonal lambrissé, était amplifi é par le traitement de la charpente à chevrons-porteurs dépourvue d’entrait et de poinçon long. Le chemin de ronde, aménagé au sommet, dans l’épaisseur du mur de courtine, reçut une couverture dès cette époque.
Moins de vingt ans plus tard, en 1469, le logis fut transformé et agrandi. Côté sud, une chapelle dédié à Saint-Michel avec, en arrière, un complexe de latrines et une poterne à pont-levis furent adjoint ainsi que la portion de courtine rejoignant la tour résidentielle. La chapelle, couverte d’une charpente lambrissée, conserve une exceptionnelle tribune dont les partitions organisent plusieurs espaces cloisonnés, marquant les différences de statut entre les membres de l’assistance. Le premier niveau est accessible directement depuis l’étage en passant soit par une chambre soit par une galerie extérieure. Le dernier niveau de claire-voie communiquant avec le grenier situé au-dessus des latrines apparaît purement décoratif. L’étage intermédiaire était directement accessible depuis la salle mais également à partir d’une petite vis en bois depuis la chapelle et par un balcon desservi par le grand escalier en vis hors-œuvre.
Sur le noyau central du logis, l’insertion d’un plancher isolant le comble, le percement de nouvelles croisées surmontées de grandes lucarnes en tuffeau et la construction de la tour de l’escalier en vis se rattachent probablement à cette phase de travaux5. Un refend en pierre portant
5 Le dernier cerne mesuré sur la charpente de la tour d’escalier date de 1462. Le nombre de cernes d’aubier conservé indique une date d’abattage postérieure à 1464. Au regard du nombre moyen de cerne d’aubier que l’on mesure dans 96% des cas la date de coupe des arbres est très probablement antérieure à 1472. L’analyse dendrochronologique du plancher réinséré pourrait permettre de resserrer cet intervalle de datation, et
78
P A T R I M O I N E D ’ A N J O U : É T U D E S E T T R A V A U X 4
cheminées remplace une des deux subdivisions en pan de bois. Un simple mur s’arrêtant sous la charpente a été substitué à l’autre. Par ailleurs, un second mur est inséré dans la partie sud de la salle. Cette subdivision supplémentaire aboutie à la création de deux salles de surface proches disposant d’une chambre avec cheminée à chaque extrémité. Le désaxement de la chapelle vers le sud peut découler de plusieurs contraintes dont la présence de la douve, la nécessité de dégager la porte de l’escalier ou être lié à la volonté d’orienter le chevet vers l’entrée sud du château. En l’état de la réfl exion, aucune de ces causes ne semble prédominer. Le lien entre le logis et de chapelle est souligné par les portes d’entrée placées en vis-à-vis ainsi que la galerie extérieure au dessus.
Au nord furent réalisées deux extensions se développant de part et d’autre d’une petite cour triangulaire ménagée en arrière de la tour d’angle. Les constructions présentent deux étages carrés surmontés d’un comble ; le mode d’assemblage entre les sablières des charpentes et les poutres du plancher permettent d’exclure une réinsertion de ces dernières. Les pièces de rez-de-chaussée semblent avoir été destinées à accueillir les servitudes, et notamment les cuisines côté est. Au sud de la courette, le bloc long de 14,5 m comprend à l’étage une « chambre » et un complexe de latrines complété d’espaces
sans doute de rattacher ces transformations à la campagne de travaux de 1469. De plus, les communications existant avec la chapelle tendent à souligner la contemporanéité des deux.
annexes de type garde-robe. L’aile en retour vers l’est, d’une longueur totale de 18,8 m, offre deux pièces par niveau. L’étage était accessible par un escalier extérieur droit aboutissant à une double porte. Un balcon monumental donnant sur la cour établit une communication directe entre les pièces de l’étage situées de part et d’autre de la courette et donne ainsi la possibilité d’accéder directement aux latrines. La porte de la chambre ouvrant sur le balcon conserve son tournavent d’origine. Une petite galerie en bois, en arrière du grand balcon, permet une circulation entre les combles. Seule la charpente située au sud du balcon de cet ensemble archéologiquement homogène a pu être datée confi rmant une réalisation en 1469, contemporaine de celle de la chapelle
Un chemin de ronde au sommet de la courtine (à mi-niveau entre l’étage et le comble) assurait une circulation continue depuis la chapelle jusqu’à la tour nord puis jusqu’à la porte des Champs. La création de baies ouvrant sur l’extérieur vers 1868 par la comtesse de Walch va le morceler en petits tronçons. Aucune communication médiévale entre ce chemin de ronde et les logis ne semble exister.
Les « communs » sud
Ce long bâtiment adossée à la courtine au sud-est de la cour se compose de deux ensembles placés de part et d’autre de la tour est. La partie nord consiste en un grand logis tandis
Partie du corps de logis avec le balcon mettant en communication les deux parties édifi ée en 1469 et la doble porte d’accès à l’étage.
79
L E P L E S S I S - M A C É - C H Â T E A U
que la partie sud abrite des espaces à vocation utilitaire, avec cependant la présence d’un petit logis inséré dans l’angle à proximité de la tour sud.
Long de 38,5 m hors-œuvre, le corps de bâtiment nord reprend une organisation déjà observée dans le logis lui faisant face de l’autre coté de la cour. Les deux étages carrés rescindés par des refends en pierre, abritent chacun une salle (18,3 m de long par 7,2 m de large) et deux « chambres » de surface équivalente (8,3 m x 7,2 m). Le rez-de-chaussée garde un fonction utilitaire comme en témoigne les petites fenêtres carrées le manque de cheminée avérée. Un escalier extérieur droit aboutissait à deux portes ouvrant pour l’une dans la salle et pour l’autre dans la « chambre » qui lui est contigüe. Des fenêtres à croisées équipées de coussièges attestent la fonction résidentielle, même si aucune latrine ne desservait directement ce logement. Le comble est constitué d’une charpente à chevrons-porteurs tramée caractérisée par des poinçons courts associés à des faux entraits. Les poutres du plancher assemblées en sous-face des sablières au moyen de queues d’aronde remplissent également la fonction de tirant. Cet étage qui prenait le jour par des lucarnes en bois, servait de grenier ou de galetas ; contrairement aux pièces des niveaux inférieurs, il n’a jamais été équipé de cheminée.
Le corps de bâtiment sud est un long bâtiment en L édifi é sur une cave enterrée large de 5,5 m. Celle-ci offre un volume unique voûté en plein cintre et renforcé régulièrement d’arcs doubleaux. Au niveau de la cour plusieurs espaces à la fonction nettement différenciés se succèdent. La partie nord-est abrite une grange (23,8 m x 7,2 m dans-œuvre) accessible par une grande porte ; elle présente un volume sous charpente ménageant une hauteur de 6,5 m sous les entraits. Les fenêtres à meneau et traverse qui éclairent actuellement cet espace, sont postérieures. Dans le prolongement de cette grange se trouve un petit logis (8,3 m de long dans-œuvre) constitué de deux pièces superposées desservies par un escalier en vis hors-œuvre. Le bâtiment communique avec la tour sud placée en arrière. L’aile en retour (19,3 m x 7,1 m dans-œuvre) comporte également une grange qu’un plafond isolait du comble à la différence de
Sud
Nor
d15
m
0Salle
Cha
mbr
eC
ham
bre
Coupe longitudinale de la charpente du logis édifi é en 1451 et transformé en 1469.
80
P A T R I M O I N E D ’ A N J O U : É T U D E S E T T R A V A U X 4
75 m NGF
80 m
85 m
75 m NGF
80 m
85 m
réalisation vers 1451Extension et reprise de 1469
0 15 m
A B
CA B
B C
Élévation de la façade du logis nord après les modifi ca-tions de 1469 (relevé et mise au net Ariane Martin).
15 m 0
Plan de l’étage du logis nord après les modifi cations de 1469 (relevé et mise au net Ariane Martin).
81
L E P L E S S I S - M A C É - C H Â T E A U
celle précédemment évoquée. Son pignon ouest borde le passage d’entrée de la porte ouvrant sur la ville. La question d’un éventuel étage intermédiaire, suggéré par des empochements de poutres et la présence de petites fenêtres carrées, visibles sur les photographies anciennes, reste posée comme la possibilité d’avoir à l’extrémité un petit logement. Mais la restauration des années 1985-90, limite toute investigation archéologique. La charpente à chevrons-porteurs couvrant la partie sud-ouest en retour est une structure tramée simple à poinçon long et entrait. Le contreventement se compose d’un faîtage et d’un sous-faîtage renforcé de croix de Saint-André. Il ne semble pas que ce comble ait servi de logement malgré les traces de lucarnes. L’analyse des charpentes montre un ensemble cohérent mis en place avec des bois abattus au cours de l’hiver [1473-1474]. Durant la même campagne de travaux, l’espace libre devant la tour orientale, entre les deux corps de bâtiment, a été couvert d’une charpente. Un grand arc décoratif, faisant écho au balcon du logis nord,
assure la continuité visuelle de cet ensemble. Cette travée devait probablement abriter les circulations verticales vers la tour ainsi que probablement vers le grenier du corps de logis.
Conclusion
Si Louis de Beaumont semble avoir conservé l’organisation topographique héritée des siècles antérieurs, les reconstructions qu’il commandite en l’espace de 25 ans ont par leur ampleur presqu’entièrement gommé les réalisations architecturales de ses prédécesseurs. En l’absence de données archéologiques, il reste diffi cile de savoir si la motte, dans sa confi guration actuelle, remonte au XIe siècle ou si elle a été agrandie plus tardivement. Sur la plate-forme sommitale, rien ou presque ne subsiste d’une éventuelle construction antérieure à la tour résidentielle érigée avant 1469, probablement vers le milieu du XVe siècle pour Louis de Beaumont. Ce logis se développant sur
Est Ouest
0 5 m
Fermes de la charpente du logis nord édifi é en 1451, le chemin de ronde a étét couvert en brique au XIXe siècle.
82
P A T R I M O I N E D ’ A N J O U : É T U D E S E T T R A V A U X 4
quatre niveaux avec son plan en U extrêmement compact, était desservi par une vis dominant le puits de lumière faisant offi ce de cour. C’est probablement vers la même période que la porte des Champs prend la forme d’une tour porche défendue par un pont-levis à fl èches. Doit-on associer à cette phase la reprise de l’enceinte et des quatre tours de la basse-cour ? L’ensemble doté d’un chemin de ronde avec créneaux et fentes de tir, est exempt de mâchicoulis.
Ouvrant au sud, un logis avec salle haute sous charpente est adossé à la courtine nord en 1451. Il faut attendre 1468 pour qu’un logis d’organisation similaire soit édifi é en vis à
vis contre la courtine sud-est. Ce nouveau bâtiment se différencie du précédant par un premier étage plafonné. En revanche, dans les deux cas l’accès à l’étage se fait par un escalier droit extérieur. L’année suivante voit l’édifi cation de la chapelle ainsi que l’allongement du logis nord. Probablement dans les mêmes années, un plafond est inséré dans le logis de 1451. Une grande vis hors-œuvre assure alors la distribution verticale, alors même que l’extension du logis nord ne dispose en 1469 que d’un simple escalier droit extérieur. Cinq ans plus tard, le modeste logis construit à l’angle sud de la cour dispose d’une vis hors œuvre. L’intense période de restructuration de cette seconde moitié du XVe du château se prolonge dans le village avec la restauration de l’église paroissiale dédiée à Saint-Pierre en 1472.
Le château du Plessis-Macé offre une juxtaposition de bâtiments résidentiels assez remarquable, dont l’importance s’explique par la personnalité de leur commanditaire, proche conseiller du roi et disposant sans doute lui-même d’un hôtel
nombreux. Pour autant, les choix architecturaux témoignent d’un certain conservatisme encore accentué par la proximité du Val de Loire qui apparaît dans la seconde moitié du XVe siècle comme le principal laboratoire de l’architecture « à la française ». Les archaïsmes dans le traitement des volumes d’apparat, dans le mode d’accès aux étages, la relative discrétion de certains aménagements défensifs contrastent fortement avec des réalisations contemporaines comme les châteaux de Montsoreau (1450-1461) ou du Plessis-Bourré (1465-1474).
OE
0 5 m
Coupe transversale du logis sud des communs sud édifi é en 1468
83
SAINT-CLÉMENT-DE-LA-PLACE
LE PETIT BITOIR
Le Grand et le Petit Bitoir sont aujourd’hui deux fermes séparées de 500 m. Les nombreuses orthographes — Bithehoire ou Bitchoire vers 1220, Butlehoyre en 1428-1474, Butihoire en 1499 — ne nous éclairent pas sur l’étymologie du toponyme. La distinction entre Grand et Petit Bitoir ne semble apparaître qu’assez tardivement, avec la mention en 1710 du Grand Buthoire ; l’adjectif « grand » suggère une certaine ascendance sur le Petit Bitoir que l’on imagine déjà à cette époque déclassé en métairie. C’est pourtant vers ce second lieu-dit, où sont conservés les restes d’un logis de la seconde moitié du XIVe siècle, qu’il convient de rechercher le point d’ancrage de l’établissement médiéval. Le manoir relevait du château du Plessis-Macé distant de 3,7 km vers le nord-est.
Le Petit Bitoir est implanté sur un socle de microgranite gris-bleu. Des affl eurements ponctuels schisto-gréseux s’observent également
à proximité immédiate. Les bâtiments s’organisent aujourd’hui de façon assez lâche autour d’une cour que traversait encore au XIXe siècle un chemin secondaire. Le site domine d’une douzaine de mètres le ruisseau de Brionneau dont le cours fut barré par une chaussée pour créer la retenue d’eau nécessaire au fonctionnement d’un moulin.
Le logis médiéval présente un plan rectangulaire orienté est-ouest, d’environ 19,25 m x 9,75 m hors-œuvre, sans compter le coffre de cheminée saillant sur le pignon oriental. Il ne subsiste de l’état ancien que la façade nord et les deux pignons. Le mur gouttereau sud, qui semblait avoir en grande partie été reconstruit, s’est récemment écroulé, entraînant dans sa chute une bonne partie de la charpente et du plancher. Les deux murs de refend, au moins dans leur état actuel, datent de réaménagements modernes ou contemporains.
0 5 m
Plan du rez-de-chaussée.
84
P A T R I M O I N E D ’ A N J O U : É T U D E S E T T R A V A U X 4
Les maçonneries, constituées pour l’essentiel de moellons de grès et de granite, ont été montées avec un mortier de terre limoneuse marron. Presque toutes les pierres de taille constituant les encadrements des ouvertures et les cheminées sont en granite, le tuffeau n’apparaissant que très ponctuellement (archivolte de la porte d’entrée, arc de décharge
de la cheminée ouest). La charpente à pannes, constituée de quatre fermes-tréteaux, paraît dater du XIXe siècle. Elle remploie néanmoins quatre entraits, de nombreux chevrons ainsi que des morceaux de faîtage appartenant à une charpente ancienne vraisemblablement médiévale.
La façade principale, tournée vers le nord et l’étang, comprenait à l’origine une porte et deux fenêtres. L’encadrement en granite de la porte d’entrée, souligné par une moulure constituée de deux tores séparés par un fi let, est surmonté d’une archivolte retournée en tuffeau. Le battant devait pivoter sur un axe latéral calé dans une crapaudine disparue et maintenu en tête par une pièce de bois scellée dans l’arrière voussure. Plus à l’est, le mur est percé d’une fenêtre à meneau et traverse et d’une baie en arc brisé dont le remplage a malheureusement disparu. L’encadrement de ces deux ouvertures se caractérise par les mêmes larges chanfreins soulignés d’un fi let. En partie inférieure de la
croisée, l’absence de feuillure incite à restituer de simples volets dont les gonds étaient directement scellés dans la maçonnerie. Le bouchage de la partie haute interdit de restituer le mode de fermeture. La baie orientale conserve en partie supérieure des rainures destinées à recevoir un vitrage.
Le logis médiéval était équipé d’une cheminée sur chaque pignon. La cheminée orientale, soulignée à l’extérieur par un puissant coffre en saillie, conserve les corbeaux, les tablettes latérales, ainsi que le départ des deux poutres dans lesquelles venait s’assembler le linteau du faux-manteau en bois. De la cheminée occidentale, dépourvue de coffre ne subsiste que la partie inférieure des colonnettes qui en constituaient les jambages ; des remaniements ont entièrement fait disparaître la partie supérieure, le manteau et la hotte. Selon des dispositions assez courantes, un arc — ici en tuffeau — placé assez haut sur le contre-cœur était destiné à en faciliter la réfection. Un petit placard avec encadrement chanfreiné en granite, aujourd’hui obturé, jouxtait la cheminée à droite.
L’examen des pièces de bois en remploi dans la charpente actuelle permet de restituer les principales dispositions de la structure d’origine. Il s’agissait d’une charpente à fermes et à pannes,
0 5 m
Est Ouest
Élévation de la façade nord.
85
S A I N T - C L É M E N T - D E - L A - P L A C E - L E P E T I T B I T O I R
constituée d’au moins quatre fermes principales. La disposition des arbalétriers situés en droit du mur et plus encore des jambettes portant au vide, de même que l’assemblage à tenon et mortaise biaise bloqué par un rossignol entre le poinçon et l’entrait, sont autant de caractéristiques techniques qui se rencontrent fréquemment sur les charpentes de nombreux manoirs bretons
des XIVe et XVe siècles (Douard et al. 1993), mais qui ont également été identifi ées sur plusieurs édifi ces angevins (manoir de Longchamp à Miré, prieuré Saint-Bibien à Échemiré, chapelle de Sousigné à Martigné-Briand…). Cette datation s’accorde également avec le type d’assemblage à mortaise peu profonde, plus longue que le tenon et dépourvu de cheville qui se rencontre à la jonction entre l’entrait et l’arbalétrier.
La présence de chanfreins sur les entraits indique que ces derniers étaient destinés à rester visibles. Sur l’un d’entre eux, le chanfrein est décoré d’une baguette faisant retour à chaque extrémité. Des entretoises, assemblées sur les faces latérales des entraits, recevaient les chevrons ; aucun de ceux remployés dans la charpente actuelle ne porte de trace de lambris.
Les mortaises sur la face supérieure originelle d’un des entraits indiquent qu’une des fermes originelles servait de support à un cloisonnement en pan de bois. Seul le triangle
de la ferme semble avoir été hourdis de façon pérenne. En effet, la sous-face de ce même entrait ne comporte à l’inverse aucune mortaise ; une interruption du chanfrein ménageant une surface plane circulaire pourrait correspondre à l’emplacement d’un poteau situé au droit du poinçon. L’hypothèse d’un comble isolé de la salle par une cloison et un plancher paraît peu
plausible. Ces différents éléments incitent plutôt à restituer une partition légère, peut-être escamotable, située entre les deux fenêtres nord pour établir une séparation entre la salle, à l’ouest, et la chambre. Des exemples analogues de cloisonnement intérieurs ont pu être mis en évidence sur plusieurs manoirs du XIVe siècle : manoirs du Plessis à Marigné-Peuton (53), de La Lucière à Vern-d’Anjou, du Grand-Chaussé à Seiches-sur-le-Loir, de Longchamp à Miré (Carré et al. 2002).
Le plancher, constitué d’au moins trois
ensembles distincts, le plus ancien à l’ouest, le plus récent à l’est, vient recouper les arrières voussures des ouvertures de la façade nord. En 1668, une description du bâtiment précise que seule une partie de ce dernier est séparée du comble par un plancher. Le plafond couvrant la partie occidentale du logis pourrait dater du XVIe siècle ; sa mise en place serait associée au percement de la petite fenêtre qui conserve son volet d’origine. Le plancher de la partie orientale est nettement plus récent, au moins dans son état actuel.
Sur le plan stylistique, le traitement des corbeaux de la cheminée se rapproche de ceux de la tour Chevaleau à Beaulieu-les-Loches (37), seconde moitié du XIIIe siècle (Carré 1999), et du logis de Bergeresse à Azay-sur-Indre (37), peu après 1360 (Carré 2003). Les larges chanfreins avec fi let orientent également la datation sur le XIVe siècle (logis de Bergeresse, châtelet inachevé du château de Saumur, Litoux et Cron sous presse). De nombreux d’exemples
Détail du corbeau et de la tablette sud de la cheminée orientale.
86
P A T R I M O I N E D ’ A N J O U : É T U D E S E T T R A V A U X 4
sont préservés en Sarthe comme le manoir de Bois-Richard à Vivoin ou Les Moullins à Saint-Rémy-en Val. En l’état actuel des connaissances, les fenêtres à meneau et traverse n’apparaissent pas en Anjou avant le XIVe siècle. Le premier exemple attesté, au manoir de Longchamp à Miré, remonte aux années 1340. L’ensemble de ces observations oriente la datation de ce logis sur la seconde moitié du XIVe siècle, sans exclure le tout début du siècle suivant.
Le Petit Bitoir constitue l’un des rares exemples de manoir à salle basse du département.
Sauf à restituer des appentis ou des bâtiments séparés, les dimensions relativement modestes du logis contrastent avec le soin apporté au traitement des ouvertures. Ce type d’édifi ce à salle basse, bien connu en Normandie et en Bretagne, est présent dans le Maine. Il n’a été identifi é que récemment en Anjou-Touraine où ils sont pour la plupart des XIIIe et XIVe siècles. Le corpus comprend maintenant une dizaine de sites, dont par exemple celui des Ligneries à Charentilly (Carrée et al. 2002), mais souvent rendus peu lisibles par des transformations ultérieures.
Vue de la façade nord.
87
VILLEBERNIER
MANOIR DE LAUNAY
Le domaine de Launay se trouve sur la rive droite de la Loire à 2,6 km au nord-est de Saumur. Les bâtiments, cernés de douves, sont implantés sur les terrains plats du lit majeur du fl euve, à quelques centaines de mètres en arrière de la levée. En 1433, Etienne Bernard, trésorier du roi René, se porte acquéreur du manoir de Launay, qu’il cède quelques années plus tard, en 1444, au duc d’Anjou. En 1446, Ce dernier fait don de Launay à sa première épouse Isabelle de Lorraine qui y réside régulièrement entre 1450 et 1453, l’année de son décès. Le manoir sera ensuite donné à sa seconde femme Jeanne de Laval. René semble avoir apprécié le lieu ; il y organise le pas d’armes du Perron et viendra y séjourner à plusieurs reprises, notamment entre 1454 et 1456. Tombé dans les mains du roi de France à la mort du duc d’Anjou en 1480, le manoir est vendu par Louis XII à Jean de Saint-Amatour en 1499. Les façades et les toitures des bâtiments ainsi qu’une partie du parc et ses douves sont inscrits à l’inventaire supplémentaire des Monuments historiques depuis le 8 avril 1963.
Le manoir est constitué de 5 ailes disposées en forme de « S ». L’examen des
bâtiments indique clairement l’existence d’un noyau ancien, l’aile centrale, de part et d’autre duquel ont été réalisées les extensions du XVe siècle attribuées au duc d’Anjou.
Le bâtiment primitif, un ancien logis porche, présente un plan barlong dont la
Aile centrale antérieure(ancien logis porche)
Tour sud-est(chapelle et
"haut retrait")
Douves
Entrée nord
Entrée est
Portique
DouvesCorps de logisprincipalA
B
Plan d’ensemble du site d’après F. Robin ; A : niveau du rez de cour, B : plan du premier étage.
88
P A T R I M O I N E D ’ A N J O U : É T U D E S E T T R A V A U X 4
longueur totale n’est pas connue du fait de la reconstruction de son pignon ouest, mais qui dépassait 26 m hors-œuvre. Le bâtiment est relativement étroit avec une largeur extérieure de seulement 6,7 m (5,3 m dans-œuvre). Il comprend un rez-de-chaussée en deux parties disposées de part et d’autre du porche, et un étage montant sous charpente.
L’examen des maçonneries en pierres de taille de tuffeau et l’étude de la charpente mettent en évidence une césure verticale dans la construction, immédiatement à l’ouest du porche. Cependant, compte tenu de la cohérence du programme architectural, ces deux campagnes de construction, bien qu’assez distinctes, correspondent vraisemblablement aux deux phases d’un seul et même chantier.
Le rez-de-chaussée offre une hauteur de 4,3 m sous plafond, ce qui a permis de donner une certaine ampleur au porche souligné sur la façade nord par un arc en plein cintre surmonté d’une archivolte retournée. Trois refends en pierre rescindent le niveau inférieur ; la pièce située à l’ouest du porche pourrait avoir abrité des cuisines (cheminée monumentale avec niches latérales, puits).
Le bâtiment comporte un étage beaucoup plus trapu dont les murs ne s’élèvent qu’à 2,2 m au-dessus du sol intérieur. Cependant, les pièces se développent en hauteur jusque sous la charpente à chevrons porteurs dont l’intrados en arc brisé semble avoir été lambrissé dès l’origine. Une étude serait à mener sur la charpente pour déterminer si le contreventement avec
faîtage, sous faîtage et croix de Saint-André appartient à la structure originelle ou s’il s’agit d’une réinsertion.
L’étage est actuel lement divisé au quart de sa longueur par un refend en pierre. À l’origine, deux cloisons en pan de bois subdivisaient la grande salle en trois pièces mesurant respectivement d’est en ouest 6,4 m, 4,0 m et
8,2 m, ce qui correspond assez précisément aux partitions du rez-de-chaussée. Ces cloisons venaient s’assembler sur les deux seules fermes principales pourvues d’un entrait, au seul endroit où les moulures des sablières s’interrompent ; ces observations démontrent ainsi l’appartenance de ces deux cloisons au projet originel. La pièce orientale est la seule à prendre le jour par
Vue de la cour nord du manoir de Launay (Cliché B. Rousseau, Inventaire, Département de Maine-et-Loire).
Vue d’ensemble de la façade sud de l’aile centrale constituant l’ancien logis porche du manoir de Launay.
89
V I L L E B E R N I E R - M A N O I R D E L A U N A Y
une fenêtre à croisée1. La présence d’une cheminée monumentale sur le refend dans la plus grande pièce désigne cette dernière comme la salle haute. La quatrième et dernière pièce située à l’ouest du refend en pierre dispose d’un petit placard chanfreiné dont l’appui souligné par une moulure arrondie, se prolonge en avant de l’appui de la baie qui le jouxte. Le fond de la niche et au moins une partie des élévations intérieures de la pièce ont
1 Cette grande baie, à l’origine équipée de coussièges, a été rabaissée au moment de l’insertion d’un plancher, puis lourdement restaurée, sans doute au XIXe siècle.
Façade nord de l’aile centrale constituant l’ancien logis porche (Cliché B. Rousseau, Inventaire, Département de Maine-et-Loire).
Latrines ?
Accès parun escalierextérieur ?
tambourdeporte ?
Premièrecampagne
Secondecampagne
Emprisedu porche
0 5 m
20 m
0
A B
Plan du premier étage de l’aile centrale du manoir de Launay ; A : état actuel, B : restitution de l’état médiéval.
90
P A T R I M O I N E D ’ A N J O U : É T U D E S E T T R A V A U X 4
été recouverts de monogrammes IHS (Jésus) et AM (Marie) peints en lettres gothiques.
Les restaurations n’ont pas permis de déterminer si l’actuel escalier en vis demi-hors-œuvre donnant accès à l’étage résulte ou non d’un remaniement. Un accès antérieur de type escalier extérieur pourrait avoir occupé le même emplacement ; à l’intérieur, la juxtaposition des deux petites fenêtres sur l’élévation sud suggère
de restituer une partition de type tambour de porte.
En l’état actuel des connaissances, le parti architectural, le traitement des cheminées et des encadrements de baie orientent la datation de ce logis porche vers le dernier tiers du XIVe siècle ou le tout début du siècle suivant. Ces décennies correspondent à une période durant laquelle les surcroîts des salles hautes sous charpente tendent à diminuer de hauteur, marquant une phase de transition entre les grands volumes montant sous charpente et les pièces plafonnées (logis du château d’Argentan (61), entre 1372 et 1395
(Chave et al. 2008), ailes sud-est et sud-ouest du château de Saumur, entre 1380 et 1400 (Litoux, Cron (dir.) 2010), manoir de Clairefontaine au Vieil-Baugé (49), entre 1392 et 1408
, manoir de Mirebeau à Vivion (72) en 1410…). L’élément le plus étonnant à Launay reste l’absence de lucarnes qui, en plus d’apporter de l’ampleur et de la lumière, en particulier dans la salle haute, auraient également permis l’aménagement de croisées supplémentaires.
La date d’insertion des plafonds dans au moins 2 des 4 pièces n’est pas précisément connue mais elle semble se faire au détriment d’aménagements et de décors peints réalisés sous le règne de René d’Anjou.
Les transformations du XVe siècle
La chronologie des transformations commandées par le duc d’Anjou reste à établir, sachant que son trésorier avait lui-même peut-être déjà ouvert un chantier. Les sources comptables indiquent qu’en septembre 1447, le prince ordonne deux paiements, l’un de 500 fl orins et l’autre de 2500 fl orins concernant « les euvres de Launay ». Sur certaines parties au moins, les travaux pourraient avoir été menés rapidement, ce que suggère par exemple la pose d’un tableau de la Passion du Christ dans la chapelle dès 1450 (Arnaud d’Agnel 1908-1910 : t. 1 p. 183). Cependant, comme sur d’autres sites, le couple ducal a probablement multiplié les campagnes de construction en fonction de ses besoins et des possibilités fi nancières. Ainsi, la comptabilité enregistre encore en 1453 le versement d’une somme de 100 livres pour le chantier de Launay.
Le site, qui a conservé la physionomie qu’il présentait à la fi n du XVe siècle s’organise autour de deux cours séparées par l’ancien logis-porche (Pelloquet 2009 a : 52-55). La cour nord, encadrée sur deux côté par un portique surmonté d’un étage en pan de bois, est accessible depuis l’extérieur par deux grands portails. La cour sud était bordée à l’ouest par un grand corps de logis desservi par deux tourelles d’escalier ; cette partie a malheureusement été en partie reconstruite vers 1830. L’aile sud, peut-être une galerie, rejoignait une grande tour à l’angle
Vue de partie est de l’étage de l’aile centrale du manoir de Launay.
91
V I L L E B E R N I E R - M A N O I R D E L A U N A Y
0 5 m
Nord Sud
Coupe transversale de la salle ouest du logis ; la répartition des monogrammes correspond à l’état actuel. Cet espace était lambrissé antérieurement à l’insertion du plancher.
92
P A T R I M O I N E D ’ A N J O U : É T U D E S E T T R A V A U X 4
sud-est. Cette dernière n’a pratiquement pas été modifi ée depuis le XVe siècle. Elle abrite au rez-de-chaussée la chapelle avec son oratoire équipé d’un petit chauffe-pied. La pièce du premier étage, traditionnellement dénommée le « haut retrait » du roi, et ornée d’un magnifi que soleil peint sur le torchis du plafond, dispose d’un petit espace annexe chauffé et de latrines. Le traitement de la porte renforcée de bande de fer laisse penser que des objets de valeur, des archives ou du numéraire y étaient resserrés. La chambre aménagée dans le comble avec cheminée, espace annexe et deux lucarnes, conserve dans l’angle un petit caisson en menuiserie dont l’étude a pu démontrer qu’il s’agissait d’une cabine de latrines spécialement réalisée pour cet emplacement.
0 5 m
A
B
Plan du premier étage et du comble de la tour sud-est.
93
LE THOUREIL
ABBAYE SAINT-MAUR DE GLANFEUIL
LOGIS «PLANTAGENÊT»
L’abbaye Saint-Maur de Glanfeuil est située à 20 km à l’est d’Angers sur la commune du Thoureil, directement sur la rive sud de la Loire, en pied de coteau. Les bâtiments actuels sont établis pour partie sur une plateforme constituée de remblais accumulés afi n de réduire les risques d’inondations, et pour partie sur la pente assez abrupte du coteau.
Saint Maur, disciple de saint Benoît, aurait fondé l’abbaye vers 543. Bien que cette tradition soit non étayée, la découverte d’un sarcophage mérovingien lors des fouilles archéologiques que C. de la Croix réalisa dans la petite chapelle Saint-Martin en 1898-1899 accrédite l’ancienneté de l’occupation. La première mention avérée date du règne de Pépin le Bref lorsque de dernier fi t don du domaine de Glanfeuil à Gainulfe de Ravenne au milieu du VIIIe siècle. Les moines furent alors chassés et le monastère détruit. Restauré au IXe siècle, l’établissement religieux aurait à nouveau connu la ruine du fait de son implantation en bord de Loire l’exposant aux raids vikings. Les moines partirent en 862 s’installer à Saint-Maur des Fossés à Paris, ce qui entraîna le déclassement du monastère ligérien en simple prieuré. L’établissement ne retrouva son statut d’abbaye qu’en 1096 ; le pape Calixte II dédicaça la nouvelle abbatiale en 1119. Aujourd’hui, les bâtiments romans ont presqu’entièrement disparu. De l’église abbatiale ne subsiste plus que la façade occidentale avec son appareil décoratif dont on rencontre de nombreux exemples sur les églises du XIe siècle de la vallée de la Loire. Dans le cloître, les vestiges du lavabo mis au jour à 2,4 m sous le sol actuel témoignent de l’ampleur des remblaiements.
Les anglais occupèrent le monastère vers 1369 puis l’incendièrent. En 1544, Eustache du Bellay reçut l’abbaye en commende. Les deux
ailes subsistantes du monastère sont établies sur les fondations médiévales ; leur édifi cation, entre 1685 et 1709, fait suite à l’introduction de la réforme mauriste en 1668. L’établissement fut vendu comme bien national en 1791. La destruction de l’église abbatiale en 1821 ne
0 10 m
support decheminée
Porte
Baie ancienne
Baie ancienne Baie ancienne ?
Accèscave
Plan du rez-de-chaussée dans son état de 1996.
94
P A T R I M O I N E D ’ A N J O U : É T U D E S E T T R A V A U X 4
Façade occidentale (cliché B. Rousseau, Inventaire, Département de Maine-et-Loire).
Est Ouest
0 5 m
Cellier ?
Salle basse
Salle haute galerie
Lambris
Coupe transversale de logis avec la restitution des dispositions médiévales.
95
L E T H O U R E I L - A B B A Y E S A I N T - M A U R D E G L A N F E U I L - L O G I S P L A N T A G E N Ê T
marqua pas la fi n de l’occupation conventuelle du site ; en effet, des moines venus de l’abbaye de Solesmes réinvestirent les bâtiments pour y établir un prieuré en 1890. Occupée par différents ordres religieux, l’ancienne abbaye fut fi nalement vendue en 1994 au Conseil général de Maine-et-Loire. Ce dernier la céda en 2005 à l’association OVAL. Après un premier classement au titre des Monuments historiques le 21 juin 1958, la protection fut étendue à l’ensemble des bâtiments le 05 avril 1979, puis à tout le site le 04 décembre 1996.
Au sud-est de l’enclos et à faible distance du chevet de l’ancienne église abbatiale se tient un bâtiment médiéval communément désigné sous l’appellation de « logis Plantagenêt ». Il s’agit d’un édifi ce de plan rectangulaire (14,05 x 8,50 m hors-œuvre) implanté sur une forte pente du sud-ouest vers le nord-est, et dont l’élévation principale fait face à l’ouest. La construction annexe appuyée contre le pignon nord apparaît sur la gravure du Monasticon Gallicanum représentant l’abbaye juste avant la reconstruction mauriste ; le traitement architectural suggère de placer son édifi cation dans le courant du XVIIe siècle.
Une bonne partie du gros-œuvre est constituée de moellons de grès siliceux (Sénonien) récoltés par simple ramassage sur les coteaux proches. Les pierres de taille de tuffeau, sans doute extraites localement, ont été réservées aux encadrements de baies, au traitement des angles et aux parties hautes des pignons. Si le layage oblique résulte d’un travail soigné, la mise en œuvre du moyen appareil de petite taille apparaît relativement maladroite avec des joints globalement assez épais. Des blocs de calcaire très induré provenant vraisemblablement des niveaux cénomaniens affl eurant à quelques centaines de mètres à l’ouest de l’abbaye, ont été employés pour la partie basse des angles. Le liant à base de terre utilisé pour la maçonnerie de moellons contraste avec le mortier de chaux et sable réservé à la pose des pierres de taille.
Le logis « Plantagenêt » comporte quatre niveaux. Le cellier, qui se trouve aux ¾ sous le niveau du sol extérieur, est couvert d’une voûte en berceau segmentaire portée par 4 doubleaux reliés à leur sommet par une lierne. La facture de ce couvrement indique une reprise complète au XVIIe ou au XVIIIe siècle. L’accès depuis le nord-ouest, sous le perron actuel, abouti à une pièce barlongue offrant 2,4 m de hauteur sous les doubleaux (2,75 m sous la voûte). Deux soupiraux, un l’est et l’autre à l’ouest éclairaient cet espace : le premier a été bouché et le second complètement repris. Le rocher naturel apparaît en parti basse du mur sud sur presque un mètre de hauteur. L’ampleur des travaux liés à la pose de la voûte moderne interdit de se prononcer sur les dispositions originelles.
Le rez-de-chaussée ne comporte qu’une seule pièce de 12,20 m x 6,35 m dont les intérieurs se trouvent malheureusement masqués par des doublages. Elle prend actuellement le jour par deux fenêtres côté est et trois côté ouest, toutes de facture relativement récente. L’une des deux ouvertures sur rue reperce une grande baie en plein cintre probablement liée au chan-gement d’affectation du bâtiment au XIXe siècle. Les traces d’une porte située à l’extrémité sud du mur gouttereau ouest, couverte par un arc
Façade orientale depuis le sud.
96
P A T R I M O I N E D ’ A N J O U : É T U D E S E T T R A V A U X 4
0 5 m
OuestEst
Coupe transversale centrale et ferme secondaire du comble du logis Plantagenêt.
Nord Sud
0 5 m
Coupe longitudinale de la charpente de comble.
97
L E T H O U R E I L - A B B A Y E S A I N T - M A U R D E G L A N F E U I L - L O G I S P L A N T A G E N Ê T
en plein cintre chanfreiné, paraissent remon-ter à l’état primitif. La présence de pierres de taille au centre de cette façade pose la question d’une éventuelle petite fenêtre sur ce même pan de mur. L’actuelle porte d’entrée sur le pignon nord est précédée d’un perron représenté sur la gravure du Monasticon Gallicanum. Elle re-prend une baie ancienne — porte ou fenêtre ? — dont subsiste l’arc segmentaire extérieur. Sur le même mur, un placard avec ébrasement inté-rieur pourrait correspondre à une ancienne fenê-tre. Sur le pignon sud, l’ouverture rectangulaire allongée (110 cm de long pour 45 cm de haut) dont la facture évoque a priori une période assez tardive, ne semble pourtant pas avoir été reper-cée après coup dans la maçonnerie ; sa forme et son positionnement en hauteur s’expliquent par le niveau élevé du sol extérieur ayant contraint le construc-teur à la traiter à la façon d’un soupirail. La salle offre une hauteur de 3,55 m sous l’actuel faux-plafond. Le doublage contemporain com-porte côté est une partie saillante em-piétant sur le volume de la pièce ; la pré-sence au revers du coffre en pierre d’une cheminée vraisem-blablement situé à l’étage1 amène à restituer au rez-de-chaussée un massif en pierre montant de fond ou un support en encorbellement.
Le premier étage offrait avant les cloisonnements contemporains une pièce unique dont les dimensions sont légèrement supérieures (12,25 m x 6,70 m) notamment en largeur, à celles du rez-de-chaussée. L’éclairage est assuré sur chaque mur gouttereau par deux fenêtres vraisemblablement assez tardives. Dans l’axe du pignon nord se trouve une grande croisée, aujourd’hui condamnée, qui ouvrait sur la Loire. La mouluration très arrondie de l’encadrement
1 Un seul conduit est visible depuis le comble derrière la cloison en plâtre masquant le mur est.
(gorge et tore séparés par un listel) et le larmier retombant sur deux petits culot, indiquent plutôt une datation dans le courant du XVe siècle. Les décalages d’assises de l’appareil à ce niveau militeraient pour une réinsertion, hypothèse que les diffi cultés d’accès ont empêché de vérifi er. Sur la façade ouest, la reprise de l’allège de la fenêtre nord semble venir combler la partie basse d’une porte couverte par un arc dont le sommier sud est encore en place. La porte débouchait vraisemblablement sur une galerie portée par au moins cinq solives mises en place dans des réservations alignées horizontalement ; celles-ci se distinguent des autres trous de boulins par des dimensions un peu plus importantes. La présence de trous similaires sur la façade orientale incline à restituer une seconde galerie, posant la question
de son éventuel prolongement sur la périphérie du bâtiment2. Une seconde porte dans le pignon sud paraît également appartenir à l’état originel. Le coffre en pierres de taille de tuffeau large de 2,8 m et faisant saillie de 25 cm sur la façade arrière, indique l’emplacement
de la cheminée qui équipait la pièce de l’étage. La jonction avec la partie inférieure plus étroite (2,5 m) et moins saillante (14 cm) est assurée par un arc segmentaire chanfreiné faisant fonction d’arc de décharge, porté par deux corbeaux moulurés. De la souche ne subsiste plus que l’amorce de la base pyramidale, juste sous le coyau actuel.
Un plancher constitué de poutres et de solives a été réinséré dans le bâtiment afi n d’isoler l’étage du comble. Ce dernier, accessible par une simple trémie, est formé par une charpente
2 Une telle disposition pourraît être mise en relation avec les ressauts extérieurs sur les deux pignons, au niveau de la base du toit.
0 1 m
Détails de l’amortissement du poinçon contre l’entrait de la ferme principale.
98
P A T R I M O I N E D ’ A N J O U : É T U D E S E T T R A V A U X 4
à chevrons-porteurs dont versants présentent une inclinaison de 50°. La structure, limitée par deux pignons couverts, comprend quatre fermes principales délimitant trois travées. Ces fermes avec entraits et poinçons chanfreinés et bagués, ne comporte pas d’aisselier. L’absence de chanfreins et de bagues sur la face non visible de la ferme nord est cohérente avec son positionnement contre le pignon nord. Le traitement de la ferme sud, dépourvue d’entrait et dotée d’un poinçon court, est à mettre en relation de l’actuelle fenêtre rectangulaire, plus tardive et aujourd’hui obturée3. Les fermes secondaires sont une déclinaison des fermes principales. Les jambettes prennent appui sur les doubles sablières par l’intermédiaire d’un blochet. Au-dessus des faux entraits, un sous-faîtage et un faîtage renforcés d’un lien par travée constituent le contreventement longitudinal. La travée centrale ne comporte que quatre fermes secondaires, contre cinq pour les deux autres. Elle se distingue également par la présence d’un potelet dans le contreventement. Sur le versant est, deux mortaises accueillaient le guigneau qui permettait de libérer le passage de la souche de cheminée située au milieu du long pan. Le marquage à la rainette, continu du sud vers le nord, avec un demi-cercle en guise de contremarque, souligne l’homogénéité de cette charpente. Aucune autre trémie n’a pu être observée permettant de restituer un second conduit de cheminée ou la lucarne pourtant fi gurée sur les deux gravures du Monasticon Gallicanum4.
Des clous et des cales en sous-face des pièces ainsi que des rainures sur les faces latérales des entraits sont les témoins du lambris qui venait masquer la charpente et former un berceau polygonal. Le levage de la charpente a précédé la construction des deux pignons couverts dont le mortier vient mouler certaines pièces de bois. L’enduit de chaux lissé
3 Il est probable que cette baie rectangulaire était originellement une lancette.4 Sur ce dernier point, on note seulement une interruption de la sablière au droit de la fenêtre sud-ouest du premier étage et une mortaise isolée. Dans la mesure où les chevrons n’apparaissent pas repris à cet endroit, seule une ouverture pour éclairer et ventiler le comble, à la suite de l’insertion du plafond du premier étage. La forme en était probablement étroite.
recouvrant les murs suit l’intrados des fermes. Cet enduit contemporain voire postérieur au lambris ne conserve aucune trace de peinture. Lors de l’édifi cation des pignons et de la pose des enduits, des ardoises ont été clouées sur la face supérieure des entraits, sans doute pour protéger les bois et éviter les salissures.
L’examen des élévations extérieures et l’étude du comble permet de restituer les principales dispositions de ce bâtiment médiéval. L’existence d’une cave dans le parti originel est vraisemblable mais la reprise en sous-œuvre de la voûte a entraîné la disparition complète des traces du couvrement primitif, peut-être un simple plancher. Au rez-de-chaussée, la salle était accessible par une porte placée en façade ouest. La dépose des doublages intérieurs serait nécessaire pour préciser le nombre total de baies et comprendre les différences de traitement. L’existence d’une cheminée à ce niveau apparaît peu probable au regard de la morphologie du coffre extérieur. À l’étage, le grand volume qui montait à l’origine sous une charpente lambrissée, était équipée d’une cheminée centrée sur le mur gouttereau est. L’accès principal s’effectuait vraisemblablement par la porte occidentale, depuis une galerie, sans doute elle-même desservie par un escalier extérieur. La porte du pignon sud, plus étroite, se trouvait plain-pied avec l’extérieur. La seule fenêtre avérée se trouvait dans le haut du pignon sud ; cependant, les modifi cations des percements au cours du temps ont sans doute fait disparaître d’autres fenêtres, sans quoi la pièce se serait trouvée plongée dans la pénombre. Les enduits visibles dans le comble actuel ne conservent aucune trace de peinture.
Si l’absence apparente de baies ouvrant sur la façade orientale s’explique aisément par l’implantation du bâtiment contre la clôture monastique, en bordure d’une voie publique, la présence — plausible mais non démontrée — d’une galerie côté est apparaît plus surprenante.
L’analyse dendrochronologique des bois de la charpente permet de dater la réalisation de cette dernière ainsi que la construction des parties hautes des pignons des années 1397-1399, soit environ 30 ans après les destructions dues au passage des troupes anglaises.
99
L E T H O U R E I L - A B B A Y E S A I N T - M A U R D E G L A N F E U I L - L O G I S P L A N T A G E N Ê T
L’extrême fi n du XIVe siècle et le début du siècle suivant correspondent en Anjou à une période relativement calme avant la recrudescence des désordres au cours de la décennie 1410-1420. Du point de vue des techniques de mise en œuvre de la pierre, le layage des tuffeaux suggère une datation sensiblement plus haute ; ceci pourrait s’expliquer par la récupération de blocs de moyen appareil issus d’un édifi ce antérieur, et leur remploi en quantité limité dans les élévations. Cependant, nous ne pouvons exclure l’hypothèse inverse, à savoir la restructuration d’un bâtiment plus ancien dont le comble, pignons compris, aurait été entièrement refait à la fi n du XIVe siècle.
Nous ne disposons d’aucun élément qui indiquerait d’éventuelles extensions médiévales. Si le rez-de-chaussée a pu être subdivisé par des cloisonnements, l’étage en revanche ne comportait a priori qu’une seule pièce, ce qui le distingue de nombreux manoirs juxtaposant une salle et une chambre. Ce parti architectural soulève la question de la fonction originelle
de l’édifi ce dans le contexte monastique. Du fait de son éloignement par rapport à l’entrée de l’abbaye qui se trouvait face à la Loire, une utilisation comme hôtellerie paraît peu probable. En l’état actuel des connaissances, il reste diffi cile de se prononcer entre un édifi ce purement résidentiel réservé à l’abbé ou à un offi cier, et un bâtiment hospitalier de type infi rmerie, cette dernière fonction se trouvant en accord avec son implantation à l’est de l’abbaye. Les légendes des gravures du Monasticon Gallicanum donnant les états avant et après la reconstruction mauriste ne permettent pas de trancher la question ; elles indiquent que l’édifi ce abritait alors les infi rmeries et qu’il fut ensuite affecté pour servir de logis pour le prieur.
L’insertion du plafond au premier étage n’est pas datée mais elle pourrait intervenir en même temps que le percement de la fenêtre à croisée dans le pignon nord, dans le courant du XVe siècle. Par la suite, les principales modifi cations ont porté sur la reprise et le percement des baies et la pose d’une voûte dans la cave.
101
BIBLIOGRAPHIE
Arnaud d’Agnel G.) 1908-1910, Comptes du Roi René d’après les originaux conservés aux Archives des Bouches-du-Rhône, Picard, Paris, 3 vol.
Bardisa (M.) et alii, 1997, Pressigny en Touraine, architecture et peuplement de la basse vallée de la Claise jusqu’au XVIe siècle. Cahier du Patrimoine n°47, Paris, Inventaire Général - A.R.E.P., 384 p.
BLOMME Yves, Anjou gothique, Picard, Paris, 1998, p. 252-258.
Boufl et (J.-H.), « Menuiseries médiévales à l’hôtel de Clermont à Laval (Mayene) », La Mayenne : archéologie, histoire, 1984, n°7, p. 3-10.
Carré (G.), 1999, « Trois exemples d’habitat aristocratique en Touraine (XIIe-XIVe s.) », Bulletin Monumental, t. 157-I, p. 43-62.
Carré (G.), Litoux (E.), 2002, « Le manoir de la Gortaie à Louvaines », Bulletin Monumental, », notice d’actualité, t. 160-III, p. 306-310.
Carré (G.), Litoux (E.), Hunot (J.-Y.), 2002 - Demeures seigneuriales en Anjou, XIIe-XVe siècles, Patrimoine d’Anjou : études et travaux 2, Conseil général, 84 p.
Carré (G.), Litoux (E.), J.-Y. Hunot (J.-Y.), 2002a, Les Ligneries à Charentilly (Indre-et-Loire) : du logis à salle basse au manoir du XVe s., Revue Archéologique du Centre de la France, t. 41, p. 239-263.
Carré (G.), 2003, « Bergeresse », Congrès Archéologique de la France - Touraine, Société française d’archéologie, Paris, p. 31-42.
Carré (G.), 2005, « Résidences en pierre de la petite et moyenne aristocratie en Anjou-Touraine (XIIe-XIVe siècle) », Vivre dans le donjon au Moyen Âge, actes du colloque de Vendôme, 12 et 13 mai 2001, Éditions du Cherche-Lune, Vendôme, p. 109-133.
Chave (I), Corvisier (C.), Desloges (J.), 2008, « Le logis d’Argentan (XIe-XVe siècle) : du castrum roman à la résidence princière », dans Argentan et ses environs au Moyen Âge. Approche historique et archéologique, publications du CRAHAM, Caen, p. 115-206.
Coutil (J.), Salch (C.-L.), 2006, Logis seigneurial en Normandie. Aula-halle, résidence, manoir, du XIIe au XIVe siècle, Châteaux-forts d’Europe, n° 2, 1997, 44 p.
Cussonneau (C.), Kerouanton (J.-L.), 1987, Canton de Baugé Maine-et-Loire, Image du Patrimoine, n° 29, Inventaire Général, Spadem, Nantes, 64 p.
Davy (C.) et Foisneau (N.), 2006, « Architecture rurale : l’exemple du canton de Sainte-Suzanne », La Mayenne, archéologie-histoire, n° 29, p. 154-165.
Douard (C.), Ducouret (J.-P.), Menant (M.-D.), Rioult (J.-J.) et al., 1993, Le manoir en Bretagne. Cahier de l’Inventaire, n° 28, Paris, Imprimerie Nationale éditions et Inventaire Général, 348 p.
ENGUÉHARD Henri, « Le château du Plessis-Macé », Congrès archéologique de la France, Anjou, Société Française d’Archéologie, Paris, 1964, p. 326-331.
Hoffsummer P. (dir.), à paraître , Les charpentes du XIe au XIXe siècle, typologie et évolution en France de l’ouest, Paris, Éditions du patrimoine, Centre des monuments nationaux.
102
B I B L I O G R A P H I E
Hunot (J.-Y.), 2004, « L’évolution de la charpente de comble en Anjou, du XIIe au XVIIIe siècle », Revue archéologique de l’Ouest, 21, 2004, p. 225-245.
Le Méné (M.), 1982, Les campagnes angevines à la fi n du Moyen Âge, CID éditions, Nantes, 534 p.
Litoux (E.), 2005, « La reconstruction du manoir de Boissay au XVIe siècle (Meigné-le-Vicomte, Maine-et-Loire) », Archives d’Anjou, n° 9, p. 48-61.
Litoux E. et Cron E. (dir), (sous presse), Le château et la citadelle de Saumur, architectures du pouvoir, Société Française d’Archéologie, Paris.
Martin (B.), Martin (D.), 1997, « Detached kitchens in eastern Sussex. A re-assessment of the evidence », Vernacular architecture, vol. 28, 1997, p. 85-91.
Napoléone (A.-L.), 2003, « L’équipement domestique dans l’architecture civile médiévale », La maison au Moyen age dans le Midi de la France, Mémoires de la Société Archéologique du Midi de la France, hors série n°2, Toulouse, 2003, 239-263.
Pelloquet (T), (dir.), 2009 (a), Entre ville et campagne. Demeures du roi René en Anjou, Images du patrimoine, Nantes. Éditions 303, art, recherches, créations, 72 p.
Pelloquet T. (dir.), 2009 (b), Le pays segréen, patrimoine d’un territoire, Images du patrimoine 256, Éditions 303, arts, recherches, créations, Nantes, 192 p.
Port (C.), 1874, Dictionnaire historique, géographique et biographique de Maine-et-Loire, vol. 1, Angers, Paris, 812 p.
Port (C.), 1874-1878, Dictionnaire historique, géographique et biographique de Maine-et-Loire, 1878, Angers, 3 tomes.
Port (C.), 1965-1996, Dictionnaire historique, géographique et biographique de Maine-et-Loire. Édition revue et mise à jour, Siraudeau, 1996, Angers, Siraudeau, 4 tomes.
Prévert (A.), 2003, « Structures et aménagements en bois dans l’architecture castrale médiévale à travers les collections du Centre de Recherche sur les monuments historiques », in J.-M. Poisson et J.-J. Schwein, Le bois dans le château de pierre au Moyen Âge, Presses universitaires Franc-Comtoises, Besançon, p. 45-59.
M.-E. Scheffer (M.-E.), S. Serre (S.) 1997, Vieil-Baugé, le logis de Clairefontaine, rapport d’étude de bâti, 2 vol., DRAC, Service Régional de l’Archéologie, Nantes.