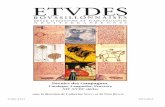Monnayeurs et ouvriers de la Monnaie de Saint-Pourçain à la fin du Moyen-Age
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
2 -
download
0
Transcript of Monnayeurs et ouvriers de la Monnaie de Saint-Pourçain à la fin du Moyen-Age
70 ETUDES BOURBONNAISES
Monnayeurs et ouvriers de la Monnaie de Saint-Pourçainà la fin du Moyen-Age (1)
Un atelier monétaire royal important fonctionna à Saint-Pourçain, petite villeauvergnate enclavée en Bourbonnais, de la fin du XIIIe siècle au milieu duXVIe siècle. Sous la direction du maître, un marchand qui prenait à ferme laproduction, s'activaient des travailleurs manuels (ouvriers et monnoyers) aux-quels incombait la fabrication proprement dite des espèces. Quelques officiersroyaux contrôlaient la fabrication et veillaient aux intérêts du roi.
Les maîtres et officiers royaux sont assez bien connus grâce aux archivesmonétaires ou par les nombreuses lettres de rémission qu'ils obtinrent pourabsoudre leurs fautes répétées (2).
En revanche, les travailleurs manuels sont plus rarement mentionnés dansles documents monétaires et il est en général difficile de les connaître et d'enapprécier le nombre.
Quelques documents, principalement extraits d'archives non monétaires,nous fournissent un éclairage intéressant sur cette main d'oeuvre obscure del'atelier auvergnat.
a) DénombrementLes travailleurs manuels de l'atelier sont divisés en deux groupes bien
distincts : les simples ouvriers ou valets qui cuisent et préparent les flans, etles monnayeurs (monnoyers) mieux payés, qui effectuent la frappe proprementdite.
Les privilèges accordés aux monnayeurs et ouvriers de l'atelier lesdispensaient en théorie de toutes les lièves, tailles et autres impositions directeslevées sur les habitants de la ville. Ainsi, la liève affermée à Jonot Dent en1357 fut prélevée sur la population senz les ouvriers et monnoiers (3).Cependant, les monnoyeurs consentaient généralement à payer les aides si ellesétaient demandées pour les fortifications et pour les réparations (4) et l'ondispose de plusieurs listes nominatives d'imposition du milieu du XIVe sièclequi groupent dans une même rubrique le personnel monétaire (5).
1) Les documents cités sans indication de dépôt proviennent des Arch. comm. de Saint-Pourçain(Allier).
2) Les principales sources sur la Monnaie de Saint-Pourçain sont : Arch. nat. Z/lb:986 (comptesde fabrication); JJ 70 n° 193 (1337); JJ 72, n" 524 (1339); JJ 74, n° 107 (1339); JJ 75, n° 467, 535(1346); JJ 84, n" 538, 641 (1355-1356); JJ 194 n° 126 (1461) (principalement des lettres de rémis-sion); Bibl. nat., ms. fr. 2600, c. 305, 320, 334, 423, 462 (inventaires de l'atelier, vers 1355) et nom-breuses quittances dans la collection Clairambault.
Voy. aussi C. Giraudel, Saint-Pourçain au début de la guerre de Cent Ans (c. 1355 - c. 1365),mém. maîtrise dactyl., Clermont-Ferrand, 1988, p. XVI1I-XX1 et 41-62 et J.Y. Ribault , Note sur lamaîtrise des Monnaies de Saint-Pourçain en 1420, Bull. Soc. Em.ul. Bourbonnais, 1971.
3) CC 1, fol. 53, 674) ibid., fol. 805) par exemple : CC 1, fol. 69v-70, 80, 85-87, 137, 168v et 54 : Talhe faite et corrigée par tfu-
guenin Charrier, Perrot Morin, Franchequin de Verdel alias de Noces, Colin Guyde et P. de Paris, lesquiex ont esté esleux par les ouvriers et monnoiers de S. Porcein...
ETUDES BOURBONNAISES 71
Ces différentes listes, dressées par des élus des monétaires, comptent àchaque fois 25 à 40 noms environ. Les noms des maîtres et officiers alors enexercice n'apparaissent pas en dehors des gardes Pierre Régnier et Lancelot deCarmone; nous nous trouvons donc uniquement en présence des ouvriers etmonnayeurs. Est-ce à dire que l'officine était une véritable manufactureemployant près de cinquante personnes ?
On remarque parmi ces noms plusieurs mentions de femme d'untel —certainement des veuves qui continuent à être comptabilisées avec lesmonnayeurs et à jouir de leurs privilèges — ou encore d'héritiers ou enfantsd'untel, monnayeur décédé, dont le cas est plus complexe.
Les fils d'ouvriers ou de monnoyers ainsi que leurs drois nepvcuz avaient lapossibilité d'embrasser ces métiers très fermés dès l'âge de 12 ans s'ils lesouhaitaient. Les héritiers Moudet et ceux de Jehan Lambert qui figurent sur leslistes de monnayeurs de 1358 à 1364, les nepveuz de Jaconin de Noces et lesnièces de P. de Paris devaient effectuer leur apprentissage à la Monnaie à moinsqu'ils ne soient comptés parmi le personnel monétaire le temps de régler unesuccession sans pour cela ouvrer à l'atelier. Par prudence, nous avons préféréles défalquer des ouvriers et monnoyers en titres.
Nous avons examiné plus attentivement trois listes de monnayeurs, celles de1358, 1360 et 1364 :
total des noms
mentions de gardes en exercice
mentions "femme de"
mentions d'héritiers, d'enfants oude neveux
monnayeurs et ouvriers
1358
41
2
1
6
32
1360
40
2
1
6
31
1364
31
2
4
8
17
Ces listes sont certainement assez fiables, il y a peu à craindre d'y voirfigurer, par complaisance, des monnayeurs ou ouvriers inactifs. Il est vraisem-blable qu'à l'imitation des autres villes, les élus tentaient de limiter le nombrede ce personnel monétaire souvent jugé pléthorique et mauvais contribuable (6)et que les listes établies étaient rigoureusement vérifiées et contrôlées par lesédiles.
Le nombre de 17 personnes auquel nous parvenons en 1364 est imputable auchômage qui affectait l'atelier depuis 1361, mais en période de pleine activité
6) Au milieu du XVe siècle, le maire de Dijon fait établir une liste des monnayeurs qui ont grantmultitude d'enffans et qui croissent et multiplient journellement en si grant nombre que, avant peude temps, ils représenteront la quarte partie du peuple de Dijon, F. liumbcrt, Les finances munici-pales de Dijon du milieu du XIVe siècle à 1477, Dijon, 1961, p.82.
72 ETUDES BOURBONNAISES
on devait atteindre, voire dépasser la trentaine de monétaires. Ce total estcomparable à ceux connus pour d'autres ateliers. Les statuts et procèsverbauxdes Assemblées des monnoyers et ouvriers du Serment de l'Empire — qui re-groupait le personnel de certains ateliers principalement situés hors du royaume— nous conservent les listes du personnel des Monnaies affiliées en 1355 d'oùnous tirons ces quelques exemples (7) :
Rouen
Pont d'Ain
Montpellier
Nantes
Ouvriers
19
23
37
28
Monnoyers
12
9
17
21
Total
31
32
54
49
b) Des privilèges importants
Alors que les habitants de la ville sont régulièrement enrôlés pour assurer lagarde de la ville, les monnayeurs sont exempts du service de guet et se refusentà l'assurer, même dans les périodes de grande insécurité dans la région (8).
On l'a déjà dit, les monnayeurs ne contribuaient jamais de bonne grâce auximpositions urbaines ou décidées par les Etals d'Auvergne.
De 1354 à 1361, les consuls de Riom poursuivent devant le Parlement lesfrères Ymbert et Hugues Chaussonnier, bourgeois et habitants de Riom, quirefusent de contribuer à la réparation des fortifications de leur ville car ils sontmonetarii à l'atelier de Saint-Pourçain (9). En 1468, un saint-pourcinoiss'abstient de payer les tailles et invoque devant les gens de la Cour des Aides saqualité de monnoier de la monnaye de Saint-poursaing et du serment de Franceet cite les privilèges par lesquels les monnayeurs sontfrancz et quiles de toutestailles et subsides. Quelques années auparavant, les bonnes villes du Bas Paysd'Auvergne s'unissaient pour fere la poursuite de certaine cause à iencontredes houvriers et monnoyers de Saint Porcein à cause du partage d'unetaille (10). A la fin du siècle, le monnayeur Martin Martin et sa soeur latailleresse Annecle Martine qui résident à Verneuil, à quelques kilomètres de
7) B.N., ms. lat. 9070, fol. 25-25 v. On estime à une dizaine le nombre de monétaires travaillantà l'atelier de Maçon vers la fin du XIVe siècle. A. Guerreau, L'atelier monétaire royal de Maçon(1239-1421), A.E.S.C., 1974, p. 370.
8) Les édiles recrutent 5 guetteurs per velher et garder (...) per faute des monnoyers qui n'y vo-hent velher per 11/1 nuyz (1357), CC 1, fol. 66
9) Arch. comm. Riom CC 17. Ymbert Chaussonnier est cité déjà cité comme monnayeur à Saint-Pourçain en 1351, Arch. nat. X/lc/5, c. 256.
10) Arch. nat. Z la 27, fol. 176 v. Arch. dép. Puy-de-Dôme, 3 E 113, DEP Eonds I, registre de1464.
ETUDES BOURBONNAISES 73
Saint-Pourçain, sont poursuivis en justice par les chanoines du lieu pour unmotif similaire (11).
Au fil des décennies, les monnayeurs parvinrent de moins en moins à fairereconnaître leurs privilèges en matière fiscale. Si en 1390 les édiles de Saint-Pourçain doivent entamer des démarches devant la Cour des Aides pour fairerecalculer le fouage demandé à leur ville en raison de la non contribution desmonnayeurs (12); un siècle plus tard, les mêmes consuls parviennent, à forcede pugnacité et de cadeaux expédiés à un conseiller du roi, à obtenir des lettresroyaux contre les ouvriers et monnoyers qui se voulaient exempter à payer lestailhes (13).
Non contents de leurs exemptions fiscales, ils ne voulaient acquitter aucundes droits banaux perçus par le prieur, seigneur ecclésiastique de la ville, etmettaient à nouveau en avant leurs privilèges. Ce désaccord entre les deuxpartis sur le fait des mesures, des lades, botage, criage, quartage et roage futporté devant le Parlement de Paris en juin 1351 et deux représentants dechaque cause furent élus pour élaborer un accord dont on ne connaît malheu-reusement pas la teneur (14).
Au cours du même Parlement, les monnoyers et ouvriers arrachèrent auprieur l'autorisation de vendre du vin pendant la durée de son ban d'août, à lataverne qu'ils exploitaient, sans doute pour mieux gagner leur vie durant lespériodes de chômage ou de faible activité. Ils devaient en contrepartie tenireux-mêmes ce cabaret qui ne comportait pas d'enseigne (15).
c) Les fortunes
Outre leurs gages et les gains procurés par l'exploitation de leur taverne, laplupart des monnayeurs semblent chercher un appoint financier. Vers 1360,Pierre Morin et les Reignier effectuent fréquemment des charrois pour lecompte de la ville. Les mêmes, mais aussi Lancelot de Carmone,Pierre de Paris, Guiot de Rodez, les de Noces et d'autres encore, possèdentdes prés et des vignes et figurent parmi les vendeurs réguliers de vin (16).Le monnoyer Thomas Arnaut répare les trompettes de la ville et surveille lebon déroulement de travaux de fortification pour le compte des édiles;maître Thomas de Puynaut, monnayeur également, est encore juge du prieuret représente Saint-Pourçain aux Etats tenus à Clcrmont en décembre 1356ou il perçoit une indemnité de 6 écus (17).
11) A.N., Z/lb/6, fol. 71 v12) Ordonnances des rois de France, t. VII, p. 352-35313) CC 92, fol. 7v, 8v (1494) et CC 83, fol. 10 (1495)14) Arch. nat. X/lc/5, c. 25615) ibid. et Arch. dép. Allier II 418, fol 1 v (accord sur le même point - 1363). Au XVe siècle,
on trouve dans d'autres villes du royaume des monnayeurs cumulant leur fonction avec un négoce :ils étaient taverniers, boulangers, drapiers, te intur iers , épiciers, merciers .... G. Dupont-Fcrrier,Etude sur les institution!; financières .., t. II, p. 187.
16) Le monnoyer L. de Noces acquiert 2 vignes vers 1343, Furgeot, Actes du parlement de Parisn° 5034. L. de Carmone possède des prés, Arch. nat. X le 107 B, c. 134. Sur les charrois et lesventes de vin, voy. C. Giraudet, op. cit., p. 37, 192 ..
17) CC 1, fol. 147 v, 152 v, 157 et Bib l . nat. ms. fr. 24031, fol. 2, 7; 22205, fol. 1.
74 ETUDES BOURBONNAISES
L'addition de ces différents revenus contribue à faire des ouvriers etmonnoyers les habitants les plus riches de la cité. La taille levée en octobre1360 indique en regard du nombre de chaque contribuable un coefficientexprimé en sous et deniers, proportionnel semble-t-il, à la capacité contributivede chacun. La liste dressée par Jehan de Menât par quartiers regroupe lesmonnoyers dans une même rubrique.
Alors que chaque habitant de Palluet, le faubourg le moins aisé, verseen moyenne 100 (en indice), ceux de Briailles payent 125 et ceux deSaint-Nicolas 115. Les résidants des secteurs les plus fortunés (Apud lagrant rue dans les portes et dedans les portes devers la Ronde) sont imposésrespectivement pour 410 et 306, tandis que les 42 monnoyers et ouvriersdoivent chacun 990, soit plus du double de ce que l'on exige des habitants duplus riche quartier (18).
La fortune de ces manieurs d'argent était bien connue de tous et suscitaitparfois la convoitise de malfaiteurs comme en cette année 1349 où une rocam-bolesque aventure survint à Hugues Chaussonnier, bourgeois de Riom,monnayeur dans notre officine. Alors qu'il s'en aloit à cheval de Riom à laMonnaie de Saint-Pourçain pour ovrer en ycelle, il fut capturé par des brigandsqui le lièrent sur son cheval pour le mener hors du royaume a/fin qu'il enheussent raençon. Bienheureusement, les ravisseurs furent poursuivis, arrêtés etenfermés dans les prisons de la duchesse de Bourbon et du prieur de Souvigny(19).
d) Un corporatisme puissant
Tous ces manoeuvres étaient groupés au sein d'une organisation corporativetrès puissante, le Serment de France, qui veillait jalousement à leurs préro-gatives et tenait régulièrement des "Assemblées" ou "Parlements" où lesdélégués des ouvriers débattaient des problèmes propres à la profession.
En mai 1354, notre atelier fut représenté à l'Assemblée qui se tint à Paris enl'ostel de mons. de Pacy, ou cloistre Sainct-Germain de l'Auxerrois (20).
Les membres de la corporation bénéficiaient de nombreux avantages, ilss'entraidaient mutuellement quand l'un d'eux tombait malade, mariait sa filleou partait outre-mer (21). En revanche des contraintes rigides régissaient leursdéplacements. Ils ne pouvaient quitter la ville où ils exerçaient pour plus dedeux nuits sans l'accord de leur prévôt et ne devaient travailler que dans lesMonnaies royales. Aymeri La Coste, monnayeur de Saint-Pourçain fut
18) Au mil ieu du XVe siècle, les ouvriers et monnoyers sont en grant nombre en la ville deSaint-Pourçain et ils portent bien la moiclié du taux des impôts de la ville.
Arch. nat. Z/la/éè, fol. 425 (1469).19) A.C. Riom, CC 17.20) Bibl. Ste Geneviève, ms. 2495, fol. 521) ibid., fol. 17v (articles 46-48). En 1354, le malade percevait une indemnité de 2 s.t. par jour
payée par les ouvriers ou monnoyers selon sa catégorie. Chaque ouvrier présent dans la ville devaitverser 12 d.t. à la fille d 'un collègue quand elle se mariait .
ETUDES BOURBONNAISES 75
condamné en 1340 à une amende pour avoir enfreint cette dernière règle ettravaillé dans les Monnaies de la dame de Senlis, du comte de Namur ou de lacomtesse de Saint-Pol, hors de nostre dit royaume (22).
Peut-être à cause de cette mobilité restreinte, on consulte que cette partie dupersonnel de la Monnaie est remarquablement stable. On retrouve les mêmespatronymes d'une liste à l'autre; d'ailleurs c'est au milieu du XVe siècle quel'office de monnayeur tend à devenir héréditaire.
En période d'activité normale, l'atelier auvergnat réunit donc au moins unetrentaine de manoeuvres qui s'activent sous la direction d'un maître et dequelques officiers royaux.
Tout le personnel chargé de la frappe forme une caste privilégiée auxrevenus confortables, souvent d'ailleurs en pratiquant une activité complé-mentaire. L'importance de cette main-d'oeuvre monétaire dans la vieéconomique saint-pourcinoise est loin d'être négligeable. Bien que la produc-tion et la commercialisation du vin assurent à la cité une activité économiqueimportante, le court transfert de la Monnaie à Montferrand vers 1440 suffit àlaisser la ville moult dyminuée, déppopulée, appauvrie et affaiblie et denombreux habitants s' en sont allés demeurer ailleurs et en lieux, estranges ethors de nostre royaume (23).
Christophe GIRAUDET
22) Arch. nat. JJ 72, n° 524. Sur la mobili té des monnaycurs, voy. Bibl . Sic Geneviève, ms. cité,fol. 6-8.
23) Arch. nat. JJ 177, n° 40
N° ISSN 09807225
ETUDESBOURBONNAISES
BULLETIN TRIMESTRIEL DE LASOCIÉTÉ BOURBONNAISE DESÉTUDES LOCALES
13e Série - N° 2573e trimestre 1991
André LEGUAI : Deux artistes au service du Duc deBourbon Charles I" : Jacques Morel et Jean Poncelet.. 61
Christophe GIRAUDET : Monnayeurs et ouvriers de laMonnaie de Saint-Pourçain à la fin du Moyen-Age 70
Jean FONTSERE : La presse dans l'Allier sous laSeconde République (suite) 76
Bibliographie 92
Documents sur un thème :47. Mesurer Encart
Secrétaire chargé du Bulletin (réception des articles,publication, retour des Bulletins) : M. Jacques LELONG,
41, rue de Bernage, 03000 Moulins
N° Corn. Parit. Pap. Presse 69 359