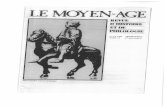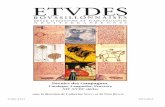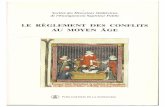La céramique d'Île-de-France à la fin du Moyen Âge
Transcript of La céramique d'Île-de-France à la fin du Moyen Âge
1. Les ateliers de poterie de terre en Île-de-France à lafin du Moyen Âge
1.1. Paris et les productions parisiennes
Ces vingt dernières années, de nombreuses fouillesd’archéologie préventive ont eu lieu à Paris, en particuliersur la rive droite de la Seine ; l’on citera tout particuliè-rement celles du Grand Louvre (Cour Napoléon, Jardinsdu Carrousel) qui, du fait de leur emplacement dans unquartier de Paris détruit au XIXe siècle, mirent au jourentre 1984 et 1990 une énorme quantité de mobilier, etcelles du château du Louvre1. D’autres fouilles significa-tives, du point de vue de l’étude de l’habitat médiéval, se
succédèrent ensuite et l’on citera parmi les plus importantes, sur la rive droite dans le quartier des Halleset celui du Marais (boulevard Sébastopol2, hôtels de Saint-Aignan3 et de Mongelas4, rue des Lombards5, rue duGrenier-sur-l’Eau6) ; sur l’île de la Cité avec les fouillesdu parking de la rue de Lutèce7 ; sur la rive gauche dansle quartier Saint-Michel (fouilles du boulevard Saint-Michel8, des thermes de Cluny9, du collège de France10).
La cuisine et la table dans la France de la fin du Moyen Âge, Publications du CRAHM, 2009, p. 249-269
2. Fouilles AFAN dirigées par Xavier Peixoto.3. Fouilles AFAN dirigées par Pierre-Jean Trombetta.4. Fouilles INRAP dirigées par Nicolas Thomas.5. Fouilles de la commission du Vieux-Paris dirigées par Philippe
Marquis.6. Fouilles INRAP dirigées par Xavier Peixoto, cf. PEIXOTO et
RAVOIRE à paraître.7. Fouilles AFAN dirigées par J.-F. Chevrot.8. Fouilles de la commission du Vieux-Paris dirigées par Didier Busson.9. Fouilles AFAN. Étude d’un ensemble des XIVe-XVe siècles
(RAVOIRE 1997) et du XVIe siècle (ID. 1991a).10. Fouilles INRAP dirigées par L. Guyard, cf. GUYARD 2003.
Mots-clés : productions céramiques, vaisselle peinte, vaisselle glaçurée, grès, faïence, diffusion, consommation, milieuxsociaux.
LES PRODUCTIONS CÉRAMIQUES D’ÎLE-DE-FRANCEÀ LA FIN DU MOYEN ÂGE (XIVe-XVIe SIÈCLE), MODALITÉS ET FORMES D’UNE ÉVOLUTION
Fabienne RAVOIRE*
* INRAP Centre Île-de-France, UMR 5594 ARTeHIS, Dijon. 1. Fouilles de la commission du Vieux-Paris, dirigées par Michel
Fleury, et de l’AFAN, dirigées par Yves de Kisch et Pierre-JeanTrombetta, puis par Paul Van Ossel.
FABIENNE RAVOIRE250
La cuisine et la table dans la France de la fin du Moyen Âge, p. 249-269
Les énormes quantités de céramiques, souvent bienconservées car provenant d’ensembles clos tels que desfosses dépotoirs, des fosses d’aisances et des couchesarchéologiques bien scellées stratigraphiquement, richesen artefacts et souvent en matériel monétaire11, ont permisde mieux connaître le vaisselier des Parisiens au MoyenÂge et à la période moderne. Elles ont aussi complété lecorpus essentiellement constitué à partir des fouilles duparvis Notre-Dame, publiées en 1986 par J. Nicourt12 et pour lesquelles les contextes de la fin duMoyen Âge étaient sous-représentés par rapport à ceux duMoyen Âge classique (XIe-XIIIe siècle). Des fourchettes dedatation relativement fiables ont été établies, en parti-culier à partir de l’étude des collections du Grand Louvre.
Socialement, ces ensembles de céramiques proviennentde contextes extrêmement divers, de riches hôtels aristo-cratiques13, des habitats bourgeois14 mais égalementpopulaires15.
L’existence de centres potiers dans la capitale et dans sesfaubourgs est attestée par les sources textuelles16 (sourcesjuridiques, statuts de la corporation des potiers de terrerédigés au XIIIe siècle, minutes notariales). Sur la rive droite,durant la période considérée dans cet article, ces atelierssont disséminés dans le tissu urbain, autour des Halles etle long des grands axes que sont les rues Saint-Martin,
11. RAVOIRE 1997, vol. 2.12. NICOURT 1986.
13. BRUT 1993; ID. 1995; PACCARD et POULAIN 1997; RAVOIRE1997; ID. 2002d; ID. 2008.
14. RAVOIRE et MONNET 1992; RAVOIRE 1997; PEIXOTO 1998;ORSSAUD 2003.
15. RAVOIRE 1998a.16. LESPINASSE 1886; LESPINASSE et BONNARDOT 1879.
Fig. 1 : Carte des principaux sites de consommation et de production franciliens (XIVe-XVIe siècle) (DAO F. Ravoire, Iliana Pasquier, B. Baudoin).
Seine-et-Marne
Val d'Oise
Seine- Saint- Denis
Essonne
YvelinesVal de Marne
Paris
Hauts-de-Seine
Des
sin
: P. P
ihui
t.
Fig. 1 : Flacourt, la Fosse Corbin - Localisation générale.
LES PRODUCTIONS CÉRAMIQUES D’ÎLE-DE-FRANCE À LA FIN DU MOYEN ÂGE (XIVe-XVIe SIÈCLE) 251
Publications du CRAHM, 2009
Saint-Denis, Saint-Honoré et Saint-Paul. Sur la rivegauche, ils se concentrent dans les faubourgs Saint-Marcelet Saint-Victor au sud-est de Paris d’une part et plus àl’ouest, dans les environs de Vaugirard, Notre-Dame-des-Champs et de Saint-Germain-des-Prés17. Jusqu’à une datetrès récente, les preuves archéologiques d’une productionà Paris et dans les faubourgs de la capitale faisaient défautmis à part des découvertes ponctuelles de possibles tesson-nières signalées par J. Nicourt18. Il faudra attendre laréalisation de fouilles préventives dans le quartier duMarais, non loin de la Seine et du chevet de l’église Saint-Gervais-Saint-Protais, rue du Grenier-sur-l’Eau (actuelleallée des Justes), pour qu’un four daté du XVIe siècle soitdécouvert, en 2001. Outre différentes parties constitu-tives du four proprement dit, de nombreux témoins de saproduction ont été retrouvés19. Tout récemment, sur larive gauche, des rebuts de cuisson datant de la deuxièmemoitié du XIIIe siècle ont été mis au jour dans des remblaisde construction du collège des Bernardins, proche dufaubourg Saint-Marcel où des potiers sont attestés auXVIe siècle, suggérant ainsi l’installation de ces derniers ences lieux dès le bas Moyen Âge.
1.2. Les ateliers régionaux
En revanche, la recherche sur les ateliers régionaux est moinsdéveloppée, les traces écrites des activités potières sont, quandelles existent, bien souvent enfouies dans les archives commu-nales20, et les traces matérielles de cette activité ont totalementdisparu. Il ne reste tout au plus que des toponymes de«poterie», nombreux dans la région et dont l’origine peutêtre très récente. Seule l’archéologie est à même de nous révélerles témoins matériels de ces ateliers régionaux qui fournirentpendant des décennies, voire des siècles, les villes et villagesd’Île-de-France et dont on retrouve les productions enabondance sur les sites de consommation. Parmi les décou-vertes les plus marquantes de ces dernières années, il fautsignaler celle des ateliers de potiers de la vallée de l’Ysieux,important secteur potier situé au nord-est de la capitale, quiont fait l’objet de fouilles suivies durant une vingtained’années21. Au nord de la capitale, neuf officines datées du XIIIe
au XVe siècle ont été fouillées à Saint-Denis (Seine-Saint-
Denis)22. En Seine-et-Marne, ont été découverts un four duXVe siècle et une partie de sa production à Brie-Comte-Robert,une tessonnière de la même période à Melun ainsi qu’une duXIVe siècle à Meaux23. Dans les Yvelines, une tessonnière duXIVe siècle a été mise au jour à Poissy24. Dans l’Essonne,plusieurs fours des XIIIe et XIVe siècles ont été fouillés àDourdan, et des rebuts de cuisson utilisés dans des remblaisont été observés à Arpajon. Il y a deux ans, des fours et leursproductions du haut Moyen Âge ont été retrouvés à Vanves(Hauts-de-Seine), ancien village situé au sud-est de Paris, à unedizaine de kilomètres des zones d’extraction d’argile deGentilly et d’Arcueil (Val-de-Marne)25. Il est certain que dansune région où la matière première était abondante, les ateliersde potiers devaient être nombreux. Les découvertes actuellessemblent montrer une concentration importante des ateliersdans ou en périphérie des villes de la région (Paris, Mantes,Poissy, Meaux, Melun, Bagnolet, Saint-Denis, Dourdan…).Cependant, l’existence des villages de la vallée de l’Ysieux(Fosses, Luzarches, Bellefontaine) indique clairement que laplace de l’artisanat rural dans l’approvisionnement en poteriede terre dans la région n’est pas à négliger. Devant notrerelative méconnaissance des centres de production franci-liens, nous ne pouvons, pour le moment, nous référer qu’auxsites de consommation, de plus en plus nombreux, qui nousfournissent d’importants corpus stratifiés issus des fouilles desites urbains mais également ruraux (châteaux, maisons debourg, maisons paysannes).
2. La céramique d’Île-de-France
2.1. Caractères généraux
Les céramiques produites par les ateliers satellites de Parissont comparables à celles de la capitale. C’est le cas desateliers de Saint-Denis, de Meaux et surtout ceux désormaisbien connus de la vallée de l’Ysieux au nord-est de la capitale.Les céramiques franciliennes médiévales et modernes sontobtenues avec des argiles sparnaciennes riches en silice.Cuites en post-cuisson oxydante, la couleur des pâtes variedu crème au beige rosé parfois beige orangé. Dans certainssecteurs du sud de l’Île-de-France, elles sont blanches ourouges. Jusqu’au XVe siècle, les parois des vases produits sont
17. RAVOIRE 1997; RAVOIRE et BOUQUILLON 2004.18. NICOURT 1972; ID. 1986.19. PEIXOTO et RAVOIRE, à paraître20. C’est le cas à Mantes où une charte communale du XVe siècle
fait référence aux potiers de la ville, voir RAVOIRE 2000.21. GUADAGNIN 2000; ID. 2007.
22. MEYER-RODRIGUES et SMIRNOFF 1992, p. 343-344.23. ORSSAUD 1999; RAVOIRE et BOUQUILLON 2004; LANELUC
2007; PACCARD en préparation.24. BOIVIN, DUFOURNIER et LECLER 1996.25. PEIXOTO et LEFÈVRE étude en cours.
1 -Paris, Rue du Grenier-sur-l’eau2 -Paris, Grand Louvre ; Hôtels de Saint-
Aignan, de Mongelas, de Beauvais ; ruedes Lombards ; boulevard Sébastopol
3 - Paris, Thermes de Cluny ; boulevardSaint-Michel, Collège de France
4 - Arcueil (94)5 - Ivry-sur-Seine (94)6 - Chevilly-la-Rue (94)7 - Vitry-sur-Seine (94)8 - Bourg-la-Reine (92)9 - Dourdan (91)10 - Meaux (77)11 - Blandy-les-Tours (77)12 - Brie-Comte-Robert (77)13 - Chelles (77)14 - Melun (77)15 - Tremblay-en-France (93)16 - Saint-Maur-des-Fossés (94)17 - Fosses-Luzarches-Bellefontaine (95)18 - Mantes (78)19 - Chevreuse (78)20 - Poissy (78)21 - Marcoussis (91)22 - Bagnolet (93)23 - Arpajon (91)24 - Saint-Denis (93)25 - Etampes (91)
FABIENNE RAVOIRE252
La cuisine et la table dans la France de la fin du Moyen Âge, p. 249-269
très fines, elles s’épaississent à partir du XVIe siècle. Lescéramiques de Paris et d’une grande partie de l’Île-de-Francesont, du XIIe au XVe siècle, majoritairement décorées à l’aidede peintures et de glaçures vertes, jaunes, rehaussées parfoisd’engobes rouges et d’éléments rapportés. Au XVIe siècle ledécor peint disparaît et la glaçure est utilisée à la fois pourles décors et pour assurer l’étanchéité d’une large gamme derécipients. Les productions à pâte rouge et à pâte blanchesont cependant dépourvues de décor peint et parfois mêmede glaçure comme celles de Dourdan.
Un faciès francilien peut être défini à partir de la carac-térisation des productions parisiennes que l’on retrouve surl’ensemble de l’Île-de-France. Toutefois, des variations plusou moins importantes se font jour lorsque l’on s’éloigne deParis et de la zone de rayonnement et de diffusion desproductions de la capitale. En effet, les céramiquesprovenant de zones situées sur les marges peuvent présenterdes variations plus ou moins importantes par rapport à la«norme» parisienne. Par exemple au XVIe siècle, les pots àcuire produits dans le sud-ouest de la région (une partie dela Seine-et-Marne, l’Essonne, les Yvelines) présentent unbord à extrémité en bourrelet alors que partout ailleurs, leslèvres sont simples. Ces mêmes bords en bourrelet sontattestés dans la Normandie voisine (dans l’Eurenotamment). Les frontières administratives et politiques del’Île-de-France, qui au Moyen Âge n’étaient déjà plus cellesassez restreintes du haut Moyen Âge, ont évolué entre leXIVe et le XVIe siècle. Ainsi, aux XIIIe et XIVe siècles, toute lapartie orientale de la Brie dont fait partie la ville de Provinsest dans la mouvance champenoise tandis que la partieoccidentale – avec les villes de Meaux, Brie-Comte-Robert,Melun – est francilienne. On constate ainsi qu’à Provins, lescéramiques des XIIIe et XIVe siècles sont de type champenoiset proviennent vraisemblablement des ateliers tout prochesde Nogent-sur-Seine. Pour autant, les réseaux de distri-bution peuvent dépasser ces limites territoriales. Parexemple, les ateliers de Fosses et de Luzarches, en pays deFrance, ont largement approvisionné la ville de Senlis et sarégion qui font partie de la Picardie. Compte tenu de l’exis-tence de microfaciès au sein même des productions del’Île-de-France, plusieurs travaux portant sur la caractéri-sation typologique et pétrographique des productionscéramique d’Île-de-France ont été réalisés ou sont en cours26.
2.2. La diffusion/circulation des céramiques
Le poids des apports de céramiques non régionales estvariable selon les époques et les lieux mais il est certain,comme en témoignent plusieurs points dans leurs statuts,que les communautés des potiers parisiens, et sans doutecelles des potiers des autres villes d’Île-de-France, exerçaientun contrôle sur la vente des autres productions. Durantune grande partie du Moyen Âge, les approvisionnementssemblent très régionalisés. Cependant, au XIIIe etXIVe siècles, certaines catégories de céramique, aisémentidentifiables, semblent avoir dépassé le strict cadre de leuraire de diffusion et avoir circulé à plus longue distancedans la région. On relève ainsi de manière très régulière,dans les assemblages céramiques étudiés, trois catégories decéramiques : les céramiques à pâte rouge de Dourdan, lescéramiques à pâte beige-orangé et glaçure jaune de larégion de Mantes, les céramiques à pâte crème et décorrapporté de la région de Poissy.
Les céramiques à pâte rouge, jamais décorées, sontproduites à Dourdan27 au sud-ouest de Paris. Essentiel-lement diffusées au XIIIe et XIVe siècle vers la région Centre,on les rencontre cependant en quantité dans les départe-ments de l’Essonne et des Yvelines, et également, mais demanière plus diffuse, à Paris et au nord de la capitale28,cela dès le XIIIe siècle, et jusqu’au XIVe siècle. Ainsi àChevreuse ou à Étampes, elles constituent les trois quartsdu mobilier céramique29. Mis à part les tasses et les pichetsglaçurés qui circulent, les productions de Mantes sontencore peu connues. Pourtant, l’on sait par leurs statutsque des ateliers existaient au XVe siècle30. Des fouilles onttoutefois permis de mettre au jour en contexte funérairedes oules31. Les céramiques «très décorées» de Poissy sontd’abord connues par la découverte et la fouille d’unetessonnière en plein cœur de la ville32. Il s’agit defragments de céramiques avec des décors d’appliquescomposés de pastilles engobées grandes et petites, souvent
26. RAVOIRE et BOUQUILLON 2004; RAVOIRE 1997. Un projetcollectif, sous la forme d’une Action de Recherche collective del’INRAP, dirigé par F. RAVOIRE a été réalisé de 2006 à 2008 sur lacéramique d’Île-de-France.
27. BOURGEAU 1987; CLAUDE et MUNOZ 1995.28. CLAUDE 1994, p. 41. On en retrouve ainsi à Maubuisson
(DUREY-BLARY 1993), à Paris (RAVOIRE et MONNET 1992; RAVOIRE1998) et même à Roissy-en-France (RAVOIRE 2002c).
29. CLAUDE 1994; TROMBETTA 1981; RAVOIRE, étude en cours.30. Des fours situés en périphérie de la ville auraient été mis au
jour et détruits au XIXe siècle. Information d’Olivier Blin que nousremercions.
31. Certains de ces objets se trouvent dans les collections du muséede Mantes, d’autres ont été récemment étudiés par C. Claude(INRAP).
32. NAVARRO-MUSSY 1992.
estampées. L’aire de diffusion de ces céramiques est étenduepuisqu’une grande partie des pichets très décorés retrouvéssur les sites de consommation rouennais sont des céramiquesde Poissy33. En Île-de-France, on les rencontre sur denombreux sites du XIVe siècle. Certains contextes permettentd’affiner la datation à la première moitié du XIVe siècle, parexemple un dépotoir parisien lié aux communs du Palais du
LES PRODUCTIONS CÉRAMIQUES D’ÎLE-DE-FRANCE À LA FIN DU MOYEN ÂGE (XIVe-XVIe SIÈCLE) 253
Publications du CRAHM, 2009
33. Voir l’étude de BOIVIN, DUFOURNIER et LECLER 1996, p. 77-79.
34. RAVOIRE et MONNET 1992.35. DUREY-BLARY 1993.36. RAVOIRE 2005, p. 78.37. CLAUDE 2007; RAVOIRE et BOUQUILLON 2004, p. 58.38. CLAUDE et MUNOZ 1995. Des analyses de pâte ont montré
qu’il ne s’agissait pas d’argile de Dourdan, voir RAVOIRE etBOUQUILLON 2004.
39. RAVOIRE, étude en cours.
Fig. 2 : Ensemble de céramiques du XIVe siècle produites à Dourdan (Essonne).
Fig. 3 : Pichet du XIVe siècle, production de Poissy (?) (Yvelines),Paris, fouilles du Grand Louvre (cl. C.-P. Charniot).
Louvre34, le dépotoir de l’abbaye de Maubuisson35, dans lecontexte du prieuré Saint-Christophe de Cergy-Pontoise oùtrès clairement, elles sont remplacées après le milieu duXIVe siècle par les récipients en grès du Beauvaisis36. Géogra-phiquement, si elles semblent plus présentes dans l’ouest del’Île-de-France, on les rencontre ponctuellement ailleurscomme par exemple dans l’est, à Sucy-en-Brie37.
À partir du XVe siècle, certains réseaux d’approvi-sionnement changent. Par exemple, dans le sud-ouestde l’Île-de-France, au château de Chevreuse, lescéramiques désormais à pâte claire ne proviennentplus de Dourdan alors que des ateliers fonctionnentencore et produisent des céramiques également à pâteclaire38. Il en est de même à Étampes où les céramiquesdes XVe et XVIe siècles sont désormais à pâte claire,voire blanche39.
Les données sont trop lacunaires pour savoir si lesateliers qui existaient au bas Moyen Âge ont continué defonctionner, après les grands désordres causés par la guerredans la région. Les ateliers de l’Ysieux ont moins produità cette période pour reprendre de plus belle à partir duXVIe siècle40. Les ateliers de Saint-Denis semblent avoircessé leurs activités. En ce qui concerne ceux de Meaux,si aucune structure de production n’a été trouvée, enrevanche l’examen des céramiques mises au jour dans larégion suggère l’existence d’une production locale, à pâteblanche ou claire, bien distincte de celle de la régionparisienne. L’étude des contextes de consommationparisiens et franciliens met en évidence le rayonnementimportant des productions parisiennes sur tout le terri-toire proche de la ville sauf au nord-est où les productionsrurales de la vallée de l’Ysieux alimentent tout le pays deFrance41. Au demeurant, outre ces ateliers et ceux de Paris,l’existence de nombreux centres de production en Île-de-France paraît évidente à l’examen à la fois des pâtes etdes formes des récipients42. En tout état de cause, leXVIe siècle apparaît comme une période particulièrementpropice à l’essor de l’artisanat de la céramique.
3. L’apport des céramiques non régionales
Les ateliers du pays de Bray situés au sud-ouest de Beauvaisen Picardie, ont acheminé leurs productions depuis Beauvaisjusqu’à Paris durant une grande partie du Moyen Âge etjusqu’au XIXe siècle43. Ce furent d’abord, dès le XIVe siècle etdurant tous les siècles qui suivirent, les céramiques en grèsqui étaient vendues réglementairement à la Halle de la ville,mais également, au moins à partir du XVIe siècle, direc-tement vendues par les potiers parisiens. Les céramiques duBeauvaisis constituent le principal groupe de céramiquesexogènes utilisées par les Parisiens. Il s’agit jusqu’au XVIe sièclede grès, céramique à pâte peu poreuse d’aspect vitrifiée, decouleur gris foncé au XIVe siècle, puis gris clair à la surfaceplus ou moins flammée. B. Palissy au XVIe siècle connaissaitla qualité des grès du Beauvaisis et les décrit ainsi :
Il y en a une espèce à Savigny-en-Beauvoisis,qui je cuide qu’en France n’y en a point desemblable, car elle endure un merveilleux feu
sans être aucunement offensée, et a ce bien-là, de se laisser former autant tenue et déliéeque nulle des autres : et quand elle est extrê-mement cuite, elle prend un petit polisse-ment vitrificatif, qui procède de son corpsmesme; et cela cause que les vaisseaux faitsde ladite terre tiennent l’eau fort autant bienque les vaisseaux de verre44.
Les fouilles des vestiges du manoir rural de Pierre desEssarts – riche personnage proche du roi –, détruit vers lemilieu du XIVe siècle, avant l’édification de l’enceinte dela ville entre 1356 et 136545, permettent de situer préci-sément l’apparition de cette céramique à Paris, sans doutepeu avant le milieu du XIVe siècle. Dans ce contexte privi-légié socialement, la part de cette céramique représenterespectivement de 1,5 à 3,7 % des trois dépotoirs liés àcette demeure46. Dans les dépotoirs du XIVe siècle associésaux maisons bâties aux abords du château du Louvre(fouilles de la Cour Napoléon), cette céramique, attestéeseulement dans les remplissages supérieurs de ces struc-tures, représente de 0,1 à 5 % des effectifs totaux47. La partde la vaisselle en grès du Beauvaisis dans les assemblagesne fera qu’augmenter au cours du XVe et surtout duXVIe siècle (20 %) jusqu’à atteindre 30 % au XVIIe siècle48.
Dans le second tiers du XVIe siècle sont diffusées, enplus des grès, des céramiques glaçurées, dénommées«plommures» dans les sources de l’époque. Ce sont surtoutdes pièces au caractère décoratif affirmé (décor gravé sur
FABIENNE RAVOIRE254
La cuisine et la table dans la France de la fin du Moyen Âge, p. 249-269
40. GUADAGNIN 2007, p. 693-694.41. Ibid.42. Voir supra § 2.1.43. CARTIER 1997.
Fig. 4 : Pichet et tasse en grès du XVe siècle, production duBeauvaisis, fouilles du château de la Madeleine à Chevreuse
(cl. P. Laforest, Service départemental d’archéologie des Yvelines).
44. MORISSON 1968, p. 40.45. VAN OSSEL 1998, p. 148.46. RAVOIRE 1998, p. 127.47. RAVOIRE et MONNET 1992.48. RAVOIRE, étude inédite.
LES PRODUCTIONS CÉRAMIQUES D’ÎLE-DE-FRANCE À LA FIN DU MOYEN ÂGE (XIVe-XVIe SIÈCLE) 255
Publications du CRAHM, 2009
engobe (fig. 16), décor rapporté et décor jaspé (fig. 17)dans le dernier tiers du XVIe siècle) qui ont été achetéesprioritairement par les Parisiens, bien que des pièces plussimples soient parfois retrouvées dans les assemblages.Cependant, des pièces légèrement plus anciennes, maiségalement exceptionnelles, les ont précédées. Ce sont desplats à décor moulé figurant les instruments de la passiondu Christ. Des fragments d’un tel plat ont été retrouvésdans les remblais du mur d’escarpe de l’enceinte de Parisdatés des années 153049.
Les céramiques en grès brun bas-normand sontconnues à Paris dès le milieu du XIVe siècle mais dans peude contextes. Ce sont des fragments de récipients à paroifine trop incomplets pour que la forme ait pu êtreidentifiée (godet?)50. Il faut attendre les dernières décenniesdu XVe siècle pour que la présence de ces céramiques,uniquement représentées par des pots à panse ovoïdemunie d’une anse courte, se généralise. C’est en effet àcette période que la consommation du beurre se répand51
(fig. 10, n° 16). Toutefois, il faut attendre la deuxièmemoitié du XVIe siècle et surtout le XVIIe siècle pour qu’à la
fois le volume et la forme générale de ces récipientsaugmentent notablement (fig. 10, n° 35), mais égalementpour que leur usage puisse être considéré comme courant,et ce, quels que soient les contextes de consommation52.
En ce qui concerne les faïences, une partie proviennentd’Italie et l’autre de France, de Lyon en particulier. Lavaisselle en faïence est exceptionnelle avant la fin duXVe siècle dans les contextes archéologiques. Ainsi unecoupe en faïence à décor vert et brun originaire d’Italie duNord a été retrouvée dans le comblement du fossé duchâteau du Louvre53. Les premières céramiques en faïenceproviennent du Levant espagnol, des ateliers de la régionde Valence. Ce sont des faïences à décor dit au lustremétallique, qui ont fait l’objet d’un commerce d’assezgrande ampleur dans toute l’Europe au XVe siècle. À Pariset en Île-de-France, les contextes de découverte sontcependant peu nombreux : des fragments d’albarelli sontattestés au château de Blandy-les-Tours (Seine-et-Marne)54. Cette forme est également connue dansquelques demeures urbaines parisiennes (fig. 6)55.Les écuelles et autres formes ouvertes sont exceptionnelles.Une magnifique coupe du XVe siècle a été retrouvée dans
49. RAVOIRE 1991, p. 252, pl. 9/67 n° 7 et 11.50. C’est le cas du manoir de Pierre des Essarts (RAVOIRE 1998,
p. 127) et de trois maisons du quartier Fromenteau (fouilles de laCour Napoléon) (RAVOIRE et MONNET 1992, p. 56).
51. RAVOIRE 1998b.
52. RAVOIRE 1997.53. BRUT 1986.54. RAVOIRE 2006b.55. RAVOIRE 1991a; ID. 1997, p. 743.
Fig. 5 : Pot à beurre en grès du XVIe siècle, production du Domfron -tais, Paris, fouilles des thermes de Cluny (cl. C.-P. Charniot).
Fig. 6 : Albarelle en faïence lustrée du XVe siècle, production espa-gnole, Paris, fouilles des thermes de Cluny (cl. C.-P. Charniot).
Voir aussi p. 242.
FABIENNE RAVOIRE256
La cuisine et la table dans la France de la fin du Moyen Âge, p. 249-269
la demeure d’un artisan du quartier Fromenteau, dansun contexte de la première moitié du XVIe siècle56. Cespièces au caractère décoratif affirmé étaient, de fait, consi-dérées comme des objets luxueux et, à ce titre, conservéesdans les familles pendant de très nombreuses années.
Dans la deuxième moitié du XVIe siècle, commencentà se répandre, dans certains contextes cependant, desrécipients en faïence, en particulier des assiettes et descoupes sur pied. Cette céramique, en faïence blanchedécorée, provient d’Italie, de Faenza et de Monteluppo quiétaient les plus importants centres de fabrication etd’exportation. Elle est également produite en France oùdes artisans italiens sont venus s’installer dès le début duXVIe siècle, à Lyon et peut-être à Paris, bien que pour cetteville, aucun atelier n’ait été découvert. Seuls, en effet, troisalbarelli retrouvés à Paris dans un contexte du premiertiers du XVIe siècle, et dont la pâte est de facture parisienne,pourraient correspondre à une production locale57. Cettedécouverte exceptionnelle reste isolée. Si l’existence de
potiers faïenciers à Paris au cours du XVIe siècle estprobable, elle est certaine pour la fin du XVIIe siècle,notamment dans le faubourg Saint-Antoine58. Lacéramique retrouvée en fouilles, essentiellement dans descontextes aristocratiques, des hôtels du quartier Fromenteau,de l’atelier de Bernard Palissy aux Tuileries, de l’abbaye deChelles et du manoir de Vincennes, n’est pas pour autanttotalement absente des contextes bourgeois, bien qu’elle y soitpeu répandue. On ne peut en aucun cas parler d’une généra-lisation de son utilisation comme en Italie ou aux Pays-Bas.Les récipients sont la plupart du temps fragmentaires et lesidentifications de provenance restent souvent difficiles àétablir. Il semble cependant que la plupart des pièces s’appa-rentent aux productions de Faenza et de Lyon et dans unemoindre part, vers la fin du XVIe siècle, de Deruta, d’Urbinoet de Sienne. Il s’agit surtout de services en faïence blanche,blanche à décor «a compendario», bleue, tous bien datés dudernier quart du XVIe siècle et des premières décennies duXVIIe siècle. Les formes sont essentiellement des plats et despots d’apothicaireries (albarelles et chevrettes, piluliers).
56. RAVOIRE 1992a; ID. 1997, p. 742; ID. 2002b.57.MARQUIS 1999.
Fig. 7 : Fragments de récipients en faïence à décor historié et à décor de grotesque du XVIe siècle, production italienne (Faenza ou Urbino?), Paris, fouilles du Grand Louvre (cl. O. Ravoire). Voir aussi p. 243.
LES PRODUCTIONS CÉRAMIQUES D’ÎLE-DE-FRANCE À LA FIN DU MOYEN ÂGE (XIVe-XVIe SIÈCLE) 257
Publications du CRAHM, 2009
Quelques pièces à décor ornemental de grande qualité, biendatées de la deuxième moitié du XVIe siècle, ont été décou-vertes dans un hôtel du quartier Fromenteau (fig. 7).
D’autres céramiques étrangères sont égalementattestées en Île-de-France. Ce sont des grès rhénans et desporcelaines chinoises. Les premiers grès rhénans sontconnus à Paris dès le milieu du XIVe siècle mais peufréquents : les fouilles des Jardins du Carrousel et en parti-culier du rempart de la ville59 daté de la même période enont livré quelques fragments. Ce sont majoritairementdes godets et des tasses en grès gris glaçuré sur les deuxfaces, peut-être originaires des ateliers de Siegburg, maisun fragment de coupe à anse en grès rouge de Langerwehea également été mis au jour60. Il faut attendre les XVIe-XVIIIe siècles pour que des récipients en grès rhénans(Cologne et Siegburg) soient plus régulièrement attestés,bien que l’on ne puisse parler à leur propos de commerce,car les rares récipients, en majorité des pichets, ont étéidentifiés seulement dans quelques contextes aristocra-tiques (abbaye de Chelles, hôtels du quartier du Louvre61).
Le goût prononcé des élites pour les curiosités orientales,dès le bas Moyen Âge, trouve un écho dans la découverte,certes anecdotique, dans un dépotoir du manoir de Pierre desEssarts62, de fragments d’une coupelle en verre blanc opacifié
à l’étain, imitation troublante de porcelaine chinoise,suggérant la circulation de faux pour ces pièces très presti-gieuses. Autre découverte exceptionnelle, un tesson encéramique extrême orientale, siliceuse blanche à décor brun,fut retrouvé dans le comblement d’un fossé du XVe sièclesitué non loin de cemanoir. De caractère tout aussi anecdo-tique mais en tout cas exceptionnelle, la présence denombreux pichets de Saintonge du début du XIVe siècle, auchâteau de la Madeleine à Chevreuse, mérite d’être signaléepuisqu’elle constitue la découverte la plus septentrionalepour la France de ce type de céramique, très clairementassociée au commerce des vins de cette région (fig. 8).
4. Modalité et évolution du vaisselier des Parisiens etdes Franciliens
L’évolution des formes et des productions en usage durantle Moyen Âge et la période moderne en Île-de-Francecommence à être bien connue grâce aux nombreux articleset travaux sur les sites de consommation et de productionrécemment découverts63. Apparaissent ainsi clairement laprééminence de certaines formes et la pérennisation de leurusage au cours des siècles avec, naturellement, des varia-tions que l’étude typologique et chronologique des objetsretrouvés en fouille met en évidence64. Quatre piècesdominent le vaisselier : la jatte ou tèle pour transformer etaccommoder les aliments, l’«oule» et le «coquemar», petitspots munis ou non d’une anse pour cuire les aliments, lepichet ou la cruche selon que ce récipient est destiné auservice ou au transport des boissons, enfin le poêlon puisl’assiette et l’écuelle pour consommer les aliments. Ces
59. RAVOIRE 1998a, p. 174, fig. 102 n° 27-30. Les terres mises enœuvre pour le rempart provenaient en fait des terres arables ayant sansdoute servi de zones d’épandage de déchets domestiques, appartenantà la communauté des Quinze-Vingts, propriétaire des lieux avantd’être expropriée en 1356 pour les besoins de la fortification.
60. RAVOIRE 1998a, p. 123, tab. VI et p. 180. Cette forme estrépandue sur les sites d’Angleterre et des Pays-Bas du XIVe siècle.
61. RAVOIRE 1994a, p. 207, fig. 157, n° 109 et 111 ; RAVOIRE1997, p. 761-762.
62. RAVOIRE 1998a, p. 127.63. Voir supra.64. Un travail de classement précis de la forme des récipients avait
été réalisé par J. Nicourt sur un corpus essentiellement parisien etchronologiquement fondé sur une fourchette comprise entre le XIe etle XVe siècle (NICOURT 1986). Dans un travail portant sur lescéramiques de la fin du Moyen Âge, nous avons également élaboré unetypologie fondée sur un classement à la fois hiérarchisé et ouvert nouspermettant de proposer un cadre typo-chronologique aux produc-tions céramiques des sites d’utilisation de l’Île-de-France (RAVOIRE1997, 2006a). En 2007, la publication par R. Guadagnin des formesproduites dans les ateliers de la vallée de l’Ysieux permet d’appré-hender le vaisselier en usage dans le nord de Paris entre le XIe et leXVIIe siècle (GUADAGNIN 2007). Le travail en cours de réalisation surles productions médiévales et modernes d’Île-de-France est l’occasionde construire une typologie régionale qui tienne compte des diffé-rents faciès microrégionaux (cf. n. 26).
Fig. 8 : Pichets et tasse (taste-vin?) du XIVe siècle, productions parisienne et saintongeaise, fouilles du château
de la Madeleine à Chevreuse (cl. P. Laforest, Service départemental d’archéologie des Yvelines).
58. PLAINVAL DE GUILLEBON 2002.
FABIENNE RAVOIRE258
La cuisine et la table dans la France de la fin du Moyen Âge, p. 249-269
*
*
*
1 2 3 4
5 6
7
8 9 10 11 12
13 14 15
16
17 18
19 20
21
22 23 24 25 26
27
28
29 30
31
32
33 34 35
36
37 38
39
40 41
42 43 44 45 46
47
48
49
50
XIVe siècle XVe siècle
Vai
ssel
le d
e ta
ble
Pré
par
atio
n /
Ser
vice
Cu
isso
nC
on
serv
atio
n
et s
tock
age
0 20 cm* grès du Beauvaisis ** glaçurée du Beauvaisis • grès de Normandie
Fig. 9 : Panorama des principaux récipients en usage à Paris et en Île-de-France au XIVe et XVe siècles.N° 1 : tasse polylobée ; n° 2, tasse quadrilobée glaçurée à décor rapporté ; n° 5 : coupe à pied ; n° 6 : coupe à ombilic ; n° 7 : bouteille glaçurée, n° 8-9 : pichets balustresglaçurés ; n° 10 : pichets élancés à panse ovoïde et globulaire glaçurés ; n° 3, 4 et 12 : godet, tasse et pichet en grès du Beauvaisis ; n° 15 : pichet élancé sans décor ; n° 16 :pichet à panse globulaire avec décor peint ; n°17-18 : poêlon avec et sans glaçure ; n° 19 : jatte peinte ; n° 20, jatte glaçurée à deux anses ; n° 21 : lèchefrite ; n° 22-26 :coquemars ; n° 27 : marmite ; n° 28 : oule. Céramiques du XVe siècle n° 32 : gourde glaçurée ; n° 33-34 : pichets avec et sans glaçure ; n° 35 : pichet en grès du Beauvaisis ;n° 37-38 : poêlons glaçurés ; n° 39 : jatte à anses ; n° 40-46 et 48 : coquemars ; n° 47-49 : marmites ; n° 50 : oule.
LES PRODUCTIONS CÉRAMIQUES D’ÎLE-DE-FRANCE À LA FIN DU MOYEN ÂGE (XIVe-XVIe SIÈCLE) 259
Publications du CRAHM, 2009
*
* *
*
*
*
* * * *
**
•
•
**
*
* *
48
1
2 3 4
5
6 7 8 9
10
11 12
13
14
15
16
17 18
19 20
21
22 23 24
25
26
27
28
29 30
31 32
33
34
35
36
37
38 39 40
41
42 43
44 45 46
47
Pré
par
atio
n /
Ser
vice
Vai
ssel
le d
e ta
ble
second tiers du XVIe siècle dernier tiers du XVIe siècle
Co
nse
rvat
ion
et
sto
ckag
eC
uis
son
premier tiers du XVIe siècle
0 20 cm* grès du Beauvaisis ** glaçurée du Beauvaisis • grès de Normandie
Fig. 10 : Panorama des principaux récipients en usage à Paris et en Île-de-France au XVIe siècle.N° 1 : réchauffoir glaçuré ; n° 2-4 : godet, coupelles en grès du Beauvaisis ; n° 5 : cruchon; n° 6 : pichet à décor rapporté ; n° 7-9 : pichet simple et à décor rapporté engrès du Beauvaisis ; n° 10 : pichet glaçuré à panse globulaire ; n° 11 : petite terrine à anse ; n° 12 : grande terrine à tenons ; n° 13 : jatte sans anse ; n° 14 : coquemar;n° 15 : marmite ; n° 16 : pot à beurre en grès bas-normand. Céramiques du second tiers du XVIe siècle n° 16-18 : réchauffoirs ; n° 19-20 : assiette ; n° 21 : coupelle engrès du Beauvaisis ; n° 22 : chevrette glaçurée ; n° 23-25 : biberon, gourde et pichet en grès du Beauvaisis ; n° 26 : bassin à suspendre glaçuré ; n° 27 : grande terrine àtenons ; n° 28 : jatte à anses ; n° 29-30 : coquemars ; n° 31-32 : pot à anse à tenon (huguenote) ; n° 33 : marmite ; n° 34 : oule ; n° 35 : pot à beurre en grès bas-nor-mand. Céramiques du dernier tiers du XVIe siècle n° 36 : coupelle en grès du Beauvaisis ; n° 37 : chevrette glaçurée : n° 38 et 40 : pichets en grès du Beauvaisis ; n° 39 :pichet glaçuré ; n° 41 : bassin à aile glaçurée du Beauvaisis ; n° 42-43 : grande terrine à tenons et à anse ; n° 44-46 : coquemars ; n° 47 : pot à cuire à anse à tenon (pottripode) ; n° 48 : saloir en grès du Beauvaisis.
FABIENNE RAVOIRE260
La cuisine et la table dans la France de la fin du Moyen Âge, p. 249-269
contenants répondent aux principales fonctions culinaires :préparer, cuire et consommer. De nombreux autres, destinésà des fonctions spécifiques, comme des lampes, à huile ounon, accompagnent ces récipients de base. La fin du MoyenÂge est une période où se met en place un véritable vaisselieren poterie de terre, permettant au consommateur d’utiliserune palette de plus en plus large de récipients destinés à desusages de plus en plus spécifiques.
4.1. La préparation : vers une gamme étendue de réci-pients
La principale forme ouverte, encore peu répandue avantle XIIIe siècle, est le poêlon, récipient profond, muni d’unmanche, de taille variée (fig. 11; fig. 9 n° 17-18). On lerencontre en quantité parfois considérable dans lesdépotoirs domestiques du XIVe siècle car c’est un récipientmultifonctionnel – certaines sources, notamment icono-graphiques, attestent son utilisation comme pot detoilette. Au cours du XVe siècle, il tend à devenir un platà cuire, ce dont témoignent les surfaces fréquemmentnoircies (fig. 9, n° 37-38). Les tèles à lait ou les jattes(formes proches mais avec des anses), larges récipientsdestinés à récupérer la crème du lait, font leur apparition(fig. 9 n° 20-39). Les exemplaires les plus anciens mis aujour à Fosses et sur les sites du pays de France datent dumilieu du XIVe siècle. Ils sont constitués d’un bassin creuxsurmonté d’une aile longue et oblique65. Ils sontuniquement connus dans les contextes ruraux. Au
XVIe siècle, la terrine remplace le poêlon. Cette forme plusbasse présente un fond large et une panse rectiligne plusou moins évasée, munie d’une anse ou de deux tenons(fig. 10, n° 11-12; 27; 42-43). La plupart des poêlons ettoutes les terrines portent une glaçure interne (fig. 12), quia pour but de rendre les parois des récipients moinsporeuses.
4.2. La cuisson : une vaisselle culinaire qui va en se spécia-lisant
Le coquemar est le principal récipient en céramique utilisé(fig. 13). Il succède à la oule, pot sans moyen depréhension, d’un usage fréquent entre le XIe siècle et ledébut du XIVe siècle et progressivement abandonné par lasuite (fig. 9, n° 28, 50, fig. 10 n° 34). Utilisé dès laseconde moitié du XIIIe siècle jusqu’au XVIIe siècle, ilservait, entre autres usages, à la cuisson de «potages». Un
65. GUADAGNIN 2007, p. 374 ; voir l'article d'Ivan Lafarge etAnnie Lefèvre dans ce volume.
Fig. 11 : Poêlon du XIVe siècle, production parisienne, fouilles du Grand Louvre (cl. C.-P. Charniot).
Fig. 12 : Terrine à anse du XVIe siècle, production parisienne,Paris, fouilles des thermes de Cluny (cl. C.-P. Charniot).
Fig. 13 : Coquemar du XIVe siècle, production parisienne, Paris, fouilles du Grand Louvre (cl. C.-P. Charniot).
couvercle, posé sur le bord puis, au XVIe siècle, engagédans celui-ci au moyen d’une encoche, pouvait l’obturer.Le volume des coquemars augmente de façon notable àpartir du XVIe siècle, même si de petits contenants sontencore produits. Moins fréquentes que les coquemars auXIVe siècle, les marmites, gros pots de cuisson à deux ansesconcurrencés par les récipients en métal, se répandent àla fin du XVe siècle (fig. 9, n° 27, 47, 49). Les coquemarscomme les marmites sont presque toujours pourvus d’undécor peint jusqu’au milieu du XVe siècle (fig. 9, n° 23 à44). Ensuite, ils sont partiellement glaçurés (fig. 9, n° 44-48), dans le fond du vase et en tache sur la face présentéeaux braises. Cette disposition se maintient par la suite,sauf pour la glaçure interne qui disparaît progressivement(fig. 10, n° 14, 29-30, 44-46). À partir du second quartdu XVIe siècle et encore au XVIIe siècle, certains coquemars,en général de très petite taille, sont entièrement glaçuréset la plupart du temps pourvus d’un bec verseur latéral.Ce souci d’étanchéité et la présence de ce verseursuggèrent un usage spécifique, lié à la fonction culinairecomme de fréquentes traces d’usage le laissent supposer.L’emploi de glaçure interne couvrante sur les pots decuisson ne se généralise que sur les pots à cuire munis depieds et dénommés «pots tripodes» (fig. 10, n° 47). Cetteforme apparaît dans le dernier tiers du XVIe siècle etconstitue le principal pot à cuire au XVIIe siècle et jusquedans les premières décennies du XVIIIe siècle.
4.3. Émergence d’une vaisselle de table en terre
Le vaisselier en terre destiné à la table, constitué derécipients pour boire d’une part et pour manger d’autrepart, se met en place à des périodes différentes, pour desraisons qui tiennent aux difficultés d’accès à d’autresmatériaux, plus ou moins onéreux (le métal, le verre, lebois), et à l’origine sociale des utilisateurs.
Le grand développement de la gobeleterie de terre semanifeste à partir du milieu du XIIIe siècle et se poursuitjusqu’au milieu du XVIe siècle. Le Moyen Âge est une époqueau cours de laquelle le vin règne sur les tables, du meilleur pourles princes à la «piquette» pour les plus humbles. C’est unemanne pour les ateliers de potiers de terre qui proposent destasses et godets accompagnant le traditionnel pichet dont onobserve la présence systématique dès le début du XIIIe siècle.
La vaisselle en grès du Beauvaisis constitue, dès sonapparition sur le marché parisien, une production raffinéedestinée à une clientèle soucieuse de nouveauté. Ainsi, àla fin du XIVe siècle, le roi de France Charles VI avait dans
son mobilier «godez de Beauvez garny d’argent 66». À lamême période, l’auteur du Mesnagier de Paris recom-mande la terre de Beauvais pour la consommation desroses vermeilles dans du verjus67. De fait, c’est dans ledomaine de la conservation et du service des boissonsdurant toute la période (fig. 11, n° 3-4, 12, 29-31, 35;fig. 10, n° 2-4, 7-9, 21, 23-25, 36, 38, 40) puis, surtoutà partir du XVIe siècle, de la conservation des graisses68
(fig. 9, n° 48), que cette vaisselle va devenir d’un emploicourant dans le vaisselier des Franciliens69.
Des pièces tout à fait remarquables ont ainsi été misesau jour dans les fouilles des ateliers du Beauvaisis. Pourautant ces récipients sont rarement retrouvés sur les sitesde consommation. On citera dans des contextes du débutdu XVe siècle, des fragments de pichets à décor au repousséprovenant des fouilles des Jardins du Carrousel70, unfragment exceptionnel de coupe de calice71 à décord’écailles couvert d’un émail blanc laiteux à reflet azuré,et un godet «en double tronc de cône» provenant d’undépotoir de l’hôtel de Beauvais, ce dernier récipient aégalement été retrouvé dans les fouilles du château duLouvre72. Plus répandus sont les tasses et simple godets engrès (fig.11, n° 3-4), puis à partir du XVe siècle, lescoupelles (fig. 9, n° 29-30) et les gobelets (fig. 9, n° 31).Si ces derniers sont nombreux dans le manoir de Pierre desEssarts où à l’Hôtel de Beauvais, ils le sont moins dans lescontextes plus ordinaires.
La première moitié du XVIe siècle révèle l’engouementpour les coupelles à boire en grès du Beauvaisis.Le dépotoir de la tour des Salves de Vincennes où unecinquantaine de coupelles ont été mises au jour, certainesayant encore de la glaçure au cobalt déposée dans l’ombiliccentral, en est un exemple. En 1525, le trésorier de laSainte-Chapelle de Vincennes, Guillaume Crétin, y faitprobablement allusion dans un de ses vers : «…grandstasses de Beauvais le sert…73 ». Ces coupelles accompa-gnent de beaux pichets ornés d’un décor moulé et deglaçure comme l’illustre un exemplaire incomplet
LES PRODUCTIONS CÉRAMIQUES D’ÎLE-DE-FRANCE À LA FIN DU MOYEN ÂGE (XIVe-XVIe SIÈCLE) 261
Publications du CRAHM, 2009
66. CHAMI 1963.67. ALEXANDRE-BIDON 2005, p. 165.68. Ibid.69. RAVOIRE 1997; ID. 2002, voir aussi ALEXANDRE-BIDON 2005,
p. 165-166.70. RAVOIRE 1998, p. 176, n° 19 et p. 178, n° 3.71. ID. 2002d. Cette forme est datée de la fin du XIVe-début du
XVe siècle, voir CARTIER 1997, p. 92, fig. 36.72. BRUT 1995, p. 71.73. CHAMI 1963, p. 94.
FABIENNE RAVOIRE262
La cuisine et la table dans la France de la fin du Moyen Âge, p. 249-269
provenant d’un habitat bourgeois parisien du second tiersdu XVIe siècle aux armes d’Anne de Bretagne (fig. 14).Ces grès sont qualifiés d’«azurés» par les contemporains,dont Rabelais qui écrit dans un passage édité en 1545 :
Et d’advantaige pour emporter d’iceulx vinsil y a de grads arbres pleins d’estocz ausquelzpendant les flascons, barils et bouteilles detoutes sortes, lesquels chascun peult emplird’iceuluy vin, et emporter là ou il luy plaistet veult, toutesfois les meilleurs pour ce fairesont noz beaulx flascons de Beauvais qui sontazurez et bons à merveilles, et se gardemieulx le vin en iceulx longuement frais etcorrompre, comme i’ay tousjours ouy dire àceulx de nostre ville de Beauvais et à ceulx deSavignie et de Leraule qui sont les lieux la ouon les faict74.
Ces objets restent cependant l’apanage des milieux aristo-cratiques. Des pichets et des gobelets plus simples, sansdécor ajouté, constituent l’essentiel des récipients retrouvéssur les sites de consommation parisiens et franciliens.
Les pichets (fig. 9, n° 8-10) et tasses glaçurés, souventà bords polylobés (fig. 9, n° 1-2), issus des productionsrégionales, sont au XIVe siècle assez répandus. D’autresformes, comme les coupes à pied et base rentranteretrouvées à l’abbaye de Maubuisson, restent exception-nelles (fig. 9, n° 5-6). Les récipients, pichets et tassespourvus d’un décor d’applique, de barbotine, rares, sontsans doute réservés à une élite (fig. 9, n° 8). Durant les XIIe
et XIIIe siècles, le coût plus élevé de la céramique glaçuréepar rapport à la céramique peinte la destine aux seulespopulations aisées. À partir du XIVe siècle, cette céramiqueest diffusée sur les sites ruraux, elle est également moinsdécorée. Les pichets destinés à la table sont décorés, tandisque ceux destinés aux tables plus ordinaires ou autransport sont soit peints, soit dépourvus de décor.Le pichet le plus couramment retrouvé dans les contextesparisiens des XIIIe et XIVe siècles est un récipient élancé, à74. CHAMI 1963, p. 95-96.
Fig. 14 : Pichet en grès à décor moulé et rapporté du XVIe siècle,production du Beauvaisis, Paris, fouilles du Grand Louvre
(cl. C.-P. Charniot).
Fig. 15 : Pichet du XIVe siècle, production parisienne, fouilles duGrand Louvre (cl. C.-P. Charniot).
LES PRODUCTIONS CÉRAMIQUES D’ÎLE-DE-FRANCE À LA FIN DU MOYEN ÂGE (XIVe-XVIe SIÈCLE) 263
Publications du CRAHM, 2009
col cylindrique et muni d’une anse verticale surmontée,pour les exemplaires avec glaçure, d’un ergot plus oumoins développé en forme d’oreille (fig. 15). Sa capacitéest de l’ordre du double de la pinte de Paris qui est de0,90 litre. Moins fréquents sont les gros pichets glaçurés,à fond muni de pieds et d’un décor peint (fig. 9, n° 13-14). Des cruches en général pourvues d’un bec pincé,d’un décor peint jusque dans le courant du XVe siècle(fig. 9, n° 16, 36), puis au XVIe siècle d’un décor glaçuré,étaient destinées au transport des boissons du tonneau àla table (fig. 10, n° 10). Enfin une forme particulière, lagourde, récipient peu fréquent au XIIIe et XIVe siècle,connaît un grand succès au XVe et au XVIe siècle, surtouten grès du Beauvaisis (fig. 10, n° 24).
C’est au cours du XVIe siècle que l’on observe l’émer-gence de la platerie de terre. Pourtant les formes creusesen bois ou en métal sont répandues dès le XIVe siècle.Destinés à la consommation individuelle, deux récipientsà large panse font leur apparition dans le vaisselier desFranciliens vers le second tiers de ce siècle : d’abordl’écuelle, forme à rebord droit munie de deux tenons depréhension opposés permettant une prise à deux mains,et l’assiette, forme pourvue d’une aile et pour laquellel’emploi d’une cuillère était nécessaire (fig. 10, n° 19).Comme la plupart des récipients à large ouverture auXVIe siècle, elles sont glaçurées intérieurement, en vert et,
uniquement au début de la période, également en jaune.Les assiettes et plats à décor gravé et jaspé du Beauvaisisconstituent le principal ornement du vaisselier de labourgeoisie, comme leur présence régulière dans lescontextes urbains l’atteste75 (fig. 16 et 17).
Enfin, en dehors de la gobeleterie et de la platerie deterre, deux objets sont représentatifs du prestige de latable au Moyen Âge : la salière et l’aquamanile, vase à eauréservé aux pratiques d’ablutions liées au repas; ils restentrares et réservés aux demeures des élites aristocratiques etbourgeoises. Ces objets sont toujours bien décorés,souvent fabriqués avec des éléments modelés rapportés.L’exemplaire retrouvé à Saint-Denis est un cavalier joueurde cornemuse ; le sel était contenu dans une petitecoupelle placée sur la croupe de l’animal76.
Au XVIe siècle, les réchauffoirs de table, larges conte-nants posés sur une base cintrée, destinés à maintenir lesplats au chaud, grâce à de l’eau placée dans le réservoirou à des braises, l’air chaud passant par des parois évidées(ce modèle est rarissime, à la fois dans les productionsrégionales et dans celles du Beauvaisis), font leurapparition. Les plus anciens réchauffoirs sont attestés
75. RAVOIRE 1994b; ID. 1997; ID. 2002b.76. Plaisirs et manières de table 1992, p. 179.
Fig. 16 : Assiette à décor gravé sur double engobe du XVIe siècle, production du Beauvaisis, Paris, fouilles du Grand Louvre (cl. O. Ravoire).
FABIENNE RAVOIRE264
La cuisine et la table dans la France de la fin du Moyen Âge, p. 249-269
dans de rares contextes parisiens et bourgeois datés dupremier tiers du XVIe siècle (Hôtel de Saint-Aignan77,maison de la Cour Napoléon du Louvre78, Hôtel deMongelas79) (fig. 9, n° 1). Il s’agit de pièces assez singu-lières dans leur conception, avec un bord « crenelé »formant tenon et orné d’un décor plastique polychrome(engobe rouge, glaçure verte et jaune) d’inspirationnaturaliste80. Ces objets ainsi que d’autres de mêmefacture mais destinés à d’autres usages (pichets, bacs àchandelle, porte-couverts [fig. 18]81, sifflets…), ont étéproduits de manière certaine à Fosses82 et sans doute àParis (mais cela reste à prouver par des analyses). Unexemplaire unique, réalisé en pâte à tuile, a été mis aujour lors des fouilles des tuileries du quartier Saint-Honoré (Grand Louvre)83.
77. RAVOIRE 1998c, p. 190.78. RAVOIRE 1997.79. RAVOIRE 2008.80. RAVOIRE 1998c, p. 190.81. Trois exemplaires remarquables ont été trouvés dans un
dépotoir parisien, voir MARQUIS 1999.82. GUADAGNIN 2007, p. 526-534.83. DUFAŸ et RAVOIRE 1998.
Fig. 17 : Assiette à décor jaspé et estampé du XVIe siècle, production du Beauvaisis, Paris, fouilles du Grand Louvre (cl. O. Ravoire).Voir aussi p. 243.
Fig. 18 : «Porte-couvert» à décor rapporté et modelé du XVIe siècle,production de Fosses (?) (Val-d’Oise), Sèvres, Musée national de la
céramique (cl. Ch. Rapa, Commission du Vieux Paris). Voir aussi p. 244.
LES PRODUCTIONS CÉRAMIQUES D’ÎLE-DE-FRANCE À LA FIN DU MOYEN ÂGE (XIVe-XVIe SIÈCLE) 265
Publications du CRAHM, 2009
Ce n’est que dans le second tiers du XVIe siècle quel’usage du réchauffoir de table (fig. 10, n° 17-18),dénommé «réchaud» dans les inventaires de potiers84, serépand dans la société : on le retrouve dans des châteauxtels que Blandy-les-Tours85, dans les demeures bourgeoisesparisiennes86 et dans certaines fermes comme celles deTremblay-en-France et du Colombier à Varennes-sur-Seine87. Cependant, le réchauffoir de table n’est pas unobjet fréquemment retrouvé : certains contextes spéci-fiques comme les établissements monastiques, l’abbayede Chelles par exemple, en ont fait un usage important dufait de la nécessité réglementaire de tenir au chaud laportion des sœurs88. Ces pièces sont fabriquées pour laplupart par des ateliers de la région mais également par lesateliers du Beauvaisis89. Elles présentent toutes un bordqui n’est plus évidé mais surmonté de trois tenons. Selonles productions, elles sont munies d’anses ou tenonsopposés ou encore d’un manche. Celles du Beauvaisis ontsouvent un décor moulé rapporté, plus rarement un décorgravé sur engobe. Trois exemplaires exceptionnels à paroisévidées ont été retrouvés dans un des dépotoirs de l’atelierparisien de Bernard Palissy90.
Conclusion
C’est dans les dernières décennies du XVe siècle que sedessinent les grands changements observés dans les formeset les décors des céramiques qui trouveront leur aboutis-sement quelques décennies plus tard seulement. En effet,
s’il y a rupture par rapport aux époques précédentes, cettedernière ne sera vraiment effective qu’à partir du secondquart du XVIe siècle. C’est à cette époque, sous le règned’Henri II, qu’émerge une orfèvrerie de terre dont lesproductions dites de Saint-Porchaire ou celles de BernardPalissy sont les manifestations les plus remarquables. Cetteorfèvrerie reste cependant l’apanage exclusif de la hautearistocratie91. À l’intention de populations plus modestes,une gamme de céramique décorée, principalement destinéeà la table et à son environnement, est mise à la dispositiondes consommateurs de l’Île-de-France par les potiers deterre de Paris, de la région parisienne et du Beauvaisis. Lemélange des matières, des couleurs, l’ajout de supportdécoratif modelé ou moulé sont autant de procédéstechniques qui permettent aux potiers traditionnels deproposer des produits agréables à la vue comme à l’usage,mettant ainsi en avant une dimension esthétique jusqu’alorsréservée à certains récipients, principalement à boire.
Au-delà de la place nouvelle dévolue à la table, levaisselier céramique mis en place au XVIe siècle apparaîtplus diversifié qu’auparavant. L’émergence de nouvellesformes, la variété des productions rencontrées et la multi-plicité des récipients utilisés soulignent l’évolution desmanières de table et des préparations culinaires. Si cevaisselier ne subit guère de modification notable jusqu’audébut du XVIIIe siècle, en revanche, l’introductionprogressive des faïences dès le XVIIe siècle dans l’équi-pement domestique aura pour conséquence unappauvrissement du répertoire ornemental et décoratifdes productions régionales.
84. RAVOIRE 1997.85. RAVOIRE 2007a.86. RAVOIRE 1991, 1997.87. RAVOIRE 2007b.88. RAVOIRE 2006c.89. RAVOIRE 2006a.90. RAVOIRE 1994b.
91. Ces pièces se trouvaient dans les collections de Catherine deMédicis et du connétable Anne de Montmorency, voir RAVOIRE 1994a,p. 207, fig. 157, n° 116. CREPIN-LEBLOND 1998, p. 17-27. Unfragment de coupe à décor jaspé attribué à B. Palissy a été retrouvé dansle dépotoir de l’abbaye de Chelles (RAVOIRE 1994).
FABIENNE RAVOIRE266
La cuisine et la table dans la France de la fin du Moyen Âge, p. 249-269
ALEXANDRE-BIDON D.2005, Une archéologie du goût. Céramique
et consommation (Moyen Âge-Tempsmodernes), Paris, Éditions Picard,301 p. (Espaces médiévaux).
BOIVIN A., DUFOURNIERD. et LECLER E.1996, «Nouvelles données sur la
céramique très décorée présuméerouennaise», dans La céramique trèsdécorée dans l’Europe du Nord-Ouest(Xe-XVe siècle), Actes du colloque deDouai (7-8 avril 1995), Travaux duGroupe de recherches et d’études surla céramique dans le Nord/Pas-de-Calais (Nord-Ouest Archéologie n° 7).
BOURGEAU L.1987, «La production de céramique
médiévale dans la région de Dourdan(Essonne) », dans CHAPELOT J.,GALINIÉ H. et PILET-LEMIÈRE J., Lacéramique (Ve-XIXe siècles) : fabrication,commercialisation, distribution, Actesdu colloque de Paris 1985, Sociétéd’archéologie médiévale, Caen,p. 77-86.
BRUT C.1986, «Les ensembles des XIIIe et
XIVe siècles », dans Le Louvre desRois : fouilles de la Cour carrée,Archéologia (collection dossierHistoire et Archéologie n° 110),Faton, Dijon.
1995, «La céramique du fossé dudonjon», dans Le Louvre des Rois :De la forteresse de Philippe Augusteau palais-musée de Louis XVI, Faton,Dijon, p. 65-71.
BRUT C. et LAGARDE F.1993, «Une fosse du bas Moyen Âge au
4, rue de la Collégiale à Paris. Étudedu matériel », Les cahiers de laRotonde 14, Rotonde de la Villette,Paris, p. 91-120.
CARTIER J.1997, 2000 ans de céramique en Pays de
Bray, Bulletin du Groupe de recherchesur la céramique du Beauvaisis, n° 19,1967-1997, Trentenaire duGRECB, p. 21-232.
CELLY P. et RAVOIRE F.2001, « Inventaire de la céramique »,
dans CELLY P., «Marcoussis, lechâteau de Bellejame (Essonne) »,DFS, INRAP, SRA Île-de-France,Saint-Denis (93), vol. II, p. 21-27,dactyl.
CLAUDE C.1994, «Aire de diffusion de la céramique
à pâte rouge produite à Dourdan auXIVe siècle », Mémoire de DEA del’École des Hautes Études enSciences Sociales, sous la directionde J.-M. Pesez, 76 p.
2007, «Sucy-en-Brie, ZAC Multisite duCentre ville, 2006 ; Étude de lacéramique médiévale» ; dans TALIND’EYZAC S., « Sucy-en-Brie, ZACMultisite du centre-ville, 2006 »,Rapport final d’opération, INRAP,SRA Île-de-France.
CLAUDE C. et MUNOZ C.1995, «La céramique de la région de
Dourdan aux époques gallo-romaines et médiévales :productions, consommation etdiffusion», dans Bulletin de la Sociétéhistorique et archéologique de Corbeil,de l’Essonne et du Hurepoix,
100e année (1994), Corbeil-Essonne, p. 91-120.
COXALL D. (dir.)1994, Chelles - Fouilles sur le site de
l’ancienne abbaye royale 1991-1992,ville de Chelles, Chelles, 245 p.
CREPIN-LEBLOND T.1998, «Une céramique de cour», dans
Une orfèvrerie de terre, Bernard Palissyet la céramique de Saint-Porchaire,catalogue de l’exposition du musée denational de la Renaissance, Châteaud’Écouen, 24 septembre 1997-12 janvier 1998, RMN, p. 17-27.
DUFAŸ B., KISCH Y. DE, POULAIN D.,ROUMEGOUX Y. et TROMBETTA P.-J.
1987, «L’atelier parisien de BernardPalissy », Revue de l’Art, p. 33-60.
DUFAŸ B. et RAVOIRE F.1998, «La production des objets en pâte
à tuile », dans VAN OSSEL (dir.)1998, p. 305-306.
DURET-BLARY V.1993, Céramiques du XIVe siècle trouvées
dans un dépotoir de l’abbaye deMaubuisson, Service départementald’archéologie du Val-d’Oise, Saint-Ouen-l’Aumône, 144 p. (Archéologieen Val-d’Oise, n° 4).
GUADAGNIN R.1995, «Fosses, un centre de production
de céramiques en Île-de-France, duIXe au XVIIe siècle», dans DELESTRE
X. et FLAMBARD HÉRICHER A.-M.(dir.), La céramique du XIe auXVIe siècle en Normandie, Beauvaisis,Île-de-France, Publications de
BIBLIOGRAPHIE
LES PRODUCTIONS CÉRAMIQUES D’ÎLE-DE-FRANCE À LA FIN DU MOYEN ÂGE (XIVe-XVIe SIÈCLE) 267
Publications du CRAHM, 2009
l’Université de Rouen, n° 202,Rouen, p. 52-60 (Sociabilité,Culture et Patrimoine, Cahierstechniques du GRHIS, n° 2).
2000, Fosses - Vallée de l’Ysieux, Mille ansde production céramique en Île-de-France, vol. 1, Les donnéesarchéologiques et historiques, Publica-tions du CRAM, Caen, 368 p.
2007, Fosses - Vallée de l’Ysieux, Mille ansde production céramique en Île-de-France, vol. 2, Cataloguetypochronologique des productions, Publi-cations du CRAHM, Caen, 735 p.
GUYARD L. (éd.)2003, Le collège de France (Paris). Du
quartier gallo-romain au quartierlatin (Ier s. av.-XIXe s.), éditions MSH(DAF, 95), Paris, 288 p.
LANELUC D.2007, «Melun, jardin de l’Hôtel de
ville : vestiges d’un four de potier etensemble céramique », Bulletin dugroupe de recherches archéologiquesmelunais, 2, p. 59-68.
LESPINASSE R.1886, Les métiers et corporations de la
ville de Paris, XIVe-XVIIIe siècles, Impri-merie nationale, Paris (Histoiregénérale de Paris).
LESPINASSE R. DE et BONNARDOT F.1879, Les métiers et corporations de la
ville de Paris, XIIIe siècle. Le livre desmétiers d’Etienne Boileau, Impri-merie nationale, Paris, 423 p.(Histoire générale de Paris).
MARQUIS P.1999, «La fouille des 12-14, rue des
Lombards à Paris (IVe arr.). Premiersrésultats», Les cahiers de la Rotonde, 21,Rotonde de la Villette, Paris, p. 1-119.
MEYER-RODRIGUES N. et SMIRNOFF H.1992, «Les fouilles de Saint-Denis »,
dans Plaisirs et manières de table1992, p. 343-344.
MEYER O., MEYER N. et WYSS M.1990, «Un atelier d’orfèvre-émailleur
récemment découvert à Saint-Denis», Cahiers archéologiques, 38,p. 81-94.
MORISSON J.1968, «Introduction à la céramique du
Beauvaisis – les argiles et leurs lieuxd’utilisation», Bulletin du GRECB,n° 1, p. 39-49.
NAVARRO-MUSSY M.1992, « Les fouilles archéologiques de
la place de la République à Poissy»,Chronos, n° 26, p. 8-22.
NICOURT J. 1972, «Productions médiévales des
potiers de terres parisiens», Archéo-logia, n° 7, p. 117-130.
1986, Céramiques médiévales parisiennes,classification et typologie, éd. JPGF,Ermont, 366 p.
ORSSAUD D.1992, «Céramique médiévale et post-
médiévale», dans Meaux Médiéval etModerne, Association meldoised’archéologie, Meaux, p. 133-154.
2003, «La céramique médiévale», dansGUYARD (éd.) 2003, p. 193-211.
PACCARD N. et POULAIN D.1997, «Présentation du mobilier», dans
TROMBETTA P.-J. (dir.), «Hôtel deSaint-Aignan, 71-73 rue du Temple,Paris», rapport de DFS, SRA Île-de-France, 3e partie, p. 1-23, dactyl.
PEIXOTO X.1998, «Les fouilles du boulevard Sébas-
topol», rapport final d’opération,INRAP, SRA Île-de-France, dactyl.
PEIXOTO X. et RAVOIRE F.À paraître, «Un four de potier parisien
du XVIe siècle et sa production dansle contexte de l’artisanat de la poteriede terre à Paris », dans BOCQUET-LIÉNARD A. et FAJAL B. (dir.), Àpropo[t]s de l’usage, de la production etde la circulation des terres cuites dansl’Europe du nord-ouest (XIVe-XVIe siècle), Table ronde du CRAHMn° 5, Publications du CRAHM,Caen.
PLAINVAL DE GUILLEBON R.2002, «Les céramistes du faubourg
Saint-Antoine avant 1750. Fabri-cation et commerce. Le point desrecherches en 2002», Bulletin de laSociété de l’histoire de Paris et de l’Île-de-France, 129e année, p. 1-68.
Plaisirs et manières de table1992, Plaisirs et manières de table aux
XIVe et XVe siècles, catalogue de l’expo-sition du musée des Augustins,Toulouse, 345 p.
RAVOIRE F.1990, «Terres cuites glaçurées du
Beauvaisis des XVIe et XVIIe sièclestrouvées cour Napoléon du Louvreet secteur sud du Carrousel à Paris»,Bulletin du Groupe de recherche surla céramique du Beauvaisis, n° 12,p. 87-198.
1991a, «Un ensemble céramique duXVIe siècle : la fosse L1 des thermesde Cluny à Paris », ArchéologieMédiévale, t. XXI, p. 209-270.
1991b, «La céramique de la fossedépotoir F1/11 : présentation d’unensemble du dernier tiers duXVIe siècle », dans VAN OSSEL P.(dir.), « Fouilles des Jardins duCarrousel », rapport collectif defouille programmée des jardins duCarrousel, Paris, SRA Île-de-France,p. 343-350.
FABIENNE RAVOIRE268
La cuisine et la table dans la France de la fin du Moyen Âge, p. 249-269
1992a, «La céramique renaissance», dansMONNET C. (dir.), L’Évacuation desdéchets en milieu urbain au bas MoyenÂge. L’exemple des fosses à fond perdude la cour Napoléon du Louvre à Paris(XIIIe-XVe siècles) et mesures diversespour assainir des villes, Documentsd’archéologie régionale, Universitécatholique de Louvain-la-Neuve, p.56-65 (collection Mertens, VIII).
1992b, «Les productions en terre cuitedans la France du Nord aux XIVe etXVe siècles, vaisselle de table etvaisselle culinaire en Île-de-France»,dans Plaisirs et manières de table1992, p. 101-115.
1994a, «Vaisselle et petit mobilier enterre cuite provenant du dépotoir St-110», dans COXALL D. (dir.), Chelles- Fouilles sur le site de l’ancienneabbaye royale 1991-1992, ville deChelles, Chelles, p. 181-209.
1994b, «Le beau seizième siècle» et «Undépôt singulier de majoliquesitaliennes», dans La fouille des Jardinsdu Carrousel, Les dossiers de l’archéo-logie, 190, p. 74-79 et p. 80-81.
1997, «La vaisselle de terre cuite en Île-de-France entre la fin du XVe siècle etla première moitié du XVIIe siècle.Définition d’un faciès régional »,thèse de doctorat nouveau régime,sous la direction de L. Pressouyre,Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Paris, 960 p., 4 vol.dactyl.
1998a, chap. 4, Le Moyen Âge avant laville : un manoir périubain duXIVe siècle, «La céramique» (p. 120-127); chap. 5, L’enceinte urbaine…,«La céramique des XIVe et XVe sièclesissue des fortifications » (p. 172-184), «La céramique du XVIe et dudébut du XVIIe siècle issue des forti-fications» (p. 180-185) ; chap. 6, Lacroissance d’une ville, «Mobilier desparcelles : La vaisselle en terre cuite(p. 240-248)»; chap. 8, Le domainedes tuileries dans la seconde moitié
du XVIe siècle, «La céramique »(p. 328-330), dans VAN OSSEL (dir.)1998.
1998b, «Le voyage des pots de beurre»,dans FLANDRIN J.-L. et LAMBERT C.(dir.), Fêtes gourmandes au MoyenÂge, Imprimerie nationale, Paris,p. 140.
1998c, «La céramique», «La productioncéramique en Île-de-France », «Lapâte blanche des confins de l’Île-de-France », «Diffusion du grès duBeauvaisis », «La vaisselle glaçuréedu Beauvaisis», «Diffusion du grèsnormand», «La vaisselle de faïence»,dans Aspects Méconnus de la Renais-sance en Île-de-France, catalogue del’exposition du musée archéologiquedu Val-d’Oise à Guiry-en-Vexin,avril-janvier 1998, Éditions d’artSomogy, Paris, 312 p.
2000, «Aperçu sur l’artisanat de lapoterie de terre en Île-de-Franceentre le XIIIe et le XVIIe siècle», dansUtilis est lapis in structura, Mélangesofferts à Léon Pressouyre, Éditions duCTHS, Paris, p. 447-460.
2002a, «Distribution et consom-mation de la majolique d’originefrançaise, italienne et des Pays-Basen France à la Renaissance »,Majolique et verre : de l’Italie à Anverset au-delà. La diffusion de la techno-logie au XVIe siècle et au début duXVIIe siècle, Actes du colloque inter-national d’Anvers (juin 1999),p. 347-370.
2002b, «Céramiques culinairesimportées en Île-de-France aux XVe
et XVIe siècles : différenciationssociales et économiques», dans Actesdes Journées archéologiques de l’Île-de-France, Thème : Boire et Manger,Paris 1991, SRA Île-de-France,p. 48-56.
2002c, «Étude du mobilier en terre cuiteet de la vaisselle», dans DUFOUR J.-Y.(dir.), «Roissy-en-France, Lechâteau : origine et développement
de la résidence seigneuriale d’unvillage du Pays de France », DFS,vol. II, Études spécialisées, SRA Île-de-France, INRAP, p. 116-235.
2005, «La céramique médiévale deCergy-Pontoise, premiers résultats»,dans Bulletin du Centre d’ÉtudesMédiévales, 9, p. 77-79.
2002d, «La céramique», dans BOUËTIEZDE KERORGUEN E. DU, «Hôtel deBeauvais, 68, rue François-Miron(Paris VIe ar.)», DFS, INRAP, SRAÎle-de-France, Saint-Denis (93),p. 19-31.
2006a, «Typologie raisonnée descéramiques de la fin du Moyen Âgeet du début de l’époque moderneprovenant du Beauvaisis, de Paris etd’ailleurs retrouvées sur les sites deconsommation parisiens et franci-liens », Revue archéologique dePicardie, n° 3/4, p. 105-202.
2006b, «Étude de la céramique desdoubles latrines», dans COSTE M.-C. (dir.), Mode de vie et alimentationà la fin du Moyen Âge au château deBlandy-les-Tours. Approche pluridis-ciplinaire des latrines de la salle del’Auditoire, 28e suppl. RACF, p. 87-112.
2006c, «Approvisionnement céramiqueet mode d’alimentation dans lescommunautés religieuses sousl’Ancien régime. L’exemple del’abbaye de Chelles (Seine-et-Marne)et du couvent des Feuillantines àParis (VIe ar.) », dans CLAVEL B.(dir.), Production alimentaire et lieuxde consommation dans les établisse-ments religieux au Moyen Âge et àl’époque Moderne, Actes du colloquede Lille (16, 17, 18, 19 octobre2003), CAHMER (Université dePicardie) et CREDHIR (Universitécatholique de Lille), Histoiremédiévale et archéologie, n° 19,p. 301-325.
2007, «La vaisselle de table encéramique des seigneurs de Blandy
LES PRODUCTIONS CÉRAMIQUES D’ÎLE-DE-FRANCE À LA FIN DU MOYEN ÂGE (XIVe-XVIe SIÈCLE) 269
Publications du CRAHM, 2009
(XIVe-XVIIe siècles)», dans Le châteaude Blandy-les-Tours (Seine-et-Marne),Conseil Général de Seine-et-Marne,éd. Gaud.
2007, «Évolution du confort matérieldans les maisons paysannes sousl’Ancien Régime en Île-de-France(XVIe-XVIIIe s.) : l’apport des sourcesarchéologiques», dans TROCHET J.-R.(dir.), Les maisons paysannes enEurope occidentale, du la fin duMoyen Âge au XIXe s., Actes ducolloque de Paris (Université deParis-Sorbonne, Institut degéographie, Paris, 14-16 septembre2006), Presses universitaires de Paris-Sorbonne, Paris.
2008 «Étude de la céramique de laRenaissance », dans THOMAS N.,«L’Hôtel de Mongelas, Paris IVe»,rapport final d’opération. SRA Île-de-France, INRAP.
à paraître, «Étude d’un ensemble decéramiques du XVIe siècle provenantd’un dépotoir domestique à Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne) », Revuearchéologique d’Île-de-France, 15 p.
RAVOIRE F. et BOUQUILLON A. (avec laparticipation de D. DUFOURNIER)
2004, «La poterie en terre cuite en Île-de-France (XVe-XVIe siècle) :production et diffusion», dans Terrescuites de la Renaissance, TECHNÈ,n° 20, RMN, Paris, p. 53-60.
RAVOIRE F. et MONNET C.1992, «Les fosses à fond perdu miroirs
du quotidien et de l’exceptionnel, lacéramique médiévale », dansMONNET C., L’Évacuation desdéchets en milieu urbain au basMoyen Âge : l’exemple des fosses à fondperdu de la cour Napoléon du Louvreà Paris (XIIIe-XVe siècles) et mesuresdiverses pour assainir les villes,Louvain-la-Neuve, Université catho-lique de Louvain, p. 33-56(collection Mertens ; VIII).
RODRIGUES N.2000, «Panorama de la poterie franci-
lienne du XIe au XVe siècle au traversdes collections archéologiques deSaint-Denis», dans L’Île-de-France
médiévale, catalogue de l’exposition,Musée départemental d’archéologie duVal-d’Oise, Musée intercommunald’histoire et d’archéologie de Louvres,Musée Bossuet de Meaux, 2000-2001,éditions Somogy, Paris, p. 82-88.
TROMBETTA P.-J.1984, «Les fouilles du château de la
Madeleine à Chevreuse. Présen-tation des dépotoirs de la fin duMoyen Âge», Mémoires et documentsde la Société historique et archéolo-gique de Rambouillet et des Yvelines,p. 23-84.
1992, «Le matériel archéologique de laCour Napoléon du Louvre », dansPlaisirs et manières de table 1992,p. 336-340.
VAN OSSEL P. (dir. )1998, Les Jardins du Carrousel (Paris).
De la campagne à la ville : laformation d’un espace urbain, Paris,Éditions de la Maison des sciencesde l’homme, 379 p. (collectionArchéologie préventive, DAF, 73).












![Non obstante quod sunt monachi. Être moine et étudiant au Moyen Âge, dans Quaderni di storia religiosa, 16, 2009 [parution janvier 2011], p. 45-81](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/6313d1e9b033aaa8b210419a/non-obstante-quod-sunt-monachi-etre-moine-et-etudiant-au-moyen-age-dans-quaderni.jpg)