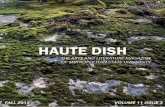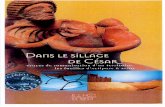Le costume, les armes, les bijoux, la céramique, les ustensiles ...
La céramique du haut Moyen Age de Sauzas à Blagnac (Haute-Garonne)
Transcript of La céramique du haut Moyen Age de Sauzas à Blagnac (Haute-Garonne)
La céramique du haut Moyen Age de Sauzas à Blagnac (Haute-Garonne)1
par Jean Catalo (Inrap, UMR 5608) dessins de Boris Kerampran (Inrap)
L’occupation médiévale du site de Sauzas à Blagnac (Haute-Garonne) était répartie entre zone funéraire et fosses d’habitat du haut Moyen Age. Dirigée par Didier Paya (PAYA 2008), cette intervention a livré de la céramique uniquement dans des structures en creux toute localisées dans la zone 5. Bien que la quantité de fragments de céramique soit très inégale suivant les structures, on note la bonne homogénéité des lots recueillis. La quantité de mobilier résiduel, antique ou plus ancien, est généralement très anecdotique. La céramique médiévale était assez bien conservée, mais le traitement de surface ou l’aspect initial de la couverte des poteries sont apparues assez dégradés par les effets de cuissons fonctionnelles répétées.
Présentation Sur la totalité de l’échantillon, seuls quelques ensembles procurent des lots assez
représentatifs en nombre. On y distingue systématiquement trois catégories de production : à post-cuisson oxydo-réductrice à traitement de surface par polissage, à post-cuisson oxydo-réductrice sans traitement, à post-cuisson réductrice de couleur grise à noire. Les deux dernières de ces catégories pourraient être éventuellement regroupées, à en juger par l’analogie des pâtes utilisées. En effet, dans les deux cas, l’argile sableuse employée est très micacée. Les variations de couleur, résultat d’une post-cuisson différente, ne semblent pas constituer le signe d’une production distincte dans la plupart des cas, mais elle a toutefois été prise en compte dans l’inventaire.
La première catégorie est généralement appelée « rouge polie » en raison de son aspect de surface caractérisée par un polissage au brunissoir sur la quasi-totalité du vase. La pâte est alors assez fine et très cuite. Les tessons présents ici sont peu nombreux mais la proportion de cette catégorie atteint 3 à 10 % en moyenne des fragments retrouvés dans la plupart des lots. Ils ne permettent pas de restituer une forme de vase mais la présence de deux anses plates et larges (fig. 1, 5063-4), dont une à nervure centrale (fig. 1, 5049-1), de bords droits et ronds (fig. 3, 5063-2), et d’une lèvre de bec laissent penser à des cruches de type comparable aux récipients à déversoir tubulaire accolé à la lèvre (GUEDON VALLET 2007, p. 52 fig.19 n°21). Le polissage est généralement très soigné et très couvrant combiné à un lissage qui tend à effacer les traces du polissage. La couleur obtenue en surface par ce traitement varie autour d’un orangé plus ou moins bruni. Les parois généralement épaisses laissent à l’âme de la pâte une teinte grise que la post-oxydation n’a pas fait virer.
Deux types d’oules La céramique grise présente une faible variété de pâte. Les tessons appartiennent tous
à des formes de pot sans anses ni bec : l’oule. Deux types de profils distincts se trouvent associés au sein de l’échantillon. Le premier se caractérise par des vases à panses globulaires plutôt oblongues. Les lèvres sont courtes, carrées, peu éversées et volontairement aplaties, ce qui donne à l’extrémité un aspect biseauté (fig. 2, 5052-1 et 5128-1). Cette tradition semble le résultat de la simplification de rebord à crochet d’époque mérovingienne puis de lèvres
1 Etude réalisée en 2008 (PAYA 2008)
effilées sur l’arête supérieure par l’accentuation d’une légère dépression interne du bord comme dans le cas du col 5014-01 (fig. 3). A cette exception près, les bords courts et lèvre aplatie plus simples sont présents dans tous les lots. Ils définissent des ouvertures relativement étroites de diamètre de 7,5 à 8,5 cm généralement. Ce diamètre est aussi celui du fond qui est plat. Cette forme peut évoluer vers une oule à bord en amande où la lèvre adopte radicalement l’aspect biseauté. C’est le cas de l’oule 5128-01 (fig. 2) qui présente un fond très légèrement lenticulaire.
Le second type marque une évolution par rapport au précédent sur deux critères principaux. Le diamètre de cet autre type d’oule est plus globulaire avec un extremum de panse à mi-hauteur du vase. Le diamètre d’ouverture atteint 12 cm comme le fond alors plus nettement lenticulaire. Le bord, toujours assez peu éversé, est maintenant rond sans traitement particulier de la lèvre (fig. 2, 5068-1).
Dans les deux types de récipient, la paroi de l’oule est plus épaisse que la lèvre avec un amincissement jusqu’à l’extremum de panse. Ceci indique une fabrication du pot en deux parties réunies ensuite. La partie haute porte encore les traces visibles du tournage, alors que la partie basse paraît avoir fait l’objet d’un lissage à l’aide d’un tissu dont on distingue parfois les empreintes obliques.
Eléments de décor La décoration de vases en céramique grise est essentielle réalisée à partir de lignes
imprimées, horizontales et concentriques, espacées sur l’épaulement (fig. 1, 5039-1, 5063-3). Ces motifs semblent avoir été réalisés sur le type d’oule à lèvre carré et ouverture étroite bien qu’aucun profil complet n’ait été observé. Ces lignes de petits pointillés triangulaires ou carrés résultent probablement du passage d’une molette simple. Pourtant la répétition de séquences identifiables courtes, ou de composition de lignes par tronçons, semblent aussi indiquer l’utilisation de peigne ou d’éléments de peignes tels qu’on les connaît le haut Moyen Âge. Cette utilisation d’un élément de peigne comme outil peut être confirmée par les rares motifs ondés également présents sur certains tessons. En effet, ces derniers présentent une triple ou une quadruple ligne de dessin qui correspond sans doute à l’empreinte d’un fragment de peigne de quelques dents.
Approche chronologique Encore très récemment, le changement de forme des lèvres des oules en pâte grise
semblait marquer une différence chronologique entre certains lots. En effet, les petits bords biseautés et ouvertures étroites sur des formes fermées larges, tout comme le décor de lignes au peigne sont connus en Toulousain pour la période carolingienne. Ces caractéristiques ont été observées à Toulouse même en contexte urbain au Donjon du Capitole et au Lycée Ozenne ou sur le site de la Cité judiciaire. Sur ces sites, et de façon plus générale en Midi-Pyrénées, elles précèdent les oules à lèvres éversées et rondes, plus globulaires, considérées plus caractéristiques des IXe-XIIe siècles. Dans ce cas de figure, les fonds plats du VIIIe siècle évoluent pour devenir faiblement lenticulaires au IXe siècle. Le phénomène d’évolution du profil de plus en plus globulaire s’accompagne d’une augmentation progressive du diamètre d’ouverture. La céramique rouge polie, systématiquement datée entre le IXe et le XIIIe siècle, accompagne les deux types. Le faciès céramique est alors présent sur de nombreux sites du Lauragais languedocien (CATHMA 1993, p.194-196 et 205-206), et aussi du Gers ou en Haute-Garonne.
Ici, comme à Toulouse2 et ses environs3, l’association des deux types et de la céramique rouge est étroite. Toutes les structures contenant un mobilier représentatif, et à l’intérieur des unités stratigraphiques qui les composent, ont livrés des tessons des deux types. Si les bords carrés d’aspect biseauté sont les plus fréquents, on ne peut identifier aucun lot présentant uniquement des bords ronds et fonds bombés. Un tableau récapitulatif de la présence des critères jugés distinctifs (bord carré, bord rond, fond plat, fond bombé, rouge polie, décor molette) résume cette contemporanéité, même partielle, de ces différents types.
Pour un approche chronologique actualisée, il faut se référer à des fouilles récentes
ayant fait l’objet de datation au radiocarbone. Sur le site du palais de justice de Toulouse, les bords carrés et les décors de lignes pointillés (CATALO 2007, pl. 12) sont eux issus de certains contextes bien datés par radiocarbone sur des sépultures entre 850 et 1000 et, en particulier une monnaie émise entre 888 et 893.
A Narbons (Montesquieu-Lauragais, Haute-Garonne), le mobilier découvert présente un faciès proche de ceux des sites de Cornebarrieu et de Blagnac avec entre 10 et 26 % de rouge polie. Les oules à bords carrés, fonds plats ou légèrement bombé, sont représentées sans être le type majoritaire (GUEDON VALLET 2007, p. 49-53, fig. 18 et 19). Les décors se résument à des sillons simples. Les quatre datations C14 offraient une fourchette chronologique large entre 776 et 1159 ap. J.-C.
A Puylaurens (Tarn), site de La Plaine, des tombes accompagnées d’oules à bord rond et éversé et fond bombé ainsi que de pégaus en « rouge polie » ont été datés entre 867 et 1043 ap. J.-C. par quatre analyses C14. Sur le même site, des bords carrés d’oules ont été découverts en dehors des tombes, dans un four, des fosses ou des silos avec des datations plus anciennes (deux analyses) entre 760 et 899 ap. J.-C. (GRIMBERT 2008, p.227-237). Toutefois, on relève ici des diamètres d’ouverture compris en général entre 11 et 15 cm, et uniquement des motifs ondés sur épaulement comme décors (GRIMBERT 2008, p.47-49).
Le site rural de l’Ourmède (Castelnau d’Estrétefonds, Haute-Garonne), au nord de Toulouse, avait livré un type d’association de mobilier très comparable à Puylaurens, pour lequel les lèvres biseautées et les faibles diamètres d’ouverture (11 cm) des oules sur des profils ovoïdes semblent minoritaires. Le seul décor recensé sur récipient en pâte grise est là encore un motif ondé (REQUI 1999, p. 29-36, pl.1-6). En revanche, la catégorie rouge polie présentait quelques vases à bec pontés et décor à la molette. Les datations réalisées donnaient une fourchette chronologique comprise entre 860 et 1070 ap. J.-C (REQUI 1999, p. 38).
Ces quelques repères chronologiques régionaux tendent à définir une évolution du
faciès céramique commune aux sites ruraux et urbains en Toulousain. Entre le VIIIe et le XIe siècle par la disparition progressive de la production en pâte grise d’oule à fond plat, ouverture étroite, bord carré et décor de lignes pointillées. Les oules plus globulaires à bord rond, diamètre d’ouverture plus large, fond légèrement bombé et décor ondé semblent les remplacer selon un processus plus lent qu’il n’était apparu au premier abord, pour s’imposer plus nettement à partir du XIe siècle. Les deux types de récipients semblent être en usage ensemble au moins aux IXe et Xe siècles. Au regard des datations disponibles, la céramique rouge polie apparaît dès le début de la période considérée, mais n’atteint le quart des fragments retrouvés que passé l’an mil. Considérant, la présence majoritaire de bords et de
2 CATALO J., FOY D., LLECH L., Mobilier de la fin de l’Antiquité et du haut Moyen Âge à Toulouse sur le site du « Donjon du Capitole », Archéologie médiévale, tome 28, 1998, p. 14-15. 3 Le site de Laville à Cornebarrieu (Haute-Garonne) a fourni le même type d’assemblage de mobilier pour un ensemble de structures en creux comparables à celles de Blagnac. Le pourcentage de céramique rouge polie proche 25% représente néanmoins une différence notable qui s’expliquait par la présence moins marqué du type d’oule réputé ancien (VEYSSIERE 2008).
décor de type ancien, la chronologie proposée pour le site du Sauzas sera une fourchette haute VIIIe-Xe siècles. Bibliographie ARRAMOND 1994 : ARRAMOND J.-C., A-64, Villeneuve-de-Rivière, la Chapelle et Saint-Pierre, D.F.S. de sauvetage programmé, SRA, Toulouse, 1994. ARRAMOND 1997 : ARRAMOND J.-C., CATALO J., LLECH L., MOLET H., RODET-BELARBI I., Site du Lycée Ozenne à Toulouse (Haute-Garonne). D.F.S., A.F.A.N./S.R.A. Midi-Pyrénées, Toulouse, 1997. BOCCACINO 1992 : BOCCACINO C., Du sauvetage archéologique d’un atelier de potiers médiévaux à la restitution de son image au Moyen-âge : enquête sur un environnement et sur une fabrication. Exemple du site de Bel Soleil à Cornebarrieu (Haute-Garonne), mémoire de maîtrise, U.T.M. 1992, 2 vol. CATALO FALCO 1990 : CATALO J., FALCO J., L’habitat rural médiéval de Vacquiers (Haute-Garonne), actes du premier colloque Aquitania, supplément Aquitania 4, 1990, p.137-149 CATALO 1996 : CATALO J. et alii, Donjon du Capitole Toulouse (31), D.F.S. A.F.A.N./S.R.A. Midi-Pyrénées, Toulouse, 1996. CATALO 2007 : CATALO J. (dir.), PAYA D., MOLET H., CALLEDE F., LLECH L., RODET-BELARBI I., GENEVIEVE V., DAYRENS O., CORNARDEAU S., Cité Judiciaire, Toulouse Haute-Garonne Midi-Pyrénées, Rapport final d’opération, Inrap, SRA Midi-Pyrénées, 2007, 3 vol.. CATHMA 1993 : CATHMA, Céramiques languedociennes du Haut Moyen Age (VIIe-XIe s.) études micro-régionales et essai de synthèse, Archéologie du Midi médiéval, tome XI, 1993, p.111-228. CAZES 1997 : CAZES J.-P. dir., L’Isle-Jourdain « La Gravette » (Gers), Document final de synthèse de sauvetage urgent, avec le concours de la Direction Départementale de l’Equipement du Gers, SRA Midi-Pyrénées, 1997, vol. 1 p. 142-143, vol.2 pl. 17-22, 27, 38, 40. GUEDON VALLET 2007 : GUEDON F., VALLET C., Le site de Narbons, une aire agricole de la fin du haut Moyen Âge (commune de Montesquieu-Lauragais, Haute-Garonne), Archéologie du Midi médiéval, tome 25, 2007, p. 35-58. GRIMBERT 2008 : GRIMBERT L., (dir.), Puylaurens La Plaine (Tarn), Rapport Final d’Opération, Inrap, février 2008, 3 vol. LASSURE VILLEVAL 1990 : LASSURE J.-M., VILLEVAL G., Quelques productions céramiques dans la région toulousaine, Archéologie et vie quotidienne au XIIIe et XIVe siècle en Midi-Pyrénées, catalogue d’exposition au Musée des Augustins, 7 mars - 31 mai 1990, Toulouse, p. 285-288. PAYA 2008 : PAYA D. (dir.), Sauzas, Blagnac (Haute-Garonne), R.F.O. secteur médiéval, Inrap, 2008. REQUI 1999 : REQUI C. dir., Site de l’Ourmède, Castelnau d’Estrétefonds (Haute-Garonne), D.F.S., AFAN Sud-Ouest, SRA Midi-Pyrénées, Toulouse, 1999. VEYSSIERE 2008 : VEYSSIERE F. (dir.), AMIEL C., BRIAND J., BRUXELLES L., CATALO J., CHANDEVAU F., DAYRENS O., KERAMPRAN B., MARTIN H., MARTY P., ONEZIME O. - L'occupation antique de la Ville - ZAC des Monges Cornebarrieu (Haute-Garonne), RFO, Inrap, septembre 2008, 3 volumes, 100 figures, 20 annexes, 563 p.