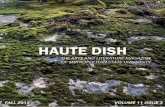L'Ourmède une aire d'ensilage à Castesnau d'Estretefonds (Haute-Garonne)
Transcript of L'Ourmède une aire d'ensilage à Castesnau d'Estretefonds (Haute-Garonne)
• •
•• • • • •
• fosse
I fond de silo
▪ silo
B Aire d'ensilage
e
I
L
Fig. 1
Castenau-
d'Estrétefonds/L'Our-
mède. Localisation des
structures en creux et
des aires d'ensilage
(DAO C. Regui/Inrap).
L'Ourmède : une aire d' a Castelnau-d'Estr
(HAUTE-GARONNE)
Le site Située au pied des coteaux du Frontonnais, l'oc-cupation médiévale est installée sur les dépôts alluvionnaires des ruisseaux de l'Hers et du Girou et se poursuit sous les limites nord et sud de la fouille. Le lieu-dit de l'Ourmède fait par-tie de la paroisse de Castelnau-d'Estrétefond depuis 1131. Auparavant, ce territoire dépen-dait de la paroisse de Saint-Martin, dont la pre-mière mention du xe s. souligne son apparte-nance au domaine du comte de Toulouse Ray-mond I". C'est seulement au xne s. que les droits de ce terroir seront partagés entre la famille de Castelnau et l'abbaye de Grandselve. Très peu d'informations sont disponibles sur la fin de la période carolingienne, mais, dans un premier temps, seules les archives départementales et municipales de Toulouse ont pu être exami-nées (étude Henri Molet/Inrap). Deux cents structures en creux — composées de silos, de fosses, de fours — organisent l'es-pace. Les silos représentent les deux tiers des vestiges et aucun ne contenait son dépôt de grains d'origine ; ils ont souvent été réutilisés
comme dépotoirs. Le reste des structures est constitué de fosses dont l'utilisation est indé-terminée. Deux ensembles de fours ont été découverts sur le site, chacun ayant de trois à quatre fours circulaires ou ovales, aménagés dans le substrat et munis d'un cendrier commun. Les dernières couches d'utilisation, encore en place, per-mettent de restituer la chronologie relative de la fin de leur utilisation.
L'aire d'ensilage Réparties sur un hectare, les deux cents struc-tures qui composent l'aire d'ensilage fouillée ne correspondent qu'à une partie de l'espace agraire initial. Les espaces vides déterminent la circulation à l'intérieur de l'aire (fig. 1) et la scindent en cinq secteurs, composés en majo-rité de silos et de fosses disposés en batteries alignées (encadré A). Certains assemblages de quatre à six structures marquent une organi-sation selon un plan quadrangulaire. Sur le site de Villeneuve-de-Rivière (Haute-Garonne), des ensembles similaires étaient ceinturés de trous
PAR CHRISTOPHE REQUI AVEC LA COLLABORATION DE CHRISTINE LE NOHEH, ISABELLE RODET-BELARBI, LAURENT BOUBY, HENRI MOLET
La fouille archéologique de l'Ourmède a eu lieu lors de l'été 1999, à l'emplacement de la future ZAC Eurocentre sur la commune de Castelnau-d'Estrétefonds, à 10 km au nord-ouest de Toulouse. Cette intervention a permis d'étudier un espace dédié au traitement des céréales aux alentours du xe s. Les informations recueillies permettent d'entrevoir le mode de gestion des réserves, les espèces cultivées, la culture matérielle et l'environnement immédiat.
Archéopages n°8 • Novembre 2002
20 m o
•
••
Regroupement de silos
e directeur de l'ensilage
Axe de circulation
3 La conservation des céréales en atmosphère confinée
e silo est un réservoir
creusé dans le sol où l'on
entrepose les denrées
agricoles afin de les
conserver. Le grain, une
fois battu et vanné, est
enfoui dans une fosse silo
hermétiquement scellée à
l'aide de terre ou d'argile. Isolé
des attaques des insectes, de
l'humidité et de l'air extérieur,
le grain continue à respirer :
l'oxygène encore présent dans
le silo se transforme alors en
gaz carbonique. Sans
oxygène, le grain entre dans
une phase de dormance qui
permet une conservation des
qualités nutritives et germinatives sur une longue
durée. Ce type de silo n'est
pas une réserve dans laquelle
on peut puiser de temps en
temps : une fois le silo ouvert
le grain doit être intégralement
utilisé. 1
ensilage mediévale étefonds
Novembre 2002 • Archéopages n°8
Pt4 38 P1439 116,5 in
P1429 Pt 428
1364
116,5m
116 rn
115,5 m_
Fig. 2
Castenau-
d'Estrétefonds/L'Our-
mède. Plan et coupes
des fours de l'ensemble
sud (DAO C. Requi/lnrap).
Coupe B
Coupe C
O Remblai d'abandon
IO1 Niveau d'utilisation du dernier état du four FR180
CI Niveau d'utilisation des 1°' et 2° états du four FR180
IO1 Réfection du four FR178
Cl Niveau d'utilisation du 1°' état du four FR178
O Niveau d'utilisation du dernier état du four FR178
• Niveau de scories
die Voûte de l'alandier
Effondrement du four
1409
1558 0 2m
Coup, A
LLI
LU
de poteau (Arramond et al. 1994). À l'Our-mède, moins de 10 % des silos échappent à ces regroupements. Un puits se trouve à la croisée des chemins, au centre de la surface fouillée. À l'intérieur des trois plus grands secteurs, les batteries de silos alignés sont orientées de ma-nière à faciliter l'accès et la circulation. Mal-heureusement, l'arasement du site, évalué à 70 cm de moyenne sous le niveau de sol ini-tial, d'après la restitution des formes et des vo-lumes des silos (encadré B), a irrémédiable-ment détruit les aménagements de surface (trous de poteau, parcellaire...) qui auraient permis de mieux comprendre la complexité de cette organisation.
Des silos et des hommes...
Les projections effectuées à partir des textes mé-diévaux et des études sur l'âge du Fer (Raynaud 1990) rendent possible une estimation de la ra-tion moyenne annuelle de céréales nécessaire à la vie d'un individu : 3,5 hl de grains par indi-vidu et par an. Pour ensemencer un champ, les études ont montré qu'un semis à la volée d'une densité de 2 hl à l'hectare légèrement recouvert à l'araire permettait un bon rendement des ré-
cokes. Pour l'époque carolingienne, de nom-breuses discussions partagent les chercheurs au sujet du rendement agricole : Georges Cornet propose un rapport maximal de 4 pour 1 qui se-rait plus proche de la réalité que celui de 2 pour 1 tiré du texte concernant le fisc d'Annapes (Comet 1992). À partir de ces données, il est possible d'obtenir des estimations de la superficie ensemencée, de la production nette ou brute et de son équiva-lent nutritif, basé sur la consommation annuelle de céréales par individu. Un silo moyen d'une contenance de 13,5 hl obtenue à partir d'une parcelle d'environ 1,5 ha pourrait nourrir 4 per-sonnes par an. Semé sur une superficie de 7 ha, ce volume donnerait une production nette de 40,5 hl de grains et pourrait alors nourrir 12 in-dividus pendant une année. Ces projections per-mettront certainement d'évaluer la population nécessaire aux activités de ces installations ru-rales, en ramenant les superficies cultivées en terme de " bras " nécessaires pour les exploiter. La reconstitution des habitudes culturales à par-tir des sites d'ensilage se heurte à trois grands types de problèmes : la nature des denrées cul-tivées, la contemporanéité des structures de stoc-
o Archéopages n°8 • Novembre 2002
kage (leurs capacités, leurs rendements et l'or-ganisation qui en découle) et enfin la nature des exploitations. La nature des denrées agricoles ensilées peut seulement être effleurée car nous ne possédons que des informations secondaires. Nous connais-sons les céréales rejetées, impropres à la consom-mation du fait de leur carbonisation, qu'elles soient tombées dans un foyer lors de leur ma-nipulation ou qu'elles aient subi un accident lors d'un séchage. La présence des légumineuses est attestée mais les calculs d'estimation de surface cultivée, de ration moyenne annuelle, etc. re-posent uniquement sur les céréales. Les fosses indéterminées, soit 25 % des structures, n'ont pas été intégrées dans les calculs. Elles sont ré-parties sur l'ensemble du site et seules six d'entre elles s'intègrent à l'organisation en ligne. En ce qui concerne la chronologie relative des structures, les datations apportées par le mo-bilier et les analyses au 14C manquent de la précision nécessaire afin d'établir des relations de contemporanéité fiables. La faible fréquence des recoupements permet de poser le postu-lat suivant : les silos matérialisés au sol ré-pondaient à une organisation raisonnée des ré-serves qui a pu se dérouler sur plusieurs an-nées. Les silos d'un même ensemble sont liés par des critères déterminés à l'avance. Ces cri-tères peuvent être d'ordre technique (capacité du silo), d'ordre typologique — classement par espèces ensilées, appartenance à une famille qui les a produits, selon les champs desquels ils sont issus, selon les personnes auxquels ils sont destinés... Autant d'hypothèses sédui-santes. Les estimations de capacité peuvent renvoyer à une organisation par groupements familiaux : un silo moyen pour une famille, un groupement de silos en ligne ou en batterie pour une famille élargie. Les groupements du secteur C possè-dent des capacités d'ensilage près de deux fois plus importantes que ceux des secteurs A et B,
sans comporter plus de recoupements. Ces sec-teurs de dimensions différentes pourraient ré-pondre à des impératifs fiscaux ou administra-tifs : chacun correspondrait à une division du manse. On peut y voir aussi une organisation économique déjà tournée vers les échanges ex-térieurs à la communauté. On peut encore pen-ser à une organisation liée au fonctionnement des exploitations (semence, nourriture des ani-maux...) et à la consommation des paysans, et d'autres aux stockages des surplus en vue d'une commercialisation.
Les fours Deux ensembles de fours distants d'environ 25 m ont été découverts. Ils sont constitués de trois fours situés au sud et quatre au nord du site (fig. 1). Le schéma directeur de tous ces fours est identique : il s'agit d'une chambre de chauffe hémisphérique d'environ 2 m de dia-mètre, creusée dans le substrat limoneux, dont l'ouverture (alandier) donne sur une fosse plus ou moins ovale qui constitue l'aire de travail et le cendrier. Lorsqu'une chambre de chauffe ne donnait plus satisfaction, les hommes en creu-saient une autre connectée à l'aire de travail. Certains fours ont néanmoins pu fonctionner simultanément (fig. 2). Les fours rencontrés sur le site existent en Ile-de-France depuis le haut Moyen Âge. De nombreux exemples (41) ont été mis au jour sur le site de Villiers-le-Sec (Val-d'Oise) (Cuisenier 1988: 242-250). On les trouve en périphérie d'habitat afin d'éviter tout risque de propagation du feu en cas d'in-cendie. Leur fonctionnement est bien connu (fig. 3) : ce sont les parois réfractaires du four, préalablement montées en température et soi-gneusement vidangées des braises et des cendres, qui cuisent ou sèchent les aliments. Les ouvertures, cheminée et alandier, étaient bouchées avec des pierres ou des fragments de meules réutilisés, comme c'est le cas ici. À POurmède, les fours étaient entièrement "ré-servés" dans le substrat et ne possédaient pas de partie à l'air libre construite à l'aide de tor-chis comme par exemple sur le site de Das-sargues (Lunel, Hérault) (Garnier et al. 1995 : 55). L'orifice en avant de la chambre de chauffe pouvait servir de cheminée lors de la mise en chauffe du four puis d'évent lors de son utili-
Fig. 3
Restitution de
l'utilisation des fours
(d'apr. Cuisenier 1988 :
244).
Novembre 2002 • Arehéopages n°8
Q
95 72 ..
H: 8,19 cm 0 San I__MM=■=
Fig. 4
Castenau-
d'Estrétefonds/L'Our-
mède. Cruche à bec
ponté en céramique
rouge polie (DAO
C. Le Noheh/Inrap).
sation (après vidange des braises et des cendres) afin de contrôler et de réguler la température interne. Les parois des chambres de chauffe étaient gros-sièrement creusées à l'aide de piochons. Un soin particulier était apporté à la construction de la sole destinée à être vidangée régulière-ment. Les réfections successives de celle de cer-tains fours montrent que les structures de chauffe de l'Ourmède étaient soigneusement entretenues et utilisées sur le long terme. Des expérimentations ont prouvé que la tempéra-ture maximale atteinte est de 443°C après une heure de chauffe (Gérard 1993). Ce type de four est souvent associé aux aires d'ensilages en Midi-Pyrénées, en Dordogne, dans le Gard et dans l'Hérault, avec une pré-sence de grains d'orge et de céréales indéter-minées dans les niveaux d'occupation qui at-teste certainement une activité de séchage des grains, couplée à l'activité de boulangerie déjà avancée pour ce type de four. Le volume de grains à traiter à l'issue des récoltes nécessitait certainement le fonctionnement de plusieurs fours en même temps. Les grains devaient être séchés sans annuler leur capacité germinatrice, ou torréfiés afin de les utiliser seulement pour l'ali-mentation et limiter les risques de germination. 12 panification des céréales nécessite une mou-ture qui est facilitée par des grains secs ; s'ils sont trop humides, deux moutures successives seront nécessaires. Des expérimentations ont montré (Sigaut 1978) que deux moutures étaient nécessaires pour obtenir un rendement de farine convenable à partir de grains issus d'un ensilage de 18 mois (les grains contenaient 15 à 17 % d'humidité). On peut comprendre que ce surcroît de travail pouvait être évité par un séchage des grains avant mouture.
Des éléments de la vie quotidienne Les données archéologiques et environnemen-tales permettent de restituer certains éléments de la vie quotidienne des communautés rurales médiévales. Les conclusions livrées ici sont ex-traites des travaux interdisciplinaires que né-cessite le traitement de ce type de site.
Le mobilier archéologique : formes et éléments de datation Le matériel céramique issu des structures est techniquement et morphologiquement homo-gène. Au regard de ces données, il est intéres-sant de remarquer que l'ensemble des caracté-ristiques de la céramique trouve la majeure par-tie de ses éléments de comparaison dans des contextes stratigraphiques régionaux datés du xe au xIIIe s. : phases I et II du site de Montai-gut (xe-xue s.), Vacquiers (xme s.). Le " vaisselier " comporte deux catégories de cé-ramiques régionales prépondérantes : la céra-mique grise grenue et la céramique rouge polie. Pour la première, les formes fermées liées aux fonctions de stockage et de préparations culi-naires se composent de pots culinaires (de type oule) à profil globulaire plus ou moins marqué, d'une contenance moyenne de 0,8 à 3 litres, de vases à ressaut sur l'encolure haute et droite, de cruches à bec pincé au profil globulaire d'un vo-lume sous encolure de 9 litres. Un plat à profil évasé et bord simple est la seule forme ouverte représentée. Pour la seconde, on trouve des cruche pansues (fig. 4) à bec ponté avec des anses rubanées opposées à fond plat, des cruches à goulot trilobé munies d'une ou de deux anses rubanées latérales et des vases à haute encolure évasée dont nous ne possédons pas le profil. Les datations par le radiocarbone, dont les four-chettes chronologiques sont centrées sur le xe s., offrent un contexte historique au mobilier qu'il convient de rapprocher du site de l'Isle-Jour-dain (Gers). En effet, ce site atteste un mobi-lier abondant pour des niveaux stratigraphiques des xe-xie s. bien situés, lequel présente des si-militudes avec celui de l'Ourmède : on re-marque une partition nette entre la céramique grise grenue et la rouge polie, une prédomi-nance de fonds plats et de bords droits simples pour les cruches en pâte rouge polie, et la pré-sence d'impressions en pointillé, réalisées à la molette, pressenties comme étant un décor de tradition mérovingienne, attribuable aux alen-tours du ville et peut-être une partie du De s. Des outils agricoles en fer (fig. 5) ainsi que des
o Archéopages n•13 • Novembre 2002
Outillage agraire :
1 fourche à deux
dents ; 2 curettes
d'aiguillon-déboureur,
outil fixé par une
douille ouverte à
l'opposé de l'aiguillon
qui servait à
débarrasser le soc des
racines et des herbes
(d'apr. Archéologie et
vie quotidienne aux
xiire-xie siècles en
Midi-Pyrénées,
Catalogue
d'exposition, Musée
des Augustins, 1990,
p. 244) ; 3 faucille (cl.
C. Le Noheh/lnrap).
Fig. 5
0 cm
CM7=111r7=
lames de couteau et des éléments de clouterie forgés ont été mis au jour. Cinq meules en grès servaient à moudre des grains de céréales. Des pesons et des fusaïoles servaient au tissage.
Un espace ouvert dédié à l'agriculture Les spectres polliniques témoignent, par l'abon-dance des rudérales, d'un environnement ou-vert et très anthropisé. Un pollen de céréale et la présence de fabacées attestent la proximité de cultures céréalière et légumineuse, et cor-respondent aux grains retrouvés carbonisés dans les remblais d'abandon des silos. Les pol-lens d'arbres identifiés sont enregistrés comme étant des apports lointains. Les spectres polli-niques issus d'un fond de silo comportent moins de rudérales et plus de prairiales. Le pay-sage y apparaît ouvert. Au vu de ces résultats et compte tenu des pro-blèmes de conservation, les interprétations doi-vent être axées prioritairement sur la recherche des productions humaines (céréales, légumi-neuses) plus que sur l'étude de l'environne-ment. Les cultures de céréales sont attestées dans le niveau d'occupation du four et la pré-sence de légumineuses est soulignée dans les remblais d'abandon des silos. Les assemblages carpologiques étudiés par Lau-rent Bouby (centre d'Anthropologie-UMR 8555) ne proviennent pas du remplissage primaire des fosses silos ; ils sont issus de couches de déchets qui les comblaient lors de leur abandon. Les ressources céréalières semblent principale-ment constituées par l'orge vêtue, le blé nu, le millet commun et l'avoine. On remarque la rela-tive discrétion du blé vêtu, probablement attri-buable à l'engrain, et du seigle, ce dernier étant peut-être légèrement sous évalué à l'Ourmède pour des raisons taphonomiques. La diversité des messicoles doit probablement être mise en rela-tion avec la pratique courante de la culture des céréales d'automne (blé nu, orge vêtue et seigle plus particulièrement). Les mauvaises herbes des cultures sarclées ou de printemps peuvent, elles, notamment être liées à la culture du millet com-mun comme à celle de la fève et du lin. Les ressources fruitières sont en grande partie documentées par le matériel minéralisé. Si celui-ci attribue une forte représentation au figuier, il est vraisemblable que la vigne ait joué un rôle économique plus important que ce dernier.
L'alimentation d'origine animale La liste des espèces étudiées par Isabelle Rodet-
Belarbi (Inrap) est relativement longue puisque l'on trouve à la fois les animaux domestiques, quelques bêtes et oiseaux sauvages auxquels s'ajoutent les espèces commensales et les pois-sons. Les ossements découverts dans le rem-plissage des fours, des fosses et des silos pro-viennent soit d'animaux tombés dedans sans pouvoir ressortir, soit d'animaux morts (mort accidentelle, de maladie...) enterrés dans une excavation en cours de comblement, soit de pièces de viande consommées. En effet, de nom-
Novembre 2002 • Archéopages n'8
ce
116,35 Ne;
11502 NGF 7 -1 1402
02
116,3 NO
15.85 NGF
11,35 NO
11111111111111111tileibbillie 1/13
1315
enidlee\NI 11111111:111111 oo Mile'e."11 It:»3à1111101111.
OS
103
0 Calculs des volumes des silos ous ne rentrerons pas
dans le détail des formes
et des comblements, pour
cela nous vous renvoyons
aux publications (Conte
1995 ; Gentili 1988 ;
Raynaud 1990) dont nous
nous sommes inspirés pour la
problématique et les critères
d'enregistrement utilisés lors
de la fouille et disponibles
dans le DFS.
La restitution des profils
s'orchestre autour de deux
pôles : la comparaison avec
les silos d'autres sites du
Moyen Âge et l'observation de
la présence d'effondrements
de parois qui permet de
valider la forme ou de la
nuancer (Gentili 1988 : 222,
fig. 66).
Afin d'estimer les volumes
ensilés, il faut décomposer la
forme géométrique du silo en
deux ou trois formes
géométriques théoriques.
Pour les sphères, le calcul
s'opère simplement avec la
formule suivante : 4/3 Pi R3.
Pour les silos ovoïdes et
piriformes ou en tronc de
cône, la formule est identique,
elle se décompose en trois :
- partie haute : volume du
secteur sphérique = 2/3 Pi R 2 h ;
- partie basse : volume du
cône tronqué = Pi H/3
(R2+r2+Rr) ;
- si le silo est concave :
volume du secteur sphérique
= 2/3 Pi R2 h ;
étant entendu que :
h = hauteur de la portion de
sphère, H = hauteur du tronc
de cône, R = grand rayon,
r = petit rayon.
Le résultat obtenu est approximatif du fait de deux
estimations successives : la
forme d'origine du silo et le
calcul du volume d'un objet
aux contours irréguliers à l'aide de formules
géométriques qui calculent le
volume de contenants parfaits.
Il est communément admis la
présence d'une marge
Profils de silos ; les effondrements de paroi
apparaissent en grisé (DAO C. Regui/Inrap).
d'erreur de 10 à 15 % qui peut
être légèrement plus
importante sur les grands
silos.
Secteur sphérique
Tronc de Cône
Secteur sphérique (si fond concave)
breux os portent des traces de débitage et de découpe. Toutes les parties du squelette des bovins, des ovi-caprins et des porcins sont représentées. Il n'y a pas de sélection particulière selon le type de structure considérée. Aucune concentration originale n'a été mise en évidence. Ces restes osseux correspondent à des déchets de consom-mation rejetés dans des fours, des fosses ou des silos abandonnés. Le seul point resté en sus-pens est la présence d'éléments de pattes de bo-vins en connexion anatomique qui n'ont, a priori, pas été consommées. D'autre part, au-cune excavation n'a révélé de déchets s'appa-rentant à un artisanat différent de celui de la boucherie, hormis un métatarse gauche d'équidé patiné, évoquant un outil dont la fonction reste à ce jour indéterminée. Les fragments osseux et dentaires provenant de
la triade domestique se répartissent différem-ment selon le type de structure envisagée mais, globalement, boeuf, mouton/chèvre et porc to-talisent chacun un tiers de l'ensemble. Il est dif-ficile de comparer les résultats obtenus en l'ab-sence d'autres références provenant d'établis-sements ruraux pour cette période chronolo-gique dans la région. En milieu urbain, à cette époque, les restes de porcs dominent les en-sembles fauniques jusqu'à représenter 50 % et plus, et ce jusqu'au mye s. Il en est de même à Charavines entre le xe et le xie s. En revanche, à Toulouse (lycée Ozenne), entre 900 et 1100, dans un contexte social très différent, celui d'une maison canoniale, le mouton/chèvre do-mine avec 50 % des restes (boeuf : 30 % ; porc : 20 %). Le site de Castelnau-d'Estrétefonds offre donc la particularité d'une répartition homo-gène des ossements entre les espèces de la triade
o Archéopages n°8 • Novembre 2002
Cr) 1.1.1
C.)
LU
C.) LLI
domestique, qui devra être confirmée ou infir-mée par d'autres études archéozoologiques. Cette organisation des ressources implique une partition nette entre la zone d'habitat et la zone d'activités agricoles. Pour des raisons de sur-veillance et de sécurité, l'habitat se trouvait cer-tainement à quelques centaines de mètres tout au plus de l'aire d'ensilage. Lemplacement de celle-ci est un élément important pour la loca-lisation encore floue du village de Saint-Martin au xe s., lorsque le comte de Toulouse Raymond Ier lègue, en 961, une somme d'argent à la pa-roisse et à l'église de Saint-Martin. En compa-raison avec d'autres sites, notamment celui de Villeneuve-de-Rivière où le site d'ensilage se situe à 200 m de l'église et de l'habitat contemporain, nous suggérons une localisation du "village" de Saint-Martin non plus sur les coteaux, où se trouve le village actuel de Castelnau-d'Estréte-fonds, mais dans la plaine, dans un périmètre de quelques centaines de mètres autour du site.
Perspectives d'études Le site de l'Ourmède s'inscrit dans la problé-matique des grandes aires d'ensilage médiévales. À la quasi-absence de sources écrites relatant l'organisation et les implications socio-écono-miques des structures liées aux activités agri-coles, s'ajoute la tardive attention des cher-
cheurs. Larchéologie agraire médiévale est une discipline jeune qui ne dispose pas d'assez de sujets de références pour restituer la vie quoti-dienne des campagnes médiévales : le mode de traitement des données doit prendre en compte cette réalité. Une petite dizaine de sites ruraux fouillés depuis 1994 en Midi-Pyrénées contien-nent des aires d'ensilage associées à d'autres aménagements : fours, bâtiments sur poteaux... Ils livrent tous, à différents niveaux, des infor-mations sur les céréales cultivées, les techniques agraires, l'organisation spatiale des réserves, la culture matérielle, la faune et l'environnement. Ces données en quantité suffisante dans la ré-gion méritent désormais d'être reconnues et trai-tées comme un chaînon incontournable pour la compréhension de la vie des sociétés rurales médiévales et devront faire l'objet d'une analyse de synthèse pluridisciplinaire.
Christophe Requi, Christine Le Noheh,
Henri Molet
Inrap, 13, rue du Négoce, 31650 Saint-Orens
Isabelle Rodet-Belarbi
Inrap, Centre de recherche archéologique,
250, rue Albert-Einstein, 06560 Valbonne
Laurent Bouby
Centre d'Anthropologie, EHESS,
39, allée Jules-Guesdes, 31400 Toulouse
Bibliographie ■Arramond et al. 1994 : ARRAMOND (J.-C.), GRIMBERT (L.), I I FCH (L.), LE NOHEH (C.). A64 Villeneuve -de-Rivière " La Cha-pelle " et " Saint-Pierre " : document final de synthèse. Bordeaux : Afan Grand-Sud-Ouest, 1994. SRA Midi-Pyrénées. ■Cazes 1997 : CAZES (J.-P.). LIsle -Jourdain "La Gravette" : docu-ment final de synthèse de sauvetage urgent. Bordeaux : Afan Grand-Sud-Ouest, 1997, 3 vol. SRA Midi-Pyrénées. ■Cornet 1992 : COMET (G.). Le Paysan et son outil. Essai d'his-toire technique des céréales (France, vine-2CVe siècle). Rome : École française de Rome, 1992, 711 p. @Conte 1995 : CONTE (P). L'archéologie des silos médiévaux : Apports, limites et perspectives. In : Actes du colloque de Rennes : Histoire rurale en France (6-8 octobre 1994). 1995. ■Conte 1994: CONTE (P). Un témoignage archéologique du mal des Ardents : l'ergot de seigle du silo 670 du site médiéval de Chadalais en Limousin. In : DEVALE 1 (J.). La peste de feu : le miracle des Ardents et l'ergotisme en Limousin au Moyen Age. Limoges : ARCHEA, 1994, p. 54-60 (coll. Les Cahiers d'ARCHEA ; 3). ■Cuisenier 1988 : Un village au temps de Charlemagne. Moines et paysans de l'abbaye de Saint-Denis du vue siècle à l'an Mil, Catalogue de l'exposition. Paris : Musée des Arts et Traditions Populaires, 1988, p. 242-250
■Garnier et al. 1995 : GARNIER (B.), GARNOTEL (A.), MER-CIER (C.), RAYNAUD (C.) : De la ferme au village Dassargues du ve au xne siècle (Lunel, Hérault). Archéologie du Midi médiéval, t. 13, 1995. ■Gérard 1993: GÉRARD (D.) : Étude de fours de type carolin-gien à Saint Pierre du Perray. Apport de l'expérimentation. In : Archéologie en Essonne : actes de la journée archéologique de l'Es-sonne, Brunoy, 27 nov. 1993. Brunoy : Société d'art, histoire ar-chéologie de la vallée de l'Yerres, 1993, p. 97-104. ■Gentili 1988 : GENTILI (F.). La conservation des céréales. In : Un village au temps de Charlemagne. Moines et paysans de l'abbaye de Saint-Denis du vile siècle à l'an Mil, Catalogue de l'exposition. Paris : Musée des Arts et Traditions Populaires, 1988. p. 218-201. ■Raynaud 1990 : RAYNAUD (C.). Le village gallo-romain et mé-diéval de Lunel-Viel (Hérault). La fouille du quartier ouest (1981-1983). Besançon : Les Belles Lettres, 1990, 354 p. ■Ruas 1998 : RUAS (M.-P.). Les plantes consommées au Moyen Âge en France méridionale d'après les semences archéologiques. Archéologie du Midi médiéval, t. 15 et 16, p. 179-204, 1998. ■Sigaut 1978 : SIGAUT (E). Les réserves de grains à long terme : techniques de conservation et fonctions sociales dans l'histoire. Paris : Éd. De la Maison des Sciences de l'Homme/Lille : PUL Lille III, 1978, 203 p.
Novembre 2002 • Archéopages n°8 o