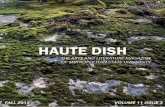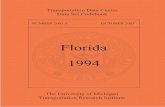1994 - Castres "Le Clot", "Lacaze Haute" et "Les Barradières"
Transcript of 1994 - Castres "Le Clot", "Lacaze Haute" et "Les Barradières"
CASTRES "Le Clot", "Lacaze Haute" et "Les Barradières"
(81065123 - 81065126 - 81065127) (Tarn)
DFS DE SAUVETAGE URGENT 06/06/94 - 15/10/94
Sous la direction de Fabrice PONS avec la collaboration de Laurent Carozza,
Bernard Garotin, Anne Lagarrigue
__________
CASTRES - ROCADE SUD 1er Tronçon
A.F.A.N. Antenne Grand Sud-Ouest avec le concours de la D.D.E du Tarn
__________
Toulouse : SRA Midi Pyrénées 1994
- 3 -
REMERCIEMENTS Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont permis, par leur contribution, de mener à bien cette opération, en particulier : Messieurs Gagnon et Rosseti, D.D.E/S.G.I/BETRA, pour leur précieuse collaboration, ainsi que Mr. Durgeat, Chef du B.E.T.R.A. Jean-Pierre Giraud et Michel Barrère, S.R.A Midi-Pyrénées, pour leur aide et leur conseil, ainsi que pour leur soutien permanent. Bernard Marty, S.R.A Midi-Pyrénées, pour sa contribution au bon fonctionnement matériel de l'opération. Le CERAC et ses membres pour la mise à disposition de leur local durant la phase d'étude.
- 5 -
SOMMAIRE REMERCIEMENTS 3 HISTORIQUE DES RECHERCHES 9 1 - LE SITE DU CLOT 11 FICHE SIGNALETIQUE 13 LOCALISATION ET ENVIRONNEMENT 15 PROBLEMATIQUE DE LA RECHERCHE 19 Méthodologie de terrain 19 Exploitation et presentation des données 20 CHRONOLOGIE DU SITE 21 PRINCIPAUX RESULTATS 23 Les structures du Néolithique moyen 23 Les structures du Néolithique final 27 Les structures du Bronze moyen 40 L'occupation au Bronze final 47 L'occupation du Bronze final 3a 47 L'occupation du Bronze final 3b 77 Les structures mal datées du Bronze final 104 Organisation de l'occupation du Bronze final 105 L'occupation du premier âge du Fer 107 Les structures du premier âge du Fer 107 Chronologie de l'occupation du premier âge du Fer 119 Conclusion 119 Les structures mal datées et non datables. 121 Les structures du Bronze final ou du premier âge du Fer 121 Les structures non datables 135 CONCLUSION GENERALE 137 2 - LE SITE DE LACAZE HAUTE 139 FICHE SIGNALETIQUE 141 LOCALISATION ET ENVIRONNEMENT 143 METHODE DE FOUILLE 146 PRINCIPAUX RESULTATS 147 Description et essai d'interprétation 147 Le mobilier 150 La faune 150 La ceramique 151 LE CONTEXTE REGIONAL : ETAT DE LA QUESTION 155 3 - LE SITE DES BARRADIERES 157 FICHE SIGNALETIQUE 159 LOCALISATION ET ENVIRONNEMENT 161 TAPHONOMIE DU SITE ET METHODOLOGIE 163 LES TEMOINS D'OCCUPATION PROTOHISTORIQUE 165 Les structures de maintien vertical 165 Le bâtiment 1 167 Le bâtiment 2 170 Des concentrations de vestiges céramiques 172 Une "structure" indéterminée : st.3003. 180 CONCLUSION 181 BIBLIOGRAPHIE: 182
- 7 -
CASTRES "Le Clot", "Lacaze Haute" et "Les Barradières"
(Tarn)
DFS de Sauvetage Urgent 06/06/94 - 15/10/94
EQUIPE DE FOUILLE : Fabrice PONS (Responsable d'opération); Clotilde CHAMPAGNE, Bernard GAROTIN (Responsables de secteur); Anne LAGARRIGUE (Responsable du mobilier); Albane BURENS, Stéphane BROSSIER, Jean-Luc GUINOT, Olivier DAYRENS, Frédéric GOMEZ, Pierre MARTY, Frank NAVARRO, Stéphane PONS, Thierry SALGUES (Archéologues fouilleurs qualifiés). EQUIPE D'ETUDE : Fabrice PONS : étude du site du "Clot" et élaboration du DFS; Clotilde CHAMPAGNE : étude du site de "Lacaze Haute"; Bernard GAROTIN : étude du site des "Barradières"; Anne LAGARRIGUE : dessin du mobilier et étude des céramiques protohistoriques, avec la collaboration de Laurent CAROZZA. ETUDES ET TRAVAUX ANNEXES : Topographie : Alain BADIE
8, place du Ravelin 31 300 Toulouse
Stabilisation du mobilier métallique : Monique DRIEUX ADPMP. Laboratoire Conservation & Restauration 6, impasse de Vérone. 31 500 Toulouse
Analyse C14 : ARCHEOLABS Le Chatelard, 38 840 St-Bonnet de Chavagne
INTERVENANTS : Maître d'ouvrage du projet d'aménagement routier : DDE Tarn Mr. DURGEAT, Chef du B.E.T.R.A. Mr. GAGNON, Contrôleur des T.P.E. Maître d'oeuvre scientifique de l'opération archéologique : SRA Midi-Pyrénées Mr. BARRERE, Conservateur. Mr. GIRAUD, Ingénieur. Gestionnaire : Antenne Interrégionale AFAN Grand Sud-Ouest.
- 9 -
HISTORIQUE DES RECHERCHES
______
En 1993, devant le projet d'aménagement de la rocade sud de Castres, le Service Régional de l'Archéologie de Midi-Pyrénées et la DDE du Tarn chargea une équipe d'archéologues de l'Association pour les Fouilles Archéologiques Nationales de mener une étude d'impact sur l'emprise du tracé du premier tronçon1, reliant la route nationale 126 à la route d'Hauterive (fig.2). Dans la pratique, cette étude a nécessité la mise en oeuvre d'une campagne de sondages systématiques au cours de laquelle plus de 400 tranchées, représentant en moyenne 3 % de l'emprise, furent réalisées. Cette méthode d'investigation, dont l'efficacité sur tracé linéaire est bien connue, ne garantit toutefois une évaluation optimale que lorsque la surface sondée avoisine les 7%. Dans le cas présent, un examen préliminaire des potentialités du terrain a permis de compenser cette marge d'erreur sans avoir recours à une multiplication du nombre de sondages. Cette opération a permis de déceler trois sites archéologiques d'inégale importance aux lieux-dits "Le Clot", "Lacaze Haute" et "Les Barradières". Les vestiges mis au jour (fosses, foyers, trous de poteaux) laissaient entrevoir des zones d'habitats protohistoriques, de l'âge du Bronze final et du premier âge du Fer. Leur destruction irrémédiable par les travaux routiers et le peu de données connues dans notre région sur ce type d'établissement en plaine ont alors provoqué la décision d'une fouille de sauvetage urgent. Les modalités financières et techniques de ces travaux ont fait l'objet d'une convention entre le Ministère de l'Equipement, des Transports et du Tourisme (D.D.E du Tarn), le Ministère de la Culture et de la Francophonie (S.R.A de Midi-Pyrénées) et l'Association pour les Fouilles Archéologiques Nationales (A.F.A.N, antenne Grand Sud-Ouest). L'intervention, qui s'est déroulée du 15 juin au 15 septembre 1994, a porté simultanément sur les trois sites. Elle a nécessité 14 personnes, dont une affectée au traitement du matériel. Au Clot, le gisement qui a pu être exploité sur plus d'un hectare a livré 143 structures signalant une occupation des lieux dès le Néolithique (moyen et final), au Bronze moyen, puis du Bronze final 3 jusqu'au premier âge du Fer. Bien que plus modeste, le site Bronze final/premier âge du Fer des Barradières a néanmoins été reconnu sur près de 1200 m². Enfin, à Lacaze Haute, une petite aire isolée d'une cinquantaine de mètres carrés a fourni un mobilier homogène datable du Bronze final 2.
1Catalo, Rayssiguier 1994.
- 13 -
FICHE SIGNALETIQUE IDENTITÉ DU SITE Site n° : 81 065 123 Département : Tarn Commune : Castres Lieu-dit : Le Clot. Cadastre : Année : 1970 (mise à jour en 1983) Section et parcelles : section E-P, parcelles 10a, 11 et 29. Coordonnées Lambert : Zone III Abscisse : 590,800 Ordonnée : 3142,250 Altitude : 170 Propriétaire du terrain : DDE Tarn. Protection juridique : Néant
OPÉRATION ARCHÉOLOGIQUE Autorisation n° : 100/94 valable du 13/6/94 au 31/12/94 Titulaire : F.PONS - 1, allée du Lot, Colomiers 31770 Organisme de rattachement : AFAN Raison de l'urgence : Tracé de la rocade sud de Castres. Section centrale, 1er tronçon. Maître d'ouvrage des travaux : DDE Tarn Surface fouillée : 15000 m² Surface estimée du site : 20000 m² au minimum.
RÉSULTATS Mots-clefs (thésaurus DRACAR pour la chronologie et les vestiges immobiliers): - sur la chronologie : VRZ, BRM, BRF, FE1. - sur la nature des vestiges immobiliers : FOS, TRO, FOY, FIN. - sur la nature des vestiges mobiliers : céramiques, lithiques, ossements faune, métal. Notice sur la problématique de la recherche et les principaux résultats de l'opération archéologique Mise au jours de 143 structures (fosses, foyers, trous de poteaux) signalant plusieurs phases d'occupations de type "habitat" (Néolithique final et Protohistoire) dont la plus importante se situe au cours du Bronze final. Lieu de dépôt provisoire du mobilier archéologique : CERAC. Domaine de Gourjade. Castres(Tarn).
- 15 -
LOCALISATION ET ENVIRONNEMENT
______
Le gisement du Clot se situe au sud-ouest de Castres (Tarn), entre la ville et la zone industrielle du Mélou. Il occupe plusieurs parcelles qui bordent la ligne de chemin de fer Montauban-Bédarieux, à proximité du lieu-dit "Le Clot" (fig.1 et 2). Le site est implanté sur la terrasse inférieure de l'Agout, affluent du Tarn qui décrit ici un vaste méandre fermé en amont par son confluent avec le Thoré. Localisée entre 169 et 170 mètres d'altitude, cette terrasse d'alluvions anciennes domine par un talus abrupt haut de 5 à 6 mètres le cours de la rivière. Ces formations littorales du Castrais, bordées de petits coteaux tertiaires (affleurements molassiques), confèrent au paysage environnant un relief légèrement vallonné qui s'étend vers le sud jusqu'au pied du versant septentrional de la Montagne Noire. Vers l'est, la rupture est marquée par le plateau granitique du Sidobre qui appartient au massif de l'Agout, avec ses bordures nord (Monts de Lacaune) et sud (Monts du Somail et de l'Espinouse) séparées de la Montagne Noire par le sillon du Thoré. L'espace géographique, au contact de deux régions naturelles fort différentes, l'extrême sud-ouest du Massif Central et la bordure orientale du Bassin Aquitain, se caractérise par de nombreux contrastes aux potentialités écologiques et biologiques très diversifiées. Localement, le substrat se décompose en deux ensembles principaux, avec à la base une couche très compacte de sables et de graves argileux et au dessus des limons argileux d'origine alluviale, sur une épaisseur variable qui peut atteindre plusieurs mètres. Les sols brunifiés qui se développent sur cette formation présentent un caractère hydromorphe assez prononcé, secs en été avec d'importantes fentes de retrait et bourbeux en hiver. Réservés autrefois à la culture de la vigne et aux vergers, ces terrains argilo limoneux et battants sont aujourd'hui cultivés intensivement, grâce aux travaux d'assainissement et d'irrigation. Le niveau archéologique situé à la base des labours, soit à une quarantaine de centimètres de profondeur, se présente sous diverses formes : concentrations ou nappes de vestiges lithiques et céramiques, traces de rubéfaction et/ou charbonneuses. La plupart de ces indices, souvent peu perceptibles, se sont révélés, à la fouille, appartenir aux comblements de structures en creux dont le sommet a été systématiquement tronqué par les travaux aratoires. D'autres, signalés par des épandages de vestiges divers, n'ont pas dévoilé de substructures et semble devoir être interprétés comme le résultat d'un arasement complet de ces mêmes types d'aménagements. Un constat de mauvaise conservation s'impose donc en ce qui concerne les diverses occupations qu'a connu le site.
- 16 -
Bien qu'importante - près de 12 000 m² - la surface investie ne permet pas d'estimer l'étendue réelle du gisement du Clot, qui doit se prolonger vers l'est. Les prospections au sol effectuées dans cette zone hors emprise des travaux routiers (fig.3) ont en effet livré un mobilier de surface (lithique et céramique) contemporain de celui du secteur fouillé.
Fig. 1 - Le Clot : vue aérienne oblique des décapages. En arrière plan, la zone industrielle du Mélou située sur la rive droite de l'Agout.
(Cliché: O.Dayrens, S.Pons)
- 19 -
PROBLEMATIQUE DE LA RECHERCHE
______
La fouille de sauvetage du site du Clot, comme celle des Barradières et de Lacaze Haute, et plus généralement la majorité des opérations préventives de ce type, ne découlait pas à l'origine d'une problématique de recherche. Cependant, bien qu'il ne s'agisse pas d'un choix, l'opportunité offerte par les travaux routiers aura permis d'exploiter sur une grande superficie des vestiges d'habitats protohistoriques livrant une abondante documentation nécessaire à une meilleure connaissance de ces périodes, et ceci pour la première fois dans le Sud-ouest de la France, .
METHODOLOGIE DE TERRAIN La définition d'une politique de sauvetage, autant que possible rapide et efficace, sur ce type de site passe avant tous travaux de fouille proprement dits par un décapage extensif. En effet, compte tenu de la nature même des vestiges à appréhender (structures en creux) et de leur répartition mais aussi des délais impartis, ce mode d'approche s'avère indispensable, permettant une localisation rapide des structures et de leurs éventuelles associations. Cette opération préliminaire a été réalisée à l'aide de deux pelles mécaniques munies de godets lisses, par bandes successives, et sous étroite surveillance archéologique2. La surface ainsi mise à nu laisse apparaître diverses anomalies, témoins d'aménagements parfois évidents mais souvent potentiels. Ces indices archéologiques, signalés dès leur apparition afin d'éviter toute perte d'information, ont ensuite fait l'objet d'une fouille au cas par cas, révélant en général la présence d'excavations. Le mauvais état de conservation de ces structures s'est très vite révélé être l'un des problèmes majeurs du site. A de rares exceptions près, les limites des creusements n'ont été perçues que par la répartition des différents vestiges contenus dans leur sédiment de comblement. Ce problème d'ordre taphonomique, fréquemment rencontré dans ces sols continuellement brassés par les vers de terre, a été un facteur déterminant pour le choix de la méthode de fouille à adopter. L'option retenue pour la majorité des cas fut celle du relevé en coordonnées du remplissage, seule méthode susceptible d'appréhender la morphologie du creusement, pour autant qu'il renferme du mobilier. Ces comblements étant souvent très homogènes, la levée de coupes ne présente aucun caractère systématique, réalisée sur le terrain seulement lorsque des niveaux bien différenciés apparaissaient. Indépendamment de leur nature, les structures mises au jour lors de cette opération ont reçu un numéro d'inventaire3. Les relevés des plans et coupes, effectués à l'échelle 2Une étroite bande correpondant à une limite parcellaire plantée en haie a été épargnée (fig.3). 3Exemples : CRS 94. 1020 = Castres Rocade Sud, secteur 1 (Le Clot, n° spécifique : 1000), structure 20.
- 20 -
1/10e, voir au 1/5e pour un besoin de précision complémentaire, sont systématiquement accompagnés de photographies et d'un bordereau regroupant des informations sur la nature de la structure, sa morphologie et son remplissage. La surface investie ne permettant guère l'installation d'un carroyage fixe, les plans ont été positionnés d'après des axes implantés au gré des structures. Ceux-ci ont été ensuite relevés au théodolite à partir de stations repérées en coordonnées Lambert III. Ce système, utilisé lors d'une précédente intervention sur un site fossoyé de quatre hectares4, permet de progresser avec une grande souplesse, sans contrainte astreignante de repérage. La mise en oeuvre de ces méthodes d'investigation a permis, dans les délais qui nous étaient impartis, de rassembler une importante documentation permettant de mener à bien l'analyse des structures et de leur remplissage.
EXPLOITATION ET PRESENTATION DES DONNEES Les données brutes de terrain relatives aux structures elles-mêmes ont fait l'objet d'une saisie informatique à partir d'un tableur. Pour chaque structure, une quinzaine de critères prenant en compte la nature de l'aménagement, sa morphologie, ses dimensions et son remplissage ont été systématiquement enregistrés. La base de données ainsi créée permet évidement un traitement statistique mais elle sert également pour l'archivage et le stockage de la documentation recueillie. Parallèlement aux travaux de terrain, le mobilier issu de la fouille des structures a fait l'objet d'un traitement en laboratoire. Au total, près de 11000 objets ont été lavés, marqués et triés en prévision de leur étude. La céramique, qui constitue l'essentiel de ce matériel, a pu ainsi être traitée dans son intégralité. Les formes restituées graphiquement, après remontage de tessons jointifs et dénombrement (nombre minimum d'individus), sont présentées chronologiquement et par structure. Afin d'éviter tout problème de vocabulaire, les descriptions morphologiques des céramiques protohistoriques sont accompagnées de renvois systématiques aux formes rencontrées. La plupart du temps, la fragmentation des vases n'a pas permis une étude de type fonctionnaliste en prenant en compte les diamètres et les volumes, mais les formes étaient reconnaissables d'où le choix d'une réflexion sur les problèmes d'ordre typologique. Il était ensuite intéressant de tenter de replacer cet ensemble céramique dans un environnement géographique élargi, du Quercy au Languedoc occidental. Dans cette optique ont été effectuées des comparaisons de vase à vase, de site à site. En plus de l'apport chronologique que fournissait cette approche (avec toutes les réserves que l'on peut émettre sur cette méthode : reconnaissance des formes, validité des contextes et éléments de référence), ces premiers renseignements devaient amener à considérer le contexte chrono-culturel de la région castraise, les ressemblances et dissemblances avec les régions proches.
4Pons, 1994.
- 21 -
CHRONOLOGIE DU SITE
______
L'occupation du site du Clot, pendant plusieurs millénaires avant notre ère, a bien évidemment révélé les vestiges non pas d'un, mais de plusieurs établissements successifs. L'importance quantitative de la documentation recueillie est donc relative en regard de la chronologie. La périodisation des quelques 140 structures mises au jour n'est d'ailleurs pas sans poser de problème. Les niveaux de sols ayant disparu, il n'existe, d'une manière générale, plus de lien stratigraphique entre ces divers aménagements. A ce manque de chronologie relative s'ajoute également, dans bien des cas, la carence ou l'imprécision des données de chronologie absolue : soit parce que le mobilier est absent, soit parce que la fourchette chronologique révélée par son étude s'avère trop large. Les données utilisables font donc état d'une première occupation des lieux au Néolithique, avec au moins 4 structures datables du Néolithique moyen et 7 du Néolithique final (Vérazien). Après une phase probable d'abandon, 3 aménagements signalent une reprise des activités au cours du Bronze moyen. La période suivante n'est pas représentée, et c'est au cours du Bronze final 3a qu'apparaît une nouvelle phase d'occupation qui semble se poursuivre jusqu'au premier âge du Fer. Une trentaine de structures sont précisément datées du Bronze final 3 (3a et 3b) et 11 du premier âge du Fer, soit 41 aménagements auxquels il convient d'en rajouter 24 qui peuvent s'insérer dans l'une ou l'autre de ces deux périodes. Enfin, bien que plus anecdotique, il faut mentionner la présence de 9 soubassements de poteaux témoignant de l'implantation d'un bâtiment à une époque récente (début du siècle). Les aménagements non datables (55 au total) représentent donc plus d'un tiers des structures fouillées. Sans omettre pour autant les problèmes d'organisation spatiale qu'ils soulèvent, leur présence nous conduit inévitablement à une sous-évaluation des diverses occupations connues sur le site. Toutefois, cette difficulté d'appréciation a pu être en partie réduite par l'association de structures datées et non datables, morphologiquement et fonctionnellement identiques. Conscient du caractère parfois hasardeux de cette analyse, nous avons donc intégré ces données dans la synthèse des résultats, présentée chronologiquement, selon les différentes phases de l'occupation du site.
- 23 -
PRINCIPAUX RESULTATS
______
LES STRUCTURES DU NEOLITHIQUE MOYEN Quatre structures de combustion à galets chauffés ont pu être datées par le radiocarbone du Néolithique moyen. Souvent réduites à l'état de lambeaux, une trentaine de structures analogues non datables pourraient être également isolées dans cette première phase d'occupation du site. En effet, abstraction faite de cette période, ce type d'aménagement ne se rencontre avec certitude sur le site que plus tard, au cours du premier âge du Fer, où il se distingue par des différences morphologiques5. Toutefois, quelques fosses du Néolithique final ont fourni des indices qui peuvent suggérer l'utilisation de structures similaires.
Fig. 5 - Le Clot : plan de répartition des structures de combustion attribuées au Néolithique moyen
Ces aménagements se ramènent tous à un même modèle. Il s'agit de structures en cuvette, à fond généralement plat, de plan circulaire ou ovale (fig.6). L'arasement a été souvent trop important pour donner une idée précise de leurs dimensions d'origine et notamment de leur profondeur. Les exemplaires les mieux conservés montrent cependant une différence de taille significative entre les types circulaires et ovalaires. Les premiers n'excèdent pas un diamètre de 0,90 m alors que les autres dépassent fréquemment un mètre de long et peuvent s'étendre sur une superficie de près de 4 m² (fig.6, n°1).
5cf. chapitre sur les structures du 1er Age du Fer.
- 24 -
Fig.6 - Le Clot : Exemples de structures de combustion à galets chauffés attribuables au Néolithique moyen.
1. st.1102; 2. st.1056; 3. st.1094
- 25 -
Les remplissages les plus complets se composent d'un lit compact et régulier de galets, recouvrant une mince couche de sédiment qui comprend souvent des traces charbonneuses, et parfois des fragments de branches carbonisées6, résidus d'une combustion incomplète du bois (fig.7). Les galets de ces structures, principalement des quartz, portent les stigmates d'une chauffe intense : certains présentent des teintes rouges et la plupart sont fissurés ou éclatés. Leurs fragments sont parfois jointifs mais beaucoup sont dispersés, montrant un remaniement important pendant ou après la chauffe. Des petits nodules de terre cuite sont quelquefois présents dans le remplissage mais le fond des cuvettes n'est jamais rubéfié, ce qui permet de supposer qu'elles n'ont pas été réutilisées.
Fig. 7 - Le Clot : la structure de combustion 1163. Des restes de branches carbonisées apparaissent sous la couverture de galets chauffés.
(Cliché: O.Dayrens, S.Pons) Ces structures s'apparentent à celles découvertes en grand nombre sur les sites néolithiques du bassin de la Garonne, notamment le village chasséen de Villeneuve-Tolosan7 et de Saint-Martin du Touch8. Elles sont généralement assimilées, dans leur principe, à des fours de type polynésien9, où les galets font office de calorifères, restituant lentement une chaleur suffisante pour la cuisson d'aliments.
6Les charbons qui ont pu être analysés proviennent de chêne à feuilles caduques (Quercus sp.). 7Clottes et alii, 1981. 8Simmonet, 1980. 9Orliac, Wattez, 1989.
- 26 -
Répartis sur plus de 6000 m², ces aménagements témoignent d'une occupation du site, mais ne mettent en valeur aucune organisation cohérente. Le mobilier découvert en association est toujours très pauvre, voire absent. Il se résume à de rares éclats de silex et fragments de céramique informes, ainsi que quelques fragments de meules dormantes en granit, manifestement chauffés, retrouvés parmi les galets. Exceptée la présence de silex blonds, qui peut suggérer une certaine ancienneté (Chasséen), l'indigence de ces vestiges ne nous apporte aucune donnée chronologique.
Fig. 8 - Le Clot : tableau synthétique des résultats des datations radiocarbones de quatre structures néolithiques.
Les résultats obtenus par l'analyse 14C de charbons de bois restent donc les seuls véritables éléments de datation en notre possession (fig.8). Les fourchettes révélées pour trois d'entre eux s'accordent assez bien, situant cette occupation néolithique vers la première moitié du quatrième millénaire avant notre ère. La dernière analyse aurait tendance à vieillir quelque peu cette date, vers une phase ancienne du Chasséen, mais il n'est pas inconcevable qu'elle reflète une fréquentation, ou un passage sur le site, à des époques plus reculées. Enfin, il convient d'insister sur le fait que seules quatre structures ont pu être ainsi datées, les autres n'ayant pas livré une quantité utilisable de charbons de bois.
- 27 -
LES STRUCTURES DU NEOLITHIQUE FINAL Sept structures ont livré un mobilier attribuable au Néolithique final. Deux d'entre elles, 1030 et 1031, sont implantées à proximité l'une de l'autre, en bordure occidentale de la fouille ; les quatre autres sont isolées, dispersées sur plus de 4000 m² (fig.9). Les aménagements de cette période comprennent exclusivement des fosses dont il ne subsiste souvent que la partie la plus profonde, parfois réduite à une nappe de vestiges. DESCRIPTION ET ETUDE DES REMPLISSAGES
La structure 1030 De plan ovalaire, cette fosse d'environ 1,60 m de long sur 1 m de large était conservée sur 0,25 m de profondeur (fig.10). Son remplissage contenait de nombreux vestiges fragmentés (tessons de céramiques, galets, éclats de silex, esquilles osseuses) enrobés d'un sédiment argilo-limoneux identique à celui de l'encaissant. L'analyse de la répartition de ce mobilier ne montre aucune concentration particulière, si ce n'est la présence de galets en quantité plus importante dans la partie supérieure du remplissage. Ces galets, manifestement chauffés, peuvent résulter de la vidange d'un foyer du même type que ceux décrit précédemment. Les fragments de céramiques, qui constituent l'essentiel du matériel issu de cette fosse, sont dispersés sur toute l'épaisseur du remplissage. Les collages de tessons provenant d'un même vase ne mettent en évidence aucun niveau, mais signalent l'homogénéité du dépôt. Ces rebuts jetés volontairement dans la fosse témoignent de sa dernière utilisation comme dépotoir. Au total, ce sont près de 300 tessons qui ont été recueillis dans ce comblement, provenant d'au moins 40 vases, tous incomplets. Les vases de grande capacité, très fragmentés, sont bien représentés avec une dizaine d'exemplaires. Il s'agit de grandes jarres à col droit ou légèrement rentrant (fig.15, n°5 à 7 ; fig.16, n°1 à 5, 7 et 9), munies de préhensions horizontales (mamelons ou tétons), ou verticales et parfois superposées (fig.16, n°9). Sur un fragment de col (fig.15, n°5), on note également une perforation témoignant d'une réparation. Dans la catégorie des petits récipients, on trouve principalement des bols hémisphériques, à ouverture plus ou moins rétrécie (fig.14, n°6 à 9 et 12), munis parfois d'une languette de préhension (fig.14, n°9), ainsi qu'un bol tulipiforme, presque conique (fig.14, n°1). Ces deux formes se retrouvent parmi les récipients de contenance moyenne, où elles peuvent comporter des mamelons superposés (fig.14, n°3 et 11). On note aussi la présence de deux écuelles à carène haute et paroi rentrante (fig.15, n°1 et 2), dont une qui porte une petite préhension allongée sur la carène. Sans être de très mauvaise qualité, cette céramique présente souvent des pâtes épaisses aux surfaces irrégulières, mal lissées, qui laissent apparaître un dégraissant grossier à base de silice. Inversement, on trouve des parois plus fines de bonne qualité, à pâte dure et sombre, soigneusement lissées et parfois lustrées. Il faut également signaler la présence de pâte grise et légère, à dégraissant végétal.
- 29 -
Fig.10 - Le Clot : relevé de la fosse 1030.
La structure 1031 Il s'agit d'un aménagement tout particulier sur le site (fig.11), mais que l'on rencontre également au cours des périodes protohistoriques. Une jarre, dont la partie supérieure semblait tronquée lors de sa découverte, était enfouie à une soixantaine de centimètres de profondeur dans une petite excavation creusée à cet effet. La fouille du contenu de ce vase a révélé la présence de nombreux fragments de céramique provenant du bris de la partie manquante. Des tessons de deux autres vases (fig.17, n°14 et 15) ont également été retrouvés, mais uniquement dans la partie supérieure du remplissage. Cette jarre, pour laquelle une fonction de "silo" est envisageable, s'est donc détériorée très vite après son abandon, laissant vide la partie supérieure de la fosse qui fut comblée ultérieurement par des apports de nature détritique. De forme cylindrique, ce récipient a une capacité de près de 30 litres, avec un diamètre à l'ouverture de 33 cm pour une hauteur de 40 cm. Il est muni d'une série de mamelons verticaux superposés et diamétralement opposés (fig.17, n°16). Bien qu'il soit en général difficile de préjuger de la profondeur primitive des aménagements, la hauteur de cette jarre permet ici d'avoir quelques éléments de réponse. En effet, si l'on considère que ce vase était entièrement enterré, la profondeur initiale de la fosse devait être au moins équivalente à la hauteur du conteneur. La partie retrouvée en place n'excédant pas une dizaine de centimètres de hauteur, on peut donc supposer que les 3/4 au moins de l'aménagement ont disparu (environ 0,30 m), ce qui correspond à peu près aux remaniements provoqués par les façons culturales.
- 30 -
Fig.11 - Le Clot : la structure 1031. (cliché: O.Dayrens, S.Pons)
Fig.12 - Le Clot : relevé de la structure 1071.
- 31 -
La structure 1071 Isolée en bordure orientale de la fouille, cette fosse de plan sub-circulaire n'était conservée que sur une dizaine de centimètres de profondeur (fig.12). Les dimensions fournies par la répartition des différents vestiges qu'elle contenait sont approximativement de l'ordre de 1 m en surface et de 0,70 m à la base. Outre d'assez nombreux fragments de céramiques, son remplissage comprenait quelques galets chauffés ainsi que des restes calcinés de bovidés (principalement des dents) enrobés d'un sédiment brun homogène, riche en petites particules charbonneuses et traces de rubéfaction. Ces divers éléments ne nous apportent aucun renseignement sur la fonction primitive de cette fosse, manifestement transformée en dépotoir. Les quelques 150 tessons récoltés dans le comblement de cette fosse proviennent d'une quinzaine de vases au moins. Il s'agit principalement de formes ouvertes, parmi lesquelles des bols profonds (fig.17, n°1 à 5) et des coupes en calotte de sphère (fig.17, n°10 et 11). Associés à ce lot de céramique, on trouve également des récipients plus fermés (fig.17, n°6 et 7) qui peuvent être munis de mamelons horizontaux plus ou moins renflés.
La structure 1115 Morphologiquement comparable à la structure précédente et également conservée sur une dizaine de centimètres de profondeur, la fosse 1115 offre toutefois des dimensions plus importantes en surface avec un diamètre d'environ 1,30 m (fig.13). Son creusement s'interrompt au contact de la grave, qui remonte ici sous la forme d'un large banc traversant le site d'ouest en est. Cette fosse réutilisée comme dépotoir recelait de nombreux tessons de céramiques, quelques galets portant parfois des traces de chauffe, de rares charbons de bois et des nodules de terre cuite, ainsi qu'une meule en granit. Des fragments issus d'une trentaine de vases différents ont pu être identifiés. Les petits vases, dont le diamètre à l'ouverture n'excède pas 20 cm, sont bien représentés. Ils comprennent des bols hémisphériques (fig.18, n°1 à 4 et 7) portant parfois un mamelon près du bord (fig.18, n°7), des écuelles à carène médiane (fig.18, n°6 et 9) ou haute (fig.18, n°8) et paroi rentrante concave, et des coupes hémisphériques (fig.18, n°5). Parmi les récipients de plus grande capacité, on note des formes sphéroïdales plus ou moins fermées (fig.18, n°15, 18 et 19), un vase tulipiforme muni d'un mamelon horizontal (fig.18, n°16) et un tesson à décor de pastilles au repoussé (fig.18, n°17).
La structure 1121 Réduite à l'état de lambeaux, seule une nappe de vestiges diffus signalait la présence de cette fosse. Trois éclats de silex, trois autres de quartz, un fragment de meule en granit et 8 tessons de céramique, dont un fragment de bord muni d'un mamelon horizontal perforé, composent la totalité du matériel conservé de ce qui restait de cette structure.
La structure 1147 Egalement très arasée, la fosse 1147 ne présentait plus que la base de son remplissage. Dans cette petite aire d'environ 0,70 m de diamètre, près de 80 tessons ont été recueillis, mêlés à quelques galets. Très érodés, ces fragments de céramique proviennent principalement de petits récipients, bols ou gobelets (fig.19, n°1 à 4) dont les formes n'ont pu être totalement restituées.
- 32 -
Fig.13 - Le Clot : relevé de la structure 1115.
La structure 1170 La moitié nord de cette fosse était recoupée par une tranchée récente, effectuée à l'occasion de sondages géologiques. L'autre moitié, conservée sur une quarantaine de centimètres de profondeur, permet d'estimer son diamètre à environ un mètre en surface et 0,80 m à la base. Exception faite d'une poche charbonneuse située à la base du comblement, le remplissage très homogène est formé d'un sédiment argilo-limoneux contenant de nombreux fragments de céramiques et quelques ossements de faune brûlés. La présence de ces détritus témoigne une nouvelle fois du colmatage volontaire de ces structures, probablement après leur abandon. Le mobilier céramique de cette fosse comprend 180 tessons appartenant à un minimum de 14 vases. Outre les formes classiques des bols hémisphériques (fig.19, n°7 à 11) et des coupes en calotte (fig.19, n°13), on note la présence d'un bol à carène adoucie (fig.19, n°5) et de petites jarres cylindriques (fig.19, n°14 à 16) munies de préhensions : boutons ou mamelons horizontaux.
- 36 -
Fig.17 - Le Clot : céramiques véraziennes des structures 1031 et 1071. 1 à 13.st.1071; 14 à 16.st.1031.
- 38 -
Fig.19 - Le Clot : céramiques véraziennes des structures 1147 et 1170. 1 à 4.st.1147; 5 à 16.st.1170.
- 39 -
ATTRIBUTION CHRONOLOGIQUE DU MOBILIER Particulièrement abondant, le mobilier céramique issu de ces fosses présente un style commun tout à fait caractéristique du groupe de Véraza tel qu'il a été défini par J.Guilaine10. Les mamelons de préhension superposés, considérés comme typiques, sont bien représentés. On les rencontre sur les grands vases mais aussi sur des récipients de capacité moindre. La céramique plus fine comprend des bols profonds presque coniques, des coupes en calotte inornées ainsi que quelques exemplaires d'écuelles à carène basse ou médiane. Ces formes ainsi que la présence d'un tesson à décor de pastilles au repoussé se rencontrent dans la phase classique du Vérazien. L'absence de décors cannelés peut également renforcer l'attribution chronologique de l'occupation du site du Clot au Néolithique final. CONCLUSION Exceptée la structure 1031 qui s'apparente à un "vase-silo" enterré, les aménagements du Néolithique final sont trop fragmentaires pour donner une idée de leur fonction initiale : leurs formes et leurs dimensions sont inconnues et les différents vestiges mobiliers rencontrés dans leurs remplissages n'indiquent qu'une utilisation finale comme dépotoir. Cette occupation est donc difficilement caractérisable, mais il est probable que la proximité de terroirs limoneux fertiles ait contribué à l'implantation d'une petite communauté humaine sur le site du Clot au cours de la deuxième moitié du troisième millénaire avant notre ère. Culture méditerranéenne, le Vérazien est très peu représenté sur le versant nord de la Montagne Noire. Il est attesté avec certitude sur trois sites de plein air dans le Bassin de la Garonne11, et dans le Tarn avec le gisement en grotte de Roquemaure12. Les structures du Clot présentent donc un intérêt tout particulier et d'autant plus important qu'il s'agit du seul site vérazien de plein air mis au jour dans le Tarn.
10Guilaine, 1980. 11Vaquer 1990, pp.330-342. 12Clottes, Giraud 1988
- 40 -
LES STRUCTURES DU BRONZE MOYEN Deux fosses voisines, localisées en bordure orientale de la fouille, ont livré du mobilier qui peut être attribué au Bronze moyen. Plus isolé, mais toujours dans le même secteur, un four daté par une analyse 14C de charbon de bois appartient également à cette phase d'occupation du site (fig.21).
Fig. 20 - Le Clot : implantation des trois structures du Bronze moyen. Les fosses 1040 et 1041
De ces deux fosses très mal conservées ne subsistait plus qu'une partie de leur remplissage, sur une quinzaine de centimètres d'épaisseur pour st.1040 (fig.21) et sur moins de 0,10 m pour st.1041. Leur comblement très homogène est constitué d'un sédiment argilo-limoneux renfermant quelques traces charbonneuses, des petits nodules de terre cuite, de nombreux tessons de céramiques ainsi que de rares esquilles osseuses de faune (ovicapriné). D'après la répartition de ces détritus, les fonds de ces deux fosses sont plats et n'excèdent pas 0,70 m de diamètre.
Fig. 21 - Le Clot : relevé de la structure 1040.
- 41 -
Ces deux structures ont livré environ 300 tessons provenant d'au moins une douzaine de vases parmi lesquels on note : - une grande jarre à col rentrant (fig.23, n°1) avec un départ de panse globuleuse et
munie d'un cordon à digitations profondes situé à la jonction col-panse. On rencontre une forme semblable en Dordogne, dans les niveaux supérieurs de la grotte Vaufrey à Cénac-et-Saint-Julien13, dans un ensemble comportant de nombreuses affinités avec le groupe du Noyer.
- un grand vase piriforme (fig.23, n°2) à bord déjeté, muni d'une anse en ruban implantée sur la partie supérieure du vase, et orné d'une ligne d'impressions ongulées au-dessus de l'anse,
- divers types de languettes, digitée (fig.23, n°3), épaisse (fig.23, n°4), arrondie (fig.23, n°10) et parfois accolées (fig.23, n°6),
- une anse en ruban (fig.23, n°5), - 4 fonds plats (fig.23, n°7 à 9 et 11),
Ce mobilier, qui peut être attribué au Bronze moyen, ne présente pas de caractères suffisamment significatifs pour définir une appartenance à un quelconque groupe de cette période. Celle-ci est par ailleurs mal connue dans la région considérée, aussi il nous a été difficile de trouver des éléments de comparaison pertinents.
Fig.22 - Le Clot : aspect du remplissage de la structure 1040.
(cliché: O.Dayrens, S.Pons)
13Roussot-Larroque, 1993, p. , fig.8,
- 42 -
Fig. 23 - Le Clot : céramiques du Bronze moyen des fosses 1040 et 1041. 1 à 9.st.1040; 10,11.st.1041.
- 43 -
Le four 1114 Ce four rudimentaire très arasé ne présentait qu'une amorce de paroi sur une dizaine de centimètres de hauteur (fig.24). Cette paroi, en partie affaissée et effondrée, était rubéfiée sur une épaisseur de 2 cm en moyenne et limitait une aire de chauffe d'environ 1,10 m de diamètre. Une sorte de "radier", composé de petits galets plats plus ou moins homométriques14 et non jointifs, occupait toute la surface intérieure. Curieusement, il ne soutient aucune sole et la combustion a manifestement eu lieu directement sur celui-ci. On retrouve en effet de nombreux charbons de bois piégés entre les galets, qui présentent également des stigmates de chauffe. Les niveaux de surface ayant disparu, cette structure de cuisson ne peut qu'avoir été creusée directement dans le substrat limoneux, ou tout au moins en partie. Sa construction s'est probablement faite depuis une fosse d'accès dont il ne reste aucune trace. Etant donné la faible élévation conservée et l'absence d'éléments de couverture, peu de renseignements nous sont fournis sur son fonctionnement, l'enfournement pouvant s'effectuer latéralement ou par le sommet de la voûte. L'abandon de ce four n'est marqué par aucun indice de destruction. L'unique objet qui pourrait être associé à son comblement était situé au sommet de celui-ci. Il s'agit d'un fragment de bois de cervidé muni d'une perforation centrale (fig.25)15. Aucun vestige n'a été retrouvé dans le remplissage constitué d'un sédiment argilo-limoneux très homogène. Les seuls éléments chronologiques disponibles sur ce four proviennent de la datation fournie par l'analyse 14C 16 de charbons de bois, qui situe son fonctionnement au cours du Bronze moyen. Cette structure, qui s'apparente aux fours culinaires à foyer unique et sole fixe fréquemment rencontrés dès la fin de l'Age du Fer, est, à notre connaissance, unique pour la période du Bronze moyen. Avec seulement trois aménagements, les témoins d'occupation du Bronze moyen du site du Clot apparaissent bien fugaces. Néanmoins, il faut noter parmi eux la présence d'une structure domestique à caractère fonctionnel, ce qui peut signaler la présence d'une véritable implantation humaine. Faute d'investigation complémentaire, notamment à l'est de la fouille, il est en effet probable que ces vestiges mis au jour soit situés en marge d'une zone d'habitat.
1412 cm de long en moyenne et 2 cm d'épaisseur. 15Pic en bois de cerf ? 16Datation N° ARC 1182 Age 14C Brut : 3300 +/- 63 BP. Date 14C Calibrée : 1740 - 1455 cal BC. L'échantillon analysé appartient au nerprun purgatif (Rhamnus cathartica L.).
- 44 -
Fig.24 - Le Clot : relevé du four 1114.
Fig.25 - Le Clot : bois de cervidé provenant du sommet du remplissage du four 1114.
- 47 -
L'OCCUPATION AU BRONZE FINAL L'occupation du site au Bronze final est révélée par de nombreuses structures qui appartiennent à plusieurs types : fosses, vases enfouis, trous de poteaux (fig.27). Parmi ces aménagements, au total une trentaine, quatre fosses et cinq trous de poteaux correspondent au Bronze final 3a. Une quinzaine de structures sont attribuables au Bronze final 3b. Les autres ne présentent pas d'éléments déterminants pour une périodisation plus fine. Le mauvais état de conservation de ces différents aménagements rend parfois délicate leur appellation. Ainsi, certaines structures en creux, probablement peu profondes à l'origine, présentent un tel état d'arasement que plus aucun creusement n'est discernable. Ces structures repérées grâce à une concentration de débris divers (céramiques, galets, charbons,...) ont été dénommées "nappes de vestiges" et ne peuvent en aucun cas être confondues avec d'éventuels niveaux de sol conservés. L'OCCUPATION DU BRONZE FINAL 3A Les fosses
Les fosses 1104 et 1104b Ces deux fosses, repérées en bordure occidentale de la fouille, ne sont distantes que de quelques centimètres. En surface, elles étaient recouvertes par une nappe de vestiges épars sur près de 12 m², correspondant aux bouleversements du sommet de leur remplissage. Leur morphologie exacte est inconnue mais la répartition des différents objets rencontrés dans leur comblement en place signale des formes asymétriques avec des dimensions relativement importantes (fig.28)17. De forme oblongue, la fosse 1104b est surcreusée dans sa partie sud, qui présente ainsi un front vertical d'une cinquantaine de centimètres de haut. La fosse 1104 semble plus régulière et présente des parois sub-verticales sur une profondeur conservée sensiblement identique. Les remplissages observés dans ces fosses résultent d'un comblement volontaire après leur abandon. Très similaires, ils n'ont pas montré de stratification significative mais témoignent plutôt d'un colmatage rapide à l'aide de détritus divers. Le sédiment, très charbonneux et riche en petits nodules de terre rubéfiée, recelait une quantité exceptionnelle de fragments de céramiques. Certaines concentrations, décelées lors de la fouille, peuvent signaler la présence d'apports successifs de nature détritique. Ainsi, des pans de plusieurs vases complets étaient rassemblés à la base du remplissage de st.1104 (fig.29). Toutefois, les tessons issus de ces fosses n'ont pas été systématiquement relevés en coordonnées - mais arbitrairement, par passe mécanique d'environ 5 cm - ce qui ne permet pas d'observations plus précises sur la dynamique des remplissages. Si l'utilisation finale de ces fosses comme dépotoirs ne fait aucun doute, en revanche leur fonction primaire est incertaine. Ces excavations irrégulières et de grandes dimensions peuvent éventuellement résulter de l'extraction de matériaux.
17De l'ordre de 1,90 m de long pour des largeurs maximales comprises entre 1,50 m (1104) et 1,10 m (1104 bis).
- 48 -
Fig.28 - Le Clot : les structures 1104 et 1104b en fin de fouille. (Cliché: O.Dayrens, S.Pons)
Fig.29 - Le Clot : aspect du remplissage de la structure 1104.
(Cliché: O.Dayrens, S.Pons)
- 49 -
La fosse 1104 a fait l'objet d'une datation C14. Les résultats sont cohérents et viennent confirmer la chronologie fournie par les caractères typologiques du mobilier céramique.218. Exceptée une épingle à tête enroulée (fig.42, n°1) et un fragment de tige en bronze (fig.42, n°2), la céramique constitue l'essentiel du mobilier recueilli dans ces deux structures. La fosse 1104 a livré plus de 2800 tessons provenant d'au moins une centaine de vases différents (fig.30 à 41), en grande majorité incomplets, et appartenant à plusieurs types de formes. Les plats et écuelles : - 13 plats tronconiques à degrés internes (fig.30, n°2 ; fig.31, n°1 à 4, 6, 8, 9, 12 à
16) dont trois portent une double perforation (fig.31, n°9, 13 et 14). En Quercy, les écuelles tronconiques à décor interne sont connues depuis le Bronze final 2, dans le coffre de Fallières à Thémines ou encore à l'Igue Blanche de Sauliac19. En Languedoc occidental elles sont attestées à la grotte du Gaougnas au Bronze final 2, au Bronze final 3a au Baous de la Salle à Bize20. Sur les Grands Causses aveyronnais, on les rencontre au Bronze final 3a à la grotte du Boundoulaou à Creissels21.
- 7 plats ou écuelles (fig.30, n°1, 3, 4 ; fig.31, n°5, 7, 10, 11) dont un exemplaire comportant de nombreuses traces de modelage sur l'extérieur (fig.30, n°3),
- un petit bol ou écuelle comportant de nombreuses traces de modelage (fig.32, n°7).
- un couvercle (fig.30, n°5). Les jattes : - une jatte portant des impressions sur le bord (fig.32, n°6), - une jatte biconique à bord cannelé rentrant (fig.38, n°1). Les gobelets ou petites urnes : - 19 gobelets à panse arrondie et petit bord déjeté cannelé ou facetté (fig.33, n°1, 2,
4, 7, 8, 10 ; fig.34, n°1 à 13) : 2 possèdent 3 cannelures jointes sous le bord ; 1, deux séries de deux cannelures jointes sur la partie supérieure du vase ; 2 ont deux traits incisés ; 3 présentent des cannelures jointes ; 1 des impressions courtes. Les petits vases restants sont lisses. Cette forme est fréquente en Quercy par exemple à la grotte aux Poteries22, elle se rencontre en Dordogne au Bronze final 3a.
- 2 petites urnes (fig.35, n°2 et 4) à carène débordante (forme attestée à la Borie-Basse, mais également en Quercy) ornées d'incisions en chevrons associés à des cannelures, incisions ou pointillés, carènes vives dont une présente une association de cannelures et d'incisions. L'emploi combiné de traits obliques et de pointillés qui connaîtra un fort développement au Bronze final 3b en Albigeois, se retrouve fréquemment dans les nécropoles23. En contexte d'habitat on le retrouve dans la couche 2-1 de la grotte de la Garenne mais également dans la couche 6 du Pech Egos24. Le décor de chevrons se rencontre fréquemment en Quercy depuis le Bronze final 2 à la grotte Sindou ou au Noyer, sur des formes du Bronze final 3a à la grotte aux Poteries, au Bronze final 3b au Bourgnétou à Pinsac, la grotte de la Fée à Thémines, La Ripane à Strenquels.
18Datation N° ARC 1185 Age 14C Brut : 2799 +/- 87 BP. Date 14C Calibrée : 1245 - 805 cal BC. 19Lorblanchet, Genot 1972 ,: fig.25 et 27. 20Guilaine 1972. 21Constantini et alii 1985. 22Lagarrigue 1993, pl.25 n°4 et 5, pl.27 n°6. 23La Maladrerie à Albi, Gabor à Saint-Sulpice, La Traytié à Lautrec. 24Carozza 1991.
- 50 -
- 4 bords déjetés d'urne à cannelure interne (fig.36, n°2, 3, 7 et 9), - 2 cols concaves (fig.39, n°6 et 7), - 26 bords isolés de gobelets ou de petites urnes (fig.39) : 8 facettés (ex.fig.39, n°2
et 4), 8 cannelés (ex.fig.39, n°1) et 10 aplanis ou arrondis. Les urnes : - un profil d'urne à épaulement et panse arrondie (fig.38, n°4), - un épaulement d'urne portant des cannelures larges (fig.38, n°5), - 2 urnes fermées sans col (fig.32, n°9 et 10). Ce type de grand vase fermé existe à
la Borie-Basse25. - 6 urnes à bord déjeté (fig.32, n°1 à 5 et 8), dont trois ont une lèvre digitée (fig.32,
n°1 à 3), - 2 urnes biconiques à col légèrement ouvert (fig.37, n°1; fig.41, n°1), l'une
possède des digitations sur le bord, toutes 2 portent des impressions au bâtonnet sur la carène,
- 4 urnes biconiques à col relevé concave (fig.36, n°1, 4 à 6), l'une avec 2 cannelures jointes sur la carène, une autre avec 3 cannelures fines sous le col et la dernière avec une ligne d'impressions rondes, peu profondes. Ce type de forme se rencontre à Berniquaut au Bronze final 2-3a26, à la Borie-Basse27, mais également en Quercy.
- une urne à col déjeté (fig.37, n°1), bord digité et cordon portant des impressions en spirale,
- 5 bords déjetés d'urnes dont trois cannelés et 2 facettés (fig.39, n°5 à 8, fig.37, n°3).
Les fonds : - un fond de faisselle (fig.40, n°2), - un fond portant des cannelures convergeant vers le centre (fig.40, n°7), - 6 fonds bombés (fig.40, n°1,3 à 6 et 13), - 2 fonds bombés de plats à degrés internes (fig.40, n°8 et 17), - un fond ombiliqué (fig.40, n°15), - 6 fonds plats (fig.40, n°9 à 12, 14, 16), - un fond plat de vase à carène vive (fig.38, n°2). Les préhensions : - une anse perforée (fig.32, n°11), - une languette (fig.32, n°12). Les décors isolés : - un cordon peu marqué portant des empreintes digitées (fig.37, n°4), - 10 tessons supports d'impressions (fig.37, n°5 et 6 ; fig.41, n°2 à 9) réalisées à
partir de matrices diverses : doigt, bâtonnets ronds ou carrés, - 3 tessons avec deux filets de doubles incisions (fig.38, n°9 à 11), - 3 tessons avec des cannelures (fig.38, n°6 à 8).
25Carozza 1991, pl.12 n°6. 26Séguier 1989 pl.1. 27Carozza 1991, pl.17.
- 63 -
Avec un nombre bien moins important de tessons issus de son comblement1, la fosse 1104b nous fournit toutefois une importante série d'au moins 46 vases différents. On retrouve les mêmes types de formes (fig.43 à 46) accompagnés de quelques décors originaux. Les plats et écuelles : - 5 plats tronconiques à degrés internes (fig.43, n°1 à 4 et 13), - un plat orné de deux cannelures étroites jointes (fig.43, n°5), - 8 bords d'écuelles ou de plats biseautés ou amincis (fig.43, n°6 à 10, 12, 13 et 15), - 2 bords cannelés (fig.43, n°11 et 14). Les jattes : - 2 jattes biconiques à bord cannelé déjeté (fig.44, n°7 et 9) : l'une porte sur sa
partie supérieure un décor de méandres symétriques incisés au double trait, suivant un tracé courbe, l'autre possède 3 cannelures jointes au-dessus de la carène et des cannelures obliques couvrant la carène. Ce type de vase existe en Quercy à la grotte aux Poteries (Vers)2.
- 2 jattes à petit col relevé (fig.44, n°1 et 3), l'une porte un décor de trois filets incisés au double trait sur la partie haute.
Les urnes : -2 urnes biconiques à col relevé légèrement concave (fig.45, n°1 et 8) et lignes
d'impressions au bâtonnet sur la carène. L'une d'elle comporte des impressions en spirale sur la lèvre. On retrouve ce type de vase au Bronze final 3a à la Borie-Basse3.
- 4 types d'impressions distinctes présents sur des tessons isolés (fig.45, n°2 à 8): digitées ou ongulées, impressions rondes, impressions au bâtonnet anguleux,
- 5 bords digités en spirale (fig.45, n°1 à 3, 6 et 7), - 4 cols légèrement relevés (fig.46, n°1 et 3 à 5), - 3 épaulements ornés de cannelures (fig.46, n°2, 6 et 7). Cette forme est fréquente
à Berniquaut au Bronze final 3b4, mais également en Quercy5. Les fonds : - 2 fonds plats (fig.44, n°1 et 3) - un fond ombiliqué (fig.44, n°1 et 3).
Fig.42 - Le Clot : objets métalliques des structures 1104 et 1104b. 1. st.1104; 2. st.1104b.
1740 fragments. 2Lagarrigue 1993, pl.19 n°5, pl.26 n°2; pl.33 n°3, pl.43 n°1. 3Carozza 1991, pl.41. 4Séguier 1989, pl.26 n°6 et 7. 5Lagarrigue 1993, pl.54.
- 68 -
La structure 1150 Cette excavation isolée est en partie creusée dans le niveau de grave qui affleure en banc au sud du site. Entaillé au nord par une tranchée moderne, le creusement est nettement perceptible et affecte une forme sub-circulaire d'un diamètre probable de l'ordre du mètre (fig.47). Les parois sont évasées et se raccordent sans rupture avec un fond rond. Conservée sur 0,45 m de profondeur, cette fosse était comblée d'une couche de limon argileux très homogène dans laquelle se trouvaient mêlés de nombreux tessons de céramiques peu morcelés ainsi que quelques fragments osseux de bovidé et d'ovicapriné. Des charbons à l'état de trace et des petits nodules de terre rubéfiée étaient également présent dans ce remplissage.
Fig.47 - Le Clot : relevé de la structure 1150.
Les quelques 280 tessons de céramiques qui constituent l'essentiel du mobilier issu de cette fosse, probablement réutilisée comme dépotoir, proviennent d'au moins 25 vases différents. Les différentes formes rencontrées se répartissent comme suit :
- 69 -
Les plats : - 3 plats tronconiques (fig.48, n°13, 14 et 15), Les jattes : - une grande jatte ouverte à bord facetté (fig.49, n°1), - un bord aplani (fig.48, n°8) de jatte, Les gobelets ou petites urnes : - un gobelet ou petite urne (fig.48, n°1)à bord cannelé relevé et épaulement peu
marqué souligné par une arête. On retrouve ce type de forme à Berniquaut (Sorèze), dans un ensemble attribué au Bronze final 2-3a6,
- des bords déjetés, à facettes (fig.48, n°2, 3, 6 et 7) ou aplani (fig.48, n°4), - un bord déjeté aplani (fig.48, n°4), - un bord de petit vase comportant une cannelure interne (fig.48, n°5), Les urnes : - une urne biconique à col droit légèrement concave (fig.49, n°10). Deux
cannelures larges sont situées sur le haut de la panse et une ligne d'impressions rondes sur le changement de direction,
- une urne biconique à col droit, lèvre facettée (fig.48, n°9). Cette forme rappelle le Bronze final 2-3a de Berniquaut7, elle se retrouve également en Quercy à la grotte aux Poteries à Vers8.
- une urne biconique à col court ouvert (fig.49, n°11), ornée d'une ligne d'impressions verticales au bâtonnet sur le changement de direction.
- une urne à col court ouvert, lèvre facettée (fig.48, n°12). Elle rappelle une forme de Berniquaut9 et se retrouve en Quercy à la grotte aux Poteries10.
- un épaulement d'urne orné de trois cannelures disjointes (fig.48, n°11), Les décors isolés : - une série de cannelures obliques sur un élément de panse (fig.48, n°10) de petit
vase, - des impressions ongulées (fig.49, n°7), - des impressions digitées (fig.49, n°9), Les fonds - 6 fonds plats (fig.49, n°2 à 6 et 8).
6Séguier 1989, pl.1 n°8. 7Séguier 1989, pl.1 n°3 et 4. 8Lagarrigue 1993. 9Séguier 1989, pl.1 n°1. 10Lagarrigue 1993, pl.44 n°3 et pl.49 n°1.
- 72 -
La structure 1099 Cette structure, située à une dizaine de mètres au sud des fosses 1104 et 1104bis, est réduite à un fond de fosse d'une vingtaine de centimètres de profondeur maximale, signalé par un comblement de nature détritique. Les différents éléments recueillis dans ce remplissage, en majorité des tessons de céramiques, délimitent une surface oblongue de 0,90 m de long sur 0,40 m de large. Parmi la centaine de fragments de céramiques que recelait cette structure, quelques éléments permettent de l'inscrire parmi les aménagements du Bronze final 3a. On notera en particulier : - une jatte biconique à carène débordante, lèvre déjetée comportant une cannelure
interne (fig.50, n°8). Elle est décorée sur la carène d'incisions au double trait formant des chevrons. On retrouve cette forme à carène débordante à la Borie-Basse au Bronze final 3a11, mais également en Quercy décorée de cannelures obliques sur la carène12.
- un élément de gobelet ou petite urne biconique à col droit, lèvre comportant une cannelure interne (fig.50, n°9). Décor incisé au double trait sous le col et départ de méandres symétriques au double trait également.
- un fragment de carène (fig.50, n°10) ornée d'une ligne de pointillés surmontant des groupes d'incisions obliques en chevrons. L'association de chevrons composés de groupes d'incisions et de pointillés se retrouve en Quercy à la grotte aux Poteries13.
- un fond plat (fig.50, n°11).
Fig.50 - Le Clot : céramiques du Bronze final 3a de la fosse 1099.
11Carozza 1991, pl.17 n°6 et pl.25. 12Lagarrigue 1993, pl.22 n°5. 13Lagarrigue 1993, pl.32 n°14; 16.
- 73 -
Les structures d'implantation A l'extrémité sud du site, cinq trous de poteaux présentent des morphologies comparables. Ils offrent des parois bien discernables, verticales ou peu évasées avec un fond plat ou légèrement concave. Leurs dimensions sont assez constantes, aux alentours de 0,50 m de diamètre pour des profondeurs conservées de l'ordre de 0,40 m. Ces excavations de fort volume recelaient une grande quantité d'éléments rubéfiés, parmi lesquels des nodules de terre cuite et des fragments de torchis (fig.52), mêlés à de nombreux charbons de bois. Le remplissage de la structure 1156 comprenait également de gros fragments de céramiques très érodés, plus ou moins plaqués contre les parois du creusement (fig.53). Ces différents remplissages, inhabituels pour des structures de maintien, sont à l'évidence le résultat d'apports volontaires, probablement consécutifs à l'arrachage des poteaux, et par voie de conséquence à une destruction (volontaire ou accidentelle) de la structure en élévation dont ils relèvent. La disposition de quatre de ces trous met nettement en évidence le plan d'un petit bâtiment (fig.51) sensiblement orienté est/ouest. De forme rectangulaire, cette construction longue de 4 m et large de 2 m couvre une surface au sol de 8 m². L'exiguïté de ce bâtiment suggère des fonctions diverses (stockage, resserre,...), mais exclut celle d'une habitation. Les poteaux, manifestement importants au regard du volume de leurs supports, semblent avoir été prévus pour supporter de lourdes charges. Ces plans, à faible emprise au sol et poteaux massifs, sont généralement assimilés à ceux des greniers surélevés. Des charbons de bois prélevés dans le remplissage de deux trous de poteaux de cette construction ont fait l'objet d'une datation par le radiocarbone. Les résultats14, qui s'inscrivent dans une fourchette assez large, situent l'abandon du bâtiment au cours du Bronze final 3a.
Fig.51 - Le Clot : plan d'une petite construction de type grenier surélevé du Bronze final 2.
14Datation N° ARC 1191 Age 14C Brut : 2845 +/- 87 BP. Date 14C Calibrée : 1315 - 825 cal BC. Datation N° ARC 1194 Age 14C Brut : 3106 +/- 148 BP. Date 14C Calibrée : 1730 - 940 cal BC.
- 75 -
La céramique du bronze final 3a : synthèse et contexte régional. Si l'on prend en compte la morphologie des céramiques, on constate une prédominance des vases dont les formes s'inscrivent dans la tradition du Bronze final 2. Il s'agit de jattes carénées ou à épaulement (st.1104b) et de gobelets à épaulement (st.1104). D'autres récipients, tels que des gobelets à panse galbée ou des jattes carénées (st.1104), traduisent le même phénomène. Cette filiation avec le Bronze final 2 se trouve également renforcée par la présence, dans le registre décoratif, de nombreuses cannelures en torsade (st.1104, 1104b et 1150). Ces mêmes ensembles clos fournissent des traceurs chronologiques plus évolués, rapportés au Bronze final 3b. Il s'agit, pour le registre décoratif, de l'apparition des motifs linéaires et géométriques incisés. On remarque également l'emploi de pointillés obliques associés à des motifs incisés linéaires. Ce type d'association est fréquent dans le Bronze final du Quercy et du Périgord. Dans un même temps, on note une évolution sensible des formes de la céramique. Le mobilier de la fosse 1104 a fourni de nombreux récipients au profil adouci ou arrondi. Il s'agit de gobelets ou de jattes. Ces récipients sont parfois ornés de doubles traits horizontaux. Des formes nouvelles apparaissent. Il s'agit d'écuelles à bord rentrant, à panse arrondie ou carénée. Ces vases se développeront durant le Bronze final 3b. D'autres types de récipients connaissent des évolutions moins marquées : les coupes tronconiques. Celles-ci portent le plus souvent de larges méplats couvrants, alors qu'au Bronze final 2, l'emploi des fines cannelures groupées est largement répandu. Cette constatation a déjà été faite sur le site de la Garenne à Penne15. Pour ce qui est des vases de grand volume - urnes et jarres - une filiation avec les types du Bronze final 2 est nettement perceptible. Le registre ornemental se singularise par l'emploi prédominant des impressions au bâtonnet, oblique ou rond, aux dépens des cordons digités. Le Bronze final 3a a été défini par J. Guilaine sur la base d'un arrondissement général des formes et de l'apparition des premières incisions au double trait. En Minervois, les sites de Roucaude à Agel et de Boussecos à Bize16 illustrent ce processus. Sur ces gisements, on note l'apparition d'écuelles hémisphériques ou carénées ornées d'incisions horizontales au double trait. Les motifs de méandres et de grecques apparaissent progressivement sur des sites tels que celui de Roucaude à Agel ou celui de la grotte 1 de Castelvieilh à Ste Anastasie17. L'absence de motifs incisés réalisés sur les bords des plats - triangles hachurés ou non - doit être relevée dans les séries languedociennes. En pays albigeois, seule la stratigraphie de la grotte de la Garenne permet de suivre la transition Bronze final 2/Bronze final 3a. Sur ce site, on note l'apparition de motifs incisés linéaires ou de fins pointillés obliques (couches C2d-C2a). Les formes tendent à s'arrondir et on observe l'apparition d'écuelles arrondies ou carénées. Le mobilier des fosses du Clot s'inscrit dans ce même processus. Nous avons pu y relever la présence de motifs incisés en méandre (st.1104 bis par exemple). Dans les structures 1104 et 1104 bis, ces ensembles révèlent que certains éléments caractéristiques du Bronze final 2 sont récurrents. Il s'agit de formes carénées ou à épaulement, parfois ornées de cannelures en torsade. De façon concomitante, on assiste à l'apparition de motifs de pointillés obliques ou de triangles incisés. Ces décors sont fréquemment représentés dans les séries quercinoises. Le mobilier issu de la grotte aux Poteries à Vers illustre ce phénomène de façon probante18. A l'image de ce que l'on peut observer en Quercy ou en Périgord, le 15Carozza 1991. 16Lauriol 1963. 17Dedet, Pene 1991. 18Carozza, Lagarrigue à paraître.
- 76 -
Bronze final 3a de l'Albigeois semble s'inscrire dans un mouvement de renouvellement. Cette tendance caractérise entre autres le mobilier du Clot ou de la grotte de la Garenne. Dans la fosse de Pigasso (Rabastens), des éléments récurrents attribuables au Bronze final 2 sont mêlés à des éléments caractéristiques du Bronze final 3a. Nous trouvons dans cet ensemble clos des récipients aux formes vives - gobelet à épaulement orné de cannelures en torsade, jatte carénée - associés à une écuelle carénée ornée d'incisions au double trait et un gobelet arrondi, orné du même motif. Sur le versant sud de la Montagne Noire, l'abri du Collier et la grotte de Buffens ont livré des céramiques comparables à celles attribuées au groupe Quercy-Albigeois. Des jattes à épaulement, ou de petits gobelets à épaulement, sont ornés de double traits linéaires et de fins pointillés obliques. Si l'ornementation est novatrice, les formes sont elles héritées du Bronze final 2. A notre connaissance, ces deux sites sont les seuls du versant sud de la Montagne Noire à posséder de tels caractères. Ils attestent de liens manifestes entre les deux versants de ce relief.
- 77 -
L'OCCUPATION DU BRONZE FINAL 3B Les fosses Sept structures disparates et d'inégale importance peuvent être assimilées à des fosses. La morphologie des creusements n'a pu être observée avec précision pour aucune d'entre elles, la répartition des différents vestiges ne fournissant en outre que des indications. Dans les descriptions qui vont suivre, nous n'insisterons donc pas sur la morphologie de ces structures et par là même sur les éventuels caractères fonctionnels initiaux, leur dernier état n'étant souvent que le reflet d'une réutilisation finale comme dépotoir. En outre, les comblements, souvent très homogènes, ne permettent pas d'apprécier la dynamique de ces remplissages. Ainsi nous développerons plus particulièrement l'analyse du mobilier céramique qui constitue la principale documentation issue de ces structures.
La fosse 1126
De plan sensiblement circulaire, de l'ordre d'1,50 m de diamètre, la fosse 1126 a fourni un abondant mobilier céramique avec plus d'un millier de tessons dispersés dans une couche de sédiment charbonneux épaisse de 0,35 m. Son remplissage comprenait également quelques fragments de galets chauffés qui peuvent provenir de la structure de combustion néolithique st.1163 installée à proximité immédiate (fig.54).
Fig.54 - Le Clot : relevé de la fosse 1126 et de la structure de combustion Néolithique 1163.
- 78 -
Après remontage, la céramique a fait l'objet de décomptes selon les types de formes rencontrés. Cependant, ce matériel est très fragmenté et les résultats qui vont être présentés (fig.55 à 60) doivent être pris comme de simples indications admettant une marge d'erreur. Les plats et écuelles : - un plat ouvert décoré intérieurement d'incisions (fig.55, n°21) : 3 séries de 3
incisions, chevrons doubles cernés par des incisions simples, groupes de 4 incisions convergeant vers le fond. Il existe à Berniquaut un plat décoré intérieurement de frises de chevrons19, daté du Bronze final 3b. L'association de chevrons et d'incisions est fréquente en Quercy, on la rencontre également sur les Grands Causses à la Granède à Millau dans un ensemble attribué au Bronze final 3b20.
- 19 bords (fig.55, n°1 à 13, 15 à 19) de plats ou écuelles, bols, - une écuelle tronconique à bord aminci légèrement déjeté (fig.55, n°14), - un grand plat ouvert portant des traces de modelage sur l'extérieur (fig.56, n°3), - un bord facetté de bol (fig.55, n°20). Les jattes : - une jatte à profil arrondi et col droit légèrement ouvert (fig.57, n°1). Cette forme
existe dans le Quercy. - 3 jattes à épaulement (ou carène surhaussée) et col ouvert. Deux portent des
impressions au bâtonnet anguleux, ou rondes et digitées sur la lèvre au niveau du changement de direction (fig.57, n°6 et 8). On retrouve cette forme au Bronze final 3a à la Borie-Basse21. La troisième (fig.56, n°1), plus grande, à carène plus basse, ne comporte pas de décor.
- une jatte à profil arrondi et lèvre déjetée portant un décor de méandres symétriques (fig.58, n°8). Ce type de vase se retrouve dans la couche C2b de la Garenne portant une association de méandres et de chevrons incisés22.
- une jatte ouverte à marli et lèvre cannelée (fig.61, n°21). On rencontre cette forme à la Borie-Basse au Bronze final 3a.
Les gobelets ou petites urnes : - un gobelet biconique à col ouvert décoré d'un méandre au double trait sur la partie
supérieure (fig.58, n°11). Cette même forme se retrouve à la grotte aux Poteries 23, décorée de deux filets incisés. Ce type de vase apparaît dans l'horizon D2 de la grotte des Planches, au Bronze final 3a24, il connaît un grand développement au Bronze final 3b. Il se rencontre également dans le groupe Mailhac I25. Le décor de méandre au double trait fait son apparition dans les horizons finaux du Bronze final 3a (C2b de la grotte de la Garenne) et se perpétue au Bronze final 3b (C2-1 et C2-2 à la grotte de la Garenne).
- un gobelet à carène débordante, petit bord cannelé (fig.58, n°1). Deux cannelures sont jointes sur la zone médiane de la partie haute, et des cannelures obliques se situent sur la carène. Cette forme qui rappelle le Bronze final 2-3a existe, mais sans le décor de cannelures obliques, à la Borie-Basse.
- un gobelet à panse arrondie et petit col ouvert (fig.59, n°11) portant 3 cannelures larges sur la partie haute,
19Séguier 1989, pl.26 n°5. 20Constantini et alii 1985, p.19, fig.16 n°4 et 5. 21Carozza 1991, pl.41. 22Carozza 1991, pl.70 n°3. 23Lagarrigue 1993 pl.26 n°6. 24Pétrequin et alii 1985, p. 138, fig.115. 25Guilaine 1972, fig. 128, n°4 et 5.
- 79 -
- 3 gobelets à panse arrondie surbaissée (fig.59, n°3 à 5), - un gobelet à carène peu marquée avec trois cannelures sur la partie haute (fig.59,
n°2), - un col de gobelet à lèvre déjetée (fig.59, n°6), - un bord biseauté de petit vase portant une série de cannelures sous le bord
extérieur (fig.59, n°10). Il existe dans les horizons anciens au Pech Egos (chantier 1)26.
- un fragment de gobelet à carène débordante (fig.60, n°4) présentant un méandre incisé au double trait sur la partie haute, associé à des chevrons au double trait sur la carène. Cette association de méandres incisés et de chevrons est attestée à la Borie-Basse27.
- 5 bords cannelés déjetés (fig.59, n°12 à 16), - 2 carènes vives (fig.60, n°7 et 8), - un épaulement et col d'urne (fig.60, n°9). Les fonds : - 6 fonds plats (fig.61, n°1 à 3, 7 à 9) dont un portant des cannelures concentriques
internes (fig.61, n°8), - 4 fonds ombiliqués (fig.61, n°4 à 6 et 10). Les décors isolés : - des impressions variées (fig.57, n°7 ; fig.60, n°10 à 13) : digitées ou ongulées,
placées au niveau du changement de direction, - des lèvres digitées (fig.60, n°2 à 5), - 6 tessons présentent des cannelures obliques en torsades sur la carène (fig.58, n°2
à 7). Ce type de décor souvent placé sur la carène est très présent en Languedoc occidental et oriental, il est également bien attesté en Quercy dans des ensembles céramiques attribués au Bronze final 2.
- une association de méandre incisé au double-trait et de pointillés (fig.58, n°10), - 2 carènes vives portant un groupe de 2 cannelures jointes sur la partie haute
(fig.59, n°20 et 22), - 7 tessons cannelés (fig.59, n°17 à 19, 21 à 23 ; fig.60, n°6), - 2 tessons supports d'un double trait incisé (fig.60, n°1 et 5).
26Carozza 1991, pl.55 n°4. 27Carozza 1991, pl.9 n°2.
- 87 -
La fosse 1085 Isolée au nord du site, cette fosse était recoupée au sud par une tranchée récente, et tronquée à l'est par un sondage d'évaluation (fig.62). Sa morphologie exacte est inconnue mais son comblement signale une profondeur conservée de 0,70 m pour des dimensions en surface de l'ordre de 1,10 m de diamètre.
Fig.62 - Le Clot : le relevé de la fosse 1085. Au sud la structure 1103 et 1086. A l'est, le sondage d'évaluation.
- 88 -
Elle contenait au sommet de son remplissage une couche charbonneuse riche en vestiges, alors que le niveau inférieur était rempli d'un sédiment brun presque stérile. Outre deux fragments d'objets en bronze (fig.65), le mobilier recueilli dans ce comblement est essentiellement constitué par de la céramique. Les décomptes qui ont pu être effectués après collages de tessons jointifs font état de la représentation d'au moins une vingtaine de vases différents. Les plats et écuelles : - 3 plats tronconiques à degrés internes (fig.63, n°3 à 5 et 9), - 4 bords de plats tronconiques (fig.63, n°4 à 8), dont deux comportent des
perforations (fig.63, n°7 et 8), - 3 bords d'écuelles à marlis (fig.64, n°9, 11 et 12), - 2 écuelles à paroi arrondie (fig.63, n°1 et 2), - un fond de plat à degrés internes (fig.64, n°18), Les jattes : - une jatte à épaulement marqué et bord déjeté aminci (fig.64, n°1). Le décor
réalisé à la cordelette est placé à la jonction col-panse et sur le changement de direction. On retrouve ce type de décor à la cordelette dans le Bronze final 3b régional notamment à Berniquaut28. La forme, quant à elle, se rencontre également à la Génibrette, Berniquaut ou la Traytié; elle semble héritée des jattes carénées et des jattes à col cylindrique du Bronze final 2-3a. On retrouve cette forme dans la vallée de l'Aveyron à la Garenne au Bronze final 3b, dans la vallée de la Garonne à Sainte-Livrade, et à la Maladrerie à Albi, Gabor à Saint-Sulpice ou encore Cazèles à Rabastens. On la rencontre également, mais avec dimensions supérieures, au Pech Egos, dans les horizons moyens du Bronze final 3a29.
- une jatte bi-tronconique décorée de méandres symétriques réalisés au pointillé sur la partie supérieure du vase (fig.64, n°3). Les jattes bi-tronconiques très fréquentes durant le Bronze final 3b servent rarement de support au décor pointillé, que l'on retrouve cependant à Cordouls30. Le méandre symétrique souvent traité au double trait sur ce type de vase apparaît ici au pointillé, élément qu'il convient de souligner.
- 5 jattes à paroi arrondie (fig.64, n°5 à 7, 13 et 14), Les gobelets ou petites urnes : - un gobelet à col droit et lèvre amincie (fig.64, n°2). Ce type de gobelet est attesté
dans le Quercy à la grotte aux Poteries31. - un gobelet à col ouvert et lèvre amincie (fig.64, n°4), - une urne à col légèrement ouvert et épaulement marqué et carène douce (fig. 63,
n°10). Des décors au double-trait sont présents : l'un à la jonction col-panse, l'autre sur le changement de direction,
- 2 bords d'urnes (fig.64, n°8 et 10),
28Séguier 1989, pl.30. 29Carozza 1991, pl.57. 30Séguier 1989, pl.36 n°20. 31Lagarrigue 1993, pl.21 n°7 et 9.
- 91 -
Fig.65 - Le Clot : objets métalliques en bronze de la fosse 1085.
Les structures 1077, 1084, 1111, 1154 et 1161 Ces cinq structures aux dimensions modestes présentent une caractéristique commune au niveau de leur remplissage. Dans ce dernier, conservé sur 0,10 à 0,35 m d'épaisseur, les pans d'au moins un vase complet ou quasi-complet ont été retrouvés. Ces récipients, dont les formes ont pu être restituées32, ont des dimensions importantes avec des capacités qui peuvent atteindre près de 40 litres (fig.69, n°2), ce qui leur confère une fonction probable de "vase-silo". Cependant, aucun d'entre eux n'a été retrouvé entier dans ces structures et l'absence de connexion entre les tessons ne permet pas de préciser la position originelle de ces vases dans les creusements (vase enfoui ?). D'autre part, ils sont parfois mêlés à quelques fragments d'autres vases signalant une utilisation de ces structures comme dépotoir. Ainsi, la structure 1111 a livré les fragments d'une grande jarre à col ouvert et panse arrondie ornée d'un cordon digité à la jonction col-panse (fig.66, n°11), mais aussi : - 4 bords à facettes de plats tronconiques (fig.66, n°1 à 4), - un bord biseauté de petit vase (fig.66, n°5), - un bord déjeté aplani de petite urne (fig.66, n°6), - une écuelle tronconique à degrés internes (fig.66, n°7), - un fragment de panse arrondie portant un trait incisé ondulant (fig.66, n°8), - un cordon digité sur un départ de panse (fig.66, n°9), - un fond plat d'écuelle à degrés internes (fig.66, n°10). Impressions digitées sur le
bord externe. On retrouve ce type de fond "cranté" durant le Bronze final 3b à la nécropole de La Traytié33.
32Exceptée pour la céramique st.1077 dont la datation est incertaine (Bronze final). 33Séguier 1989, pl.10 n°4.
- 93 -
Fig.67 - Le Clot - la structure 1161. (cliché: O.Dayrens, S.Pons)
Fig.68 - Le Clot - la structure 1084.
(cliché: O.Dayrens, S.Pons)
- 94 -
La structure 1161 ne recelait les fragments que d'un seul vase (fig.67). Il s'agit d'une urne à col légèrement ouvert et panse arrondie marquée par un léger épaulement (fig.69, n°2). Elle est décorée d'impressions courtes et arrondies disposées sur un cordon peu marqué situé sur le départ de l'épaulement. Dans la structure 1084 (fig.68) ont été recueillis les fragments d'un fond plat d'urne (fig.69, n°1) et ceux d'une très grande jarre à épaulement marqué et col ouvert concave, munie d'un cordon digité à la jonction col-panse (fig.69, n°2).
Fig.69 - Le Clot : céramiques du Bronze final 3b des structures 1161 et 1084.
1,3. st.1084; 2. st.1161. Enfin, la structure 1154 a livré des tessons d'au moins trois vases différents (fig.70, n°1 à 4) et en particulier les fragments d'une grande urne à col ouvert, épaulement large et panse arrondie, décorée de trois lignes incisées à la jonction col-panse (fig.70, n°1). Ces grands vases à col haut ouvert semblent fréquents dans les nécropoles de la région castraise, à la Traytié ou la Génibrette34, et ils sont également très largement représentés en Languedoc occidental au Bronze final 3b. La forme de ces vases rappelle les urnes funéraires de Barthou35, mais le col est ici moins développé. Cette tendance au sur-développement des cols est l'apanage des faciès culturels du 7ème siècle qui succèdent au groupe Mailhac I en Languedoc occidental : nécropole du Grand Bassin I36. Il semble que nous ayons à faire ici à une forme plus ancienne annonçant les productions du premier âge du Fer. 34Séguier 1989, pl.9; pl.23 n°1. 35Séguier 1989, pl.51 n°2. 36Séguier 1989.
- 96 -
La structure 1038 Totalement détruite, la structure 1038 ne présentait plus qu'une nappe de vestiges étalés sur près de 6 m² selon une direction préférentielle est-ouest. La densité de ces vestiges, plus importante à l'est, peut éventuellement signaler l'emplacement de la structure originelle. Quelques galets chauffés étaient dispersés parmi le mobilier recueilli qui comprend une centaine de tessons de petite taille et très érodés. Cette céramique comprend quelques éléments caractéristiques : - un bord aplani de plat à degrés internes (fig.71, n°1), - un fragment de plat à degrés internes (fig.71, n°2), - un bord biseauté d'assiette; deux perforations sous la lèvre (fig.71, n°3), - un bord de petit vase ouvert (fig.71, n°4), ligne de pointillés obliques, - un bord arrondi de jatte (fig.71, n°5), ligne d'impressions à la cordelette sous le
bord et décor anthropomorphe réalisé au double trait. En bas pays albigeois, on rencontre des décors anthropomorphes traités le plus souvent au trait simple, de façon très stylisée à Berniquaut ou La Traytié37.
- un fragment de gobelet ou petite urne à carène douce (fig.71, n°6) portant une ligne de pointillés sur la partie supérieure,
- un élément de panse présentant des impressions ongulées superposées (fig.71, n°7),
- un épaulement et départ de col d'urne (fig.71, n°8), - un col haut ouvert d'urne (fig.71, n°9) avec des impressions digitées sur le bord
externe. Les grandes urnes à col ouvert se retrouvent à la grotte aux Poteries38 et sont attribuées à la phase finale du Bronze final 3. Cette forme est connue à la grotte du Luc dans le Gard39, elle est attestée également dans l'est de la France.
- 5 fonds plats(fig.71, n°10 et 13 à 15), - un col ouvert avec un cordon digité rapporté sur le départ de la panse (fig.71, n°12).
37Séguier 1989, pl.85 n°13 à 15. 38Lagarrigue 1989, pl.45 n°5. 39Constantini et alii 1985, p.46, fig.45 n°2; 3 et 6.
- 98 -
Les structures d'implantation La fouille a révélé près d'une quarantaine de petites excavations attribuables ou assimilables à des trous de poteaux, mais il est probable que ce chiffre soit bien en dessous de la réalité. En effet, seuls les aménagements présentant un comblement bien différencié ont pu être repérés. D'autre part, les éléments de datation (céramiques, charbons) sont rares, voire totalement absents pour un grand nombre de structures . De ce fait, l'effectif attribuable à l'occupation Bronze final du site se trouve réduit à une quinzaine d'aménagements. De plan circulaire ou sub-circulaire, la majorité des structures d'implantation du Bronze final offrent des parois verticales ou légèrement évasées (fig.73). Les dimensions qui ont pu être relevées oscillent entre 0,20 et 0,65 m de diamètre. Les creusements les plus volumineux sont aussi les plus profonds, conservés sur une cinquantaine de centimètres en moyenne. Ce rapport entre diamètre et profondeur n'est cependant pas constant (fig.72). Certains trous semblent être étroits et relativement profonds. Ces derniers peuvent effectivement correspondre à des creusements peu volumineux, mais aussi plus simplement au fantôme du poteau.
Diamètre (m)
Pro
fond
eur (
m)
0,00
0,10
0,20
0,30
0,40
0,50
0,60
0,00 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70
Bf3a
Bf3b
Bf
Bf ou 1er Fer
Fig. 72 - Le Clot : Distribution des trous de poteaux du Bronze final selon leur diamètre et leur profondeur.
- 99 -
Fig.73 -Le Clot : les structures d'implantation du Bronze final 1. st.1096; 2. st.1062; 3. st.1064; 4. st.1055; 5. st.1060.
- 100 -
Dépourvus d'éléments de calage, ces structures présentent des comblements très similaires, constitués d'un sédiment brun limoneux souvent très riche en particules charbonneuses et nodules de terre rubéfiée. Les quelques tessons de céramiques associés à ces creusements proviennent généralement du niveau supérieur des remplissages. Très indigent, ce mobilier est de surcroît rarement identifiable. Ainsi, parmi les structures d'implantation qui peuvent être attribuées au Bronze final seul le trou de poteau 1096 a livré de la céramique permettant de préciser son insertion chronologique, avec quelques éléments datables du Bronze final 3b : - une jatte biconique à carène adoucie décorée de deux tracés incisés au double trait
(fig.74, n°1). Cette forme connaît un fort développement durant le Bronze final 3b. On retrouve très fréquemment ce type de vase orné de filets incisés sur les Grands Causses au Bronze final 3a40. En Languedoc occidental, on le rencontre par exemple au Laouret ou au Gaougnas41. En Quercy, cette forme existe notamment à la grotte aux Poteries42.
- un fragment de carène vive comportant une ligne d'incisions courtes obliques au-dessus de la carène (fig.74, n°2),
- un fond plat de vase tronconique à degrés internes (fig.74, n°3), - un pied bas comportant une perforation (fig.74, n°4), - un gobelet ou petite urne à bord rentrant biseauté et panse arrondie (fig.74, n°5).
L'épaulement, marqué par une arête vive, est décoré d'impressions courtes obliques. Cette forme se retrouve dans le Bronze final 3b de Cordouls43, elle se rapproche également d'un vase des niveaux 2sup et 2base de la grotte de la Garenne à Penne, niveaux attribués au Bronze final 3b44.
Fig.74 - Le Clot : céramiques du Bronze final 3b du trou de poteau 1096.
40Constantini et alii 1985, p.71, fig.78 n°4 à 20. 41Guilaine 1972, p.306, fig.119 n°1, fig.120 n°1. 42Lagarrigue 1993, pl.13. 43Séguier 1989, pl.38 n°13. 44Carozza 1991.
- - 101
Le trou de poteau 1096 est cependant isolé et ne peut être associé à aucune autre structure du même type. Plus au nord, en bordure occidentale de la fouille, une construction est toutefois discernable. Elle est signalée par la répartition de six trous de poteaux et d'un septième supposé, qui définissent un plan trapézoïdal à une nef, d'une surface d'environ 30 m² (fig.75). Sa largeur, qui n'excède pas 4 mètres, reste compatible avec des portées d'un seul tenant. La stabilité des parois pouvait être garantie par des entraits reliant deux à deux les poteaux opposés. Cette technique qui apparaît au Bronze final1 à l'avantage de libérer l'espace couvert. Bien qu'il soit difficile de déterminer la fonction de ce bâtiment, réduit à un plan au sol sans divisions et aménagements internes, sa superficie importante permet toutefois d'avancer avec prudence l'hypothèse d'une habitation. Les quelques éléments céramiques issus du comblement d'un des trous de poteaux de ce bâtiment, pourrait situer son abandon au cours du Bronze final, sans autre précision.
Fig. 75 - Le Clot : plan d'un bâtiment du Bronze final.
1Audouze, Buchsenschutz 1989.
- - 102
La céramique du bronze final 3b : datation, comparaisons et état de la question. Les ensembles qui se rapportent à cette période sont nombreux mais n'ont livré que peu d'éléments identifiables. Parmi ceux-ci, la structure 1038 a fourni un petit lot comprenant un décor incisé qui pourrait se rapprocher d'une figuration anthropomorphe. Ce type de décor est fréquent dans le groupe Mailhac 1. Notons toutefois que ce décor figure les détails des mains et du "visage". Ce type de figuration est extrêmement rare dans le groupe Mailhac 1. A l'exception de cette structure, l'ensemble de l'ornementation des céramiques se compose de motifs géométriques - méandres et pendentifs - obtenus soit par incision, soit à la cordelette. Il nous faut signaler l'absence de motifs géométriques ornant les bords de plats, notamment les triangles hachurés. Ce caractère est pourtant fréquent dans le Bronze final 3b régional2. Les formes sont rarement complètes ou restituables. On remarque un nombre important d'écuelles carénées ou au profil ouvert arrondi. Les vases de grande contenance au profil arrondi ne sont presque exclusivement ornés que de cordons digités. Parallèlement à un fort développement de cette technique, on constate un quasi-abandon des impressions digitées ou au bâtonnet. S'il est indéniable qu'un certain nombre de céramiques présente des caractères inscrits dans la tradition du Bronze final 3b, le morcellement du mobilier et le faible effectif disponible ne permettent pas d'assurer une datation précise. La sériation des tombes de la nécropole de Mailhac (Aude) a permis à Thierry Janin de déterminer une phase de transition entre le Bronze final 3b "classique" et le premier âge du Fer. Cette proposition doit être prise en compte, bien que le site du Clot n'ait pas livré d'éléments déterminants. Il nous semble probable que certains ensembles puissent s'intégrer dans ce scénario. L'analyse des ensembles funéraires permettra de préciser ce point. Le Bronze final 3a, tel que nous avons pu le définir à partir des ensembles du Minervois, est propre au Languedoc. Il est à la source même du groupe Mailhac I. Avec ce groupe, le nombre des décors géométriques s'accroît. Outre les figurations anthropomorphes ou zoomorphes, le registre décoratif fait appel à des formes complexes (grecques, chevrons ..). L'emploi de la polychromie -vases peints ou incrustation de matières blanches ou rouges dans les incisions - est propre à cette période. Sur le site de Mailhac, mais aussi dans le bassin de l'Aude, une communauté stylistique se singularise par l'emploi fréquent de pointillés associés aux incisions. Ce type d'associations se rencontre à Médor Ornaison, à la Balma Sabatiero ou à Buffens à Caunes-Minervois. Le groupe Mailhac I a souvent été considéré comme un ensemble homogène occupant un vaste espace géographique. Cependant, en Languedoc, des particularismes clairement identifiés permettent d'individualiser des sous-groupes. Des différences importantes existent entre les séries céramiques issues du Bas Languedoc oriental et occidental. Les formes des céramiques diffèrent ; le registre décoratif, s'il s'inspire de thèmes semblables, présente des traitements différents. Dès que l'on s'éloigne des zones littorales, on observe une disparition ou une transformation rapide des décors et des formes. Ce cas de figure se présente en Languedoc oriental dans la zone des garrigues3. Vers l'ouest, l'extension du groupe Mailhac I se limite au seuil de Naurouze (site de Lestrade à Mireval-Lauragais). Le site de Carsac pourrait lui aussi illustrer ce même phénomène.
2Carozza 1991, Séguier 1989. 3Dedet 1991.
- - 103
En Albigeois, l'évolution du Bronze final 3a a pu être suivie grâce à la stratigraphie de la grotte de la Garenne. Le mobilier de la couche 2 a livré un ensemble de récipients richement ornés d'incisions linéaires ou en motifs géométriques, associés à des pointillés, attribuables au Bronze final 3b. Dans le Castrais, certains caractères propres au groupe Mailhac I sont présents. Des figurations zoomorphes traitées au trait simple ont été reconnues à la nécropole de la Traytié4. Ces représentations sont spécifiques au sud albigeois. Les différences stylistiques, caractérisées notamment par l'emploi de pointillés parfois obtenus à la cordelette, singularisent ce groupe de sites. Dans le nord albigeois où l'on constate l'absence de figurations schématiques de type Mailhac I, les ensembles céramiques attestent de relations avec le Languedoc parallèlement au développement des spécificités liées au substrat local5.
4Séguier 1989. 5Carozza 1991.
- - 104
LES STRUCTURES MAL DATEES DU BRONZE FINAL Outre les quelques trous de poteaux sans mobilier, décrits précédemment, cinq structures très arasées6, réduites le plus souvent à des nappes irrégulières de vestiges, sont datables du Bronze final 2 ou 3b. Leur état de conservation ne permettant pas une description morphologique, nous ne connaissons pratiquement rien de ces aménagements, qui ont pu être à l'origine des fosses peu profondes. Parmi les traces charbonneuses et autres éléments brûlés provenant du remplissage de ces structures détruites, quelques tessons de céramiques ont été recueillis. Ce mobilier extrêmement fragmenté et très érodé n'a pu être restauré et très peu d'éléments ont été restitués graphiquement. Parmi ceux-ci la structure 1118 a fournit les pièces suivantes : - un fragment de bord déjeté aplani (fig.76, n°1), - 2 fragments de panse portant un départ de méandres symétriques incisés au
double trait (fig.76, n°2 et 3). - un fragment de panse orné de courtes incisions horizontales (fig.76, n°4), - un fragment de panse muni d'impressions ongulées (fig.76, n°5).
Fig. 76 - Le Clot : céramiques du Bronze final de la structure 1118.
6st.1067, st.1069, st.1118, st.1132 et st.1146.
- - 105
ORGANISATION DE L'OCCUPATION DU BRONZE FINAL Si, grâce à l'étude des ensembles clos issus des structures en creux, il a été possible de définir plusieurs phases d'occupation du site au cours du Bronze final, en revanche la répartition des différents aménagements ne met en valeur aucun plan cohérent, à l'exception des trous de poteaux suggérant la présence de deux bâtiments. Le premier, daté du Bronze final 2, peut signaler une aire de stockage au sud du site, et le second, implanté plus au nord du site, peut éventuellement correspondre à une habitation. Cette construction reste toutefois mal datée. Peu nombreux et mal conservés, les autres témoins du Bronze final ne rendent pas compte d'une véritable organisation de l'espace. Toutefois on peut remarquer que l'implantation des bâtiments ne se confond jamais avec celle des fosses "dépotoirs", ce qui pourrait signifier une certaine partition de l'espace, où les "aires de rejet" se situent à l'extérieur des habitations ou des zones de stockage. Enfin, il est intéressant de noter l'absence de recoupement entre les différentes structures du Bronze final, ce qui peut conforter l'idée d'une continuité de l'occupation entre le Bronze final 2 et le Bronze final 3b. Néanmoins, ce phénomène reste difficilement vérifiable sur le terrain sans liens stratigraphiques. Dès lors et dans un cas comme celui-ci, les informations qui nous sont fournies par les ensembles clos issus de structures en creux deviennent essentielles.
- - 108
L'OCCUPATION DU PREMIER AGE DU FER Les structures qui correspondent à cette phase d'occupation du site sont peu nombreuses mais diversifiées. En effet, elles comprennent des aménagements domestiques à caractère fonctionnel tels que les foyers ou les trous de poteaux, mais également des fosses destinées aux déchets après leur abandon (fig.77). LES STRUCTURES DU PREMIER AGE DU FER Les fosses
La fosse 1012 En surface, la fosse 1012 présente une forme ovalaire de 1,40 de long sur 1,10 m de large. Les parois, peu lisibles, semblent irrégulières avec un palier au sud, à une trentaine de centimètres de profondeur. L'excavation affecte ensuite une forme circulaire jusqu'au fond situé 20 cm plus bas (fig.78).
Fig.78 - Le Clot : relevé de la structure 1012.
- - 109
Le comblement de cette structure volumineuse montre une stratification qui implique au moins deux phases de remplissage. La première est matérialisée par une couche de sédiment brun très charbonneux et riche en vestiges céramiques. L'apport suivant est constitué d'un sédiment de nature identique mais dépourvu de charbons et beaucoup moins riche en débris de céramiques. Ce dernier, en forme de cuvette, pourrait signaler une éventuelle réutilisation avant l'abandon définitif de la structure. La nature des rares vestiges rencontrés dans ce niveau n'apporte cependant aucun élément permettant de préciser cet état. Le mobilier céramique issu de cette fosse constitue une série homogène. Il comprend des éléments caractéristiques du premier âge du Fer, qui peuvent être attribués au VIIème ou VIème siècle avant notre ère. On notera en particulier : - 2 vases ouverts à profil arrondi continu (fig.79, n°1 et 5), - un fond plat (fig.79, n°2), - 2 fonds bombés (fig.79, n°3 et 4), - un bord aplani d'un vase ouvert (fig.79, n°6), - un bord déjeté d'une grande urne, portant de profondes incisions longues et
verticales sous la lèvre (fig.79, n°7), - un grand vase à col droit et profil sinueux présentant un cordon incisé sur le
départ de la panse (fig.79, n°8). Le fond est bombé. - un vase à col droit portant des incisions longues profondes et obliques sous le
bord (fig.79, n°9). On rencontre ce type d'incisions dans le matériel du premier âge du Fer de Cordouls à Puylaurens7.
7Séguier 1989, pl.79.
- - 111
La fosse 1023 Implantée non loin de la précédente (fig.77), la fosse 1023 est la plus imposante des structures en creux repérées sur le site. Ses dimensions sont incertaines mais avoisinent au moins 1,40 m de diamètre en surface pour une profondeur minimale de 0,80 m. Bien que les parois de cette excavation ne soient pas directement visibles, les divers éléments constituant son remplissage permettent d'entrevoir un creusement hémisphérique (fig.80). En effet, au comblement limoneux se mêlaient de très nombreux fragments de charbons et de terre cuite, donnant une teinte plus brune au sédiment qui se différencie ainsi de l'encaissant. Plus de 250 tessons de céramiques, quelques restes osseux d'ovicapriné, de suidés et de bovidés, parfois brûlés, et une meule dormante en granit (fig.81) étaient également dispersés dans toute l'épaisseur du remplissage. L'hypothèse d'un comblement unique ou en apports successifs est difficilement vérifiable étant donnés l'aspect très homogène de ce dépôt et le volume de cet aménagement. Quoiqu'il en soit, la dernière utilisation de cette fosse apparaît être, une fois encore, celle d'un dépotoir domestique.
Fig.80 - Le Clot : relevé de la fosse 1023.
- - 112
Fig.81 - Le Clot : meule dormante en granit provenant de la fosse 1023. La céramique, qui constitue l'essentiel du matériel recueilli dans cette structure, comprend quelques éléments identifiables, provenant d'au moins 12 vases différents parmi lesquels : - un grand vase à profil sinueux, col droit et lèvre biseautée (fig.82, n°13). Un
cordon portant des incisions profondes en chevrons est placé à la jonction col-panse,
- un gobelet ou petite urne à panse arrondie, col droit et lèvre triangulaire portant une cannelure interne (fig.82, n°1). Ce petit vase rappelle des gobelets à panse très arrondie de la grotte de la Garenne, attribués au premier âge du Fer8, formes qui paraissent issues de l'évolution directe de celles du Bronze final.
- 3 bols à paroi arrondie (fig.82, n°2 à 4). Ce type de vase se rencontre au premier âge du Fer dans la couche 1b de la grotte de la Garenne.
- un bord de vase ouvert de type écuelle (fig.82, n°5), - un bord d'urne à col droit (fig.82, n°6), - un bord biseauté (fig.82, n°7), - un fragment muni d'un mamelon perforé (fig.82, n°8), - un fragment de col d'urne, à lèvre déjetée (fig.82, n°10), - 2 fonds plats(fig.82, n°11 et 12), - un élément de panse comportant un mamelon, accompagné d'incisions profondes
en chevrons (fig.82, n°9). On rencontre des éléments de préhension (boutons, mamelons ou languettes) intégrés dans le décor, notamment à Cordouls (Puylaurens).
8Carozza 1991, pl.66 n°6 et 7.
- - 114
La fosse 1097 Cette fosse, isolée en bordure occidentale de la fouille, affecte une forme oblongue de l'ordre de 1,40 m de long sur 0,80 m de large. Le creusement, profond de 0,40 m, s'interrompt au contact d'un niveau de grave (fig.83).
Fig.83 - Le Clot : relevé de la fosse 1097.
Son comblement comprenait à la base une quantité importante de fragments de terre cuite, dont certains montrent des empreintes de végétaux. Ces éléments, de toutes tailles mais trop peu épais pour appartenir à des parois en torchis, pourraient provenir du démantèlement d'une sole de foyer ou de four. Le reste du remplissage est homogène, constitué d'un sédiment charbonneux dans lequel se trouvait mêlés de nombreux fragments de céramiques. Ce matériel, très érodé, n'a pas permis l'identification de beaucoup de formes : - un vase à col droit et profil sinueux (fig.84, n°1), - un fond plat d'un vase à panse arrondie (fig.84, n°2), - un mamelon ou languette (fig.84, n°3), - un fragment de bord aplani muni d'une languette placée sous la lèvre (fig.84, n°4), - 3 fragments d'anses de section aplanie(fig.84, n°5 à 7) - 3 fonds plats (fig.84, n°8 à 10).
- - 116
La structure 1152 Bien que comptée parmi les structures en creux de type fosse, la nature précise de cette "structure" nous échappe (fosse détruite ?). Elle est signalée par une nappe de vestiges irrégulière et diffuse qui s'étale sur une surface de plus de 6 m de long et 2 m de large. La répartition des divers objets (tessons de céramiques, galets, charbons, nodules de terre cuite) ne fait apparaître aucune organisation ou concentration particulière au sein de cette nappe. Le morcellement des céramiques, tout comme celui du reste du matériel, est très variable. Par ailleurs, ce mobilier n'a pu faire l'objet d'aucune liaison, et seul un gros fragment d'une grande jarre (fig.85, n°1) a pu être identifié. Elle présente un col droit, légèrement ouvert avec un bord aplani et décor de cordon digité en torsade situé à la jonction col-panse.
Fig.85 - Le Clot : céramique du premier âge du Fer de la structure 1152. Les structures de combustion Cinq structures de combustion appartiennent à cette phase d'occupation du site. Fonctionnellement identiques à celles du Néolithique moyen, leur plan rectangulaire ou quadrangulaire permet de les distinguer aisément de ces dernières. La structure 1007, qui a fait l'objet d'une datation 14C9, est la plus représentative de l'ensemble. Elle présente un plan rectangulaire d'1,60 m de long sur 0,80 m de large, très nettement discernable malgré l'arasement (fig.86, n°1). Son remplissage est constitué d'un lit charbonneux recouvert par une nappe de galets chauffés de nature iverse : quartz, schiste, granit. Sur ce niveau, de rares tessons de céramiques informes ont été retrouvés. Dans les structures 1166 et 1167, des meules dormantes usagées (fig.87), en granit, ont également été utilisées comme calorifères. Une autre caractéristique commune à toutes ces structures du premier âge du Fer réside dans la taille des galets utilisés comme calorifère qui est nettement plus importante que celle rencontrée dans les aménagements du Néolithique. En effet, des dimensions de l'ordre de 0,20 m voir 0,30 m de côté sont fréquentes, calibres qui ne semblent pas avoir été choisis au Néolithique.
9Datation N° ARC 1192 Age 14C Brut : 2350 +/- 42 BP. Date 14C Calibrée : 760 - 260 cal BC.
- - 117
Fig.86 - Le Clot : Exemple de structures de combustion à galets chauffés du premier âge du Fer. 1. st.1007; 2.st.1166.
- - 118
Fig.87 - Le Clot : meule dormante en granit provenant de la structure de combustion 1167.
Fig.88 - Le Clot : la structure de combustion à galet chauffés 1007. (cliché: O.Dayrens, S.Pons)
- - 119
Les trous de poteaux Deux petites excavations10, assimilables à des trous de poteaux, ont livré de la céramique du premier âge du Fer. De forme sub-circulaire, leur diamètre n'excède pas 0,40 m pour une profondeur conservée de l'ordre de 0,20 m. Leur sédiment de remplissage est très homogène, charbonneux et riche en nodules de terre cuite. Le mobilier associé à ces creusements provient du niveau supérieur de leur comblement. La structure 1143 a fourni des fragments d'un vase à paroi très fine et col ouvert. L'épaulement arrondi est décoré d'incisions obliques courtes et espacées (fig.89, n°1). Les fragments d'un autre vase proviennent du trou de poteau 1059 (fig.89, n°2). Il offre un profil sinueux à bord droit, avec cependant une carène marquée sur la partie supérieure du vase. Cet élément rappelle le premier âge du Fer. On rencontre cette forme également à Saint-Chippoli à Dourgne11ou encore à la grotte de Lacalm à Aiguefonde12.
Fig. 89 - Le Clot : céramiques du premier âge du Fer des trous de poteaux. 1. st.1143; 2. st.1059.
10st.1059 et st.1143. 11Séguier 1989, pl.91 n°2. 12Séguier 1989, pl.93 n°1.
- - 120
CHRONOLOGIE DE L'OCCUPATION DU PREMIER AGE DU FER L'ensemble du matériel recueilli dans les structures ne paraît pas représenter une même période d'occupation. On peut en effet distinguer : - une phase ancienne, qui semble directement issue du Bronze final et qui en conserve les traditions. La structure 1142 présente des formes connues dans le Bronze final 3b local et qui se développent durant le premier âge du Fer ; le décor à la cordelette se retrouve également fréquemment au cours de cette période dans la région. - un premier âge du Fer affirmé, avec des bols à bord droit, des vases aux profils sinueux, des décors d'impressions ou d'incisions profondes (st. 1012, st.1097, st.1059). Le col bien développé du vase de la structure 1143 semble également participer à ce phénomène. Le mobilier de la structure 1023 reprend les caractéristiques énoncées ci-dessus avec cependant un fragment associant décor et préhension qui pourrait être plus récent. Ces éléments se retrouvent en effet localement à la fin du premier âge du Fer, au VIème ou Vème siècle av. J.-C. Le mobilier du premier âge du Fer constitue donc en définitive un petit ensemble hétérogène. L'absence de séries homogènes locales publiées ne nous permet pas de proposer d'autres comparaisons afin de préciser la chronologie. CONCLUSION Avec seulement onze structures réparties sur près d'un hectare, les témoins de premier âge du Fer restent très fugaces. Si les aménagements repérés reflètent bien un certain dynamisme sur le site du Clot à cette époque, celui-ci est extrêmement difficile à quantifier et à qualifier. Les structures et leurs contenus suggèrent la proximité d'un habitat mais ne permettent pas d'en définir les caractéristiques. Ces structures, par leur seule présence, montrent tout de même une certaine continuité dans l'utilisation des lieux.
- - 122
Fig.90 - Le Clot : plan de répartition des structures datables du Bronze final ou du premier âge du Fer.
- - 123
LES STRUCTURES MAL DATEES ET NON DATABLES. Dans ce chapitre, qui intéresse près d'une cinquantaine d'aménagements en creux, nous présenterons de manière succincte mais à l'aide d'exemples quelques unes des structures, et leur contenu qui ne peuvent être périodisés ou dont la datation reste imprécise. Ces dernières ayant livré du mobilier céramique, celui-ci fera l'objet d'une présentation générale en fin de paragraphe. LES STRUCTURES DU BRONZE FINAL OU DU PREMIER AGE DU FER Vingt-quatre structures sont attribuables aux dernières phases d'occupation du site, mais une datation plus précise que celle du Bronze final ou premier âge du Fer apparaîtrait comme peu fondée. Dispersés sur presque toute la surface investie, ces aménagements comprennent une quinzaine de fosses, dont 4 réduites à une nappe de vestiges, et 8 trous de poteaux (fig.90). Les fosses et nappes de vestiges Rarement conservées sur plus de 0,20 m de profondeur, les fosses présentent en surface des plans plus ou moins circulaires. Les dimensions fournies par la répartition des différents vestiges qu'elles recelaient sont assez variables, de l'ordre de 0,50 m de diamètre pour les plus petites et aux alentours d'un mètre pour les plus grandes (fig.62 et 91). A l'exception de st.1001, les remplissages observés sont très homogènes et témoignent d'un comblement unique de nature détritique. Ils se composent généralement de débris divers (tessons de céramiques, esquilles d'ossements brûlés, galets parfois chauffés,...) dispersés dans un sédiment peu charbonneux. Le remplissage de la fosse 1001 montre toutefois une stratification (fig.91, n°3) qui indique au moins deux apports successifs de nature différente. La couche supérieure recelait de nombreux tessons de céramiques alors que le fond de la fosse n'était comblé que par un sédiment très charbonneux, vidange probable de résidus de combustion. Le comblement de la fosse 1103, également bien pourvu en débris de céramiques, contenait de nombreux fragments de terre cuite parmi lesquels se trouvaient des éléments de paroi au profil concave, comportant une coulée de bronze de 3 à 4 cm d'épaisseur (fig.92). Ces vestiges, ainsi que la présence de quelques gouttelettes de bronze fondu, constituent à l'évidence le témoignage d'une activité métallurgique sur le site au cours d'une des phases d'occupation protohistorique.
- - 124
Fig.91 - Le Clot : quelques exemples de fosses du Bronze final ou du premier âge du Fer.
1. st.1129; 2. st.1095; 3. st.1001; 4. st.1078.
- - 125
Fig.92 - Le Clot : élément de paroi en terre cuite
provenant de la structure 1103. Hormis ces quelques témoins d'activités spécialisées, les autres éléments recueillis dans les différentes structures ne présentent aucun caractère particulier. Il s'agit principalement de détritus d'origine domestique, en particulier des céramiques usagées. En dépit d'une certaine abondance et de quelques formes complètes, ce matériel ne comporte pas de critères suffisamment spécifiques pour une attribution chronologique précise. D'autre part, l'homogénéité de certains ensembles céramiques - tel que celui issu de la fosse 1103 (fig.93) - semble douteuse. L'existence d'occupations protohistoriques relativement rapprochées peut évidemment contribuer à cet état. Au total, 12 structures ont livré des pièces identifiables, avec :
St.1103 - une jatte bi-tronconique à bord aplani (fig.93, n°1), présentant un décor composé
de méandres symétriques incisés au double trait, sur la partie supérieure. Cette forme connue au Bf3a est omniprésente au Bf3b. Dans la région, ces vases sont souvent décorés sur leur partie supérieure d'incisions zoomorphes, méandres symétriques, triangles hachurés, chevrons, cannelures ou impressions fines. Ils sont plus rarement le support de décors pointillés13. Ce type de jatte, support de décor incisé en méandres symétriques, admet une large répartition géographique : on le retrouve en effet en Provence, Languedoc oriental et occidental, Centre-Ouest, Charente, Périgord, Quercy.
13Séguier 1989, pl.29, n°1 à 13.
- - 126
- un gobelet ou petite urne à carène vive (fig.93, n°2) et pied bas. Une ligne de pointillés obliques disposée sur la carène est accompagnée de pendentifs composés de trois lignes pointillées verticales. Ce type de décor se retrouve dans le sud de l'Albigeois à Gourjade dans les sépultures T1 et T2 mais également dans le Bf3b de Berniquaut14. Il est aussi très présent dans le premier âge du Fer local.
- une jatte bi-tronconique (fig.93, n°3), - une jatte à paroi arrondie (fig.93, n°4), - 3 plats tronconiques comportant des perforations sous le bord (fig.93, n°6, 7 et
11), - 8 plats tronconiques (fig.93, n°5, 8, 9, 10, 12, 13, 18 et 19) dont un (le n°19), à
degrés internes, - 3 fonds plats(fig.93, n°14, 15 et 17), - un fragment de bord de petit bol (fig.93, n°16).
St.1086 - un élément de panse arrondie à décor d'impressions verticales au bâtonnet sur le
changement de direction (fig.94, n°1), - un fragment muni d'un cordon digité (fig.94, n°2), - un fragment de grand vase à col droit légèrement concave (fig.94, n°3), portant un
cordon digité sur le départ de la panse, - une grande jarre à col droit et profil sinueux portant un cordon digité peu épais
sur le départ de la panse (fig.94, n°4), - 2 plats à lèvre aplanie (fig.94, n°5 et 6).
St.1001 - un bord aminci de plat tronconique (fig.95, n°1), - un pied bas (fig.95, n°2), - un fond bombé (fig.95, n°3), - un fond plat de grand vase (fig.95, n°4).
St.1028 - 3 bords droits (fig.95, n°6 à 8), dont un d'un petit vase. - un plat tronconique à lèvre en méplat et larges degrés internes (fig.95, n°9).
St.1095 - un fragment de bord d'urne à lèvre déjetée à facette (fig.95, n°11), - un fragment de bord déjeté de gobelet ou de petite urne (fig.95, n°12), - un fragment de bord droit épais (fig.95, n°13), - un fragment de gobelet ou de petite urne à col et panse arrondie, et ligne
d'impressions à la cordelette placée à la jonction col-panse (fig.95, n°14), - un tesson à cordon digité et impressions en spirale situé à la jonction col-panse
(fig.95, n°9), - un fragment de cordon lisse (fig.95, n°10).
St.1142 - une jatte à profil arrondi, bord rentrant et pied bas (fig.96, n°1). Ce type de forme
se rencontre à la Traytié, la Génibrette (T2)15. Cette forme est connue au Bf3b local, dans les niveaux 4 et 5 de Pech Egos 3, on la retrouve et elle connaît un bon développement au premier âge du Fer (couche 1b de la Garenne)16.
- 2 fragments de bords déjetés à double facette appartenant à des gobelets ou petites urnes (fig.96, n°2 et 3),
- 2 gobelets ou petites urnes à bord déjeté à double facette, panse arrondie portant un décor de cannelures larges (fig.96, n°4 et 6). On retrouve successivement cette
14Séguier 1989, pl.22 n°3 et 6; pl.21 n°3. 15Séguier 1989, pl.25 n°6. 16Carozza 1991.
- - 127
forme à La Traytié (sépulture T6), à Cordouls mais avec un décor pointillé. Le décor de cannelures est bien attesté à Berniquaut. Elle rappelle également une urne de La Gaye à Fréjeville, attribué à une phase ancienne du premier âge du Fer, ou encore du matériel de Gabor17. Cette forme, peu fréquente dans le groupe Mailhac I, se retrouve cependant dans la vallée de l'Aveyron, par exemple à la grotte de La Garenne.
- un fragment d'épaulement d'urne à col décoré de cannelures larges (fig.96, n°5). Cette forme est fréquente au Bf3b notamment à Berniquaut18, on la retrouve également dans les horizons anciens du Pech Egos, Chantier 119.
St.1129 - un fragment d'urne à panse arrondie portant une ligne d'impressions obliques au
bâtonnet sur le départ de la panse (fig.96, n°7), - un bord facetté de plat tronconique (fig.96, n°8), - un fragment d'écuelle à degrés internes (fig.96, n°9), - un fragment de vase à panse arrondie décorée d'impressions courtes horizontales
(fig.96, n°10), - un grand vase à col droit et panse arrondie, lèvre digitée et cordon digité placé à
la jonction col-panse (fig.96, n°11). St.1022
- 2 fragments de bords arrondis (fig.97, n°7 et 8), - un fragment de petit vase à bord déjeté portant une cannelure (fig.97, n°9), - un fond plat de vase à paroi arrondie (fig.97, n°10), - un fragment portant un cordon décoré d'incisions verticales espacées (fig.97,
n°11), - un fragment de panse muni d'un cordon à impressions au bâtonnet (fig.97, n°12).
St.1024 - un col droit d'urne à panse probablement arrondie et lèvre aplanie vers l'extérieur
(fig.97, n°1). Un décor de 4 cannelures verticales groupées est situé sous la lèvre. On rencontre ce type de décor depuis le B2-3a à Cordouls à Puylaurens, par exemple20, mais également sur l'épaulement d'une jatte à Berniquaut à Sorèze ou sur le col d'une urne de Gourjade. On le retrouve également bien développé en Languedoc, notamment à Las Fados, il est connu à Forton comme à Lansargues21.
- un bord facetté de plat tronconique (fig.97, n°2). St.1089
- un fragment muni d'un cordon digité sur départ de la panse (fig.97, n°3), - un fond plat (fig.97, n°4), - 2 fragment de bords droits arrondis (fig.97, n°5 et 6).
St.1078 - un cordon digité à la jonction col-panse (fig.98, n°1), - un fragment portant une série de boutons accolés sur une carène douce (fig.98,
n°2), - un bord déjeté de petit vase (fig.98, n°3), - 3 fonds plats (fig.98, n°4 à 6), - un fragment de grand vase à bord droit aplani comportant une languette épaisse
sous le bord (fig.98, n°7). Cet élément semble intrusif dans ce contexte.
17Séguier 1989, pl.19 n°7, pl.25 n°6, pl.38 n°11 et pl.45 n°12. 18Séguier 1989. 19Carozza 1991, pl.55 n°8. 20Séguier 1989. 21Séguier 1989.
- - 130
Fig.95 - Le Clot : céramiques du Bronze final ou du premier âge du Fer. 1 à 4. st.1001; 5 à 8. st.1028; 9 à 14. st.1095.
- - 131
Fig.96 - Le Clot : céramiques du Bronze final ou du premier âge du Fer. 1 à 6. st.1142; 7 à 10. st.1129.
- - 132
Fig.97 - Le Clot : céramiques du Bronze final ou du premier âge du Fer. 1,2. st.1024; 3 à 6. st.1089; 7 à 12. st.1022
- - 134
Les trous de poteaux Cinq de ces aménagements22, regroupés à l'est du bâtiment du Bronze final (fig.90), pourraient signaler la présence d'une autre construction. Les écartements sont cependant trop importants pour permettre une restitution complète du plan au sol. Deux autres - st.1026 et st.1027- ne sont distants que de 2 mètres, et le trou 1133 est isolé en bordure occidentale du décapage. Leur morphologie est inconnue, la plupart des creusements n'étant pas discernables. Leur emplacement est signalés, soit par des petites concentrations de charbons et de terre cuite, soit par la présence d'éléments de calage ou de soutien (fig.100), parmi lesquels figurent des meules usagées (fig.99). Quelques tessons de céramiques ont également été retrouvés en association dans tous ces aménagements, mais les éléments restituables, peu nombreux, sont difficilement attribuables à une des phases d'occupation protohistorique du site.
Fig.99 - Le Clot : une meule usagée utilisée comme élément de calage dans le trou de poteau 1027.
22st.1050, st.1051, st.1052, st.1073 et st.1076.
- - 135
Fig.100 - Le Clot : le trou de poteau 1073. (cliché: O.Dayrens, S.Pons)
Fig.101 - Le Clot : le trou de poteau 1072.
(cliché: O.Dayrens, S.Pons)
- - 137
LES STRUCTURES NON DATABLES Au nombre de 28, ces structures sont également disséminées sur toute la surface fouillée. La pauvreté et l'indigence du mobilier découvert en association ne permet pas de les inscrire dans une des phases d'occupation du site. Parmi ces aménagements, les trous de poteaux comptent le plus grand nombre de structures indatables, avec 16 exemplaires. A l'instar de la plupart de ces structures décelées sur le site, leur morphologie exacte est inconnue. Repérés grâce à la présence, dans leur comblement, de résidus de combustion (charbons, terre rubéfiée) ou d'éléments de calage (galets), aucun mobilier céramique n'est associé à ces aménagements. Leur répartition (fig.102) ne met en valeur aucun plan cohérent. Ils sont souvent isolés ou très distants les uns des autres. Des petits groupes inorganisés sont toutefois perceptibles, notamment à proximité de l'hypothétique habitation du Bronze final. Les fosses non datables sont très mal conservées. Ces structures, 9 au total, ne présentent en général plus que leur base23, voire une simple étalement de vestiges24. Les exemplaires les mieux conservés affectent des formes circulaires d'un diamètre approximatif compris entre 0,60 et 1 m, leur profondeur ne dépassant pas 0,25 m. Pour la majorité d'entre eux, le sédiment de remplissage comprend des restes de terre cuite, le plus souvent sous forme de petits nodules mais parfois de taille plus importante. Ainsi, la structure 1169 recelait un fragment de sole épais de 5 cm et perforé de quatre trous régulièrement espacés (fig.103, n°3). Ces soles perforées, qui appartiennent généralement à des fours plus complexes que ceux à sole pleine, sont connus dès le Bronze final, où ils sont en principe utilisés pour la production de céramiques25. La structure 1141 a également livré des objets en terre cuite utilisés dans la cuisson. Il s'agit d'une dizaine de tores (fig.103, n°1,2 et fig.104) et de bourrelets peu cuits mais ayant manifestement servi avant d'être rejetés dans cette fosse. Ces éléments, qui présentent une section circulaire, ont un diamètre assez constant autour de 0,10 m. Ils sont souvent considérés comme des cales employées pour la cuisson des poteries. Le remplissage de la structure 1136 présentait une autre particularité. Il était composé dans sa totalité de blocs de granit plus ou moins érodés parmi lesquels des fragments de meules ont été reconnus. Enfin, nous citerons pour mémoire la présence de 4 structures de combustion26 à galets chauffés, trop perturbées pour donner une idée de leur morphologie et par conséquent de leur chronologie.
23st.1058, st.1113, st.1136, st.1141 et st.1169 24st.1034, st.1039, st.1047 et st.1134. 25Audouze, Buchsenschutz 1989, pp.175-177. 26st. 1020, st.1048, st.1112 et st.1135.
- - 138
Fig.103 - Le Clot : Objets en terre cuite. 1,2. st.1141; 3. st.1169.
Fig.104 - Le Clot : la structure 1136. (cliché O.Dayrens, S.Pons)
- - 139
CONCLUSION GENERALE
______ En dépit d'une médiocre conservation des différentes occupations rendant délicate l'approche spatiale du site, les apports de cette opération sont nombreux et fournissent une importante documentation sur les habitats de plein air, notamment en ce qui concerne la protohistoire. La fouille d'un habitat de plein air protohistorique, réalisée sur une grande superficie, est par ailleurs un fait novateur qui dépasse le cadre régional. Loin de combler la carence dans ce domaine, ce type d'habitat restant mal connu, les aménagements en creux décelés sur le site du Clot sont autant de témoignages supplémentaires sur l'implantation humaine au cours du Bronze final et du premier âge du Fer. Bien que l'organisation de l'habitat n'ait pu être précisée pour aucune des phases d'occupation du site, faute d'une meilleure conservation des vestiges, certains caractères originaux ont pu être dégagés, avec notamment la mise en évidence de constructions. Ces témoins architecturaux, souvent soupçonnés mais rarement vérifiés, sont en effet quasiment méconnus dans la région. En ce qui concerne l'aspect mobilier, les informations fournies par les ensembles clos issus des structures en creux sont conséquentes et devraient contribuer utilement à une meilleure connaissance de la dynamique chronologique et culturelle de ces périodes. Enfin, au chapitre de la préhistoire récente, l'occupation vérazienne du site est un élément important. Ce groupe est en effet peu représenté sur le versant nord de la Montagne Noire et les quelques sites de plein air connus dans la région ont rarement fait l'objet d'une fouille extensive.
- - 143
FICHE SIGNALÉTIQUE
IDENTITÉ DU SITE Site n° : 81 065 126 Département : Tarn Commune : Castres Lieu-dit : Lacaze Haute. Cadastre : Année : 1970 (mise à jour 1983) Section et parcelle : Section E.O, parcelles 98a et 101. Coordonnées Lambert : Zone III Abscisse : 591,140 Ordonnée : 3142,820 Altitude : 174. Propriétaire du terrain : DDE Tarn. Protection juridique : Néant
OPERATION ARCHEOLOGIQUE Autorisation n° : 100/94 valable du 13/6/94 au 31/12/94 Titulaire : F.PONS - 1, allée du Lot, Colomiers 31770 Organisme de rattachement : AFAN Raison de l'urgence : Tracé de la rocade sud de Castres. Section centrale, 1er tronçon. Maître d'ouvrage des travaux : DDE Tarn Surface fouillée : 200 m² Surface estimée du site : 50 m².
RÉSULTATS Mots-clefs (thésaurus DRACAR pour la chronologie et les vestiges immobiliers): - sur la chronologie : BRF. - sur la nature des vestiges immobiliers : ?. - sur la nature des vestiges mobiliers : céramiques, ossements faunes, métal. Notice sur la problématique de la recherche et les principaux résultats de l'opération archéologique : Petite aire isolée (zone de rejet), liée à un habitat du Bronze final 2. Lieu de dépôt provisoire du mobilier archéologique : CERAC. Domaine de Gourjade. Castres(Tarn).
- - 145
LOCALISATION ET ENVIRONNEMENT
______
Le site de Lacaze Haute se situe sur le territoire de la commune de Castres, à une centaine de mètres au sud-ouest du hameau du même nom (fig.1). Distant d'environ 600 mètres du site du Clot, il est implanté au pied d'un petit coteau (altitude : 174 m) sur lequel est établi le hameau de Lacaze Haute (fig.2). Cette situation, plus élevée que celle du site du Clot et plus éloignée du cours de la rivière Agout, entraîne quelques changements d'ordre géologique et pédologique, l'environnement immédiat étant le même. En effet, la stratigraphie locale présente un substratum calcaire recouvert d'une couche superficielle de molasse sur laquelle se développe un sol très argileux, épais en moyenne de 0,50 m. C'est au sein de cette formation qu'apparaît le niveau archéologique, à la base des labours, soit à une trentaine de centimètres de profondeur. Il se présente sous la forme d'une nappe de vestiges d'environ 45 m², riche en minuscules charbons de bois, ce qui donne au sédiment argileux une coloration brune sur une épaisseur maximale de 0,30 m. La base de cette couche, qui signale la présence d'une petite dépression naturelle, repose sur une fine strate épaisse d'environ 5 cm, extrêmement riche en mollusques (c.3). Cette concentration de vestiges peut témoigner d'une phase relativement humide, ou plus simplement d'une zone anciennement marécageuse, ces terrains étant encore de nos jours très mal drainés et relativement humides une bonne partie de l'année. Cette petite aire, qui a fourni un mobilier attribuable au Bronze final 2, semble totalement isolée. Les sondages d'évaluation pratiqués en périphérie, complétés par un décapage extensif lors de l'opération de fouille, n'ont en effet révélé aucune extension du site1 .
1Catalo, Rayssiguier, 1993.
- - 147
Fig.2 - Lacaze Haute : localisation cadastrale du site. (Castres, section E.O, mis à jour 1983).
- - 148
METHODE DE FOUILLE
______
Afin de vérifier l'étendue du site, une surface de plus de 200 m² a été décapée mécaniquement, à partir du sondage d'évaluation (fig.3) qui avait déjà mis à nu la quasi-totalité de la surface à fouiller. Interprétée alors comme une petite aire d'occupation, celle-ci semblait totalement isolée et n'excédait pas une cinquantaine de mètres carré. L'extension des décapages a confirmé cette situation. La couche archéologique ne présentant aucun indice d'organisation visible et ses limites étant peu discernables, les vestiges qu'elle contenait ont fait l'objet d'un prélèvement par quart de mètre carré et par passes successives d'environ 3 cm d'épaisseur. Ponctuellement, lorsque des niveaux bien différenciés apparaissaient, des relevés à l'échelle 1/10ème ont été effectués. Deux coupes, traversant le site d'ouest en est et du nord vers le sud, ont été également levées d'après les sondages qui avaient entamé le substrat molassique.
Fig.3 - Lacaze Haute : plan général des fouilles.
- - 149
PRINCIPAUX RESULTATS
______
DESCRIPTION ET ESSAI D'INTERPRETATION La nappe de vestiges mise au jour à Lacaze Haute occupe une aire sensiblement ovalaire (fig.4) qui correspond à l'emplacement d'une légère dépression naturelle (fig.5 et 6). Les témoins, répartis sur une trentaine de centimètres d'épaisseur au maximum, comprennent de nombreux tessons épars, et quelques fragments osseux de faune à la base. Des charbons de bois, le plus souvent à l'état de traces, ainsi que des nodules de terre cuite, très érodés et de dimensions inférieures à 0,5 cm de côté, étaient également dispersés dans toute l'épaisseur de cette couche. La céramique, qui constitue donc l'essentiel du mobilier recueilli, se caractérise par une très grande fragmentation et des cassures émoussées. Les rares liaisons, qui ont pu être effectuées par collage de tessons jointifs, se limitent à quelques remontages de proximité immédiate, ne mettant aucune stratigraphie en évidence. Le plan de répartition de ces vestiges, réalisé d'après les décomptes effectués par quart de mètre carré, montre toutefois deux zones à forte densité (fig.4) : une petite concentration de mobilier sur 0,50 m² dans le carré B1, et une autre plus importante qui s'étend sur environ 2 m² (carrés D,E,F.2,3). Les limites de ces deux ensembles sont cependant très diffuses. En outre, la disposition du mobilier n'indique aucun effet de paroi, pouvant correspondre au comblement d'une éventuelle structure en creux. Si la conservation de ces vestiges est probablement à mettre en relation avec la présence d'une légère dépression du substrat molassique ("chenal" comblé), en revanche les modalités de leur dépôt restent incertaines. L'hypothèse d'une zone de rejet, située en marge d'un habitat qui n'aurait laissé aucune autre trace, peut bien entendu être envisagée. Mais les vestiges découverts, qui correspondent indéniablement à des détritus, montrent d'importantes traces d'érosion pouvant résulter d'un séjour en milieu humide. En effet, outre des cassures émoussées, on note des dépôts de manganèse et de légers concrétionnements plaqués sur les surfaces. De façon plus significative encore, des nodules de terre cuite sont entièrement recouverts d'une gangue de teinte brunâtre, résultant de la précipitation du manganèse en solution. Au vue de ces quelques observations, il est donc permis d'entrevoir un dépôt dans une zone probablement palustre à l'origine, ce que confirmera peut-être la détermination des différentes espèces de mollusques2 repérées à la base de la couche. En tout état de cause, cette nappe de vestiges ne peut être assimilée à un comblement d'une quelconque structure en creux.
2Etude malacologique en cours.
- - 150
Fig.4 - Lacaze Haute : répartition du mobilier. Les ossements fauniques, pris en compte dans ce graphisme, sont présents dans toutes les
zones ou la densité des tessons de céramiques est supérieure à 25/m².
- - 152
LE MOBILIER Exceptés deux anneaux en bronze (fig.7), dont un de facture moderne, le matériel issu de cette petite aire comprend quelques ossements fauniques et surtout de la céramique.
Fig.7 - Lacaze Haute : mobilier métallique. LA FAUNE Parmi les quelques vestiges fauniques recueillis, seuls 23 % ont pu être déterminés3. La quasi-totalité des fragments non identifiés mesurent moins de 3 cm. Quatre groupes sont représentés : le boeuf, les suidés (porc), les ovicaprinés (moutons et chèvre) et les cervidés (cerf). Parmi ceux-ci les restes de porcs sont les plus nombreux. Le cerf, espèce qui relève de la chasse, est surtout signalé par des fragments de bois, dont un "sceau", base caractéristique d'un bois de chute. L'âge de mortalité des espèces domestiques, juvéniles ou jeunes adultes, correspond au stade de meilleure qualité de la viande. On notera également la présence de coquillages marins4 avec un fragments d'huître (Ostrea edulis lamellosa) et une valve de coque (Cerastoderma edule (L.)).
3Détermination : V.Forest (Docteur vétérinaire-Zoologue). 4Détermination : F.Brien-Poitevin.
- - 151
Il ressort de l'étude de la faune, malgré l'extrême pauvreté du matériel, des indices caractérisant la population à l'origine des restes : éleveurs polyvalents d'ovicaprinés, de porc et de boeuf qu'ils abattent au meilleur âge boucher, occasionnellement chasseurs de cerf dont ils ramassent également les bois de chute. LA CERAMIQUE Le mobilier céramique, qui compte près de 4000 tessons, est extrêmement morcelée, la majorité des tessons n'excédant pas 3 à 4 cm de côté. Cet état, conjugué à l'altération des cassures, n'a évidemment pas permis la restitution de formes complètes (fig.8 et 9), et rend difficile une estimation du nombre de vases représenté. Si le lot de céramique issu de ce dépôt semble homogène, il convient tout de même de rappeler la présence parmi ce matériel d'un fragment de bague de facture moderne (fig.9), ainsi que quelques débris de tuile romaine provenant des niveaux supérieurs. Description du mobilier
Les bords de plats tronconiques sont nombreux - au moins 22 individus - et dominés par des types à facettes, simples ou multiples (fig.8, n°8 à 30 par exemple). Les lèvres cannelées sont représentées mais plus rares, avec seulement 10 individus (fig.8, n°33 par exemple). Les bords de petits bols sont simplement aplanis ou biseautés (fig.9, n°38 à 43 par exemple). Dix éléments de formes représentent des plats décorés intérieurement : cinq d'entre-eux portent de fines cannelures groupées (fig.8, n°35 à 37, 40 et 41), quatre des gradins internes (fig.8, n°36, 37, 40 et 41), et deux possèdent un décor de guirlandes cannelées (fig.8, n°38, 39, 42 et 45). Les fonds, peu fréquents, peuvent être ombiliqués (fig.8, n°47), ou plats (fig. n°46, 48 et 49). Les gobelets sont représentés par de petits bords déjetés, facettés ou cannelés (fig.9, n°1 à 8). Sept bords largement déjetés appartiennent à de petites urnes à facette concave (fig.9, n°9 par exemple) ou avec plusieurs cannelures jointes (fig.9, n°16). Les décors se composent en majorité de cannelures jointes au-dessus d'une carène vive (fig.9, n°17, 19, 20 à 24). Une carène débordante porte de fines cannelures en torsades (fig.9, n°29). On trouve également sur un élément de panse des chevrons réalisés par des incisions profondes (fig.9, n°30). Deux bords portent des digitations sur la lèvre (fig.9, n°35 et 36). Enfin, il existe trois éléments de préhension : deux anses aplanies (fig.9, n°31 et 32), et un départ d'anse ou de mamelon (fig.9, n°34). Un élément de forme reste indéterminé (fig.9, n°33), petit pied ou tenon?
- - 154
Attribution chronologique
La série céramique se singularise par la présence de bords ouvragés - cannelures multiples ou facetages - et d'éléments de formes anguleuses. Parmi les éléments décoratifs, on note la présence de plats ornés de cannelures en ove, de cannelures en torsade, ou de cannelures qui dessinent des triangles. Certains de ces éléments peuvent se rapprocher de séries céramiques issues de l'Albigeois ou du versant sud de la Montagne Noire. Les cannelures en ove se rencontrent à la grotte de la Pyramide (Penne, Tarn), dans les grottes de Buffens (Caunes-Minervois, Aude) et du Gaougnas (Cabrespine, Aude) ou dans la fosse de la Gravette (Cavanac, Aude). Les cannelures en forme de triangle ont été également identifiées sur les sites de la Gravette ou de Buffens (Aude). Ces caractères peuvent être attribués au Bronze final 2. Les cannelures en torsade ornent le plus souvent des jattes à épaulement. On trouve ce type de récipient dans les séries Bronze final 2 du midi de la France.
- - 155
LE CONTEXTE REGIONAL : ETAT DE LA QUESTION
Cette phase du Bronze final, apparemment bien définie, est illustrée par de nombreux mobiliers le plus le souvent issus de grottes. Ces sites ont rarement livré des milieux homogènes ou des stratigraphies. Les ensembles clos disponibles sont donc peu nombreux, ce qui confère à la série de Lacaze Haute une importance toute particulière. En Languedoc, on peut citer les fosses du Baous de la Salle à Bize ou de la Gravette à Cavanac. En Albigeois, les séries proviennent également des grottes, comme celles de la Pyramide ou de la Garenne à Penne. Seul un habitat de plein air, Berniquaut à Sorèze5, a livré des céramiques du Bronze final 2, malheureusement hors contexte. Le Quercy et sa multitude de réseaux karstiques est riche en témoins céramiques. En Albigeois comme en Languedoc, le Bronze final 2 est marqué par la présence d'influences orientales. En Albigeois, les éléments céramiques se rapportant à ce courant sont principalement des jattes surbaissées ornées de cannelures verticales, telles qu'on les trouve à la grotte de la Borie-Basse à Livers-Cazelles ou à la grotte de la Pyramide à Penne6. Si l'on consulte les ensembles de référence, ce type de récipient peut être rapporté au Bronze final 2a ou 2b7. D'autres types de caractères correspondent à des influences orientales. Il s'agit de plats segmentés ou de décors au peigne (grotte de la Borie-Basse). En Languedoc, les séries céramiques de la Cauna de Martrou9 ou celles du Roc de Conilhac8, jugées comme les plus anciennes du Bronze final 2, n'ont pas livré d'éléments attribuables à ce courant d'influence. En revanche, certains caractères présents dans ces séries peuvent désigner des apports méditerranéens, peut-être ligures. Sur le versant sud de la Montagne Noire ou dans le bassin de l'Aude, des apports de type France orientale sont néanmoins perceptibles. Ils se caractérisent par exemple par des formes telles que les vases à piédestal ou des décors cannelés géométriques (grotte du Gaougnas à Cabrespine ou la fosse du Baous de la Salle à Bize). Au regard de cette diversité, il nous semble délicat de fonder une césure chronologique au sein du Bronze final 2 sur la seule présence de ces caractères typologiques. La distinction entre une phase 2a et 2b du Bronze final suppose que l'on puisse clairement identifier dans le temps comme dans l'espace les caractères de type continental. Des attributs novateurs - tels les doubles lignes, non pas incisées mais finement incurvées réalisées au brunissoir - figurent dans un grand nombre de ces séries. Il sont souvent associés à des formes ou des décors de tradition Bronze final 2. Sur le site de la Gravette à Cavanac (fouille J. Vaquer, G. Rancoule, M. Passelac) on note, dans un
5Séguier 1989. 6Carozza 1991. 7Vital 1991. 9Gascó 1983. 8Guy 1950.
- - 156
ensemble homogène, l'association de récipients d'influence orientale - vases à piédestal ornés de fines cannelures obliques - à des formes à épaulement ou carénées, parfois décorées de doubles lignes horizontales. Ce type d'association est fréquent dans les ensembles issus des grottes. Il est notamment représenté par le groupement de cannelures en torsade et de décors linéaires ou en méandre sur un même vase (Buffens). Cela pourrait indiquer que les caractères typologiques d'influence continentale se développent dans le temps au-delà du Bronze final 2.
- - 159
FICHE SIGNALÉTIQUE
IDENTITÉ DU SITE Site n° : 81 065 127 Département : Tarn Commune : Castres Lieux-dits : Les Barradières. Cadastre : Année : 1970 (mise à jour en 1983) Section et parcelles : Section D, feuille n° 1, parcelle 48. Coordonnées Lambert : Zone III Abscisse :592,600 Ordonnée : 3142,820 Altitude : 190. Propriétaire du terrain : DDE Tarn. Protection juridique : Néant
OPERATION ARCHEOLOGIQUE Autorisation n° : 100/94 valable du 13/6/94 au 31/12/94 Titulaire : F.PONS - 1, allée du Lot, Colomiers 31770 Organisme de rattachement : AFAN Raison de l'urgence : Tracé de la rocade sud de Castres. Section centrale, 1er tronçon. Maître d'ouvrage des travaux : DDE Tarn Surface fouillée : 2000 m² Surface estimée du site : 1200 m² au minimum.
RÉSULTATS Mots-clefs (thésaurus DRACAR pour la chronologie et les vestiges immobiliers): - sur la chronologie : BRF, FE1. - sur la nature des vestiges immobiliers : FOS, TRO. - sur la nature des vestiges mobiliers : céramiques, lithiques. Notice sur la problématique de la recherche et les principaux résultats de l'opération archéologique Occupation protohistorique de type habitat signalée par des structures de maintien vertical mettant en valeur les plans de deux petites constructions datées par le mobilier retrouvé en association, du Bronze final 3b/premier âge du Fer. Lieu de dépôt provisoire du mobilier archéologique : CERAC. Domaine de Gourjade. Castres(Tarn).
- - 161
LOCALISATION ET ENVIRONNEMENT
______
Le site des Barradières se situe sur le territoire de la commune de Castres (Tarn), à environ 2,5 kilomètres au sud de la ville (fig.1). Le gisement se développe sur le versant sud d'un coteau molassique, entre 189 et 195 mètres d'altitude. Il présente une déclivité régulière (fig.4) assez prononcée1, jusqu'en bordure de la terrasse inférieure de la rive droite du Thoré, affluent de l'Agout. La stratigraphie locale se compose d'un niveau de molasses sableuses entrecoupées de bancs calcaires plus ou moins gréseux. Sur cette formation se développe un sol argilo-marneux dont l'épaisseur évolue entre 0,30 à 0,80 m. Le niveau archéologique découvert apparaît au sein de cette couverture sédimentaire, à la base des labours, entre 0,30 à 0,50 m de profondeur. Il se présente sous la forme de concentrations de vestiges céramiques et/ou lithiques signalant pour la plupart l'emplacement de structures en creux. Ces différents aménagements se repartissent sur une surface totale de 1200 m². L'étendue du gisement, qui a pu être cernée à l'ouest, à l'est et au nord, reste toutefois inconnue vers le sud, au delà de l'emprise des travaux.
Fig.2 - Les Barradières : vue du site depuis la départementale 60. (Cliché: O.Dayrens, S.Pons)
1De l'ordre de 6 %.
- - 163
TAPHONOMIE DU SITE ET METHODOLOGIE
______
Afin de localiser le plus rapidement possible les témoins d'occupations protohistoriques, la surface concernée fut décapée mécaniquement avec une marge de sécurité d'au moins 10 mètres d'après les derniers vestiges rencontrés. Ce décapage fut complété à l'est et au nord-ouest par des sondages complémentaires couvrant une surface totale d'environ 400 m² (fig.4). Seul le sondage est a révélé la présence de structures mais d'époque nettement plus récente, liées à des travaux d'assainissement : deux drains (fig.4). A l'instar des structures découvertes au "Clot", les témoins d'occupation mis au jour sur ce site présentent un très mauvais état de conservation. Outre les pratiques culturales (labours profonds) qui ont définitivement démantelé les niveaux de surface originels, la texture du sédiment cumulée à un important effet de pente a favorisé le colluvionnement et le lessivage des sols. La présence diffuse sur l'ensemble du gisement d'un mobilier céramique très fragmenté et fortement érodé signale ce phénomène, dont les effets ont pu être observés lors d'importantes précipitations intervenues durant la fouille. Seuls des éléments "lourds"2 de structures en creux suffisamment profondes ont finalement résisté à ces actions naturelles et anthropiques. Ils s'agit principalement de blocs de calages appartenant à des structures de maintien vertical (fig.5), dont les creusements n'ont par ailleurs pu être observés. En effet, la similitude entre le sédiment de remplissage et celui de l'encaissant empêche toute distinction stratigraphique. Aussi seule une fouille minutieuse et un relevé systématique des vestiges mobiliers ont permis de mieux cerner ces différents témoins d'occupation.
2Les lessivages des sols et les effets physico-chimiques expliquent également l'absence totale d'éléments organiques, légers et fragiles, tels que faune, charbons, graines, etc, ...
- - 165
LES TEMOINS D'OCCUPATION PROTOHISTORIQUE
______
LES STRUCTURES DE MAINTIEN VERTICAL Outre quelques pierres isolées, la fouille a révélé une quinzaine de petites concentrations de blocs attribuables ou assimilables à des éléments de calage de structures de maintien vertical (fig.7 et 8). Ces blocs, en majorité des grès3 dont les dimensions n'excèdent pas 35 cm de long pour 25 cm de large, sont généralement posés de chant et présentent un pendage important. Disposés de façon plus ou moins concentrique sur une seule assise, ils ménagent le plus souvent un espace central dont aucun diamètre ne peut raisonnablement être restitué. Certains ont manifestement subi des bouleversements qui peuvent être imputables à l'arrachage des poteaux. Les plans fournis par la répartition de onze de ces aménagements permettent d'entrevoir la présence de deux petites constructions : bâtiments 1 et 2 (fig.11 et 12). Implantées à proximité l'une de l'autre et selon une même orientation nord/sud, ces deux plans sont définis respectivement par l'association de 6 et 5 structures de maintien (fig.6).
Bâtiment N°Structure
1 3023, 3025, 3026, 3027, 3028, 3029
2 3018, 3019, 3020, 3021, 3022
Fig. 6 - Les Barradières : les associations de structure.
3Grés : 67% ; calcaire : 32% ; granit : 1%.
- - 166
Fig.7 - Les Barradières : la structure de maintien 3020. (Cliché: O.Dayrens, S.Pons)
Fig.8 - Les Barradières : la structure de maintien 3021.
(Cliché: O.Dayrens, S.Pons)
- - 167
LE BATIMENT 1 De plan rectangulaire, cette construction de 3,50 m de long sur 1,20 m de large couvre une surface au sol d'environ 4 m². Elle est formée par deux rangées parallèles de 3 structures de maintien vertical dont les écartements évoluent de 1,50 m à 2,00 m. Cette variation d'écartement permet une autre interprétation du plan de ce bâtiment avec la présence de deux petites constructions rectangulaires mitoyennes (fig.9 et 10).
Hypothèse Structure Plan Surf. Long. larg.A 3023, 3025, 3026, 3027, 3028, 3029 rectangulaire 4,20 m² 3,50 m 1,20 m
B 3023, 3025,3028, 30293025, 3026, 3027, 3028
rectangulairerectangulaire
1,80 m²2,40 m²
1,50 m2,00 m 1,20 m
Fig.9 - Les Barradières : dimensions du bâtiment 1.
Fig.10 - Les Barradières : hypothèses de plan du bâtiment 1.
- - 170
LE BATIMENT 2 Deux lectures différentes du plan de ce bâtiment sont possibles. En effet, la structure 3018 ne s'intègre pas rigoureusement dans le prolongement des alignements définis par les quatre autres calages et peut tout aussi bien appartenir à un autre aménagement. Dans le premier cas de figure, où st.3018 n'est pas associée aux autres éléments, nous serions en présence d'une petite construction rectangulaire à quatre poteaux, d'une surface au sol de 5,40 m² (fig.14, n°1). La deuxième hypothèse, prenant en compte cette structure, permet de dessiner un plan trapézoïdal d'environ 7 m² (fig.14, n°2).
Hypothèse Structure Plan Surf. Long. larg.
A 3019, 3020, 3021, 3022 rectangulaire 5,40 m² 3,00 m 1,80 m
B 3018, 3019, 3020, 3021, 3022 trapézoïdal 7,20 m² 4,90 m 1,80 m
Fig.13 - Les Barradières : dimensions du bâtiment 2.
Fig.14 - Les Barradières : hypothèse de plan du bâtiment 2.
- - 171
Malgré les différentes hypothèses énoncées, les plans restitués évoquent systématiquement des petites constructions à une nef dont la surface au sol n'excède pas 4,20 m² pour le bâtiment 1 et 7,20 m² pour le bâtiment 2 (fig.13). La profondeur maximale des éléments de calage (la profondeur réelle des structures étant inconnue), par rapport à un niveau de référence horizontal théorique, augmente régulièrement du nord vers le sud. Cette corrélation avec la topographie locale semble mettre en évidence l'absence de nivellement préalable à la construction des édifices. L'intérieur de ces bâtiments a pu cependant faire l'objet d'un apport de matériaux destiné à régulariser la surface d'occupation. Mais étant donné le plan au sol de ces édifices, leur faible superficie et leur implantation dans un milieu sensible à l'humidité, l'existence de plancher suspendu à l'image des structures de conservation de type grenier surélevé est plus vraisemblable. Réduit à quelques tessons de céramique provenant des structures 3019 et 3021 (fig.19, n°19 à 23), le mobilier associé ne permet pas de dater précisément ces ensembles. Il présente toutefois une certaine homogénéité et des caractères morphologiques et stylistiques (écuelles, gobelets, cordons à impressions digités, ...) qui permettent de l'attribuer au Bronze final 3b/premier âge du Fer au sens large.
Fig.15 - Les Barradières : vue du bâtiment 1. (Cliché: O.Dayrens, S.Pons)
- - 172
DES CONCENTRATIONS DE VESTIGES CERAMIQUES Bien que l'on rencontre des fragments de céramiques très érodés sur l'ensemble de la surface, on note quelques densités plus importantes de tessons. Disposés le plus souvent sur un seul niveau en nappes plus ou moins diffuses, la plupart de ces ensembles4 ne mettent en évidence aucune organisation permettant de définir d'éventuelles structures bouleversées. Néanmoins, leur répartition à l'extérieur des témoins de construction est systématique ce qui pourrait laisser présager l'existence d'aires de rejets en périphérie des "lieux de stockage" (fig.5). Deux petites concentrations très localisées et n'excédant pas une surface d'1m² se distinguent toutefois des autres ensembles : st.3006 et st.3032 (fig.17 et 18.). Elles présentent l'aspect d'un "tas" irrégulier formé d'un à trois niveaux de tessons de céramiques très denses. Dans les deux cas, la répartition de ces fragments montre un front sub-vertical est-ouest quasi rectiligne en ce qui concerne st.3032. Cette disposition très particulière signale à l'évidence un effet de contrainte. Un tel phénomène peut se produire au sein d'une structure en creux déjà partiellement colmatée par un dépôt sédimentaire en forme de dôme sur lequel ont été rejetés les débris de céramique. Cette hypothèse reste toutefois difficilement vérifiable en l'absence de tout autre élément significatif.
Fig.16 - Les Barradières : vue de la concentration de tessons de céramiques 3006. (Cliché: O.Dayrens, S.Pons)
4st.3013, st.3015, st.3033, st.3036 et st.3037.
- - 175
Dans toutes ces concentrations, le mobilier céramique recueilli est très fragmenté. Les rares liaisons par collage qui ont pu être effectuées (fig.17) n'ont pas permis l'identification de formes complètes (fig.19 et 20). La majorité des tessons appartiennent à de grands récipients à fond plat, souvent ornés de cordons digités disposés à la base du col (fig.19, n°7 et 10). On note également la présence de vases ouverts de type plat ou bol à bord facetté (fig.19, n°8,11; fig.20, n°2 et 10 à 12), parfois décorés de lignes d'impressions (fig.19, n°8). Un décor de chevrons incisés est aussi présent sur deux fragments (fig.20, n°18 et 22) dont un marqué par une carène (fig.20, n°18). Peu différenciés, ces quelques caractères permettent d'intégrer cette céramique dans un contexte Bronze final 3b/premier âge du Fer, sans autre précision.
- - 176
n°1. 3005 - Fragment de bord arrondi de vase ouvert. n°2. 3005 - Fragment de bord facetté ouvert de petit vase (gobelet ou petite urne). n°3. 3006 - Fragment de col haut d'urne légèrement ouvert. n°4. 3006 - Fragment de col haut d'urne légèrement ouvert. n°5. 3006 - Fragment de col haut d'urne légèrement ouvert. n°6. 3006 - Fragment d'un vase à profil arrondi muni d'un cordon à impressions ovales
au bâtonnet disposé à la jonction col-panse. n°7. 3006 - Fragment de vase muni d'un cordon digité situé à la jonction col-panse. n°8. 3006 - Fragment de plat tronconique à larges degrés internes, décoré
d'impressions digitées (ou traces de modelage) sous le bord à l'extérieur. n°9. 3006 - Fragment de vase à paroi arrondie, portant des impressions digitées. n°10. 3006 - Fragment de vase muni d'un cordon digité situé à la jonction col-panse. n°11. 3007 - Fragment de bord à facettes de plat tronconique. n°12. 3015 - Fragment de bord arrondi de vase ouvert. n°13. 3015 - Fragment de bord aplani. n°14. 3015 - Fragment de bord cannelé (deux cannelures jointes) de plat tronconique. n°15. 3015 - Fragment de plat tronconique décoré de deux cannelures jointes. n°16. 3015 - Fragment de pied bas. n°17. 3015 - Fragment de vase caréné à décor d'impressions rondes. n°18. 3015 - Fragment de fond plat. n°19. 3019 - Fragment de bord de vase ouvert de type écuelle ou bol. n°20. 3019 - Fragment de bord de vase ouvert de type écuelle ou bol. n°21. 3019 - Fragment de vase muni d'un cordon décoré d'impressions obliques
ongulées. n°22. 3021 - Fragment de bord droit arrondi. n°23. 3021 - Fragment de col et départ de panse d'un petit vase globuleux de type
gobelet ou petite urne. Il est orné de deux incisions longues placées verticalement sur la panse.
- - 178
n°1. 3013 - Fragment de lame en silex. n°2. 3013 - Fragment de bord aplani de plat tronconique. n°3. 3031 - Fragment de pied bas. n°4. 3031 - Fragment de bord arrondi d'un petit vase globuleux. n°5. 3033 - Fragment de pied bas. n°6. 3036 - Fragment de bord d'un vase ouvert de type jatte. n°7. 3036 - Fragment de vase muni d'un cordon digité en torsade. n°8. 3036 - Fragment de bord d'un vase ouvert de type jatte. n°9. 3036 - Fragment de bord d'un vase ouvert de type jatte. n°10. 3037 - Fragment de bord facetté de plat tronconique. n°11. 3037 - Fragment de bord facetté de plat tronconique muni de deux perforations. n°12. 3037 - Fragment de bord facetté de plat tronconique. n°13. 3032 - Fragment de pied bas. n°14. 3032 - Fragment d'une grande urne à col ouvert et bord aplani. n°15. 3032 - Fragment de fond plat portant des traces de doigts (modelage ou décor) sur
le départ de la panse. n°16. 3032 - Fragment de bord digité. n°17. 3032 - Fragment d'un petit vase décoré de trois cannelures jointives. n°18. 3032 - Fragment de vase caréné orné d'un décor de chevrons au double trait au
dessus de la carène. n°19. 3032 - Fragment de jatte à profil brisé et large méplat. n°20. 3032 - Fragment de vase caréné portant une ligne d'impressions au bâtonnet sur la
carène. n°21. 3032 - Fragment de vase caréné portant une ligne d'impressions au bâtonnet sur la
carène. n°22. 3032 - Fragment d'un vase décoré de chevrons au double trait. n°23. 3032 - Fragment de col ouvert. n°24. 3032 - Fragment de col ouvert d'un petit vase. n°25. 3032 - Fragment de bord aplani. n°26. 3032 - Fragment de bord d'un plat muni d'une perforation. n°27. 3032 - Fragment d'un vase à carène vive. n°28. 3032 - Fragment de vase muni d'un cordon digité situé à la jonction col-panse. n°29. 3032 - Fragment de vase muni d'un cordon digité situé à la jonction col-panse.
- - 180
UNE "STRUCTURE" INDETERMINEE : ST.3003. Isolée au sud-est du décapage, la "structure" 3003 est une masse compacte d'argile rubéfiée qui affecte une forme oblongue irrégulière de 0,75 m de long, 0,37 m de large et 0,25 d'épaisseur (fig.21). De teinte orangée sur toute son épaisseur mais tendre et friable, cette rubéfaction dénote une chaleur intense mais insuffisante pour une cuisson complète de l'argile.
Fig.21 - Les Barradières : la "structure"3003.
En l'absence de tout autre indice, la fonction de ce bloc ainsi que son origine restent difficilement déterminables. L'hypothèse d'un élément provenant d'une éventuelle structure de combustion, telle qu'un four, peut être envisagée. A l'opposé, celle du résultat d'un incendie ne peut être complètement écartée, bien que l'épaisseur rubéfiée soit considérable. En tout état de cause, dans les deux cas de figure, la combustion sur place n'aurait laissé aucune autre trace, ce qui semble peu probable. Il est plus vraisemblable qu'il s'agisse d'un élément déplacé, éventuellement rejeté dans une fosse dont le creusement reste indifférencié.
- - 181
CONCLUSION
______
Malgré la mauvaise conservation des vestiges, l'absence de liens stratigraphiques et l'imprécision des données chronologiques, les informations fournies par la fouille du site des Barradières sont loin d'être négligeables. Les occupations de plein air protohistoriques font rarement l'objet d'une intervention de ce type et restent par conséquent très mal connues dans la région. La mise en évidence de deux petites constructions de type grenier constitue l'essentiel de la documentation recueillie. Ces aménagements, dont on a pu voir un autre exemplaire daté de la fin du Bronze final sur le site du Clot, sont largement représentés durant toute la protohistoire en Europe occidentale où ils sont généralement associés aux habitats. Ils sont encore utilisés de nos jours en divers points du monde5 pour conserver des réserves alimentaires à l'abri de l'humidité et des rongeurs6 . Bien que les indices soient faibles, l'occupation du site des Barradières est probablement à mettre en relation avec une implantation humaine de proximité liée, par exemple, à l'exploitation des terrains environnants (culture, pâturage, ...).
5Audouze, Buchsenschutz 1989, p.161. 6Sigaut, 1978.
- - 182
BIBLIOGRAPHIE: Audouze, Buchsenschutz 1989 : AUDOUZE (F.), BUCHSENSCHUTZ (O.). - Villes, villages et campagnes de l'Europe celtique, Ed. Hachette, 1989, 362 p. Carozza 1991 : CAROZZA (L.). - La fin de l'âge du Bronze en pays Albigeois: échec d'une acculturation?, Mémoire de diplôme à l'Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, Toulouse 1991, 148 p., 48 fig et 144 pl. hors texte. Carozza, Gascó 1988 : CAROZZA (L.), GASCO (J.). - La céramique des habitats groupés de Penne (Tarn) à la fin de l'âge du Bronze, Peuplement et vie quotidienne depuis 100 000 ans : 10 ans d'archéologie tarnaise, Actes du colloque d'Albi Mai 1988, pp.105-114, 9 fig. Catalo, Rayssiguier 1994 : CATALO (J.), RAYSSIGUIER (A.). - Rocade sud de Castres, premier tronçon : DFS d'étude d'impact. Toulouse, SRA Midi-Pyrénées,1994. Clottes, Giraud 1988 : CLOTTES (J.), GIRAUD (J.P.). - Présentation de la grotte vérazienne de Roquemaure, à St-Amancet (Tarn), Peuplement et vie quotidienne depuis 100 000 ans : 10 ans d'archéologie tarnaise, Actes du colloque d'Albi Mai 1988, pp.43-57, 10 fig. Clottes et alii 1981 : CLOTTES (J.), GIRAUD (J.P.), ROUZAUD (F.), VAQUER (J.). - Le village chasséen de Villeneuve-Tolosane (Haute-Garonne), Fouille 1978, Congrés Préhistorique de France, XXème session, Montauban-Cahors, 3-9 sept. 1979. Paris, Soc. Préhist. Française, vol. 1, pp.118-128. Constantini et alii 1985 : CONSTANTINI (G.), DEDET (B.), FAGES (G.), et VERNET (A.). - Vestiges du peuplement du Bronze final au premier âge du Fer dans les Grands Causses. Revue Archéologique de Narbonnaise,1985, n°18, pp.1-125, 122 fig. Dedet 1991 : DEDET (B.). - Le Bronze final III en Languedoc Oriental et dans les Grands Causses : état de la question, Autour de Jean Arnal (dir. J. Guilaine et X. Gutherz), Montpellier 1991, pp.409-427, 6 fig. Gascó 1983 : GASCO (J.). - L'âge du Bronze à la Cauna de Martrou, ou grotte de Villemaury (Mas-des-Cours, Aude), L'anthropologie, t.87, 1, pp.99-112. Gascó 1991 : GASCO (J.). - La chronologie de l'âge du Bronze et du premier âge du Fer en France méditerranéenne et en Catalogne, Autour de Jean Arnal (dir. J. Guilaine et X. Gutherz), Montpellier 1991, p.385-408, 5 fig. Gascó, Carozza 1988: GASCO (J.), CAROZZA (L.). - L'âge du Bronze moyen et ses dynamismes en Languedoc Occidental, 113° congrès national des Sociétés Savantes, Strasbourg 1988, Dynamisme du Bronze moyen en Europe Occidentale, pp.453-457, 6 fig. Gascó, Guilaine, Sol 1986 : GASCO (J.), GUILAINE (J.), SOL (J.). - Le Laouret (Floure, Aude) un site de hauteur de l'âge du Bronze final : la céramique. Revue Archéologique de la Narbonnaise, 19, 1986, pp.321-330, 8 fig.
- - 183
Guilaine, 1972 : GUILAINE (J.). - L'âge du Bronze en Languedoc occidental, Roussillon, Ariège, Mémoire n°9 de la Société Préhistorique Française, Paris, Klincksieck, 1972, 460 p., 134 fig., 11 pl. hors texte. Guilaine 1976 : GUILAINE (J.). - Problèmes du Bronze Final et du Premier Age du Fer en Languedoc Occidental et Pyrénées de l'Est, Colloqui Internacional d'arqueologia de Puigcerda, 1976, pp.31-46. Guilaine, 1980 : GUILAINE (J.). - Le groupe de Véraza et la fin des temps néolithiques en Languedoc et Catalogne, Le groupe de Véraza et la fin des temps néolithiques dans le sud de la France et en Catalogne, Ed. du Centre National de la Recherche Scientifique, Paris 1980, pp.1-10. Guilaine 1990 : GUILAINE (J.). - Le Bronze final du midi de la France questions d'actualité, Revue Archéologique de l'Ouest, supplément n°2, 1990, pp.227-233, 2 fig. Guilaine (dir), et alii 1986 : GUILAINE (J.), RANCOULE (G.), VAQUER (J.), PASSELAC (M.). - Carsac, une agglomération protohistorique en Languedoc, Centre d'Anthropologie des Sociétés Rurales, Toulouse 1986, 217 p. Guy 1950 : GUY (M.). - La station du Roc de Conilhac, Gruissan (sondage III), Revue d'Etude Ligure, XVI° année, pp.118-125. Lagarrigue, 1993 : LAGARRIGUE (A.). - Aspects de la fin de l'âge du Bronze en Haut-Quercy, d'après l'étude d'une partie du mobilier céramique de la grotte aux Poteries, commune de Vers (Lot). Mémoire de maîtrise, Université de Toulouse-le-Mirail, 1993, 2 volumes, 85 p., 28 fig. et 66 pl. hors texte. Lauriol 1958 : LAURIOL (J.). - Un gisement de transition Bronze final/premier âge du Fer, Les fonds de cabane du Baous de la Salle (commune de Bize), Cahier Ligures de Préhistoire et d'Archéologie, 1958, pp.16-47. Lauriol 1963 : LAURIOL (J.). - Les habitats des Boussecos à Bize, Cahiers Ligures de Préhistoire et d'Archéologie, pp.131-141. Louis, Taffanel 1955-1960 : LOUIS (M.), TAFFANEL (O.), TAFFANEL (J.). - Le premier âge du Fer languedocien, Bordighera-Montpellier, tome 1 1955, 208 p. ; tome 2 1958, 264 p. ; tome 3 1960, 424 p. Orliac, Wattez, 1989 : ORLIAC (C.), WATTEZ (J.). - Un four polynésien et son interprétation archéologique, Nature et fonction des foyers préhistoriques, Actes du Colloque de Nemours 1987, Mémoires du Musée de Préhistoire d'Ile de France, 2, 1989, pp. 69-75. Petrequin et alii, 1985 : PETREQUIN (P.), CHAIX (L.), PETREQUIN (A.M.), et PININGRE (J.F.). - La grotte des Planches-près-Arbois (Jura). Proto-Cortaillod et âge du Bronze final, Ed. de la Maison des Sciences de l'Homme, Paris, 1985, 273 p., 216 fig.
- - 184
Pons, 1994 : PONS (F.). - L'Hospitalet-du-Larzac, Le site des Campasses et de Labro (Aveyron) : DFS de sauvetage programmé. Toulouse : SRA Midi-Pyrénées, 1994. Autoroute A 75. Roussot-Larroque,1993 : ROUSSOT-LARROQUE (J.). - L'âge du Bronze dans la grotte Vaufrey (Cénac-et-Saint-Julien, Dordogne), Bulletin de la Société Préhistorique Française, 1993, pp. 446-467, 18 fig. Roussot Larroque 1988 : ROUSSOT LARROQUE (J.). - Vent d'Est vent d'Ouest, Rhin-Suisse-France Orientale et Bronze Atlantique, Le groupe Rhin-Suisse-France Orientale et la notion de civilisation des Champs d'Urnes, Actes du colloque de Nemours 1986, Mémoires du musée de préhistoire d'Ile-de-France, 1, 1988, pp.512-516. Séguier, 1989 : SEGUIER (J.-M.). - Recherches sur l'âge du Bronze final et sur le premier âge du Fer dans le sud de l'Albigeois, mémoire de diplôme à l'Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, Toulouse 1989, 3 volumes, 234 p., 94 pl. hors texte. Sigaut, 1978 : SIGAUT (F.) - Les réserves de grains à long terme, techniques de conservation et fonction sociale de l'histoire, Maison des Sciences de l'Homme, Paris,1978, 203 p. Simmonet, 1980 : SIMONNET (G.). - Les structures dites "fonds de cabanes " du Néolithique chasséen de Saint-Michel-du-Touch, à Toulouse (Haute-Garonne), Travaux de l'Institut d'Art Préhistorique, Hommage au Pr. L.R. Nougier, Univ. Toulouse-Le Mirail, XXII, 1980 pp,.129-152. Vaquer 1990 : VAQUER (J.) - Le Néolithique en Languedoc Occidental, Ed. du Centre National de la Recherche Scientifique, Paris 1990, 408 p. Vital 1991 : VITAL (J.). - Protohistoire du défilé de Donzère : l'âge du bronze dans la Baume des Anges (Drôme), Ed. de la maison des Sciences de l'Homme, Paris, 1990, 152 p.