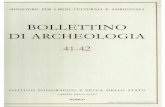Définition, prélèvement et gestion de la dîme en Provence orientale à la fin du Moyen Age 2012
Transcript of Définition, prélèvement et gestion de la dîme en Provence orientale à la fin du Moyen Age 2012
CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUECultures et Environnements. Préhistoire, Antiquité, Moyen Âge
LA DÎME, L’ÉGLISE ET LA SOCIÉTÉ FÉODALE
ÉTUDES RÉUNIES PARMICHEL LAUWERS
COLLECTION D’ÉTUDES MÉDIÉVALES DE NICE
VOLUME 12
HF
DÉFINITION, PRÉLÈVEMENT ET GESTION DE LA DÎME EN PROVENCE ORIENTALE À LA FIN DU MOYEN ÂGE
gerMain butauD CEPAM, UMR 7264, Université Nice Sophia Antipolis – CNRS
La « restitution » des dîmes par les laïcs commença dès les années 10601 en Provence orientale. À la fin du Moyen Âge, le processus était prati-
quement arrivé à son terme. Ainsi contrairement au royaume de France, où les dîmes laïques ou inféodées étaient fréquentes2, elles étaient exceptionnelles en Provence. L’emprise des seigneurs dans ce domaine était résiduelle. On en prend connaissance, par exemple, au détour d’un acte de délimitation des territoires de Saint-Blaise et de Levens datant de 1252 qui garantissait à la famille des Riquier, seigneurs de Levens, tout ce qu’ils avaient dans le territoire de Saint-Blaise in dominiis, taschis, decimis et proprietatibus terrarum3. De telles mentions, fugaces, de dîmes intégrées au dominium laïque sont isolées, de même qu’il est exceptionnel d’en relever dans les chartes de franchises.
Il faut signaler cependant un cas remarquable d’inféodation de dîmes. Le 5 août 1329, dans la cathédrale de Vintimille, Manuele et Ottone, fils de Guglielmo dei conti di Vintimiglia, furent investis par l’évêque, par tradition d’une épée dégai-née, des dîmes de Gorbio, Castellar et Sainte-Agnès, comme l’avaient été leurs ancêtres avant eux4. C’est le premier acte de ce genre conservé, mais la situation devait être bien plus ancienne. Pour le droit canonique en effet, ce genre d’inféo-dation n’était tolérée que si elle était antérieure à 1179 (date du troisième concile de Latran) et transmise héréditairement5. La pérennité de la famille des Lascaris
1. Cf. Archives départementales des Alpes-Maritimes [AD06], 2 G 70, nº 2 (15 mars 1067), original par-chemin, édité dans Cartulaire de l’ancienne cathédrale de Nice, éd. E. caïs De PierLas, Turin, 1888, nº 9, p. 11-13 et dans Trésors d’archives. Mille ans d’histoire, Nice, 2005, p. 24-25. Le dossier sur ces transferts, souvent désignés explicitement comme des restitutions, est assez fourni pour le diocèse de Nice : Cartulaire de l’ancienne cathédrale de Nice, nº 48, p. 62 (vers 1078), nº 44 p. 57-58 (1109), nº 45, p. 58-59 (vers 1125), nº 58, p. 70-71 (1151), nº 27, p. 34-35 (1151), nº 28, p. 36-37 (1152), nº 31, p. 42-43 (1152), nº 42, p. 55-56 (1156).
2. « Au début du xive siècle, la dîme laïque triomphe », telle est la conclusion à laquelle parvient Paul Viard au terme de son chapitre consacré aux dîmes laïques et aux dîmes inféodées (P. viarD, Histoire de la dîme ecclésiastique dans le royaume de France aux xiie et xiiie siècles (1150-1313), Paris, 1912, p. 164).
3. Chartrier de Saint-Pons de Nice [désormais CSPN], éd. E. caïs De PierLas, G. saige, Monaco, 1903, p. 74, nº 60.
4. N. aLLaria-oLivieri, « Castellar, Gorbio e Sainte Agnès. Feudo dei vescovi di Ventimiglia e le investiture », dans Le comté de Vintimille et la famille comtale, Menton, 1998, p. 9-15, ici p. 9.
5. Cf. P. viarD, Histoire de la dîme ecclésiastique dans le royaume de France, cit. n. 2, p. 144-148.
474 GerMain Butaud
issus des comtes de Vintimille permit en outre à cette situation de perdurer pendant des siècles. Au milieu du xviiie siècle, les dîmes de Gorbio, Castellar et Sainte-Agnès étaient encore détenues par des vassaux des évêques de Vintimille6… Dans ce même diocèse, on relève également un cas de figure peu courant. À Sospel, la cour du comte de Provence jouissait en 1333 d’une partie des dîmes, plus pré ci-sément des trois quarts des revenus perçus (on ignore selon quelles modalités) par neuf habitants, nommément désignés7. Hors de ces deux exemples, qui font figure de « curiosités juridiques », la documentation, prise dans son ensemble, témoigne du monopole exercé par l’Église sur la dîme.
Récurrents depuis la réforme grégorienne, les litiges entre décimateurs constituent toujours à la fin du Moyen Âge une source d’information de première importance. L’analyse de ces contentieux, entre clercs et moines notamment, sera notre première thématique d’étude. Elle est d’autant plus intéressante qu’elle met en jeu la question des limites paroissiales et de la hiérarchie des églises.
Les conflits et les transactions entre habitants et décimateurs forment un autre type de documentation, qui caractérise la fin de la période médiévale. Ils permettent d’appréhender sur le vif les problèmes de la définition de la dîme. En les complétant par d’autres sources comme les chartes de franchises et les enquêtes administratives, les taux de prélèvement de la dîme apparaissent dans toute leur diversité, le taux originel du dixième ne se rencontrant quasiment jamais à cette époque.
En dernier lieu, quelques remarques seront faites sur la gestion de la dîme. Celle-ci est en effet l’objet de contrats de ferme qui, même s’ils laissent dans l’ombre les modalités de prélèvement, révèlent tout un milieu social impliqué dans l’économie de la dîme.
Les contentieux entre DéciMateurs
Les litiges les plus fréquents, et à vrai dire traditionnels, opposaient séculiers et réguliers. Ainsi en 1213, une transaction eut lieu à propos des dîmes prélevées à La Penne entre, d’une part, l’évêque et les chanoines de Glandèves et, d’autre part, le prieur de l'église Sainte-Marie, dépendant de l’abbaye Saint-Victor de Marseille. Le prieur conserva la dîme sur toutes les terres de son église, mais dut céder à l’évêque et au chapitre, l’arrière dîme étant prélevée, la moitié des dîmes
6. Voir le détail des actes analysés dans N. aLLaria-oLivieri, « Castellar, Gorbio e Sainte Agnès », cit. n. 4, p. 9-15. On peut y ajouter une investiture du 20 octobre 1421 éditée par G. rossi, « Un vescovo scismatico della Chiesa Ventimigliese », Archivio storico italiano, 5e ser, 12, 1893, p. 139-148, ici p. 147-148. Du point de vue du rituel, en 1487 l’anneau remplaça l’épée dégainée comme symbole d’investiture.
7. Item assignat dicto clavario homines infrascriptos de Cespitello qui dant decimam bladorum, vini, agnorum et edorum quando habent predicte, videlicet dicta curia habet partes tres et quarta pars est ecclesie. (T. Pécout dir., G. butauD, M. bouiron, Ph. Jansen, A. venturini éd., L’enquête de Leopardo da Foligno en Provence orientale [avril-juin 1333], Paris, 2008, p. 551).
définition, prélèveMent et Gestion de la dîMe en provence orientale 475
qu’il percevait dans la paroisse, du fait de l’église Saint-Pierre de Proprietate8. Deux ans plus tard, c’est dans la basilique du Latran, la veille de l’ouverture du célèbre concile, que fut réglé un contentieux entre l’évêque de Nice et l’abbé de Saint-Ruf. En échange de la cession (équivalant en fait à une confirmation) à l’abbaye de plusieurs églises de la région de Peille9, Saint-Ruf dut verser annuel-lement à l’évêque huit setiers de froment et au chapitre quatre setiers, provenant des dîmes de l’église de Peille10.
Entre 1267 et 1276, un long procès opposa l’évêque et le chapitre de Vintimille au moine de Saint-Pons de Nice qui était prieur de Saint-Nicolas de Sospel. Ils lui contestaient les droits paroissiaux et en particulier la perception des dîmes. L’évêque de Glandèves, juge délégué par le pape de cette affaire, condamna dans un premier temps, en 1271, l’évêque de Vintimille. Finalement en 1276, les deux parties abandonnèrent leur procès et le prieur de Saint-Nicolas eut confirmation de ses droits paroissiaux dans des limites définies, soit sur tout le bourg qui s’était développé au nord de la Bévéra, en face de l’agglomération principale11. Dans d’autre cas, les limites paroissiales n’étaient pas claires et l’attribution des dîmes concernant les territoires marginaux était soumise à arbitrage. C’est ce que l’on constate en 1286, entre le prieuré paroissial de Saint-Blaise, dépendance de Saint-Pons, et l’église Saint-Antonin de Lévens, qui appartenait au chapitre de Nice12. En 1334, le chanoine prieur de cette même église Saint-Antonin dut également accepter de reverser une partie des dîmes prélevées, soit soixante-dix boisseaux de céréales par an, au prieur de l’église rurale Sainte-Marie-des-Prés, un autre prieuré de Saint-Pons13. Les contentieux permettaient donc de définir progres-sivement les aires de prélèvement de la dîme des églises mais aussi le partage des dîmes entre église paroissiale et église rurale. En l’absence d’un accord de redistribution, la situation ordinaire était que les églises non paroissiales ne per-cevaient la dîme que sur les terres qu’elles exploitaient, mais non en dehors. C’est ce qui fut décidé par exemple en février 1243 pour deux dépendances de
8. […] mandamus quod decimas omnium terrarum quas nunc habet […] dictus prior […] habeat precipuas ipse prior et ecclesia supradicta […] ; reliquas vero omnes decimas tocius parrochie, et nominatim dictam ecclesiam Sancti Petri que dicitur de Proprietate, dividant per medium predicti episcopus et capitulum, ex una parte, et, ex altera, dictus prior de Penna, Cartulaire de l’abbaye de Saint-Victor de Marseille, éd. B. guérarD, Paris, 1857, nº 980, II, p. 431 (23 septembre 1213).
9. Il s’agit des églises de Peille, d’Ongran-inférieur, d’Ongran-supérieur, d’Oira, et de Sainte-Thècle.10. G. DoubLet, Recueil des actes concernant les évêques d’Antibes, Monaco - Paris, 1915, nº 146,
p. 186-189. (10 novembre 1215).11. CSPN, nº 85, p. 91-95, et nº 88, p. 98-100. Sur la topographie de Sospel, cf. A. sagLier, « Approche
topographique et économique de Sospel médiéval », Archéam, Cahiers du Cercle d’Histoire et d’Archéologie des Alpes-Maritimes, nº 15, 2008, p. 163-192. Au sujet des cinq églises du bourg et du territoire de Sospel, cf. J.-Cl. Poteur, « Les agglomérations de la vallée de la Roya au Moyen Âge : un échec de l’incastellamento ? », dans Le comté de Vintimille et la famille comtale, Menton, 1998, p. 131-145.
12. CSPN, nº 98, p. 110-111 (7 mars 1286).13. CSPN, nº 138, p. 150-151 (10 décembre 1334).
476 GerMain Butaud
Saint-Victor de Marseille du diocèse de Glandèves14, ou en 1442, par le docteur en décrets Guillaume de Littera, pour le prieuré monastique Sainte-Marie, dans le territoire de Gattières15.
Dans une même paroisse, il était donc fréquent que coexistent des prélè-vements de dîme d’inégale importance : le prélèvement principal de l’église paroissiale, le ou les prélèvements secondaires des églises rurales, voire même parfois des prélèvements pesant sur certaines terres et qui n’étaient pas forcément liés à des églises du territoire. Le censier du prévôt du chapitre de Nice, compilé en 1465, comprend ainsi une liste de vingt-huit terres situées dans le territoire du village abandonné de Montolieu16, qui étaient « de la dîme de l’Église de Nice17 ». Comme il est précisé que l’église de Montolieu percevait la moitié de la dîme pour trois terres seulement, il apparaît que les autres prélèvements étaient reliés directement à la cathédrale de Nice, sans l’intermédiaire d’une église dépendant du chapitre. Le prélèvement de la dîme était donc parfois plus attaché à la terre qu’à une église, et nous verrons même qu’il pouvait varier de parcelle à parcelle.
L’exemple de La Napoule, bien documenté, permet d’illustrer cette interaction entre prélèvement de la dîme et pouvoir foncier ou seigneurial. La situation était rendue plus complexe encore par le fait que le territoire était régi par une cosei-gneurie18. Depuis la fin du xiiie siècle, les habitants avaient abandonné les hauteurs du Puy Saint Pierre et s’étaient établis sur le site littoral, marqué aujourd’hui par la tour seigneuriale qui était contrôlée par une branche de la famille de Villeneuve. En revanche, l’église paroissiale était en dehors du village, plus au nord : il s’agis-sait du prieuré lérinien Notre-Dame d’Avinionet19. Le problème était que le chapitre de Grasse, plus précisément son prévôt, était également coseigneur du village, et contrôlait le quartier de Mandelieu où il disposait d’une tour au bord de la Siagne, sans y avoir néanmoins d’église. Le litige prit forme en 133820. Selon le prieur lérinien, le prévôt devait lui payer la dîme sur certaines terres dont il donne les localisations précises, et situées explicitement dans les limites paroissiales de Notre-Dame d’Avinionet, de même que lui payer la dîme du foin. À l’inverse, le prévôt affirmait que le prieur ne pouvait faire paître son bétail qu’avec son
14. Il s’agit de Saint-Pierre de Bonvillar (Saint-Pierre, Alpes-de-Haute-Provence, cant. Entrevaux) et de Saint-Pierre de Cluselles (commune d’Aiglun, Alpes-Maritimes, cant. Saint-Auban). En outre, les deux prieurs devaient payer la dîme à l’évêque et aux chanoines de Glandèves sur les terres acquises depuis moins de quarante ans et leur faire un versement de froment et d’avoine. Voir l’article de Thierry Pécout, « Dîme et institution épiscopale au xiiie siècle en Provence », dans ce volume.
15. CSPN, nº 316, p. 375-376 (24 novembre 1442).16. L’ancien village de Montolieu se trouvait dans le quartier Saint-Michel de la commune actuelle
de Villefranche, sur les hauteurs dominant Beaulieu. Il fut abandonné avec la fondation de Villefranche en 1295.
17. AD06, 2 G 147, fº 66r-v.18. Pour l’histoire du village, cf. J.-A Durbec, « La Napoule (du xie au xixe siècle) », Annales de la
société scientifique et littéraire de Cannes et de l’arrondissement de Grasse, n.s., 32, 1986, p. 21-83. Il y a de nombreux documents d’archives encore inexploités sur ce territoire.
19. Sur cet édifice qui a été fouillé avant sa destruction, cf. M. fixot (dir.), Le site de Notre-Dame d’Avinionet à Mandelieu, Paris, 1990.
20. Toute l’affaire est connue par une sentence arbitrale du 13 mars 1338 : AD06, H 392 (cahier, copie de 1534).
définition, prélèveMent et Gestion de la dîMe en provence orientale 477
autorisation et ne pouvait pas ouvrir une taverne pour vendre son vin. Par ailleurs, il ne pouvait pas selon lui prélever la dîme sur un vallon du côté de Pégomas qui était du droit paroissial de l’église Saint-Pierre de Pégomas. Enfin le prieur devait déduire un trentième de la dîme qu’il prélevait à Auribeau et les lui reverser.
Les deux arbitres, un chanoine de Fréjus et un juriste de Grasse, proposèrent une sentence, complexe, qui ménageait les deux parties. Pour les terres exploitées directement par le prévôt ou ses fermiers, il n’y aurait pas de dîmes payées au prieur ; en revanche, pour les terres du prévôt confiées aux paysans la dîme serait du douzième. Quatre parcelles toutefois étaient soumises à une dîme du dixième en faveur du prieur. Le prévôt ne devait pas payer de dîme pour le foin et son bétail mais, à l’inverse, avait le droit de percevoir la dîme dans le vallon près de Pégomas. Il conservait aussi son défens de la Roubine et de Mandelieu : aucun pâturage n’était permis dans ses limites sans son autorisation. En dehors de ce défens, le pâturage était libre et le prieur pouvait aussi librement vendre son vin. Il disposait de la dîme des nadons (agneaux et chevreaux) et autre bétail appar-tenant aux hommes d’Auribeau et pâturant à La Napoule dans la paroisse (infra parrochiam) de l’église Notre-Dame d’Avinionet.
Par la suite, La Napoule, comme de nombreux villages, se dépeupla. Au milieu du xve siècle, de nouveaux habitants s’y établirent, et les tensions reprirent. En 1459, il y eut une délimitation des deux zones contrôlées par les Villeneuve, au sud, et par le chapitre, au nord, soit le quartier de Mandelieu21. En 1461, le seigneur Antoine de Villeneuve accorda une charte de franchises aux habitants, qui cultivaient par ailleurs des terres dépendant du prieur de Lérins ou du chapitre grassois22. Les procès ensuite se multiplièrent, faisant intervenir alternativement les habitants, leur seigneur laïque, le monastère de Lérins et le chapitre de Grasse23. En décembre 1506 par exemple, plusieurs témoins furent interrogés à l’occasion d’un litige entre Honorat de Villeneuve et le chapitre. On apprend aux détours des dépositions que le prieuré lérinien Notre-Dame d’Avinionet était bien l’ecclesia matrix, qui disposait de fonts baptismaux, d’un cimetière et du droit de dîme sur tout le territoire, de part et d’autre de la délimitation de 1459. À l’inverse, le chapitre de Grasse ne disposait d’aucune église sur ses terres, ni de fourche sym-bolisant sa juridiction24. Mais quelques décennies plus tard, en 1550, le chapitre contesta cette situation en cherchant à démontrer que Mandelieu était un ancien castrum abandonné. Cela apparaissait dans de vieilles chartes, en particulier un acte de 113425. Des vestiges témoignaient aussi de ce lointain passé : n’y avait-on
21. AD06, 1 J 132 (25 août 1459, original parchemin et copie moderne).22. R. aubenas, Chartes de franchises et actes d’habitation, Cannes, 1943, p. 41-52 (20 mai 1461).23. Voir notamment le gros registre relatif au procès entre les habitants de La Napoule et le chapitre de
Grasse, entre 1470 et 1493 : AD06, G 765.24. AD06, H 392, registre des dépositions de témoins de 1506, fos 27v-28r, 31v-32r, 34r, 39r, 41v, 44v,
46v, 48r-v, 50r, 52v, 54v-55r, 56r, 60v, 62r-v, 64r, 66r-v, 69v, 72r, 74v, 76v, 78r-v, 80r. Ces extraits ont été fait en 1555 par le parlement d’Aix, à la demande du monastère de Lérins, dans le contexte d’un procès sur les dîmes justement avec le chapitre de Grasse.
25. Le 6 juin 1134, l’évêque d’Antibes Mainfroi et le chapitre avaient acheté pour 100 sous melgoriens les biens et droits de Niel de Pierrefeu à Mandelieu quod olim castrum fuit et à Epulia, forme primitive du
478 GerMain Butaud
pas vu les ruines de maisons, d’une église et des ossements humains26 ? En prati-quant une « archéologie » très orientée, le chapitre cherchait ainsi à s’assurer du prélèvement de la dîme sur Mandelieu, en inventant en quelque sorte une paroisse où il n’y avait auparavant qu’une seigneurie foncière. Des arguments d’avocat à la création effective d’une paroisse, il y avait cependant un fossé car il s’agissait d’une procédure rare.
Pour la justifier, il fallait un essor démographique et bénéficier de l’appui pon-tifical. Le cas le plus explicite concerne Nice au xiiie siècle, dans le contexte de l’expansion de l’habitat en contrebas du site primitif de la Colline du Château, soit autour de l’église Saint-Réparate, prieuré de Saint-Pons. Un délégué apos-tolique vint sur place et accorda le 11 novembre 1246 à l’abbé de Saint-Pons les droits paroissiaux sur les tous les habitants des faubourgs de Nice, à savoir dans la condamine inférieure et supérieure de Sainte-Réparate, et hors des portes de la ville haute27. L’abbé restait toutefois sur la défensive par rapport à l’évêque. En dépit d’un nouvel appui pontifical en 124728, il dut reconnaître à l’évêque le droit d’approuver les oblations des fidèles qui habiteraient les deux condamines de Sainte-Réparate29. Le procès se poursuivit, aboutissant à une transaction le 7 octobre 1248. Une nouvelle paroisse fut créée à Sainte-Réparate englobant les deux condamines ; les chanoines au nom de la cathédrale, des chapelles Saint-Jacques, Saint-Martin et Saint-Michel ne devaient pas perturber les paroissiens ; les maisons contiguës aux deux paroisses, la neuve et la vieille, seraient communes . En échange, les moines verseraient à l’avenir chaque année 4 livres génoises et demie à la fête de la purification de la Vierge et à la vigile de Noël 10 sous pour les amandes et le vin ; la dîme (ou peut-être plus justement le dixième) du poisson pêché dans les deux ports Lympia et Saleya serait partagée en deux30. Les moines avaient donc pu transformer leur prieuré en église paroissiale. La situation semble avoir été calme jusqu’au milieu du xive siècle où l’on a trace d’un litige entre l’abbaye et l’évêque. Il est alors question, parmi plusieurs griefs, de la détention de dîmes abbatiales par l’évêque31.
toponyme La Napoule (G. DoubLet, Recueil des actes concernant les évêques d’Antibes, cit. n. 10, nº 64, p. 71-73).
26. « Dist en oultre que anciennement ledit lieu et terroir de Mandaluec estoit peuplé et habité de plusieurs maisons et d’une église qui seroient ruynées, et le lieu rendu inhabité par les Turcs et aultres ennemys. Et de ce y a encores ou naguières en y avoit bonnes enseignes, car l’on y a veu et treuvé naguières les fondemens de plusieurs maysons, les ossailles de plusieurs corps mortz et aultres enseignes demons-trans qu’il y avoit heu anciennement chasteau, église, cemetière et habitations. Et y a encores la monstre évidente de ladite église ruynée. » (AD06, H 392, registre de procès de 1550, non folioté).
27. CSPN, nº 42, p. 54.28. On a trace d’un procès instruit à la demande de l’abbaye de Saint-Pons en 1247 (CSPN, nº 45, p.55).
Le 13 juin 1247, la bulle d’Innocent iv indique parmi les possessions : le Bourg Saint-Pons et le Bourg de Mas cum juribus et aliis pertinentiis suis ; decimas, possessiones et domos, furnos, molendina et prata, que habetis in civitate et diocesi Niciensi (nº 46, p. 57).
29. CSPN, nº 48, p. 60 (23 novembre 1247).30. […] ac decimam piscarie utriusque portus, scilicet de Lempeda et de Sallea, dicte partes per medium
dividant inter se, CSPN, nº 50, p. 63-65.31. CSPN, nº 178, p. 193-196 (14 février 1354).
définition, prélèveMent et Gestion de la dîMe en provence orientale 479
Aux tensions entre moines et clercs s’ajoutaient celles nées de conflits internes. Le prélèvement des dîmes pouvait diviser une communauté. Ainsi en février 1330, un accord fut conclu entre deux moines de Lérins : le prieur de Gars reconnut qu’il devait bien verser la moitié des dîmes de son prieuré Saint-Sauveur au prieur de Sainte-Marie de Briançonnet. Pour une durée de quatre ans, il s’engagea à payer chaque année une contribution fixe : vingt setiers d’avoine, cinq de seigle, cinq d’orge et cinq de froment32. En 1505-1506, ce fut le camérier qui affronta l’abbé de Lérins au sujet de la dîme des blés et des légumes prélevée sur les Cannois dans l’île Sainte-Marguerite. Selon lui, cela faisait partie des dotations ordinaires de son office. De fait, les commissaires délégués par l’administration provençale pour enquêter sur place reçurent plusieurs témoignages qui confir-mèrent que le camérier prélevait bien la dîme sur l’île. En conséquence, la cour trancha en sa faveur contre l’abbé et la sauvegarde royale fut mise sur l’église Sainte-Marguerite33.
De semblables divisions se retrouvent entre évêques et chanoines ou au sein d’un chapitre comme on peut le saisir pour le petit diocèse de Vence. Le territoire de Salles correspondait à un éphémère village, ou bastide, au nord de Cagnes et à la limite sud du territoire de Vence. En 1461, après des décennies d'abandon, le territoire commença probablement à être cultivé de façon plus intensive. Un procès s’ouvrit entre le chapitre de Vence et le prieur de Cagnes, nommé par l’évêque. On interrogea plusieurs témoins proposés par chacune des parties. Il apparut clairement que les paysans de ce territoire avaient coutume de payer la dîme à des décimateurs envoyés par le chapitre de Vence ; de plus ils se rendaient à Vence pour les sacrements et les fêtes religieuses. Le seul droit du prieur de Cagnes était un péage sur le passage du Var. C’est à partir de là qu’il avait bâti ses prétentions. La décision fut donc entièrement en faveur du chapitre et il n’y eut pas de nouvelle délimitation territoriale34. En 1471 en revanche, pour un litige entre l’évêque de Vence et le prieur de Thorenc d’une part, et de l’autre le prévôt du chapitre de Vence et les prébendiers de Gréolières, les arbitres déterminèrent les bornes de la vallée dite de Gréolières ou de Thorenc, qui était au centre du litige. Toute la dîme fut accordée dans ses limites au prévôt et aux bénéficiers de Gréolières35. Gréolières justement fut l’objet d’un autre litige en 1508 concernant la levée des dîmes. Il concernait la limite avec Coursegoules, donc de la limite orientale cette fois. Le procès faisait s’affronter deux chanoines de Vence, prieurs respectifs des deux localités. Les limites entre les deux dîmeries furent consignées dans un texte en provençal36.
Au gré de ces conflits au sein de l’Église, les aires de prélèvement de la dîme furent ainsi de plus en plus précisément définies. C’est un processus de longue
32. AD06, H 431.33. AD06, H 608 (dossier de procédures).34. AD06, 1 G 8 (30 septembre 1461).35. AD06, 1 G 8 (22 mai 1471).36. AD06, 1 G 8 (8 novembre 1508).
480 GerMain Butaud
haleine qui devait tenir compte des évolutions de l’habitat. On l’a vu pour la création de la paroisse Sainte-Réparate de Nice. Mais tout aussi important fut le phénomène inverse de désertification de la fin du Moyen Âge qui multiplia les zones où les droits étaient incertains et où il fallut les fixer après enquête. De plus, à l’intérieur des paroisses se posait le problème récurrent des dîmes prélevées sur leurs terres par les églises secondaires. La dîme était alors particulièrement liée aux droits fonciers et seigneuriaux. Plusieurs facteurs concourraient donc à la multiplication des contentieux sur le sujet. Peu importaient souvent les profits disputés : monastères, chapitres et évêques en faisaient une question de principe.
Définition De La DîMe et taux De PréLèveMent
Comme cela a été mis en évidence pour la Provence rhodanienne, les conflits entre clercs et laïcs à propos de la dîme et des droits paroissiaux se multiplièrent à partir du début du xiiie siècle37. Ils s’inscrivaient alors dans un contexte de ten-sions anticléricales, d’émancipation urbaine, et secondairement d’hérésie. Ils devinrent plus nombreux encore dans les années 1260-1340, période qui semble marquer l’apogée des conflits mais aussi leur résolution car on aboutit à une série d’accords qui seront durables. On assiste ainsi « à une remise en ordre général des structures ecclésiales ». Pour le Comtat Venaissin, ce « temps du refus » est repré-senté par une centaine de cas connus. Par la suite, en dépit de sources beaucoup plus riches, la fréquence des litiges diminue fortement. Une autre période s’ouvre pour les communautés marquée par le poids des exigences de la guerre.
En l’état des recherches, il est difficile de savoir si ce modèle rhodanien est applicable dans le reste de la Provence. Signalons un bel exemple de contestation hors de notre aire d’étude, à Moustiers, dont l’église paroissiale était un important prieuré dépendant de Saint-Honorat de Lérins38. Quelques mois après sa nomi-nation comme prieur de Moustiers par son oncle, le pape Jean xxii, le cardinal Arnaud de Via voulut, en mars 1318, imposer le taux de prélèvement du dixième pour la dîme. Les habitants refusèrent catégoriquement. Ils furent excommuniés, l’interdit fut jeté sur leur ville. Privés de communion et de confession pendant plus d’un an, ils encoururent un procès pour hérésie. Mais le cardinal dut finale-ment céder, le 22 mars 1321, les pardonner et admettre qu’à l’avenir les habitants paieraient la dîme selon le taux, qui était coutumier, du treizième pour les grains, les porcs, les poulets, les fromages, les agneaux, le foin, les raisins…
37. J. chiffoLeau, « Sur l’économie paroissiale en Provence et Comtat Venaissin du xiiie au xve siècle », La Paroisse en Languedoc (xiiie-xive s.), Cahiers de Fanjeaux, 25, 1990, p. 85-110, p.87-89 ; iD., « Les transformations de l’économie paroissiale en Provence (xiiie-xve siècles) », dans A. Paravicini bagLiani, V. Pasche (dir.), La parrochia nel Medio Evo : economia, scambi, solidarietà, Rome, 1995, p. 61-117.
38. Cette affaire n’est connue que par des analyses d’actes disparus : AD06, H 10 bis, fº 109r.
définition, prélèveMent et Gestion de la dîMe en provence orientale 481
Pour la Provence orientale, la documentation est trop lacunaire pour percevoir un front de contestation. On doit se contenter de relever une poignée de litiges isolés et de dates plus tardives. Complétés par d’autres sources, cela permet néan-moins de préciser en quoi consistait concrètement le prèlevement de la dîme.
Conflits et transactions entre les décimateurs et les habitants
Le plus ancien acte concernant la définition de la dîme que nous avons relevé date de 1222 et ne concerne qu’une partir de la dîme. Le 11 novembre 1222, les consuls de Grasse cédèrent à l’évêque d'Antibes ce qu’ils détenaient à Antibes, en échange l’évêque Bertrand ii fixa au soixantième la dîme sur le vin et supprima celle touchant les figues. Cet acte fut confirmé en 133039.
Ensuite, il faut attendre un acte de 1299 sur Callian40, dans la diocèse de Fréjus, pour disposer d’un accord fixant le taux de prélèvement de la dîme. D’un côté, il y avait Jean Grimaud, prieur de l’église Sainte-Marie, mais aussi des autres églises du territoire, de l’autre les paroissiens. Le compromis fut conclu par le moine de Lérins Raymond de Soleillas et un damoiseau, coseigneur de Callian, Augier Justas, représentant le prieur, et deux syndics représentant les habitants. Le taux de la dîme fut fixé et un autre point précisé : en cas de dépenses pour la réfection de l’église, les habitants paieraient les trois quarts et le prieur le dernier quart.
Tandis qu’à Èze en 1331, le prieur s’accorda sur les quotité de la dîme avec les seuls habitants41, la transaction de 1334 concernant Aspremont impliqua éga-lement les seigneurs42. Le prévôt de Grasse Guillaume Fulcosi et Raimond Caïs furent les arbitres qui tranchèrent le litige. Leur décision était explicitement ins-pirée par le prélèvement qui était fait dans les villages voisins. Les taux prescrits alors ont donc une valeur microrégionales43. Comme pour Callian, une autre ques-tion fut réglée en même temps : le prieur obtint les lits des morts, ou 6 (sous) tournois, ou selon sa conscience. Cet accord ne mit pourtant pas fin aux tensions. En 1343 alors que Paul Caïs était prieur d'Aspremont, il dut subir une attaque en règle de son prieuré par les fils du seigneur, Hugues et Manuel, et surtout Milon Chabaud, frère de l’Hôpital. Ces derniers pillèrent les réserves de vin (quatre-vingt saumées), interrompirent de façon sacrilège une messe, brisèrent les coffres, s’emparèrent des livres, des ornements religieux, des biens du prieuré, ce qui leur valut une excommunication44. Dans ce cas, c’est donc plutôt l’affrontement entre seigneurs laïques et prieur qui compte, le rôle des habitants n’est pas discernable.
Il arrivait cependant que des particuliers entrent en conflit avec un prieur, à titre individuel. Ainsi Pierre Feraud, villageois de L’Escarène affirmait qu’un
39. G. DoubLet, Recueil des actes concernant les évêques d’Antibes, cit. n. 10, nº 165, p. 221-223.40. AD06, H 355 (12 août 1299).41. Ch.-A. fighiera, Èze, Nice, 2000, p. 35.42. CSPN, nº 137, p. 149-150 (octobre 1334).43. Voir l’annexe I.44. CSPN, nº 153 et 154, p. 162-169.
482 GerMain Butaud
champ acquis en 1349 dans la vallée ne payait à l’église Saint-Pierre que le tren-tième des fruits, comme c’était la coutume pour cette terre franche et comme les gens de Peille payaient la dîme. Le prieur produisit l’acte de partage de 1252 entre l’Escarène, Peille et Berre et put ainsi prouver que la terre en question figu-rait bien dans les limites de l’Escarène. Le 5 mars 1367, Pierre Feraud fut donc condamné à payer la quinzième partie des fruits de sa terre45.
Du fait de la perte des archives judiciaires, il est impossible de savoir si de telles contestations étaient fréquentes. En revanche, pour ce qui concerne les combats collectifs portant sur la dîme, l’impression d’ensemble est qu’ils sont relativement rares aux xive et xve siècles. Une poignée d’affaires seulement sont à signaler en plus des cas évoqués précédemment. À Vence, un débat s’ouvrit en 1339 sur un point particulier : les habitants prétendaient être exempts du paiement de la dîme sur le chanvre et le lin. Selon une sentence de 1345, ils furent néanmoins soumis à une dîme du vingt-cinquième sur ces produits46. En 1415, c’est à l’issue d’un litige que le prieur de l’Escarène supprima la dîme sur les produits du jardinage « pour maintenir la paix et éviter les scandales47 ».
Pour la ville de Nice, on relève à partir de 1353 un long procès entre la commune et l’abbaye de Saint-Pons. Ce procès est notamment scandé par des accords en 1357, 1362 et 1367 qui permettent de connaître le détail du conten-tieux48. Or la dîme n’apparaît pratiquement pas dans ce conflit : c’était la seigneurie de l’abbaye qui était combattue dans ses multiples manifestations : les cens, les lods et trézains, les droits relatifs aux fours, aux moulins, aux canaux d’irriga-tion en particulier. Le refus de payer les dîmes n’intervient que ponctuellement, pour renforcer la contestation49, mais n’est pas à l’origine du conflit. Le pacte de soumission des Niçois au comte de Savoie ne contient ainsi aucun passage sur la dîme, alors qu’il prévoit l’abolition de la seigneurie foncière de l’abbaye Saint-Pons qui devait être dédommagée par l’octroi de fiefs confisqués sur les rebelles50.
Au xve siècle en revanche, un nouveau procès surgit, cette fois entre la ville et le chapitre de Nice. En 1459, les Niçois argumentèrent que la dîme était trop élevée car ils étaient dans un lieu stérile, un lieu frontalier, proche de Gênes. Selon le dicton, « quiconque urine trop, pisse du sang » (qui nimis emingit, elicit sanguinem). En conséquence, la dîme fut définie par une transaction en date du 30 août 1459. Elle fut établie au quinzième des blés, à savoir froment, avoine, orge, seigle, épeautre, mais non le millet et l’alpiste (excepto de milio et sca-
45. CSPN, nº 211, p. 248-254.46. E. tisseranD, Histoire de Vence (cité, évêché, baronnie), de son canton et de l’ancienne viguerie de
Saint-Paul du Var, Paris, 1860, p. 53, 54-55.47. CSPN, nº 275, p. 343-344 (27 mai 1415).48. Pour les trois sentences arbitrales, cf. CSPN, nº 186, p. 204-209 (4 septembre 1357), nº 199, p. 223-236
(7 juillet 1362) et nº 210, p. 247-248 (4 février 1367). Pour l’ensemble de la procédure, cf. CSPN, nº 174-176, p.185-192 ; nº 182, 184, p. 202-204 ; nº 191-197, p. 219-222 ; nº 200, p. 236-238 ; nº 209, p. 246-247.
49. Cf. CSPN, nº 174, p. 185-186.50. Cf. E. caïs De PierLas, La ville de Nice pendant le premier siècle de la domination des Princes de
Savoie, Turin, 1898, p. 37 (article 24 de l’acte du 28 septembre 1388).
définition, prélèveMent et Gestion de la dîMe en provence orientale 483
gliuola) et au quinzième également pour les légumes, les fèves, les vesces sauf les fayots (exceptis fayolis). Le taux était du dixième pour les nadons. Enfin les habitants verseraient chaque année à la Toussaint 120 florins au nom des dîmes du vin, des fruits des arbres, des herbes, du foin, du chanvre, du lin, des oignons, des aulx… Cet accord fut ratifié par l’évêque le 14 janvier 1460 et par le conseil de la ville le 22 janvier 1460. En 1476, l’évêque Barthélemy Chuet voulut exiger plus des Niçois, qui assignèrent en justice les chanoines. Ceux-ci refusèrent de changer l’accord précédent. En janvier 1489, le conflit reprit avec une nouvelle pétition des syndics de Nice ; ils se plaignaient que l’évêque et les chanoines n’avaient pas fait ratifier par le pape l’accord sur les dîmes d’août 1459 et dénonçaient surtout le fait qu’on exigeait d’eux 200 florins par an, et non les 120 florins convenus. Comme depuis 1475, ils ne payaient que ces 120 florins, l’évêque avait com-mencé une instance contre eux devant la cour de Rome. Le pape Innocent viii ratifia finalement l’accord, par bulle du 8 avril 1489 (60 florins devaient retourner à l’évêque et 60 fl. aux chanoines), puis par une nouvelle bulle du 19 décembre 1490. En 1492, les syndics dédommagèrent l’évêque des impayés et l’évêque et le chapitre reconnurent définitivement la fameuse transaction de 145951.
Alors que les syndics de Nice s’étaient focalisés sur les taux de prélèvement de la dîme, en 1475-1476, les syndics de Saint-Paul affrontèrent le chapitre de Vence quant à son utilisation52. Selon eux, le vicaire et le vicaire secondaire qui étaient en place ne suffisaient pas pour desservir correctement l’église paroissiale, qui était par ailleurs devenue trop petite du fait de l’augmentation de la population53. Lors de certaines fêtes solennelles, ou lorsque que des prédicateurs étaient de passage, une partie des fidèles restait en dehors de l’église, et il fallait célébrer une deuxième messe. Il était ainsi demandé au chapitre de Vence de nommer au moins un desservant (personatum) supplémentaire. Le vicaire, Pierre Guigonis, âgé de vingt-cinq ans, et dont un oncle avait été administrateur du chapitre, appuyait cette demande, d’autant plus légitime que le chapitre percevait chaque année environ 120 florins au titre des dîmes, alors qu’il ne lui laissait que dix setiers de froment, dix setiers d’épeautre et six saumées de vin et, heureusement, les revenus des anniversaires, soit au moins 30 florins, avec lesquels il devait cependant payer son secondaire (à raison de dix à douze florins annuels)54… Le chapitre contesta du tout au tout ces arguments55 : l’église de Saint-Paul était assez grande, aucun
51. AD06, 2 G 2 fos 119r-121v, 132r-136v, 139r-156r ; G. DoubLet, « Le chapitre cathédrale de Nice sous l’épiscopat de Barthélemy Chuet (1462-1501) », Nice historique, 1914, p. 449-512.
52. Ce procès est connu par deux enquêtes testimoniales : la première, en octobre 1475, pour vérifier les arguments de la ville, et la seconde, en janvier 1476, à propos des contre arguments du chapitre de Vence. (AD06, E 004/083, Archives municipales de Saint-Paul, II 1, un registre de 77 folios et un registre de 156 folios).
53. Un témoin rapporte que depuis qu’il était arrivé à Saint-Paul, il y a seize ans, la population avait augmenté du tiers, ou au moins du quart (AD06, E 004/083, II 1, registre 1, fº 37v). Pour le vicaire, on distribuait environ 1 400 pains lors des aumônes générales, à raison d’un pain par personne (Ibid., fº 54r).
54. Voir notamment la déposition du vicaire, qui est confirmée par les autres témoins : Ibid., fº 50r-59v.55. AD06, E 004/083, II 1, registre 2, passim.
484 GerMain Butaud
desservant supplémentaire n’était nécessaire car l’évêque envoyait au besoin des chapelains. Surtout, le chapitre était en difficulté pour assumer toutes ses charges. Ses revenus annuels n’étaient que de 380 florins environ, ce qui était insuffisant pour payer les prébendes du prévôt, des sept chanoines, des six clercs bénéficiers, du diacre, du sous-diacre, des enfants de chœur, du maître d’école et l’entretien de la cathédrale. On ignore les suites de cette affaire qui témoigne des tensions internes, et même des rancoeurs, au sein du clergé. Le jeune vicaire de Saint-Paul pensait ainsi qu’il devait bien rester de l’argent au chapitre pour avoir pu doter la cathédrale de Vence d’un si beau chœur et de si belles cloches56, alors qu’il devait se contenter d’une église exiguë, et faire face, durant la semaine pascale, à une foule de fidèles voulant se confesser et communier…
Ce procès conduit par les habitants de Saint-Paul est isolé dans la documen-tation disponible dans la mesure où il exprime d’abord une demande religieuse et une critique implicite de l’usage des revenus de la dîme. Par contraste, les autres affaires se concentrent sur les modalités de sa perception. En outre, elles semblent plutôt rares si on les compare aux litiges liés à la mise en défense et aux problèmes fiscaux, qui constituaient des champs d’intervention majeurs des équipes municipales. Celles-ci n’hésitaient d’ailleurs pas à faire des procès aux clercs pour qu’ils contribuent aux charges57. Les pâturages et les forêts à l’heure du développement de la transhumance étaient également, pour les villages de l’arrière-pays en particulier, au centre de débats récurrents entre communautés voisines, ou entre habitants et seigneurs58. En fin de compte, même si les pertes documentaires peuvent fausser notre jugement, la dîme n’apparaît pas comme une préoccupation majeure des communautés d’habitants de Provence orientale à la fin du Moyen Âge.
Les produits soumis à la dîme
Aucun cas de dîmes personnelles, pesant sur les gains et les redevances, n’a été rencontré. Cette absence n’est pas surprenante tant ce genre de dîme était rare, mis à part dans les écrits des canonistes. Les dîmes prédiales portaient en
56. Interrogatus si eis restarent peccunie respondit quod si non restarent peccunie non fecissent fieri chorum tam pulcrum sicut est, et campanas etiam tam pulcras sicut sunt. (AD06, E 004/083, II 1, registre 1, fº 58r).
57. Cf. G. gauthier-ZiegLer, Histoire de Grasse, depuis les origines du Consulat jusqu’à la réunion de la Provence à la Couronne (1155-1482), Paris, 1935, p. 192, et pour un procès entre les syndics de Nice et les ecclésiastiques de la ville dans les années 1358-1359, CSPN, nº 189-190, p. 210-219.
58. Cf. par exemple T. scLafert, Cultures en Haute-Provence. Déboisements et pâturages au Moyen Âge, Paris, 1959 ; J.-P. boyer, Hommes et communautés du Haut-Pays niçois médiéval. La Vésubie (xiiie-xve siècles), Nice, 1990, p. 37-174, 257-294 ; J. LassaLLe, « Aux confins de la Provence orien-tale. L’exercice de quelques droits d’usages au milieu du xve siècle », dans P. Jansen (dir.), Entre monts et rivages. Les contacts entre la Provence orientale et les régions voisines au Moyen Âge, Antibes, 2006, p. 35-53.
définition, prélèveMent et Gestion de la dîMe en provence orientale 485
droit sur tous les produits agricoles et les animaux59. Dans les faits, il y avait certains produits non taxés. Cela peut être établi d’une part en rassemblant les informations extraites des transactions portant spécifiquement sur la dîme ou de certaines chartes seigneuriales (annexe I60) ; d’autre part en exploitant l’en-quête d’affouagement de 147161. On sait que cette enquête qui concerne toute la Provence a conservé le nom de tous les chefs de foyer62, mais elle donne aussi une image précise des charges pesant sur les habitants, y compris la dîme. Même si les déclarations omettent certaines composantes mineures des dîmes, il y a là une source importante qui permettrait de dresser un tableau d’ensemble de la dîme en Provence. Nous avons retenu l’exemple de trente-trois localités de Provence orientale (annexe II). Par ailleurs, nous avons tiré profit d’une enquête d’affoua-gement de 1607-1609 conduite dans la viguerie de Grasse. Elle est en effet d’une grande richesse d’informations sur les terroirs, les droits seigneuriaux et la dîme et permet de connaître des usages coutumiers qui remontent sans doute à l’époque médiévale (annexe III)63.
En ce qui concerne les produits soumis à la dîme, il n’est pas surprenant de voir que ce sont les blés qui sont le produit essentiel, toujours cités en premier. Les textes en général ne prennent pas le soin de préciser ce que cela englobe. Quand ils le font64, il est question du froment, de l’avoine, du seigle, de l’orge, de l’épeautre, du méteil, du millet. Cette dernière céréale est exclue, avec l’alpiste, de la dîme à Nice. Cela semble un cas isolé.
Par légumes, on entendait principalement les fèves, les pois et les lentilles. Même si l’enquête de 1471 ne les évoque pas, il ne fait pas de doute que la dîme pesait sur ces produits. Cela apparaît dans les transactions spéficiques et dans l’enquête d’affouagement de 1609. On relève deux exceptions à cette époque : les
59. P. viarD, Histoire de la dîme ecclésiastique dans le royaume de France, cit. n. 2, p. 12-19.60. Les références sont pour l’essentiel mentionnées dans les notes relatives aux transactions avec les
habitants. Pour la charte de franchises de Cannes de 1448, cf. R. aubenas, Chartes de franchises et actes d’habitation, Cannes, 1943, p. 29-39 et p. 32 sur la dîme ; pour l’acte d’habitation de Valbonne de 1519, cf. Ibid., p. 93-111, et en particulier p. 99.
61. Archives départementales des Bouches-du-Rhône : B 200. Nous nous sommes servi principalement de la transcription faite par Ernest Hildesheimer et reproduite dans Th. chaPPé, Transcription et étude de l’affouagement de la viguerie de Grasse et de la baillie de Saint-Paul-de-Vence en 1471, Université de Nice, mémoire de maîtrise, 1972. Pour une présentation de cette source (mais sans édition du texte), cf. Th. chaPPé, « Transcription et étude de l’affouagement de la viguerie de Grasse et de la baillie de Saint-Paul-de-Vence en 1471 », Recherches régionales, 1975, nº 2, p. 1-71, et en particulier p. 38-39 à propos de la dîme. Pour quelques localités, nous avons utilisé la transcription faite par Robert Latouche (AD06, 22 J 4).
62. Cf. É. baratier, La démographie provençale du xiiie au xvie siècle, Paris, 1961.63. On dispose pour chaque localité des déclarations des consuls, de l’exposé contradictoire des consuls
de Grasse, de l’expertise des commissaires et de quelques témoignages d’habitants. Cette enquête, consignée dans deux manuscrits complémentaires (Archives communales de Grasse, CC 40 et Archives départementales des Bouches-du-Rhône, B 1321), a été éditée par Oswald Baudot et Marie-Hélène Froeschle-Chopard entre 1995 et 2001 dans la revue Recherches régionales. Elle est aisément accessible à l’adresse Internet : http://www.cg06.fr/fr/decouvrir-les-am/decouverte-du-patrimoine/les-archives-departementales/histoire-am/sources/la-viguerie-de-grasse/la-viguerie-de-grasse/.
64. Voir par exemple AD06, 1 J 132 (La Napoule, 1469).
486 GerMain Butaud
habitants de Mougins et de Cannes ne payaient pas la dîme sur les légumes. Il est probable que c’était un usage ancien. Il existe en outre un cas particulier avec les fayots ou flageolets, dont l’exemption est signalée à Nice. À Biot, le texte de 1474 précise qu’il faudra déterminer s’ils étaient bien exclus de la dîme, comme on le disait, dans le diocèse de Grasse. Dans le cas contraire, ils seraient taxés comme les autres légumes, soit le quatorzième65. Or l’enquête de 1609 fait justement état pour Biot de l’exemption de dîme pour les fayots. En toute logique, cette exemp-tion devait concerner tout le diocèse.
L’enquête de 1471 montre que les raisins ou le vin étaient soumis à la dîme dans la plupart des localités. Quand il n’est pas mentionné dans la majorité des cas cela correspond à une absence ou une quasi absence de culture de la vigne, comme c’est explicité par les habitants à Saint-Vallier et à Bezaudun.
Les dernières productions agricoles communément taxées étaient le chanvre surtout et le lin qui était moins fréquent. On les trouve mentionnés dans la plupart des tarifs de dîme, ce qui montre l’importance et la diffusion de ces cultures qui impliquent un artisanat rural par ailleurs bien mal documenté.
Hors de ces produits, qu’en était-il de la dîme ? Faut-il penser qu’elle n’exis-tait pas ou au contraire qu’elle s’appliquait tacitement du fait de son universalité ? L’enquête d’affouagement de 1609 permet d’établir que les olives (ou l’huile) ainsi que les figues échappaient normalement au prélèvement de la dîme dans cette région. À propos des olives, les deux exceptions relevées concernent Èze où, selon un barème fixé en 1331, elles étaient soumises, comme les figues et les caroubes66, à un prélèvement du trentième et Vence, où le taux était du quatorzième et s’appliquait aussi aux figues et à un ensemble de produits67. Pour les autres loca-lités documentées, le produit des oliviers n’était pas taxé. Il ne faudrait cependant pas en conclure que cela constituait une perte importante pour le clergé. Les oliviers étaient relativement rares en Provence à l’époque médiévale68. Dans de nombreux terroirs, les figuiers constituaient une culture aussi importante, pour l’alimentation humaine mais aussi pour nourrir le bétail69. Les figues faisaient partie des denrées
65. Item transigerunt, pepigerunt et convenerunt ut supra dicte partes quibus supra nominibus quod de fayolis ibidem recolligendis pro decima nihil solvatur, si in dicta Grassensi ecclesia non solvitur, ut dicitur, si vero solvatur quod etiam decimare teneantur modo et mensura aliorum leguminum predic-torum, AD06, G 195.
66. L’importance des caroubiers à Èze est encore soulignée au début du xixe siècle. « Ce fruit est excellent pour nourrir et engraisser le gros bétail ; il est même fort bon pour l’homme, soit cru, soit séché au four » (Fr. Em. foDéré, Voyage aux Alpes Maritimes, Paris, 1821, tome II, p. 127).
67. E. tisseranD, Histoire de Vence (cité, évêché, baronnie), de son canton et de l’ancienne viguerie de Saint-Paul du Var, Paris, 1860, p. 54-55.
68. L. stouff, « L’olivier et l’huile d’olive en Provence aux derniers siècles du Moyen Âge », Provence Historique, 38, 1988, p. 181-191.
69. « On ne manque jamais d’en mettre lorsqu’on plante la vigne, et il est des territoires très-étendus, tels que celui de Sospello et autres, où le figuier occupe tous les espaces qui ne sont pas remplis par l’oli-vier : c’est que son fruit, desséché, est d’une grande ressource pour les habitants ; il sert de nourriture à un grand nombre de cultivateurs pour qui le pain est rare, et en même temps, dans un pays si dépourvu de fourrages, il nourrit et engraisse les bestiaux durant la saison de l’hiver. » (Fr. Em. foDéré, Voyage aux Alpes Maritimes, Paris, 1821, tome II, p. 128).
définition, prélèveMent et Gestion de la dîMe en provence orientale 487
achetées par les marchands génois et étaient ainsi exportées par les ports proven-çaux. Comme on l’a vu, les Grassois obtinrent en 1222 la suppression de la dîme sur les figues. Il est possible que cette exemption ait influencé la coutume dans toute la région. Quoi qu’il en soit, au xve siècle, dans le diocèse de Grasse, il n’y a qu’à Mougins où existait une dîme sur les figues, au taux du dixième. Ce prélèvement atypique fut contesté par les habitants qui obtinrent sa suppression, mais l’abbé de Lérins, seigneur du village, changea par la suite d’avis. Du coup, la communauté fit appel à la cour de l’official de Grasse, puis à la cour de l’archevêque d’Embrun, avant même d’en appeler au pape. Sans résultats. Ils renoncèrent à leur contesta-tion en 1492 et la paix fut conclue sur ce sujet entre les deux camps70. En 1609, les Mouginois ne manquèrent pas d’indiquer aux enquêteurs qu’ils étaient les seuls à être soumis à la dîme des figues dans la région.
Dans le domaine de l’élevage, le foin était un produit en général exempté de dîme. Dans notre corpus, ce n’est que dans le territoire inhabité de Pégomas qu’on le taxait. Les bovins et les équidés échappaient à la dîme, mis à part à Vence et La Napoule. En revanche, l’élevage porcin était fréquement soumis à la dîme comme on le remarque dans les transactions particulières ou l’enquête de 1609, l’affouagement de 1471 étant incomplet sur ce point. Dans le diocèse de Glandèves, l’usage était de prélever un porcelet par portée, ce qui correspond à un taux proche du dixième. Dans le diocèse de Grasse, il s’agissait d’un porcelet pour deux portées71. La charte d’habitation d’Auribeau de 1497 entre dans les détails72. À La Napoule, le taux du treizième en vigueur pour les produits agri-coles et les nadons s’appliquait aussi aux porcelets, qui devaient avoir atteints l’âge de sept semaines, soit environ l’âge du sevrage73. De façon similaire, la dîme pesait quelquefois sur les volailles au taux d’un poulet par couvée74. À La Napoule, il s’agissait d’un poulet de trois semaines prélevé par maison qui dispo-sait de volaille, sinon rien n’était exigé75.
Ces prélèvements étaient mineurs en comparaison de la dîme des nadons : soit les animaux nouvellement nés, agneaux et chevreaux. Du fait de l’impor-tance de l’élevage ovin et caprin en Provence76, cette dîme portait sur le croît de
70. AD06, H 616 (13 mai 1492).71. C’est aussi le cas à Callian en 1299 (AD06, H 355). Le texte comporte quelques détails supplémentaires.72. « Pour une pourcelagne, si tant est qu’un homme n’en ait qu’une, on paiera un gros de dîme, en
monnaie courante, et pour deux pourcelagnes, une porquette en âge de vivre sans sa mère, et si un particulier en a quatre, il en payera deux, et si davantage, il payera à proportion. » (R. aubenas, Chartes de franchises et actes d’habitation, Cannes, 1943, p. 56). Le texte de 1299 concernant Callian comporte des dispositions assez proches (AD06, H 355).
73. AD06, 1 J 132.74. Voir l’enquête de 1609 et le texte concernant Callian (AD06, H 355).75. AD06, 1 J 132.76. Voir notamment Th. scLafert, Cultures en Haute-Provence. Déboisements et pâturages au Moyen
Âge, Paris, 1959, p. 9-24, 45-65, 133-165 ; J.-A. Durbec, « L’élevage dans la région de Grasse avant 1610 », Bulletin philologique et historique (jusqu’à 1610) du CTHS, 1967, p. 61-119.
488 GerMain Butaud
troupeaux de centaines et souvent de milliers de têtes77. Selon le taux de taxation le plus répandu, le décimateur avait droit à un animal nadon sur vingt. Quand le croît n’atteignait pas la quotité prévue pour la dîme, celle-ci était convertie en un paiement en numéraire : un denier par nadon à Callian en 1299, deux deniers réforciats par nadon à Aspremont en 133478.
Les taux de prélèvement
Alors que le taux du dixième semble uniformément en usage jusqu’au xiie siècle, on observe par la suite dans le royaume de France une « tendance très nette quoique locale à une diminution assez sensible » de ce taux. En dépit des exemples de prélèvement au douzième, treizième ou quatorzième qu’il a pu glaner pour différentes régions de France, Paul Viard pensait toutefois que, globalement, le taux du dixième devait être le plus fréquent, les baisses n’étant que très locali-sées79. Cet avis mériterait confirmation. Notre corpus provençal témoigne en effet d’une baisse généralisée de la dîme à tel point que le prélèvement du dixième était devenu exceptionnel. Dans les exemples proposés, ce taux n’apparaît qu'en 1471 pour le minuscule village de Sallagriffon dans le diocèse de Glandèves et pour la bourgade de Mougins. Cette localité sous la seigneurie entière de l’abbé de Lérins se démarque des autres par la lourdeur du taux de prélèvement de la dîme. Mais il y avait une compensation : les habitants étaient exempts de toute tasque tandis que celle-ci existait à Cannes, le village voisin qui dépendait également de l’abbaye de Lérins80. Chaque localité était régie par sa propre coutume, mais il y a néanmoins des tendances valables à l’échelle d’un diocèse. C’est ainsi que pour les diocèses de Grasse et de Vence, le taux du treizième était le plus fréquent pour les blés et celui du vingtième le plus commun pour les nadons et le vin. Par contraste, dans le diocèse de Glandèves, les nadons étaient plus fortement taxés, du dixième au quinzième, et dans le diocèse de Nice, les quelques exemples connus font penser qu’un quinzième des céréales seulement était prélevé au nom de la dîme. Les barèmes concernant le vin étaient les plus fluctuants, tantôt supérieurs, tantôt lar-gement inférieurs au vingtième.
Dans l’ensemble, la dîme était prélevée selon un taux qui était inférieur en général aux prélèvements à part de fruits qui touchaient les parcelles. Un censier établi en 1465 recense trente tenures situées dans le territoire de Villefranche qui dépendaient du prévôt du chapitre de Nice81. Le cens correspondait le plus
77. Pour donner un ordre de grandeur sur le menu bétail, en 1471 les habitants de Grasse déclaraient 7 410 bêtes à laine, ceux de Séranon 3 600, ceux de Cagnes 6 510, ceux Saint-Paul-de-Vence 3 750, ceux de Saint-Auban 3 000, ceux de Vence 2 700, ceux de Coursegoules 2 100, ceux de Cipières 1 620, ceux de Gourdon 990, ceux de Gars 345… (Th. scLafert, Cultures en Haute-Provence, cit. n. 76, p. 141, 143).
78. AD06, H 355 ; CSPN, nº 137, p. 149-150.79. P. viarD, Histoire de la dîme ecclésiastique dans le royaume de France, cit. n. 2, p. 28-32.80. Ce fait est affirmé dans l’enquête de 1609.81. AD06, 2 G 147, fos 58r-65r.
définition, prélèveMent et Gestion de la dîMe en provence orientale 489
souvent en un champart du neuvième ou du dixième des récoltes82 tandis que la dîme était variable (ce qui doit être un cas de figure peu commun) : elle était soit du vingtième (dix-sept cas), soit du quinzième (treize cas). Le taux le plus fort concernait plutôt les champs, mais pas uniquement. Chaque parcelle était un cas particulier. On rencontre par exemple quatre vignes soumises à un champart du neuvième et une dîme du quinzième, tandis que sept autres n’étaient redevables que d’un prélèvement partiaire du dixième et d'une dîme du vingtième… D’autres contrats agricoles témoignent de ces taux allant du huitième au onzième83. Le droit de tasque permettait par ailleurs aux seigneurs de faire des prélèvements moins élevés, et donc proches de ceux de la dîme : au treizième sur tous les pro-duits (sauf les noix) à Aspremont d’après la charte de 135484, au quinzième à Châteauneuf-Villevieille en 144385, au quatorzième pour le chanvre et le lin et au quinzième pour les blés et les légumes à La Napoule en 146186.
Il est difficile de savoir si les taux de dîme rencontrés étaient fixés depuis des siècles ou au contraire récents, ou relativement récents87. Seuls quelques cas de diminution sont connus. À l’Escarène, le taux du quinzième sur les produits de la terre, blés et légumes, que l’on rencontre en 137088 remonte en fait à une conces-sion faite le 5 novembre 1348, donc peu de temps après l’épidémie de peste noire, et évoque justement l’état de pauvreté et de détresse des habitants, ce qui amena l’abbé de Saint-Pons en accord avec le prieur du lieu à réduire du dizième au quinzième le prélèvement89. De la même façon, en 1423, à Èze, la dîme des blés et des légumes fut réduite du douzième au quinzième90.
En 1474, pour le cas de Biot, le contexte est celui d’un repeuplement récent du village. Aussi l’évêque de Grasse, coseigneur du village, afin d’encourager le développement de la communauté, remplaça le taux du douzième sur les blés et légumes par un quatorzième91. En 1501, le moine de Lérins Raynier Lascaris,
82. Dans cinq cas, le cens était exprimé en numéraire (3 ou 9 sous par exemple). Pour les 25 autres cas, on obtient les taux de champart suivants : 4 prélèvements au huitième, 7 au neuvième, 12 au dixième, un au douzième et un au vingtième.
83. Le chartrier de Saint-Pons permet de connaître des concessions au huitième (CSPN, nº 217, p. 267-268) et au onzième (nº 243, p. 301-302 ; nº 249, p. 306-307 ; nº 261, p. 327).
84. J.-P. fighiera, « La vie féodale en Provence orientale du xiie au xve siècle », Nice Historique, 1972, p. 89-127, p. 115.
85. Ibid., p. 120.86. R. aubenas, Chartes de franchises et actes d’habitation, Cannes, 1943, p. 43.87. Pour les xie-xiiie siècles, la documentation est de façon générale très mince sur les taux de pré lè-
vement pratiqués. Par exemple, pour la Picardie, sur un vaste corpus de 2 054 documents mentionnant la dîme entre 1100 et 1300, à peine une douzaine permettent de déduire la quotité du prélèvement. Elle varie du neuvième au douzième (R. fossier, « Remarques sur la dîme en Picardie (xie-xiiie siècles) », Revue du Nord, 86, 2004, p. 615-631, ici p. 627).
88. CSPN, nº 224, p. 272-273 (27 novembre 1370).89. CSPN, nº 163, p. 178-179. L’analyse de cet acte laisse un léger doute car elle ne mentionne pas expli-
citement la dîme mais parle de « redevance annuelle sur les produits des terres qui se payent à l’église de Saint-Pierre ».
90. C.-A. fighiera, Èze, Nice, 2000, p. 35.91. AD06, G 195 (7 novembre 1474).
490 GerMain Butaud
prieur et seigneur de Vallauris, alla plus loin encore pour repeupler le village : il supprima la dîme sur tous les fruits92, ce qui constitue un cas de figure unique.
La tendance à la baisse des taux se poursuivit au xvie siècle. L’enquête de 1609 en donne plusieurs exemples (annexe III). En général, la baisse était légère, d’un centième seulement, mais l’on relève une forte baisse à Antibes où le nouveau taux était seulement du quarantième. On remarque en outre qu’il y a quelquefois de légères discordances entre les taux de dîme annoncés par les consuls et ceux déclarés par les habitants interrogés par les enquêteurs. Afin probablement de jus-tifier le statu quo de leur charge fiscale, les consuls de Cipières affirmaient que les blés et les légumes étaient taxés au douzième, soit comme en 1471, mais les trois villageois interrogés parlaient d’un taux du treizième qui était dominant dans la région. Ces discordances semblent résulter du changement de la coutume : de facto la quotité avait baissé d’un centième. Le taux du treizième s’était également imposé à Mougins autrefois soumis à des taux du onzième et du dixième comme nous l’avons vu.
Lors de l’affouagement de 1728, le prèlèvement d’ensemble s’était lègère-ment amoindri93 : le taux du quatorzième sur les blés et les légumes était le plus diffusé dans les diocèses de Grasse et de Vence, associé au traditionnel ving-tième pesant sur les raisins et les nadons. Chaque diocèse disposait de sa formule de pré lè vement. Dans le diocèse de Riez, les blés et légumes étaient alors taxés au quinzième, les raisins et les nadons au dixième. Dans le diocèse de Senez, le prèlèvement était plus lourd qu’ailleurs, avec un taux du douzième pour tous les produits tandis qu’à l’inverse, dans le diocèse d’Apt, on appliquait seulement un prélèvement du vingtième. Dans la région d’Arles et d’Avignon, les taux étaient même inférieurs. Cette faiblesse des taux de la dîme dans la Provence rhodanienne est ancienne car on la remarque déjà dans les transactions des années 1260-134094. La baisse du taux ne s’est donc pas faite de façon uniforme : elle a été plus forte et plus précoce en Provence occidentale. Seule une étude d’ensemble permettrait de saisir les rythmes propres à chaque diocèse. L’érosion du prélèvement est un phénomène s’inscrivant dans la longue durée. En 1728, le taux du soixantième pour le vin était toujours en vigueur à Grasse, comme l’avait fixé la transaction de 1222. C’était le taux le plus faible rencontré en Provence95, mais comme le vignoble grassois était notable, cette dîme n’était pas négligeable. Symboliquement l’évêque et le chapitre devaient aussi tenir à cette dîme dont la suppression aurait pu constituer un précédent pour tout le diocèse…
92. R. aubenas, Chartes de franchises et actes d’habitation, Cannes, 1943, p. 62 (article 2 de la charte du 20 avril 1501) et p. 83 (article 2 de la charte du 2 octobre 1506).
93. Pour ce qui suit, voir le tableau des taux moyens de la dîme, par diocèse, pour les grains, les raisins et les nadons établi par M. DerLange, Les communautés d’habitants en Provence au dernier siècle de l’Ancien Régime, Toulouse, 1987, p. 140.
94. La dîme au dixième ne semble déjà exigée que pour les paroissiens dépendant de prieurés clunisiens ; ailleurs, on rencontre des taux du treizième, quinzième, vingtième, vingt-quatrième, voire même du trentième ou du quarantième : cf. J. chiffoLeau, « Les transformations de l’économie paroissiale en Provence », cit. n. 37.
95. M. DerLange, Les communautés d’habitants en Provence, cit. n. 93, p. 139.
définition, prélèveMent et Gestion de la dîMe en provence orientale 491
La gestion De La DîMe
Le dernier apport de la documentation du Moyen Âge tardif concerne la gestion de la dîme. On dispose en premier lieu de quelques informations sur la façon concrète de faire le prélèvement.
À ce sujet, un acte du 10 mai 1274 est particulièrement intéressant96. Il régle la façon dont étaient prélevées les dîmes par le recteur de Saint Trophime et de Saint Pierre d’Opio, celui de Châteauneuf-de-Grasse et celui de Magagnosc et Clermont, concernant le blé, le millet, les légumes, le vin et le chanvre. Il y aurait désormais deux décimateurs chaque année, choisis l’un par l’évêque de Grasse et l’autre par le prieur d’Opio. Pour leur travail de collecte, ils percevront la quinzième partie de la dîme. Les deux décimateurs jureront en présence de l’évêque et de celle du prieur d’Opio de bien collecter la dîme et de la rassembler dans la maison du prieur. Là, l’évêque prélèvera sa part, seize setiers de blé, pour moitié de froment, pour moitié des autres blés ; le prieur d’Opio prélèvera vingt-cinq setiers (dix de froment et quinze d’autres blés). Ensuite les décimateurs diviseront la dîme en trois parts égales, pour les églises de Châteauneuf, Magagnosc et Clermont. Cet accord dut être appliqué longtemps car on en connaît des vidimus de 1339, 1353 et 1413.
La charte de franchises de Mougins de 1438 précise qu’une fois les blés foulés et nettoyés, une fois requis le dîmier, les habitants pourront enlever le blé et le porter chez eux sans crainte de peine97. Le texte de 1474 sur Biot indique la même réalité : nul ne pouvait prendre sur l’aire le blé avant le passage du décimateur, ou d’une personne mandatée par lui98 Le prélèvement de la dîme se faisait donc essentiellement sur l’aire de battage.
L’acte d’habitation d’Auribeau de 1497 indique que la dîme sur le chanvre et le lin était prélevée là où on les cultivait, et celle des légumes, à la maison99. La dîme sur les vignes prenait deux formes : elle consistait soit en raisins, taxés au moment des vendanges, soit en vin, prélevé à la cuve (ad tinam, ad radum tine). D’après l’enquête de 1471, du moins d’après l’échantillon de localités considé-rées (annexe II), les deux formes de prélèvement étaient également pratiquées. Au sujet des nadons, à Mougins en 1438, à la demande des habitants, la dîme des agneaux était perçue le jour du Vendredi Saint100. C’est également la date indiquée à La Napoule en 1469101. À Auribeau, c’était à la Saint Georges (23 avril), comme pour les porcelets102.
96. AD06, G 131.97. R. aubenas, Chartes de franchises et actes d’habitation, Cannes, 1943, p. 26.98. AD06, G 195.99. R. aubenas, Chartes de franchises et actes d’habitation, Cannes, 1943, p. 56.100. Ibid., p. 27.101. AD06, 1 J 132.102. R. aubenas, Chartes de franchises et actes d’habitation, Cannes, 1943, p. 56.
492 GerMain Butaud
Pour éviter toute tromperie, la transaction de 1299 sur Callian autorise le prieur ou celui qui percevra pour lui la dîme à disposer d’un scriptor placé au portail du village pour « savoir la vérité et éviter les fraudes103 ».
Le fait marquant concernant la gestion de la dîme à la fin du Moyen Âge est le recours généralisé à des contrats de fermage. Évêques, chanoines et moines recevaient ainsi une somme convenue d’avance chaque année pendant la durée du contrat, tandis que les fermiers se remboursaient en percevant la dîme. Il arrivait que les fermes ne concernent pas seulement la dîme mais tous les revenus des prieurés, redevances foncières, droits seigneuriaux divers… Le 30 octobre 1395, Roland Phelipini, marchand de Grasse, prit ainsi à ferme le prieuré lérinien de Valbonne pour six ans, moyennant le versement de 25 florins chaque année. La dîme n’était qu’une composante de la ferme qui englobait les cens, les lods et trézains, les bans, les pâturages, les terres, les bois104. Le même Roland Phelipini s’occupa spécifiquement de la dîme selon deux autres contrats conclus avec l’évêque de Nice, agissant comme vicaire de l’évêché de Grasse. Il devint ainsi fermier de la dîme de Châteauneuf-de-Grasse, d’Opio et de Magagnosc en échange du versement de 45 setiers d’avoine et 45 setiers de froment105 et acheta la dîme des blés, des légumes et du vin de Grasse106.
En octobre 1433, l’arrentement du prieuré lérinien de Vallauris fut conclu pour une durée de dix ans entre le prieur, Paul Corme, et Honorat Clapier, de Grasse. Une première partie du contrat concernait les pâturages, estivaux et hivernaux, et la dîme des nadons de Vallauris qui étaient loués contre un versement annuel de 70 florins, ainsi qu’un mouton et un chevreau. La seconde partie de la ferme accordait au preneur toutes les terres agricoles en échange du dixième des récoltes (blés, légumes, chanvre etc.). Le prieur conservait en revanche pour lui les dîmes sur tous ces produits, de même que la possibilité de louer le ramassage des glands dans le territoire, sans pouvoir cependant y faire venir des porcs ou autres animaux. Le fermier avait le devoir de mettre en culture chaque année le tiers des terres, de façon à ce qu’en trois ans toutes les terres cultivables soient exploi-tées. Il bénéficiait par ailleurs de l’usage des étables et des greniers du prieuré, de ses prés, des récoltes des arbres fruitiers mais devait entretenir les figuiers et les treilles et s’abstenir de faire pâturer du bétail dans le verger situé derrière la demeure du prieur107…
103. AD06, H 355 (12 août 1299).104. AD06, 3 E 79/32, non folioté.105. AD06, 3 E 79/32, acte du 15 mars 1397 (n. st.) relatif à la saisie de ces blés par un sous-collecteur
apostolique.106. AD06, 3 E 79/32, acte du 24 mars 1397 (n. st.) : quittance d’un associé de Roland Phelipini.107. AD06, 3 E 79/89, fos 136v-138v (8 octobre 1433). Le 10 août 1436, ce contrat donna lieu à une
quittance partielle et à quelques modifications. Le fermier Honorat Clapier était alors associé à Jean Draqui, de Mougins (Ibid., f°228v-230r).
définition, prélèveMent et Gestion de la dîMe en provence orientale 493
Les contrats de ferme relatifs aux dîmes ne sont pas conservés en nombre suffisant dans les diocèses de Grasse ou de Vintimille108 pour permettre une étude d’ensemble. En revanche, le diocèse de Glandèves bénéficie d’un dossier docu-mentaire assez fourni entre 1481 et 1511 (annexe IV109). Ces baux émanent de l’évêque de Glandèves110, ou beaucoup plus souvent de ses procureurs. Leur libellé comprend certains éléments que l’on peut considérer comme standards. Au prélèvement de la dîme étaient associés des prélèvements secondaires dont la nature précise est difficile à définir111. La durée de la ferme était de trois ans. Le paiement se faisait chaque année en deux échéances : à la Toussaint puis à l’occa-sion du synode subséquent.
Le formulaire des actes ne permet pas de déterminer quelle part de la dîme d’une localité revenait au prélat, ce qui constitue une limite importante de ces actes notariés. Dans plusieurs villages, comme par exemple à Briançonnet qui était une dépendance de Lérins, les prieurs devaient prélever pour leur propre compte une part non négligeable de la dîme, qui échappe à notre documentation. Il n’y qu’à Villeneuve-d’Entraunes que l’on dispose pour une même année (1494), d’une part du contrat portant sur la dîme perçue par l’évêque (mise à ferme à raison de 48 florins par an pendant trois ans) et d’autre part, du contrat de fermage établi par le prieur, d’un montant de 11 florins et 4 gros par an, pendant trois ans. Pour cette dîme du prieur, il est précisé qu’elle était prélevée sur les blés, légumes et nadons. En revanche, pour les dîmes perçues par l’évêque, les actes de 1494 ne fournissent aucun détail sur l’assiette du prélèvement112 et se contentent d’indiquer que la ferme concerne ce que l’évêque a coutume de percevoir dans la localité. La com-paraison avec les contrats postérieurs, et notamment ceux de 1509, qui détaillent les choses, pose par conséquent problème. L’hypothèse la plus probable est de considérer qu’entre les deux dates la dîme portait sur les mêmes éléments. On comprend ainsi les cas où les différences entre les montants des fermes sont rela-tivement faibles, comme par exemple à Sigale ou Roquestéron. Mais il y des cas où le doute est permis. À Briançonnet, la ferme annuelle pour la dîme de l’évêque
108. Pour le diocèse de Vintimille, voir cependant les analyses d’actes dans N. aLLaria-oLivieri, « Atti dei vescovi ventimigliesi nei sec. xiv-xv in Sospello », Recherches régionales, nº 161, janvier-mars 2002, p. 40-62 : p. 41 (1356 et 1357), 43 (1380), 45 (1401 et 1402), 46 (1403), 47 (1417 et 1419), 48 (1424), 49 (1425), 50-51 (1433), 53 (1486 et 1487).
109. Les actes notariés sont tirés de trois registres : AD06, 3 E 77/61 ; Archives historiques du diocèse de Nice [AHDN], 2 E 1, registre des années 1451-1506 et registre des années 1485-1515. Certains contrats ne furent pas effectifs car nous remarquons qu’ils furent suivis d’un autre peu de temps après.
110. Les deux exceptions concernent Malaussène (dîme de la prévôté en 1494) et Villeneuve-d’Entraunes où l’on dispose aussi de la dîme affermée par le prieur du lieu. Comme nous l’avons vu, les dîmes prélevées par les prieurés monastiques étaient le plus souvent affermées en même temps que les autres droits fonciers (cens, lods et trézain, etc). Le 9 janvier 1514, par exemple, le moine de Lérins, prieur des églises Saint-Saturnin et Saint-Martin de La Rochette, les arrenta pour trois ans à deux habitants de La Rochette pour 38 florins par an (AD06, 3 E 74/13, partie non foliotée, à la fin du registre).
111. Dans les actes de 1494, les droits suivants sont énumérés après la dîme : retrodecimam tescarum bajuli, jus orreorum et collectam exceptis partitarum. Dans les actes de 1509, la formule est peu différente : retrodecimam, collectam tescarum bajuli, jus horreorum et alia jura decimalia.
112. Signalons toutefois le cas particulier de la grande dîme des nadons du Val d’Annot.
494 GerMain Butaud
était de 36 florins en 1494, mais de 140 florins en 1509, quand on sait qu’elle tou-chait les blés, légumes et nadons. À Collongues, la ferme triple durant la même période, passant 20 florins annuels à 60 florins. Face à une telle différence, on peut se demander si les contrats portent sur la même chose, ou le même territoire. La tendance à l’augmentation des fermes autour de 1500 apparaît toutefois géné-rale : elle ne souffre aucune exception. Il est difficile de ne pas en conclure que l’on assiste alors à une reprise agricole marquée, voire peut-être même spectacu-laire dans certains villages113. Pour l’évêque de Glandèves, le gain fut très notable entre 1494 et 1509.
En ce qui concerne le profil des fermiers de la dîme, on observe que la moitié des contrats sont conclus avec des personnes extérieures au village114. Mais il s’agit dans ce cas généralement de proches voisins ; seuls quelques rares contrats impliquent des personnes venues d’un peu plus loin, comme Jacquet Caroli, mar-chand de Nice, qui prit à ferme la dîme de Sigale ou maître Huguet Albin, notaire de Bargemon, qui devint fermier de celle d’Ubraye. Dans l’ensemble donc, l’af-fermage des dîmes se réglait à une échelle très locale et il n’y avait pas de fermiers cumulant les contrats. Sur les quarante-huit fermiers connus, trente-cinq n’inter-viennent que dans un seul contrat, dix dans deux contrats, et trois, seulement, dans trois contrats. L’absence de grande ville dans le diocèse explique sans doute pour partie cette situation. Remarquons aussi que jamais la ferme des dîmes n’est assumée par la communauté des habitants par le biais de leurs syndics. Il s’agit toujours de contrats impliquant des particuliers, à titre privé.
Parmi ces fermiers, les laïcs sont plus nombreux que les clercs : on en compte vingt-huit au total, contre vingt clercs. On peut les considérer comme représentant une bonne partie de l’élite sociale du diocèse car l’on relève la présence de six seigneurs et de quatre nobles115 tandis que certains villageois étaient apparentés à des clercs ou sont désignés comme maître. Le marché des dîmes épiscopales renforçait donc le pouvoir local des nobles et des notables. D’autre part, un tiers des fermiers (16 sur 48) des dîmes de l’évêque étaient les prieurs ou chapelains de la localité concernée qui donc par ce biais complétaient leur prélèvement dans la paroisse. Ils en devenaient les seuls décimateurs effectifs. Seuls quatre clercs agissent comme fermiers hors de leur lieu de résidence.
La situation que l’on observe dans le diocèse de Glandèves, où les baux d’affermage portant sur la dîme concernent un groupe élargi de clercs, nobles
113. À propos de ce lien entre dîme et reprise économique, on peut ajouter que dans le procès de 1475-1476 entre les habitants de Saint-Paul et le chapitre de Vence un témoin affirme que cent ans en arrière les dîmes de Saint-Paul rapportaient 140 florins tandis que vers 1455, elles ne valaient plus que 60 ou 80 florins, et qu’elles s’élevaient à environ 120 florins en 1475 (AD06, E 004/083, II 1, registre 2, fº 57v).
114. Sur un ensemble de 61 baux d’affermage de la dîme, 30 sont conclus avec des personnes extérieures à la localité.
115. Soit Louis de Berre, seigneur de Collongues, Honorat de Berre, seigneur de Gillette, Louis de Grasse, seigneur du Mas, Antoine de Ferres, seigneur des Ferres, Elzéar de Daluis, seigneur de Daluis et Puget-Rostang, Georges Grimaldi, baron de Bueil, et trois nobles de Puget-Théniers (Antoine de Faucon, Georges Fabri et Milan Palherii) et un noble d’Entraunes (Honorat Arnaud).
définition, prélèveMent et Gestion de la dîMe en provence orientale 495
et notables, est probablement la plus courante. Dans certains cas cependant, les fermiers pouvaient accumuler les contrats ou avaient des responsabilités plus vastes. En octobre 1513, l’évêque de Grasse Augustin Grimaldi concéda à deux fermiers, Nicolas Grimaldi, coseigneur d’Antibes et Jean Tardini, marchand de Grasse, la totalité des revenus du diocèse, les dîmes comme les revenus fonciers et judiciaires pour la somme de 1 200 florins par an (à payer en deux versements de 600 florins) pour une durée de trois ans116. Avec de tels contrats globalisants, le prélèvement de la dîme devenait une composante, parmi d’autres, des revenus de puissants personnages. Il ne profitait plus au prêtre ou aux élites du village.
* * *
À l’issue de ce panorama non exhaustif, concernant une région relativement peu favorisée par les sources, la dîme apparaît comme un prélèvement qui suscite peu les contestations des fidèles. Les lacunes documentaires empêchent de savoir si la période de refus mise en évidence dans la Provence rhodanienne dans les années 1260-1340 fut à l’ordre du jour en Provence orientale. La rareté globale des litiges aux xive et xve siècle est toutefois significative, surtout si on la compare au développement considérable de la fiscalité municipale et princière qui caracté-rise cette période. La dîme est à l’inverse un prélèvement coutumier, patiné par le temps, qui n’était quasiment jamais perçu selon le taux du dixième. Elle représen-tait en général entre le 13e et le 15e des céréales et des légumes, le 20e du chanvre, entre le 13e et le 20e des nadons, et un taux plus variable de vin ou de raisins. À cela s’ajoutaient selon les lieux quelques porcelets et poulets. Il est dommage de ne pas pouvoir déterminer, fautes de sources, depuis quand ces taux de perception étaient en usage mais ils invitent à être prudent quant on raisonne sur le poids global de la dîme, et que l'on fait des comparaisons avec les autres prélèvements fonciers. L’opinion des fidèles sur la dîme et sa raison d’être est également laissée dans l’ombre par la documentation. Contrairement à certains cas rhodaniens du xiiie siècle, on ne perçoit pas de lien entre litiges sur la dîme et anticléricalisme. Sauf exception, les revendications paraissent prosaïques, concernant les taux de prélèvement et les produits taxés et non l’usage des revenus de la dîme.
Au sein de l’institution ecclésiale, le contentieux semble en revanche actif à propos des dîmes, comme pour la période antérieure. La délimitation des aires de prélèvement d’églises voisines était l’objet d’un équilibre relativement instable. Certains territoires en particulier, même de peu de profit, étaient âprement dispu-tés car la dîme participait à la définition des droits fonciers et seigneuriaux des prieurs, que ceux-ci dépendent d’un monastère, d’un chapitre ou d’un évêque. Cette dimension patrimoniale de la dîme apparaît également dans les contrats de ferme qui intègrent parfois les dîmes aux revenus globaux d’un bénéfice. Si l’on ajoute le fait que les laïcs étaient le plus souvent les fermiers des dîmes, et donc ceux qui la prélevaient sur le terrain, la dîme apparaît comme un prélèvement
116. AD06, 3 E 74/12, fos 217v-218v (11 octobre 1513).
496 GerMain Butaud
largement sécularisé dans son fonctionnement, un « second champart » comme cela a été remarqué depuis longtemps117. En revanche, du fait du caractère excep-tionnel des dîmes laïques ou inféodées en Provence, seule l’Église en tirait des profits directs. Les profits des laïcs, en temps que fermiers, étaient indirects et plus aléatoires.
117. Cf. P. viarD, Histoire de la dîme ecclésiastique dans le royaume de France, cit. n. 2, p. 195.
définition, prélèveMent et Gestion de la dîMe en provence orientale 497
annexe i : Les taux De La DîMe en Provence orientaLe D’aPrès Les transactions
gr
ain
s/b
Lés
Lég
uM
esv
in/r
ais
ins
nad
on
sc
ha
nv
re
Div
ers
Div
ers
Cal
lian
(dio
cèse
de
Fréj
us),
1299
13e
18e (
rais
ins)
15e
10e (c
hanv
re
mâl
e se
ulem
ent)
porc
elet
spo
ulet
s
Eze
(dio
cèse
de
Nic
e), 1
331
12e
12e
20e
20e
20e (
chan
vre
et li
n)30
e : fig
ues,
oliv
es, c
arou
bes
Asp
rem
ont (
dioc
èse
de N
ice)
, 133
4
seig
neur
du
lieu
15e
15e
20e
20e
15e
0
habi
tant
s14
e14
e16
e20
e15
e0
Venc
e, 1
345
13e
13e
15e
25e (
chan
vre
et li
n)
porc
elet
s et 1
4e :
chev
aux,
vea
ux,
mul
ets,
poul
ets
14e :
figu
es,
pom
mes
, ol
ives
, noi
x,
aulx
, fro
mag
es,
œuf
s…
L’Es
carè
ne (d
iocè
se d
e N
ice)
, 137
015
e15
e25
e
Can
nes (
dioc
èse
de G
rass
e), 1
448
(cha
rte d
e fr
anch
ises
)se
lon
la c
outu
me
selo
n la
cou
tum
ese
lon
la c
outu
me
30e
chan
vre
et li
n,
selo
n la
cou
tum
e
Nic
e, 1
459
15e (
from
ent,
avoi
ne, o
rge,
se
igle
, épe
autre
, sa
uf m
illet
et
alpi
ste)
15e (s
auf l
es
fayo
ts)
10e
120
florin
s par
an
pour
rem
plac
er la
dîm
e du
vin
, du
chan
vre,
du
lin, d
es o
igno
ns, d
es a
ulx
La N
apou
le (d
iocè
se d
e Fr
éjus
), 14
6913
e13
e13
e13
e13
e (c
hanv
re
et li
n)po
rcel
ets
poul
ets
Biot
(dio
cèse
de
Gra
sse)
, 147
414
e14
e (ca
s de
s fay
ots à
dé
term
iner
)40
e20
e 20
e (ch
anvr
e et
lin)
Aur
ibea
u (d
iocè
se d
e G
rass
e), 1
497
(act
e d’
habi
tatio
n)13
e13
e (lé
gum
es
et ri
z)12
ese
lon
la c
outu
me
de l’
Églis
e de
G
rass
e13
epo
rcel
ets
Valb
onne
(dio
cèse
de
Gra
sse)
, 151
9 (a
cte
d’ha
bita
tion)
13e
13e
20e (
rais
ins)
20e (
chan
vre
et li
n)
définition, prélèveMent et Gestion de la dîMe en provence orientale 499
annexe ii : Les taux De La DîMe D’aPrès L’enquête De 1471
grains/bLés vin/raisins nadons chanvre Divers
DIOCESE DE GRASSE
Antibes 13e 20e (vin) 20e (agneaux)
Le Bar-sur-Loup 13e 30e (raisins) 20e (agneaux)
Cannes 13e 11e (raisins)
Châteauneuf-Grasse 13e 20e (raisins) 20e 20e
Cipières 12e 15e (agneaux)
Gourdon 12e 20e
Grasse 13e 60e (vin) 20e
Mougins 11e 10e (raisins) 10e 10e 10e : figues
Saint-Cézaire 13e 20e (raisins) 15e (agneaux)
Saint-Vallier-de-Thiey 12e « pas de vignes » 15e
DIOCESE DE VENCE
Andon 13e
Bezaudun 13e « pas de vignes » 20e (agneaux)
Le Broc 12e 20e (vin) 15e (agneaux)
Cagnes 13e 20e (raisins) 20e 20e (chanvre et lin)
Carros « au treizième »
Coursegoules 13e 15e (agneaux)
Gréolières (Hautes et Basses) 13e « pas de vignes » 20e (agneaux)
Saint-Jeannet 13e 20e (raisins) 20e (agneaux)
Saint-Paul-de-Vence 12e 12e (raisins) 20e 12e (chanvre et lin)
Tourrette-sur-Loup 13e 20e (vin) 20e (agneaux)
Vence 13e 15e (vin) 20e (chanvre et lin)
Villeneuve-Loubet 12e 20e (raisins et vin, sic)
20e (chanvre et lin)
500 GerMain Butaud
grains/bLés vin/raisins nadons chanvre Divers
DIOCESE DE GLANDEVES
Amirat 13e 13e 13e
Briançonnet 13e 13e
Collongues « tout au douzième »
Cuébris 13e 20e (vin)
La Croix-sur-Roudoule 15e 18e (vin) 15e (agneaux)
Gars 13e 20e (raisins) 13e
Guillaumes 15e 15e (raisins) 15e
Puget-Rostang 15e 18e (vin) 15e 15e
Sallagriffon 10e 10e (vin) 10e
DIOCESE DE FREJUS
La Napoule 13e 14e : chevaux
Séranon 12e 15e
DIOCESE DE SENEZ
Saint-Auban 13e 12e
définition, prélèveMent et Gestion de la dîMe en provence orientale 501
annexe iii : La DîMe Dans La viguerie De grasse en 1609 [et en 1471]
bLés LéguMes vin nadons chanvre Divers
DIOCESE DE GRASSE
Antibes 40e [13e] 40e [13e ?] 40e [20e] 20e [20e] 40e (chanvre et lin)
pas de dîme sur les figues
Auribeau 8e (avec tasque et quarton)
8e (avec tasque et quarton) 13e 15e 13e
Le Bar-sur-Loup 13e [13e] 13e [13e ?] 30e [30e] 20e [20e] 20e pas de dîme sur les figues et les olives
Biot 14e 14e 40e 20e 20e (chanvre et lin)
pas de dîme sur les figues, olives,
fayots, millet…
Cabris 13e 13e 20e 20e 20e pas de dîme sur les figues et les olives
Cannes 13e [13e] pas de dîme 13e [11e] (raisins) 15e 13e pas de dîme sur les
figues et le riz
Châteauneuf-Grasse 14e [13e] 14e [13e ?] 20e [20e] 20e [20e] 20e [20e] pas de dîme sur les figues
Cipières 12e ou 13e [12e] 12e ou 13e [12e ?] 20e
15e[15e] (menu bétail à l’année) ; 30e si le bétail hiverne
en dehors
20e
Gourdon 13e [12e] 13e [12e ?] 20e ou 30e ? 15e [20e] 13e
Grasse 13e [13e] 13e [13e ?] 60e [60e] 20e [20e] 20e (chanvre et lin)
Mouans et Sartoux (inhabité) 13e 13e 13e (16e ou 20e
pour Sartoux) 20e 20e pas de dîme sur les figues et les olives
Mougins 13e [11e] pas de dîme 13e [10e] 13e [10e] 13e [10e] 13e [10e] : des figues
Opio 13e 13e 20e 20e 20e pas de dîme sur les figues et l’huile
Pégomas et La Roquette (inhabités) 13e 13e 13e des foins
Saint-Cézaire 13e [13e] 13e [13e ?] 20e [20e] 15e [15e] pas de dîme sur les figues et l’huile
Saint-Vallier- de-Thiey 13e [12e] 13e [12e] pas de vignes
15e[15e] (menu bétail à l’année) ; 30e si le bétail hiverne
en dehors
20e pas de figuiers ni d’oliviers
502 GerMain Butaud
bLés LéguMes vin nadons chanvre Divers
Valbonne 13e 13e 20e 13e (ou 20e ?) 20e
Vallauris exemption de toutes les dîmes, remplacées, depuis l’acte d’habitation de 1506, par une pension annuelle à verser à l’abbaye de Lérins
DIOCESE DE VENCE
Andon (Grand-) 14e [13e] 14e [13e ?] pas de nadons
Caille et le Petit-Andon 13e [13e] 13e [13e ?] 15e un poulet par couvée
Vence 13e [13e] 13e [13e ?] 20e ou 16e [15e] 20e 20 [20e] un porcelet pour deux portées
DIOCESE DE GLANDEVES
Amirat 14e [13e] 14e [13e ?] pas de vignes 14e [13e] 14e ou 20e ? [13e]
un porcelet par portée et un poulet par
couvée
Briançonnet 13e [13e] 13e [13e ?] 13e 13eun porcelet par
portée et dîme sur les poussins
Gars 13e ou 14e [13e] 13eou 14e [13e ] 20e [20e] 14e [13e] 14eun porcelet par portée
et un poulet par couvée
DIOCESE DE FREJUS
La Napoule 13e [13e] 13e [13e ?] 13e (raisins) pas de menu bétail 13e 14e sur les volailles
Séranon 12e [12e] 13e (grossan et légumes) pas de vignes 15e [15e]
DIOCESE DE SENEZ
Saint-Auban 13e [13e] 13e [13e ?] pas de vignes 10e [12e]
définition, prélèveMent et Gestion de la dîMe en provence orientale 503
annexe iv : La ferMe Des DîMes Dans Le Diocèse De gLanDèves (1481-1511)
Sigles : A = AD06, 3 E 77/61 B = AHDN, 2 E 1, registre 1451-1506 C = AHDN, 2 E 1, registre 1485-1515
LocaLité Date Du contratDéfinition De La DîMe (baiLLeur)
Montant De La ferMe (Durée Du
contrat)
noM et statut Du ferMier De La DîMe
référence
Amirat 1494 (6 avril) dîme épiscopale (évêque) 31 fl./an (3 ans)
noble Louis de Berre, seigneur de
CollonguesA, fos 162r-164r
Annot
1494 (17 avril) dîme épiscopale (évêque) 60 fl./ an (3 ans)
Louis Albin, chapelain et vicaire
d’AnnotA, fos 207v-209r
1494 (6 avril)grande dîme des nadons du Val
d’Annot (évêque)137 fl./an (3 ans)
noble Louis de Grasse, seigneur du
MasA, fos 184r-186r
Auvare
1494 (17 avril) dîme épiscopale (évêque) 14 fl./an (3 ans)
Antoine Feraud, prieur d’Auvare et
Barthélemy Chabert, d’Auvare
A, fos 174v-176v
1509 (23 mai) dîme des blés et nadons (évêque) 46 fl./an (3 ans) Monet Arbraud,
chapelain de La Croix C, fos 96r-97v
Bonson
1494 (7 juillet) dîme épiscopale (évêque) 12 fl./an (3 ans)
maître Giraud Dalmas, fils
d’Honorat, notaire de Bonson
A, fos 228v-230r
1502 (17 mars)dîme épiscopale des blés et des nadons
(évêque)14 fl./an (3 ans)
noble Antoine de Faucon, de
Puget-ThéniersC, fos 48r-49v
Braux 1494 (17 avril) dîme épiscopale (évêque) 19 fl./an (3 ans) Pierre Piche, prieur
de Braux A, fos 211r-213r
Briançonnet
1494 (6 avril) dîme épiscopale (évêque) 36 fl./an (3 ans)
noble Louis de Berre, seigneur de
CollonguesA, fos 164r-165v
1509 (23 mai)dîmes des blés,
nadons et légumes (évêque)
140 fl./an (3 ans)Elzéar Durand,
chapelain habitant Briançonnet
C, fos 101v-103r
La Caïnée et Pierrefeu 1494 (16 avril) dîme épiscopale
(évêque) 50 fl./an (3 ans)noble Antoine de
Ferres, seigneur des Ferres
A, fos 167v-169r
Castellet-lès-Sausses et Aurent 1494 (20 mai) dîme épiscopale
(évêque) 41 fl./an (3 ans) maître Pascal Guy, de Castellet-lès-Sausses A, fos 180r-182r
504 GerMain Butaud
Châteauneuf-d’Entraunes
1494 (17 avril) dîme épiscopale (évêque) 35 fl./an (3 ans)
Antoine Antemani, chapelain
de Saint-MartinA, fos 209r-211r
1507 (17 mai) dîme des blés et nadons (évêque) 60 fl./an (3 ans) Jean Gralhe,
de Châteauneuf C, fos 51r-52v
1509 (23 mai) dîme des blés, nadons et légumes (évêque) 78 fl./an (3 ans) Jean Gralhe,
de Châteauneuf C, fos 89v-91r
Collongues
1494 (17 avril) dîme épiscopale (évêque) 20 fl./an (3 ans) Pierre de Montblanc,
prieur de Collongues A, fos 217v-219v
1509 (23 mai) dîme des blés et nadons (évêque) 60 fl./an (3 ans) Pierre de Montblanc,
prieur de Collongues C, fos 99v-101r
La Croix 1494 (17 avril) dîme épiscopale (évêque) 31 fl./an (3 ans)
Jean Ganelle et Jacques Raybaud,
de La CroixA, fos 06r-207v
La Croix, Saint-Léger, Auvare, Puget-Rostang
1494 (17 avril) petite dîme des nadons (évêque) 10 fl./an (3 ans)
Louis Magalon, chanoine
de GlandèvesA, fos 20v-222r
Cuébris 1494 (17 avril) dîme épiscopale (évêque) 28 fl./an (3 ans) Jean Guisolis alias
Gobet, de Cuébris A, fos 190r-191v
Cuébris et Saint-Antonin 1509 (3 juin) dîmes des blés et
nadons (évêque) 52 fl./an (3 ans) Jean Guisolis alias Gobet, de Cuébris C, fo 141v
Daluis
1494 (17 avril) dîme épiscopale (évêque) 25 fl./an (3 ans)
maître Balthazar Duranti, fils
de Barthélemy, de Guillaumes
A, fos 223r-225r
1501 (21 juin) dîmes des blés et vin (évêque) 40 fl./an (3 ans)
noble Elzéar de Daluis, seigneur
de Daluis C, fos 153r-154v
Entraunes 1509 (22 mai)dîmes des blés,
nadons et légumes (évêque)
163 fl./an (3 ans)
Antoine Baudoyn, vicaire d’Entraunes
et noble Honorat Arnaud d’Entraunes
C, fos 140r-141r
Les Ferres 1494 (25 avril) dîme épiscopale (évêque) 25 fl./an (3 ans) Pierre Alochi, prieur
des Ferres A, fos 225r-226v
Le Fugeret 1494 (10 avril) dîme épiscopale (évêque) 34 fl./an (3 ans)
Claude Feraud, chapelain et vicaire
du FugeretA, fos 186r-188r
Gars
1494 (16 avril) dîme épiscopale (évêque) 7 fl./an (3 ans)
noble Louis de Berre, seigneur
de CollonguesA, fos 165v-167r
1509 (23 mai)dîmes des blés,
nadons et légumes (évêque)
25 fl./an (3 ans)Elzéar Durand,
chapelain habitant Briançonnet
C, fos 101v-103r
Gilette 1494 (16 avril) dîme épiscopale (évêque) 28 fl./an (3 ans)
noble Honorat de Berre, fils d’Honorat de Berre, s. de Gilette
A, fos 170v-172v
définition, prélèveMent et Gestion de la dîMe en provence orientale 505
Guillaumes
1494 (17 avril)dîme épiscopale des blés et du vin
(évêque)140 fl./an (3 ans)
maître Barthazar Duranti, fils
de Barthélemy, de Guillaumes
A, fos 193v-195v
1494 (16 juin)dîme épiscopale des blés et du vin
(évêque)115 fl./an (3 ans)
magnifique Georges [Grimaldi] de Beuil, seigneur de Beuil.
A, fos 234r-236r
Malaussène 1511 (1er août)dîme de la prévôté
(fermiers de la prévôté)
10 fl./an (3 ans)Jérôme Stephani,
vicaire d’Ascros et prieur de Malaussène
C, fos 177r-178r
Le Mas 1494 (17 avril) dîme épiscopale (évêque) 35 fl./an (3 ans)
maître Jean-Antoine Aynes, savetier
de Puget-ThéniersA, fos 197v-199r
Méailles 1494 (20 mai) dîme épiscopale (évêque) 74 fl./an (3 ans) Jacques Albaye, fils
d’Erige, d’Annot A, fos 182r-184r
Montblanc 1494 (17 avril) dîme épiscopale (évêque) 10 fl./an (3 ans)
Jacques Michaelis, fils d’Antoine,
de Sigale A, fos 176v-178r
Peiresc 1494 (17 avril) dîme épiscopale (évêque) 40 fl./an (3 ans) Louis Rancurel,
chapelain de Peiresc A, fos 213v-215v
La Penne et Chaudol
1494 (17 avril) dîme épiscopale (évêque) 29 fl./an (3 ans)
maître Jean-Antoine Aynes, [savetier]
de Puget-ThéniersA, fos 195v-197v
1509 (23 mai) dîme des blés et des nadons (évêque) 75 fl./an (3 ans)
maître Honorat Tardelhi,
de Puget-ThéniersA, fos 98r-99v
Puget-Figette [inhabité]
1494 (17 avril) dîme épiscopale (évêque) 15 fl./an (3 ans) Jean Magalon,
de Puget-Théniers A, fos 202v-204r
1509 (20 juin) dîmes des blés et nadons (évêque) 52 fl./an (3 ans)
Augustin Lautaud, chapelain
de Puget-Théniers C, fos 142r-143r
Puget-Rostang 1494 (6 avril) dîme épiscopale (évêque) 28 fl./an (3 ans)
noble Elzéar de Daluis, seigneur de Puget-Rostang
A, fos 188r-189v
Puget-Théniers 1494 (25 avril) dîme épiscopale (évêque) 70 fl./an (3 ans) noble Georges Fabri,
de Puget-Théniers A, fos 240r-241v
Roquestéron
1494 (17 avril) dîme épiscopale (évêque) 50 fl./an (3 ans) Pierre Daniel, prieur
de Roquestéron A, fos 191v-193v
1509 (23 mai) dîme des blés, nadons et légumes (évêque) 63 fl./an (3 ans Honorat Fraynet,
de Roquestéron C, fos 87v-89r
Saint-Benoît 1494 (20 mai) dîme épiscopale (évêque) 25 fl./an (3 ans) Pierre Salvanhi,
prieur de Saint-Benoît A, fos 178v-180r
Saint-Jean d’Aurella
1494 (25 avril) dîme épiscopale (évêque) 14 fl./an (3 ans) Noble Milan Palherii,
de Puget-Théniers A, fos 238r-239v
1502 (17 mars)dîme épiscopale des blés et des nadons
(évêque)25 fl./an (3 ans)
noble Antoine de Faucon,
de Puget-ThéniersC, fos 48r-49v
506 GerMain Butaud
Saint-Martin d’Entraunes
1481 (15 nov.) dîme sur les blés et nadons (évêque) 50 fl./an (4 ans) Clément Antemani,
de Saint-Martin B, fos 259v-261r
1494 (17 avril) dîme épiscopale (évêque) 66 fl./an (3 ans)
Antoine Antemani, chapelain
de Saint-Martin A, fos 200v-204r-206r
Sallagriffon
1494 (29 avril) dîme épiscopale (évêque) 20 fl./an (3 ans)
maître Honorat Tardelhi,
de Puget-ThéniersA, fos 226v-228v
1509 (23 mai)dîmes des blés,
nadons et légumes (évêque)
40 fl./an (3 ans)Elzéar Durand,
chapelain habitant Briançonnet
C, fos 101v-103r
Sausses 1494 (17 avril) dîme épiscopale (évêque) 17 fl./an (3 ans) Louis Raybaud,
prieur de Sausses A, fos 215v-217v
Sigale
1494 (15 avril) dîme épiscopale (évêque) 70 fl./an (3 ans)
Honorat Genoesi, chapelain, curé
de SigaleA, fos 160r-161v
1509 (3 juin) dîmes des blés, vin et nadons (évêque) 83 fl./an (3 ans) Jean Guisolis alias
Gobet, de Cuébris C, fo 141v
Tourette Revest
1494 (16 avril) dîme épiscopale (évêque) 46 fl./an (3 ans)
noble Honorat de Berre, fils d’Honorat de Berre, s. de Gilette
A, fos 169r-170v
1494 (2 août) dîme épiscopale (évêque) 46 fl./an (3 ans) Jacquet Caroli,
marchand de Nice A, fos 236r-238r
Ubraye 1494 (17 avril) dîme épiscopale (évêque) 126 fl./an (3 ans) Maître Huguet Albin,
notaire de Bargemon A, fos 200v-202v
Villeneuve d’Entraunes
1494 (16 avril) dîme épiscopale (évêque) 48 fl./an (3 ans)
Antoine Juramy, fils de Jean,
de GuillaumesA, fos 172v-174v
1494 (26 avril)
dîme du prieuré, sur les blés, nadons, légumes (Pierre Amic, prieur)
11 fl. 4 gr./an (3 ans)
Erige Arnaud, chapelain
de VilleneuveA, fos 16v-18r
1509 (23 mai) dîme des blés, nadons et légumes (évêque) 78 fl./an (3 ans)
Folinus Pedone, chapelain
de GuillaumesC, fos 93r-95v
Villevieille 1494 (17 avril) dîme épiscopale (évêque) 8 fl./an (3 ans)
Louis Magalon, chanoine
de GlandèvesA, fos 222r-223r