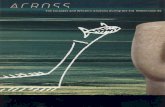The Artist Readymade: Marcel Duchamp and the Societe Anonyme
Monnayage et societe dans les Cyclades pendant la periode imperiale
Transcript of Monnayage et societe dans les Cyclades pendant la periode imperiale
Comité d’honneur (au 01.01.2015) :Jean Andreau, Alexandre Farnoux, Ian Morris, Georges Rougemont, Catherine Virlouvet
Comité de Rédaction (au 01.01.2015) :Marie-Françoise Boussac, Roland Étienne, Jean-François Salles, Laurianne martinez-sève, Jean-Baptiste Yon
Responsable de la Rédaction : Marie-Françoise Boussac
Adjoint : Jean-Baptiste Yon
Maison de l’Orient et de la Méditerranée — Jean Pouilloux7 rue Raulin, F-69365 LYon
www.topoi.mom.frwww.persee.fr/web/revues/home/prescript/revue/topoi
Diffusion : De Boccard Édition-Diffusion, 11 rue de Médicis, 75006 Paris
Topoi. Orient-Occident 19, Lyon (2014)ISSN : 1161-9473
Illustration de couverture : Tête masculine, Hatra (photo © Henri Stierlin).Illustration du dos : Temple de Maran, Hatra (photo © Henri Stierlin).
Ouvrage publié avec le concours
de la Société des Amis de la Bibliothèque Salomon Reinach
Topoi 19 (2014)p. 5-7
SOMMAIRE
Fascicule 1
Sommaire 5-7
Index des auteurs 9-10
Les sanctuaires autochtones et le roi dans l’Orient hellénistiquePh. ClanCier et J. Monerie, « Avant-propos » 11-15D. agut-labordère et G. gorre, « De l’autonomie à l’intégration. Les temples égyptiens face à la couronne des Saïtes aux Ptolémées » 17-55L. graslin-thoMé, « De Jérusalem à Babylone. Les relations entre le temple de Jérusalem et les souverains achéménides et hellénistiques » 57-100C. apiCella, « Du roi phénicien au roi hellénistique » 101-121G. tolini, « Les sanctuaires de Babylonie à l’époque achéménide. Entre légitimation, soumission et révoltes » 123-180Ph. ClanCier et J. Monerie, « Les sanctuaires babyloniens à l’époque hellénistique. Évolution d’un relais de pouvoir » 181-237L. Martinez-sève, « Les sanctuaires autochtones dans le monde iranien d’époque hellénistique » 239-277
Les CycladesR. étienne, « Les Cyclades : une expression géographique ? » 279-290Cl. hasenohr, « Le bas quartier du théâtre à Délos à l’époque impériale » 291-308H. WurMser, « L’habitat dans les Cyclades à l’époque impériale » 309-323Ch. papageorgiadou-banis, « Monnayage et société dans les Cyclades pendant la période impériale » 325-333M.-Th. le dinahet, « Les nécropoles cycladiques du ier au iiie s. apr. J.-C. » 335-399C. bouras, « Les ports des Cyclades à l’époque impériale » 401-415A. peignard-giros, « La céramique d’époque impériale dans les Cyclades : l’exemple de Délos » 417-433M. galli, « Les réalités associatives dans les Cyclades à l’époque impériale. Le bâtiment à l’intérieur de l’Agora des Déliens et le “Portique des Mystae” de Mélos » 435-455E. le Quéré, « Fortunes et “stratégies” sociales dans l’espace cycladique : le rôle des évergètes sous l’Empire » 457-476
6 sommaire
SOMMAIRE
Fascicule 2
Sommaire 481-482
De la Grèce à RomeR. Bouchon, « Démophilos de Doliché, Paul-Émile et les conséquences de la troisième guerre de Macédoine à Gonnoi » 483-513É. Prioux et E. santin, « Des écrits sur l’art aux signatures d’artiste : l’école de Pasitélès, uncasd’étudesurlanotiondefiliationartistique» 515-546
Méditerranée hellénistiqueP. schneider, « Savoirs lettrés et savoirs pratiques. Denys d’Alexandrie etlesmarchandsalexandrins» 547-563S. Élaigne et S. lemaître, « De la vaisselle et du vin chypriote au Létôon deXanthosàl’époqueromaine» 565-593
Proche-OrientJ. seigne, « Des portiques du naos de Zeus Olympien aux entrées des thermes de l’évêquePlaccus.Empruntsetrecyclagesd’élémentsarchitecturauxàGérasa» 595-627C. saliou,«Àproposdequelqueséglisesd’Antiochesurl’Oronte» 629-661
Comptes rendusS. Fachard, St. Elden, The Birth of Territory(2013) 663-670J. ZurBach, D.W. Jones, Economic Theory and the Ancient Mediterranean(2014) 671-673J. ZurBach, F. de Angelis, Regionalism and Globalism in Antiquity(2013) 675-678H. Broise, S.K. Lucore, M. Trümper (éds), Greek Baths and Bathing Culture(2013) 679-686J.-Cl. david, N. Ergin (éd.), Bathing Culture of Anatolian Civilizations(2011) 687-703r. nouet, Fl. Gherchanoc et V. Huet (dir.), Vêtements antiques. S’habiller, se déshabiller dans les mondes anciens (2012) 705-708P. Pomey, J.-M. Kowalski, Navigation et géographie dans l’Antiquité gréco- romaine (2012) ; J. Beresford, The Ancient Sailing Season(2013) 709-713S. amigues, A. Giesecke, The Mythology of Plants (2014) 715-717Chr. Feyel, J. Marcillet-Jaubert, A.-M. Vérilhac et Cl. Vial, Index du Bulletin épigraphique 1978-1984(2007) 719-733Orient ancien, époques archaïque et classiqueS. gondet, J. Álvarez-Mon & M.B. Garrison (éds), Elam and Persia (2011) 735-740
sommaire 7
H. Le meaux, M.C. Belarte, R. Plana-Mallart (éds), Le paysage périurbain en Méditerranée occidentale (2012) ; P. Darcque et al. (éds), Proasteion (2014) 741-746A. sartre-Fauriat, A.-M. Guimier-Sorbets et Y. Morizot (éds), L’enfant et la mort dans l’Antiquité I (2010) 747-748B. HoLtzmann, a. Papanikolaou, Η αποκατάσταση του Ερεχθείου (2012) 749-759Époque hellénistique et romaineG. Frija, M. Horster et A. Klöckner (éds), Cities and Priests. Cult Personnel in Asia Minor and the Aegean Islands (2013) 761-763Fr. Prost, V. Platt, Facing the Gods (2011) 765-768P. scHneider, S. Guédon, Le voyage dans l’Afrique romaine (2010) 769-773P. scHneider, St. Guédon (dir.), Entre Afrique et Égypte : relations et échanges entre les espaces au sud de la Méditerranée à l’époque romaine (2012) 775-779V. dasen, J. Mander, Portraits of Children on Roman Funerary Monuments (2012) 781-784J.-B. Yon, M. Blömer, E. Winter (éds), Iuppiter Dolichenus. Vom Lokalkult zur Reichsreligion (2012) 785-791R. raja, N. Andrade, Syrian Identity in the Greco-Roman World (2013) 793-796A. Vokaer, A. Schmidt-Colinet et W. al-As‘ad, Palmyras Reichtum durch weltweiten Handel, 2 vol. (2013) 797-800L. tHoLbecq, J.S. McKenzie et al., The Nabataean Temple at Khirbet et-Tannur, 2 vol. (2013) 801-811P.-L. Gatier, « Princes clients du Proche-Orient hellénisé » ; à propos de T. Kaizer et M. Facella (éds), Kingdoms and Principalities (2010) ; A.J.M. Kropp, Images and Monuments of Near Eastern Dynasts (2013) ; G. Vörös, Machaerus I. History, Archaeology and Architecture (2013) » 813-827Égypte et Orient de l’époque hellénistique à l’islamTh. FaucHer, R. et D. Klemm, Gold and Gold Mining in Ancient Egypt and Nubia (2013) 829-836L. martinez-sèVe, r. Boucharlat, e. Haerinck, Tombes d’époque parthe (2011) 837-840L. martinez-sèVe, G.M. Cohen, The Hellenistic Settlements in the East from Armenia and Mesopotamia to Bactria and India (2013) 841-849Fr. de caLLataÿ, F. Sinisi, Sylloge Nummorum Parthicorum VII, Vologases I – Pacorus II (2012) 851-855Ch. LerouGe-coHen, L. Dirven (éd.), Hatra (2013) 857-865Arabie, Inde, océan IndienA. aVanzini, M. Mouton et J. Schiettecatte, In the desert margins. The Settlement Process in Ancient South and East Arabia (2014) 867-874O. boPearacHcHi, I. Strauch (éd.), Foreign Sailors on Socotra (2012) 875-879J. Pons, G. Ducœur (éd.), Autour de Bāmiyān, De la Bactriane hellénisée à l’Inde Bouddhique (2012) 881-892
Topoi 19 (2014)p. 325-333
MOnnAyAGE Et SOCIété DAnS LES CyCLADES PEnDAnt LA PéRIODE IMPéRIALE
Un des changements les plus radicaux qui fut apporté dans le monde grec par la montée et la prospérité des nouvelles puissances hellénistiques fut celui du déplacement du centre de gravité du monde antique vers l’Orient, et le retrait qui s’en suivit de l’espace grec. Ce changement se stabilisa, en prenant sa forme administrativedéfinitive,aveclamiseenplacedel’empireromain.LesîlesdesCyclades, à leur échelle, ont eu évidemment le même destin, elles qui n’ont jamais été des centres de décisions importants, même si elles constituaient des carrefours sur les routes commerciales (Fig. 1).
Il n’est guère nécessaire de faire une fois de plus mention de l’image d’abandon et de pénurie qui dépeint traditionnellement l’état des îles. La situation économique est décrite justement et en quelques mots seulement par R. Etienne, « Les Cyclades auront joui de la Pax Romana, mais pas de l’Abundantia », ce qui est dû principalement au système d’exploitation imposé par les Romains 1. La position même des îles aggravait encore leur situation, puisqu’il leur était imposé souventdefaciliterlesactivitésportuairesdelaflotteromaineetdefournirdesvivres aux soldats qui hivernaient ou étaient de passage dans la région 2. Les problèmesfinanciersauxquelsdevaientfairefaceleshabitantsdesîlessontrévéléspar les sources épigraphiques 3, dans lesquelles reviennent de façon insistante des témoignages sur l’état de conservation déplorable des bâtiments municipaux de la ville, ou des problèmes d’alimentation et de prêts.
1. étienne 1990, p. 151 et 168.
2. Comme par exemple en 208 sous les Sévères. Comme l’a montré grunauer von hoerschelman 1978, les émissions des Sévères étaient frappées pour des raisons fiscales,pourpayerledonum coronarium.
3. Voir par ex., Minoa (Amorgos) : nigdelis 1990, p. 17. Voir aussi mendoni, zoumbaki 2008.
326 c. papageorgiadou-banis
Néanmoins, malgré ce sombre environnement économique, tel qu’il est habituellement décrit, et en dépit d’une dégradation administrative inévitable, uneactivitéfinancièrenouvelledébutadanslamajoritédesîlesdèslespremièresannées de l’Empire. Durant l’époque impériale, la frappe des monnaies a visé principalement à couvrir des besoins locaux, étant donné que la masse monétaire était formée par la monnaie romaine ; c’est pourquoi l’activité monétaire se limitait à un rôle d’expression et de renforcement du sentiment civique. C’est dans ce cadre que l’on peut situer la production monétaire des îles des Cyclades, qui reflète,commeonleverraplusloin,leschoixdessociétéslocales(Fig. 2).
Mykonos et peut-être Kéa sont les premières à frapper monnaie, à l’époque d’Auguste, à un moment probablement limité, puisque leur effort n’a pas eu de suite 4. On sait que Kéa avait déployé beaucoup de zèle à conférer des honneurs à l’empereur et à son épouse Livie 5, mais on ne possède pas d’informations similaires pour Mykonos. Siphnos, en revanche, est la dernière des îles de Cyclades à frapper monnaie, avec une émission unique sous Gordien. Une seule émission est aussi attribuée à Pholegandros ; de leur côté, Théra, Ios, Mélos, Naxos et Ténos ont eu une activité très limitée et intermittente.
À Ténos, la reprise de la frappe des monnaies vers 22 apr. J.-C., avec trois émissions 6, est liée, selon R. Étienne, à l’attribution, de la part de Tibère, d’une série de privilèges au temple de Poséidon et d’Amphitrite. La deuxième série, qui commença sous Sabine, a été émise durant un voyage d’Hadrien et de l’impératrice en Orient 7. On doit souligner néanmoins le fait qu’en dehors de Ténos, il n’existe pas d’enquête approfondie sur les ateliers monétaires impériaux de Cyclades ; on n’est donc pas en mesure d’estimer de manière satisfaisante l’activité véritable de chacun des ateliers.
La production monétaire de Paros est aussi faible, même si elle apparaît plus concentrée sous les règnes d’Antonin le Pieux et de Marc Aurèle.
Cette image des ateliers monétaires d’îles comme Naxos et Paros, dont la production fut importante auparavant, et dont les sources de richesse étaient toujoursexploitables,estdifficileàexpliquer–Naxoscomptelenombreleplusimportant de negotiatores, ce qui est mis avec vraisemblance en relation avec ses activités agricoles et vinicoles 8, tandis que des commerçants italiens sont attestés dans les documents épigraphiques de Paros depuis le ier siècle après J.-C. ; il ne fait
4. Le monnayage des îles est daté surtout d’après le règne de Néron, sous lequel tous les ateliers des îles furent fermés.
5. papageorgiadou-bani 1997, p. 49-50.
6. étienne 1990, p. 250.
7. étienne 1990, p. 198 et 251.
8. nigdelis 1990, p. 269-270.
monnaYage et société dans les cYclades 327A
mor
gos
And
ros
Thér
aIo
sK
eaM
élos
Myk
onos
Nax
osPa
ros
Syro
sSi
phno
sTé
nos
Phol
egan
dros
Aug
uste
Dom
itien
Ner
vaTr
ajan
Mar
kian
eH
adrie
n(S
abin
e)A
. Pie
uxM
. Aur
èle
(Fau
stine
II)
L. V
erus
(Lou
killa
)C
omm
ode
S. S
ever
e(I.
Dom
na)
Car
acal
la(P
laut
ille)
Get
aEl
agab
al(I
. Mai
sa)
(I. P
aula
)Se
v. A
lex.
(I. M
amaia
)G
ordi
en II
IA
uton
omes
328 c. papageorgiadou-banis
aucundoutequ’ilsétaientinstallésdanscetteîlebeaucoupplustôt,afindeprofiterde l’exploitation de ses marbres célèbres 9.
Andros, de son côté, présente une activité monétaire continue depuis l’époque d’Hadrien jusqu’à celle de Septime Sévère, activité qui doit probablement être mise en relation avec un programme de travaux publics important, observé pendant le iie siècle après J.-C. 10.
Contrairement aux cas traités jusqu’à présent, la situation à Syros semble complètement différente, puisque des émissions y sont attestées sans interruption, de Domitien jusqu’à Caracalla 11. Le fait que Syros ait été non seulement un port très fréquenté 12, mais aussi un centre important des Cyclades, remplaçant, d’une certaine manière, Délos, doit expliquer cet « épanouissement » monétaire. Ce fait peut être observé à travers les lettres impériales qui survivent, dont celles d’Hadrien (125), de Septime Sévère (208) et de Caracalla (après 212) 13.
Enfin,laproductionmonétaired’Amorgosestaussiintéressante14. Amorgos commence à frapper monnaie au moment où les émissions des autres îles deviennent de plus en plus rares. Une émission d’Antonin le Pieux a été récemment attribuée à cette île ; si elle lui appartient véritablement, elle pourrait être mise en relation avec une lettre de l’empereur adressée aux habitants de Minoa, lettre datée de 138quiconfirmeleurlibertéetleurautonomie15. Notons aussi que la plupart des émissions de l’île sont liées aux femmes de la famille impériale, Domna, Maesa, Paula, Mamaea, observation qui peut nous amener à supposer l’existence d’un culte impérial, pour lequel néanmoins on ne dispose pas d’autres sources.
Il paraît donc évident que la production monétaire dans les Cyclades n’a pas suivi une organisation chronologique centralisée. Chaque ville frappait monnaie quand elle considérait que la frappe de numéraire était indispensable pour des raisons qui lui étaient propres et indépendamment de ce qui se passait dans les autres îles. Nous observons néanmoins une concentration des frappes sous les Antonins. Ce phénomène pourrait être associé à des activités architecturales, réalisées presque partout dans les Cyclades, qui comprirent notamment des réparations des bâtiments publics détruits probablement à cause d’un tremblement de terre.
9. nigdelis 1990, p. 117. Pour le monnayage de cette période, nicolet-pierre 2009, p. 395-405.
10. palaiokrassa-kopitsa 1996, p. 264-265.
11. étienne 1990, p. 168.
12. nigdelis 1990, p. 275.
13. nigdelis 1990, p. 222.
14. liampi 2004, p. 63-113.
15. sugden 2004, p. 115-117.
monnaYage et société dans les cYclades 329
Par la suite, le iiie siècle fut une période de bouleversements et de crise économique, en raison des invasions barbares, attestées même dans les Cyclades.La diminution de la production à cette époque est donc tout à fait attendue.
Les choix iconographiques sont aussi différents d’une île à l’autre. Pendant l’époque impériale, on observe une tendance à la conservation de types iconographiques qui sont déjà connus depuis l’époque hellénistique et qui font allusion aux dieux panhelléniques, mais souvent avec quelques variantes. Un des cas les plus caractéristiques est celui d’Apollon, qui apparaît le plus souvent en tant que citharode, selon des prototypes attestés à Rome, qui le lient à certains empereurs (de même à Amorgos, Kea et Siphnos). On observe le même phénomène avec Athéna : qu’elle soit porteuse du casque ou de l’ensemble de ses armes, elle est mise en relation désormais avec dea Roma. En parallèle, et conformément au climat général de l’époque tourné vers l’Orient, des divinités de cette région ont été adoptées : la plus importante est, bien entendu, Isis. Dans les îles de Cyclades, ce phénomène prend un aspect particulier, puisque plusieurs familles illustres se sont déplacées vers la capitale de la province, Éphèse 16, où elles ont acquis des richesses, de la notoriété, et atteint un très haut niveau social. Cela explique probablement la représentation des divinités grecques de l’Orient, notamment Apollon de Didymes ou Artémis d’Éphèse.
Par ailleurs, des divinités déjà connues, ainsi que l’iconographie monétaire hellénistique, continuent à inspirer les émissions impériales, sur lesquelles apparaissent souvent aussi des images dont l’inspiration vient de Rome : le syncrétisme des types grecs et romains est la tendance dominante de la période, comme par exemple à Siphnos, où sont attestés d’une part l’aigle traditionnel, mais aussi les types romains d’Athéna/Rome et d’Apollon Citharodos. Syros présente à nouveau plus d’intérêt numismatique car le nombre important d’émissions connues fournit l’espace nécessaire pour Artémis, Hermès et pour les Cabires locaux, mais aussi pour la Victoire romaine près d’untrophée,pour leseffigiesimpériales et pour Isis. Théra, quant à elle, représente toujours son dieu tutélaire, Apollon, mais sous des formes diverses (soit un xoanon archaïque, soit un Apollon citharode romain, soit encore, avec une belle qualité artistique, sur un cygne en vol) ; à Andros, où les références au culte de Dionysos formaient la majeure partie de l’iconographie hellénistique, le dieu est représenté à nouveau avec le thyrse et le canthare. À Mélos aussi, on conserve le type déjà connu à l’époque hellénistique, la tête d’Athéna, mais aussi la gravure de l’ethnique ou du nom du magistrat dans une couronne. À Mykonos, de la riche iconographie hellénistique ne survit que Dionysos, la principale divinité de l’île. Naxos et Paros déploient un répertoire aussi limité que leur activité monétaire. À Naxos, seule une amphore rappelle le culte dionysiaque ; les trois Charites, Tyché et la corne d’Amalthée pourraient certes appartenir à un plus large cycle dionysiaque, mais n’en sont pas vraiment
16. nigdelis 1990, p. 294-295 et 298, comme le cas de T. Cl. Frontonianus (Mélos) ou les Flavii de Théra.
330 c. papageorgiadou-banis
caractéristiques. À Paros apparaissent seulement des types nouveaux : Athéna, les trois Charites (à mettre peut-être en parallèle avec l’iconographie naxienne) et une lyre surement en relation avec Archiloque. À Ténos, Poséidon cède la place à une divinité dont l’identité est discutée – elle pourrait être Poséidon, mais rappelle beaucoup Dionysos – tandis qu’à Pholegandros apparaît pour la première fois Athéna. Ce n’est qu’à Ios que sont utilisés tous les types déjà connus, ainsi Athéna, Homère et le palmier.
Comme les besoins de l’économie dans l’environnement élargi des temps impériaux n’exigeaient pas une activité monétaire abondante et continue, il est évident que les cités insulaires eurent la liberté d’exercer leur activité monétaire sans conditions, aussi bien chronologiquement qu’idéologiquement. C’est précisément ce que prouvent d’une part l’existence d’émissions limitées, sans continuité ni cohésion, et d’autre part les choix iconographiques.
Les productions monétaires locales ne semblent pas être liées à des épisodes historiques de grande importance ;ellesnereflètentpasnonpluslapropagandeofficielle impériale. En revanche, il est évident qu’elles servent les besoinslocaux, très souvent liés à des initiatives impériales en direction des insulaires : les cas d’Andros, où la production monétaire correspond au programme de constructions du iie siècle après J.-C., ou même de Kéa ou de Ténos, dont des émissions isolées sont rattachées à des voyages impériaux connus par les sources littéraires et épigraphiques, sont caractéristiques. C’est dans ce même contexte qu’on peut situer la production monétaire de l’époque de Marc Aurèle : la présence de représentants impériauxenvoyéspourassainir lesfinancesdelarégion17 fut un événement important, comme en témoignent les inscriptions de Minoa à ce sujet 18. Évidemment les décisions concernant le début, la durée ou la masse de la production monétaire, ainsi que le choix de l’iconographie, ont été prises dans un cadre local. Nous verrons ci-dessous qu’elles étaient liées à l’autopromotion de la classe supérieure.
Durant l’époque impériale, alors que les communautés locales, comme en témoignent les inscriptions, souffraient, les sources de richesse furent concentrées dans les mains de peu de gens, qui exerçaient le pouvoir. Il s’agissait surtout de membres des anciennes familles aristocratiques qui avaient acquis, grâce aux revenus de propriétés rurales, des fortunes importantes et qui investirent ces fortunes dans les grands centres de l’époque, en particulier dans la capitale de la province, Éphèse 19, pour obtenir une reconnaissance économique et sociale ; ils se transmettaient le pouvoir de façon héréditaire. Ils devaient répondre aux demandes de l’autorité mais aussi se distinguer – ἐν πολλαὶς ἀρχαὶς καὶ
17. nigdelis 1990, p. 222.
18. nigdelis 1990, p. 151 et 304.
19. Ayant obtenu la civitas romana, dès l’époque augustéenne.
monnaYage et société dans les cYclades 331
λιτουργίαις καὶ εὐεργεσίαις – 20. C’est justement cette obligation, que souvent les anciens aristocrates – aristoi – n’étaient plus en mesure de prendre en charge, qui amena sur le devant de la scène d’autres catégories sociales dont les membres remplissaientlesconditionsfinancièrespourlaprisedeparticipationaupouvoir.Des Romains 21, des Italiens 22, mais aussi des affranchis (ἀπελεύθεροι) eurent accès aux plus hautes fonctions locales, puisqu’ils avaient la richesse nécessaire pour assumer des évergésies 23.
En tout cas, l’entrée en charge dans les fonctions civiques était marquée par une série de dons pour les gens plus faibles économiquement, des fêtes et des banquets publics 24, et par une série de promesses publiques (εἰσαγγελίες)afindefinancerdesconstructions importantes25. Les contributions majeures au bien commun devaient être le prêt à la cité à taux avantageux pour réussir à régler les obligationsfiscalesenversRomeetlesaidesfinancièrespendantlespériodesdefamine 26. Bien entendu, les contributions excessives, et sans utilité évidente, ne manquaient pas, comme les statues impériales qui visaient surtout à impressionner et à célébrer la personne du dédicant.
Comme le mentionne Nigdelis, dans tous les cas, quelle que fut leur importance, les εὐεργετούντες dédiaient à l’empereur les travaux et les charges, qu’ils avaient assumés 27,afind’obtenirlabienveillancedel’autoritésupérieure:cela leur était indispensable pour faire partie de la société romaine et gravir les échelons permettant d’accéder aux plus hautes fonctions 28, étant donné que la plupart avait des intérêts et des ambitions dans les grands centres de la province.
20. nigdelis 1990, p. 63 (Aigiale, Amorgos).
21. Les aristocrates romains, même s’ils n’étaient pas eux-mêmes installés dans les îles, avaientdes intérêtsfinanciers importants,commel’exploitationsoitdes terressoitdes produits locaux.
22. Une autre catégorie de citoyens provenant de Rome ou d’Italie, étaient les descendants des premiers συμπραγματευομένοι de Délos ou negotiatores, qu’on trouve dans les Cyclades dès le iie s. av. J.-C., et qui s’étaient bien assimilés aux sociétés locales.
23. Leur essor financier devait être dû au commerce et la navigation, ainsi qu’auxressources locales.
24. nigdelis 1990, p. 64, à propos des δημοθοινίαι.
25. CommeTiberiusFlaviusKleitosthenesClaudianus, qui avaitfinancéune série deconstructions importantes à Théra.
26. Comme Satyros Phileinos à Ténos. Les affranchis jouaient peut-être un rôle important dans ce domaine, car ils étaient des acteurs majeurs du commerce.
27. nigdelis 1990, p. 302.
28. nigdelis 1990, p. 103.
332 c. papageorgiadou-banis
Nous considérons que les frappes monétaires locales devaient constituer un moyen pourfaireréférenceàl’empereuretàsafamillequ’elleshonoraientetflattaient.
Les magistrats locaux à l’occasion d’une contribution ou d’un bienfait envers les communautés civiques soit provoquaient soit se chargeaient de la frappe des monnaies. Mais on ne sait qui avait le dernier mot pour décider de ces émissions : l’empereur, le Sénat, le gouverneur de la province ou quelqu’un à un niveau inférieur ? Dans tous les cas, ces monnaies devaient être émises pour être distribuées au peuple à l’occasion de l’entrée en charge dans une fonction ou lors d’une euergesia ou de l’organisation de banquets publics. Ainsi pourrait-on expliquer le nombre important des monnaies frappées par Syros, qui a aussi fourni un nombre non négligeable d’inscriptions concernant les δημοθοινίαι, les banquets publics.
Dans tous les cas, étant donné que le monnayage était une fonction de l’État, les magistrats donnaient une aura impériale à leur donation, s’assuraient de la faveur du souverain et, en même temps, réussissaient leur propre promotion, obtenaient une reconnaissance et tout ce que cela impliquait en dehors des limites du cadre local. On peut mentionner, à titre de parallèle, le cas des monetales de la république romaine, qui, toujours dans le cadre de l’État, réussirent à rendre publiques leurs valeurs familiales et leurs traditions, en bref, leur nom. Par ailleurs, il est évident que les frappes servaient les besoins locaux, elles étaient très souvent liées à des initiatives impériales en direction des insulaires. Les cas d’Andros, où la production monétaire importante correspond au programme de constructions du iie siècle après J.-C., ou même de Kéa ou de Ténos, dont des émissions isolées ont été rattachées à des voyages impériaux connus par les sources épigraphiques sont caractéristiques.
Cette première enquête restreinte à la question des émissions impériales dans les Cyclades devrait conduire à examiner prochainement sur une échelle plus large les raisons et la position des monnayages locaux dans les provinces grecques du monde romain, et à rechercher aussi les responsables qui furent à l’origine de ces émissions.
Charikleia papageorgiadou-banis
FondationNationaledelaRechercheScientifiqueCentre de Recherche de l’Antiquité Grecque et Romaine
Bibliographie
étienne R. 1990, Ténos et les Cyclades du Ive s. av. J.-C. au IIIe s. ap. J.-C., Ténos II, BEFAR 263, Paris.
grunauer von hoerschelman s. 1978, Die Münzprägung der Lakedaimonier, Berlin.liampi k. 2004, « The coinage of Amorgos », RN, p. 63-113.mendoni L. et S.B. zoumbaki 2008, Roman Names in the Cyclades I, ΜΕΛΕΤΗΜΑΤΑ 56,
Athènes.
monnaYage et société dans les cYclades 333
nicolet-pierre H. 2009, « Monnaies de Naxos (Cyclades) d’époque impériale romaine », in ΚΕΡΜΑΤΙΑ ΦΙΛΙΑΣ, Τιμητικός τόμος για τον Ιωάννη Τουράτσογλου, Athènes, p. 395-405.
nigdelis 1990 = Π. Μ. Νιγδελη, Πολίτευμα και κοινωνία των πόλεων των Κυκλάδων κατά την Ελλενιστική και Αυτοκρατορική εποχή, Thessalonique.
palaiokrassa-kopitsa l. 1996, Παλαιόπολις Άνδρου. Τα οικοδομικά από την προανασκαφική έρευνα, Andros.
papageorgiadou-bani Ch. 1997, The Coinage of Kea, ΜΕΛΕΤΗΜΑΤΑ 24, Athènes.sugden k. 2004, « Minoa on Amorgos, some new imperial coins », RN, p. 115-117.