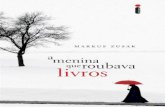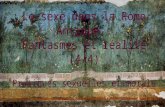Protocole expérimental du Cybermarket Le sexe fait-il acheter
Menina : construction d’une catégorie féminine dans le travail du sexe à Fortaleza, Brésil
Transcript of Menina : construction d’une catégorie féminine dans le travail du sexe à Fortaleza, Brésil
1
École des Hautes Études en Sciences Sociales
Master II
Ethnologie et anthropologie sociale
Ana Paula Luna Sales
Menina : construction d’une catégorie féminine dans le travail du sexe à Fortaleza,
Brésil
Mémoire dirigé par Laurent Barry (LAS : EHESS)
Soutenance le 5 juillet 2013
Jury
Laurent Barry (Maître de Conférences, EHESS, directeur)
Marie-Élisabeth Handman (Directrice d’Études, EHESS)
Klaus Hamberger (Maître de Conférences, EHESS)
2
“The basis for classification does not inhere in the objects themselves
but in how they are transacted and to what ends. The action is the
gendered activity.” (STRATHERN, 1988, p. xi)
L’intérieur du Restaurante Granada.
3
Remerciements
Je voudrais remercier toutes les meninas qui ont dédié leur patience et leurs efforts à
cette recherche. Plus spécifiquement, j’adresse mes remerciements à Andrea, qui était toujours
très attentive à ma présence sur le terrain, et à Larice, qui depuis le début a stimulé les
meninas à parler avec moi et à bien m’expliquer leur travail. Plusieurs autres meninas m’ont
soutenu à des moments importants. Je remercie Cassandra, Nálary, Stéphanie, Rafaela,
Valdete et Lia.
Je remercie sincèrement Laurent Barry qui a accepté de diriger cette recherche et s’est
montré très disponible pour la discuter, la critiquer et la soutenir malgré les soucis
additionnels dûs aux imperfections de l’écriture en français. Je remercie aussi Marie-Élisabeth
Handman qui, à côté de Laurent Barry, m’a dirigé au long du master et m’a introduit dans le
monde la politique de la prostitution en France.
D’autres enseignant-e-s encore ont été très soucieux et soucieuses dans la discussion et
la critique de mes travaux durant le master. Je voudrais remercier Klaus Hamberger (EHESS),
Michael Houseman (EPHE), Catherine Laurière (EHESS), Sébastien Roux (CNRS) et Michel
Bozon (INED).
Je remercie également tout le cadre de l’EHESS et spécialement la mention Ethnologie
et anthropologie sociale qui m’a concédé l’aide au terrain qui a permis la systématisation des
données sur les meninas présentes dans ce travail. Cette et d’autres démarches académiques
ont été facilitées par Véronique Poullet, que je remercie sincèrement. Je suis aussi
reconnaissante à tout le personnel du LAS et de la Bibliothèque Claude Lévi-Strauss, où j’ai
eu les conditions parfaites pour faire la recherche bibliographique.
La correction de l’écriture en français a été le résultat de plusieurs efforts. À Natacha
Raynal, Thierry Veyrié, Marion Porry et Oto Cronopio je dois remercier pour leur
disponibilité pour corriger ce mémoire et pour leur amitié. Je remercie aussi la sympathie et le
soin d’Audrey Laurent dans la correction professionnelle de certaines parties de ce texte.
Dans l’EHESS et le LAS, la pause-café était toujours animée par des conversations
fructueuses avec collègues et ami-e-s. Un grand merci à Mariana Guanabara, Francesca
Minuti, Vinícius Ferreira, Agathe de Framond, Nicolas Adde et Clément Sellier. Presque tous
les sujets présents dans ce mémoire ont été discutés auparavant avec eux et elles.
Les liens du Brésil, même si lointains dans cette période, n’ont pas été moins
importants. Je remercie Rafael Vital, mon fiancé, qui m’a soutenu de toutes les manières dans
la réalisation de l’enquête et l’écriture du mémoire. Sans doute ce travail ne serait pas le
4
même sans son appui. Je remercie mes parents, Assis et Claudia Sales pour le soutien
financière et émotionnel indispensable, ainsi que mes frères Francisco Neto et Bruno Sales
pour leur intérêt et soutien, et ma grand-mère, Amandina Luna.
Je voudrais remercier également mes ami-e-s au Brésil et en France. Merci Claire
Paugam, Marion Fontaneil, Émilie Pagnon, Juan Cardenas, Emilio et Chantal Raimondo, côté
France. Au Brésil ou ailleurs, merci Mariana Magalhães, Sávio Cunha, Lívia Linhares,
Osivan Junior, Rodrigo Carvalho, Sara Pontes, Renata Oliveira, Carol Borges, Rachel Brás.
Finalement, je remercie mes collègues et professeur-e-s du Brésil : à l’UECE, mon
tuteur dans cette institution, João Tadeu de Andrade ; à l’UFC, mon amie et professeure
Simone Simões ; au projet de recherche au CNPq Cinderelas, merci Ilnar de Sousa, Érika
Pinho et Raquel Mesquita. Je remercie ceux et celles qui s’engagent dans la recherche du
marché du sexe au Brésil, en spécial Hélio Silva, Soraya Simões et José Miguel Nieto Olivar.
Saravá !
5
Résumé et mots-clés
Cette étude a le but de comprendre les modes d’identification des catégories du travail
du sexe à partir de la pratique par les meninas du Restaurante Granada, à Fortaleza, Brésil.
Avec ce propos nous avons livré une analyse des éléments qui constituent leur réseau,
construit comme un groupe discret. Le partage de savoirs et de pratiques a été perçu comme
central dans sa structuration. Leurs concepts émiques sont souvent construits par rapport aux
connaissances issues d’autres institutions sociales de sorte qu’il a été important aussi de les
exposer dans leur croisement et réappropriation perçus dans les savoirs des meninas. Aussi les
relations avec d’autres sujets qui participent au quotidien du Restaurante Granada et du
quartier où il se situe ont été recherchées. Les moyens que les meninas utilisent pour classifier
et regrouper ces autres sujets de leur espace professionnel ont été très éclairants sur la
construction de leur propre groupe et sur leur choix contextuel des catégories. En plus, ces
catégorisations indiquent des modèles de relation préétablis valables pour toutes les
composantes ainsi que pour les concepts de genre et sexualité dans la perspective des meninas
qui sont largement employés dans leur analyse et expérience des marchés au sexe.
Comprenant l’inscription du groupe et de la catégorie de meninas il est possible d’envisager
que la constitution de ces femmes en tant que collectivité potentialise leur capacité d’agency
et que leur activité dans l’espace de prostitution que nous avons étudié les pousse à reformuler
leurs propres règles de genre et de sexualité.
Mots-clés : travail du sexe, catégorisations, savoirs, pratiques, genre, sexualité, perspective,
agency.
6
Table des matières
Remerciements ......................................................................................................................... 3
Résumé et mots-clés ................................................................................................................. 5
Table des matières .................................................................................................................... 6
Introduction .............................................................................................................................. 8
Chapitre I : La catégorie meninas ........................................................................................ 15
1. Savoirs techniques et identification sexuelle ............................................................ 16
2. Une sexualité en commun au Granada ..................................................................... 19
3. Adhésion individuelle et appartenance au groupe .................................................. 23
4. L’influence du programa sur la sexualité des meninas ............................................ 25
Chapitre II : Catégorisation et production des savoirs extérieurs .................................... 31
1. Le savoir associatif ..................................................................................................... 31
2. Le savoir législatif et juridique.................................................................................. 33
3. Le savoir géographique .............................................................................................. 34
4. Le savoir médical ........................................................................................................ 36
5. Le savoir religieux ...................................................................................................... 39
6. Le savoir médiatique .................................................................................................. 41
7. Le savoir anthropologique ......................................................................................... 42
8. À quoi les savoirs servent-ils ? ................................................................................. 44
Chapitre III : Identification et différenciation à travers la catégorisation des femmes au
Granada ................................................................................................................................... 46
1. Les meninas qui volent ............................................................................................... 47
2. Les meninas de la boîte .............................................................................................. 49
3. Les meninas qui sortent avec des gringos ................................................................. 49
4. Les meninas riches qui font des programas .............................................................. 50
5. Les filles qui embrassent n’importe qui aux fêtes ................................................... 51
6. Les femmes mariées ................................................................................................... 53
7. Les femmes de la mairie ............................................................................................. 54
8. Les femmes et leur famille ......................................................................................... 56
9. Les folles ...................................................................................................................... 61
10. L’ethnologue ................................................................................................................ 61
Chapitre IV : Identification et différenciation à travers la catégorisation des hommes au
Granada ................................................................................................................................... 63
7
1. Les clients anonymes .................................................................................................. 64
2. Les clients bien soignés et parfumés ......................................................................... 68
3. Les clients amis ........................................................................................................... 69
4. Les clients du bar ........................................................................................................ 71
5. Les travailleurs du quartier ...................................................................................... 72
6. Les hommes et leur famille ........................................................................................ 73
7. Les compagnons.......................................................................................................... 77
Conclusions ............................................................................................................................. 81
Bibliographie ........................................................................................................................... 86
Glossaire .................................................................................................................................. 89
Annexes ................................................................................................................................... 92
8
Introduction
La présente étude se base sur deux périodes de travail de terrain : une première en
2010, pendant huit mois, selon la méthode ethnographique, et une deuxième en 2013,
consistant en un mois d’enquête intensive pour la systématisation des données recueillies
précédemment. La réalisation de la recherche en deux temps a été essentielle à la définition de
l’objet de cette étude.
Avant toute chose, je souhaiterais souligner que c’est d’un problème de terrain qu’a
émergé cette problématique anthropologique. Entre les deux enquêtes, plusieurs éléments sont
restés inchangés. L’espace est un bar, le Restaurante Granada, situé dans le quartier du Passeio
Público, territoire qui abrite les phénomènes et les groupes sociaux ici concernés. Ce territoire
est localisé au centre-ville de Fortaleza, Ceará, Brésil. Il s’y pratique divers types de
prostitution féminine, populaire, locale et hétérosexuelle qui constituent le sujet de cette
recherche.
Les deux études sont menées depuis la perspective des meninas, travailleuses du sexe
qui « officient » principalement au Restaurante Granada. Entre 2010 et 2013, ce groupe de
femmes a peu été modifié, si ce n’est en raison du départ de quatre d’entre elles, ayant
abandonné la profession, et de l’arrivée de cinq nouvelles. Les personnes côtoyant ces
meninas sont, elles aussi, les mêmes, à l’exception du serveur, Victor, renvoyé en 2010.
Aucune remarque sur les clients n’a été formulée par ces femmes.
Le travail du sexe au Restaurante Granada se fait sans maquerelle ni proxénète. Les
meninas gèrent seules leur activité professionnelle et leur organisation, en tant que groupe,
comprend des hiérarchies qui ne sont pas statiques. Elles règlementent elles-mêmes leurs
relations avec les clients, ce qui ne laisse place à aucune violence ou abus de ces hommes à
leur encontre.
En 2010, j’ai observé plusieurs bagarres au sein de ce bar, entre les meninas résidentes
ou les meninas et des femmes de l’extérieur (les meninas qui volent, par exemple). À l’égard
des clients, il ne s’agit pas de conflits à proprement parler, sinon d’expressions féminines de
mépris en public. En revanche, en 2013, aucune dispute physique n’a été relevée, les femmes
se dénigrant désormais les unes les autres de façon plus subtile.
Si les agents de l’État, telle la police, ou les fonctionnaires de la mairie peuvent être au
centre des discussions, ils n’interviennent toutefois que ponctuellement, laissant ainsi les
meninas, et leur clientèle, à l’abri de toutes poursuites.
Toutes les meninas appartiennent actuellement aux classes populaires, sauf deux
9
d’entre elles, issues des classes moyennes. Avant d’être prostituées, elles ont travaillé comme
employées de maison, femmes au foyer ou petites commerçantes. Lorsqu’interviewées, elles
m’ont systématiquement affirmé que leur entrée sur le marché du sexe avait été volontaire, sur
les conseils d’une amie, d’une voisine. Pour toutes, la scolarité s’est arrêtée avant le
baccalauréat et, pour certaines, la prostitution a succédé à un précédent travail débuté dès
l’adolescence.
Presque toutes sont mères et en couple. La plupart qualifient leur peau de brune ou de
noire. Elles font très attention à leur apparence physique, et j’ai pu remarquer, en 2013,
qu’elles soignent maintenant également la forme et le fond de leur conversation. Néanmoins,
elles n’adhèrent pas pour autant à l’ethos des classes aisées : « Ton petit-ami est avocat ? Le
mien, c’est un délinquant juvénile ! », m’a lancé Andressa d’un ton moqueur.
Les horaires de fonctionnement du bar ont évolué. Tandis qu’en 2010 il n’ouvrait que
du lundi au samedi de 8 heures à 20 heures, en 2013, le dimanche était devenu ouvré, y
compris pour les meninas. Ces dernières ont également intensifié la fréquence de leurs
voyages professionnels afin d’accroître leurs revenus.
Leur salaire a ainsi considérablement augmenté. À ce propos, de nombreux facteurs
sont à identifier. À l’instar des nouveaux horaires et conditions de travail, le prix du programa
ou « passe » est passé de 30 reais (environ 12 euros) à 40 reais (15 euros). Ceci résulte de
l’augmentation du salaire minimum au Brésil, à présent de 678 reais (255 euros).
Leur relation à la drogue a aussi visiblement changé : leur utilisation a diminué alors
que le petit commerce entre elles et leurs clients s’est, lui, développé. La peur de la répression
policière freine toutefois ce trafic. En dépit de leurs diverses pratiques illicites, la prostitution
demeure leur source majeure de revenus. Le sujet de ce trafic n’étant pas au cœur de cette
enquête, les meninas n’ont pas été amenées à me le détailler, même si elles ne s’en sont pas
cachées.
La première recherche se concentrait sur les spécificités des rencontres au sein du
travail du sexe. La structure du programa est le dénominateur commun dans la pratique de la
prostitution des meninas, les distinguant d’autres professionnelles. Les meninas m’ont appris
les impératifs du programa, me permettant ainsi de modéliser leur pratique et de comprendre
leur conception de la sexualité. Pour elles, leur sexualité n’entre pas en jeu dans leur
prostitution.
C’est d’ailleurs ce qui s’est nettement dégagé de nos échanges et de leur réaction à la
lecture de mon premier mémoire (de licence) sur le sujet. Alors que je craignais de les
offenser en les interrogeant sur leur intimité, elles n’ont pas manqué de me faire savoir que ce
10
n’était pas le lexique de la sexualité qui les dérangeait, sinon le terme « prostituée ».
Car, à la fin de mon enquête menée en 2010, j’avais tenu à remettre à Larice, vendeuse
de snacks et fidèle compagne des meninas, quelques copies de mon mémoire de licence.
J’étais soucieuse de leur réaction face à la diffusion publique de leurs paroles et faits intimes,
même si des pseudonymes avaient été utilisés.
J’ai perçu leur mécontentement et, devant leur refus de m’en donner la raison, suis
allée trouver directement Andrea, ladite « chef » des meninas. Elle s’est approchée et m’a
avoué à voix basse que le souci venait du titre : « On n’apprécie pas trop que tu mettes le mot
‘prostitution’ ». Qu’elle me le dise tout bas m’a montré combien la présence du mot
prostitution dans le titre les avait choquées.
Cela m’a affectée car, si au quotidien elles se qualifient majoritairement de meninas,
elles emploient aussi couramment le terme « prostituée », voire « pute ». J’ai alors eu la
sensation de n’avoir rien compris d’elles et leur ai demandé quel nom elles auraient préféré
que j'utilise. Andrea m’a indiqué pour le titre celui de « travailleuses du sexe ». Un peu
confuse et, je dois l’avouer, honteuse, j’ai répliqué : « Mais, vous n’avez jamais utilisé ce
terme en ma présence. » Ce à quoi Andrea m’a rétorqué : « Si tu rédiges un travail, désigne-
nous dans le titre comme travailleuses du sexe, pas prostituées. »
Pendant quelques temps, je n’ai pas su comment mettre ce reproche à profit. Que les
meninas n'apprécient pas l'intégralité de mes propos, soit, mais la confusion des catégories
était une erreur qu'il me fallait rectifier. C’était un peu comme parler d’ « esquimau » au lieu
d’ « inuit » ! Pourtant, la catégorie « travailleuse du sexe » est demeurée quasi inexistante
dans les données recueillies lors de l’enquête de terrain de 2013.
La première difficulté relative à l’élaboration de ce travail a donc été de désigner
correctement les meninas, celles-ci utilisant principalement ce terme, toutefois trop général
hors contexte pour faire référence, de façon satisfaisante, à un groupe discret. Or, si le souci
concernant ce nom venait manifestement de son usage en contexte, la réponse devait, elle
aussi, faire cette même différence, soit appréhender l’utilisation faite par les meninas de
chaque catégorie, selon le contexte.
La question du titre renvoie à une nouvelle analyse de la situation politique des
meninas : si elles ne sont pas intégrées dans la politique institutionnelle, cette dernière ne leur
est pas inconnue. Or, « le sexe est toujours politique » (RUBIN, 2010, p. 137). L’expression
« travailleuses du sexe » a été adoptée dans les années 1990-2000, par divers groupes de
femmes travaillant dans ce ‘secteur’. Elle a été très diffusée et associée à l’idée de fierté de la
profession. En dépit des disputes actuelles autour des formes de catégorisation, le
11
positionnement le plus parlant pour les meninas demeure celui du travail du sexe.
Bien que les détails de ces divergences soient exposés plus loin, je souhaiterais d'ores
et déjà émettre quelques remarques sur cette situation. La politique est partie prenante du
quotidien des meninas et ce, beaucoup plus que leur organisation un peu diffuse et leur
manque d’institutionnalisation ne le laisserait suspecter.
La catégorie non-controversée des meninas, à l'instar de celle, réfutée, des
« prostituées », doit donc se nommer « travailleuses du sexe » lorsqu’il s’agit de titres publics,
diffusés. Andrea en a exposé la problématique au nom de toutes. Comme nous l'avons
mentionné ci-dessus, cette femme porte le surnom, souvent taquin, de « chef », en raison de sa
position centrale au sein du Restaurante Granada. Si la hiérarchie existe dans ce bar et que les
pouvoirs s’y cristallisent, nous sommes très loin d'un type d’organisation qui comprendrait un
chef officialisé en bonne et due forme.
Mais, que révèlent ces plaisanteries autour du statut de chef officieux d'Andrea ? Qu'il
existe une division entre les meninas, à savoir entre celles de ce bar et les autres. Bien que ce
groupe ne constitue ni une ethnie, ni une association ou une classe, le sens communautaire y
est bien présent. « Nous sommes des travailleuses du sexe », a affirmé Andrea. Elles forment
un groupe discret, dans lequel on peut être accepté/e ou laissé/e en marge, catégorisé/e comme
menina ou au moyen d’un autre terme marquant une distanciation. C’est sur les processus
d’identification aux catégories en tant que collectivité qu’est bâtie cette étude.
Le terme « prostitution » et ses dérivés ont été retirés du titre. Cependant, ils ne sont
pas voués à être exclus de ce corps de texte compte tenu, sur le terrain, de la multitude de
pratiques effectives y renvoyant bel et bien. Dans leurs relations à l'altérité, les meninas
peuvent trouver en l’‘étiquette’ de la prostitution des points de repère et des revendications
communes, sans pour autant se voir exclusivement rattachées à un type de pratique. « Son
nom [de la prostitution], sa forme et son contenu sont en construction permanente et
agonistique » [traduction libre] (BELELI & OLIVAR, 2011, p. 493).
La compréhension du caractère unilatéral des catégorisations extérieures oblige à
prendre en compte toutes les nuances d’identification des meninas par rapport à autrui. Le
regard est entièrement contextuel, aucun essentialisme n’étant envisagé, et basé sur la
perspective du groupe en étude.
Tout ce travail est donc axé sur la compréhension de l’usage en contexte des catégories
créées et/ou adoptées par les meninas.
Dans le premier chapitre, la construction de la catégorie meninas, utilisée dans
l’espace de prostitution, sera le focus de l’analyse. Elle sera appréhendée et comprise à partir
12
des savoirs et des pratiques produites et partagés dans le Restaurante Granada. À ce propos,
seront spécifiées les connaissances issues de leur travail du sexe : les savoirs maîtrisés par une
partie des meninas qui bénéficient ainsi d'une position puissante et imposée aux autres sujets,
la création de règles et de la déviance, la définition des contours de groupe.
D’après la constitution interne des meninas, il est facile d’observer les conséquences
que l’appartenance à ce groupe peut avoir dans le rapport entre sujets identifiés et autres
catégories professionnelles. Au-delà de la stigmatisation, quelques avantages sont perçus dans
le vécu de la prostitution, notamment celui de maîtriser sa sexualité, générant un regard plutôt
positif sur ce travail.
Néanmoins, les catégorisations et productions de savoirs imposées par d’autres
institutions sociales contraignent ces femmes. Toutes aussi établies soient-elles au sein de la
hiérarchie du Restaurante Granada, les meninas n’en ont pas moins à faire face à ces
contraintes qui participent, par là même, à la construction de leur identification en tant que
meninas. Dans le deuxième chapitre, plusieurs institutions productrices de connaissances sur
la prostitution et sur les meninas du Granada seront objets d’étude. L’intérêt portera sur le
croisement entre ces savoirs institutionnalisés, et souvent méprisants, et ceux présentés dans
le premier chapitre.
Il est évident que l'effet des institutions analysées sur chacune des meninas n’est pas
homogène. Il existe toutefois des moyens de repérer l’assimilation des caractéristiques
attribuées au savoir interne collectif. Ces processus ne se font jamais sans une re-signification
qui, parfois, change la connotation du caractère en question.
Le genre est un élément central dans l’analyse de la prostitution au sein du
Restaurante Granada. Il n'est nullement question ici de quelque domination intrinsèque des
hommes sur les femmes à travers la sexualité en ce contexte. Comme il sera abordé au fil de
cette étude, le travail du sexe est un espace d'autonomie pour les meninas qui créent des
discours nouveaux et positifs sur la prostitution. Unies sous les mêmes catégories, elles
rassemblent les forces pour faire respecter leur condition de professionnelles.
C'est à partir du point de vue des meninas que le phénomène du travail du sexe et ce
qui l’entoure est ici offert à percevoir. Toutes les catégories utilisées pour faire référence à
l’autre sont celles utilisées par ces femmes. Elles s’engagent à classifier et ainsi encadrer les
sujets selon des éléments clés tels que le genre, la sexualité et la participation sur le marché du
sexe.
Au niveau des concepts pratiques, le genre est essentiel à la structuration des classes
de sujets. C’est uniquement pour cela que je l’ai choisi afin d'organiser la présentation des
13
groupes en contact avec les meninas, ainsi divisés dans les chapitres 3 : féminin, et 4 :
masculin. N’y voyons donc aucune réification de l’idée de « la différence des sexes [ou genre]
[qui est] fondement de toute pensée, aussi bien traditionnelle que scientifique » (HÉRITIER,
1996, p. 19).
Au contraire, le genre est compris ici comme une forme de catégorisation, certes très
répandue et puissante, mais contingente comme n’importe quelle autre, ne pouvant être
réduite à un essentialisme anatomique. Les meninas la trouvent utile pour classifier les sujets
et mettre en forme leurs relations de groupe avec les autres : c’est une catégorie de leur
pratique du travail du sexe.
Il est important de reconnaître dans leur savoir non seulement le raffinement des
constructions, souligné tout au long de ce travail, mais aussi les limitations auxquelles il est
rattaché, la dichotomie de genre primant. Ainsi, sa reproduction est proposée pour organiser
les catégories tout en gardant l’idée qu’« il n’y a pas d’identité de genre derrière l’expression ;
cette identité est performativement constituée par les ‘expressions’ mêmes qu’on dit être son
résultat. » (BUTLER, 2006, p. 33)
Le troisième chapitre se compose de la description de certaines catégories du féminin
retrouvées dans le discours des meninas. Ce sont des sujets qu’elles rencontrent (aussi) dans
leur condition de groupe intégré dans le marché du sexe. Les relations avec l’altérité féminine
se construisent ici en prenant en compte le corps collectif des meninas. Lorsqu'elles se
comparent à ces autres femmes, les meninas pointent certaines différences et reconnaissent
des similitudes, permettant ainsi également de délinéer leurs propres caractéristiques.
Dans cette même visée, le quatrième chapitre s’intéresse aux catégories masculines
présentes au Granada. Ici, c’est la constitution, par les meninas, de l’autre de genre masculin
qui sera mise en valeur. La caractérisation des sujets et des modes relationnels qui s’appuient
sur le format du programa est une donnée centrale pour comprendre le travail du sexe au
Restaurante Granada. Les identifications et différenciations servent aussi à repérer les
contours du groupe des meninas.
Ces données de terrain convergeront finalement en la compréhension des meninas non
comme population, désignée à partir de l’extérieur, sinon en tant que communauté. Réunies
dans leur espace de travail, ces femmes acquièrent le pouvoir de re-signifier les valeurs
courantes des genres, des sexualités et des prostitutions. Leur manière d’organiser et de
caractériser les sujets à la lumière de leurs propres concepts reflète ainsi leur agency,
potentialisée dans l’espace de prostitution par le groupement qui s’y tient.
Dans cette étude, le but est notamment de montrer que les comportements de cette
14
agency, empreinte d’intentionnalité, de pouvoir et de subjectivité, sont caractérisés par un
contexte, et non par des attributs du genre féminin/masculin ou le statut de travailleuse du
sexe. Au Restaurante Granada, spécifiquement, les meninas expriment leur intentionnalité et
leur pouvoir au quotidien, y reconstruisant les normes de genre et de sexualité qui les
contraignent.
15
Chapitre I : La catégorie meninas
Dans ce chapitre, nous analyserons les éléments au travers desquels la catégorie
menina se construit et les règles selon lesquelles ce réseau se constitue et se hiérarchise. Puis,
nous verrons comment celui-ci s'étend au-delà du domaine du Restaurante Granada et du
quartier du Passeio Público.
Reprenons d’abord la discussion sur les catégories meninas, prostituées et travailleuses
du sexe dans le contexte politique brésilien1. L’identification et le refus de ces trois
dénominations indiquent l'appartenance aux « réseaux du sexe ». Ces « réseaux du sexe » se
revendiquent de différentes filiations politiques. L’appropriation de la catégorie meninas peut
ainsi être comprise comme le facteur le plus visible de la construction de ce groupe de
femmes qui font des programas au Restaurante Granada.
Le terme meninas a dès le départ été classé comme « non controversé ». Remarquons
que cela n’est vrai que dans le contexte du Granada. L'usage de cette catégorie s’avérant
pratique, c’est à partir d’elle que la plupart des sujets ont été discutés. Je la privilégie dans
l’écriture académique sur le thème. S'il s'agit de la catégorie émique par excellence de ce
terrain, notons toutefois que son usage en tant que tel peut être problématique face aux
connotations qui lui sont prêtées de l’extérieur.
Dans les études spécialisées sur la politique de la prostitution au Brésil, la catégorie est
complexe. La reconstitution de l’usage politique du mot meninas a été possible à partir de la
critique que fait l'une des figures centrales de la prostitution militante contemporaine :
Gabriela Leite (2009). Cette ex-prostituée, activiste politique, co-fondatrice de la Rede de
Brasileira de Prostitutas2 (à partir d’ici : RBP) a participé à de nombreuses mobilisations
collectives pour les droits des prostituées3. Les meninas du Granada ne reconnaissent pourtant
pas cette figure.
Gabriela Leite questionne l’utilisation du mot meninas, ayant acquis une signification
perverse dans le contexte de la Pastoral da Mulher Marginalizada (en français, « pastorale de
la femme marginalisée »). Elle le perçoit comme un euphémisme utilisé par « peur » du mot
1 Nous pouvons voir les études qui parlent de « travail du sexe » comme souvent favorables à cette pratique et
celles qui parlent de « prostitution » comme celles s’y opposant (COMTE, 2010). Au Brésil cette opposition
n’est guère éclairante.
2 Plus d’informations sur : http://www.redeprostitutas.org.br
3 Gabriela Leite est notamment créatrice et présidente de l’ONG « Davida » et de la griffe de vêtements
« Daspu », inspirée par les tenues des prostituées.
16
prostituta parmi les agents institutionnels de l’Église catholique (LEITE, 2009). Lors de son
militantisme, elle se dit puta, non pas menina ni travailleuse du sexe. À son avis, ces
euphémismes sont peu utiles à la lutte politique contre ce stigmate. En se disant puta, elle se
réapproprie la catégorie stigmatisante comme bien d’autres mouvements sociaux (AGIER,
2013).
Non seulement les catégories, mais aussi les langages, les espaces et les vêtements
font partie de l’ensemble des éléments qu’on veut très souvent « domestiquer » chez les
prostituées, faire sortir du domaine public, impropre au genre féminin (DESCHAMPS,
2011/2). Comme le propose Olivar (in press), il existe des « habits moraux » que l’on essaye
d’imposer à ces femmes. Au long de cette étude, nous analyserons certains d’entre eux.
Dans le discours de Gabriela Leite et de la RBP, la plus grande opposition parmi ces
femmes est celle de l’Associação das Prostitutas do Ceará4 (à partir d’ici : APROCE), au
travers de la figure de sa présidente Rosarina Sampaio5. L’APROCE est marquée par une
rhétorique dite moralisante et par une politique considérée comme mercenaire. Dans le
contexte de la grande politique, à Brasília, la RBP et l’APROCE sont les deux discours issus
des associations de prostituées qui jouissent d’expressivité tout en s’opposant l’une à l’autre.
Les femmes du Granada, face à la recherche menée sur elles (sans l’intermédiaire de
l’APROCE ou de la RBP), affirment s’opposer aux deux discours. Si elles trouvent
déconcertant d’être catégorisées comme prostituées (voire « putes » !) dans la sphère
politique, selon ce qu’avance la RBP, elles sont aussi en désaccord complet avec la praxis
politique de l’APROCE. Celle-ci n’est plus la bienvenue au sein du quartier du Passeio
Público depuis 2007 (cf. chap. 2 « Le savoir géographique »).
1. Savoirs techniques et identification sexuelle
Dans cette partie, l’étude des catégories sera reprise lors de l’insertion de la
prostitution dans la rhétorique du monde du travail. Les croisements entre termes et pratiques
professionnelles peuvent ainsi être envisagés autant dans la macro-politique qu’au Granada.
L’une des grilles de lecture envisageables pour comprendre les pratiques des meninas
nécessite d’accorder au programa le statut de geste technique professionnel. Cela représente
une partie des revendications faites au Granada et figure comme l’un des objets majeurs de la
4 Plus d’informations sur : http://aproce.blogspot.fr/.
5 La présidente de l’APROCE, Rosaria Sampaio, a disparu le 25 mars 2013, durant la rédaction de ce texte. Les
nouvelles directions que l’association va prendre sont actuellement inconnues. Le présent des verbes n'a
cependant pas été modifié.
17
lutte associative contemporaine contre le stigmate que subissent les travailleuses et les
travailleurs du sexe (VANCE, 1992)6.
Par cette lecture, nous pouvons intégrer les meninas à la catégorie socio-
professionnelle liée au travail du sexe, en analysant leurs pratiques comme des techniques du
corps efficaces grâce à une chaîne opératoire (CRESSWELL, 2003) de gestes caractérisant la
prestation de service typique du programa. Nécessaires ou probables, les gestes qui
composent la rencontre entre prostituée et client sont envisagés ici comme des étapes dans le
processus de la prestation du service sexuel.
Les efforts contemporains pour la reconnaissance politique et juridique du travail du
sexe visent à extraire du domaine de la déviance, au regard des règles morales appliquées à la
sexualité des sociétés occidentales, les pratiques et savoirs normalisés existant dans les
espaces de prostitution (BECKER, 1977). La chaîne opératoire qui produit le programa n’est
toutefois pas unique.
La relation complexe, entre le rassemblement de différents groupes à propos d’un but
commun et la définition d’une « identité » à cet ensemble, est également vécue par les
prostituées et travailleuses du sexe brésiliennes : le lobbying envisagé par Butler (2003) existe
au côté des micro-fascismes décrits par Deleuze et Guattari (1995).
Le rapport entre (1) la lutte pour la reconnaissance des droits et d’un statut légitime au
travail du sexe et (2) l’identification publicisée de ses acteurs à la prostitution (dans sa version
« pute » par choix ou travailleuse du sexe) ne peut être négligé. Simões explique que dans le
contexte brésilien les prostitué-e-s militant-e-s ont dû « distinguer conduites, postures,
procédures, droits, devoirs et une certaine éthique » [traduction libre] (2010, p. 25), ainsi
qu’endosser la responsabilité du choix de la profession. Pour revendiquer les droits des
« putes », il fallait d’abord se dire « pute » et expliquer de quoi il s’agissait.
Lors de l’inscription de la prostitution en tant que profession dans la Classificação
Brasileira das Ocupações (« classification brésilienne des métiers »), divers groupes de
femmes participantes ont proposé des spécifications qui ne concernaient pas toutes celles qui
s’identifiaient à ce métier. Le texte de la description sommaire finalement adoptée pour la
rubrique « professionnels du sexe » est le suivant :
Développent des programas sexuels ; accueillent et accompagnent les
clients ; participent à des actions éducatives dans le domaine de la sexualité.
Les activités sont exercées selon des normes et procédures qui minimisent la
6 Pour le cas français, voir le STRASS sur http://site.strass-syndicat.org/.
18
vulnérabilité de la profession. [traduction libre] (Ministério do Trabalho e
Emprego)
L’accent mis sur les actions éducatives auxquelles elles participeraient est l’élément le
plus divergeant dans les pratiques des meninas. Les noms qui figurent en guise d'intitulés sont
: garota de programa, garoto de programa (masculin), meretriz, messalina, michê (masculin),
mulher da vida et trabalhador do sexo (masculin), celui de menina en est exclu. Les noms
assurent l’imposition de l’unité d’un ensemble (DELEUZE & GUATARRI, 1995), leur refus,
dans ce cas, est un rappel à l’altérité, à la non-identification.
Le point de vue des meninas du Granada sur le caractère public du statut professionnel
est la principale divergence d’avec celui des militant-e-s (point développé au chap. 2). Les
revendications des droits, pourtant, sont perçues comme légitimes car elles incorporent
complètement la compréhension de leur pratique en tant que profession. Cela s’observe
surtout dans le discours interne à l’espace de prostitution et envers les proches. Dans ce
chapitre, les savoirs et les pratiques produits par les meninas et véhiculés parmi elles, et leur
entourage, seront présentés et analysés.
La notion d’identité, malgré son historicisation et relativisation, se montre toujours
problématique dans ce contexte (AGIER, 2013). La fierté professionnelle des meninas du
Granada n’est pas la même que celle des « putes » et travailleuses du sexe, militantes, pour
qui le discours de l’identité professionnelle fait partie du langage. Le caractère flou de la place
qu’occupe la profession du sexe dans l’identité et la sexualité des meninas ramène davantage
au concept d’identification, car « as a processual, active term, derived from a verb,
‘identification’ lacks the reifying connotations of ‘identity’. » (BRUBACKER & COOPER,
2000, p. 14)
L’usage du terme « identité » est puissant lors de la construction d’un « essentialisme
stratégique » (AGIER, 2013), cas des militantes politiques qui s’opposent ici aux meninas.
Quand imposé depuis l’extérieur, le terme « identité » fonctionne comme la reproduction des
stigmates. Il est préférable de parler d’« identification » (BRUBACKER & COOPER, 2000),
quand c’est une affaire politique ou interpersonnelle, et de « construction de soi » (BOZON,
2001), lorsqu’il s’agit des constructions intrapsychiques. Dans le dernier cas, il faut remarquer
que le sens donné aux expériences (sexuelles ?) au long de la biographie n’est ni univoque ni
pérenne.
Les processus de construction de soi et d’identification à la catégorie meninas
présentent des patterns car il existe une réglementation des gestes techniques créés et imposés
19
verticalement dans le contexte du bar. Ce corpus normatif construit aussi des déviances. De ce
fait, il ressort qu’il y a des « meninas de ce bar ci »7 et les autres composant le même espace
physique ; les positions hiérarchiques dépendent entièrement du réseau articulé par chacune
car, au Granada, le savoir ne découle pas du pouvoir (FOUCAULT, 1976).
Lors de mon retour sur le terrain en avril et mai 2013, j'ai constaté que la distanciation
hiérarchique s’était intensifiée. Rafaela, qui n’était pas une menina du bar, a été de plus en
plus rejetée, jusqu'à ne plus avoir aucun contact avec les meninas et à devoir travailler le soir,
une fois celles-ci parties, le bar fermé et cette zone occupée par les travestis. D’autres meninas
sont apparues : d’entre-elles, seule Yane a été considérée comme menina du bar, quand
plusieurs autres y sont sans pourtant accéder à ce statut.
2. Une sexualité en commun au Granada
Développons maintenant les liens professionnels qui s’établissent entre les meninas du
Granada, et autour, et engendrent ainsi leur compréhension collective de la sexualité au regard
du programa.
Les femmes qui ont contribué à cette recherche composent un groupe qui s’auto-
désigne comme composé de meninas. Il est marqué par les hiérarchies et peut s’apparenter à
ou s’éloigner d’autres groupes de meninas qui fréquentent le quartier, caractérisées par des
marqueurs de lieu (« de la boîte »), de pratique (« qui volent ») ou de clients (« qui sortent
avec des gringos »). Ceci est le sujet du chapitre 3.
Les meninas basent leur identification communautaire sur un terme très répandu en
contexte brésilien, menina signifiant avant tout « fille » (ou « nana »). En s’appropriant ainsi
ce terme : « je suis une menina d’ici », elles opèrent de façon similaire à celle des groupes
amérindiens, utilisant ce mot « moins comme un substantif que comme un pronom. »
[Traduction libre] (VIVEIROS DE CASTRO, 1996, p. 125) Être (une) menina marque une
position de sujet, une perspective qui comprend l’existence des autres.
Alors, si dans le discours quotidien la stratification du groupe est beaucoup plus
présente que son unité, l’élément clé pour appréhender ses contours est l’ensemble des savoirs
qui leur permet de partager le point de vue commun des meninas « tout court ». Être une
menina implique ainsi un certain nombre de connaissances qui portent surtout sur le domaine
de la sexualité et de son antithèse, le programa, mais touchent aussi les rapports de classe,
7 Soulignées dans les tableaux ci-après.
20
race et genre et leurs implications particulières dans l’espace de prostitution étudié.
Ces savoirs concernant le programa ont été exposés en détail par ailleurs (à ce propos,
cf. Luna Sales (2013)). Ici, ils seront repris dans leur qualité d’ensemble, de corpus partagé et
imposé, qui s’inscrit dans la pratique de la prostitution des meninas sous l’idée générale et
toujours présente du programa comme n’étant pas du sexe.
Du questionnement quant au but et à la méthodologie de la recherche que je faisais,
auprès d’elles, sur leur travail, est né un petit dialogue en ces termes :
Cassandra : - Si j’en avais la possibilité [d’aller à l’université], je ne
reviendrais plus jamais ici.
L’ethnologue : - Pourquoi ?
Andrea : - Moi, je reviendrais, c’est sûr, pour montrer que je suis riche. Je
passerais en voiture, là, aujourd’hui.
Cassandra : - Non, ce n’est pas ça que je dis. Je dis que je n’aurais pas besoin
d’étudier, comme elle le fait. Je le saurais déjà !
Par ce dialogue, Cassandra faisait comprendre à l’ethnologue la transversalité et la
globalité de son savoir.
La connaissance générale des savoirs produits par les travailleuses et travailleurs du
sexe, indispensable à leur pratique professionnelle, est présumée chez les sujets qui
s’identifient à la catégorie. Dans les cas où ils ne sont pas connus ni (au moins) partiellement
respectés, d’autres formes de catégorisation sont utilisées (cf. ce phénomène dans le contexte
du Granada au chap. 3). L’attachement entre catégorisation et savoir s’impose principalement
parce que celui des prostituées n’est accessible que par la pratique8.
Les meninas du Granada ont à cet effet développé une « pédagogie » qui passe autant
par la transmission orale des savoirs que par l’épreuve en face-à-face avec le client, qui ne
peut être enseignée sinon souvent re-signifiée collectivement après. Cette pédagogie ne se
résume pas à un souci de bienveillance. Quand les aînées apprennent aux cadettes leurs
modèles de rapport avec les clients, elles créent, instaurent des règles à chaque fois plus
répandues, ainsi que le caractère de déviance de certaines meninas qui s’y opposent
(BECKER, 1977).
Un indice de la spécificité des savoirs de la prostitution est notamment le nombre
massif d’échecs au tout premier programa mené par ces meninas. Elles nomment « échec » de
ne pas avoir de rapport avec le client, expérience majoritaire incluant quand même le
8 Cette réalité s’affaiblit dans le contexte brésilien avec la publication des récits autobiographiques de Bruna
Surfistinha (2005) et Gabriela Leite (2009). Les deux parlent de la prostitution féminine à la première personne
ce qui leur a donné un grand succès public, le premier ayant été adapté en film.
21
paiement, ou, chose plus rare, d’avoir un rapport avec celui-ci mais de ne pas être payées en
retour. L’occurrence de l’argent et de l’accomplissement de la rencontre9 sont ainsi
indispensables.
Quand elles parlent de leurs premières expériences, la timidité, les manières « brutes »
du client, la taille du pénis, le montant à payer et, plus généralement, ne savoir que faire avec
lui une fois dans la chambre sont les aspects qu’elles citent. En cas d’échec, elles ont toutes
réitéré l'expérience, après avoir demandé conseil auprès d'une aînée, et y ont réussi. À ce
propos, le tableau suivant marque l’espace où s’est tenu le premier programa et la perception
de la menina quant à sa réussite ou non.
Menina Espace Réussite
Gabriela Centro Non
Andrea Centro Non
Nálary Centro Non
Cassandra Centro Oui
Maria João Centro -
Stéphanie Centro Oui
Valdete - -
Manuela Centro Non
Yane Centro Oui
Dolores Praia do Futuro Non
Andressa Campagne Oui
Daniela Centro Oui
Raissa - -
Rafaela Centro -
Lia Centro -
Marlene Centro Ne se souvient pas
Elida Centro Ne se souvient pas
Catarina Centro Non
Tableau 1 : Espace et statut de réussite ou non du programa.
Nous voyons à travers ces données que les échecs ne sont pas vécus comme des
barrières définitives à la pratique de la prostitution, mais qu'ils font partie de l’apprentissage
continu dans lequel elles s’engagent. Il s’est avéré un peu problématique de trouver les
bonnes questions à poser aux prostituées aînées.
Précisions également que, au moment de leur initiation à la prostitution, aucune des
9 La rencontre peut n’impliquer que l’accompagnement du client, par exemple, mais elle est considérée comme
réussie quand effectuée dans sa totalité.
22
meninas n’était vierge. Ce n’était donc pas le sexe qui leur était méconnu, sinon justement le
programa, qui a priori ne se confond pas avec le sexe voire s’y oppose. Ce que la rencontre
avec le client clarifie encore davantage : dans la plupart des cas, il est là pour un programa,
une forme de relation codifiée et spécifique. Dans la perspective des meninas, la
caractéristique principale de cette pratique est d’être du non-sexe (OLIVAR, 2011), chez les
clients d’autres significations peuvent y être attribuées.
L’espace choisi pour initier leur carrière dans la prostitution est une constante. Le
quartier du Centro (le centre-ville de Fortaleza), jusque dans les années 1990, abritait
plusieurs espaces de prostitution socialement reconnus (cf. chap. 2), du type maison close ou
en plein air. Andrea, par exemple, a eu son premier contact avec le travail du sexe suite à un
reportage télévisé sur la prostitution au Centro.
À présent, le Centro n’est plus l’endroit privilégié du marché du sexe : d’autres
espaces et d’autres formes de rencontre mettant l’accent sur l’échange économico-sexuel se
sont développés dans la ville. De ce fait, l’ensemble des savoirs des meninas n’est ni central
ni légitime parmi toutes les prostitué-e-s de Fortaleza (cf. chap. 3). Dans des contextes
ethnographiques similaires, d’autres formes de rapport sont possibles, parfois l’implication
affective y est nécessaire et l’investissement de la sexualité féminine désirable (PISCITELLI,
2011 ; PINHO, 2012). Elles le savent : il faut être une menina de ce bar-ci pour être sûres de
garder sexualité et affectivité hors du programa.
Les savoirs et pratiques de prostitution les plus légitimes au Granada en 2010 étaient
ceux proposés par Andrea, Nálary10
et Cassandra. Le statut de leur discours découlait surtout
de la cohésion de leur réseau et des relations qu’elles entretenaient avec d’autres sujets
importants à la dynamique du bar : le serveur, le gérant, D. Larice et de bons clients. De leur
point de vue, le programa, c'est :
Savoir/Pratique
Ne pas parler la première aux clients
Ne pas rester longtemps avec eux dans le bar
Monter au Motel au-dessus du bar
Prendre une douche avant
Faire prendre une douche au client avant
Ne se laisser toucher que le nécessaire
Utiliser le préservatif
10
À présent, Nálary s’est éloignée des autres meninas car elle est allée habiter à Russas, ville de taille moyenne,
dans la même région, où elle travaille dans une maison close. Son statut a donc visiblement changé au Granada.
23
Rester dans la chambre pendant 15 minutes, pas plus
Ne faire que le basic (fellation, pénétration vaginale)
Ne pas jouir
Prendre une douche après
Se faire payer 40 reais (15 euros) à la fin
Ne pas voler, sauf s’il n’y a aucun risque de se faire prendre
Tableau 2 : Savoirs et pratiques hégémoniques.
3. Adhésion individuelle et appartenance au groupe
Dans cette rubrique, les formes d’appartenance au réseau des meninas sont abordées à
partir de l’incidence qu’a sur elles l’idée de déviance quant aux normes du programa.
Si la catégorie centrale de cette étude, celle des meninas, est extrêmement floue, elle
se délimite cependant sur le terrain de façon tout à fait contraignante. La valeur pronominale
du mot meninas donne lieu à la spécification « meninas de ce bar-ci » lorsqu’on veut mettre
en évidence la hiérarchie. Les noms soulignés présents dans les tableaux pourraient aussi bien
se subdiviser en plusieurs catégories qui exprimeraient avec plus d’exactitude la structuration
du groupe des meninas au moment de la recherche.
Les cristallisations momentanées du pouvoir, si elles ont quelques repères dans les
situations passées, par exemple l’ancienne configuration de la place (cf. dans le chap. 2 « Le
savoir géographique »), ne s’expliquent pas pour autant pleinement. En fait, plusieurs facteurs
simultanés concourent à faire qu'une menina soit bien intégrée ou déviante, ceci justifiant que
les biographies individuelles ne soient pas toujours éclairantes pour comprendre les
configurations des réseaux au bar (BECKER, 1977).
En revanche, des facteurs synchroniques semblent permettre la compréhension de la
manière dont se constituent les micro-fascismes chez les meninas. C’est dans la configuration
actuelle des réseaux de pratiques et de savoirs que le pouvoir est repéré, seul moyen que je
trouve pour expliquer comment les meninas pronominales se séparent en « meninas de ce bar-
ci » et les autres.
Il faut donc observer les niveaux de savoir et de pratique du programa dans le contexte
du Granada. Étant donné que toutes les femmes qui figurent dans cette recherche fréquentent
les mêmes endroits de travail, à des intensités différentes, il est légitime de supposer leur
convivialité et leur fonctionnement comme réseau étendu. Je l’ai vécu en personne quand, au
début de la recherche, il n’y avait rien que je fasse ou dise qui ne soit ensuite connu de toutes.
Continuant avec mon exemple, dans la mesure où je me suis insérée dans ces réseaux, j’ai eu
24
accès aux secrets et aux confidences des conversations.
La forme la plus légitime du programa n’est ignorée par personne, pourtant son
émission et sa modification d’un côté, et sa mise en pratique entière ou partielle de l’autre
sont très variables.
Rappelons que la forme du programa ici en étude a été élaborée et diffusée par
Andrea, Nálary et Cassandra. Si dans une optique pédagogique, nous les voyons comme « les
profs », il faut remarquer qu’il y a toujours les « cancres », les meninas déviantes, telles
Rafaela, Marlene, Elida et Valdete. L’explication de l’origine de la déviance dépasse le but de
cette étude, ce qu’elle produit, à son tour, est centrale : la distance dans les relations
personnelles avec celles-ci – pouvant générer d’autres conséquences – et la
connaissance/pratique partielle des règles.
La gravité des déviances et l’application des sanctions sont des indices sur
l’importance de la règle, mais surtout de la menina dans le réseau producteur de savoir.
L’occurrence du « peut-être » dans le tableau suivant indique le traitement inégal selon le
sujet :
Déviance Sanction (application)
Appeler ouvertement les clients Peut-être
Rester au bar longtemps avec les clients Oui
Ne pas monter au Motel Peut-être
Ne pas prendre une douche avant Aucun cas
Ne pas faire prendre une douche au client avant Peut-être
Se laisser toucher Oui*
Ne pas utiliser le préservatif Oui
Rester dans la chambre plus de 15 minutes Peut-être
Faire plus que le basic sans augmenter le tarif Oui
Jouir Peut-être
Ne pas prendre une douche après Aucun cas
Se faire payer avant Non
Voler et avoir des problèmes Oui
Tableau 3 : Savoirs et pratiques déviantes et les possibilités de sanction.
Le « peut-être » indique que les pratiques déviantes ne sont pas toujours sanctionnées
quand réalisées par les meninas « soulignées ». Les normes peuvent être sujettes à
reconstruction, certes, mais c’est surtout la non-punition de sujets déterminés, tout en gardant
la validité « pour les autres » ou « dans d’autres cas » qui domine dans ce bar.
Impliquer la sexualité dans un contexte de prostitution est l'une des questions les plus
25
concernées par le schéma du programa et elle est exprimée dans la quasi-totalité des règles :
appeler ouvertement le client peut être vu comme un indice du désir féminin, tout autant que
rester longtemps au bar avec lui, rester dans la chambre plus de 15 minutes, faire plus que la
prestation de base sans augmenter le tarif et jouir. De la même manière, mais en quittant le
champ des dispositions personnelles, les douches et l’usage du préservatif sont des moyens
d’éloignement matériel et symbolique du client.
L’astérisque qui accompagne le « se laisser toucher » laisse à penser qu’il est possible
de trouver, exceptionnellement, un compagnon parmi les clients et donc de faire bouger tout
le modèle de relation mis en scène. En revanche, se laisser toucher par des clients anonymes,
généralement considérés comme n’étant pas de « vrais hommes » (OLIVAR, 2011 ; LUNA
SALES, 2013) indique la déviance maximale, une totale méconnaissance de ce qu’est la
prostitution au Granada et le rabaissement de soi en tant que femme (cf. dans le chap. 3 « Les
filles qui embrassent n’importe qui »).
4. L’influence du programa sur la sexualité des meninas
Nous verrons ici quelle est la place du travail du sexe dans la construction de la
sexualité personnelle des meninas.
Les récits des meninas sont très ambigus à l’égard de la sexualité. Si elles disent
connaître mieux que n’importe qui11
l’« art du sexe », elles affirment en revanche ne rien faire
de spécial dans le contexte de la prostitution, allant jusqu’à éloigner leur pratique
professionnelle de la sexualité et tous les éléments qu’elles reconnaissent dans celle-ci. À
nouveau, l’usage des catégories et l’explication et implication de leurs propriétés peuvent se
révéler assez compliqués. Cette complexité a surtout été ressentie au moment de
l’organisation des données et de l’explicitation des propos émiques. Les catégorisations ont
été beaucoup plus claires sur le terrain.
Pour saisir le paradoxe de la maîtrise exceptionnelle de la sexualité, malgré son
exclusion dans le cadre du programa, plusieurs chemins sont possibles :
1. Les relations entretenues avec un grand nombre de partenaires sont appréciées comme
indice du savoir acquis (BOZON, 2008) ;
11
Il est très commun qu’elles fassent des comparaisons avec les « femmes mariées » (cf. chap. 3), par exemple.
En revanche, elles ne comparent pas leur savoir sur la sexualité avec celui des hommes.
26
2. La logique repose sur savoir ce que le sexe n’est pas – il n’est pas un programa, d’où
l'importance de la prestation de base, sans toucher, ni jouissance – afin d’avoir un
avantage en termes de connaissance sur les autres femmes ;
3. On catégorise à partir de l’extérieur et de façon conservatrice (MACKINNON, 1987),
comprenant la sexualité dans un cadre essentialiste et établissant des relations
simples du type « c’est toujours du sexe ».
Ces propositions ne s’excluent pas, chacune bénéficiant de quelque légitimité,
pourtant, la façon d'inscrire la prostitution dans la sexualité est le sujet le plus complexe et le
moins pensé au bar. C’est pour cela que cette rubrique, plus que les précédentes, doit compter
sur une bonne dose de théorisation quant à ce qui constitue le domaine de la sexualité
conjugué à la proposition très claire des meninas : le programa n’est pas du sexe.
La quantité de partenaires sexuels est l'un des aspects de la carrière de la prostitution
ressortant le plus lors de la mise en œuvre du stigmate de la « putain » – potentiellement
expérimentable par n’importe quelle femme (PHETERSON, 1999). Au-delà du stigmate, la
pluralité de partenaires est comprise comme cause de la plus grande expérience et de
l’expertise (BOZON, 2008) de la sexualité par les prostituées. Connaître « toutes sortes
d’hommes » qui fréquentent les espaces de prostitution, comme les meninas se plaisent
souvent à le souligner (cf. chap. 4), permet de connaître toutes sortes de sexualité dans une
vision androcentrée de celles-ci.
Cette vision androcentrée ne témoigne pas de la perspective globale des meninas sur la
sexualité. En fait, dans leur perception ordinaire du programa, la sexualité n’est présente que
du côté masculin, celle-ci prenant une place centrale dans la rencontre au bar : c’est le désir
masculin et l’absence du désir féminin qui la caractérisent. Les clients impliquent leur
sexualité que les meninas viennent à connaître, élargissant leur propre répertoire.
Connaître les diverses pratiques qui leur sont demandées dans le cadre du programa
leur permet de les désirer elles-mêmes en d’autres espaces et de les apprendre aux partenaires
qu’elles choisissent. Ceci permet d’accéder à de nouveaux plaisirs et à avoir une place active
dans la jouissance en couple. L’intensité du contact corporel, le temps employé dans le
rapport, la centralité de la jouissance féminine sont chez les meninas la sexualité elle-même.
La seule satisfaction du désir masculin, ceci n’est pas du sexe.
Pourtant, la proposition « le programa n’est pas du sexe » ne se fait pas sans contexte.
Elle est surtout observable lorsqu’est demandée la différence entre la rencontre avec un client
et celle par désir. La sortie du domaine sémantique de la sexualité se produit quand la relation
avec le client est comparée à une relation extérieure à la prostitution. De ce même contexte
27
ressort la différence entre homme et client. Il m’a été expliqué : « dans la vie nous [les
femmes] rencontrons des hommes et des ânes, ici [au bar] il n’y a que des ânes ». Or, les ânes
sont ici masculins, ils peuvent être dits « hommes », quand ce mot a seulement la valeur
descriptive du genre. En revanche, quand les attributs de la masculinité hégémonique sont
envisagés, les clients sont des cafuçus12
, des ânes, des bêtes, des gados13
.
La verbalisation des gestes accomplis lors du programa est d’ordinaire faite dans le
lexique de la sexualité. Son appréhension dans le domaine de la sexualité dominante au sein
de la société brésilienne est présente quand les meninas utilisent des mots et expressions
comme relation (sexuelle), transar (« baiser ») pour se référer à l’acte, ou encore, homme,
pour se référer au client. De même, les positions pratiquées avec les clients, les substances
masculines et les espaces de prostitution possèdent le nom ordinaire et commun à toute
rencontre sexuelle. Malgré la différence soulignée par les meninas, le souci des mots n’est
observé que lorsqu’elles tiennent à distinguer programa et sexe.
La non-correspondance entre les savoirs réclamés et les savoirs pratiqués dans le
domaine de la prostitution est, je répète, le point le plus complexe du corpus de connaissances
des meninas. Cela vaut aussi pour la confusion qui peut parfois exister entre les deux
domaines. Le face-à-face entre la profession du sexe et le désir sexuel exigent d’elles des
élaborations générales sur les propriétés de l’un et de l’autre, ce qui construit un rapport
d’opposition. Pourtant, quand ils ne sont pas confrontés, ces domaines peuvent comprendre
des rapprochements importants.
Dans ce sens, l’extrait suivant est éclairant : Stéphanie m’avait expliqué qu’un de ses
amis allait l’aider à payer son loyer. J’ai pensé qu’il s’agissait d’une relation d’amitié et j’en
ai parlé dans ces termes. Larice a rectifié tout en reprochant à Stéphanie sa confusion entre les
catégories : « C’est un client, non un ami ! Comment est-ce que tu veux qu’elle [l’ethnologue]
comprenne ? »
La différence est réelle. Pour illustrer, je reprendrai la situation de Cassandra en 2013.
Son mari actuel, qui savait qu’elle faisait des programas, était présent dans le quartier sans lui
dire. Stéphanie l’a remarquée et Cassandra s’est affligée car elle attendait son petit ami, dont
le mari était jaloux. Sa solution a été de se comporter comme si c’était un client pour ne pas
avoir une dispute conjugale : avec un client, la jalousie n’a pas lieu d’être.
L’efficacité du décalage des pratiques est reconnue par plusieurs groupes qui adhérent
à la vision du monde des meninas. Ceci explique pourquoi, jusqu’à présent, la catégorie de
12
Voir chapitre 4. 13
Du bétail, en français.
28
« déviantes » a été utilisée par rapport à la distance aux normes issues des pensées et des
pratiques du Granada. Il faut remarquer, néanmoins, que dans la littérature sur la sexualité, les
communautés créées dans les espaces de prostitution seraient les déviantes par rapport aux
mœurs occidentales contemporaines (FOUCAULT, 1976; RUBIN, 2010).
Malgré la distinction centrale entre programa et sexe, manquant d’évidence en
d’autres contextes, et le stigmate quant aux réseaux de prostitution, il y a une approximation
entre les normes sexuelles plus répandues et celles des meninas. Michel Bozon et Maria Luiza
Helborn (1996) font remarquer, par exemple, l’importance des caresses dans l’initiation
sexuelle au Brésil. Leur interdiction générale parmi les meninas est éclairante pour la mise à
l’écart du sexe dans le programa.
Dans leurs réseaux extérieurs au Granada, les meninas engagées dans l’établissement
d’un domaine de connaissance spécifique à leur pratique peuvent le mobiliser pour avoir un
certain avantage dans des rapports d’amitié, de compagnonnage, de mariage, de parenté, de
voisinage, etc. Pour ces femmes être prostituée n’est pas seulement un handicap, mais aussi
une source de pouvoir.
Le tableau suivant indique la tendance à mobiliser les éléments issus de l’univers de la
prostitution dans les relations avec les proches, hors du marché du sexe. Ceci se traduit
surtout par leur connaissance (oui ou non) de leur activité professionnelle. Le rapport de
proximité ou de distance avec des parents sera repris en analyse aux chapitres 3 et 4.
Menina Enfants Parents / Frères et
sœurs
Compagnon-e-s Belle famille
Gabriela Non Oui Oui Oui
Andrea Non Oui Oui Oui
Nálary Non Oui Oui -
Cassandra Non Oui Oui Oui
Maria João Non Oui Oui -
Stéphanie Non Oui Oui -
Valdete Oui Oui Non Oui
Manuela Non Non Oui Non
Yane Oui Oui Oui Oui
Dolores Non Oui Oui -
Andressa Pas d’occurrence Oui Oui -
Daniela Non Oui Oui -
Raissa - - - -
Rafaela Oui Non Oui Oui
Lia Non Oui Oui -
Marlene Oui Oui Oui -
29
Elida Oui Oui - -
Catarina Non Non Non Non
Tableau 4 : Connaissance du travail du sexe selon la catégorie de proches
Faire connaître leur participation dans le travail du sexe est souvent un choix des
meninas. Ceci ne se fait pas en quête d’intimité ni en raison de la compréhension de cette
pratique comme centrale à leur identité. En fait, les savoirs issus de la pratique de la
prostitution peuvent aussi être utilisés comme un avantage face aux proches. L’incidence des
réponses positives ou négatives une fois informés, selon les catégories de parents, en
témoignent.
Les enfants sont les moins informés. Leur âge joue sur ce choix, car il faut prendre en
compte que l’autorité maternelle peut être soumise à contestations lorsque conjuguée à la
prostitution (COMTE, 2010). Quand les enfants se font adultes, la perte d’autorité n’est plus à
craindre et les meninas peuvent discuter de ce sujet avec eux en exigeant leur compréhension
et le respect de la profession. Ceci s’est ainsi produit pour tous les cas présentés ci-dessus.
Les parent-e-s et les frères et sœurs sont majoritairement informés, ce qui ne veut pas
dire que ce sujet soit discuté. La perception de la profession du sexe comme avantage ou
handicap et la proximité ou distance des relations vont varier selon le lien de parenté (cf.
chapitres 3 et 4) et sont ici négociables.
La plupart des compagnon-e-s connaissent l’engagement des meninas dans la
prostitution. À nouveau, ceci n’implique pas la discussion du sujet : ne pas cacher, sans pour
autant parler explicitement des programas est la forme la plus répandue dans la vie en couple
de ces meninas. L’indépendance financière acquise grâce au travail est toutefois toujours
soulignées auprès des partenaires.
La belle-famille est une catégorie plus éloignée mais qui ne peut pas être ignorée. Sa
faible présence dans les conversations qui ont lieu au Granada indique son importance
mineure. Néanmoins, la préoccupation des meninas quant à clarifier le fait d’avoir son propre
argent justifie parfois la nécessité d’exposer la nature de son travail.
D’entre les avantages reconnus dans le travail du sexe, la maîtrise de la sexualité sera
le domaine privilégié dans cette étude, en raison de son caractère central à la construction de
la catégorie meninas. L’indépendance financière est aussi revendiquée et sera abordée ici à
plusieurs reprises. Toutefois, d’autres éléments ont été perçus pendant l’enquête : l’accès aux
drogues (pour les utiliser ou en faire un trafic), la possibilité de nombreuses rencontres et
même l’affirmation de leur avis face à la peur de l’autre. Ceux-ci ne seront pas développés.
30
Les exemples des avantages trouvés dans la prostitution laissent entrevoir la
complexité des formes d’identification à la catégorie meninas. Celle-ci sera développée dans
les prochains chapitres par rapport aux autres catégories de savoirs et de sujets. La
délimitation d’un corpus de savoir qui les constitue comme catégorie professionnelle, leur
spécificité face à d’autres catégories et leur perception du marché du sexe sont les éléments ici
privilégiés pour caractériser les meninas en tant que sujets dotés d’agency, constructrices de
leurs espaces de prostitution et des relations qui s’y établissent.
31
Chapitre II : Catégorisation et production des savoirs extérieurs
Les savoirs les plus importants dans le quotidien des meninas sont ceux issus de leurs
propres élaborations en tant que collectivité professionnelle. Dans le premier chapitre, il a été
avancé que ces savoirs spécifiques promeuvent l’identification interne et positive à la
catégorie sociale des meninas.
Cependant, ils se construisent par rapport à nombre d’autres catégorisations qui
jouissent souvent d’une légitimité plus expressive face à la société brésilienne et même face
aux meninas selon le contexte.
The state is thus a powerful “identifier”, not because it can create “identities”
in the strong sense – in general, it cannot – but because it has material and
symbolic resources to impose the categories, classificatory schemes, and
modes of social counting and accounting with which bureaucrats, judges,
teachers, and doctors must work and to which non-state actors must refer.
But the state is not the only “identifier” that matters. (BRUBACKER &
COOPER, 2000, p. 16)
Le but de ce chapitre est donc de reprendre quelques discours extérieurs sur la
prostitution et spécifiquement sur les meninas du Granada. Ceux-ci ne sont envisagés que
lorsque investis dans leur identification et croisements avec les savoirs et les pratiques déjà
décrits. Cela nous permettra de contextualiser leurs savoirs en repérant les continuités et les
schismes par rapport à d’autres domaines de la vie sociale.
Ce chapitre est organisé en plusieurs topiques titrés selon le domaine de production
des savoirs en question. Ils sont séparés par les institutions auxquelles ils appartiennent de
façon à indiquer leur légitimité et leur répercussion dans le sens commun, cependant ils ont
une influence mutuelle et ils font partie du fait social global qu’est la prostitution.
1. Le savoir associatif
Le domaine associatif a un statut flou par rapport au locus de production du savoir
(interne ou externe ?) issu des problématiques de la représentativité. Dans le contexte auquel
nous avons fait référence plus tôt, les meninas se sentent non représentées : l’APROCE est
considérée comme une « association fantôme » où les « putes appartiennent toutes à elle [à la
présidente de l’association] », et Gabriela Leite et la RBP, situées dans le lointain Rio de
Janeiro, sont fort peu connues par les femmes du Granada.
32
Reprenant la problématique des catégorisations (cf. introduction et premier chapitre)
face aux savoirs, il est possible de percevoir que les discours institutionnalisés des prostituées
ou des travailleuses du sexe ne sont pas les mêmes que celui des meninas du Granada. Il
existe un point de tension qui rend les deux premières catégories inadmissibles : leur caractère
public.
La publicité, c’est-à-dire l’institutionnalisation politique, juridique et civile du statut
de prostituée, n’est nullement désirée pas ces femmes. Les postures revendicatives de Rafaela
sur la nécessité des droits des travailleurs et travailleuses et du respect de la société envers les
« putes » ont été abandonnées aussitôt que j’ai allumé le dictaphone :
« Menina, je te disais une blague, je ne pense pas que ce soit très bien d’être
reconnue officiellement comme prostituée, non. Il y en a qui se bagarrent
encore à cause des hommes, des clients… Je pense que ça c’est horrible. Est-
ce que c’est une vie ? On vit ici car on gagne notre sou, mais on sait que ce
n’est pas digne. (…) On sait qu’aux yeux de la population c’est un truc mal
vu. »
Ce thème est beaucoup revenu au fil de nos conversations et j’ai pu comprendre que
les meninas ont beau croire mériter les droits des travailleurs et travailleuses tels qu’établis
dans la législation brésilienne (congés payés, vacances, retraite), être fières entre elles de leur
pratique et de leurs savoirs, tout cela demeure circonscrit au domaine de la prostitution. À
partir du moment où elles perdent la possibilité de négocier directement avec les sujets
(jusqu’à présent interlocuteurs) à propos du statut de leur activité « dans la société », il ne leur
est plus possible d’en parler de la même manière.
Ce n’est pas une question de honte de la prostitution, comme nous pourrions le penser
en entendant Rafaela parler de respect de la dignité. Ce n’est pas une honte de m’en parler
puisque je suis devenue « proche », comme ce n’est pas une honte non plus d’en parler à
d’autres personnes de même niveau discursif et pas au-dessus d’elles. Il y a une clarté
remarquable dans leurs discours : comprenant la spécificité de leur savoir et les avantages
qu’elles tirent de la prostitution, elles négocient leur valeur dès qu'elles le peuvent, au cours
de dialogues relativement égalitaires. En revanche, il n’est pas envisageable de se voir
exposée en tant que « pute » dans une société qui « perçoit mal » cette pratique sans
bénéficier du droit de réponse. Un employeur d’une autre société ou un fonctionnaire de
l’administration les considérera à travers la représentation unilatérale selon laquelle « la pute
ne parle pas » [traduction libre]. (LEITE, 2009, p. 134)
Lors de la création de l’APROCE, celles qui se sont revendiquées prostituées face à la
33
« population » l’ont fait lors de l’ascension des mouvements sociaux des prostituées et des
investissements financiers nationaux et internationaux contre le VIH/SIDA. Elles comptaient
aussi sur l’appui des étudiants de l’université et des politiciens de gauche et ont eu le courage
de mettre le mot pros-ti-tu-ta (prostituée) dans un document officiel sous le regard étonné du
notaire (RIBERIRO, 2012).
À Fortaleza, cette mobilisation a perdu de sa force depuis longtemps. L’actuelle
présidente n’a jamais été prostituée, sinon maquerelle. Les autres femmes qui y sont inscrites,
sont « à elle », contrôlées par elle dans le cadre de l’association depuis le milieu des années
1990. Les recherches sur la prostitution qui passent par l’APROCE sont vérifiées et doivent
être payées. D’après les meninas, ce ne sont pas de « vraies » prostituées, ce sont des
« fantômes ».
De la RBP, elles ne m’en ont jamais parlé. J’ai parfois mentionné Gabriela Leite, mais
elles ne la connaissaient pas, cela était bien extérieur à leur réalité. Le seul lien possible avec
cette importante figure politique est justement celui des catégories. Les femmes du Granada,
contrairement à Leite, préfèrent être menina, voire travailleuse du sexe, que « pute » pour la
« population ».
2. Le savoir législatif et juridique
Le savoir produit par le droit dans la contemporanéité de la prostitution au Brésil est
(1) méconnu des administrateurs et (2) marqué par l’ambiguïté. L’application de la force
policière et la consultation juridique ouverte au public agissent souvent avec ignorance, se
basant plutôt sur l’idée traditionnelle que « la prostitution ne peut être légale » que sur le
contenu des lois, largement restrictives et défavorables à la pratique de cette profession
(OLIVAR, in press).
À ce propos, il est bon de noter que la prostitution n’est pas un crime en soi, mais que
ce mot figure, à plusieurs reprises, dans le code pénal brésilien. Le chapitre V est
exclusivement dédié au proxénétisme et à la « traite » de personnes subvenant à la prostitution
ou toute autre pratique d’exploitation sexuelle. Les dernières modifications de ces lois datent
de 2009 et indiquent l’alignement de la politique brésilienne sur celle des organismes
internationaux de lutte contre la « traite » des êtres humains.
Les articles du chapitre V du code pénal brésilien criminalisent : inciter un tiers à la
pratique de la prostitution ou l'empêcher d'en sortir (article 228), gérer un établissement
destiné à l’exploitation sexuelle (article 229), profiter économiquement de la prostitution
34
d’autrui (article 230), promouvoir l’entrée ou la sortie du territoire national de personnes afin
qu’elles ne se livrent à la prostitution (article 231), promouvoir le déplacement dans le
territoire national de personnes afin qu’elles ne se livrent à la prostitution (article 232).
En l’occurrence, l’absence de proxénétisme caractéristique du Granada et le mode de
vie plutôt sédentaire des meninas14
les laissent quelque peu indifférentes à cette législation,
contrairement à la RBP qui lutte contre les contraintes qu’imposent les lois. Même la
configuration ambiguë du bar rend incertaine son appellation d' « établissement destiné à
l’exploitation sexuelle ». Il faut remarquer pourtant que « même les applications sporadiques
de ces lois sont là pour rappeler aux individus qu’ils font partie d’une population
particulièrement surveillée. » (RUBIN, 2010, p. 176)
Le type d’établissement associé à la description de l’article 229 est connu à Fortaleza
comme cabaré. Son existence en centre-ville est devenue rare depuis les années 1990, en
raison de la nouvelle morale liée à l’idéal du couple romantique qui commence à s’instaurer
dans les classes populaires du nord-est brésilien (REBHUN, 1999), donc parmi les clients et,
bien sûr, à l’accroissement de l’épidémie du sida (SOUSA, 1998).
Le Restaurante Granada n’a été appelé cabaré que deux fois par les meninas durant la
période ethnographiée, bar étant le qualificatif le plus fréquemment employé. Cela va de pair
avec l’analyse de Sousa (1998) quand elle indique que les espaces de prostitution deviennent
de plus en plus publics, non exclusifs à cette pratique. Le Granada a les portes ouvertes sur le
trottoir et n’importe qui peut entrer, « même les gens en couple, les enfants », fait remarquer
Andrea (cf. figure 1 en annexe). C’est un facteur valorisé par les femmes car le bar ne
constitue pas un « monde à part », même si l’objectif d’y pratiquer des programas y demeure
bien présent.
3. Le savoir géographique
Les changements des espaces de prostitution à Fortaleza, nous amènent à remarquer
les savoirs populaires et administratifs de l’inscription de la prostitution dans la ville. La
géographie des regroupements spatiaux des prostituées est « doublement [construite] par
l’intervention des pouvoirs publics et les tactiques des prostitué-e-s pour faire face à la
répression et à certaines formes de violence. » (REDOUTEY, 2005, p. 51)
14
En 2010, ceci se résumait à certaines meninas ayant déménagé sur la capitale très jeunes et n'ayant fait depuis
que de petits déplacements pour les vacances ou des visites familiales dans la région même. En 2013, l’envie de
partir à l’étranger demeure absente au Granada, pourtant les déplacements dans la région sont devenus
fréquents : souvent à la campagne pour y augmenter ses revenus.
35
La connaissance de la géographie de la prostitution se fait à différents niveaux selon la
catégorie sociale à laquelle appartient le sujet : les habitants de Fortaleza savent, en général,
où il y a prostitution et qui fréquente les lieux (à la Beira-Mar il y a les travestis-prostituées, à
la Praia de Iracema les gringos-clients, etc.), mais le recoupement territorial est beaucoup plus
minutieux que cela.
Le quartier du Passeio Público en est un exemple. Dans les années 1990, quand la
place était principalement occupée par les meninas pendant la journée et par la
malandragem15
pendant la nuit, et que les classes moyennes n’osaient pas y mettre les pieds16
,
il y avait un partage de la place même en deux moitiés antagoniques. D’un côté, les meninas
bien soignées et parfumées, jolies et expertes ; de l’autre, des voleuses, des droguées, des
moches, des non-professionnelles. La dernière réforme, datant de 2007 et visant à restituer la
place à la bourgeoisie bohème locale, a fait disparaître à jamais cette structure17
. La place a
été plutôt désertée par les prostituées. Celles qui la fréquentent encore le plus le font en raison
de positions défavorables dans la hiérarchie des espaces de prostitution de l’entourage,
maintenant centraux face à la place périphérique. (LUNA SALES, in press)
À présent, le quartier du Passeio Público (cf. figure 2 en annexe) où est inséré le
Restaurante Granada comprend plusieurs types de prostitution. À côté de celle des meninas du
bar, détaillée au premier chapitre, il y a celle pratiquée à l’Espaço Show Bar, appelé « boîte »
et aussi celle du terrain en friche dit la « pente », toutes très marquées par l’espace physique
qui les abrite. La prostitution de la boîte est plus chère, pratiquée par des femmes plus jeunes
et plus « exhibitionnistes », selon l’avis des meninas (cf. chap. 3).
À côté du Granada, l’Espaço Show Bar est très contrasté, mais les relations entre les
femmes qui fréquentent les deux endroits sont plutôt horizontales, malgré les critiques il y a
un respect mutuel. La prostitution de la pente, en revanche, nourrit un rapport très différent.
Situées à environ 100 mètres du bar, et beaucoup moins chères que les deux autres, les
meninas qu’y travaillent sont souvent des mineures toxicomanes. Leur dépendance au crack et
l’âge les rendent physiquement très distinctes des deux autres groupes : ce sont des filles
maigres et sales, très éloignées du standard de propreté existant au Granada. Les meninas du
bar sont plutôt condescendantes envers elles, ne jugent pas ces filles, voire essayent de leur
15
Le terme, équivalant à « ruse » en français, peut être utilisé pour les jeux de scène et ses acteurs. Son usage est
très courant chez les meninas, en témoigne la phrase d’Andrea : « La malandragem respecte les « putes ». » 16
Lors d'un échange personnel, Cristiano Câmara, collectionneur passionné de cinéma hollywoodien et habitant
traditionnel du quartier, m’a parlé de l’étonnement général des classes moyennes natives quand Jean-Paul Sartre
et Simone de Beauvoir y sont passés lors de leur visite à Fortaleza dans les années 1970. « Il n’y avait que de la
malandragem mais ils ont voulu y aller quand même ». 17
Voir plus de détails sur ce projet urbanistique en Lopes (2011).
36
donner des conseils ponctuels.
Les clients aussi se partagent entre ces trois endroits, mais ne leur sont pas attachés. Le
prix, par exemple, peut être un facteur de transit, ainsi que l’ambiance recherchée. La boîte est
normalement plus festive et là-bas « il fait toujours nuit », dans le bar cela dépend, il y a des
jours où c’est calme et des autres où l’on danse parmi les tables au son de la musique très
forte émanant du jukebox. La pente n’a aucune structure, il s'agit d'une route donnant sur une
grande avenue et d'un terrain abandonné avec un trou dans le mur.
Les meninas qui travaillent dans chacun de ces endroits se différencient fortement les
unes des autres et s’identifient entre elles. Les clients, qu’ils soient toujours dans le même
espace ou qu’ils transitent de l'un à l'autre, ne constituent pas forcément de communauté avec
elles : les relations avec les clients, pensées à partir de la dynamique de la prostitution, sont
très souvent marquées par l'opposition, l’altérité, et parfois aussi l’identification.
Même si le quartier du Passeio Público n’est pas exclusivement dédié à la prostitution,
il est connu sous cet aspect. Dans un autre texte18
, nous avons discuté des déplacements des
meninas en ville et des contours relatifs aux espaces de prostitution dans leur perspective.
Quand le référent est le centre-ville, il faut remarquer que toutes les meninas ont
besoin de longs déplacements pour y arriver. La plupart habite dans les quartiers
périphériques de Fortaleza ou en banlieue. De ce fait, le Granada s’avère un espace opposé à
celui de l’habitation et des relations familiales et amicales. Il est un lieu de travail, destiné à
ordonner les routines (opposant la vie personnelle à la vie professionnelle) (SIMÕES, 2010),
mais aussi et souvent un lieu de fête. L’affectivité et l’intimité n’y sont pas exclues : le lien
entre certaines meninas outrepasse les limites du bar. Le principal facteur de rapprochement
entre les femmes au Granada repose sur l’autonomie financière et la « liberté » sexuelle. Cela
ne signifie pas que la maternité et les sujets domestiques en sont exclus ni que les meninas ne
se rendent jamais visite ; la perméabilité entre les espaces existe malgré leur distinction.
4. Le savoir médical
Le savoir médical produit sur la sexualité est à présent centré sur le souci de soi et le
bien-être individuel lié au concept de santé sexuelle non reproductive et légitime (GIAMI,
2009). Ceci n’empêche pas que les approches médicales de la sexualité présentent encore des
contraintes sur la pratique des sexualités, surtout celles déviantes. Les réponses à l’épidémie
18
Voir Luna Sales (in press).
37
du sida, où la réglementation du sexe est plus qu’explicite, ont aussi beaucoup d’influence
dans les discours reproduits au Granada.
Ceux-ci sont donc les deux axes principaux du savoir médical sur l’expérience de la
prostitution ici étudiée : le bien-être lié à la sexualité et à la prévention du sida. La première
est la plus présente dans la vie quotidienne indiquant chez les meninas aussi « la
médicalisation du bien-être ». (GIAMI, 2009, p. 246)
Il n’est pas question ici de classifier comme corrects ou erronés les propos des
meninas sur la sexualité au regard du modèle scientifico-médical occidental19
. Les
préoccupations autour de la santé sexuelle sont fréquemment en rapport avec ces discours
hégémoniques, mais présentent de petits décalages influencés par d’autres savoirs médicaux
(la médecine populaire et le mysticisme, par exemple).
La contraception étant une des questions centrales au Granada, il est important de la
remettre dans le cadre de la santé sexuelle même si la santé reproductive appartient à tout un
autre domaine de la médecine contemporaine. L’extrait de conversation suivant permet
d’avoir quelques repères :
Andrea : - Julie [la fille de Nálary], elle a un peu de toi [à Zé Pequeno] aussi.
Moi, je me souviens du jour où vous êtes partis ensemble…
Nálary : - Moi ? Je ne parlais même pas avec Zé Pequeno.
Zé Pequeno : Non, Julie c'est… c'est après qu’elle se soit mise en ménage
avec ce mec-là et elle ne me regardait même pas !
Andrea : - Et ce jour-là, elle était déjà enceinte…
Zé Pequeno : Oui, mais justement elle était déjà enceinte, déjà enceinte. Je
vais faire quoi ? Juste…
Andrea : - Mais tu dois donc lui donner quelque-chose.
Zé Pequeno : - Le bébé était déjà formé. L’embryon était déjà en train de se
développer.
Nálary : - J’étais enceinte de déjà trois mois.
(…)
Zé Pequeno : - Après la fécondation, c’est fait.
Cet extrait de conversation entre deux meninas et leur copain, travailleur du quartier,
laisse envisager déjà quelques particularités des savoirs sur la reproduction et la sexualité :
pour Andrea le rapport sexuel sans préservatif est censé apporter quelque chose à Julie,
l’enfant de Nálary, mais non la paternité à part entière. Le demi-père présumé, Zé Pequeno, à
son tour, se défend en parlant d’abord de la grossesse avancée lors de la relation sexuelle
(trois mois implique déjà le développement) et après l’acte univoque de la fécondation.
19
Il existe plusieurs travaux, marqués par la prévention du sida, où il est important d’évaluer l’effectivité ou non
des pratiques et savoirs des meninas sur la sexualité pour justifier une intervention extérieure. L’étude de Sousa
(1998) en est un excellent exemple.
38
Dans la même conversation, Andrea mentionne le préservatif utilisé par un client qui
tremblait dans la poubelle juste après être jeté. Cela lui a fait penser : « tiens, les enfants
sautent déjà ! » Elle ressent une importante autonomie du sperme, comme une chose qui, étant
en contact avec autrui (ou autre chose), est censé produire des conséquences. Le préservatif la
protège donc du contact avec la substance la plus active et la plus puissante de l’homme : son
sperme.
Nálary, avec un discours plus consonant avec le savoir médical, ne considère pas
important d’avoir eu des rapports non protégés quand elle était enceinte de Julie : elle ne
pouvait pas retomber enceinte et Zé Pequeno, comme copain, n’est pas censé être sale ou
avoir des maladies, comme le sont les clients (cf. chapitre 4). Sa grossesse est ici un substitut
au préservatif, ce qui ne serait pas arrivé dans le cas d’Andrea.
Leurs propos diffèrent un peu, mais ont tous issus de ce mélange entre savoir médical
stricto sensu, savoir populaire et savoir spécifique des prostituées. Les degrés d’influence de
chacun sont variables, mais il est clair que les gens connaissent ces différents domaines et les
comprennent comme valables. Toujours à propos de la contraception, Cassandra m’a informée
que la pilule n’était pas bien car « ça fait accumuler trop » : trop de quoi ? On ne peut pas
préciser, mais ces idées et les remèdes (de la médecine occidentale ou populaire) circulent
entre les meninas qui s’informent mutuellement.
Le bien-être est aussi menacé à cause de la taille du pénis du partenaire sexuel : client
ou ami. Catarina m’a parlé des périls de « râper l’utérus », d’où le besoin de faire des
examens préventifs. Nálary confirme qu’une fois son vagin s’est déchiré sur 1,5 cm à cause
de cela. Le sexe anal est très souvent évité : hémorroïdes, tumeurs et lésions sont à craindre.
Les relations sexuelles des meninas sont le plus souvent opposées aux rencontres faites
au Granada. Il est toujours envisagé d’avoir un copain ou même plusieurs avec lesquels
l’épanouissement sexuel est possible. Finalement l’activité sexuelle en couple est censée
diminuer au fil de la vie, même si elles demeurent actives dans le travail du sexe.
À propos de la pratique de la prostitution, entre les politiques de bien-être individuel et
la lutte contre la propagation du VIH se situe la campagne Sem vergonha, garota : você tem
profissão20
initiée par le ministère de la santé (Ministério da Saúde) brésilien en 2002
(SIMÕES, 2010). Celle-ci a été élaborée et exécutée en collaboration avec la RBP (qui à
l’époque s’appelait Rede Brasileira de Profissionais do Sexo) promouvant la catégorie
20
Littéralement : « Pas de honte, ma fille : tu as une profession. » Le slogan fait référence à l’expression sem-
vergonha utilisée pour désigner des personnes qui n’auraient pas d’honneur, faisant un jeu de mots en la mettant
sans trait d’union pour exprimer l'absence de honte à avoir.
39
« professionnelles du sexe » et combattant la stigmatisation des prostituées dans le but de
former parmi elles des « agents de santé », ainsi que de fortifier les associations dans le pays
(BELELI & OLIVAR, 2011). Cette campagne ne fait pas écho parmi les meninas du Granada.
Le seul vestige de ces actions du Ministério da Saúde s’observe dans la catégorie que
les meninas se réservent dans leur inscription publique – ou étatique – celle de
« professionnelles du sexe ». Lors d’un congrès international sur la prévention du VIH,
Gabriela Leite a fait remarquer qu’entre les mots « prohibés » qui ont été énumérés dans la
brochure distribuée aux participant-e-s figurait « prostituée » ; les références à la pratique ne
pouvaient se faire qu’avec les termes de travailleuses et travailleurs du sexe (LEITE, 2009).
La médecine a imposé cette dénomination sans prendre en compte les sujets qui la pratiquent.
À l’heure actuelle, les questions sur le sida apparaissent surtout lorsque surviennent
des rumeurs sur quelqu’un qui serait porteur : un ancien client, un travailleur du quartier,
l’une des meninas, etc. J’étais présente lors du développement d’un de ces commérages :
quelqu’un a dit que le propriétaire d’un motel du quartier avait le sida, à un stade déjà très
avancé, ce qui a fait rappeler à certains que Valdete aurait eu des rapports non protégés avec
lui. Alors, tout le monde s’est mis à dire qu’elle avait le sida. Elle a donc fait un examen
médical et a apporté son résultat négatif au bar. La réticence a pourtant perduré car « tout le
monde sait que ça peut être négatif les six premiers mois ». Comme n’importe quelle rumeur,
celle-ci a disparu aussi vite. Après six mois, personne ne lui demandera de refaire ce test.
Le savoir scientifico-médical n’est certainement pas extérieur aux connaissances des
meninas, mais il n’est pas non plus compris comme la vérité absolue sur la santé sexuelle. À
celui-ci s'ajoutent nombre d’autres savoirs issus de l’expérience quotidienne qui composent
les discours faisant que la catégorie « groupes à risque » – tels qu’ont été classifiés les
prostituées et leurs clients dans les années 1990 au Brésil – ne soit pas assimilée ni assumée,
mais laisse place à l’identification d’un « réseau de risque » délimité dans le temps et dans
l’espace.
5. Le savoir religieux
Larice : - Elida a dit qu’une fois sortie [de prison] elle va aller à l’église.
Nálary : - À chaque fois elle dit qu’elle va aller à l’église. Son mari est mort,
« je vais aller à l’église » (…) elle est arrêtée par la police une première fois,
« je vais aller à l’église », arrêtée la troisième fois, ça a été « je vais aller à
l’église ».
Andrea : - Ce qu’elle a fait au lieu d'y aller, c’est de se faire faire un
tatouage.
40
L’église à laquelle il est fait référence dans le dialogue ci-dessus est la néo-pentecôtiste
(Assembléia de Deus et Igreja Universal do Reino de Deus sont les deux plus importantes au
Brésil). Elle est la plus présente au Granada, des prosélytes y distribuant des brochures de
temps en temps, mais les croyances catholique et afro-brésilienne (Umbanda et Candomblé
surtout) sont aussi très répandues.
Le savoir religieux protestant et catholique est très rapproché, même si les cultes
présentent des différences non négligeables. La prostitution (et d’autres formes de sexualité
déviantes) sont vues comme des péchés desquels les meninas peuvent être libérées si elles
abandonnent leur profession et « vont à l’église », c’est-à-dire adhèrent aux modes de vie
conformes à la théologie en question. La prostituée dans les cosmogonies chrétiennes est
toujours associée au péché et opposée à la vie sainte (VIEIRA, 2012).
Cependant, les religions afro-brésiliennes présentent un discours et une cosmogonie
différents de la chrétienne. Dans leurs propos, la prostituée et d’autres catégories sociales
déviantes sont représentées et protégées par la déesse Pomba-Gira. Nul besoin de conversion
ou d’abandon, la prostitution n’étant pas considérée comme un péché.
Mais même aux religions afro-brésiliennes, moins conflictuelles, le recours se fait
plutôt sporadiquement, comme dans le cas d’Elida. L’intégration dans la communauté
religieuse avec ses activités quotidiennes est peu envisagée. Aller à l’église et être croyant
n’est pas un évènement spécial chez les meninas du Granada, ainsi que les prostituées de la
Praça dos Diários étudiées par Vieira, malgré leur non-adhésion formelle aux institutions :
[Elles] assimilent stratégiquement les discours des croyants sur les points qui
leur ‘conviennent’, construisent le sacré comme élément primordial et
négocient [les dons divins] elles-mêmes, sans l’intermédiaire des
institutions, comme s’il y avait un raccourci vers Dieu. [traduction libre]
(2012, p. 16)
Finalement, au-delà du discours général des religions chrétiennes sur la vertu
féminine, il y a celui des branches des églises qui concentrent leur action sur les prostituées.
Les brochures néo-pentecôtistes en sont l’exemple le plus commun au Granada, mais aussi
dans d’autres contextes brésiliens, il existe la présence de la Pastoral da Mulher
Marginalizada (cf. chapitre 1). Il est important de la citer à nouveau dans ce topique car la
Pastorale est à l’origine de la controverse du mot meninas.
Cet organisme de l’église catholique surgit dans le contexte de la Théologie de la
Libération et se mobilise pour la fin de la prostitution, croyant que les prostituées sont
41
victimes de la société patriarcale (LEITE, 2009). Le terme meninas pour cette institution est
une manière de faire disparaître la prostitution, du moins dans les discours produits par la
Pastoral. Son objectif à long terme est de faire disparaître la prostitution partout.
Au Granada, en revanche, c’est un terme traditionnel qui substitue « prostituée » ou
« pute » couramment, de façon plutôt neutre. Or évidemment, cette appropriation catholique a
eu des conséquences pernicieuses pour l’organisation du mouvement des prostituées et il
devient controversé quand il gagne la sphère publique et peut aussi atteindre une recherche
anthropologique. Le savoir religieux va ici complètement à l'encontre de celui des meninas
sur elles-mêmes, où s’identifier ainsi n’est point démonstration de honte quant à sa
profession.
6. Le savoir médiatique
La présence des médias dans le quotidien des meninas est remarquable, les séries
télévisées diffusées par la Rede Globo21
, particulièrement, sont toujours sujets de
conversation. Admettant que les médias sont producteurs de savoir, je m’appuie sur l’analyse
de Beleli et Olivar (2011) pour étudier l’influence de cette institution sur la compréhension
des meninas de leur propre pratique.
La recherche menée sur les productions de 2007 à 2011 montre que les séries
télévisées qui parlent de la prostitution ont changé progressivement leur approche, auparavant
liée à l’idée de profession du sexe, pour s’orienter sur les questions de la traite des êtres
humains et de l’exploitation sexuelle, s’entourant ainsi de la législation pénale modifiée en
2009 (voir plus haut). Malgré cela, les auteurs reconfigurent les dichotomies qui opposent la
« pute » à la « mère » (comme celle présente dans le discours religieux catholique).
Si ce personnage [Bebel] et les constructions proposées par les médias qui
sont ici présentées sont loin d’être ‘révolutionnaires’, il est mis en évidence
un important, même si mineur, moteur de dés-établissement [des
dichotomies] dans le sens qu’au-delà des récits de misère ou d’autorité,
Bebel est juste un personnage complexe, qui perdure, expérimenté et doté
d’agency et de subjectivité. [traduction libre] (BELELI & OLIVAR, 2011, p. 527)
La présence presque immanquable des prostituées dans les séries télévisées fournissent
plusieurs modèles fréquemment discutés par les meninas. Elles actualisent les surnoms et la
façon dont elles appellent le bar d’après des productions culturelles qui, en tant
21
Le plus important réseau de télévision au Brésil.
42
qu’éphémérides, sont vite substituées par d’autres. À ce propos Beleli et Olivar proposent qu’
« à Porto Alegre, l’image de Bebel circulait parfois investie de fierté et d’affects, d’autres de
haine, mais demeurant toujours une référence réflexive dans les réseaux sociaux de la
prostitution » [traduction libre]. (2011, p. 500)
Les personnages ainsi complexifiés pratiquent, pourtant, ce que les auteurs appellent la
« prostitution quasi folklorique » : ce sont des adultes atemporelles qui ont toujours été
« putes ». Les transits et les asymétries rendues visibles lors des rencontres avec des étrangers
ramènent encore à la victimisation des prostituées et à la criminalisation de la prostitution.
Les meninas du Granada pratiquent normalement cette prostitution « folklorique », car
leurs clients sont surtout des hommes locaux et elles ne se déplacent pas à l’extérieur. Elles
disent qu’elles ont leur maison et leurs enfants à Fortaleza, que leur vie est là et qu’elles n’ont
pas envie de tout abandonner. En plus, la langue se montre aussi un problème22
. Andrea et
Nálary disent qu’il serait bien de trouver un gringo23
qui leur donnerait beaucoup d’argent
pendant trois jours et après repartirait chez lui, « ça serait trop bien ». Mais des hommes avec
lesquels elles devraient maintenir une relation stable « surtout pas. J’en ai déjà assez ici ».
Les relations avec les étrangers sont attractives en tant que bonus potentiel, mais non
pas comme règle. Aux meninas du bar, où le programa est d’environ 30 minutes (15 minutes
dans la chambre), passer des semaines avec un client paraît insoutenable. Les différences de
rémunération sont connues, notamment par rapport à celle des meninas de la boîte, mais cela
ne suffit pas pour motiver le changement de leurs habitudes. Elles gagnent environ 400
€/mois, presque deux fois le salaire minimum au Brésil.
7. Le savoir anthropologique
Le savoir anthropologique est marqué par la transversalité. Les études sur la
prostitution citées au long de ce texte témoignent du dialogue développé entre celui-ci et les
autres domaines en analyse. Les chercheurs et chercheuses sont très souvent intéressé-e-s par
la critique d’autres disciplines ainsi que des leurs : ils dénoncent chez les autres la prétention
d’objectivité qui cache les projets politiques et essayent toujours d’entreprendre la
déconstruction de ces savoirs. Ils reconnaissent chez eux les mêmes possibilités de faiblesse,
une fois que « l’écriture ethnographique ne peut pas entièrement éviter le recours
22
Rafaela m’a demandé des informations sur le cours de français que je faisais à l’époque de l’enquête de terrain
en raison d’un client martiniquais. 23
Homme étranger.
43
réductionniste à des dichotomies et à des ‘essences’ (…) » (CLIFFORD, 2003, p. 264). Il en
reste que, grâce aux efforts des anthropologues visant à remarquer les biais qui composent la
production des savoirs, l’aspect politique et l’aspect interpersonnel des recherches ne sont pas
négligés :
(…) en tant que moyen de production de la connaissance à partir d’un
engagement intense et intersubjectif, la pratique de l’ethnographie détient un
certain statut. (CLIFFORD, 2003, p. 265)
C’est un moteur de la complexification des regards sur la prostitution de
l’anthropologie contemporaine brésilienne, selon la lecture de Leite (2009), c’est leur
initiative de « discuter sur elles-mêmes ». Ceci, associé à la densité de la rencontre des études
en anthropologie, a forgé une nouvelle lecture de la prostitution qui est majoritairement
compréhensive et engagée politiquement.
De cette façon, les prostitué-e-s sont dépeint-e-s en tant que sujets empowered et dotés
d’agency – statuts qui sont des réponses directes au féminisme abolitionniste, minoritaire au
Brésil, mais très important dans la production occidentale des théories sociales, aux États-
Unis et en Europe.
Nous sommes tous engagés à montrer les différents aspects (parfois insolites) de la
prostitution, où les femmes (objet de la plupart des travaux) ne sont pas des amazones
matriarcales ressurgies (BACHOFEN, 1903). La révolution sexuelle et ses impératifs
moralisants (LEITE, 2009) ne sont pas envisagés ; les questions du jour sont les stratégies
intersubjectives et sociopolitiques pour vivre la prostitution et d’autres formes d’amour
(SIMÕES, SILVA, & MORAES, in press) et les trajectoires transnationales de ces relations
face aux rapports de race, classe et genre et les agendas humanitaires internationaux
(PISCITELLI, ASSIS, & OLIVAR, 2011).
À plusieurs reprises, les meninas et moi avons discuté de l’utilité de la recherche. Cela
se faisait surtout parce qu’elle n’était pas évidente. Rafaela a d’abord proposé que je leur
« offre une voix ». Elle pensait ainsi car, à la différence de la méthode des autres
professionnel-e-s qui les interrogeaient (des journalistes principalement), l’anthropologie
exige de fréquents contacts24
. Leurs histoires pourraient devenir des livres, disaient-elles, et le
résultat de mon travail serait plus ou moins cela.
24
À ce propos, elles m’ont parlé d'un film documentaire sur elles, basé sur mon mémoire de licence, qui n’a pas
abouti car « les gens étaient trop pressés ». La comparaison de ce documentaire avec le travail anthropologique
précèdent leur a fait remarquer l’importance de la durée de l’enquête.
44
Des voix, elles en avaient déjà, même si elles sont à l’extérieur de l’APROCE. Je les ai
vues se mobiliser pour leur compte et la possibilité d’organisation politique ne leur était pas
inconnue. Au fil du temps, je les ai vues intriguées par la représentation que j’aurai à faire
d’elles. À l’intérêt porté à la profondeur de leur vie, elles ont répondu, à leur tour, par une
forte réflexion. Très vite, Les réponses ont quitté le domaine du prêt-à-porter et la réflexivité
des meninas s’est conjuguée à celle envisagée dans l’écriture ethnographique.
8. À quoi les savoirs servent-ils ?
L’ensemble des savoirs participant à l’expérience des meninas ici exposé a été présenté
selon l’utilisation qu’elles peuvent en faire. Plusieurs dispositifs sont en marche lors de
l’élaboration des corpus de connaissances sur la prostitution. Leurs divers degrés de légitimité
parmi les meninas sont constitués par des configurations subjectives, interpersonnelles et
sociopolitiques. Il faut avoir à l’esprit que les contraintes imposées par les institutions décrites
auparavant sont très puissantes et sont en partie reproduites par le discours des meninas elles-
mêmes ; en revanche, la consommation est aussi une activité productive (CERTEAU, 2008).
Les savoirs énumérés ici sont tout autant contrainte qu'opposés à cette contrainte.
L’exposition des formes de catégorisation du marché du sexe, issues des savoirs
étatiques ou en rapport avec l’État, démontre la relation intrinsèque entre eux. Les domaines
plus traditionnels de la religion, de la médecine et du droit, qui jouissent d'une importante
légitimité auprès des meninas et de la société brésilienne en général, se reproduisent souvent
mutuellement avec de petits décalages. Ils font face, pourtant, à d’autres domaines qui ont une
importance croissante.
Les « actes contre nature » initialement traités comme des péchés dans le
contexte religieux ont été transformés en crimes ou délits dans le contexte
judiciaire, puis plus récemment en maladies à soigner dans le registre de la
médecine, avant de sortir du champ de la pathologie et être construits comme
une forme d’identité sociale et de participation à une « communauté ».
(GIAMI, 2009, p. 231)
Les différentes connotations des savoirs produits sur la prostitution ne sont pas
seulement issues des chercheurs et chercheuses des différentes disciplines en question. La
participation des prostitué-e-s, travailleuses et travailleurs du sexe et meninas, sujets
producteurs du savoir de la prostitution dans la formation du corpus des savoirs sur la
prostitution est de plus en plus importante. Il y a un long chemin à parcourir, car la légitimité
45
d’autres locus de production de savoir (médecine, droit) s’imposent sur le savoir interne
(associatif) dans les élaborations du sens commun quant à ce qu’est la prostitution. Pourtant,
le seul fait que les prostitué-e-s aient une « voix », sans besoin d’anthropologues ni de
journalistes, est à célébrer. L’optimisme est permis et les meninas du bar constituent entre
elles un groupe qui s’apparente à une communauté.
46
Chapitre III : Identification et différenciation à travers la catégorisation des femmes
au Granada
Les savoirs produits et appropriés par les meninas sont au sein de la configuration de
leur réseau. Même si l’appartenance à cette catégorie ne se fait pas de façon homogène chez
elles, le constat de la proximité issue du partage de la forme du programa, de l’espace de
travail, des clients, etc., laisse entrevoir les contours de ce groupe.
Pour mieux comprendre qui sont les meninas, il est important de percevoir comment
elles conçoivent les autres catégories de femmes qui les croisent, au quotidien, dans leur
travail. La catégorie féminine centrale de cette étude sera ici comprise par rapport à ce qu’elle
n’est pas : dans ce chapitre ce sont les altérités féminines présentes dans le quartier du Passeio
Público et le Restaurante Granada. La présentation de ces femmes qui ne sont pas des
meninas est faite entièrement à partir de la perspective de ces dernières ; les catégorisations de
l’altérité représentent beaucoup plus les caractéristiques de leurs auteurs que celles des sujets
catégorisés (AGIER, 2013).
Dans la description des autres femmes qui participent quotidiennement au marché du
sexe que nous étudions, les processus d’identification et d’éloignement par rapport aux
meninas en sont le principal objet. L’organisation selon le genre féminin de ces groupes est
proposée à cause de la centralité de cet élément dans les constructions des meninas.
Nous allons voir dans ce chapitre, dédié aux sujets féminins qui fréquentent ces
mêmes espaces, l’opérationnalisation des modèles de genre pour la construction d’une
collectivité morale et politique dans un contexte de prostitution. Ce choix de présentation des
catégories est ainsi fait car : « gender differentiates types of sociality such that the structure of
same-sex bonds has a separate productive outcome from that of cross-sex bonds. »
(STRATHERN, 1988, p. 324)
Sont exclues de ces catégories féminines : Larice, propriétaire d’une buvette
ambulante et snacks, Aparecida, vendeuse de cosmétiques, et la « Tia », responsable du
ménage dans le Motel ; ces trois femmes, un peu plus âgées, sont toujours au Granada et ont
une relation très étroite avec les meninas, surtout Larice. Elles ne sont jamais inclues dans une
même catégorie, mais désignées de façon individualisée.
Les catégories d’analyse sont organisées selon le degré de proximité géographique et
sociale partagée avec le Granada, de différence de la plus subtile à la plus accentuée du point
de vue des meninas. À travers cette classification, sont ici en étude : les meninas qui volent ;
les meninas de la boîte ; les meninas qui sortent avec des gringos ; les meninas riches qui font
47
des programas ; les filles qui embrassent n’importe qui aux fêtes ; les femmes mariées ; les
agents de la mairie, les femmes et leur famille, les folles, l’etnologue.
1. Les meninas qui volent
Cette catégorie se situe entre être une menina et être une autre. Le nom menina utilisé
pour désigner ces femmes indique déjà la forte présence des éléments en commun. Les deux
catégories fréquentent quotidiennement le même espace – le quartier du Passeio Público – et
parfois peuvent se confondre. Pourtant, les meninas qui volent ne sont pas un sous-groupe de
celles du Granada. L’agrégation de l’expression « qui volent » à leur catégorie désigne des
femmes qui prétendent pratiquer la prostitution quand de facto leur objectif est de voler les
clients des prostituées. Leur activité est donc néfaste à la pratique des meninas « tout court »,
quand celles-ci, comme nous l’avons signalé au premier chapitre, ne sont censées voler qu'en
cas de situations extrêmement favorables. Si cela ne se produit pas, rien ne nuit aux revenus,
puisque leur principale ressource résulte du programa.
D’où l'existence d'un éloignement réel entre les deux catégories malgré leur proximité
pour un observateur externe. À ce propos, Rafaela m’a raconté qu’elle a été prise pour l'une
des meninas qui volent :
Oui, elles étaient là-bas et ont volé un mec… Le vieux a juré que c’était moi.
Et ce jour-là j’avais deux cents, trois cents reais (80 euros, 110 euros), alors
il a dit que l’argent était le sien. J’ai échappé à la prison et à un casier à la
police grâce à une copine à moi. Elle a appelé le commissariat de police et
leur a dit que je n’avais jamais fait ce genre de chose. Mais si elle ne l’avait
pas fait… J’aurais été injustement condamnée.
Le client volé n’a pas distingué les meninas de celles qui volent, ni avant ni après
l’occasion. Il n’était certainement pas un habitué du bar car ceux qui le fréquentent le savent
déjà, ils ont « peur de celles qui volent » selon Larice. La police, en revanche, sait bien qu’il
existe une distinction entre les deux catégories et c’est pour cela que Rafaela a été libérée.
Quand une autre menina « tout court » atteste qu’elle n’est pas voleuse, ils reconnaissent
l’importance de la distinction des catégories et « croient » à la cohésion du groupe des
professionnelles du sexe. Andrea fait remarquer dans un autre contexte : « quel intérêt à voler
si nous sommes toutes d’ici ? », Cassandra poursuit : « il n’y a même pas de quoi voler ».
La figure limite entre la menina du bar et la menina voleuse est Maria João. Son cas
est compliqué car, comme le dit Larice, « des fois elle prend de la drogue et invente des
48
histoires, mais c’est une bonne personne ». Elle a une « passion dingue » pour une autre
femme et, à chaque fois que les choses se passent mal entre elles, Maria João prend de la
drogue et fait des bêtises, telles que voler les clients. Ainsi, comme Larice, les meninas ont un
regard plutôt compréhensif envers les mécontentements amoureux de Maria João, elles
blâment sa compagne, qui « ne vaut pas une merde » et elle demeure la bienvenue.
Les distinctions établies en raison de la pratique de vols parmi les meninas de ce
quartier ont été encore plus marquées dans le passé. La place du Passeio Público était partagée
en deux côtés agonistiques qui s’opposaient par la pratique centrale ou non du vol dans un
contexte de prostitution : le côté Aldeota, ou encore Zoomp, appartenait aux meninas tandis
que le côté Pirambu, ou Beco da Poeira, comptait les meninas qui volent.
Ces moitiés sont illustrées par des métaphores basées sur les ethos des classes sociales.
Même si toutes les femmes qui fréquentaient la place dans les années 1990 étaient issues des
couches populaires, il existait une distinction établie où le vol des clients comme source
principale de revenus était signe d’une série d’attributs négatifs (cf. chap. 2) qui stigmatisaient
les femmes du Beco da Poeira par rapport à celles de la Zoomp.
La dichotomie d’espaces symétriques n’a pas perduré après que les filles se sont
déplacées vers le bar. Celles qui appartenaient à l’Aldeota s’y sont établies sans problèmes
autour de la figure d’Andrea, parfois dite la « chef ». Le destin des meninas du Pirambu
diffère : il y a des cas comme celui de Gabriela25
qui s’est conformée aux normes du
professionnalisme. Il y a d’autres situations dans lesquelles les femmes sont marginales au bar
même si la place n’est plus adéquate au travail. C’est ce qui se produit pour Marlene26
et Elida
qui circulent entre les espaces de prostitution du quartier sans vraiment s’établir nulle part.
À l’heure actuelle, les meninas de la pente, dont nous avons parlé au chapitre deux, se
composent majoritairement de voleuses, compte tenu de l'importance de la toxicomanie dans
leur quotidien au quartier du Passeio Público. Les meninas agissent de manière solidaire
envers elles, mais les excluent de leur espace de travail. En l’absence de structure, les meninas
qui sont de la pente utilisent une friche pour faire les programas et prendre de la drogue.
La catégorie « meninas qui volent » les englobe et les dépasse en nombre. En fait, les
« meninas qui volent » désignent des femmes moins éloignées physiquement des meninas que
celles de la pente.
25
Dans l’enquête de 2013, j’ai appris que Gabriela avait quitté le bar pour des raisons financières. Désormais,
elle est employée domestique. 26
Marlene ne fréquente plus ces espaces. Les problèmes avec sa fille (voir plus loin) et/ou sa mise en couple
récente sont mentionnés comme raisons par les meninas.
49
2. Les meninas de la boîte
Les facteurs de différence des meninas de celles de la boîte, déjà mentionnées ci-avant,
seront ici développés. Les espaces de socialité distincts abritent des différences morales,
sociales et physiques. Les bonnes relations entre les meninas et les meninas de la boîte ne
permettent pas qu’on les confonde.
Les prix du programa dans la boîte sont d’environ 25 euros et celui du bar 12 euros.
Le tarif du loyer des chambres pour une heure est de 8 euros à la boîte et de 2 euros au bar. Il
y a une importante différence de revenu dans les deux catégories qui représentent des types
distincts de travail du sexe. Les motivations sont aussi diverses, l’âge et la maternité en
témoignent : au bar les meninas ont environ 40 ans, et même la plus jeune, qui à l’époque de
la recherche en 2010 avait 24 ans, avait quatre enfants, lesquels représentaient une grande
partie de ses obligations financières.
Marlene, qui a 47 ans, m’a fait remarquer que, pour entrer dans la boîte, le videur lui
demandait la carte d’identité et ne la laissait pas entrer à cause de son âge. Jouant avec l’ironie
de cette exigence, le videur ne lui interdit pas l'entrée parce que trop jeune, sinon parce que
trop vieille.
Les vêtements sont aussi une distinction : celles de la boîte sont habillées en mini-
jupe, petit haut et chaussures à talons. Plus jeunes, elles sont aussi plus longilignes et plus
attentives à la minceur de leur corps. J’y suis allée une fois avec Rafaela et j’ai remarqué
qu’elles avaient des pratiques de séduction érotique plus proches de celles médiatisées
(BELELI & OLIVAR, 2011) : elles font des strip-tease dans un salon toujours très sombre,
plein de bruit et de fumée. « Parfois les clients leur lèchent la chatte au milieu des gens ! C’est
complétement immoral ! », m'a confié Rafaela, indignée et soulignant ici l'importance de la
discrétion. Même si les meninas et celles de la boîte viennent des couches populaires, les unes
et les autres ont des habitudes très différenciées.
3. Les meninas qui sortent avec des gringos
Dans ce cas aussi, la distinction n’est pas bien nette, car les unes et les autres sont des
meninas et les processus de différenciation sont nommés d’après le type de client. Les études
menées sur le sujet à Fortaleza indiquent pourtant une distinction plus importante entre les
pratiques des femmes qui sortent avec des gringos et celles des meninas étudiées ici. La
complexification systématique des rapports entre les femmes indigènes et les hommes
50
étrangers remplace le modèle du programa et le lexique de la prostitution par celui de l’ajuda,
qui appartient au contexte du couple stable :
(…) les échanges considérées ajuda au Brésil, même s’ils peuvent être
situés, en termes analytiques, dans le domaine de la sexe-marchandise,
mettent en évidence leur différence par rapport à la prostitution dans les
conceptualisations indigènes. [traduction libre] (PISCITELLI, 2011, p. 553)
Parmi les différences, la durabilité de la relation et la possibilité de la vie en couple
sont les plus saillantes. Les meninas savent que « il arrive à toutes les femmes de tomber
amoureuse d’un client », mais cela porte le voile de l’exceptionnalité. Par contre, leurs
collègues qui sortent avec des gringos ont toujours cette possibilité en vue. Jusqu’à présent,
aucune étude quantitative entre le nombre de relations initiées lors de rencontres dans le cadre
de la prostitution traditionnelle et le nombre de relations pratiquées avec des gringos n’a
encore été réalisée, de sorte qu’il n’est actuellement pas possible de savoir si et dans quelle
mesure les différences de disposition les affectent.
Ce sont deux pratiques distinguées, mais non pas auto-exclusives. Le traditionalisme
et même le statut folklorique ont été désignés comme les marques de la forme ascétique
d’insertion dans le marché du sexe pratiqué par les meninas. L’appartenance à d’autres
générations – la plupart des meninas étant âgées d’environ 40 ans – n’est pas marquée par la
méconnaissance de ces nouvelles pratiques plus floues dans le domaine du marché du sexe.
D’autres facteurs les motivent. Pour les meninas, la plus grande bêtise est d’arrêter de
travailler et d’être dépendante – elle et ses enfants – d’un seul homme, qu’il soit client ou
mari27
. Les ajudas des clients sont accueillies avec méfiance. L’argent récupéré tous les jours,
petit à petit, d’hommes différents est plus sûr que le soutien expressif d’un seul homme. Il
s'agit bien de protéger son indépendance.
Il n'y a que très rarement des gringos au bar : le martiniquais de Rafaela, un européen
que j’ai croisé une fois, et d’autres dont on ne se souvient pas. Au bar, ils sont comme des
clients anonymes locaux et ils font les programas à la mode des meninas, « tout court ».
4. Les meninas riches qui font des programas
27
Malgré cela, Valdete n’était plus présente au bar puisqu’elle s’était mariée avec un « vieux ». Recevoir l’ajuda
d’un homme plus âgé, à épouser ou non, est le modèle classique de cette pratique qui à l’heure actuelle s’étend
aux rencontres sporadiques avec des hommes étrangers en vacances, qu’ils soient ou non plus âgés.
51
Un jour, à côté du chariot de Larice, Cassandra m’a demandé pourquoi je ne
recherchais pas d’autres types de prostitution, surtout celui des meninas étudiantes de
l’université. La question de Cassandra est très importante car elle porte le regard académique
sur un autre objet, éloigné socialement et géographiquement d’elles-mêmes, mais appartenant
toujours au marché du sexe, soit sous la forme du programa, soit via l’ajuda. Par cette
remarque, elle sort leur pratique de l'exotisme pour la rapprocher de celle exercée par des
collègues de faculté.
Larice : - Il y a beaucoup de filles à papa qui font des programas pour
payer…
Cassandra : - Bien sûr !
Larice : … la fac…
Cassandra : - La fac, les disciplines…
Larice : … le luxe…
Cassandra : - Pour avoir une voiture, de beaux vêtements… Il y en a
beaucoup !
Dans le cas des filles riches, il est important de noter que la théorie de la nécessité
absolue, proposée par la Pastoral da Mulher Marginalizada, n’est pas valable, leur pratique
étant perçue comme superficielle, surtout ici par Cassandra. Elle est la seule des meninas à
avoir montré un grand mécontentement concernant le travail du sexe et a, à plusieurs reprises,
raconté ses ambitions et tentatives de s’engager dans une autre carrière28
. Elle explique son
incapacité à trouver un autre travail par le fait qu'elle n'ait pas achevé le lycée. Dans sa
jeunesse, elle a fréquenté des écoles et des personnes de classes moyennes et aisées. Enceinte
de son premier enfant à 17 ans, elle a dû abandonner l’école. La prostitution n’avait jamais
figuré parmi ses projets et ses anciennes copines « pleurent quand elles la voient là-bas ».
Alors, quand une fille qui est à l’université choisit le travail du sexe, pour Cassandra, c’est
une aberration.
5. Les filles qui embrassent n’importe qui aux fêtes
Ici, nous sortons des catégories de femmes liées professionnellement au marché du
sexe pour rentrer dans les pratiques sexuelles qui sont associées à la prostitution, malgré leur
non-correspondance avec la réalité de la sexe-marchandise. Dans l’étude du stigmate de la
28
Lors de la recherche de 2013, ceci n’était plus le cas. Même si Cassandra mentionnait encore des phrases
marquées par le stigmate, étranges pour les autres femmes qui l’écoutent, comme « quand j’étais une
personne… », pour parler de son passé riche et extérieur à la prostitution, elle m'a semblé plutôt satisfaite de son
travail.
52
« pute », Pheterson (1999) fait remarquer les non-correspondances entre ce qui lui est attribué
et la pratique de la prostitution. Dans la conversation restituée ci-après, les meninas
démontrent ces éloignements :
Nálary : - Moi, je ne comprends pas ! Les jeunes filles qui… Jeunes, tu sais
comment, qui ne vivent pas dans cette vie [de la prostitution]. Elles vont aux
fêtes et embrassent n’importe quel homme ! Je n’ai jamais été comme ça !
Cassandra : - Moi non plus.
Nálary : - Que j’aille à une fête pour embrasser un homme sur la bouche, ça
ne s’est jamais produit dans ma vie !
Cassandra : - Moi non plus.
Nálary : - Moi je suis très discrète. Sauf s’il y a un type que je connais déjà
et je le vois dans une fête… Je lui plais, il me plait aussi, je peux l’embrasser
dans cette fête. Mais si ce n’est pas comme ça, non !
(…)
Nálary : (…) il lui payait une bière, 1 real [40 centimes d’euro] ! 1 real ! À
chaque fois qu’elle allait à une fête elle embrassait un homme différent sur la
bouche et ne le revoyait plus jamais.
Cassandra : - Et elle ne gagnait rien pour faire ça !
Le questionnement mené par Nálary et Cassandra porte sur les nouvelles pratiques
sexuelles incorporées par la jeunesse, surtout les adolescent-e-s, hors des espaces de
prostitution. C’est un choc générationnel des mœurs sexuelles avec le bémol des savoirs issus
du travail du sexe. Plusieurs des meninas ont été élevées dans les règles de la fréquentation
chaste et du mariage vierge, côté femmes, bien sûr (BOZON & HELBORN, 1996). À ce
propos, Valdete, quand elle m'a raconté sa première fois, a utilisé l’expression « je me suis
perdue », car son compagnon à l’époque l’a abandonnée après, comme c’était commun de le
faire il y a quelques décennies. Comme pour de nombreuses femmes de sa génération « son
‘déshonneur’ se rapporte à trois éléments : la honte, un sentiment d’échec, la peur. » (1996, p.
9)
Cependant, la prostitution des meninas, dite folklorique, ne peut pas être liée
mécaniquement à des visions traditionnelles de la sexualité et de l’amour, ni à une prétendue
révolution sexuelle. Le modèle du couple chez les meninas est très puissant. Même si le
mariage et la dépendance financière ne sont pas envisagés, être en couple avec un ou plusieurs
sujets est souvent leur ambition. L’éphémère du ficar – comme les jeunes appellent ces
rencontres avec des baisers et parfois du sexe sans perspective de lendemain – n’est pas
désiré.
Partout dans le nord-est du Brésil, les diverses formes d’être ensemble constituent un
continuum qui permet aux sujets de nommer leur rapport « de couple » tout en gardant une
53
grande gamme de types de couple où les frontières sont très floues : « designations as
amasiamento, concubinato (‘concubinage’), chamego (‘having an affair’), or prostituição
(‘prostitution’) depends on the attitude of the speaker toward the union. » (REBHUN, 1999,
p. 156)
6. Les femmes mariées
Celle-ci est la catégorie clé pour comprendre le rapport des meninas avec leurs savoirs
et les autres groupes sociaux. Les femmes mariées sont entièrement constituées d’ambiguïté.
Elles passent devant les meninas sans les regarder, parfois même traversent la rue pour ne pas
être sur le même trottoir que nous, pourtant ces femmes mariées ne sont pas toutes forcément
mariées officiellement. Elles placardent leur statut « en couple », bras dessus, bras dessous
avec l’homme qui les accompagne, se distinguant des meninas alors qu’elles viennent des
mêmes classes populaires, ont le même type physique et portent les mêmes vêtements.
Cette différence n’est donc due qu’à la posture contextuelle, une différence qui
souvent ne fait sens que dans l’espace de prostitution, où les meninas sont les « putes » alors
qu’elles sont des femmes mariées. Nous revenons ainsi à la distinction endossée par le savoir
religieux entre « pute » et mère. Hors de ce contexte, les meninas sont tout autant mères en
couple que les femmes mariées.
Pourtant, nous appréhendons ici cette distinction du point de vue des meninas. C’est-à-
dire que « femmes mariées » est une catégorie formulée par elles-mêmes face à l’attitude des
piétonnes. Elles se distinguent donc de ces femmes parce que le mariage n’est pas l’aspect le
plus important de leur vie sociale ni de leur sexualité, tout du moins dans le contexte du
Granada.
En fait, c’est justement dans le domaine de la sexualité que cette différenciation est
développée. Contre le préjugé affiché de ces femmes, les meninas redéveloppent l’image de la
prostituée « femme fatale » qui, à côté de celle de victime, composait l’imaginaire populaire
et le savoir académique sur le sujet (RAGO, 2008). Cette imagerie n’est pas vraie ou fausse,
elle est une option.
À propos de la haine des femmes mariées, Larice explique : « Donc, tu sais comment
sont les hommes, non ? Il y en a plusieurs qui viennent avec le projet de faire un goûter, de
prendre un petit café, ça justement pour regarder les meninas ». Au Granada, il est envisagé
que leur haine apparente dissimule en réalité la reconnaissance de l’infériorité quant aux
savoirs sur la sexualité.
54
C'est face aux femmes que les préjugés sur leur profession sont les plus fortement
perçus. La coïncidence du genre dans un contexte de prostitution hétérosexuelle provoque de
l’agressivité entre « putes » et mères, alors que le masculin est négligé29
. Rafaela qui semble
aspirer à la reconnaissance de leur pratique en tant que profession, travail digne de fierté, m'a
confié : « mais les femmes ne voient pas ça, elles passent comme si on était des espèces de
bêtes, des choses sans importance, des saloperies, n’est-ce pas ? ».
N’est-ce pas ? Oui, c’est bien cela. Assise à côté des meninas, j’ai également été l'objet
du regard méprisant de femmes mariées, faisant un effort pour ne pas nous croiser. La réponse
venait vite, elles faisaient l'objet de moqueries, à haute voix : « Ces femmes ne savent rien de
la vie, alors leur mari vient nous chercher ». Car, les meninas, elles, savent ! Elles ne font rien
de spécial avec les clients ordinaires (cf. chap. 1 et 4), mais elles peuvent le faire si (1) on les
paie plus, (2) c’est un client bien parfumé ou (3) c’est leur copain.
Avec la satisfaction sexuelle, il existe aussi un partage qui peut être mis en termes
d’amitié, de respect et d’amour. Aucun de ces sentiments n’est extérieur à la prostitution,
pourtant leurs conditions de production ne sont pas toujours présentes. Dans une
communication personnelle, Michael Houseman a signalé que « le programa est une danse
qui se danse à deux ». Pour elles, le programa au Granada est dénué de satisfaction sexuelle,
elles la simulent, cerclées d'une série d’interdictions qui excluent a priori le partage.
Le savoir des prostituées, en plus des pratiques qui leur permettent de maîtriser la
sexualité dans le programa et de l’expérience acquise avec plusieurs hommes, leur apporte
une connaissance plus approfondie de la sexualité de leurs clients (maris d’autrui). Quand les
hommes sont dans la catégorie de clients, il y a des changements de comportement : leur
conformation aux règles des prostituées (femmes), les désirs déviants, l’adhésion à la vie
bohème en sont quelques exemples. Gabriela Leite remarque que les clients pleins de
fantasmes sexuels gardent ces désirs pour les satisfaire avec des « putes » : « normalement ces
hommes sont mariés et passent tout leur vie avec une seule et même femme qui ne va jamais
connaître ce côté de leur personnalité ». (LEITE, 2009, p. 70)
7. Les femmes de la mairie
La catégorie valable pour les deux genres « agents de la mairie » est ici substitué par
celle de « femmes de la mairie » car, lorsque les meninas se plaignent des actions
29
Un jour, un homme prenait un café chez Larice et parlait avec les meninas en attendant sa femme. Quand elle
lui a rejoint, elle a jeté un regard était furieux sur les femmes.
55
ségrégationnistes et répressives, elles critiquent les sujets au féminin. Ceci doit être mis en
relation avec l’identification des préjugés concernant la catégorie féminine précédente ; l’une
et l’autre représentent pour les meninas le stigmate ressenti au quotidien. Si la production des
savoirs scientifiques et religieux imprégnés de jugements moraux sur la prostitution a
longtemps été un privilège masculin dit universel (SCOTT, 2012), leur ressenti s'est jusqu'à
présent exprimé lors de contacts avec des sujets du genre féminin. Les hommes qu’elles
rencontrent dans le contexte du bar sont très souvent vus comme de possibles alliés (voir le
quatrième chapitre).
Lors de l’inauguration de la dernière réforme du Passeio Público, en 2007, il y a eu un
problème car « des femmes trop bêtes » ont exigé que Larice retire son chariot du trottoir.
Ceci fut vécu par elle et les meninas comme une grande humiliation qu’elles gardent encore
très vive dans leur mémoire.
Larice : - C’est qu’il y a eu un événement une fois là-bas et Luizianne
(madame le maire) devait venir, alors elles ont dit de me faire sortir, mais je
suis revenue.
L’ethnologue: - Ah bon ? Et vous avez souffert de violences [en plus] ?
Larice : - Non, non. Je suis allée parler avec eux.
L’ethnologue : - D’accord.
Larice : - Moi, j’ai dit que j’allais demander un remboursement à Luizianne,
que bientôt j’aurais 19 ans de travail ici. J’ai élevé mes enfants ! Je vis ici
pour maintenir ma famille.
(…)
Larice : - Il y a des gens à qui il plaît d’humilier les gens plus humbles…
Maria João : - Larice, elle enfreint tout.
Cette situation est anecdotique, mais la logique implicite est flagrante : la prostitution
n’est pas un crime, donc il n’est pas possible de simplement emprisonner ou déplacer les
prostituées30
, surtout dans le cas présent, la mairie étant de gauche. La solution est d’en
enlever la structure, ou du moins une partie, dans ce cas : Larice et sa buvette ambulante.
L’attribution du genre féminin aux personnes qui ont motivé la sortie de Larice – soit
madame le maire et ses accesseur-e-s – permet le même type de lecture élaboré pour analyser
les relations avec les femmes qui passent accompagnées d'un homme. Rafaela explique à
propos des événements culturels qui ont lieu au Passeio Público et de l’envie des meninas de
demeurer absentes : « on est si habituées à être rejetées que tant pis. [Rejetées par] les femmes
avec des hommes hyper beaux, tu vois ? »
Les femmes mariées et celles de la mairie peuvent se confondre lors d’un événement
30
Lors de la visite du comité de la reine Elizabeth II à Rio, en 1967, les militaires ont cerclé le plus traditionnel
espace de prostitution de la ville, la Zona do Mangue, au moyen de palissades.
56
culturel qui englobe des classes moyennes et intellectuelles. Si ici l’origine sociale s’ajoute
comme marqueur de différence, les efforts de différenciation ne sont pas moins présents et les
mêmes pratiques – traverser la rue, ne pas regarder, regarder avec mépris – sont mises en
œuvre à l'égard des meninas. Cela revient à dire : « je suis une femme différente de vous ». Ce
à quoi elles répondent par un dialogue indirect en disant : « on baise mieux et vos maris
viennent nous chercher avec plus de désir qu’ils n’en ont envers vous ». Cette différenciation
se fait face aux préjugés qui ont lieu lorsqu’elles travaillent au Granada. Dans un autre
contexte, elle n’aurait pas lieu. L’idée de processus est très importante : il n’est pas question
d’affirmer une différence essentielle entre ces catégories de femmes et celles des meninas,
mais de comprendre comment cette différence se construit.
8. Les femmes et leur famille
Les femmes de la famille sont généralement des individus compris dans l’ensemble
non genré de la « famille », lequel est fréquemment très éloigné de leur espace de travail,
pourtant elles ne sont pas complètement absentes. La stratégie analytique, consistant à les
séparer sous une rubrique qui relève l’importance du genre, se fait face à la construction de
proximités et de distances (d’)avec le lien de parenté selon cette inscription.
Nombre d’autres catégories issues du domaine de la parenté sont pertinentes dans
l’établissement de la proximité/complicité et/ou l’éloignement/la sévérité entre femmes de la
même famille : la génération, la parenté par filiation ou alliance, la condition de cadette ou
d’aînée, etc. La prise en compte détaillée et exhaustive de toutes les inclinations possibles
d’après les expériences des meninas serait un objet de mémoire en soi, de façon qu’ici nous
garderons le terme général d’apparentées pour désigner ces femmes et relèverons celles qui
ont une position importante dans leurs discours et leur vie.
Les mères sont normalement très proches des meninas, elles sont leurs amies et
avocates à l’âge adulte (REBHUN, 1999) : plusieurs habitent chez elles et/ou leur versent une
importante aide financière continue. Parfois aussi, les enfants aîné-e-s des meninas ont été
élevé-e-s par leur grand-mère maternelle et les autres peuvent y passer des séjours plus ou
moins longs. Le modèle d’aide mutuelle entre proches concernant l’argent et la formation des
enfants n’est pas exclusif aux meninas, dans tout le Brésil ces pratiques peuvent être
observées, surtout en milieux populaires (FONSECA, 2000). La figure de la mère conserve le
statut de proximité et d’affectivité, même si les conflits ne sont pas exclus de ces relations.
57
« Despite the nearly universal veneration of mother love, or perhaps because
of it, many people I spoke with, after praising their mothers’ trustworthiness
in general, discussed their conflicts and disappointments with their own
mothers. » (REBHUN, 1999, p. 167)
Des conflits ont souvent violemment éclaté lors de la « découverte » de l’activité
professionnelle de leur fille. Il existe plusieurs manières de les régler. Je présenterai celle
d’Andrea. Elle a dû retourner dans la petite ville du littoral où habitent ses parents lorsque sa
mère l’a vue faire des programas à Fortaleza à l’âge de 17 ans. Là-bas, elle s’est mise en
couple, a eu deux enfants, s’est fiancé avec le garçon. Mais, au lieu de se marier, elle a décidé
de revenir vivre dans la capitale et travailler comme prostituée, ses enfants restant avec sa
famille à qui elle rend visite de temps en temps.
Les filles des meninas sont aussi très proches d'elles. Les âges sont très divers,
certaines sont elles-mêmes mères, d’autres adolescentes et d’autres en plus bas âge. Les
soucis que les meninas ont par rapport à leurs filles sont plutôt ordinaires : adolescentes,
qu’elles fassent attention à ne pas tomber enceintes, adultes, à ne pas se marier avec un
homme méchant. Le problème le plus grave qui s’est produit chez l'une des meninas par
rapport à sa fille a été l’overdose de crack de la fille de Marlene qui l’a amenée à l’hôpital
philanthropique voisin. Marlene était très préoccupée et nous avons cherché ensemble les
institutions publiques qui pourraient l’aider à traiter la toxicomanie de sa fille. En 2013, j’ai
appris que Marlene ne pouvait plus travailler à cause de ces problèmes : sa fille allait au
quartier du Passeio Público et « agissait comme une folle », m’ont raconté les meninas.
Le taux de mariage civil parmi les filles des meninas est très élevé, mais normalement
ils ont lieu après la cohabitation informelle. Les conseils des mères par rapport aux bons maris
et le bon âge pour avoir des enfants semblent être suivis, mais l’officialisation des relations
ouvre la question de la différenciation avec leur mère quant à la pratique de la prostitution.
En même temps, à chaque fois ce sont les meninas elles-mêmes qui m’ont raconté les
mariages de leurs filles, ce qu’elles ont fait avec grande fierté. Plusieurs meninas se disent
être des mères « pas trop libérales ».
Je ne connais aucune transmission directe de savoirs et de pratique de la prostitution
au Granada de génération en génération de meninas. La seule fois que j’ai vu une mère et sa
fille travailler ensemble, les deux femmes étaient des inconnues du bar et les meninas me les
ont indiquées, à plusieurs reprises, comme une bizarrerie proche de l’inceste : « mère et fille
baisant ensemble ! ».
La fille de Valdete travaille aussi dans la prostitution, mais dans les boîtes d’une autre
58
région de la ville et même si elles sont très proches, elles ne se sentent pas à l’aise pour parler
sexualité. Le seul cas de transmission dans l’espace du Granada, mais non de travail
ensemble, est celui d’Elida et de sa mère, qui va parfois lui rendre visite au bar et semble bien
connaître les pratiques :
Elida : - J’étais en train de boire avec maman, n’est pas, à ce moment-là [elle
confirme avec Larice] ? « [J’ai demandé au client :] Donne-moi un peu
d’argent », donc il m’a donné 10 reais [4 euros].
Larice : - Heureusement, non ?
L’ethnologue : - Et c’était la première fois que tu sortais avec lui ?
Elida : - Mais non, ça doit être la cinquième fois. Et j’allais amener maman à
l’arrêt de bus mais elle m’a dit « pas besoin. Reste avec le client qui t’a
donné 10 reais [3,70 euros] ».
Les sœurs ne sont pas très souvent objet de conversation. Pour celles que j’ai
aperçues, elles leur sont plutôt éloignées et ne parlent de celles-ci que quand elles sont
directement concernées (par exemple : comme j’allais habiter en France, Andrea m’a dit que
sa sœur habitait en Italie, mais il n’y a pas eu plus de détails). La fréquence du caractère
éloigné de ces relations indique des différenciations faites au sein de la même famille quand il
n’y a pas de distance générationnelle.
Les compagnes des meninas qui se disent lesbiennes font souvent partie des
conversations jouissant d’un statut de légitimité qui peut être affaibli par leur référence en tant
que sapatão (camionneuse) au lieu du prénom. Ceci, pourtant, est plutôt issu des divergences
individuelles et non des préjugés sur toute la catégorie « lesbienne ». C’est le cas de la
relation amoureuse entre Maria João et sa femme. Dans la citation précédente, Larice faisait
référence à la femme de Maria João dans des termes très méprisants. En fait, toutes les
meninas trouvent malsaine leur relation. La même Larice qui méprise la femme de Maria João
a dit que, encore jeune, elle aimait bien sortir avec des filles. Ceci paraît ne pas être
complétement étranger à la vie de l’ensemble des meninas, il y a très souvent des allusions au
rapport femme-femme. D’un autre côté, Stéphanie est aussi en couple avec une femme,
pourtant leur relation n’est jamais l'objet de rumeurs ni de jugements moraux.
Il faut comprendre à ce sujet que le rapport romantico-sexuel entre femmes est
accepté, cependant quand celui-ci est en échec, le poids des préjugés sur l’orientation sexuelle
s’ajoute aux reproches faits à la relation. Maria João, pourtant, dans le cas présent, reste
intouchée par les catégorisations péjoratives : quand il s’agit de parler de l’homosexualité
entre elles, la catégorie est : « meninas qui aiment les filles ».
Les belles-sœurs ne figurent pas très souvent non plus dans les conversations,
59
pourtant lors qu’elle apparaissent, la relation qu’on peut deviner entre les meninas et elles est
plutôt de proximité. Andrea, quand je lui ai demandé qui étaient ses copines en dehors du bar
m’a répondu qu’elle n’avait pas de copines, j’ai insisté, un peu étonnée, ce à quoi elle a
rectifié : « si j'en ai une, c’est ma belle-sœur, mais il faut bien voir. »
Les belles-filles, les femmes de leurs enfants, sont couramment objet de souci : il
importe qu’elle soit une bonne épouse et, si elle l’est, les meninas sont discrètes quant à leur
activité. Rafaela, que ses enfants respectent énormément, m’a dit qu'elle ne voulait pas
apparaître sur les photos en raison de sa belle-fille. Pourtant, lors de l’anniversaire de son
petit-fils, elle nous a toutes invitées, meninas et moi, ce qui indique que sa profession n’était
pas ignorée de sa belle-fille, sinon qu’elle voulait en préserver l’image.
Les belles-mères, mères de leurs compagnon-e-s, jouissent d’un statut plus distant qui
n’est pas spécifique aux meninas. Dans diverses sociétés, la belle-famille en général fait
l’objet de relations pleines de tensions et de conflits (CARSTEN, 1987), principalement dans
le rapport intergénérationnel entre femmes (MATHIEU, 1985). Le cas de Valdete en est un
exemple :
Valdete : - Ça va finir par nous séparer, car sa mère habite dans la même rue
que moi.
Ethnoglogue : - Ah bon ?
Valdete : - Oui, sa mère ne veut pas que je sois sa copine, elle n’aime pas ça.
Ethnologue : - Pourquoi ?
Valdete : - Sa mère, elle sait que moi je suis là. Elle le sait…
(…)
Ethnologue : - Et tu ne penses pas qu’elle le lui a dit ?
Valdete : - Non. Elle a dit comme ça… Elle pense qu’ici c’est un truc d’un
autre monde, tu sais ?
Ethnologue : - Ouais…
Valdete : - Mais sa mère n’est pas sérieuse. Sa mère n’est pas comme ces
gens sérieux. Tiens ! Elle ne l’a jamais été, là elle le veut. Alors, c’est ça.
Donc, elle ne veut pas que je sois avec lui à cause de ça.
Les relations très compliquées avec son compagnon étaient lues comme effet de la
désapprobation de sa belle-mère. Ce type de conflit peut avoir lieu dans des cas extrêmes,
mais normalement il y a une acceptation mutuelle avec peu de proximité – même dans le cas
où elles habitent la même rue. Gabriela s’est donnée comme exemple : « Je pense [que j’ai
une bonne relation avec ma belle-famille], tu vois ? [Mais] c’est très difficile que j’aille chez
sa mère. »
Les rapports d’identification et de différenciation se construisent selon les motifs
valables pour la parenté, en systèmes généralement complexes auxquels s’ajoute la condition
60
de prostituée dans certains cas de figure. Si l’identité est partagée en raison de la communauté
de causes qui ont produit les individus (BARRY, 2012) au sein d’une génération, comme dans
les relations entre sœurs, l’identification de l’une avec le travail du sexe a fréquemment
comme réponse la différenciation et distanciation de l’autre qui n’y adhère pas. En revanche,
si l’identité est minimale comme avec la belle-sœur, même si la génération coïncide,
l’approximation peut se traduire en amitié. Lors des relations transgénérationnelles, la
proximité ou la distance est liée à la filiation (proches) ou à l’alliance (distanciées).
Le tableau ci-dessous systématise les relations de proximité et de distance de chaque
menina selon les catégories féminines de parent à l’exception de celle de compagne
présupposée proche dans tous les cas où elle se présente.
Menina Mère Filles Sœurs Belles-
sœurs
Belles-filles Belle-mère
Gabriela Proche Proche Distanciée Distanciée Pas
d’occurrence
Distanciée
Andrea Proche Proche Distanciée Proche Distanciée Distanciée
Nálary Proche Proche Distanciée - Pas
d’occurrence
-
Cassandra Proche Proche Distanciée Distanciée Pas
d’occurrence
Distanciée
Maria João Proche Proche Distanciée - Pas
d’occurrence
-
Stéphanie Proche Proche Proche Distanciée Pas
d’occurrence
Distanciée
Valdete Distanciée Proche Distanciée Distanciée Distanciée Distanciée
Manuela Proche Proche Distanciée - Pas
d’occurrence
Distanciée
Yane Proche Proche Proche - Proche -
Dolores Proche Proche Proche - Pas
d’occurrence
-
Andressa Proche Pas
d’occurrence
Proche - Pas
d’occurrence
-
Daniela Proche Proche - - Pas
d’occurrence
Proche
Raissa - - - - Pas
d’occurrence
-
Rafaela Proche Proche Distanciée - Proche -
Lia Proche Proche - - Pas
d’occurrence
-
Marlene - Proche - - - -
Elida Proche Proche - - - -
Catarina Proche Pas
d’occurrence
- - Pas
d’occurrence
-
Tableau 5 : Type de relation par catégorie de parent du genre féminin
61
9. Les folles
Si une femme est à l’intérieur du Granada toute seule à boire de la bière sans
l’intention de faire des programas, elle est dite folle. Comme décrit auparavant, les meninas
ont des pratiques très spécifiques qui excluent : boire des bières sans être accompagnées et
payées, ainsi qu’avoir des conversations avec des hommes sans faire un programa.
C’est une catégorie appliquée à n’importe quelle femme dans l’espace de prostitution
mais sans clairement adhérer à la pratique ni s’associer aux meninas. Lorsqu’une femme
comme cela apparaît, elles ne font que commenter entre elles, nul besoin de les faire sortir :
elles le feront toute seules au bout d’un moment.
Il y a eu une époque où Lia a été considérée folle malgré son statut antérieur de
menina. Elle connaissait les pratiques de la prostitution, mais ne les exécutait pas ; à sa place
elle passait ses après-midi à manger et à boire à l'une des tables du Granada, sans faire de
programas. On l’a surnommée « Ténèbres », à cette époque-là d’après l’intitulé d’une série
télé. Aujourd’hui Lia, toujours appelée Ténèbres, tient un cabaré dans la proche banlieue de
Fortaleza auquel les meninas sont allées une fois.
Avec cette catégorie, les meninas mettent en évidence, d’un côté, la distinction entre la
profession du sexe et les fantasmes que les femmes peuvent avoir par rapport à sa pratique
(CALLIGARIS, 2006), de l'autre, un rejet impitoyable. Ce n’est pas quelque chose
d’extraordinaire, c’est un travail.
10. L’ethnologue
Cette catégorie a été construite peu à peu, au fur et à mesure qu’avançait l’enquête
ethnographique. Aujourd’hui, nous pouvons dire qu’elle existe : là-bas, je suis « Paula, celle
qui fait des recherches ». Pourtant, le chemin qui a mené à l’appropriation de mon inscription
académique par les meninas et de sa re-signification face aux clients est un moyen intéressant
pour comprendre les mécanismes d’identification et de différenciation mis en pratique dans
une relation continue.
Les premières fois que je suis allée au Passeio Público, j’ai été l’objet de curiosité et
elles me posaient beaucoup de questions, ce qui a rendu le contact initial assez facile. Les
impressions du terrain m’ont poussée à réélaborer le projet de recherche en un thème alors
complétement étranger pour moi.
62
Mes propres incertitudes sur la construction de l’objet de recherche, qui passait de la
place au bar, et mon apparence physique, leur ont fait supposer que j’étais lycéenne. J’avais
expliqué ma filiation à l’université, mais elles ne l’avaient pas retenue, ce qui est intéressant :
elles ont supposé que je mentais à propos de mon âge et de mon objectif. Pendant deux ou
trois jours, j’étais peut-être une « jeune folle ».
Avec la fréquence – environ trois fois par semaine – ceci a vite changé. Nous avons
discuté davantage sur mon projet, suite à quoi elles ont pensé que j’étais une journaliste qui
allait écrire un livre. C’était déjà mieux, car j’avais un vrai propos professionnel avec elles.
Ce statut a perduré jusqu’à août, quand j’ai amené le premier résultat de notre recherche que
j’avais présenté à la 27ª Reunião Brasileira de Antropologia (« réunion brésilienne
d’anthropologie »), montrant clairement qu'il s'agissait bien d'une recherche rattachée à
l’université.
Les clients ne figuraient pas dans les conversations autrement qu'en objet de moquerie
ou d’analyse professionnelle. Le sujet qui nous rapprochait le plus était le genre et la
sexualité : nous parlions de nos relations du présent et de nos expériences antérieures.
Nous avons discuté longuement des conditions de notre initiation sexuelle et aussi de
leur initiation à la prostitution. Nálary et Andrea ont fait un parallèle entre leur première fois
avec un client (cf. chap. 1) et mon premier jour de recherche. Dans les deux situations, nous
étions maladroites, ne sachant comment faire, mais nous avons insisté et appris.
Cette approximation d’expériences a été très importante pour nuancer la distance
sociale qui nous séparait. Des phrases comme celle de Larice à Zé Pequeno : « ne regarde pas
cette menina [moi-même] car elle est en train de faire une recherche ! » ont cédé la place à la
réponse moqueuse que Victor, le serveur du Granada, donnait aux clients qui demandaient
mon prix : « 1, 2, 3, 4, 5 mille reais ! » tarif invraisemblable même pour le marché du sexe de
luxe à Fortaleza, mais qui indiquait mon appartenance « symbolique » à l’espace de
prostitution.
À la fin de la période d’ethnographie en 2010, Rafaela m’a taquinée, demandant si
j’étais vierge quand elle connaissait bien la réponse. Andrea l’a entendue, ce à quoi elle a
répondu : « celle-ci ? Elle sait mieux que nous ! ». Le partage des savoirs, rendu possible par
de longues conversations qui comprenaient l’investissement des deux parties, a fini par
minimiser les éléments de différence : âge, classe sociale, pratique professionnelle, « race »,
etc., et permettre de construire une identification basée sur la sexualité détachée du travail.
63
Chapitre IV : Identification et différenciation à travers la catégorisation des hommes
au Granada
Les relations établies par les meninas avec les sujets du genre masculin au Granada ont
plusieurs connotations possibles et suivent un modèle déterminé par les différentes catégories
auxquelles ils sont renvoyés. Les éléments d’identification et de différenciation mis en œuvre
lors de la rencontre avec eux suivent des règles très spécifiques, construisant un ensemble de
savoirs sur le masculin précieux pour la pratique de la prostitution. La centralité des
catégories genrées dans le contexte du bar, en particulier, offre le point de départ commun, des
catégories ici en étude.
En dehors du travail du sexe, une différence dans la catégorie de base combinée avec
d’autres entraîne souvent une plus grande proximité qu’avec le genre parallèle. Dans plusieurs
espaces de prostitution, le sens de communauté entre les personnes qui le fréquentent a été
décrit ainsi :
Le facteur d’identification finit donc par réunir hommes et femmes qui
partagent certaines préférences, et celui-ci est suffisant pour que les uns et
les autres créent des situations et des codes de conduite et de protection qui
diffèrent à chaque maison [close], principalement en fonction de la politique
établie par le propriétaire. [traduction libre] (SIMÕES, 2010, p. 95)
Pourtant, la catégorie d’« homme » ou même de « client » est beaucoup trop large pour
distinguer de manière satisfaisante ceux auxquels les meninas du Granada s’identifient et les
autres, dont elles se différencient complétement. Tout autant, cette idée de communauté n’est
valable que dans des contextes très spécifiques. On le voit par exemple, lorsque les sujets qui
fréquentent le Granada sont négligés au profit d’une autre catégorie d’hommes, extérieure à la
dynamique de la prostitution.
Aussi dans ce chapitre, la présentation des catégories se fera suivant le degré supposé
de proximité géographique et sociale de ces hommes avec les meninas, ayant tous le Granada
comme point commun. Le masculin dans le bar peut se présenter sous la forme : des clients
anonymes, des clients bien soignés et parfumés ou des clients amis ; ou sous la forme des
clients du bar, des travailleurs du quartier, des hommes et leur famille et des compagnons.
Cette chaîne représente la proximité au bar et non pas la hiérarchie de classes d’hommes avec
lesquels les meninas ont les relations les plus intimes. En réalité, les compagnons, les
travailleurs du quartier ou les clients bien soignés et parfumés viennent en premier.
64
1. Les clients anonymes
Il est important d’avoir en tête toujours ici que les catégories masculines sont
attribuées par les meninas. C’est-à-dire qu’elles peuvent différer énormément de celles
utilisées par les hommes qui fréquentent le Granada pour s’auto-désigner. La classe du client
anonyme est un exemple puissant : le caractère d’anonymat est à la fois un point de départ et
d’arrivée. Les clients anonymes – la condition de tout client a priori – vont rester inconnus
des meninas à cause de la mise en œuvre du schéma du programa qui vise à empêcher le
rapprochement.
Un indicateur de ce statut des clients est l’association de leur catégorie avec celle de
cafuçu. Ceci est un argot de la région du Ceará qui indique le manque de manières chez les
individus, englobant aussi l’ignorance, la pauvreté du goût esthétique, les traits physiques
grossiers et les actions maladroites. C’est un attribut qui désigne des individus différents
même s’ils sont tous en contact avec elles : un homme cafuçu l’est par rapport aux meninas,
qui lui seraient supérieures, mais non par rapport à sa propre femme, par exemple, qui serait
cafuçu elle aussi.
La condition de cafuçu des clients est présumée, même si elle ne leur est pas réservée.
En fait, l’analyse de ce mot est très éclairante précisément de par son usage transversal : il
peut être attribué à n’importe quel individu dans n’importe quel contexte, mais tous les clients
le sont d’emblée.
Preuve à l’appui chez les meninas, au sujet de la place des caresses dans un programa.
Andrea était d'accord avec Rafaela pour dire que cela n’arrive pas normalement, qu’elles ont
les moyens de les éviter, sauf si c’est un client sympa, bien parfumé, « mais les
cafuçus jamais ! ». Les hommes anonymes qui fréquentent le Granada sont des clients et tout
ce qu’ils peuvent dire ou faire dans ce contexte sera interprété à travers cette catégorie. Il
s’agit en fait pour les meninas des techniques pour « la soumission des ‘autres’ aux identités
collectives et le déni de leur subjectivité (…) » (AGIER, 2013, p. 132).
Ainsi, la dé-subjectivation du client dans la perspective des meninas interdit aussi la
reconnaissance de leur agency. La classification d’un sujet comme client anonyme met en
œuvre des modèles relationnels stricts par lesquels sa subjectivité est niée, par lequel cet autre
masculin devient un non-homme avec lequel la rencontre prend la forme de « non-sexe ».
L’« objectification »31
– notion très utilisée pour faire référence au regard masculin porté sur
31
Cette notion très répandue parmi certaines féministes d’inspiration marxiste et matérialiste ne me paraît pas
très approprié pour comprendre les dynamiques de relations dans un espace de prostitution, étant celle de dé-
65
les travailleuses du sexe (BLANCHETTE & SILVA, 2011) – se montre aussi utile pour
comprendre la vision de ces femmes sur leurs clients. La symétrie n’est pourtant pas
manifeste car la légitimité des discours des prostituées élaborés sur le sujet est minimale face
à celle du discours étatique dominé par le masculin. Dans le couple éphémère « pute »-client
que nous observons il n'est pas question d’une « conscience dominée », ni non plus d’un
pouvoir matériel équitable (MATHIEU, 1985).
Cette élaboration sur le manque d’agency chez les clients à partir du regard des
prostituées a été proposée auparavant par José Miguel Nieto Olivar (2011), quand il a travaillé
sur la prostitution à Porto Alegre (sud du Brésil) dans les années 1980. Dans son travail,
c’était non pas le cafuçu, mais le trouxa, qui produisait les clients non-hommes de la
prostitution.
Trouxa est une espèce de non-agency, de non-homme avec lequel on a du
non-sexe, un programa, et que l’image limite est celle du client qui paye
pour « ser comido »32
(sodomisé par la prostituée). [traduction libre]
(OLIVAR, 2011, p. 97)
La subjectivité masculine étant très associée, parmi les meninas, à la virilité, ces deux
facteurs s’enchaînent dans un continuum comme celui décrit par Olivar. Il s’agit d’une lecture
des relations sociales dans laquelle chaque déviance, par rapport au modèle de masculinité
hégémonique, confirme le mépris préalable. Nálary exemplifie très bien cette démarche dans
cet extrait :
Il y a un [client] qui est sorti avec moi qui disait ici en bas [dans le bar] qu’il
était très bien, qu’il donnait sa carte bleue à sa femme pour qu’elle s’achète
des fringues chères. Donnait tout ce qu’il y a de mieux à sa femme, donc
moi, je me suis intéressée, tu vois ? Un homme comme ça, qui s’en est bien
sorti, je me suis intéressée. Quand on arrive en haut [au Motel] j’ai vu que je
m’étais trompée. Il bandait, mais quand je suis montée dessus, il a débandé.
Donc, il m’a dit d’enlever la capote [de son pénis], mettre sur mon doigt et
l’enfiler dans… dans sons anus. Là, ça lui a plu. Le même jour, il est
revenu, et on a des supports pour des hamacs dans la chambre, alors j’ai pris
le support et lui-même l’a enfilé complétement dans son trou du cul.
J’ai demandé à Nálary et à Cassandra si ceci était fréquent. La première m’a dit que
depuis qu’elle fait des programas cela ne s’est passé qu’une fois. De son côté, Cassandra m’a
dit qu’avec elle c’était très souvent, un sur vingt. En fait, le nombre d’hommes qui veulent se
subjectivisation plus proche du processus de faire un « homme » devenir un client « non-homme ». 32
Toute la construction théorique du texte d’Olivar (2011) se base sur différents niveaux de signification du mot
portugais comer qui, dans sa version plus générale, se traduit en français par « manger ».
66
faire pénétrer par les meninas importe peu : s’il y a un cas raconté, celui-ci suffit pour
confirmer qu’il ne faut pas s’intéresser aux clients.
Les clients anonymes sont ainsi uniformisés, même s’ils ne sont pas tous adeptes de la
pénétration anale passive, ils sont perçus comme dévirilisés, non-hommes ou mi-hommes par
les meninas qui contrôlent toutes les étapes de la rencontre avec eux. Dans ce contexte, elles
adhérent au modèle d’une masculinité hégémonique opérant au Brésil, fondé sur les pratiques
sexuelles qui instruit le mépris du client anonyme (PASINI, 2009). Cependant, ceci n’est pas
une relation établie sans ambiguïté, la présomption de faible virilité du client anonyme le rend
« impropre » au rapport romantico-sexuel, mais parfait pour le programa. Quand j’ai
demandé si le programa était considéré comme une trahison du compagnon, Cassandra m’a
dit : « on hait les clients ». Les meilleurs clients anonymes sont les pires amants : ceux qui
terminent vite, qui ne demandent rien, qui ne font que se masturber, etc.
Pourtant, même ces clients anonymes peuvent être décrits plus minutieusement par
rapport à leurs motivations et leur milieu social. Les meninas soulignent la diversité des
clients et des fantasmes qu’ils cherchent à réaliser avec elles. Cela indique que l’interaction
existe malgré la dé-subjectivation complète (cf. chap. 1). Mais si nous contextualisons l’usage
de ces informations dans la pratique de la prostitution, nous voyons qu’elle ne contrarie pas
forcément les mouvements de distanciation entrepris par les meninas, car « classifier les
clients c’est aussi une façon de les choisir » [traduction libre] (PASINI, 2009, p. 241). Andrea
explique :
Il y a beaucoup d’hommes mariés, [qui viennent] quand parfois leurs
femmes sont malades… Ils passent plusieurs jours sans baiser, donc ils
viennent. Il y a des hommes qui ont une épouse, une maîtresse et viennent ici
chercher encore du sexe. Il y a plusieurs types d’hommes, tu sais ? Il y a des
hommes qui sont comme des toxicos, toutes les semaines ils viennent. Un
jour ils veulent sortir avec une [menina], l’autre jour ils veulent sortir avec
une autre. Il y a des hommes qui ne sortent qu’avec une, parce que ça leur
plaît d’être avec une seule femme.
Le « type d’homme » est un savoir partagé parmi les meninas, même si c’est un client
qui aime sortir avec la même femme. Ce sont des informations utiles par rapport à l’exécution
de leur travail, mais non indispensables (PASINI, 2009; SOUSA, 1998). Dans ce sens,
Rafaela et Andrea ont continué d'exposer ainsi les caractéristiques des clients qui fréquentent
le Granada :
67
Rafaela : - Regarde, il y a toutes sortes de personnes. Il y a celui de la voiture
chic, celui qui vient à pied, l’ouvrier, le maçon. Tous les genres.
Andrea : - Oui ! Il y en a !
Rafaela : - Il y a des gens qui disent comme ça : « oh, mais les hommes font
tout ce qu’ils veulent ! » Mais non !
Andrea : - Mais pas du tout ! Il y a des hommes qui s’arrêtent là, ne font que
prendre une bière et par la suite ils nous appellent.
Rafaela : - Plusieurs voitures qui sont garées ici sont aux médecins, avocats !
Andrea : - Oui.
Rafaela : - Ce ne sont pas que des très pauvres qui viennent, non.
Ethnographe : - Mais donc ils quittent la voiture et viennent au bar ?
Andrea : - Parfois ils prennent des bières et montent aussitôt dans la
chambre, d’autres sont pressés, s’arrêtent ici et nous appellent
immédiatement.
Remarquons, par ailleurs, une deuxième perception des éléments appris lors de
l’échange verbal entre menina et client : l’affirmation de la qualité des services fournis par la
prostituée est basée sur la perception de la couche sociale à laquelle appartiennent les clients.
Les meninas prennent aussi appui sur des hiérarchies sociales valables à l’extérieur du
Granada, soulignent la diversité des hommes qui les fréquentent, mettant l’accent sur les
médecins et les avocats. Ceci leur permet de s’identifier avec ceux-ci non pas sur un plan
affectif-sentimental (comme ami ou compagnon) mais dans le domaine professionnel. Cette
pratique montre qu’il est possible d’envisager que la perspective « communautaire » de
l’espace de prostitution soit indifférente à l’identité des sujets.
Dans son travail pionnier au Brésil sur le sujet, Sousa a établi le profil socio-
économique des clients qui fréquentaient les cabarés 90 et 705, dans les années 1990 à
Fortaleza. Ceux-ci se rapprochent plus de l’ambiance de la boîte (cf. chap. 2 et 3), pourtant la
proximité géographique (localisés au centre-ville) et sociale (les deux ont comme principal
public les couches populaires) permet de supposer quelques similitudes entre les hommes
étudiés par Sousa et les clients des meninas du Granada.
En synthèse, le profil esquissé suggère que ce client qui fréquente les
maisons closes est âgé entre 25 et 35 ans, ce qui a été perçu autant en
1992/93 qu’en 1995 (46 %). À la fin de 1992 et début de 1993, cet homme
était célibataire (57 %), alors qu’en 1995 il était marié (57 %).
La scolarisation se montre variable : en 1992/93 il n’avait pas passé
le baccalauréat (36 %) ; en 1995, il ne possédait pas de diplôme (38 %).
Cependant, dans la période enquêtée cet homme est en emploi (94,95 %)
dans le secteur privé (39 %), pendant l'année 1992/93 et en 1995 (50 %),
recevait entre 1 et 3 salaires minimums pendant la période de quatre ans.
[traduction libre] (SOUSA, 1998, pp. 100-101)
Ces données montrent que les clients sont en général plus jeunes que les meninas, que
68
la condition de marié n’empêche ni les uns ni les autres de fréquenter les espaces de
prostitution, et que, en général, ils sont rémunérés et scolarisés de façon équitable par rapport
aux meninas. Quant au secteur de l’économie, elles sont travailleuses autonomes, alors qu’ils
sont employés d'entreprises privées.
Les zones de la ville habitées par les clients (SOUSA, 1998, p. 95) et meninas (LUNA
SALES, in press) sont aussi les mêmes et les deux groupes ont besoin de faire des
déplacements importants pour accéder au Granada ; dans la lecture de Sousa, les clients des
cabarés travaillent en centre-ville et fréquentent ces endroits lors de la sortie du travail, en
guise d'happy hour, d’abord, puis en soirée.
Sur ce point, il existe une nette différence avec les clients du Granada, car le bar
fonctionne durant les horaires de bureau et les hommes qui le fréquentent sont souvent au
chômage ou pratiquent des activités informelles qui leur permettent d’y aller dans la journée.
La pause-déjeuner et l’horaire juste après le travail, quand le bar est encore ouvert, sont aussi
des occasions dont ils profitent.
En conclusion, nous pouvons considérer que les études de Sousa (1998) et celles
effectuées ici présentent de grandes similitudes, même si les contacts que j’ai pu établir avec
les clients pour confirmer ou réfuter les données de Sousa ont été très ponctuels, étant donné
que les meninas évitent toute relation non rémunérée avec ceux-ci.
2. Les clients bien soignés et parfumés
Ceux-ci sont marqués par la subjectivation et donc par la suppression partielle (car ils
règleront à l'identique au final) de la forme de relation standard de rapport avec les clients et
des préjugés dé-virilisants qui les marquent. Ils peuvent aussi être catégorisés « clients
sympas » au Granada ou tout simplement « amis » dans d’autres contextes de prostitution
ethnographiquement rapprochés (PINHO, 2012). J’avoue que la différenciation avec la
catégorie de « clients amis » n’est pas très nette, pourtant, observant la continuité des discours
de certaines meninas je pense avoir repéré des distinctions qui justifient leur analyse séparée.
Les clients bien soignés et parfumés sont l’exception dont toutes les meninas parlent.
Après les descriptions qui différencient énormément les clients des hommes qu’elles
rencontrent hors du Granada, apparaît toujours la figure du client très sympa qui sent très bon
et avec lequel elles peuvent se détendre et même jouir sans inquiétude.
Par rapport à cela, Andrea m’a expliqué qu’après sa séparation, quand elle restait trois
jours sans connaître la jouissance et qu'elle rencontrait un client bien parfumé, elle se
69
détendait complètement avec lui. Mais cela n’arrive que lorsqu'elle est célibataire ou presque :
à l’époque, elle avait un copain qu’elle ne rencontrait que deux fois par mois. Elle se disait :
« il doit être très bête de penser qu’une femme va se contenter de jouir deux fois par mois ».
La différence qu’elle fait entre les possibilités de sens de la rencontre génitale est très
éclairante quant à l’exclusion de la dimension sexuelle dans le programa, du point de vue
féminin : quand il s’agit d'avoir une relation sexuelle, elle parle de « jouir », alors qu'au cours
d'un programa, le terme plus éloigné est « avoir un rapport ». Cela ne s'est pas passé qu'avec
Andrea. Elle se souvient de Nálary qui, une fois, est sortie d’un programa les jambes
tremblant de plaisir. Bien qu’elle sache que cela est vrai, cela reste exceptionnel. En parlant de
relations avec les clients, elles expliquent les techniques du programa :
Nálary : - [Je lui dis] « Mais non, menino, tu es trop lourd ! »
Cassandra : - Moi je dis déjà : « fais comme ça, c’est mieux car, ouf, je viens
de prendre mon déjeuner, je suis… » Je fais déjà… Je n’aime pas.
Andrea : - C’est ça ! Sinon… On fait ça à quatre pattes car ça va plus vite…
C’est aussi mieux quand l’homme ne sent pas bon.
Nálary : - Mais il arrive qu’on aime bien un homme du programa.
Andrea : - C’est vrai.
Cassandra : - Ah bon ?
Nálary : - Oui.
Cassandra : - Moi je n’ai jamais aimé personne d'un programa.
Andrea : - Mais oui, Fabiano.
Nálary : - Oui.
Andrea : - C’est ça, Fabiano.
Nálary : - Ça arrive toujours.
Andrea : - Ça arrive à n’importe quelle femme.
Cassandra : - Même avec mon copain actuel.
Comme dans le cas de Cassandra, la transition entre le client anonyme et le
compagnon avec lequel elle allait emménager bientôt n'est pas forcément bien distincte. Ce
sont deux catégories très éloignées, pourtant à même d'évoluer. Toutefois, certains clients bien
soignés et parfumés le demeurent, ne devenant pas des compagnons mais ne s’incluant pas
non plus dans la catégorie de client anonyme, et ce même si elles connaissent la jouissance au
quotidien avec leur compagnon ou leur compagne. Il y a envers eux du désir. Comme l'a dit
Rafaela avec joie, faisant allusion à un client : « si on prend un bébé [façon familière de parler
d’un jeune client] de temps en temps… »
3. Les clients-amis
Si j’ai choisi l’exemple de ce client de Rafaela pour finir la catégorie précédente, c'est
70
justement parce qu'il se situe dans la zone grise entre les deux catégories référées plus haut.
Pour faire la transition, il est important de remarquer cette distinction principale : avec ceux
bien soignés et parfumés, il y a du désir sexuel tandis que les amis sont objets plutôt de
respect et de considération sans forcément inclure d'attirance physique.
La relation d’amitié présuppose de la cordialité entre les parties, les clients accèdent là
aussi au statut de sujets mais ce n’est pas pour cela que les meninas trouvent du plaisir dans la
relation sexuelle. Ils sont déjà familiers avec la mise en scène du programa, donc elles
peuvent être plus souples dans les techniques sans que cela soit compris comme un
rapprochement amoureux. Ce sont des relations plus tranquilles, dans lesquelles elles sont
sûres que les choses vont bien se passer et où la répulsion n’est pas latente même s’il n’y a
pas de plaisir. C’est peut-être uniquement avec les clients amis qu’elles arrivent au stade de
« neutralité » sympathique dans la relation avec le client.
L'ethnologue: - Et alors, quand le programa est fini, comment tu fais ?
Marlene : - Je ne regarde même plus le type. Si c’est un ami on dit :
« salut », « ciao », « ça va ? », « reviens après ». Mais si c’est un étranger
c’est « au revoir ».
Les amis sont une catégorie très importante, car elle offre des points de repère parmi
les hommes qui fréquentent le bar en même temps qu’ils assurent une certaine rente. Un client
qui est l'ami d’une menina n'est censé sortir qu’avec elle. Pourtant, si elle n’est pas là, cela
arrive qu’il fasse un programa avec une autre, sans souci. Ils sont des figures très valorisées
par les meninas et chacune en a plusieurs.
La relation avec les amis, cependant, comme toute autre catégorie, est susceptible de
connaître des métamorphoses. Au début de la recherche, quelqu’un a fait référence à un
homme qui passait en l’appelant gigolo, ce à quoi Andrea a répondu : « pas un gigolo, un ami
de Cassandra. Dieu me préserve d’un diable de gigolo. »
On voulait la taquiner, car il n’y a pas de gigolo au Passeio Público et ils sont très mal
vus là-bas (voir le cas de Valdete dans ce chapitre infra). À nouveau, sur le sujet des
identifications, il est important de reconnaître dans les clients amis, des hommes « bien »
exempt des traits négatifs (la saleté, la maladie) qui caractérisent d’autres catégories. « Ceux
qui sont moches, qui ont une mauvaise odeur, qui sont maigres, séropositifs… Ils ont des
difficultés pour rencontrer une prostituée qui les accepte. » [traduction libre] (SOUSA, 1998,
pp. 85-86) Le présupposé selon lequel il existe une obligation des travailleuses du sexe à
accepter tous les clients a été réfuté à plusieurs reprises et le cas des meninas n’est en rien
71
différent. Comme l'a confirmé Rafaela :
Je choisis. Je ne sors pas avec des clients bourrés, je ne sors pas avec des
clients drogués. Mes amis sont tous bons, vraiment, ils viennent seulement
me chercher et après ils partent. Ce ne sont pas des clients qui arrivent et
boivent des bières. Ils ne font que venir ici. [Ils ne veulent] que s’amuser,
faire l’amour.
4. Les clients du bar
Ici, encore une fois, les clients de Rafaela font la transition entre les catégories,
pourtant, dans ce cas, la différence est nette : Rafaela n’est jamais, ou presque jamais, dans le
bar. Sa place est toujours auprès de Larice et son chariot et, comme elle dit, ses clients la
cherchent là-bas. Ceci est l'un des points de différence par rapport aux autres meninas qui,
avec leurs clients, fréquentent parfois le bar. Mais l’endroit le plus sûr où toutes les rencontrer
reste auprès de Larice, d’où elles observent les hommes au Granada.
Cet emplacement est très important car les clients du bar ne sont pas toujours leurs
clients à elles. Il est très commun que les hommes aillent en groupe aux zones de prostitution
pour regarder les femmes sans effectivement faire un programa. À la Vila Mimosa, « il n’est
pas nécessaire d’avoir un rapport physique-sexuel avec elles [les prostituées], il suffit de les
regarder ou, si on va plus loin, de les caresser ». [traduction libre] (PASINI, 2009, p. 247)
Les intentions des clients du bar ne sont pas tout à fait satisfaites au Granada. Se
laisser toucher sans faire un programa est hors de question pour les meninas et même le
regard énerve : travailler sans être payé pour cela, c’est être « bête ». Il arrive très souvent
que, derrière les voitures garées de l’autre côté de la rue, les meninas regardent, sans être
vues, les hommes qui rentrent dans le bar, reconnaissant ou non leurs clients.
Lorsqu’il s’agit d’un client bien soigné et parfumé ou un client ami elles n’hésitent pas
à traverser la rue et à parler avec eux. Andrea m’a « enseigné », ainsi qu’à une nouvelle
femme qui voulait travailler au bar, que s’il y a plus de deux hommes à une table, nul ne sert
d'aller les voir, car ce ne sont que des clients du bar.
Les meninas restent peu de temps au bar en raison de la chaleur et du bruit.
Lorsqu’elles y sont, Cassandra explique comment la rencontre se passe :
Cassandra : - Ici en bas [au bar], ici en bas, selon l’homme, parfois il passe
dehors et fait un signe pour qu’on monte [au motel]. Quand on est en haut [il
demande] : « c’est combien le programa ? », alors on dit : « c’est ça ». Donc,
s’il est d’accord il monte, si non…
72
L'ethnologue : - Quel est le prix déjà ?
Cassandra : - C’est 30 reais [11 euros]. Si non, il demande : « est-ce que tu
peux le faire à 20 reais [7,5 euros] ? » « Allons. » [Elle répond] Laisse-moi
seulement prendre ces deux bières-là et on monte. » [Le client lui demande.]
Il faut qu’il y ait des « hommes à programa » dans le bar pour qu’elles se montrent. Il
arrive parfois, en milieu de journée, qu'il n'y ait personne, alors elles mettent en œuvre des
techniques pour appâter les clients. À ces fins, j'ai une fois vu Nálary aller à la cuisine avec
Victor pour prendre un peu d’eau parfumée et la vaporiser dans le salon du bar, mouillant
aussi un peu les filles dans une espèce de jeu. Elles se douchent aussi souvent afin d'être elles-
mêmes bien soignées et parfumées afin d'inviter les clients par l’odeur. Quand rien n'opère,
elles blâment un « cocu infecté » qui serait rentré dans le bar et l’aurait vidé.
5. Les travailleurs du quartier
Les hommes qui travaillent dans le quartier et fréquentent le chariot de Larice, ainsi
que le bar quotidiennement sont les plus opposés aux clients. Ils sont généralement très
proches des meninas : ce sont des amis, ils les courtisent et ont même des histoires avec elles.
Ils ne sont pas du tout encadrés dans la catégorie de clients : s’ils réussissent à se rapprocher
des meninas en tant que groupe discret, cela leur permet de jouir de modèles de relation plus
symétriques, dans lesquels ils sont considérés comme de « vrais hommes », où l’identification
se fait au niveau affectif et personnel.
Ainsi, un « vrai homme » pour les meninas n’est pas une catégorie figée, elle se
construit : il est un homme qui sait courtiser une femme en faisant usage d’argent mais qui ne
la paie pas directement. Surtout il ne la fait pas baisser son prix. Nálary en donne un exemple
quand elle taquine Zé Pequeno en présence de plusieurs personnes autour de la buvette
ambulante de Larice :
Moi, je veux voir si tu es un homme ! Montre-moi que tu es un homme !
Invite la fille à déjeuner avec toi. Ça n’aboutit à rien, j’allais mourir de faim.
Le modèle masculin envisagé est sans doute beaucoup lié à l’argent, mais les formes
de transaction sont autres que celles du Granada. En fait, la relation romantico-sexuelle
qu’elles désirent se rapproche souvent des formes d’ajuda décrites par Piscitelli dans le cas
des couples transnationaux composés de femmes du nord-est du Brésil et d'hommes
européens :
73
L’ajuda permet une sorte d'avenir. Ce mot ne renvoie pas nécessairement à
l’épargne ou au planning, mais revêt le sens d’une vie financière plus
confortable à long terme. (…) Les modalités d’échange sexuelles et
économiques encadrées dans cette catégorie ne sont pas aussi stigmatisées
que la prostitution. [traduction libre] (PISCITELLI, 2011, p. 554)
Pourtant il existe une différence primordiale : tandis que les rapports d’ajuda se basent
sur le respect et la considération (comme celui des clients amis), le désir sexuel mutuel est
caractéristique des « vraies » relations des meninas, surtout les plus jeunes et constitue un
élément indispensable à la relation du couple. « We can see that while sexual relations are
discussed in the idiom of the gloss amor, they take place under intense economic pressure. »
(REBHUN, 1999, p. 215)
Alors, si avec ces hommes le flirt est permis et répandu, leur continuité est très faible
et ils prennent la place plutôt d’amis que de compagnons. Ce qui n’empêche pas, et à mon
avis renforce même, l’identification entre ces deux groupes. Ce sont des hommes qui sont
toujours avec elles au bar et même ailleurs. Victor, le serveur, sortait très souvent avec
Andrea, Nálary et Cassandra. João Marcelo, le moto-taxi les a accompagnées aux fêtes. Nilo
Gato, qui gardait les voitures, avait un flirt avec Valdete et, finalement, Zé Pequeno a eu une
brève histoire avec Nálary (cf. chap. 2).
6. Les hommes et leur famille
Les parents masculins des meninas, ainsi que les parentes féminins (cf. chap. 3) ne
sont pas d’ordinaire présents au bar. L’inclusion de cette catégorie dans cette étude s’explique
par le temps et l’énergie qu’elles dépensent à parler d’eux, en particulier à travers la figure du
compagnon.
Dans cette sous-partie, des catégories symétriques aux catégories féminines seront
analysées. La proximité et la distance, de la même façon, seront envisagées par rapport aux
critères de génération et de lien de parenté (filiation ou alliance), en vue d’apprendre les
déterminants de l’identification ou de la différenciation malgré la parenté.
Les pères, de façon un peu étonnante, ne préoccupent que peu les meninas. À la
« découverte » de leur activité professionnelle, ce sont généralement les mères qui ont la
charge de gérer la situation, s'il y a lieu de la gérer, les pères préférant rester dans l’ombre.
L’étonnement vient de la relation couramment établie entre père et fille dans le nord-est
brésilien :
74
Fathers also may fell a quasi-romantic, fiercely possessive love toward
daughters. (…) A father’s protective jealousy of daughters often prevents
them from having any open courtships. (…) Some men are afraid to have
daughters for fear dishonor. (REBHUN, 1999, p. 169)
Malgré leur distance relative due à l’activité professionnelle de leur fille, les pères des
meninas ne sont pas pour autant complétement absents de la vie de celles-ci, s’ils sont encore
en couple avec leur mère. Dans ce cas, la relation semble être médiatisée par la figure
féminine (la mère ou la marâtre) et si le couple ascendant se décompose, les relations seront
difficilement maintenues avec le père. « For some men, loving a child is an outgrowth of
loving the child’s mother, and when the relationship with the woman ends, so does the
relationship with the child. » (REBHUN, 1999, p. 171)
Les fils des meninas, de leur côté, demeurent toujours très proches de leur mère, qui
malgré la profession, constituent l’image idéale – à certains aspects – de la femme. « For
many men, their mothers were the standard by which they judged all other relationships, both
with woman and men. » (REBHUN, 1999, p. 167) Ils habitent souvent chez leur mère jusqu’à
l’âge adulte et nourrissent pour elles un profond respect, même une fois quitté le nid.
L’exemple d’Elida est très parlant : elle me racontait qu’elle avait dû quitter la maison
de sa mère (qu’elle avait achetée), où elle habitait avec son fils, car il était persécuté par des
dealers du quartier. La confrontation avec ces hommes montre clairement le rôle actif des
mères dans la protection de leur(s) fils, même à l’âge adulte :
Elida : - (…) Alors, un dimanche j’étais chez moi et il [le dealer] est venu
avec un autre type. Chez moi, les murs sont en béton. Donc il a escaladé le
mur et est entré chez moi. Ma mère était en train de faire la vaisselle, tiens,
ma mère faisait la vaisselle ! Quand les deux bêtes ont bondi à l'intérieur.
Chacun tenait un revolver énorme. Dieu merci, mon fils n’était pas là. « Où
est ton fils ? » [a-t-il demandé], comme ça ! Moi, j’ai dit : « écoute, tu sors
immédiatement d’ici ! » Ma mère a détalé quand elle l'a vu et moi, j’ai eu
pitié d’elle. Ma mère s'est enfuie de la pièce en courant ! Moi je n’ai pas
couru, non ! « Hé, mec, sors d’ici. Va-t’en, dégage, dégage ! » (…) « Sors
d’ici ! Hé gamin, va-t'en ! Mon fils ne te doit rien ! Va-t'en marginal
trafiquant salaud ! Sors de ma maison tout de suite ! » Alors il m’a dit
comme ça : « tu es brave, c’est ça ? Alors comme ça tu es brave ? » J’ai
répondu : « c’est toi qui est bien brave d’envahir ma maison comme ça ! Si
tu ne sors pas maintenant, j’appelle les flics pour venir te chercher. J’appelle
la police ! » Alors, il est sorti doucement et a fait le mur dans l'autre sens.
Ces relations impliquent des sacrifices mutuels, même face à la menace de mort. Elida
aimait bien sa maison, mais elle a déménagé avec son fils pour le protéger des trafiquants.
75
Toutefois, les sacrifices ne sont pas toujours du côté des meninas. Comme mentionné au
chapitre 3, la solution est parfois de confier les enfants aux grands-parents, souvent
temporairement et, même si la mesure devient pérenne, la mise à distance n’advient pas.
Les enfants de Nálary sont allés habiter chez sa mère en 2010, mais ils dormaient chez
elle deux fois par mois et elle leur rendait souvent visite à cette époque-là. Après que Nálary a
déménagé à la campagne, les visites et les versements d’argent sont devenus rares, même si
elle revenait régulièrement à Fortaleza. Alors, face à cette situation, en mai 2013 sa mère est
apparue dans le bar et l’a confrontée publiquement. Ceci a donné des résultats : toutes les
meninas ont reproché l’attitude de Nálary, suite à quoi elle est allée passer une saison chez sa
mère.
Andrea, dont les deux enfants aînés habitent chez sa mère, avait déjà adopté l'attitude
de Nálary, ceci pouvant se faire sans que le rapport de parenté ni la proximité de ce lien ne
soient perdus. Pourtant, quand la mère de Nálary est apparue au bar pour lui demander des
comptes, c'est bel et bien Andrea qui lui a dit où se cachait sa fille afin que cette dernière
subisses les reproches maternels.
Les frères sont généralement craints par les meninas. Leur rapport est distant et elles
essayent de les laisser en dehors de leur vie professionnelle même s’ils la connaissent. S’il y
en a qui fréquente les cabarés, ils ne se rendent jamais au Granada. Le sujet de la sexualité
entre frères et sœurs est fortement évité. Cassandra dit que ses frères cadets connaissent sa
profession et que « ça va », alors que son frère aîné se méfie, « s’il m’attrape à faire des
programas… ». Discutant des personnes avec lesquelles il était utile de parler sexualité,
Valdete m’a expliqué : « je ne raconte pas ma vie à mes frères, non. Ni à mes sœurs. Ni à ma
mère, rien. » À l’exception de la mère, normalement proche, l’attitude de Valdete à l'égard de
ses frères et sœurs est assez répandue au Granada.
Les compagnons seront étudiés sous une rubrique séparée. Ils seront abordés avec une
profondeur plus importante que celle dédiée aux compagnes face à l’asymétrie des données de
terrain sur le sujet.
Les beaux-frères ne sont pas très présents. La seule occasion qui s’est présentée
pendant la période ethnographiée a été quand le frère du compagnon de Manuela a été vu à
l’arrêt de bus en face du Granada. Elle était très préoccupée car sa famille ne savait pas
qu’elle continuait à travailler là-bas et elle avait très peur des conséquences que cela risquait
d'engendrer. Quelques secondes après, elle a décidé de sortir du bar rapidement, en ma
compagnie, car je n’avais pas « la gueule de celles qui y travaillent ». Ainsi, nous lui dirions
que nous y étions entrées pour acheter de l’eau, si jamais il nous y avait vues et nous
76
demandait quelque chose. La confrontation ne s’est pas produite et, alors que déjà en France,
j’ai appris que Manuela était enceinte de son compagnon, ce qui indique que cette histoire
s’est bien terminée.
Les gendres, les compagnons de leurs filles, sont couramment source de craintes chez
les meninas. Ceci ne leur est pas particulier : la figure de la mère de la compagne est
populairement perçue comme très conflictuelle à cause du statut d’avocate inconditionnelle
attribué au rapport mère-fille (cf. chap. 3).
Mais le plus important parmi les meninas est la question de l’indépendance financière,
très valorisée au Granada comme dans leur milieu familial. Cela produit une perception plus
exigeante des compagnons choisis par leurs filles. L’incitation à retarder l’époque du mariage
et à bien choisir l’époux est forte : au lieu d’un discours traditionnel où il faut se marier de
toute façon pour avoir une rente (REBHUN, 1999), le discours des meninas voit la catégorie
de compagnon comme dispensable quant à l’argent. Il doit amener quelque chose de plus à
leur vie, le luxe.
Les beaux-pères représentent fréquemment la figure la plus éloignée de toutes celles
qui ont été décrites jusqu’à présent, masculines comme féminines. Cela est compréhensible
compte tenu de la juxtaposition des catégories de belle-mère et de beau-père. Ils ne sont pas
tout à fait responsables de la gestion des réseaux familiaux. Les belles-mères qui le font, le
font de manière distanciée, et le beau-père plus encore.
Menina Pères Fils Frères Beaux-
frères
Gendres Beaux-
pères
Gabriela Proche Proche Distanciée Distanciée Pas
d’occurrence
Distanciée
Andrea Proche Proche Distanciée Proche Distanciée Distanciée
Nálary Proche Proche Distanciée - Pas
d’occurrence
-
Cassandra Proche Proche Distanciée Distanciée Distanciée Proche
Maria João Proche Proche - - Pas
d’occurrence
-
Stéphanie Proche Proche Proche Distanciée Pas
d’occurrence
Distanciée
Valdete - Proche Distanciée Distanciée - -
Manuela - Proche Distanciée Distanciée Pas
d’occurrence
-
Yane Proche Proche Proche Proche Proche -
Dolores Proche Proche - - Pas
d’occurrence
-
Andressa Proche Pas
d’occurrence
- - - -
77
Daniela Proche Proche - - - -
Raissa - - - - - -
Rafaela Proche Proche Proche - Proche -
Lia - Proche Proche - - -
Marlene - Proche - - - -
Elida Distanciée Proche - - - -
Catarina - - - - - -
Tableau 6 : Type de relation par catégorie de parent du genre masculin
7. Les compagnons
Cette catégorie encadre plusieurs formes de rapports romantico-sexuels qui ont pour
caractéristiques communes la durée et la stabilité. Les divers modèles de couple répandus au
nord-est du Brésil (cf. chap. 3) laissent entrevoir cette diversité, pourtant, cela n’est pas tout.
En fait, les compagnons sont classifiés ici par rapport à l’espace qu’ils occupaient dans
le quotidien des meninas pendant la période enquêtée. La classification est faite en fonction
de l’investissement émotionnel féminin dans ces relations, mais quelques-unes des
configurations qui seront présentées ici laissent entrevoir que les dispositions et les modèles
relationnels que les meninas mettent en œuvre dans ce domaine sont parfois beaucoup moins
efficaces. Ce sujet est souvent le plus intime qu’elles aient abordé, baissant la voix et faisant
une confidence malgré la présence du dictaphone ; d’autres fois, peu importe qui écoute, il est
mieux que tout le monde entende. Quoi qu'il en soit, l’investissement dans un rapport
émotionnel semble en révéler beaucoup sur elles-mêmes et elles se soucient de cette image. Je
voudrais donc présenter les cas de deux meninas, repérant les éléments liés au travail du sexe
qui peuvent influer sur chacun.
Valdete : - Alors… Celui-ci, avec qui j’étais là.
L'ethnologue : - Oui.
Valdete : - Alors, il m’a dit que si… si je baisais avec lui de la façon qu’il
voulait, il allait se mettre en couple avec moi. Alors j’ai dit : « non, car
moi… Je baise. J’aime bien une baise normale. » Et lui : « moi, j’aime
mieux le trou du cul. »
l'ethnologue : - Quoi ?
Valdete : - « J’aime mieux le trou du cul. » Alors il y a trois jours… Il était
en couple avec moi, mari et épouse, tu sais ? Et, cette femme est apparue
dans sa vie et ils se sont mis ensemble à la campagne.
l'ethnologue : - Je vois…
Valdete : - Là, il m’a écartée [de sa vie]. Après nous sommes sortis. Nous
sommes sortis et sortis… Alors, il s’est calmé, mais elle est revenue encore
une fois séparer notre vie. Alors c’est fait… Il dit qu’il m’aime, tu vois ?
78
À cette époque-là, Valdete était très malheureuse de l’instabilité de sa relation qui,
depuis peu, constituait un couple sérieux, mari et épouse. La visite de son compagnon à son
travail, la demande qu’il lui a faite et l’échange objectif qu’il prétendait établir indique qu’il
agissait d’une forme proche de la figure du client, pourtant il existe un grand décalage. Un
client normal serait difficilement aussi impertinent que ne l'a été le compagnon de Valdete et,
sans l’investissement affectif de la femme, cela ne serait même pas imaginable.
Le compagnon de Valdete se rapproche beaucoup de la figure du gigolo, en fait, et
c’est peut-être pour cela qu'elle ne parlait de lui à personne, si ce n'est à moi. Elle aimait lui
offrir des cadeaux chers : une moto 500 cc juste avant leur séparation et à Noël, quand ils
s’étaient à nouveau remis ensemble, elle lui a acheté beaucoup de vêtements de marque ainsi
qu’à ses enfants. Elle a, dans le couple, la fonction de payer pour tous les luxes, que les
meninas attribuent normalement aux hommes. Reprenant le modèle valorisé entre elles de
l’ajuda masculine mentionnée plus haut, laquelle doit payer les luxes éventuels sans être un
soutien intégral, nous constatons que Valdete a inversé les rôles des genres dans sa relation.
C’est justement cela, entretenir un homme, que la plupart des meninas considèrent
indigne ; cet homme est alors traité de gigolo. C’est une figure en extinction dans la
prostitution contemporaine au Brésil (BLANCHETTE & SILVA, 2011; LEITE, 2009;
OLIVAR, in press), mais qui, dans un passé récent, se confondait avec la figure du
compagnon (OLIVAR, 2011; TEDESCO, 2008) et était une présence constante dans les
espaces de prostitution.
Or ce jour-là, le compagnon de Valdete y est allé en tant que client – à la rigueur
seulement Valdete et moi savions qu’il avait essayé de se comporter comme un gigolo –
depuis ce jour-là où le compagnon y est allé en tant que client je n’ai plus jamais entendu
parler de sa présence là-bas. Elle me disait qu’ils ne parlaient pas de sa profession
ouvertement, car officiellement il ne la connaissait pas. Le mécontentement de Valdete était le
résultat d’un quiproquo entre les formes relationnelles, probablement voulu par son
compagnon. Ceci laisse voir que si ces catégories existent et engendrent une série de
dispositions et d’actions, le point de vue des meninas ne parvient pas toujours à s’imposer,
surtout hors de l’espace de prostitution.
Cette situation n’est toutefois pas majoritaire dans les relations des meninas avec leur
compagnon. Dans plusieurs cas, le couple s'accorde sur une forme stable et le travail du sexe
est compris selon la vision des meninas :
79
Marlene : - On vit bien. C’est parce qu’il était un programa à moi, donc il ne
dit rien.
L'ethnologue : - Ah bon…
Marlene : - Je lui explique toujours, le soir, à l’heure du journal [télévisé],
qu’on fait une vie comme celle-ci par professionnalisme. Donc c’est pour ça
qu’il ne dit rien. Et puis moi j’utilise la capote, il me fait confiance en… ce
que je lui dis, il le croit.
L'ethnologue : - Et comment ça se passe avec vous ?
Marlene : Au programa ou dans le [sexe avec du] désir ?
L'ethnologue : - Quand tu es avec lui, ce que tu fais… Qu’est-ce qui
change ? Ce qui est différent ?
Marlene : - Ça change que je suis si fatiguée lorsque je rentre que je n’ai plus
la force [de baiser]. C’est plutôt pour la convivialité [qu’on est ensemble].
Le cas de Marlene est un exemple de l’efficacité des savoirs et techniques des meninas
sur la sexualité dans le domaine du couple. La transition entre les catégories de client à mari
se fait de façon très claire pour les deux partenaires et c’est la perspective de la
prostituée/épouse qui prévaut dans les deux contextes. Nul doute sur le statut d’époux : la
diminution de l’activité sexuelle, commun parmi les couples mûrs (BOZON, 2001), en est la
preuve.
La logique en œuvre dans les paroles de Marlene, très habituelle dans celle des autres
meninas aussi, souligne l’importance, pour le bon déroulement de la relation de couple, du
statut précédent de client. Cela implique que tous les éléments du rapport sont connus et que
la poursuite de la pratique professionnelle ne constitue pas une trahison (cf. l’exemple de
Cassandra dans le chap. 1). Nálary explique la seule forme de trahison possible dans le cadre
du programa :
Quand nous nous sommes connus ici, pour moi, il n’y a pas eu de secret, car
il m’a connue faisant des programas. Mais si moi, si je me trouve un petit
ami, ou si non, c’est ça : moi, je pense que j’ai trahi le père de mes enfants,
car moi j’étais avec lui, je ne faisais pas de programas et alors je suis venue.
Pour ça c’est une trahison ! (…) Mais [si je] faisais déjà des programas, je
connais un type, même s’il ne sait pas que je fais des programas, pour moi
ce n’est pas de la trahison. Car je fais déjà des programas. Il ne le sait pas,
mais je les fais.
Ainsi, dans plusieurs situations, cette activité professionnelle peut être cachée. Parfois
au profit des meninas, pour ne pas avoir à s’expliquer tout le temps ou à le faire en raison de
la jalousie de l’autre. Ou alors, à celui des compagnons, qui se permettent d’agir comme celui
de Valdete. Pourtant, la plupart du temps, la reconnaissance est progressive, négociée pas
après pas par les deux composants du couple qui peuvent finalement décider de ne jamais
l’aborder directement.
80
Les meninas n’éprouvent pas le besoin d’aveux. Elles sont fières de leur profession et
de leur indépendance financière et si cela est accepté sans questions par leur compagnon, tant
mieux. Elles considèrent que les compagnons sont les privilégiés, ceux avec lesquels la
sexualité est présente d’emblée et les seuls avec lesquels le temps coule librement. Avec les
compagnons, tout leur savoir sur ce qu’est le « vrai sexe » est présent.
Les meninas ont relaté les différences entre la rencontre qui se produit avec un client et
celle avec un compagnon :
Cassandra : - Oh, c’est très différent ! Avec le petit ami je pratique vraiment
le sexe, je fais l’amour, je prends mon temps.
Andrea : - Avec un petit ami on baise…
Nálary : - Avec tendresse.
Cassandra : - Il y a des câlins, on l’embrasse sur la bouche… On prend le
temps.
81
Conclusions
C’est de la rencontre ethnographique qu’est né le sujet structurant cette recherche. En
effet, le désaccord terminologique et le mécontentement manifeste des meninas du
Restaurante Granada, lors de ma présentation des résultats de la première étude les
concernant, en 2010, m’ont amenée à devoir m’interroger sur la question des catégories.
La façon de désigner un groupe peut toujours être source de contestations, et ce
d'autant plus quand c’est depuis l’extérieur que nous le faisons. L’« erreur » que j’ai commise,
en rapportant les divers niveaux d’identification des meninas aux termes de « prostituées » et
de « travailleuses du sexe », n’est toutefois pas comparable à celle des colonisateurs et
explorateurs à qui il est arrivé de nommer un groupe social au moyen de la catégorie
péjorative que lui donnaient ses ennemis.
Chez les meninas, aucune catégorie utilisée dans les textes de 2010 à 2013 n’est fausse
ni péjorative. Cependant, aucune n’est adéquate si le contexte dans lequel elle prend place
n’est pas connu. Selon, elles se disent meninas, prostituées, putes, garotas de programa,
travailleuses du sexe ou professionnelles du sexe. Et, à l’instar des catégories, plusieurs
caractéristiques associées suivent cette même logique.
J’ai d’abord compris qu’elles ne sont a priori valables que dans leur espace de travail,
l’existence même de ce groupe n'ayant d’effet concret qu’à l’intérieur et aux alentours du
Restaurante Granada. La délinéation de cette collectivité et la participation de la menina,
quand amenée à travailler de son propre chef à l’extérieur du Granada, se négocient
intensément au regard de la vie personnelle, en termes d’avantages et de désavantages
apportés à celle-ci.
Tout au long de ce travail, nous avons remarqué que les manières de marquer ou de
dissimuler leur appartenance au groupe des meninas sont multiples. La posture de Valdete, par
exemple, est de la nier au maximum. Cela joue sur sa capacité d’agency dans l’espace de
prostitution et ailleurs. Elle vit majoritairement son travail comme un fardeau et s'applique à
rester à l'écart des autres, ce qui la rend très vulnérable au poids du stigmate et au harcèlement
moral.
Ses souffrances contrastent radicalement avec le ressenti des autres meninas. Andrea,
Stéphanie, Cassandra et Marlène, se sentent à l’aise au bar et profitent de la constitution du
groupe pour garantir la prévalence de leurs visées non seulement concernant les clients, mais
aussi dans d’autres domaines de leur vie.
L’agency forme leur conduite établie au bar et leur expérience positive dans cet espace
82
les pousse à l’étendre au domaine familial. L’indépendance financière acquise dans le travail
du sexe n’est pas moins appréciée sous prétexte qu’il y aurait stigmatisation de celui-ci. Au
contraire, en différenciant les programas de la sexualité, elles re-signifient leur pratique et lui
donnent la connotation de technique et de métier.
L’expérience de la prostitution peut être très chargée de préjugés menant à l’exclusion
sociale voire à la destitution du statut de personne. Cependant, ceci n’est pas le seul horizon
offert à la profession. L’identification de la source des préjugés qui l’entourent et la création
d’une nouvelle perception sur l'activité en tant que métier permettent de conférer à cette
dernière une teinte positive, même si celle-ci se limite à la communauté. Il en est ainsi pour
la majeure partie des meninas étudiées ici.
Pourtant, ces nouvelles significations ne sont pas assumées de façon homogène. Le
groupe se construit selon des contraintes internes et externes : il y a des disputes autour des
sens et des pratiques, acceptées ou refusées dans l’espace de travail, qui se relient aux
discours d’institutions extérieures à la prostitution. Les inégalités existent au sein de la
collectivité, mais l’établissement et le partage des savoirs et des qualificatifs tolérés amènent
ces femmes à comprendre que le Granada est leur siège. Comprendre les règles de
l’appartenance à la catégorie nominale de meninas, telle a été la première étape.
J’ai ensuite remarqué dans leur savoir collectif des élaborations sur le genre, la
sexualité et la prostitution. La contextualisation de ces concepts a ainsi été comprise au regard
de maints autres lieux de production de savoir qui peuvent s’imposer ou dialoguer avec celui
des meninas.
Ainsi, quand elles créent et organisent leurs propres savoirs, elles le font par
identification ou différenciation (d’)avec ceux des autres groupes rencontrés ou contrés au
quotidien. Les remarques sur les éléments qui caractérisent les autres leur ont servi pour
organiser l’espace de travail et formater les formes d’interaction.
De même qu’elles se reconnaissent dans certaines catégories, elles classent également
les autres sujets rencontrés au Restaurante Granada. Le pouvoir de les nommer est
minutieusement exercé par ces femmes. Très peu de figures échappent à leur regard
classificateur.
Les classifications des meninas sur le marché du sexe hétérosexuel au Granada sont
fortement marquées par le genre. Il en est le biais majeur. Plusieurs facteurs justifient cette
forme d’organisation. Il est important de remarquer que le ressenti des préjugés à l’encontre
de leur pratique professionnelle a lieu dans les relations de même genre. L’idée de
compétition entre professionnelles d’autres groupes existe aussi, mais de façon mineure.
83
Le masculin, de son côté, est mobilisé autour de la catégorie du client, dont les
déclinaisons varient, bien que souvent centrées sur le mépris ou l’indifférence systématique.
Ceci s’explique par la distance maintenue entre menina et client durant tout le programa. Si
les clients peuvent constituer des alliés des travailleuses du sexe dans les espaces de
prostitution, ce type de relation ne se poursuit que rarement à l’extérieur du contexte
professionnel. Quand les hommes ne sont pas clients, ce sont d’autres formes relationnelles
qui se tissent, reposant sur la recherche de caractéristiques comme le soin du corps, la virilité,
la sophistication, la richesse et la beauté, rendant les rapports parfois agonistiques, mais
toujours plus intenses.
L’aspect collectif de la classification est ce qui permet ici son encadrement. En rendant
compréhensibles des propos comme « le programa n’est pas du sexe » via les catégories de
client anonyme et client compagnon, nous montrons que cette activité donne lieu à plusieurs
exemples de conceptualisation pratique du genre et de la sexualité par les meninas.
Tout ce travail a été centré sur les processus de création d’une collectivité à partir des
catégorisations dont elle s’imprègne afin de générer l’identification interne de ses membres et
sa différenciation d’avec autrui. La valeur positive de leur production professionnelle et
l’écho que l’appartenance à ce groupe a sur les vies individuelles des meninas ont été choisis
pour démontrer l’aspect contestateur de ce groupe féminin.
Adopter la perspective des meninas, c’est reconnaître leur voix et leur agency. Leur
subjectivité ne leur a pas été enlevée par le travail du sexe. Bien au contraire, c’est grâce à lui
qu’elle est maximisée et organisée. Le travail du sexe revêt chez les meninas un double sens
car leur participation au marché du sexe leur offre un environnement suscitant chez elles des
questionnements et des ré-élaborations quant aux normes qui les contraignent le plus, à savoir
celles du genre et de la sexualité. Le travail du sexe réalisé par les meninas au Restaurante
Granada est « bon à penser ».
Il a été avancé à plusieurs reprises que, malgré la réalité de stigmates et de préjugés
endurés par ces femmes, il existe dans la pratique de la prostitution certains avantages. Les
points positifs revendiqués par ces femmes au quotidien ont ici été privilégiés. Il s'agit
de l’expertise sexuelle et de l’indépendance financière.
Au-delà de ces éléments, j’abonde dans le sens de Marilyn Strathern (1988) lorsqu’elle
défend que les rapports de domination et de violence genrés, potentiellement subis par les
femmes, sont issus des différentes formes de socialité liées aux genres féminin et masculin.
Le masculin et le féminin ne sont pas deux catégories opposées en essence, leur point de
différenciation se trouve dans le rassemblement collectif et public du premier face à
84
l’isolement privé du second. Ces formes de socialité sont sujettes à changement via
l’occurrence de nouvelles formes de structuration sociale.
Or, chez les meninas c’est précisément le caractère collectif de leur conformation et
public de leur profession qui les constituent en catégorie. Associés à la sexualité, ces éléments
sont peut-être aussi la source des préjugés. Les meninas ont toujours été présentées ici comme
au centre de production et de contrôle du Granada. Ceci est le cas la majeure partie du temps.
Elles détiennent le pouvoir au sein de ce bar et le savent ; les clients et les fonctionnaires ne
sont que des figures secondaires ici. En ce contexte, ce sont eux les isolés, séparés de leurs
pairs du genre masculin pour l’efficacité du programa et l'adoption de la perspective
féminine.
Pour conclure cette étude, j’avance que la capacité de production et de mise en œuvre
des savoirs et des pratiques des meninas dans l’espace de prostitution est en rapport direct
avec leur forme de socialité. Associées dans le domaine public, les meninas deviennent « plus
grandes », plus puissantes qu’elles n’auraient été dans un contexte privé et isolé comme celui
de leurs activités antérieures ou extérieures à la prostitution (employées de maison, femmes
au foyer, etc.).
Au Restaurante Granada, les meninas mènent collectivement le travail du sexe tout en
travaillant ensemble sur le sens du sexe. Leurs idées se construisent de manière « bricolée »,
populaire, empiriste et communautaire. C’est grâce à la théorie de la pratique que l’approche
anthropologique de la prostitution a pu évoluer et, nous l’espérons, fera bouger,
considérablement encore, les savoirs produits sur la sexualité.
L’espace de prostitution s’inscrit dans la vie des meninas comme un lieu d’exercice de
leur subjectivité, mise en évidence dans cette étude par leur construction collective du
programa. Il est réalisé sur la base de l’idée de subjectivation du client et de l’imposition du
point de vue de la menina sur la relation. Sa caractéristique majeure est d’être du non-sexe,
soit l’opposé de ce que cherche le client.
Cette confrontation entre la perspective féminine et la perspective masculine, lorsque
l’une et l’autre sont engagées dans un programa, éclaire grandement la question de l’existence
en tant que sujet malgré l’imposition d’une catégorie à partir de l’extérieur. Ni clients ni
meninas ne sont destitués de subjectivité, mais ils savent alors en apparence l’accorder. « One
might put it that people do not exist in a permanent state of either subjectivity or objectivity.
The agent is a conduit. » (STRATHERN, 1988, p. 331)
L’attitude des meninas au Granada s’exprime au moyen de l’agency. Elle est
potentialisée chez ces femmes à travers leur association mutuelle, entre elles, ainsi que par
85
leur alliance avec d’autres groupes sociaux, dont les clients.
Après trois années de recherche sur ce terrain et pensant avoir repéré ses éléments
déterminants, j’ai tenu à démontrer ici, à partir d’une méthodologie empiriste, les possibilités
qu’ont les femmes de vivre leur subjectivité dans un espace de prostitution féminine et
hétérosexuelle, ainsi que les bénéfices qu’elles peuvent tirer de leur constitution collective
dans ce domaine, et ailleurs. J’espère que mon propos d’anthropologue et de féministe aura
été atteint.
86
Bibliographie
AGIER, M. (2013). La condition cosmopolite. L'anthropologie à l'épreuve du piège
identitaire. Paris: La découverte.
BACHOFEN, J.-J. (1903). Le droit de la mère dans l'antiquité. Paris: Groupe Français
d'Études Féministes.
BARRY, L. (2012). La parenté au singulier. In: E. DÉSVEAUX, & M. d. FORNEL, Faire des
sciences sociales. Généraliser (pp. 121-150). Paris: Éditions de l'EHESS.
BELELI, I., & OLIVAR, J. M. (2011). Mobilidade e prostituição em produtos da mídia
brasileira. In: A. PISCITELLI, G. O. ASSIS, & J. M. OLIVAR, Gênero, sexo, amor e
dinheiro: mobilidades transnacionais envolvendo o Brasil (pp. 491-535). Campinas:
UNICAMP/PAGU.
BLANCHETTE, T., & SILVA, A. P. (10 a 13 de Julho de 2011). Jogue o bebê, salve a água do
banho. Repensando a "objetificação" no contexto do trabalho sexual. Anais da IX
Reunião de Antropologia do Mercosul: Culturas, Encontros e Desigualdades.
Curitiba, Paraná, Brasil: RAM.
BOZON, M. (2001). Orientations intimes et constructions de soi. Pluralité et divergences dans
les expressions de la sexualité. Sociétés contemporaines, 11-40.
BOZON, M., & HELBORN, M. L. (1996). Les caresses et les mots. Initiations amoureuses à
Rio de Janeiro et à Paris. Terrain, 37-58.
BRASIL. (7 de décembre de 1940). Código penal. Acesso em 11 de mars de 2013, disponível
em www.planalto.gov.br: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-
lei/del2848compilado.htm
BRUBACKER, R., & COOPER, F. (January de 2000). Beyond "identity". Acesso em 05 de
April de 2013, disponível em Selected Works of Roger Brubacker:
http://works.bepress.com/wrb/2
BUTLER, J. (2006). Défaire le genre. Paris: Éditions Amsterdam.
CALLIGARIS, E. d. (2006). Prostituição: o eterno feminino. São Paulo: Escuta.
CARSTEN, J. (1987). Analogues or opposites: household and community in Pulau Langkawi,
Malasya. In: C. Macdonald, & ECASE, De la hutte au palais. Sociétés "à maison" en
Asie du Sud-Est insulaire (pp. 153-168). Paris: Éditions du CNRS.
CERTEAU, M. d. (2008). A invenção do quotidiano: 1. Artes de fazer. Petrópolis: Vozes.
CLIFFORD, J. (2003). De l'autorité en ethnographie. Le récit anthropologique comme texte
littéraire. In: D. CÉFAÏ, L'enquête de terrain (pp. 263-294). Paris: La Découverte.
87
FONSECA, C. (1996). A dupla carreira da mulher prostituta. Estudos Feministas, pp. 7-33.
FONSECA, C. (2000). La circulation des enfants pauvres au Brésil: une pratique locale dans
un monde globalisé. Anthropologie et Sociétés, 53-73.
GIAMI, A. (2009). Les formes contemporaines de la médicalisation de la sexualité. In: S.
YAYA, Pouvoir médical et santé totalitaire: conséquences socio-anthropologiques et
éthiques (pp. 225-249). Montréal: Presses de l'Université de Laval.
HÉRITIER, F. (1996). Masculin/féminin. La pensée de la différence. Paris: Éditions Odile
Jacob.
LEITE, G. (2009). Filha, mãe, avó e puta. Rio de Janeiro: Abril.
LUNA SALES, A. P. (2013). Amor à venda? Ritualizações do programa entre as prostitutas
do Restaurante Granada. Etnográfica, 147-163.
LUNA SALES, A. P. (in press). Espaços de prostituição, espaços de dominação: esboço das
relações de poder no Restaurante Granada. In: S. SIMÕES, H. SILVA, & A.
MORAES, Prostituição e outras formas de amor. Niterói: FAPERJ.
MATHIEU, N.-C. (1985). Quand céder n'est pas consentir. Des déterminants matériels et
physiques de la conscience dominée des femmes et de quelques-unes de leurs
interprétations en ethnologie. In: N.-C. MATHIEU, L'arraisonement des femmes.
Essais en anthropologie des sexes (pp. 167-237). Paris: Éditions de l'EHESS.
OLIVAR, J. M. (Fevereiro de 2011). Banquete de homens. Sexualidade, parentesco e
predação na prática da prostituição feminina. Revista Brasileira de Ciências Sociais,
pp. 89-101.
OLIVAR, J. M. (in press). Rue Garibaldi, 2007... Gênero, eficácia e predação na atualização
da “zona”. In: S. SIMÕES, H. SILVA, & A. MORAES, Prostituição e outras formas
de amor. Niterói: FAPERJ.
PASINI, E. (2009). Sexo com prostitutas: uma discussão sobre modelos de masculinos. In: M.
E. DÍAZ-BENITEZ, & C. E. FIGARI, Prazeres dissidentes. Rio de Janeiro:
Garamond.
PHETERSON, G. (1999). The whore stigma: female dishonor and male unworthness. Social
Text, 39-64.
PINHO, É. B. (2012). Memórias de mulheres e amigos: interesse e afeto no meretrício de
Fortaleza (1960-1980). Anais da 28ª Reunião Brasileira de Antropologia. ABA.
PISCITELLI, A. (2011). Amor, apego e interesse: trocas sexuais, econômicas e afetivas em
cenários transnacionais. In: A. PISCITELLI, G. ASSIS, & J. OLIVAR, Gênero, sexo,
afetos e dinheiro: mobilidades transnacionais (pp. 537-582). Campinas:
88
UNICAMP/PAGU.
PISCITELLI, A., ASSIS, G. O., & OLIVAR, J. M. (2011). Gênero, sexo, amor e dinheiro:
mobilidades transnacionais envolvendo o Brasil. Campinas: UNICAMP/PAGU.
RAGO, M. (2008). Os prazeres da noite. Prostituição e códigos da sexualidade feminina em
São Paulo (1890-1930). São Paulo: Paz e Terra.
REBHUN, L.-A. (1999). The heart is unknown country. Love in the changing economy of
Northeast Brazil. Stanford: Stanford University Press.
REDOUTEY, E. (2005). Trottoirs et territoires, les lieux de prostitution à Paris. In: M.-E.
HANDMAN, & J. MOSSUZ-LAVAU, La prostitution à Paris (pp. 39-90). Paris:
Éditions de la Martinière.
RIBERIRO, E. (15 de Août de 2012). Comunication enregistré dans le cadre du projet
"Cinderelas". (A. P. LUNA SALES, Entrevistador)
RUBIN, G. (2010). Surveiller et jouir. Anthropologie politique du sexe. Paris: EPEL.
SCOTT, J. (2012). De l'utilité du genre. Paris: Arthème Fayard.
SIMÕES, S. (jan-jun de 2010). Identidade e política: a prostituição e o reconhecimento de um
métier no Brasil. Revista dos Alunos de Antropologia Social do PPGAS-UFSCar, pp.
24-46.
SIMÕES, S. (2010). Vila Mimosa: etnografia da cidade cenográfica da prostituição carioca.
Niterói: EdUFF.
SIMÕES, S., SILVA, H., & MORAES, A. (in press). Prostituição e outras formas de amor.
Niterói: FAPERJ.
SOUSA, F. I. (1998). O cliente: o outro lado da prostituição. Fortaleza/São Paulo: Secretaria
de Cultura e Desporto/Annablume.
STRATHERN, M. (1988). The Gender of the Gift. Problems with Women and Problems with
Society in Melanesia. Berkley/Los Angeles/London: University of California Press.
TEDESCO, L. d. (2008). Explorando o negócio do sexo: uma etnografia sobre as relações
afetivas e comerciais entre prostitutas e agenciadores em Porto Alegre/RS. Porto
Alegre: Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, Dissertação apresentada ao
Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social da Universidade Federal do Rio
Grande do Sul.
VIEIRA, G. (02 de juillet de 2012). "A gente vive assim, mas a gente precisa de uma luz":
experiências religiosas de prostitutas em Pernambuco. Acesso em 25 de mars de
2013, disponível em 28ª Reunião Brasileira de Antropologia:
http://sistemasmart.tempsite.ws/rba/arquivos/31_5_2012_21_12_38.pdf
89
Glossaire
Ajuda : type de relation qui vise un échange économico-sexuel, stable et de longue durée, sans
être soumis aux mêmes préjugés que le programa.
Aldeota : quartier bourgeois de Fortaleza.
Amasiamento : cohabitation informelle.
Amor : équivaut à « amour » en français.
Assembléia de Deus : l’une des plus grandes Églises néo-pentecôtistes au Brésil.
Associação das Prostitutas do Ceará : association de prostituées créée en 1990, à Fortaleza et
agissant dans la région du Ceará.
Beco da Poeira : marché de vêtements de contrefaçon, au centre-ville de Fortaleza.
Beira-Mar : quartier de Fortaleza, en bord de mer, fréquenté par les touristes et habité par la
bourgeoisie locale.
Cabaré : équivalant du terme « maison close » en français.
Candomblé : religion afro-brésilienne.
Cafuçu : adjectif qualifiant les personnes sans élégance, pauvres et grossières.
Centro : centre-ville de Fortaleza.
Chamego : équivaut à « affaire » en français.
Classificação Brasileira das Ocupações : compilation et description des professions
reconnues par l’État brésilien.
90
Concubinato : type de cohabitation informelle où l’un des partenaires est marié(e) avec une
autre personne.
Espaço Show Bar : boîte de nuit dédiée à la prostitution.
Ficar : type de rencontre sexuelle de connotation éphémère en vogue entre les adolescent-e-s
brésilien-ne-s.
Gado : littéralement « bétail » ; au sens figuré « connard » en français.
Gringo : surnom qualifiant un homme étranger.
Igreja Universal do Reino de Deus : l’une des plus grandes Églises néo-pentecôtistes au
Brésil.
Malandragem : équivaut à « ruse » en français.
Menina : catégorie émique pour les travailleuses du sexe du quartier du Passeio Público ;
équivalant à « fille » en français.
Ministério de Saúde : équivalant au ministère de la santé, en français.
Motel : type d’hôtel destiné à la rencontre sexuelle, la location de la chambre se faisant à
l'heure et non à la nuitée.
Passeio Público : place localisée en centre-ville de Fortaleza ; désigne le quartier où se
trouvent le Restaurante Granada et d’autres espaces de prostitution ;
Pastoral da Mulher Marginalizada : secteur de l’Église catholique au Brésil dédié à
l’assistance aux travailleuses du sexe et à l’abolition de cette activité.
Pirambu : quartier de Fortaleza stigmatisé par la pauvreté et la violence dans les années 1990.
Pomba-Gira : déesse des religions afro-brésiliennes, associée aux prostitué-e-s.
91
Praia de Iracema : quartier festif fréquenté par les étrangers.
Praia do Futuro : partie du littoral de Fortaleza la plus fréquentée pour les loisirs aquatiques.
Programa : équivaut à une « passe » en français.
Real : monnaie du Brésil.
Rede Brasileira de Prostitutas : réseau de prostituées créé en 1987, à Rio de Janeiro, actif à
l'échelle nationale.
Rede Globo : la plus grande chaîne de télévision au Brésil.
Restaurante Granada : l’espace de prostitution où est centrée la recherche.
Reunião Brasileira de Antropologia : rencontre biennale réunissant les anthropologues
brésiliens.
Sapatão : équivaut à « lesbienne » ou « camionneuse » en français.
Transar : équivaut à « baiser » en français.
Trouxa : équivaut à « imbécile » en français.
Umbanda : religion afro-brésilienne.
Zoomp : marque de vêtements très prestigieuse à Fortaleza, dans les années 1990.





























































































![[tapuscrit original] Femme et langue. Sexe et langage (1982)](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/6336af56e8daaa60da100428/tapuscrit-original-femme-et-langue-sexe-et-langage-1982.jpg)