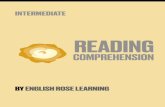Mémoire Master 2 Histoire, langues et taïwanité. Le cas de Rose, Rose, I Love You de l'écrivain...
-
Upload
univ-lyon3 -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of Mémoire Master 2 Histoire, langues et taïwanité. Le cas de Rose, Rose, I Love You de l'écrivain...
MASTER ARTS - LETTRES – LANGUES MENTION LANGUES ET CULTURES ETRANGÈ RES
SPÉ CIALITÉ ETUDES CHINOISES ANNÉ E 2009-2010
UNIVERSITÉ JEAN MOULIN LYON 3
Histoire, langues et taïwanité : le cas de Rose, Rose, I Love You de l’écrivain taïwanais Wang Chen-ho
歷史、語言與台灣性-以王禎和的《玫瑰玫瑰我愛你》為例
Gwennaël Gaffric Sous la direction de M. Corrado Neri
4
REMERCIEMENTS
En préambule de ce mémoire, je tiens à adresser mes remerciements aux personnes
qui m’ont apporté leur aide, et qui ont par conséquent participé à l’élaboration de ce
mémoire.
Je suis tout d’abord reconnaissant à mon Directeur de recherches, le professeur
Corrado Neri, pour ses remarques pertinentes et ses suggestions, ainsi qu’aux
professeurs Gregory B. Lee pour ses orientations théoriques et Florent Villard pour
ses conseils et sa disponibilité, et le professeur Chen Fang-hwey qui m’a permis de
connaître Wang Chen-ho. Mes remerciements s’adressent également aux participants
de la journée masterale/doctorale du GDR Taiwan en 2008, pour leurs conseils et
leur amitié, et en tout particulier au professeur Stéphane Corcuff pour sa disponibilité
et l’enthousiasme communicatif qu’il porte aux études taïwanaises.
Je suis aussi redevable à tous mes camarades de Lyon 3, pour leurs conseils et leurs
relectures, tout particulièrement à Alban, Stéphane et Vincent, ainsi qu’à mes
camarades de l’Université Tsinghua (清華大學 ). Je tiens aussi à remercier tout
spécialement les professeurs Liu Shu-qin柳書琴, Chen Chien-ch’ung陳建忠, Chen
Wan-yi陳萬益 et Wang Hui-zhen王惠珍 de l’Institut de Littérature Taïwanaise de
Tsinghua (清華大學台灣文學所), pour leur amitié, leur soutien et leur générosité.
Je n’oublie pas de remercier mes proches, ma famille, Matthieu pour sa relecture, et
surtout Anaïs, dont la présence et le soutien m’ont été indispensables durant toute
cette année scolaire.
5
Table des matières
AVANT-PROPOS ....................................................................................................................................................................... 6
RÉ SUMÉ DE L’ŒUVRE ÉTUDIÉE ........................................................................................................................................... 7
I- INTRODUCTION GÉ NÉ RALE ........................................................................................................................... 8
II- DE LA LITTÉ RATURE DU TERROIR À ROSE, ROSE, I LOVE YOU............................................. 15
1. Introduction ................................................................................................................................................................ 15
2. Taiwan et la littérature du terroir : aperçu historique ........................................................................................... 16
3. Le sens du terroir : années 70-80 ............................................................................................................................. 22
4. Wang Chen-ho et Rose, Rose, I Love You .................................................................................................................. 28
5. Conclusion ................................................................................................................................................................... 35
III- ROSE, ROSE, I LOVE YOU : UNE RELECTURE POSTCOLONIALE DE L’HISTOIRE DE TAÏWAN ............................................................................................................................................................................... 37
1. Introduction ................................................................................................................................................................ 37
2. Un retour sur l’histoire locale ................................................................................................................................... 38
3. Taïwan, Etats-Unis et capitalisme ........................................................................................................................... 45
4. Etats-Unis, colonialisme et l’idéologie de la propreté .......................................................................................... 51
5. Conclusion ................................................................................................................................................................... 57
IV- CRÉ OLITÉ ET CACOPHONIE : LA TAÏWANITÉ COMME LANGAGE ...................................... 59
1. Introduction ................................................................................................................................................................ 59
2. Renverser le monolinguisme et faire naître la Créolité : traduction et appropriation ..................................... 61
3. De la polyphonie à la taïwanité : la Créolité comme méthode ........................................................................... 72
4. Cacophonie et langue populaire : le grotesque dans Rose, Rose, I Love You ....................................................... 77
5. Conclusion ................................................................................................................................................................... 82
V- CONCLUSION GÉ NÉ RALE ............................................................................................................................... 85
Bibliographie .......................................................................................................................................................................... 89
Liste des caractères chinois ................................................................................................................................................. 98
Annexe 1 .............................................................................................................................................................................. 104
Annexe 2 .............................................................................................................................................................................. 107
6
« Etudier des contacts de culture, c’est décider déjà qu’on n’a pas de leçon à en tirer, la nature de
tels contacts étant d’être fluente, inattendue. 1» Edouard Glissant, Tout-monde
AVANT-PROPOS
En écrivant ce mémoire, nous souhaitions avant tout porter notre attention sur la
thématique de l’identité à travers la littérature taïwanaise. Si le (jeune) champ des
études littéraires taïwanaises commence à décoller à Taïwan, mais aussi aux Etats-
Unis (où les chercheurs taïwanais sont par ailleurs nombreux) ou encore en
Allemagne, les études taïwanaises en France, et particulièrement sur la littérature de
Taiwan sont encore à explorer plus profondément. Malgré tout, la publication du
premier ouvrage en français spécialisé sur la littérature taïwanaise en 2009 participe à
l’élaboration de ce nouveau champ de recherche2.
Plusieurs auteurs taïwanais tels que Pai Hsien-yung, Wang Wen-hsing, Li Ang ou
encore Hwang Chun-ming ont déjà été traduits en français, ce n’est pas encore le cas
de Wang Chen-ho ; il est de notre point de vue, dommage que celui-ci n’ait pas
encore eu cette occasion, dans la mesure où celui-ci invite à un dialogue entre Taïwan,
la Chine, le Japon et l’Occident (tout du moins, les Etats-Unis). En effet, les
nombreuses études, réactions et passions qu’il suscite sur l’île de Formose confirment
qu’il s’agit d’un auteur important, et plus encore, sa réflexion sur l’histoire de Taiwan
et sa perpétuelle recherche d’une identité complexe méritent amplement l’attention.
Ce modeste mémoire propose à sa façon un « détour » par Taïwan, pour non
seulement mieux comprendre la Chine, le rôle des Etats-Unis dans la région, l’histoire
coloniale et postcoloniale moderne mais aussi s’apercevoir que Taiwan en tant que
1 Edouard Glissant, Traité du Tout-Monde : Poétique IV, Paris, Gallimard, 1997, p.132. 2 Il s’agit tout simplement du premier ouvrage qui s’intéresse exclusivement à la littérature taïwanaise publié en français : Sandrine Marchand, Sur le fil de la mémoire : Littérature taïwanaise des années 1970-1990, Lyon, Tigre de Papier, 2009
7
lieu de confluences culturelles participe à l’ouverture du champ des possibles des
« Identités-Relations » du « Tout-Monde »3.
RÉ SUMÉ DE L’ŒUVRE ÉTUDIÉE
Avant toute chose, pour permettre une meilleure compréhension de l’analyse du
roman Rose, Rose, I Love You4 (Meigui meigui wo ai ni 玫瑰玫瑰我愛你), il est nécessaire
d’effectuer un bref résumé du roman :
Afin d’accueillir au mieux des GI’s états-uniens en guerre au Vietnam à Taiwan
pour un programme de R&R (Rest and Recreation) dans la ville de Hualian, les quatre
propriétaires des plus grands bordels du quartier se mobilisent pour construire un bar
et « former » des prostituées dignes de ce nom, capables d’accueillir et de « servir » au
mieux les soldats états-uniens. Ils font pour cela appel à un professeur d’anglais
flatulent, à un député arriviste, à un médecin pervers et à un avocat mystérieux. Le
professeur Dong organise ainsi des cours accélérés d’anglais, de « culture américaine »
et d’hygiène pour les prostituées, dans l’église du canton, et s’active afin que tout soit
parfait pour l’accueil des « clients » états-uniens. L’histoire se déroule sur un jour, celui
de la cérémonie d’ouverture du bar en question, et se termine tout juste avant l’arrivée
des GI’s à Taïwan.
3 Nous reviendrons dans notre étude sur ces termes chers au poète et théoricien martiniquais Edouard Glissant. 4 Wang Chen-ho 王禎和, Meigui meigui wo ai ni 玫瑰玫瑰我愛你 [Rose, Rose, I Love You], Taipei,
Hongfan Shudian, 1994 (première édition : 1984). Pour la traduction anglaise du roman : Wang Chen-ho, Rose, Rose, I Love You, trad. du chinois par Howard Goldblatt, New York, Columbia University Press, 1998.
8
I- Introduction générale
Stéphane Corcuff parle à propos de Taiwan « d’un laboratoire d’identités » 1. Cela a
plusieurs significations, la première c’est que les « identités » ne s’écrivent pas au
singulier à Taïwan, s’il y a « identité », elle est plurielle, ou elle résulte de différents
procédés d’identification. La question de l’identité, des identités, traverse les domaines
lorsqu’on s’intéresse à Taïwan, et cette question n’échappe ainsi pas non plus aux
études littéraires. Le second sens se situe ensuite dans le terme « laboratoire » : le
« laboratoire » est le lieu des inventions, des expériences, des mélanges… La
littérature taïwanaise, riche d’expériences diverses et variées, est une porte ouverte à
ce laboratoire bouillonnant, à condition qu’on veuille bien y rentrer, s’y perdre, et en
ressortir avec de nouvelles clés.
Il serait faux de dire que la littérature taïwanaise est née après l’arrivée du
gouvernement Nationaliste 2 chinois sur l’île, car l’identité taïwanaise se construit,
s’invente depuis ses premières relations avec le monde extérieur, depuis l’aube de son
histoire coloniale, mais surtout depuis la colonisation japonaise3. Mais il serait tout
aussi faux de dire que la tradition littéraire taïwanaise est une chaîne ininterrompue,
unique et monophonique.
Parler d’ailleurs de « Taiwan », ou d’identité taïwanaise ne fut d’ailleurs pas si facile
au cours de l’histoire, le référent « Taiwan » ayant été banni pendant de nombreuses
1 Stéphane Corcuff, « Introduction: Taiwan: A Laboratory of Identities », in Stéphane Corcuff, Memories of the Future: National Identity Issues and the Search for a New Taiwan, New York, Armonk, M.E.Sharpe, 2002, p.xi. 2 Nous utiliserons dans notre travail le terme « Nationaliste » avec un N majuscule, en référence au
gouvernement du KMT (guomindang 國民黨) pour le différencier de l’adjectif « nationaliste ». 3 L’écrivain Wu Zhuo-liu 吳濁流 est ainsi considéré comme l’un des premiers à se pencher sur la
question de l’identité taïwanaise simultanément par rapport au Japon et à la Chine. Son œuvre
maîtresse Yaxiya de gu’er 亞細亞的孤兒 [Orphelin d’Asie] écrite durant la colonisation japonaise mais
publiée après l’arrivée des Nationalistes Chinois à Taiwan en 1946 reste un parfait exemple de cette interrogation de l’identité taïwanaise.
9
décennies. Cependant, la littérature, à sa façon, est là pour prouver qu’il existe, sous
différentes formes. Comme le rappelle la taïwanaise Chiu Kuei-fen (邱貴芬) :
台灣社會在一九四五年之前一直是依附著日本符號,而一九四五到台灣解嚴的一九八七
年則轉而依附中國符號,在這漫長的歷史歲月裡,「台灣」一直是個禁忌的符號。從一九
八七年至今不過短短十來年,這中間「台灣」的內涵和實質的意義才逐漸在台灣文化場域
裡有所討論。4
[La société taïwanaise d’avant 45 était dépendante du référent (fuhao) « Japon », et de 1945 jusqu’à
la fin de la loi martiale en 1987, du référent « Chine ». Durant ces longues années d’histoires, « Taiwan »
a toujours été un référent interdit. De 1987 à aujourd’hui, lors de cette petite décennie seulement, on a
peu à peu commencé à débattre du contenu et de la signification essentielle du référent « Taiwan » dans
les cercles culturels à Taïwan.]
Notre étude porte ici sur un roman publié en 1984, soit trois ans avant la fin de la
loi martiale à Taiwan (instaurée en 1949, supprimée en 1987), c’est pourquoi « Taiwan
» en tant que signe étant « interdit » et même parfois inenvisageable parmi les
Taïwanais eux-mêmes, il est intéressant d’interroger l’existence d’une particularité
taïwanaise (taiwan teshuxing 台灣特殊性 ), avant même sa large utilisation par les
discours nationalistes de la période post-loi martiale.
C’est pourquoi, dans notre travail, nous avons choisi d’employer le terme
« taïwanité ». Le mot est évidemment un néologisme, il pourrait signifier « ce qu’il y a
de spécifique à Taiwan », « l’ensemble de constructions imaginaires destinées à créer
une identité taïwanaise » ; le suffixe « -ité » peut en outre nous permettre de faire un
4 Chiu Kuei-fen邱貴芬, Houzhimin ji qiwai後殖民及其外 [Le postcolonial et son en-dehors], Taipei,
Maitian chubanshe, 2003, p.139. De même, Sandrine Marchand remarque qu’ « après la lente dislocation du régime autoritaire, le gigantesque soulèvement de la mémoire taïwanaise depuis le début des années 1990, en parallèle à la recherche d’une identité taïwanaise, doit être salué dans ses excès mêmes. Pour un pays jeune, absolument adapté au monde moderne, prendre le taureau de la mémoire par les cornes est un exemple remarquable que les pays voisins ne semblent pas être prêts à suivre. », Sandrine Marchand, Sur le fil de la mémoire : Littérature taïwanaise des années 1970-1990, Lyon, Tigre de Papier, 2009, p.25.
10
parallèle avec le terme « identité ». On pourrait bien évidemment mettre le terme
« taïwanité » au pluriel, mais, à travers l’œuvre de Wang Chen-ho (王禎和), c’est une
vision d’une forme de taïwanité que nous cherchons à repérer (la taïwanité n’excluant
pas une identification plurielle, nous nous en apercevrons). Ce que nous cherchons à
comprendre dans notre étude, c’est ce qu’est la taïwanité pour Wang Chen-ho.
Comment se manifeste sa recherche dans Rose, Rose, I Love You? Dans quel contexte
s’inscrit cette recherche, quels critères implique-t-elle, et par quels procédés y
parvient-elle ?
Comme le note l’allemand Carsten Storm, l’analyse d’une œuvre d’un auteur
taïwanais à un moment donné de l’histoire nous ramène à étudier l’expression d’une
identité imaginée par ce même auteur, à ce même moment5.
Revendiquer une identité, partir à sa recherche, c’est avant tout lui définir des
critères, des raisons d’exister. Pour Mark Harrison, l’expression de l’identité
taïwanaise se définit à travers trois critères principaux : la langue, la politique et
l’histoire6. C’est à travers ses trois axes que nous allons ainsi porter notre attention
dans Rose, Rose, I Love You de Wang Chen-ho, en insistant tout particulièrement sur
l’histoire (avec laquelle s’entrecoupe inévitablement la politique) et la langue (les
langues), et nous nous intéresserons en plus de ces critères à l’importance du « lieu »,
du « local » dans la littérature taïwanaise et chez Wang Chen-ho en particulier. Dans
un autre contexte, Jean Bernabé, Patrick Chamoiseau et Raphaël Confiant définissent
quant à eux plusieurs exigences transitoires de l’expression littéraire d’une
représentation de l’identité créole : la Créolité : 1.L’enracinement dans l’oral 2.La mise
5 Carsten Storm, « Introduction », in Mark Harrison and Carsten Storm The Margins of Becoming. Identity and Culture in Taiwan, Harrasowitz Verlag, 2007, p.18. 6 Mark Harrison, « Writing Taiwan’s Nationhood », in Fang-Long Shih, Stuart Thompson and Paul-François Tremlett, Re-Writing Culture in Taiwan, New York, Routledge, 2009, p.123.
11
à jour de la mémoire vraie 3.La thématique de l’existence 4.L’irruption dans la
modernité 5.Le choix de sa parole7.
Dans cette recherche identitaire qu’est la « quête de la taïwanité », l’ « ici » est
essentiel, car il est le pivot de l’histoire, des langues et de la mémoire collective (nous
verrons que les partisans de la littérature du « terroir » (xiangtu wenxue 鄉土文學) ont
eu du mal à se dire « différents » autrement qu’en disant : nous avons une situation
géographique particulière). Dans notre première partie, c’est d’ailleurs la genèse de
l’écriture de Rose, Rose, I Love You qui nous intéresse : en essayant de replacer l’œuvre
et son auteur dans leur contexte littéraire et historique, et nous insisterons sur
l’importance et l’influence du mouvement de la littérature du terroir et son retour sur
le local comme nouveau lieu d’identification.
Nous nous interrogerons ensuite, dans notre deuxième partie, sur la relecture
historique opérée par Wang Chen-ho dans Rose, où l’action se déroule dans les années
60, alors que le livre, lui, est écrit dans les années 80. Nous verrons en quoi cette
relecture de l’histoire passée récente peut contribuer à l’excavation et à la réinvention
d’une identité propre, en s’intéressant tout particulièrement aux rapports entre Etats-
Unis et Taïwan, thème par ailleurs largement traitée dans la production artistique à
Taïwan8.
Dernièrement, outre l’expérience particulière du lieu et de son histoire, les
partisans de la littérature du terroir de la fin des années 70 et du début des années 80,
tout comme Wang Chen-ho lui-même, revendiquent la possibilité d’un autre langage,
d’un droit à la subversion du langage officiel. L’importance de la langue dans la
littérature taïwanaise est indispensable à celui qui veut la comprendre : c’est donc
7 Jean Bernabé, Patrick Chamoiseau et Raphaël Confiant, Eloge de la Créolité, Paris, Gallimard, 1989. Nous verrons que ces exigences traversent elles aussi l’œuvre de Wang Chen-ho dans sa quête d’une expression littéraire de la « taïwanité ». 8 Pour ne citer qu’eux, la fiction des écrivains Hwang Chun-ming (黃春明), Ch’en Ying-chen (陳映真),
Wang T’uo (王拓) ou les films du réalisateur Wu Nien-jen (吳念真) traite dans les années 70-80 de
cette expérience « coloniale » particulière.
12
autour de cette thématique de l’utilisation des langues que s’articulera notre troisième
partie, dans laquelle nous proposerons l’idée d’une Créolité taïwanaise.
Cette importance du lieu, de la thématique de l’identité, de la recherche d’une
histoire confisquée, du choix de sa parole fait entrer la littérature taïwanaise des
années 70-80 en général, et l’œuvre de Wang Chen-ho en particulier, de plain-pied
dans une situation postcoloniale très spécifique. Nous entendons, à la manière de Bill
Ashcroft, Gareth Griffiths et Helen Tiffin, le sens du mot « postcolonial » dans son
sens large :
We use the term ‘post-colonial’, however, to cover all the culture affected by the imperial process
from the moment of colonization to the present day.9
[Nous utilisons le terme « postcolonial », toutefois, pour traiter de toute la culture affectée par le
processus impérial, du moment de la colonisation jusqu’au jour d’aujourd’hui.]
C’est donc avec une telle grille de lecture que nous tenterons d’envisager les
particularités de Rose, Rose, I Love You. Nous nous appuierons à ce sujet tout
particulièrement sur le travail de Chiu Kuei-fen et sur les analyses des antillais Frantz
Fanon, Edouard Glissant et des auteurs de l’Eloge de la Créolité. Nous reviendrons dans
notre étude sur ce choix, et sur sa pertinence éventuelle.
Malgré l’absence (physique) des GI’s états-uniens dans le roman, Rose, Rose, I Love
You est avant tout l’histoire d’une rencontre, d’un choc culturel, entre les Etats-Unis
et Taïwan. Paroxysme de cette rencontre avec les Etats-Unis et du formidable rapport
transculturel Chine-Taïwan-Etats-Unis, le titre du roman : Rose, Rose, I Love You
(Meigui meigui wo ai ni玫瑰玫瑰我愛你) : la chanson « Rose, Rose, I Love You » est
une adaptation anglaise d’un tube pop chinois des années 30, écrite par Wu Cun (吳
9 Bill Ashcroft, Gareth Griffiths and Helen Tiffin, The Empire Writes Back: Theory and Practice in Post-colonial Literatures, New York, Routledge, 1989, p.2.
13
村) et composé par Chen Gexin (陳歌辛). La chanson fut ensuite popularisée à
Taiwan grâce à la voix bien connue de la chanteuse Feng Fei-fei (鳳飛飛), puis
adaptée en anglais par le britannique Wynford Vaughan Thomas avant de connaître
un franc succès grâce au chanteur états-unien Frankie Laine dans les années 60.
Comme un symbole, les jeux de la langue de Wang Chen-ho dans le roman se
retrouvent aussi dans le titre : le mot chinois pour « rose » (meigui 玫瑰) est très
proche phonétiquement du mot « Etats-Unis » (meiguo 美國), ce qui pourrait donner,
si l’on prononce mal : « USA, USA, I Love You » (et on verra dans notre étude que
cette image a un sens évident dans le roman). Enfin, ce même mot « rose » meigui
donnera le terme (proche phonétiquement) « make way » en anglais, expression qui
fait partie du refrain de la chanson en anglais10.
Dans cet immense laboratoire d’identités qu’est la littérature taïwanaise, notre
choix d’étudier Wang Chen-ho n’est pas pris au hasard, car il est en l’un de ceux qui
manient le mieux l’éprouvette, créant, nous y reviendrons, un cocktail détonnant à
base de chinois classique (wenyanwen 文言文 ), de chinois mandarin (« langue
nationale » : guoyu 國語), d’anglais, de japonais ou encore de « dialectes » taïwanais, en
grande majorité le taigi11.
L’expérience qui nous intéresse ici, Rose, Rose, I Love You, interroge et met en
branle l’histoire et la littérature telle qu’elle est officiellement narrée à Taïwan, mais
10 Pour plus d’informations sur la chanson « Rose, Rose, I Love You », voir http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,935240,00.html (consulté le 10 février 2010), et Howard Goldblatt, « Afterword », in Wang Chen-ho, Rose, Rose, I Love You, trad. du chinois par Howard Goldblatt, New York, Columbia University Press, 1998, pp.181-183. 11 Le taigi (taiyu 台語) « est « littéralement « le taiwanais » ou « la (ou les) langue(s) de Taiwan », est
souvent utilisé comme un terme collectif désignant le groupe de dialectes des Min du Sud (minnan) parlé par environ 73 % de la population actuelle de Taiwan. » Voir : Henning Klötter, « Vers une société multilingue ? », Perspectives Chinoises, n°85, 2004, http://perspectiveschinoises.revues.org/document685.html (consulté le 11 mars 2010). A la manière d’Henning Klötter, nous préférerons utiliser le terme « taigi » (sa prononciation dans cette même langue) plutôt que « taïwanais », ou « taiyu », pour éviter les confusions ou les raccourcis trop politiques (le taigi n’est absolument pas la seule langue parlée à Taiwan en dehors du chinois mandarin).
14
nous verrons que le roman possède de réelles différences par rapport à l’esprit
« traditionnel » (ou qui se veut comme tel) de la littérature du terroir. De nombreux
chercheurs taïwanais ou occidentaux se sont déjà penchés sur Rose, Rose, I Love You, en
l’analysant à travers des filtres variés, et parviennent à des conclusions diverses,
certains estimant qu’il s’agit d’une satire politique sur un mode parodique12, d’autres d’
une longue blague de la taille d’un roman13 , d’un héritage de la culture comique
chinoise14, ou même à d’un chef d’œuvre d’humour postmoderne15, elle est en effet un
peu tout à la fois : une expression littéraire singulière d’une recherche identitaire, et
d’une réaction engagée à la confluence de différents discours et de différentes cultures,
celles de Taïwan, de la Chine et des Etats-Unis.
12 Sung-Sheng Yvonne Chang, Modernism and the Nativist Resistance, Contemporary Chinese Fiction from Taiwan, Durham, Duke University Press, 1993, p.81 Pour le traducteur états-unien Howard Goldblatt, Rose, Rose, I Love You est tout simplement « la satire politique comique chinoise la plus fine de l’ère moderne » : Michael Berry, « The Translator’s Studio: A Dialogue with Howard Goldblatt », Persimmon: Asian, Literature, Arts and Culture, été 2002, p.22. 13 Jeffrey C. Kinkley, « Mandarin Kitsch and Taiwanese Kitsch in the Fiction of Wang Chen-ho », Modern Chinese Literature, Vol.6, 1992, p.102. 14 David Der Wei Wang 王德威, « Cong lao she dao wang zhenhe : xiandai zhongguo xiaoshuo de
xinüe qingxiang » 從老舍到王禎和-現代中國小說的戲謔傾向 [De Lao-she à Wang Chen-ho : la
tendance à la blague dans les romans chinois modernes], Cong liu’e dao wang zhenhe 從劉鶚到王禎和
[De Liu’E à Wang Chen-he], Taipei, Shibao wenhua chubanshe, 1986, pp.149-182 15 Huang I-min, « A Postmodernist Reading of Rose, Rose, I Love you », Tamkang Review, 1986, Vol. XVII, No.1, pp.27-43.
15
II- De la littérature du terroir à Rose, Rose, I Love You
「[…] 吸引我去寫小說的,是人物,是一批我聽過的、我見過的人物。他們過的遭遇、
言行、掙扎、痛苦、或是他們的荒誕行止,都給我很深很深的印象。十年來、二十年來、
三十年來」、都忘不了,仿佛成了生命的一部分。」1
[« […] Ceux qui me poussent à écrire des romans, ce sont les personnages, la foule de ceux que j’ai
vus ou entendus. Ceux dont les rencontres, les actes, les paroles, les luttes, les peines, ou les conduites
absurdes ont laissé en moi des impressions profondes. Dix ans, vingt ans, trente ans ont passé, je n’ai
rien oublié, comme s’ils étaient devenus une partie de moi-même. »] Wang Chen-ho, « La quête
perpétuelle »
1. Introduction
Les années 70 marquent un tournant dans l’histoire littéraire de Taïwan, car c’est
le moment où les défenseurs de ce qu’on appellera désormais la « littérature de
terroir » (xiangtu wenxue) arrivent sur le devant de la scène2. Tout d’abord, d’un point
de vue terminologique, nous devons expliquer notre choix du terme « terroir » pour
traduire le mot chinois xiangtu (鄉土). Traduit la plupart du temps par « littérature
nativiste » (nativist literature) en anglais, cette traduction ne nous renseigne
1 Wang Chen-ho 王禎和, « Yongheng de xunqiu », 永恆的尋求 [La quête perpétuelle], Rensheng de
gewang 人生的歌王 [Le roi des chansons de la vie], Taipei, Lianhe wencong, 1987, p.1. 2 Ch’en Fang-ming陳芳明, « Taiwan xinwenxue shi de jiangou yu fenqi »台灣新文學史的建構與分
期 [Construction et périodisation de l’histoire de la nouvelle littérature taïwanaise], Unitas 聯合文學,
n°178, août 1999, p.67. Nous utiliserons les 18 chapitres de Ch’en Fang-ming (parus dans la revue
Unitas 聯合文學 entre 1999 et 2002 sur l’histoire de la littérature taïwanaise comme référence
principale.
16
qu’exclusivement sur le sens de celle-ci3, et nous lui préférerons le terme de « terroir »,
moins politique, mais plus juste à notre avis4.
Ce qui nous intéresse tout particulièrement dans ce chapitre, c’est la façon dont
est né ce mouvement, le rôle qu’il prend à cette époque dans le domaine littéraire, et
les différents discours qu’il véhicule. La littérature du terroir se situe en effet aux
frontières de plusieurs idéologies, de plusieurs sensibilités. Nous nous attacherons
donc à la mettre en relation avec l’arrière-plan historique taïwanais qui lui donne vie et
sens. Nous verrons enfin que Wang Chen-ho ne se réclame pas directement de ce
mouvement (bien qu’il soit régulièrement cité et « utilisé » par certains partisans du
terroir), mais qu’il lui est inévitablement lié. En effet, on ne peut nier que le contexte
littéraire et historique taïwanais des années 60 jusqu’aux années 80 ont marqué de leur
empreinte l’œuvre de Wang, et nous permettent de comprendre sa façon
d’appréhender l’identité taïwanaise. Il nous faut donc avoir à l’esprit qu’une œuvre
comme Rose, Rose, I Love You est un trait d’union entre plusieurs tendances
idéologiques et littéraires contradictoires de l’époque.
2. Taiwan et la littérature du terroir : aperçu historique
Pour mieux comprendre le développement de la littérature taïwanaise, ainsi que la
recherche de ce qu’on pourrait appeler une « identification taïwanaise », il nous faut
remonter au moins dans les années 1920-1930, alors que Taiwan est une colonie
3 En guise d’exemple : un personnage comme T’ang Wen-biao 唐文標 et Guan Jie-ming 關傑明,
considérés comme l’un des pionniers du mouvement littéraire du terroir xiangtu 鄉土 sont ainsi
respectivement nés à Hong-Kong et Singapour. 4 Sandrine Marchand, dans son ouvrage sur la littérature taïwanaise des années 70-90 utilise également le terme de « littérature du terroir », afin de traduire l’expression « xiangtu wenxue ». Voir Sandrine Marchand, Sur le fil de la mémoire : Littérature taïwanaise des années 1970-1990, Lyon, Tigre de Papier, 2009, p.15.
17
japonaise depuis 1895 et le traité de Shimonoseki5. Les années 30 marquent le début
de prise de conscience d’une « particularité » historique et linguistique de la part de
certains intellectuels taïwanais, qui, sous l’influence de la langue japonaise (du
colonisateur) d’une part, et du chinois6, proposent une « littérature du terroir »7, en
« langue taïwanaise » (taiwan huawen台灣話文), qui se veut représentative du peuple
taïwanais, souhaitant utiliser sa langue et ses imaginaires populaires et en faire les
fondations de cette nouvelle littérature.
Si les partisans de la littérature en chinois, et en langue taïwanaise se rejoignirent
sur plusieurs points, notamment sur le fait d’être moderne (et donc de quitter le règne
du classicisme), d’être au service de la culture de masse (dazhong wenhua大眾文化),
leur discordance se situait plutôt au niveau de la définition de cette culture et par
corrélation de la langue qui la décrit et qui la parle8. Cependant, aucune des tendances
ne l’emporta effectivement sur l’autre, et dès l’année 1937, le gouvernement
colonialiste japonais lance une politique de japonisation complète de l’île de Taiwan
(kominka en japonais, huangminhua en chinois 皇民化 : littéralement : impérialisation
du peuple) : il est officiellement interdit de publier des œuvres en chinois et en
taïwanais. L’historien taïwanais Ch’en Pei-feng y voit une autre raison à l’échec de ce
mouvement de la littérature du terroir, plus interne, à savoir l’impossibilité d’écrire
exclusivement en taigi9, ainsi que l’incapacité de la part des intellectuels taïwanais
5 Notre but ici, n’est pas de donner une vision élargie de l’histoire de Taïwan, pour plus d’informations (en français) sur cette période, voir Lee Hsiao-feng, Histoire de Taïwan, trad. du chinois par Yan Hsia-hou, Paris, Editions L’Harmattan, 2004. 6 On devrait pour être précis indiquer qu’il s’agit du chinois vernaculaire (zhongguo baihuawen中國白話
文) du mouvement de 4 mai 1919 en Chine continentale. 7 « xiangtu wenxue 鄉土文學 » C’est la première fois que l’expression est utilisée, et elle donnera son
nom au mouvement homonyme des années 70. 8 Ch’en Fang-ming 陳芳明, « Wenxue zuoqing yu xiangtu wenxue de queli » 文學左傾與鄉土文學的
確立 [Radicalisation à gauche de la littérature et établissement de la littérature du terroir], Unitas 聯合
文學, n°183, 2000, pp.128-136. 9 Et ce, malgré, les différentes tentatives de romanisation de langue taigi, voir à ce sujet Ann Heylen, « Loading the Matrix: Taiwanese in Historical Perspective », in Mark Harrison and Carsten Storm, Margins of Becoming. Identity and Culture in Taiwan, Harrasowitz Verlag, 2007 pp.35-49.
18
même d’utiliser la même langue chinoise que les écrivains chinois du mouvement du 5
mai 1919 (wusi yundong五四運動). En effet, les participants à la polémique n’écrivent
pas en taigi, mais dans un chinois hybride, avec des structures grammaticales
japonaises, les mots de la modernité occidentale (traduits du japonais), et des
expressions issues des différents dialectes présents à Taïwan10. Il est donc intéressant
de noter que cette première tentative, dans les années 30, d’une identification
taïwanaise par la littérature du terroir doit son échec en grande partie à cause de
l’impossibilité d’une identification totale à une seule langue.
Suite à la fin de la Seconde Guerre Mondiale, en 1945, le Japon doit céder Taiwan
à la Chine, et le gouvernement du parti Nationaliste (guomindang國民黨) qui détient le
pouvoir en Chine continentale prend le contrôle de Taïwan. En 1949, suite à la
victoire des Communistes sur les Nationalistes, ces derniers se réfugient sur l’île de
Taiwan et y exercent leur pouvoir d’une main de fer. Entre-temps, des conflits
identitaires sont déjà intervenus dès l’arrivée des waishengren (外省人) (fréquemment
(mal) traduit en français par « Chinois continentaux ») avec les benshengren (taïwanais
« de souche »本省人 ). Comble de ces tensions identitaires, le 28 février 1947
(« l’évènement du 28 février » : er’er’ba shijian二二八事件), une violente révolte des
Taïwanais de souche est réprimée dans le sang par le gouvernement chinois
Nationaliste. Cet évènement marque un tournant très important dans l’histoire
politique et littéraire de Taïwan. En effet, dès lors, les écrivains taïwanais de souche ne
peuvent s’exprimer librement (de nombreux activistes de gauche, tels que les écrivains
Yang K’uei (楊逵 ), ou Lu He-jo (呂赫若 ) sont enfermés ou disparaissent
10 Ch’en Pei-feng 陳培豐, « Rizhi shiqi taiwan huawen pai de piaoyou yu xiangxiang : diguo hanwen,
zhimindi hanwen, zhongguo baihuawen, taiwanhuawen » 日治時期台灣漢文派的飄遊與想像:帝
國漢文、殖民地漢文、中國白話文、台灣話文 [Imaginaires et errances des partisans du chinois à
Taiwan sous la gouvernance japonaise : chinois impérial, chinois colonial, chinois vernaculaire et
« langue taïwanaise »], Taiwan Lishi yanjiu台灣歷史研究 [Etudes sur l’histoire de Taïwan], Volume 5,
n°4, décembre 2008, pp.32-83.
19
mystérieusement). De plus, écrire en japonais est désormais interdit, et les écrivains
taïwanais, déjà habitués à s’exprimer dans la langue nippone (ou en taigi, lui aussi
banni des cours d’école et des cercles littéraires11) se retrouvent dans l’impossibilité
d’écrire en chinois, langue qu’ils ne maîtrisent pas. La fin des années 40, et les années
50 (avec l’instauration de la loi martiale en 1949) marque le début d’une longue
période de « silence » pour les écrivains taïwanais12.
La décennie qui suit voit l’apogée d’une littérature plus officielle, culturaliste et
souvent anti-communiste et au service de l’Etat. La plupart des écrivains en activité,
et qui participent la plupart du temps, à un degré plus ou moins important, à la
construction de la littérature officielle sont ceux qui ont suivis le gouvernement
Nationaliste lors de son repli à Taïwan. Les écrivains taïwanais (de souche) quant à
eux, apprennent ou réapprennent le chinois pendant que certains sont toujours
victimes de la censure et de la pression politique exercée par le gouvernement
Nationaliste. Ceux-ci sont alors dans l’incapacité de s’exprimer dans leur langue
maternelle.
Une première forme de réaction à la littérature officielle et à la propagande anti-
communiste des années 50 se manifeste avec le mouvement Moderniste (xiandai zhuyi
wenxue 現代主義文學) au début des années 60. Plusieurs jeunes étudiants de la
faculté des Langues Etrangères de l’Université Nationale de Taiwan publient dès le
début des années 60 une revue nommée Littérature Moderne (xiandai wenxue現代文學).
On y retrouve plusieurs futurs grands écrivains taïwanais, tels que Pai Hsien-yung (白
先勇), Wang Wen-hsing (王文興), Chen Jo-hsi (陳若曦), Ouyang Tzu (歐陽子) ou
encore un étudiant de quelques années leur cadet, Wang Chen-ho, qui y publie sa
11 Henning Klötter, « Vers une société multilingue ? », Perspectives Chinoises, n°85, 2004, http://perspectiveschinoises.revues.org/document685.html. (consulté le 11 mars 2010.) 12 Ch’en Fang-ming 陳芳明, « Er’er’ba shijian hou de wenxue rentong yu lunzhan » 二二八事件後的
文學認同與論戰 [Controverses et identité littéraire après l’évènement du 28 février], Unitas 聯合文學,
n°198, mars 2001, pp.162-175.
20
première nouvelle en 1961. Les étudiants publient des œuvres traduites de James
Joyce, Franz Kafka, William Faulkner, Sigmund Freud, Albert Camus et autres, et
l’influence des grands maîtres occidentaux du modernisme se ressent dans les œuvres
de ceux-ci13.
L’apolitisme déclaré des Modernistes taïwanais est, entre autres, une réaction à la
littérature officielle, ultra-politisée des années 5014. Cependant, comme le note Lai
Ming-yan :
Through the Chinese Cultural Renaissance Movement launched in 1966, the Nationalist
government has vigorously promoted a vision of modernity for Taiwan that integrates Chinese cultural
traditions with modern (Western) scientific and technological development.15
[A travers le mouvement pour une Renaissance de la Culture chinoise lancé en 1966, le
gouvernement Nationaliste a vigoureusement promulgué une vision de la modernité intégrant à la fois
les traditions culturelles chinoises, ainsi que les sciences (occidentales) modernes et le développement
technologique.]
C’est face à une telle tendance, et surtout en réaction à l’influence occidentale
grandissante, que les nouveaux partisans de la littérature du terroir, font entendre
leurs voix, dès les années 70. Ils s’opposent à une vision de l’art pour l’art, critiquant
l’influence moderniste occidentale, préconisant un retour aux « racines taïwanaises » et
une littérature militante16.
13 Ch’en Fang-ming 陳芳明, « Liuling niandai xiandai xiaoshuo de yishu chengjiu » 六 0年代現代小
說的藝術成就 [Succès artistiques des romans modernistes des années 60], Unitas聯合文學, n°208,
février 2002, pp.151-163. 14 Sung-Sheng Yvonne Chang, Modernism and the Nativist Resistance, Contemporary Chinese Fiction from Taiwan, Durham, Duke University Press, 1993, p.23. 15 Lai Ming-Yan, Nativism and Modernity, Cultural contestations in China and Taiwan under Global Capitalism, New York, State University of New York Press, 2008, p.54. 16 Ch’en Fang-ming 陳芳明, « Xiangtu wenxue yundong de juexing yu zai chufa » 鄉土文學運動的覺
醒與再出發 [Le réveil et le nouveau départ du mouvement de la littérature du terroir], Unitas 聯合文
學, n°221, mars 2003, pp.138-159.
21
Le « terroir » prôné par ces intellectuels ou écrivains n’existe ainsi qu’en référence
avec quelque chose d’autre, « en dehors », ou bien « étranger » à ce terroir, et avant
même une remise en question du pouvoir Nationaliste chinois, les défenseurs de la
littérature du terroir s’attaquent à l’impérialisme culturel et économique occidental,
tout particulièrement celui des Etats-Unis17.
Différents événements économiques, sociaux et historiques expliquent également
la montée de ce discours du terroir et le rejet de la modernité occidentale. Parmi ceux-
ci, l’évènement déclencheur d’un renouveau nationaliste (chinois, dans un premier
temps) est le « mouvement de la protection de Diaoyutai » (baodiao yundong保釣運動)
en 1970. Diaoyutai (釣魚台), un archipel d’îles situées au Nord de Taiwan est devenu
propriété états-unienne à la fin de la Seconde Guerre Mondiale, cependant, la Chine
et le Japon revendiquaient tous deux la souveraineté sur cette région (riche en pétrole).
En 1970, les Etats-Unis accèdent aux exigences nippones, et Diaoyutai devient
japonais. Cet évènement provoqua ainsi en premier lieu l’indignation de jeunes
étudiants taïwanais vivant aux Etats-Unis, puis l’écho qui lui fait suite sema la révolte
parmi les jeunes intellectuels taïwanais, qui y virent là une désillusion nationale. Ces
évènements furent suivis par d’autres, non moins importants : en 1971, le président
états-unien Richard Nixon se rend officiellement en Chine Populaire pour y signer le
« Communiqué de Shanghai » (shanghai gongbao 上海公報). Un an plus tard, l’ONU
reconnaît officiellement la Chine Populaire, et Taiwan (à l’époque République de
Chine) perd son siège au profit de son voisin communiste. Ce nouvel épisode
international est perçu parmi un certain nombre de jeunes écrivains taïwanais comme
un abandon états-unien, sur un plan politique d’une part, mais ceux-ci dénoncent
aussi le fait que les états-uniens conservent leur immense influence économique et
17 Lai Ming-yan, Nativism and Modernity, Cultural Contestations in China and in Taiwan under Global Capitalism, p.16.
22
culturelle sur l’île, tout en traitant avec « l’ennemi ». Les années 70 sont également
marquées par un évènement majeur sur la scène politique de Taïwan, avec une révolte
nationaliste (de partisans de l’indépendance taïwanaise) à Kao-hsiung (高雄) en 1979,
connue sous le nom de « l’évènement de Formose » (meilidao shijian 美麗島事件). C’est
dans ce contexte littéraire, économique et politique complexe que le discours du
terroir prend son envol, et les partisans du terroir deviennent, à la fin des années 70,
et au début des années 80, à son paroxysme, proches des mouvements
indépendantistes18.
3. Le sens du terroir : années 70-80
Un tournant important à propos de la littérature du terroir intervient à la fin des
années 70. En effet, durant les années 1977-1978 plus particulièrement, de nombreux
écrivains, critiques et intellectuels participent à la polémique de la littérature du terroir
(xiangtu wenxue lunzhan 鄉土文學論戰 ). De façon générale, la polémique de la
littérature du terroir provient d’une volonté de politisation de la littérature en réaction
à l’apolitisme « bourgeois » des Modernistes dans les années 60. Le thème de la
recherche identitaire est aussi une des clés du mouvement, et on peut avancer qu’une
véritable réflexion sur l’histoire et la mémoire collective de Taiwan est désormais en
œuvre. Cependant, la définition de la littérature du terroir n’a pas, à ce moment, de
définition fixe et acceptée par chacun, et les divergences idéologiques de chaque
18 Ch’en Fang-ming, « Xiangtu wenxue de juexing yu zai chufa », pp-138-159, voir aussi You Sheng-
guan 游勝冠, Taiwan wenxue bentulun de xingqi yu fazhan 台灣文學本土論的興起與發展 [L’essor et le
développement du discours nativiste dans la littérature taïwanaise], Taibei, Qunxue, 2009, p.138-159.
23
intellectuel contribuent à lui donner des sens différents, permettant de la même
manière l’élargissement de son espace imaginaire19.
Tout d’abord, comme nous l’avons vu précédemment, le « terroir » des années 70
découle avant tout d’une opposition binaire Chine-Occident, les premières critiques
des écrivains taïwanais de souche ont lieu dès le milieu des années 70, avec une
critique acerbe des poètes Modernistes, accusés de « plagier » les Occidentaux. Puis,
les évènements politico-historiques des années 70 déjà discutés ne font que renforcer
l’indignation des Taïwanais vis-à-vis de l’Occident, le Modernisme est alors perçu
commune manière de noyer la tradition chinoise, et de se jeter dans les bras du
capitalisme occidental. Après être revenu sur les évènements ayant marqué l’histoire
récente de Taiwan, le Taïwanais Wang T’uo (王拓) fait le constat suivant :
生活在台灣的文學作家,便在這種縱的方面割斷了自己的民族傳統,橫的方面卻又盲目
的放開胸懷吸收西方資本主義的思想和價值觀念的情形下,開始了他們盲目模仿和抄襲西
方文學的寫作路線了。20
[Les écrivains vivant à Taïwan, pour ce qui est du Nord au Sud, ont rompu avec leur propre
tradition nationale, mais pour ce qui est d’Ouest en Est, dans la mesure où ils ont aveuglement ouvert
les bras aux courants de pensée capitalistes occidentaux et à leurs valeurs, ils ont commencé à imiter et
à recopier les lignes d’écriture de la littérature occidentale.]
On voit ici que la controverse de la littérature du terroir vient tout d’abord d’un
refus de l’influence culturelle occidentale (états-unienne) en particulier. Comme
l’explique Arif Dirlik, l’anti-modernisme permet au local (le « terroir ») d’être perçu
19 Ch’en Fang-ming 陳芳明, Houzhimin Taiwan : wenxue shi lun ji qi zhoubian 後殖民台灣-文學史論
及其周邊 [Taiwan postcolonial : discussions sur l’histoire littéraire et ses marges], Taipei, Maitian chubanshe, 2002, p.92. 20 Wang T’uo 王拓, « Shi xianshi zhuyi wenxue, bu shi xiangtu wenxue » 是現實主義文學,不是
「鄉土文學」 [C’est la littérature réaliste, non la littérature du « terroir »], in Yu Tian-cong 尉天驄,
Xiangtu wenxue taolunji, 鄉土文學討論集 [Anthologie de discussions sur la littérature du terroir], Taipei,
Yuanjing, 1978, p.110.
24
comme un moyen d’échapper aux ravages de la modernité en créant un lieu de
résistance21, et pour Wang T’uo, le terroir inclut non seulement la campagne, les
villages d’ouvriers et de pêcheurs, mais ne peut se permettre dans le même temps
d’exclure les villes taïwanaises, tout aussi susceptibles selon lui de recevoir et de lutter
contre l’influence du capitalisme occidental22.
On retrouve une analyse très proche chez l’écrivain Ch’en Ying-chen (陳映真),
pourtant influencé à ses débuts par les auteurs modernistes occidentaux :
文化上精神上對西方的附庸化,殖民地化-這就是我們三十年來精神生活突出的特點。
23
[Ces trente dernières années, la vassalisation et la colonisation culturelle et spirituelle de l’Occident
constituent une caractéristique proéminente de notre vie intellectuelle.]
La littérature pour Ch’en Ying-chen se doit de plus d’être politique, sociale, et
proche des classes sociales défavorisées, cependant il diffère de Wang T’uo dans la
mesure où celui-ci réfute l’idée d’une littérature taïwanaise possédant une particularité
distincte de la Chine continentale taïwanaise. Pour lui le social-réalisme littéraire
taïwanais s’inscrit dans la même tradition que la littérature socialiste chinoise : une
littérature nationale, antiféodale et anti-impérialiste24.
Une troisième perception du terroir est à l’œuvre chez l’écrivain et critique
littéraire Yeh Shih-tao (葉石濤), qui se concentre plus sur l’expérience locale et
historique de l’île de Taïwan, qui pour lui est le fondement d’une particularité
21 Arif Dirlik, « The Global in the Local », in Bill Ashcroft, Gareth Griffiths, Helen Tiffin, The Post-Colonial Studies Reader, New York, Routledge, 2006, p.464. 22 Wang T’uo, « Shi xianshi zhuyi wenxue, bu shi xiangtu wenxue », p.110. 23 Ch’en Ying-chen 陳映真, « Wenxue laizi shehui, wenxue fanying shehui » 文學來自社會,文學反
映社會 [La littérature vient de la société, la littérature reflète la société] in Yu Tian-cong, Xiangtu
wenxue taolunji, p.61. 24 Hsu Nan-cun 許南村 (Ch’en Ying-chen), « « Xiangtu wenxue » de mangdian » 「鄉土文學」的盲
點 [Le scotome de la « littérature du terroir »], Yu Tian-cong, Xiangtu wenxue taolunji, pp.93-99.
25
taïwanaise (taiwan teshuxing 台灣特殊性), qui diffère de l’universalité chinoise (zhongguo
pubianxing中國的普遍性) :
[…] 那便是臺灣的鄉土文學應該是以「台灣為中心」寫出來的作品;換言之,它應該是
站在台灣的立場來視整個世界的作品。25
[[…] La littérature du terroir taïwanais doit donc être composée d’œuvres prenant « Taïwan » pour
centre, autrement dit, d’œuvres qui doivent regarder le monde avec un point de vue taïwanais.]
A travers ces quelques mots, on peut comprendre de façon claire le point de vue
de Yeh Shih-tao. Pour Yeh, la particularité principale de Taiwan réside dans le fait
qu’elle a été séparée de la Chine, pendant très longtemps, et que leurs histoires et leurs
consciences (yishi意識), du fait de la particularité du lieu, diffèrent.
A un moment où les intellectuels taïwanais sont encore sous la menace de la loi
martiale et où le discours dominant est sinocentré, Yeh prône prudemment une
désinisation (qu zhongguohua去中國化) de la littérature taïwanaise, bien que celle-ci ne
puisse être pleinement exprimée dans son article, car sous la menace de la censure
officielle. Pour Yeh, la taïwanité est une conscience d’être, taïwanaise et locale, par
opposition à celle chinoise et centralisée.
Les réactions officielles ne tardent d’ailleurs pas à venir, et deux figures littéraires
de l’époque, P’eng Ko (彭歌) et Yu Kwang-chung (余光中) se chargent de critiquer
les partisans du terroir, en dénonçant leurs idéologies marxisantes déviantes et
dangereuses 26 . On peut dès alors se rendre compte de la véritable subversion
25 Ye Shi-tao 葉石濤, « Taiwan xiangtu wenxue shi daolun » 台灣鄉土文學史導論 [Introduction à
l’histoire de la littérature du terroir taïwanais], in Yu Tian-cong, Xiangtu wenxue taolunji, p.69. 26 P’eng Ko 彭歌, « Bu tan renxing, he you wenxue? » 不談人性,何有文學 ? [Comment y a-t-il de
littérature si on ne parle pas d’humanité?], Lianhe fukan 聯合副刊, août 1977, pp. 245-263 et Yu
Kwang-chung 余光中, « Lang lai le» 狼來了 [Au loup !], in Yu Tian-cong, Xiangtu wenxue taolunji,
pp.264-267.
26
(politique) de la littérature du terroir. Plus qu’un mouvement conservateur de retour
aux « racines », elle n’hésite pas à prôner une littérature militante et elle se place de
plus en opposition avec la lecture officielle Nationaliste de l’histoire. Les points de
vue idéologiques s’affrontent alors entre partisans du terroir et écrivains plus proches
du gouvernement, mais aussi à l’intérieur même des défenseurs du terroir, sur la
question de l’identité taïwanaise par rapport à la Chine27.
Sung-sheng Yvonne Chang détache cependant trois objectifs communs que
proclament les différents partisans du discours du terroir : 1. la destruction du mythe
politique Nationaliste sur la reconquête du continent, 2. la dénonciation des valeurs
capitalistes et bourgeoises, et 3. le refus de l’impérialisme culturel occidental (sous la
forme du Modernisme littéraire, entre autres)28.
Face à une littérature Nationaliste proclamant la renaissance de la culture d’une
Chine mythifiée et face aux écrivains modernistes, plus enclins à piocher dans le style
des écrivains modernistes occidentaux, la littérature du terroir prône donc une
littérature de l’ « ici » et du « maintenant » (ou éventuellement, du passé récent), ainsi
qu’une reconquête de la langue.
La polémique de la littérature du terroir dans les années 1977-1978 reste
cependant assez évasive sur l’idée d’une « identité taïwanaise » radicalement distincte
par rapport à l’ « identité chinoise », en raison d’un contrôle gouvernemental encore
très dur et d’un manque d’espace pour ce genre de réflexion. Mais cette polémique
enfonce la porte des tabous qui ouvre sur l’interprétation historique officielle, et en
cela, elle prépare à une grande remise en question de la légitimité et de la définition de
la littérature taïwanaise dans le début des années 80. Dès lors, pour certains le terme
27 Le taïwanais You Sheng-guan 游勝冠 classifie les partisans du terroir en trois groupes : 1) les
défenseurs d’une tradition du terroir taïwanaise (Ye Shi-tao), 2) les nationalistes chinois (Ch’en Ying-chen) et 3) les partisans d’une littérature réaliste (Wang T’uo) : voir You Sheng-guan, Taiwan wenxue bentulun de xingqi yu fazhan, pp.400 28 Sung-Sheng Yvonne Chang, Modernism and the Nativist Resistance, Contemporary Chinese Fiction from Taiwan, p.2.
27
de « littérature du terroir taïwanais » (taiwan xiangtu wenxue 台灣鄉土文學) est une
manière politiquement correcte de parler de « littérature taïwanaise » (taiwan wenxue台
灣文學)29. Si dans les années 70, le « terroir » s’apparente à l’expérience particulière
du « local Taiwan » à l’intérieur du « global Chine », on aperçoit chez les écrivains du
terroir des années 80, un élargissement du sens du « terroir », non plus perçu comme
lieu reculé, comme « campagne » par opposition à la ville, mais comme lieu d’un
destin commun.
La tendance localiste de la littérature du terroir à la fin des années 70 pose donc
les bases de cette recherche identitaire, qui sera poursuivie dans les années 80, thème
qu’on retrouve largement dans les œuvres de Wang Chen-ho. Et comme le rappelle
justement Mark Harrison :
Localism is not explicitly Taiwanese nationalism, in that it did not imagine the ‘local’ in Taiwan in
national terms, but is a bounded and structured discourse producing a narrative of the meaning of
Taiwan.30
[Le localisme n’est pas explicitement un nationalisme taïwanais, en cela qu’il n’imagine pas le
« local » à Taiwan en termes nationaux, mais c’est un discours délimité et structuré, créant un sens
narratif de Taïwan.]
C’est en cela qu’on peut dire que la littérature du terroir envisage une « idée de
Taiwan », exprimée ou non en terme national, mais assurément comme détentrice
d’un espace-temps narratif particulier. C’est justement ce qui nous intéresse ici dans le
cas de Wang Chen-ho.
29 Ch’en Fang-ming, Houzhimin Taiwan : wenxue shi lun ji qi zhoubian, p.104. Pour une analyse du changement des discours du « terroir » des années 70 aux années 80, on peut aussi consulter Lu Cheng-
hui呂正惠, « Qi, ba shi niandai taiwan xiangtu wenxue de yuanliu yu bianqian »七、八十年代台灣鄉
土文學的源流與變遷 [Les sources et les transformations de la littérature taïwanaise du terroir dans
les années 70-80], in Lu Cheng-hui, Wenxue jingdian yu wenhua rentong文學經典與文化認同 [Classiques
littéraires et identité culturelle], Taipei, Jiuge chubanshe, 1995, pp.65-85, spécialement les pages 78-85. 30 Mark Harrison, « Writing Taiwan’s Nationhood », in Fang-Long Shih, Stuart Thompson and Paul-François Tremlett, Re-Writing Culture in Taiwan, New York, Routledge, 2009, p.132.
28
4. Wang Chen-ho et Rose, Rose, I Love You
Cette présentation succincte du contexte littéraire des années 60-80 à Taiwan nous
permet de mieux comprendre l’évolution des nouvelles et des romans de Wang Chen-
ho. Avant de s’intéresser directement au roman Rose, Rose, I Love You, il est utile
d’effectuer une présentation de l’auteur et de son parcours littéraire.
Wang Chen-ho (1940-1990) est né dans le comté de Hualian (Hualian xian 花蓮
縣). Il intègre le département de langues et littératures étrangères de l’Université
Nationale de Taiwan en 1959, et en ressortira diplômé en 1963. Entre-temps, il publie
sa première œuvre, « Le fantôme, le vent du Nord et l’homme » (gui. beifeng. ren 鬼‧
北風‧人) en 1961.
Il exerce alors diverses professions : professeur d’anglais dans un collège de
Hualian (花蓮), employé dans l’entreprise d’aéronautique de Cathay Pacific, puis
enfin travaille dans le domaine de la diffusion télévisuelle. Si l’art télévisuel aura une
influence sur ses œuvres31, c’est surtout du cinéma, et en particulier des metteurs en
scène japonais Yasujiro Ozu, et suédois Ingmar Bergman que Wang Chen-ho se
réclame32.
31 Jeffrey C. Kinkley, « Mandarin Kitsch and Taiwanese Kitsch in the Fiction of Wang Chen-ho », Modern Chinese Literature, Vol.6, 1992, pp.95-97. 32Wang Chen-ho 王禎和, Xianggelila 香格里拉 [Shangri-La], Taipei, Hongfan shudian, 1970, pp.1-3
Dans la préface de cette anthologie de nouvelles, Wang fait part de son admiration pour Ozu, et de la grande influence qu’il exerce sur ses œuvres. Wang a également traduit l’autobiographie d’Ingrid
Bergman en chinois : Ingrid Bergman and Alan Burgess, Yinggeli Baoman zihuan 英格麗褒曼自傳 [Autobiographie d’Ingrid Bergman], trad. de l’anglais par Wang Chen-ho, Taipei, Yuanjing, 1985 En plus d’être critique, Wang Chen-ho est aussi parfois scénariste. Ainsi, Rose, Rose, I Love You remporte le 22ème « Cheval de Bronze» de la meilleure adaptation en scénario au festival des Golden
Horse Awards de Taiwan (二十二屆金馬獎最佳改編劇本) en 1985. Le film, sorti en 1985, est réalisé
par Zhang Mei-jun 張美君, le film est cependant ignoré par la critique et le public, qui lui préfèrent un
autre roman de Wang adapté au cinéma : « Un char à bœufs pour dot » (jiazhuang yi niu che 嫁妝一牛
車), du même réalisateur, mais avec l’écrivain Hwang Chun-ming comme scénariste, qui obtient en
29
Dès 1979, il est atteint du cancer du nasopharynx, maladie contre laquelle il lutte
jusqu’en 1990, où il meurt à l’âge de 50 ans. Cette longue période de maladie affaiblit
Wang, mais ne l’empêche pas d’écrire et il signera, ces années durant, quelques unes
de ses meilleures œuvres.
Dans les années 60, Wang Chen-ho commence à publier ses premiers travaux
dans la revue Littérature Moderne, et ceux-ci sont fortement marqués de l’influence
moderniste occidentale, notamment de Joyce, Faulkner et les pièces de théâtre du
britannique David Herbert Lawrence et de l’états-unien Eugene O’Neill33. Un peu
plus tard, au milieu des années 60, sous l’égide de Yu Tian-cong (尉天驄), est créée
une nouvelle revue, Trimestriel Littéraire (wenxue jikan 文學季刊), dont la plupart de
ceux qui y publient sont plus ou moins reliés au mouvement de la littérature du terroir.
Y paraissent ainsi des œuvres de Wang T’uo, Ch’en Ying-chen, Hwang Chun-ming
(黃春明) ou encore… Wang Chen-Ho.
Celui-ci écrit dans les années 60 et 70 pour l’immense majorité des nouvelles,
telles que « Le fantôme, le vent du Nord et l’homme », « Rouge solitaire » (jimo hong寂
寞紅) (1963), « Un char à bœufs pour dot » (jiazhuang yi niu che嫁妝一牛車) (1967)
« L’histoire des trois printemps » (三春記) (1968), « Hsiao-Lin vient à Taipei » (xiaolin
lai taibei 小林來台北) (1973) « Su-lai va se marier ! » (sulai yao chujia 素來要出嫁 !)
(1976), « Shangri-La » (xianggelila香格里拉) (1979) (pour la liste complète des œuvres
de Wang, voir l’annexe 1). Parmi celles-ci la plus étudiée est sans contexte « Un char à
1985 le prix de la meilleure œuvre dramatique au Festival de la télévision asiatique (yatai yingzhan亞太
影展) (pour plus d’informations, voir :
http://cinema.nccu.edu.tw/cinemaV2/film_show.htm?SID=1396 http://www.goldenhorse.org.tw/gh_tc/gh/gh-6.aspx?year=1985 http://taiwanreview.nat.gov.tw/fp.asp?xItem=30766&CtNode=205 : sites consultés le 19 mai 2010.) 33Voir Pai Hsien-yung 白先勇, « Hualian fengtu renwu zhi » 花蓮風土人物誌 [Annales des coutumes
et des personnages de Hualian], in Gao Quan-zhi高全之, Wang chen-ho de xiaoshuo shijie王禎和的小說
藝術 [Le monde des romans de Wang Chen-ho], Taipei, Sanmin Shuju, 1997, pp.1-21. Il est également
important de souligner aussi l’influence d’auteurs chinois continentaux sur Wang, tels que le
dramaturge Cao Yu (曹禺), l’écrivain Lin Yutang (林語堂) ou l’écrivain Zhang Ailing (張愛玲).
30
bœufs pour dot » où Wang Chen-ho dresse le portrait d’un pauvre conducteur de char
à bœufs, à moitié sourd, que sa femme trompe avec un voisin récemment installé près
de chez eux. Ce genre d’histoires est un fait une récurrence chez Wang Chen-ho, qui
contrairement à d’autres écrivains de la tendance du terroir (comme Hwang Chun-
ming par exemple), préfère enlaidir ses personnages, faire ressortir leurs défauts
physiques et l’absurdité de leur existence. Ne nous trompons pas, il ne s’agit pas là de
cynisme, mais d’une forme particulière d’humanisme, la laideur et le tragique des
personnages étant plus directs, inspirant en même temps le rire et la pitié34.
Une autre particularité de Wang Chen-ho est que la trame de ses récits se déroule
dans l’immense majorité dans la ville ou dans le comté de Hualian, hormis peut-être la
nouvelle « Hsiao-lin vient à Taipei » et le roman Portrait des gens beaux (meiren tu 美人圖)
(1982), mais qui traite d’un jeune homme de Hualian, Hsiao-lin qui travaille à Taipei.
En cela, il est la plupart du temps « classifié » comme écrivain du terroir35. Cependant,
malgré ses accointances avec la littérature du terroir, sa tendance à parler des « petits-
personnages » (xiao renwu小人物) de la campagne et à utiliser abondamment du taigi,
l’écriture de Wang reste profondément marquée du style moderniste, et selon Pai
Hsien-yung, Wang Chen-ho est la preuve que « terroir » et modernisme ne sont pas
nécessairement antinomiques36. Pour les critiques du terroir, modernisme littéraire et
impérialisme culturel occidental sont inséparables. Cependant, et Sung-sheng Yvonne
Chang le rappelle justement, « [A Taïwan], les appropriations du modernisme
occidental se produisent exclusivement à des niveaux linguistiques et stylistiques, mais
34 Pour des études sur les premières nouvelles de Wang Chen-ho, voir entre autres Gao Quan-zhi 高全
之, Wang chen-ho de xiaoshuo shijie 王禎和的小說世界 [Le monde des romans de Wang Chen-ho],
Taipei, Sanmin Shuju, 1997, ou encore Sung-Sheng Yvonne Chang, Modernism and the Nativist Resistance, Contemporary Chinese Fiction from Taiwan, pp.67-81. 35 Pai Hsien-yung, « Hualian fengtu renwu zhi », p.10. 36 Pai Hsien-yung, « Hualian fengtu renwu zhi », pp.10-12.
31
avec un contenu et un contexte culturel et historique très différent. 37» De même,
l’utilisation du modernisme en littérature peut être une manière de « faire irruption
dans la modernité, c’est-à-dire se servir des techniques modernes en littérature et
participer aux débats linguistiques, le tout dans une lucidité libératrice ; il faut
exploiter la thématique de l’existence et ne rien rejeter de la mosaïque culturelle […]38».
Outre les diverses influences modernistes occidentales, la visite de Wang dans
l’Université d’Iowa en 1972, aux Etats-Unis, marquera de son empreinte les œuvres
suivantes de celui-ci. C’est d’ailleurs de retour des Etats-Unis qu’il commence à écrire
« Hsiao-lin vient à Taipei » 39 . La nouvelle « Hsiao-lin vient à Taipei » marque un
tournant dans la carrière littéraire de Wang Chen-Ho, on aperçoit désormais dans les
œuvres qui lui succèdent des préoccupations plus sociales, à un niveau plus large que
la simple campagne de Hualian. De même, les personnages ne sont plus
nécessairement pauvres et opprimés, au contraire, Wang commence à décrire des
personnages de la classe moyenne ou de la classe aisée, des hommes d’affaires,
professeurs, médecins, avocats, etc. Au même moment, l’écrivain Hwang Chun-ming,
souvent associé à Wang, connaît également un tournant similaire dans les années 80,
en passant d’une littérature tournée sur les petits personnages vivant à la campagne, à
des préoccupations plus sociales, notamment la question du rapport avec les Etats-
Unis. Ainsi, « Le goût des pommes » (pingguo de ziwei蘋果的滋味)40 et plus encore « I
love Mary » (wo ai mali我愛瑪莉)41, écrites respectivement en 1972 et en 1979 marque
aussi un tournant dans l’œuvre de Hwang Chun-ming, puisqu’il s’intéresse au rapport
37 Sung-sheng Yvonne Chang, Modernism and the Nativist Resistance, Contemporary Chinese Fiction from Taiwan, p.5. 38 Katia Levesque, Entre tradition d’oraliture créole et tradition littéraire française, Québec, Nota Bene, 2005, p.87. 39 Wang Chen-ho 王禎和, « Xiaolin lai Taibei », 小林來台北 [Hsiao-lin vient à Taipei], Wenxue jikan,
文學季刊 [Trimestriel littéraire], octobre 1973. 40 Hwang Chun-ming 黃春明, « Pingguo de ziwei »蘋果的滋味 [Le goût des pommes], Erzi de da
wan’ou兒子的大玩偶 [Le pantin de son fils], Taipei, Huangguan chubanshe, 2000 (1972), pp.41-73. 41 Hwang Chun-ming 黃春明, Wo ai mali 我愛瑪莉 [I Love Mary], Taipei, Yuanjing, 1979.
32
entre le discours du colonisateur (états-unien) et l’attitude du colonisé (taïwanais)42. Il
est intéressant de noter que deux écrivains traditionnellement associés à la littérature
nativiste connaissent au même moment, ou presque, un changement aussi significatif
dans leurs préoccupations littéraires. « Hsiao-lin vient à Taipei » marque également le
début d’une écriture encore plus corrosive, satirique, avec un sens politique plus
marqué, notamment dans la relation avec l’hégémonie culturelle états-unienne et
japonaise. Ce changement dans les préoccupations de Wang est également à associer
avec les différents évènements politiques de Taiwan précédemment introduits. Le
roman Portrait des gens beaux, qui paraît en 1982 est une prolongation de la nouvelle
« Hsiao-lin vient à Taipei » qui raconte l’histoire du personnage Hsiao-lin, venant à
Taipei pour travailler dans une entreprise d’aéronautique et qui s’aperçoit du
comportement mimétique de ses collègues par rapport aux états-uniens. Ce roman à
la fois ironique et grotesque (le sexe et le corps prennent une image essentielle dans le
récit), est une première expérience d’un nouveau genre au roman qui nous intéresse,
Rose, Rose, I Love You, publié lui en 1984.
Avant de s’intéresser au contenu et au style du roman, il est intéressant de noter
que le roman reçut un accueil critique mitigé à sa sortie, et qu’il fut l’objet de plusieurs
scandales43.
On reproche ainsi à Rose, Rose, I Love You deux aspects principaux : tout d’abord,
au niveau de la forme, le roman est balayé de l’utilisation de différentes langues
(mandarin, taigi, chinois classique, japonais, anglais…) et pour certains, le lecteur ne
42 Pour une interprétation de la nouvelle I Love Mary, voir notre deuxième partie. 43 Tung Nien 東年 effectue un bon résumé des polémiques autour du livre dans : Tung Nien東年,
« Meiguo meiguo wo ai ni : naoju « Meigui meigui wo ai ni » de huangmiu yuyi » 美國美國我愛你 -
鬧劇《玫瑰玫瑰我愛你》的荒謬寓意 [USA, USA, I Love You : allusions absurdes dans la farce
« Rose, Rose, I Love You »], Unitas 聯合文學, n°74, décembre 1990, pp.33-36.
33
peut pas supporter ce véritable « handicap de lecture » (yuedu zhang’ai 閱讀障礙)44 ;
pour la critique Lung Ying-tai (龍應台), Wang fait trop étalage de ses connaissances
linguistiques et celle-ci condamne les mesquineries (xiao congming小聰明) du langage
dans Rose45. Au niveau du contenu, on doit bien avouer que Rose, Rose, I Love You est
plus qu’un roman burlesque, ou qu’une farce politique, c’est aussi un roman parsemé
de références sexuelles et scatologiques (pour exemple, le personnage principal, Dong
Si-wen est atteint de flatulences régulières (pp.17-18) et c’est aussi un masturbateur
expérimenté (63-65)46, le docteur Yun quant à lui est amateur de jeunes éphèbes sur
qui il pratique des attouchements sexuels dans son cabinet (115-119)…), de plus le
langage du roman est empli de références scatologiques, d’injures, et de mots
détournés de leur propre sens pour avoir une signification sexuelle (nous reviendrons
particulièrement sur le vocabulaire grotesque de l’œuvre dans la dernière partie de
notre étude).
Le critique Lu Cheng-hui (呂正惠) reproche donc à Rose un certain manque de
« morale » (daode 道德)47, tandis que Lung estime que l’exagération sans commune
mesure du roman empêche le lecteur de s’identifier au récit, et que de cette entreprise
résulte une « blague pas drôle » en affirmant qu’il ne faut pas laisser Wang Chen-ho
« faire fausse route » 48.
44 Lu Cheng-hui 呂正惠, « Huangmiu de huaji ju : Wang Chen-ho de rensheng tuxiang »荒謬的滑稽
劇:王禎和的人生圖像 [L’absurde comédie burlesque : Portrait de la vie de Wang Chen-ho],
Wenxing 文星, n°109, 1987, pp-32-36. 45 Lung Ying-tai 龍瀛台, « Wang Chen-ho zou cuo lu le » 王禎和走錯路了 [Wang Chen-ho a fait
fausse route], Long yingtai ping xiaoshuo 龍應台評小說, [Critique de romans par Lung Ying-tai], Taipei,
Erya Congshu, 1986, p.82. 46 Les numéros de page entre parenthèses (exemple : (65-66)) renvoient aux pages de Wang Chen-ho
王禎和, Meigui meigui wo ai ni玫瑰玫瑰我愛你 [Rose, Rose, I Love You], Taipei, Hongfan Shudian,
1994 (1984). 47 Lu Cheng-hui, « Huangmiu de huaji ju : Wang Chen-ho de rensheng tuxiang », p.34. 48 Lung Ying-tai, « Wang zhenhe zou cuo lu le », p.82. Cette vision est aussi partagée par d’autres
critiques comme Wu Bi-yong吳璧雍 ou Hsu Su-lan 許素蘭. Voir Tung Nien, « Meiguo, meiguo wo ai
ni », p.34.
34
Certains personnages du monde littéraire taïwanais, tels que Tung Nien (東年) et
David Der Wei Wang (王德威) ont pourtant défendu le roman contre ses détracteurs.
Pour David Der Wei Wang, le roman s’inscrit dans la tradition de la comédie chinoise,
et se rapproche de la vision carnavalesque du monde de François Rabelais49. Tung
Nien met lui plus en avant le rapport avec les Etats-Unis dans le roman, et replace
Rose dans son contexte historique, rappelant le caractère subversif de la farce50.
Quant à Wang Chen-ho, il estime que cette critique provient d’une volonté de
« politiquement correct », et lors d’une interview, en 1987, il apporte la réponse
suivante :
只有沒有自由的地方,文藝才標榜路線,才條條框框規定要如何如何,才有「你走錯路
了」的大學報,你說是不是?51
[Il n’y a que dans les lieux sans liberté qu’on fait l’éloge d’une ligne à suivre pour les arts et les
lettres, qu’on décide conventionnellement de règles, qu’on décide de faire comme ci ou comme ça, ou
bien qu’on entend qu’« on a fait fausse route », ne pensez-vous pas ?]
Rose, Rose, I Love You prend en effet un sens politique encore plus fort que dans les
précédentes œuvres de Wang, et celui-ci est parfaitement conscient que son roman
n’est pas seulement une blague salace inoffensive, comme il l’annonce pourtant lui-
même de façon très ironique dès le début du roman :
49 David Der Wei Wang 王德威, « Wang zhenhe zou cuo lu le ma ? »王禎和走錯路了嗎?[Wang
Chen-ho a-t-il fait fausse route ?], Yuedu dangdai xiaoshuo 閱讀當代小說 [Lecture de romans contemporains], Taipei, Yuanliu chubanshe, 1991, pp.21-25, et surtout David Der Wei Wang, « Cong
lao she dao wang zhenhe : xiandai zhongguo xiaoshuo de xinüe qingxiang » 從老舍到王禎和-現代
中國小說的戲謔傾向 [De Lao-she à Wang Chen-ho : la tendance à la blague dans les romans chinois
modernes], Cong liu’e dao wang zhenhe 從劉鶚到王禎和 [De Liu’E à Wang Chen-he], Taipei, Shibao
wenhua chubanshe, 1986, pp.149-182. Wang fait une analyse intéressante de l’humour dans le roman,
mais j’estime que sa tentative replacer Rose dans la grande tradition comique chinoise (celle de Li Yu 李
漁 d’abord, puis de Lao She 老舍) est moins pertinente. 50 Tung Nien, « Meiguo meiguo wo ai ni », p.35. 51Zong Yan-ling et Li Tai-fang 縱燕玲, 李臺芳, « Xunzhao zhenshi de shengyin : fang Wang Chen-
ho » 尋找真實的聲音-訪王禎和 [A la recherche de la voix vraie : interview de Wang Chen-ho],
Taipei Pinglun 台北平論 [Critiques de Taipei], n°1, 1987, p.29.
35
要向大家說明的是: (一) 這是一部「限級」的笑話小說。
(二) 人物情節純屬虛構,請不要考證,因為這鐵定浪費時間的。52
[Voilà deux avertissements destinés à tous : 1. Il s’agit d’un roman-blague destiné à un public averti.
2. Les personnages, de même que l’action de ce roman relèvent complètement de l’invention, ne tentez
donc pas de retrouver leurs origines, car ce serait une perte de temps assurée.]
5. Conclusion
Wang Chen-ho occupe une place particulière dans la littérature taïwanaise des
années 60-80. Issu du modernisme littérature, il ne s’intéresse pas seulement à la
performance artistique de ses nouvelles (comme le sont d’autres écrivains modernistes,
tels que Wang Wen-hsing par exemple 53 ), mais ces œuvres prennent encore une
dimension sociale.
Si Wang ne s’est jamais revendiqué écrivain du terroir, il y est malgré tout associé
de par ses préoccupations du local, du social et du politique. Mais, parmi les écrivains
de cette mouvance, il est sans conteste le plus intéressé par les expériences
linguistiques et stylistiques (ce qui le rapproche parfois d’un Wang Wen-hsing ou d’un
Ch’i Teng-sheng (七等生)), il n’est d’ailleurs pas étrange que parmi les écrivains
modernistes, ce sont l’irlandais James Joyce et l’états-unien (du Sud) William Faulkner
que Wang Che-ho classe parmi ses écrivains favoris54. Dublin pour Joyce, la région du
Mississipi (et son comté (fictif) de Yoknapatawpha) pour Faulkner, Hualian pour
Wang : le point commun entre ces écrivains est l’importance qu’ils accordent au lieu,
52 Wang Chen-ho 王禎和, Meigui meigui wo ai ni 玫瑰玫瑰我愛你 [Rose, Rose, I Love You], Taipei,
Hongfan Shudian, 1994 (1984), p.15. Etrangement, ce passage ne figure pas dans la traduction en anglais de Rose, Rose, I love you par Howard Goldblatt. 53 Sung-sheng Yvonne Chang, Modernism and the Nativist Resistance, Contemporary Chinese Fiction from Taiwan, p.74. 54 Pai Hsien-yung, « Hualian fengtu renwu zhi », p.10.
36
et à la possibilité du local de fournir un langage universel. Kent C. Ryden parle lui de
« sens du lieu » (« meaning of the place ») :
The meaning of a place, for the people who live there is best captured by the stories that they tell
about it, about the elements that comprise it, and about the events that took place within its bounds.55
[Le sens d’un lieu, pour ceux qui y habitent, est le mieux rendu par les histoires qui parlent de lui,
des éléments qui le composent, et des évènements qui prennent place à l’intérieur de ses frontières.]
La particularité de Wang réside dans sa façon de « parler » ce lieu, de rendre
compte de son histoire et de ses particularités, c’est ce qui lui a valu un certain
nombre de critiques, et c’est ce qui va justement nous intéresser dans les deux parties
suivantes de ce travail.
55 Kent C. Ryden, Mapping the Invisible Landscape: Folklore, writing and sense of place, Iowa City, University of Iowa Press, 1993, p.45.
37
III- Rose, Rose, I Love You : une relecture postcoloniale
de l’histoire de Taïwan
« C’est moi qui voudrais les retirer de l’ennui qu’ils s’imposent ainsi par respect pour mon chagrin.
Je devrais par exemple leur conter une histoire. Mais laquelle ? Celle que je sais le mieux et qui me tente
le plus en ce moment est tout à fait semblable à la leur. C’est aux aveugles et à ceux qui se bouchent les
oreilles qu’il me faudrait la crier. 1 » Joseph Zobel, Rue Case-Nègres
1. Introduction
L’historien taïwanais Ch’en Fang-ming (陳芳明) propose de diviser l’histoire de la
nouvelle littérature taïwanaise du XXe siècle en trois grandes périodes : la première
comprise entre 1921 et 1945 est la période coloniale (zhimin shiqi 殖民時期), la
seconde entre 1945 et 1987 (correspondant à l’arrivée du gouvernement Nationaliste
chinois jusqu’à la fin de la loi martiale), est appelée période néocoloniale (ou de
recolonisation : zai zhimin shiqi 再殖民時期 ), et la dernière période, de 1987 à
aujourd’hui, période postcoloniale (houzhimin shiqi後殖民時期)2. Cette périodisation
est toutefois loin de faire l’unanimité dans les cercles littéraires taïwanais3. Notre but
ici n’est pas de débattre sur la pertinence de cette périodisation, cependant nous
1 Joseph Zobel, Rue Case-Nègres, Paris, Présence Africaine, 1974 (1950), p.301. 2 Ch’en Fang-ming陳芳明, « Taiwan xinwenxue shi de jiangou yu fenqi »台灣新文學史的建構與分
期 [Construction et périodisation de l’histoire de la nouvelle littérature taïwanaise], Unitas 聯合文學,
n°178, août 1999, p.67. La périodisation commence en 1921, considérée comme l’année de début de la
« nouvelle littérature taïwanaise » (新台灣文學). 3 La réaction de Ch’en Ying-chen est à ce propos particulièrement virulente. Nous estimons cependant, en accord avec Chiu Kuei-fen que toute la littérature taïwanaise n’est pas résumable uniquement par
des relations de colonisateur à colonisé (voir Chiu Kuei-fen邱貴芬, Houzhimin ji qiwai後殖民及其外
[Le postcolonial et son en-dehors], Taipei, Maitian chubanshe, 2003, pp.111-145.
38
estimons qu’une réflexion postcoloniale existe belle et bien dans la littérature
taïwanaise et qu’elle débute même chez certains auteurs avant 1987 et la fin de la loi
martiale, au début des années 80, face au dévoilement de l’hégémonie culturelle
occidentale, et particulièrement états-unienne. En 1992, Chiu Kuei-fen écrivait
ainsi que Rose, Rose, I Love You avait été écrit avec un « esprit postcolonial » (houzhimin
jingshen後殖民精神)4 . Pour elle :
台灣過去幾百年的歷史、文化、演進,主要基於外來殖民勢力與被殖民者之間文化和語
言衝突、交流的互動模式。5
[Les quelques siècles de l’histoire, de la culture et de l’évolution de Taiwan ont principalement
pour essence les modèles conflictuels et d’échanges mutuels linguistiques et culturels entre colonisés et
forces colonisatrices extérieures.]
A travers son roman Rose, Rose, I Love You, Wang Chen-ho effectue une relecture
historique locale de sa ville de naissance, Hualian, confrontée à l’impérialisme
économique et culturel des Etats-Unis et à travers elle, il porte une réflexion plus
globale sur l’expérience historique de Taïwan.
2. Un retour sur l’histoire locale
Dès la fin des années 70, le domaine littéraire à Taiwan est marqué par une
volonté de relecture de l’histoire de Taïwan. Parmi ces tentatives, on peut noter celle
de l’écrivain hakka Li Ch’iao (李喬) et de sa Trilogie de la nuit d’hiver (hanye san bu qu寒
4 Chiu Kuei-fen 邱貴芬 « 「Faxian taiwan」 : jiangou taiwan houzhimin lunshu » 「發現台灣」建
構台灣後殖民論述 [« Découvrir Taiwan » : construire un discours postcolonial taïwanais], Zhongwai
wenxue 中外文學, vol.21, n 2̈, juillet 1992, p.155. 5 Chiu Kuei-fen, « 「Faxian taiwan」 : jiangou taiwan houzhimin lunshu », p.153.
39
夜三部曲) dont le dernier tome est achevé en 19796, ou encore le cas de Cheng
Ch’ing-wen (鄭清文), et son « Cheval à trois pattes » (sanjiao ma 三腳馬) (1979)7
notamment, deux exemples parmi bien d’autres qui tentent de faire la lumière sur des
épisodes sombres de l’histoire coloniale taïwanaise. Même si le style de Wang Chen-
ho diffère radicalement de celui de Li Ch’iao et de Cheng Ch’ing-wen (plus réalistes,
ceux-ci insistent plus sur les blessures et les cicatrices de l’histoire de Taiwan
colonisée, ils sont également plus radicaux et leur critique politique est souvent plus
directe que celle de Wang Chen-ho), on trouve une même idée chez ces auteurs de
partir des expériences historiques locales pour mieux comprendre l’histoire de l’île de
Taïwan. Chez Wang, malgré l’influence non négligeable des auteurs modernistes
occidentaux qui s’intéressent en majorité à la ville en tant que cité moderne, la
campagne de Hualian, à l’Est de Taïwan, reste le principal terrain de ses expériences
littéraires et les histoires de Wang sont nécessairement liées à elle. Le local est ainsi
une arme pour les écrivains du terroir, dans la mesure où il leur permet de sortir du
cadre historique centralisé : il est l’occasion de raconter l’histoire avec un filtre
alternatif, car le local a la faculté de narrer un moment et un lieu, situés en dehors de
la grande procession nationale de l’histoire8. Ces entreprises peuvent être qualifiées de
postcoloniales dans la mesure où ces écrivains taïwanais de souche ont été privés de
leur histoire, durant quarante années de domination Nationaliste chinoise et tentent
de regarder cette histoire avec un point de vue nouveau, avec le récit d’une histoire
différente, souvent en conflit avec l’histoire officielle9. Cette entreprise de relecture de
6 Li Ch’iao 李喬, Hanye san bu qu 寒夜三部曲 [Trilogie de la nuit d’hiver], Taipei, Yuanjing, 1979. 7 Cheng Ch’ing-wen 鄭清文, « Sanjiao ma » 三腳馬 [Le cheval à trois pattes], Zheng qingwen duanpian
xiaoshuo quanji 3 鄭清文短篇小說全集 3 [Œuvres complètes de Cheng Ch’ing-wen : Nouvelles : Volume 3], Taipei, Maitian chubanshe, 1998 (1979), pp.169-205. 8 Mark Harrison, « Writing Taiwan’s Nationhood », in Fang-Long Shih, Stuart Thompson and Paul-François Tremlett, Re-Writing Culture in Taiwan, New York, Routledge, 2009, p.136. 9 Ainsi, après l’arrivée des Nationalistes du KMT à Taiwan en 1945, la première entreprise fut officiellement de déjaponiser l’île en tentant de faire oublier le passé colonial du peuple de Taïwan, instaurant l’idée d’ « une seule Chine », d’ « une seule culture chinoise », d’« une seule histoire chinoise »,
40
l’histoire « confisquée » n’est d’ailleurs pas exclusive à Taïwan, mais dans le monde
postcolonial dans son ensemble. Dans son analyse des romans du martiniquais
Raphaël Confiant, Katia Levesque rappelle qu’ « […] une autre caractéristique de la
culture postcoloniale, [est] la tendance à se donne[r] une vision de l’histoire
événementielle qui ne correspond pas à celle imposée par les pouvoirs colonisateurs.
10 » De même, pour Frantz Fanon, qui s’intéresse aux intellectuels des pays colonisés,
estime que ceux-ci n’hésitent pas à replonger dans le passé de leur terre, pour
comprendre ce qui échappe à l’analyse historique des colonisateurs et pour y déceler
les prémices d’une culture nationale naissante 11 (parfois même ce mouvement
de retour en arrière ou à des traditions ancestrales est opéré « contre l’histoire, et
contre son peuple lui-même12»).
Ce qu’essaie de dire ou d’inventer la littérature taïwanaise du terroir, c’est d’abord
que l’histoire de l’île de Taiwan n’est pas uniquement une histoire événementielle, ni
non plus une histoire à court terme, la taïwanité dans la littérature taïwanaise en
général tente de s’inventer à travers ce que l’historien français Fernand Braudel
appelle les « trois temps » de l’histoire. Tout d’abord, une histoire dite « immobile »,
« silencieuse » relative au milieu13, (l’insularité de Taïwan, le rôle de la montagne, de la
mer 14 participe à cette histoire « silencieuse », détentrice d’une certaine identité).
et d’ « un seul langage chinois », négligeant ainsi l’expérience taïwanaise éprouvée avant et pendant la colonisation japonaise, voir Ann Heylen, « The legacy of Literacy Practices in Colonial Taiwan. Japanese-Taiwanese-Chinese: Language Interaction and Identity Formation », Journal of Multilingual and Multicultural Development, vol 26: 6, 2005, p.506. 10 Katia Levesque, Entre tradition d’oraliture créole et tradition littéraire française, Québec, Nota Bene, 2005, p.154. 11 « Ce créateur qui décide de décrire la vérité nationale se tourne paradoxalement vers le passé, vers l'inactuel. » Frantz Fanon, Les Damnés de la Terre, Paris, La Découverte, 2002 (1961), p.213. 12 Frantz Fanon, Les Damnés de la Terre, p.213. 13 Fernand Braudel, « Préface », La Méditerranée et le Monde méditerranéen à l'époque de Philippe II, Paris, Colin, 1949, p.13. 14 Ici, il est intéressant de remarquer que récemment, certains chercheurs nationalistes taïwanais
utilisent le terme de « littérature océane » (海洋文學 ) pour définir la littérature taïwanaise et la
rapprocher des littératures et cultures austronésiennes, il s’agit bien sûr d’inscrire la culture taïwanaise dans une tradition différente de celle du continent.
41
Ensuite, une histoire dite « sociale », « celle des groupes et des groupements 15», dans
le cas de Taïwan, on ne peut bien sûr pas négliger l’importance des migrations
humaines, des contacts sociaux entre groupes de différentes cultures. Pour finir,
l’histoire taïwanaise inclurait aussi une forme d’histoire « événementielle 16 », plus
individuelle, une histoire dont les agitations entraînent des modifications inéluctables
sur la longue durée. La recherche de la taïwanité dans la littérature taïwanaise tend à
s’orienter à travers ses différents « plans » de l’histoire : Taiwan en tant qu’île, en tant
que lieu de confluences et en tant que lieu d’expériences individuelles.
Dans Rose, les références au contexte historique (événementiel) du récit (qui se
déroule dans les années 60) sont peu nombreuses, et lorsqu’il y en a, ces « rappels
historiques » sont plus ironiques qu’informatifs. Par exemple, on rappelle que « faire
l’amour, pour une prostituée n’est pas si dur - du moins pas autant - que de tuer des
bandits communistes » (63) (en référence à la guerre entre Nationalistes et
Communistes, et au matraquage de la propagande Nationaliste), ou que « Mao était à
la même époque en train de faire je ne sais quelle Révolution Culturelle » (221). En
dehors de ces rappels événementiels « globaux », on trouve dans Rose de nombreuses
digressions (presque métafictionnelles), de « rappels historiques » du narrateur
(l’écrivain), mais sur des « micro-événements 17 », des changements sociaux qui
paraissent à première vue insignifiants et n’ayant aucun rapport avec l’histoire, comme
par exemple l’évolution des publicités entre les émissions en taigi (145-146),
l’évolution des prix et de la politesse avec les conducteurs de taxis (138), ou encore de
15 Fernand Braudel, « Préface », La Méditerranée et le Monde méditerranéen à l'époque de Philippe II, p.13. 16 Fernand Braudel, « Préface », p.14. 17 L’expression est de Sandrine Marchand : Sandrine Marchand, Sur le fil de la mémoire : Littérature taïwanaise des années 1970-1990, Lyon, Tigre de Papier, 2009, p.86.
42
longues descriptions des changements des toilettes dans les campagnes(14-15, 68)18.
Ces rappels historiques sont ainsi destinés à enraciner le récit dans un contexte
local (celui de la ville de Hualian), afin de plonger dans une mémoire qui n’a pas
nécessairement à première vue une dimension nationale. C’est d’ailleurs tout d’abord
à un exercice de mémoire que Wang s’attèle dans Rose. Avant d’être une farce
hilarante, un roman politique, Rose, Rose, I Love You est d’abord une tentative de
relecture du passé. Après l’écriture du roman, Wang Chen-ho avoua que la tentation
d’écrire ce roman le titillait depuis longtemps, et qu’il passa beaucoup de temps à le
rédiger19.
Dans cette interview, Wang Chen-ho revient sur ses souvenirs de la construction
d’un bar pour les soldats états-uniens à Hualian, lorsqu’il était plus jeune :
記得越南美軍第一次搭軍艦到花蓮度假,全花蓮市都忙碌起來,有的準備歡迎,有的忙
著賺美金,報紙更忙用頭條新聞、花蓮消息報導美軍來臨。[······]酒吧,花蓮人聽都沒聽
過,那裏見過哦![…] 我是不得不虛構,因為我沒有那麼幸運曾參加當年建設酒吧的「光
榮」星列。20
[Je me rappelle quand les GI’s en guerre au Vietnam ont pour la première fois pris leur navire pour
venir passer leur vacances à Hualian : toute la ville était sur le qui-vive, certains étaient occupés à
gagner des dollars, quant aux journaux, ils se dépêchaient de boucler leurs unes, en arrivant l’arrivée des
GI’s. […] Un bar ! Les habitants de Hualian n’en avaient même jamais entendu parler, comment
18 Le passage des toilettes « à la turque » aux toilettes de style « occidental » est d’ailleurs un thème abordé ailleurs chez Wang Chen-ho, ainsi que chez d’autres auteurs du terroir, indiquant le changement
non anodin d’un tel phénomène. Voir Wang Chen-ho 王禎和, «San chun ji » 三春記 [L’histoire des
trois printemps], Xianggelila 香格里拉 [Shangri-la], Taipei, Hongfan shudian, 1980 (1968), pp.1-29 et A
Sheng 阿盛, « Cesuo de gushi » [L’histoire des toilettes], A Sheng jingxuan ji 阿盛精選集 [Sélection des
meilleures œuvres d’A Sheng], Taipei, Jiuge chubanshe, 2004 (1978), pp.294-300. 19 Chiu Yan-ming 丘彥明, « Ba huanxiao saman renjian – fang xiaoshuojia wang zhenhe » 把歡笑撒
滿人間 – 訪小說家王禎和 [Répandre le rire parmi les hommes – Interview de l’écrivain Wang Chen-
ho], Meigui meigui wo ai ni 玫瑰玫瑰我愛你 [Rose, Rose, I Love You], Taipei, Hongfan shudian, 1994
p.255. Wang Chen-ho explique aussi que c’est avec ce roman qu’il rencontra le plus de difficultés (« 我
寫小說以來,遭遇最大的困難就是這部。») 20 Chiu Yan-ming, « Ba huanxiao saman renjian – fang xiaoshuojia wang zhenhe », p.255-256.
43
pouvaient-ils en avoir déjà vu ! [Dans ce roman], je n’ai eu d’autre choix que d’utiliser mon imagination,
car je n’ai hélas pas eu la chance d’entrer cette année-là dans les rangs « glorieux » de la construction du
bar.]
De ce souvenir d’adolescent (dans les années 60, Wang devait avoir entre 18 et 25
ans), reste une impression, une interprétation, à la fois burlesque et critique du
comportement des habitants de Hualian, anticipant l’arrivée des GI’s en construisant
ce bar. Dans Rose, Rose, I Love You, les GI’s n’interviennent d’ailleurs pas une seule fois,
et l’écrivain se sert de sa mémoire et de son imagination pour retranscrire ce qu’il
estimait être le comportement des gens à l’époque. Comme l’explique Maurice
Halbawchs,
Mais alors, ce n’est plus le passé tout entier qui exerce sur nous une pression en vue de pénétrer
dans notre conscience. Ce n’est plus la série chronologique des états passés qui reproduirait exactement
les événements anciens, mais ce sont ceux-là seuls d’entre eux qui correspondent à nos préoccupations
actuelles, qui peuvent réapparaître. 21
On comprend ainsi que le fait de relater, ou plutôt de réinterpréter les événements
qui ont eu lieu à Hualian dans les années 60 est une manière de décortiquer le passé
pour comprendre le présent. Comme nous l’avons vu dans notre première partie, la
littérature du terroir de la fin des années 70 tend à critiquer la manière dont les
intellectuels, les « petits bourgeois » taïwanais copient et imitent les impérialistes
occidentaux. Dans cette même mouvance, mais avec un style plus ironique et corrosif
que mélancolique et nostalgique, Wang Chen-ho engage cette réflexion dès la
nouvelle « Hsiao-lin vient à Taipei » (1973), mais surtout avec son roman Portrait des
gens beaux (1982), qui critiquent tous deux de façon burlesque les employés d’une
21 Maurice Halbawchs, Les cadres sociaux de la mémoire, Paris, Albin Michel, 1994 (1925), p.144.
44
entreprise d’aviation dont le désir ultime est de devenir états-unien. Cependant, dans
Rose, Wang tente un retour de vingt ans en arrière, au moment où l’arrivée des GI’s à
Taiwan marque ce début d’une attirance et d’une imitation prononcée des Taïwanais
pour les Occidentaux.
C’est pourquoi, contrairement à l’analyse de Margaret Hillenbrand 22 , il nous
semble que Wang Chen-ho ne soit pas de ceux qui glorifient le passé du « terroir »,
mais essaie d’en faire une analyse sans concessions (bien qu’évidemment subjective)
pour mieux comprendre le présent dans lequel il se situe. On sent d’ailleurs dans Rose,
Rose, I Love You, le ton ironique, et celui de l’autodérision : le personnage Dong Si-wen
(董斯文) n’est que le double grotesque de Wang Chen-ho : comme lui, il est diplômé
des langues étrangères de Taida, est professeur d’anglais, travaille à la télévision,
idolâtre la culture états-unienne d’une part, mais dans le même temps écrit des articles
nostalgiques sur Hualian, qui « sonnent faux » :
到了台北工作,他便狠是喜歡在報章雜誌發表文章。寫過一篇這樣的散文-「啊啊!我
好懷念花蓮的舊式的廁所啊!尤其夜半人靜那挑糞的鐵杓子觸碰水泥糞坑發出鏗鏘有致的
響音啊!是最使我難以忘耳的美麗音聲。啊啊!現在是怎麼樣也再也聽不見這美麗的響音
了啊!啊啊!只要一記起鐵杓在糞池鏗鏘鏗鏘,我就無端地鄉愁濃濃啊!(這是騙人的。他
根本不是花蓮市人。他是在花蓮光復鄉長大的。) 我就會無端地興起無限的感傷啊!(這也是
騙人的,因他根本不是那種多善感的人。)」-這篇文章雖然滿是啊啊啊!可是啊!得了個
文藝獎啊!23
[Arrivé à Taipei pour travailler, il s’adonnait joyeusement à publier des articles dans les magazines.
Il écrivait des essais de ce style : « Oh, oh ! Comme les vieilles toilettes de Hualian me manquent ! Et
tout spécialement le bruit métallique de la cuillère en acier du ramasseur de crottes lorsqu’il cognait la
fosse en ciment au plein cœur de la nuit calme ! Ce son est pour moi la plus inoubliable des mélodies !
22 Margaret Hillenbrand, Literature, Modernity and the Practice of Resistance: Japanese and Taiwanese fiction, 1960-1990, Leiden, Brill, 2007, p.168. 23 Wang Chen-ho, Meigui, meigui, wo ai ni [Rose, Rose, I Love You], pp.14-15.
45
Oh, oh ! Maintenant, il est tout simplement impossible de réentendre ce son, oh ! Oh, Oh ! Il suffit que
je repense au bruit métallique de la cuillère dans la cuvette pour plonger aussitôt dans une nostalgie
infinie. (Un mensonge. Dong n’était absolument pas originaire de la ville de Hualian. Il avait grandi
dans la commune de la Libération, dans le comté de Hualian.) Je succombe alors à un chagrin sans
limites, oh ! (Encore un mensonge, car il n’était fondamentalement pas du genre sentimental) – bien
que cet article fut parsemé de « Oh ! oh ! oh ! », il obtint tout de même un prix artistique ! Oh !]
Le grotesque est ici de mise, et pour Wang, la nostalgie des écrivains du terroir (et
la sienne) est tout aussi susceptible d’être tournée en dérision que l’idolâtrie de
l’Occident. La relecture du passé de Taiwan implique pour Wang une perpétuelle
remise en question des comportements et des discours 24 ; cependant, le premier
discours visé dans Rose reste celui du capitalisme venu d’Occident et du néo-
colonialisme culturel occidental.
3. Taïwan, Etats-Unis et capitalisme
Dans Rose, Rose, I Love You, les Etats-Unis sont à la fois absents et ultra-présents,
les GI’s n’apparaissent ainsi pas une seule fois en réalité dans le récit, et aucun
personnage états-unien n’est à signaler, tous les personnages étant exclusivement
taïwanais25.
24 Le martiniquais Frantz Fanon a une très jolie formule pour expliquer le plongeon de l’intellectuel dans sa mémoire, et le tournage en dérision de ses comportements passés : « Parce qu’il se sent devenir aliéné, c’est-à-dire le lieu vivant de contradictions qui le menacent d’être insurmontables, le colonisé s’arrache du marais où il risquait de s’enliser et à corps perdu, à cerveau perdu il accepte, il décide d’assumer, il confirme. Le colonisé se découvre tenu de répondre de tout et de tous. Il ne se fait pas seulement le défenseur, il accepte d’être mis avec les autres et dorénavant il peut se permettre de rire de sa lâcheté passée. », Frantz Fanon, Les Damnés de la Terre, pp.263-264. 25 Le récit s’étale d’ailleurs sur une seule journée, et l’utilisation du « courant de conscience » dans un récit temporel très court, n’est pas sans rappeler Ulysse de James Joyce.
46
Cependant, la démesure des habitudes et des comportements « modernes »
occidentaux (provenant des Etats-Unis pour la plupart) sont là pour rappeler la
présence envahissante des géants capitalistes occidentaux à Taïwan. Outre la présence
débordante des mots anglais et des néologismes, les personnages font du tennis (77-
79) et du golf (114), de la chirurgie esthétique (79), fument des Camel et des Kent (21,
40, 79), boivent du Brandy (42) ou du Coca-Cola (160), portent des vêtements Dior
(106) ou lisent la Bible du Roi James (68). Les références à la culture occidentale sont
même parfois plus insolites : le député Qian (錢) (député «Argent ») s’appelle lui-
même 007 (45, 43), l’avocat Zhang est lui comparé à Sherlock Holmes (199) et pour
ce qui est de Dong Si-wen, il lit très souvent le journal en anglais (107, 136), on y fait
même mention de son voyage à Disneyworld lorsqu’il avait 7 ans (20) : cette présence
d’éléments atteste de manière évidente de la présence débordante d’objets issus du
capitalisme occidental à Taïwan.
L’existence de ces nombreux éléments occidentaux à Taiwan n’explique toutefois
pas à elle seule la relation toute particulière qu’entretient avec les Etats-Unis, et il est
nécessaire de rappeler tout d’abord le contexte historique de ce roman26.
En 1951, en pleine Guerre Froide avec l’URSS, les Etats-Unis décident de faire de
Taiwan une base militaire et économique pour contrer le géant communiste chinois,
c’est pourquoi une « aide » financière (meiyuan美援) importante est apportée à Taiwan
par les Etats-Unis ; un total d’un milliard cinq cent millions de dollars est ainsi
« offert » à Taiwan durant les quatorze années de ce programme27 . L’année 1965
26 Jeffrey C. Kinkley voit par exemple dans la présence d’éléments occidentaux dans le roman une certaine forme de « kitsch », tout comme un élément chinois peut être aussi « kitsch » aux É tats-Unis, il néglige à notre avis les raisons concernant la présence de tels éléments à Taïwan, ainsi que leurs contenus idéologiques. Voir Jeffrey C. Kinkley, « Mandarin Kitsch and Taiwanese Kitsch in the Fiction of Wang Chen-ho », Modern Chinese Literature, Vol.6, 1992, pp.85-112. 27 Tung Nien東年, « Meiguo meiguo wo ai ni : naoju « Meigui meigui wo ai ni » de huangmiu yuyi » 美
國美國我愛你 -鬧劇《玫瑰玫瑰我愛你》的荒謬寓意 [USA, USA, I Love You : allusions
absurdes dans la farce « Rose, Rose, I Love You »], Unitas 聯合文學, n°74, décembre 1990, p.26. Une
47
marque ensuite le début de l’engagement des Etats-Unis dans la Guerre du Vietnam,
et Taiwan devient non seulement une base militaire de retrait, mais aussi un « centre
de vacances » (dujia zhongxin 度假中心 ), grâce au programme dit « R&R »
(Rest&Recreation)28. Ce programme permettait aux soldats états-uniens en guerre au
Vietnam de venir passer leurs vacances à Taiwan (ou en Corée du Sud), où les
attendaient bars et prostituées. Ils seraient ainsi venus plus de 170 000 GI’s états-
uniens à Taiwan entre 1967 et 197029. Certains GI’s parlent à l’époque de Taiwan
comme d’un « paradis de l’éjaculation » (shejing tiantang射精天堂).30
Les écrivains Ch’en Ying-chen, Hwang Chun-ming et Wang Chen-ho tous trois à
leur manière témoignent dans leurs nouvelles et romans de ce phénomène31. Il était
donc évident qu’une telle présence ne se limitait pas à l’afflux massif de produits
étrangers, mais provoquait des bouleversements sociaux majeurs32.
Parmi ceux-ci, celui qui nous intéresse directement, le phénomène social le plus
marquant était sans conteste l’établissement de bars « à l’occidentale » et la
prostitution massive de jeunes taïwanaises. Pour certains opportunistes taïwanais, le
expression est symptomatique de l’époque : les américains fournissent le goudron, les Taïwanais la terre
(美國出打馬膠,臺灣出土腳). 28 Tung Nien, « Meiguo meiguo wo ai ni : naoju « Meigui meigui wo ai ni » de huangmiu yuyi », p.26,
voir aussi Ch’en Chien-chung 陳建忠, Song zelai xiaoshuo yanjiu 宋澤萊小說研究 [Etude des romans
de Song Ze-lai], Qinghua daxue zhongguo wenxue yanjiusuo lunwen 清華大學中國文學研究所論文
http://ws.twl.ncku.edu.tw/hak-chia/t/tan-kian-tiong/sek-su/sek-su.htm,, consulté le 3 avril 2010. 29 Tung Nien, « Meiguo meiguo wo ai ni : naoju « Meigui meigui wo ai ni » de huangmiu yuyi », p.26. 30 Cheng Ch’ian-ju鄭倩如, Shuangmian fanyi – lun wang zhenhe « Meigui meigui wo ai ni » de kua wenhua yu
kua yuji jiaohuan 雙面翻譯-論王禎和《玫瑰玫瑰我愛你》的跨文化與跨語際交換 [Double
traduction – Echanges transculturels et translinguistiques dans Rose, Rose, I Love You de Wang Chen-ho]
Taiwan daxue taiwan wenxue suo lunwen 台灣大學台灣文學所論文, 2008, p.54. 31 Voir par exemple : Hwang Chun-ming, « Xiao guafu » 小寡婦 [Petite veuve], Xiao guafu 小寡婦
[Petite veuve], Taipei, Yuanjing, 1975 (1968), pp.93-213 et Chen Ying-chen陳映真, « Liuyue li de
meiguihua » 六月裏的玫瑰花 [Roses de juin], Shangban zu de yi ri 上班族的一日 [Une journée de
travailleur], Taipei, Renjian chubanshe, 1988 (1967) pp.1-22. 32 Pour une bonne analyse de la présence des forces militaires au Japon et à Taiwan après la seconde guerre mondiale et sa répercussion sociale, voir Margaret Hillenbrand, Literature, Modernity and the Practice of Resistance: Japanese and Taiwanese fiction, 1960-1990, pp.105-133, on peut également avoir une introduction aux relations économiques et politiques entre Taiwan et les É tats-Unis dans : Ramon H. Meyers, « A Unique Relationship », in Ramon H. Meyers, A Unique Relationship : The United States and the Republic of China Under the Taiwan Relations Act, Standford, Hoover Institution Press, 1989, pp.1-24.
48
marché de la prostitution constituait une aubaine pour gagner des « dollars » et se
« faire bien voir » des états-uniens présents à Taïwan. Ces comportements sont
personnalisés dans le roman par les quatre patrons des bordels de Hualian, dans Rose,
Rose, I Love You, qui ne pensent qu’à s’enrichir, par tous les moyens : leur devise est
d’ailleurs « un GI égal un dollar » (yi meijun dengyu yi meijin « 一美軍等於一美金 »)
(27). Ceux-ci sont ainsi capables de tout pour gagner de l’argent, même se faire
injurier (99), tandis que l’un des patrons de bordel, Lion le gros-nez (Dabishi大鼻獅)
est même prêt vendre son fils comme prostitué si « on peut se faire de l’argent avec ! »
(192). Les bordels sont ainsi comparés à la florissante entreprise Datong (大同) de
Taiwan (188), et afin de convaincre les patrons des quatre grands bordels de participer
à la prospérité économique de la nation, Dong explique qu’ouvrir une formation de
prostituées de bars revient simplement à ouvrir une entreprise de production (shechang
zhizao chanpin 設廠製造產品 ) (167), pendant que dans le reste du roman, les
prostituées sont également indifféremment décrites avec le mot « produit » (chanpin產
品) (164, 184). Le capitalisme d’état s’entremêle ainsi chez Wang avec la prostitution.
Prostituer des jeunes taïwanaises revient alors à produire et à vendre un « corps » de la
nation, une marchandise, vente dont le gain présupposé est destiné à la prospérité
économique nationale.
Former des prostituées pour en retirer des dollars reste la trame principale du
roman, et le principal objectif des patrons de bordels. Au départ, ceux-ci
envisageaient « seulement » d’enseigner l’anglais aux prostituées, jusqu’à l’intervention
de Dong Si-wen qui va aller plus loin dans la formation de celles-ci, en prolongeant le
sens idéologique d’une telle entreprise. Il ressort donc du roman une métaphore de
l’impérialisme économique états-unien, mais qui s’entremêle en même temps avec un
néo-capitalisme à échelle humaine.
49
Cependant, il est essentiel de noter que les patrons de bordel sont uniquement
intéressés par les dollars américains, ce qui diffère de Dong Si-wen, non intéressé par
l’argent (212), mais qui voit l’accueil des états-uniens non seulement comme une
mission nationale mais aussi comme un moyen de se mettre au service d’un peuple
plus moderne et plus pur (nous aborderons la question de la pureté et de l’hygiène un
peu plus loin dans notre étude).
L’acharnement de Dong et son enthousiasme débordant dans l’établissement du
bar et sa mise en œuvre s’expliquent par deux raisons : d’une part son attachement à
l’honneur de la nation (37, 38, 143), qui passerait par une reconnaissance de la part
des Etats-Unis (170, 172) et d’autre part par un irrésistible désir mimétique d’imitation
des comportements américains33. Dong ne se contente donc pas d’avoir une habitude,
une hygiène de vie occidentale (17-18), il utilise aussi de nombreuses expressions
anglaises dans ses discours (26, 27, 29, 104, 105, 134, 143) en n’ignorant pas que ses
interlocuteurs n’y comprennent rien, et va même jusqu’à prendre un accent des Etats-
Unis lorsqu’il parle chinois (218), et utilise la grammaire anglaise en chinois :
攻讀外國語文系的他,也許過度用功吧!竟連自己講的國語都躲不掉西潮的影響。談話
的對象知識水平越高,他的話就越似拙劣翻譯小說的詞句,像:多麼胡說-我很高興你跟
我同意-這是我的認為-他不知道他在說什麼-我為你感到很驕傲-我被愉快地累了……
經常自他嘴裡冒出來,常常叫對方聽得又吃力又彆扭,有時還真鴨子聽雷,聽莫懂啦!34
[En raison sans doute d’un investissement trop zélé dans l’apprentissage des langues étrangères, le
mandarin de Dong n’échappait étrangement pas à la vague occidentale. Plus le niveau intellectuel de
son interlocuteur était élevé, plus ses paroles ressemblaient à des expressions tout droit sorties d’un
roman grossièrement traduit : Comme un mensonge ! – Je suis content que tu es d’accord avec moi – Cela est ma
33 Le même genre de comportements est également présent dans Portrait des gens beaux 美人圖(1982)
(Wang Chen-ho 王禎和, Meiren tu 美人圖 [Portrait des gens beaux], Taipei, Hongfan shudian, 1985
(1982)) où les plus fervents disciples du « rêve américain » tentent de participer à un mouvement nationaliste, mais se rétractent finalement, de peur d’être découverts, et que l’on ne leur donne jamais la « carte verte », synonyme de travail aux É tats-Unis. 34 Wang Chen-ho, Meigui, meigui, wo ai ni [Rose, Rose, I Love You], p.17.
50
croyance – Il ne sait pas ce qu’il est en disant – Je me sens fier pour toi – Je suis plaisantemment fatigué... La plupart
du temps, ce qui s’échappait de sa bouche apparaissait pénible et embarrassant à ses interlocuteurs, et
parfois, tel un canard écoutant l’orage, ils n’y comprenaient que couic.]
Pour Dong, la pigmentation de la langue chinoise par la langue anglaise revient à
se métamorphoser soi-même en colonisateur, ou à se maintenir au moins à un degré
plus élevé que ses compatriotes (il ne souhaite parler avec une grammaire anglaise
qu’avec les personnes qu’il estime « intellectuellement » capables de le comprendre, et
on sait dans Rose que Dong maîtrise pourtant parfaitement le chinois mandarin et
parle aussi le taigi)35. On comprend donc que chez Dong Si-wen, l’imitation est, dans
ses comportements et pratiques, un acte intentionnel, présupposant un effort
conscient.
Pour mieux comprendre ce phénomène dans un contexte postcolonial, on peut
une nouvelle fois faire référence à Frantz Fanon : dans son livre Peaux noires, masque
blanc citant Westermann, celui-ci fait la constatation suivante :
Porter des vêtements européens ou des guenilles à la dernière mode, adopter les choses dont
l’Européen fait usage, ses formes extérieures de civilité, fleurir le langage indigène d’expressions
européennes, user de phrases ampoulées en parlant ou en écrivant dans une langue européenne, tout
cela est mis en œuvre pour tenter de parvenir à un sentiment d’égalité avec l’Européen et son mode
d’existence.36
35 Pour le théoricien postcolonialiste indien Hommi Bhabha, « l’imitation est à la fois un processus de reproduction du semblable, impliquant la répétition d’un modèle, et une stratégie de détournement et de subversion, pouvant, de ce fait, constituer une menace à l’ordre social » (voir Hommi Bhabha, « Of Mimicry and Man: the Ambivalence of Colonial Discourse », October, n° 28, 1984, pp. 125-133, et Nélia Dias, « Imitation et Anthropologie », Terrain, 44, 2005, http://terrain.revues.org/index2610.ht, consulté le 2 avril 2010. Mais ici, l’imitation de Dong dans Rose ne renverse aucunement l’ordre social préexistant et participe au contraire à son maintien et son aboutissement. On préférera par conséquent à ce sujet l’analyse de Frantz Fanon. 36 Frantz Fanon, Peau noire, masques blancs, Paris, Editions du Seuil, 1971 (1952), pp.19-20.
51
Mais plus qu’une « singerie de colonisé », malgré son éminent côté absurde et la
plume grotesque de Wang, imiter l’occidental chez Dong réside plus dans une volonté
d’ascension sociale (211) et naît d’un besoin de reconnaissance (143, 191), comme
Fanon l’affirme également, dans le cas de l’homme noir :
Aussi pénible que puisse être pour nous cette constatation, nous sommes obligés de la faire : pour
le Noir, il n’y a qu’un destin. Et il est blanc.37
Ce que Wang Chen-ho dénonce dans le même temps de façon ironique dans Rose,
c’est l’entremêlement des discours nationalistes du gouvernement du KMT, de celui
des colonialistes états-uniens et celui d’« une collaboration » zélée opérée par des
personnages comme Dong Si-wen.
4. Etats-Unis, colonialisme et l’idéologie de la propreté
Le destin de la terre des peuples colonisés est d’être dépouillée, pillée ou encore
violée. Le thème de la prostitution de la femme est par conséquent fréquemment
utilisé dans la littérature taïwanaise et est-asiatique pour servir de métaphore à cette
colonisation du corps et de la terre38. Malgré cela, on s’aperçoit que dans Rose, Rose, I
Love You, il n’y a pas de viol direct de la part des GI’s (absents). Au contraire les corps
féminins sont fournis et présentés en offrande par les Taïwanais eux-mêmes, tout du
moins ceux qui ont le pouvoir de le faire. Le professeur Dong Si-wen représente le
degré le plus élevé de ce paradoxe du colonisé.
37 Frantz Fanon, Peau noire, masques blancs, p.8. 38 Sandrine Marchand, Sur le fil de la mémoire : Littérature taïwanaise des années 1970-1990, p.321 : « Hwang Ch’un-ming associe la colonisation japonaise à la prostitution comme c’est le cas aussi avec la présence de l’armée américaine sur le sol de différents pays d’Asie (Corée, Japon, Vietnam). Cette présence armée a engendré un courant littéraire qui critique la présence du pays ingérant grâce à la métaphore sexuelle : un pays occupé qui tolère cette occupation est un pays qui se prostitue. »
52
La thématique de la prostitution est également récurrente chez un autre écrivain
des années 70-80, Hwang Chun-ming, qui s’est aussi beaucoup posé la question de la
prostitution de la femme comme métaphore de la colonisation états-unienne et
japonaise. Si on sent poindre un désir de révolte chez le personnage principal de
Sayonara, Au revoir ! (shaoyounala.zaijian 莎唷那拉‧再見) 39 qui doit emmener des
clients japonais chez des prostituées taïwanaises, en revanche, Dawei (大胃 : gros
estomac), le personnage principal de I love Mary40 est prêt à abandonner sa femme et
ses enfants pour une chienne…laissée en cadeau par son ancien patron états-unien,
qui a déjà quitté Taïwan, et n’y reviendra plus. Pour celui-ci, Mary (la chienne
américaine) est plus importante que sa propre famille car elle représente le trait
d’union entre sa condition de taïwanais (colonisé) et ce qu’il tend à être (le
colonisateur). pour finir, il finira par tuer involontairement Mary, tentant de la faire
avorter, car enceinte d’un bâtard - donc impropre - chien taïwanais. Cette même idée
est déclinée, même si sous un angle moins tragique, et à première vue plus drôle, dans
Rose, Rose, I Love You, mais la critique n’en est pas moins corrosive.
Dans Rose, les patrons des quatre plus grands bordels de la région de Hualian, ne
trouvant pas de solution pour que les prostituées apprennent un anglais simple et
basique, posent alors leurs espoirs sur les épaules du professeur d’anglais Dong Si-
wen… Au début, celui-ci est réticent à participer à cette « intrigue sexuelle » (seqing
goudang 色情勾當), on est alors loin d’imaginer que plus le projet avance, plus le
professeur Dong est enthousiaste et débordant d’idées, toutes aussi « immorales » les
unes que les autres. De ce simple cours d’anglais naît l’esprit absurde et farceur du
récit. Tout d’abord, l’accueil des GI’s devient une affaire d’honneur national (143,
191). Afin de prévenir tout débordement ou tout faux-pas des prostituées, le
39 Hwang Chun-ming 黃春明, Shayounala, zaijian 莎喲娜拉‧再見 [Sayonara, Au revoir], Taipei,
Yuanjing, 1975. 40 Hwang Chun-ming 黃春明, Wo ai mali, 我愛瑪莉 [I Love Mary], Taipei, Yuanjing, 1979.
53
professeur Dong prévoit de donner des cours de « danse, de chant, d’apprentissage
essentiel des protocoles internationaux, d’esthétique et de maquillage, d’introduction à
la culture américaine, des grandes lignes de la civilisation chinoise, d’hygiène et de
physiologie, de droit, de l’art des cocktails, et de méthode de prière chrétienne » (168)
et les « prostituées » (banü 吧女) prennent désormais l’appellation d’ « étudiantes »
(xueyuan 學員) (159), afin de laisser aux « clients » une « meilleure impression ». Non
content de recruter seulement des jolies jeunes filles, Dong Siwen demandent
également aux patrons des bordels de faire appel à des « mères » d’un certain âge (30-
40 ans) : Dong explique ce recrutement par le fait que les GI’s ayant quitté les Etats-
Unis depuis plusieurs mois, ceux-ci ont peut-être la nostalgie de leurs propres mères ;
dans le même temps, il fait aussi appel à de jeunes hommes, car il a lu dans une étude
que près d’un quart des états-uniens seraient homosexuels (136), et que le chiffre
devrait être « sensiblement le même » dans le cas des GI’s.
Au fil du roman, Dong Si-wen dépasse même son intention première de service
(fuwu 服務) (86-87) pour les GI’s. Les« matières premières » (yuanliao原料) de base du
produit se doivent, selon lui d’être propres et purs (qingjie清潔), et le processus de «
production » doit répondre à des normes d’hygiène drastiques, c’est pourquoi les
étudiantes susceptibles d’être sélectionnées ne doivent présenter aucune trace de
maladies sexuelles. Celles qui réussissent peuvent alors rentrer dans le nouvel hôtel
sélectionné par Dong, répondant aux règles de base de l’hygiène « moderne », afin de
préserver leur propreté (168-170). Dong fixe alors des standards pour la « prostituée
propre » et susceptible d’être offerte en offrande aux GI’s (les seins doivent ni trop
petits, ni trop gros, de la taille, environ des pomelos (wendanyou文旦柚) (93-94), elles
doivent avoir passé leurs périodes des règles (97) etc.). La standardisation de la beauté
et son adaptation en fonction du goût du colonisé (ou comme dans Rose, en fonction
54
de l’ « imagination » qu’on se fait du goût du colonisé) est en effet elle aussi commune
aux peuples colonisés, comme Jean Bernabé, Patrick Chamoiseau et Raphaël Confiant
l’expriment dans leur Eloge de la Créolité :
La francisation nous a forcés à l’autodénigrement : lot commun des colonisés. […] Ce que nous
acceptions beau en nous-mêmes, c’est le peu que l’autre à déclaré beau.41
L’hygiène et la pureté vers laquelle Dong s’efforce de tendre n’est qu’un pendant
de l’idéologie coloniale, la purification revient à « lactifier »42 la race, la rendre plus
blanche, plus propre, plus digne d’être acceptée par les occidentaux, face à la saleté
originelle de la race du colonisé.
[…] 唔知她們身上的每一寸每一分皮肉都是有價錢的,我們怎麼捨得讓她們白瓷瓷的皮
肉 […] 最講究的就是絕不留下任何一絲痕跡,一點證據。43
[[…] elles n’se doutent pas que chaque centimètre, chaque fraction de leur chair a un prix,
comment pourrait-on ne pas désirer rendre leur corps blanc comme la porcelaine ? […] Ce à quoi il fait
faire le plus attention, c’est de ne laisser aucune tâche, aucune preuve.]
我們要盡我們所能讓人家帶一個沒有任何汙染的好印象回家去。OK? 44
[Nous devons faire tout notre possible pour que les gars [les GI’s] ne repartent pas avec une
impression polluée, OK ?]
他又想出什麼新把戲?你聽我說呀!他講好不容易才選出這一批又青春又美麗又衛生又
乾淨的學員,我們應當盡最大的力量來保護她們,不讓她們受到汙染然後把骯髒的傳染給
美軍。45
41 Jean Bernabé, Patrick Chamoiseau et Raphaël Confiant, Eloge de la Créolité, Paris, Gallimard, 1989, p.24. 42 Le mot est de Fanon, voir Frantz Fanon, Peau noire, masques blancs, p.38. 43 Wang Chen-ho, Meigui, meigui, wo ai ni [Rose, Rose, I Love You], pp.88-89. 44 Wang Chen-ho, Meigui, meigui, wo ai ni [Rose, Rose, I Love You], p. 104.
55
[Quelle nouvelle astuce est-il encore allé chercher ? Ecoute bien ! Il a dit qu’il n’avait déjà pas été
facile de dégoter cette troupe d’étudiantes, belles, hygiéniques et propres, et qu’on se devait de faire
tout ce qu’on pouvait pour les protéger, pour ne pas les laisser se faire polluer et transmettre ensuite la
saleté contagieuse aux GI’s.]
La liste de telles citations pourrait s’allonger à l’envie (86, 163, 185). On défend
également aux prostituées de ne coucher avec des chinois (taïwanais) afin d’être
propres (ganjing乾淨) pour servir les GI’s (184). Les prostituées – hormis peut-être la
prostituée aborigène, qui semble être la seule à s’élever contre cette tendance (88, 206,
210) – ne sont d’ailleurs pas contre cette idée, et Ahen (阿恨), la concubine de Lion le
gros-nez, un des patrons d’un des quatre bordels, refuse même de coucher avec lui,
afin de se réserver pour les GI’s. Cette idée du sacrifice « volontaire » est également
présente chez d’autres peuples connaissant la colonisation occidentale, comme dans
les Antilles, dans le roman Rue Case-Nègres du martiniquais Joseph Zobel, une mulâtre,
Mamzelle Andréa fait la remarque suivante :
« Comment voulez-vous que j’aime les nègres et que je sois fière d’en être, me répond-elle,
toujours irritée, quand je les vois tous les jours faire des crasses ! D’ailleurs, sauf ma couleur, je ne suis
pas nègre : j’ai un caractère de Blanc… Et je me demande quel vice a pu pousser ma mère qui état déjà
une belle mulâtresse à faire salir ses draps par un nègre ! » 46
Dans le même temps, on remarque dans Rose la forte présence des références à la
religion catholique : l’entraînement des prostituées s’effectue dans la chapelle de la
Grâce (de’en tang德恩堂), les idées du professeur Dong semblent venir directement
du Ciel (shen lai zhi bi神來之筆, « venues du pinceau de Dieu » (153)). Bien que Wang
45 Wang Chen-ho, Meigui, meigui, wo ai ni [Rose, Rose, I Love You], pp.184. 46 Joseph Zobel, Rue Case-Nègres, p.290. On retrouve cette idée chez Fanon, lorsqu’il étudie le comportement psychologique du colonisé, et de Nini et Mayotte Capécia par exemple, voir Frantz Fanon, Peau noire, masques blancs, pp.42-50.
56
annonce ironiquement dès l’entrée du récit que ce roman n’a aucune valeur de
« critique de la religion catholique, ni d’aucune religion d’ailleurs » (15), on sent un lien
direct entre la purification par la religion (occidentale) et la purification des corps,
lorsque Dong s’adresse aux prostituées :
我非常十分可憐你們啊!所以我要盡我所能救贖你們啊!清潔你們啊 !傾囊相授要成功
地把你們訓練成最具水準的吧女啊!47
[Oh, je vous prends en grande compassion ! C’est pourquoi je dois faire tout mon possible pour
vous obtenir la rédemption ! Vous purifier ! Je vais vous transmettre tout mon savoir pour vous
entraîner et réussir à faire de vous des prostituées de haut niveau !]
Ici, l’idéologie de l’hygiène, de la propreté se confond avec celle, coloniale, de la
modernité, comme l’indique la décision de Dong de « moderniser » les conditions des
« étudiantes » (185).
Dans le même temps, on prie Jésus, et on accueille avec des chants religieux
l’arrivée des soldats états-uniens (200, 252). A ce propos, Chiu Kuei-fen suggère que
le « Croyez en Jésus » (203) s’adresse à l’intermédiaire de Dieu (états-unien) et des
hommes (taïwanais), et qu’il désigne en réalité Dong Si-wen48. Cette idée est encore
plus présente un peu plus loin dans le récit :
「直到永遠,阿門!」這一次董斯文的聲音也高得和牧娘不相上下。不過「阿門」他唸
的是字正腔圓的英文,而不是我們的國語,仿佛不這樣他至誠的祈禱便無以傳到外籍上帝
的耳裏去。49
[« Pour les siècles des siècles, Amen ! » Cette fois, la voix de Dong Si-wen s’était faite à peu près
aussi forte que celle de la mère du prêtre. Mais son « Amen » n’avait pas été prononcé dans notre
47 Wang Chen-ho, Meigui, meigui, wo ai ni [Rose, Rose, I Love You], p.69. 48 Chiu Kuei-fen, « 「Faxian taiwan」 : jiangou taiwan houzhimin lunshu », p.171. 49 Wang Chen-ho, Meigui, meigui, wo ai ni [Rose, Rose, I Love You], p.207.
57
mandarin, mais avec un impeccable accent anglais, comme si la prière sincère qu’il avait adressée n’avait
aucune chance d’atteindre l’oreille du Dieu étranger s’il ne l’avait pas faite ainsi.]
De la même façon, le roman se clôture sur les chansons religieuses chantées par le
chœur des prostituées, accueillant à la fois « le règne éternel » de Dieu, ainsi que les
GI’s états-uniens (252). La cérémonie, ou plutôt le « rite » d’ouverture du bar se
déroule en effet dans l’église, et l’on loue à la fois Dieu, l’établissement du bar et
l’arrivée prochaine des GI’s. et il est aisé de comprendre que chez Wang, la mise au
service des prostituées a un aspect éminemment rituel et religieux, comme si les
Taïwanais décidaient de sacrifier leur corps et leur terroir au Dieu états-unien.
5. Conclusion
Rose, Rose, I Love You peut d’abord être perçu comme la tentative de relecture du
passé colonial de Taïwan, car Wang repose la question de la relation des Etats-Unis et
de Taïwan, notamment lors de la guerre du Vietnam, dans les années 60-70. Ce retour
sur un passé proche, récent, permet à Wang Chen-ho de mieux comprendre le
présent taïwanais, d’en faire une interprétation, et Rose sert de cette façon de
« textualité mémorielle »50 , permettant la fixation d’une mémoire locale, celle de
l’expérience coloniale particulière de la ville de Hualian.
D’autre part, Wang s’attache dans Rose à une véritable analyse des comportements
psychologiques des « colonisés » taïwanais, de même qu’on a vu que les évènements
politiques majeurs des années 70 entraîne les partisans de la « littérature du terroir » à
faire une critique des comportements mimétiques des Taïwanais vis-à-vis de
l’Occident. Frantz Fanon explique lui que « […] c’est par l’intérieur que le Noir va
50 Katia Levesque, Entre tradition d’oraliture créole et tradition littéraire française, p.8.
58
essayer de rejoindre le sanctuaire blanc. L’attitude renvoie à l’intention. 51 » On
pourrait effectuer la même analyse du comportement de Dong Si-wen, dans son
entêtement à se mettre au service des colonisateurs, et dans son zèle farouche, il
espère que par ses tentatives de purification des prostituées, il puisse laisser une
impression indélébile aux clients états-uniens, susceptibles de lui être reconnaissants
plus tard52.
Dans une interview, Wang Chen-ho admet que le roman Rose s’intéresse plus aux
« personnages intermédiaires » (zhongjian renwu 中 間 人 物 ), qu’ « aux petits
personnages » sur lesquels il se penche plus dans ses œuvres précédentes, et le
personnage de Dong Si-wen est justement le représentant de cet intermédiaire entre la
culture du colonisé et du colonisateur53.
La critique des comportements de ces personnages intermédiaires dans Rose reste
cependant destiné à mettre en valeur la vérité d’une histoire, et l’une des motivations
profondes de Wang Chen-ho, est aussi selon son propre aveu d’être le « témoin de
l’histoire, le témoin de son temps » (lishi de jianzheng, shidai de jianzheng歷史的見證、
時代的見證)54.
51 Frantz Fanon, Peau noire, masques blancs, p.41. 52 On observe toujours ce même désir de reconnaissance du corps (je suis presque blanc) et de l’intention (j’agis presque comme un blanc), qui rejoint parfaitement l’analyse de Frantz Fanon, dans le cas de la Martinique. On n’hésite ainsi pas dans Portrait des gens beaux de Wang Chen-ho, à trahir sa « patrie » pour avoir un semblant de reconnaissance états-unien. 53 Chiu Yan-ming, « Ba huanxiao saman renjian – fang xiaoshuojia wang zhenhe », p.259. 54王禎和 Wang Chen-ho, « Yongheng de xunqiu », 永恆的尋求 [La quête perpétuelle], Rensheng de
gewang 人生的歌王 [Le roi des chansons de la vie], Taipei, Lianhe wencong, 1987, p.9.
59
IV- Créolité et cacophonie : la taïwanité comme langage
Qu’importe la langue, quand il faut du cri et de la parole mesurer là l’implant. Dans toute langue autorisée, tu bâtiras ton langage. 1 Edouard Glissant, L’intention poétique
1. Introduction
Le langage et la langue dans Rose sont loin d’être uniquement des outils stylistiques
et linguistiques, le travail sur les langues est une des clés qui permet de rentrer dans le
monde de la littérature de Wang Chen-ho, comme le montrent par ailleurs les
nombreuses études menées à ce niveau non seulement dans Rose, mais aussi dans les
autres œuvres de Wang Chen-ho2.
Dans Rose, Rose, I Love You, comme dans la littérature postcoloniale, «Language is
adopted as a tool and utilized in various ways to express widely differing cultural
experiences.3 » [Le langage est adopté comme outil et utilisé de différentes façons
pour exprimer des expériences culturelles très singulières].
La particularité de l’œuvre de Wang Chen-ho si on le compare avec d’autres
écrivains du terroir, ou d’autres écrivains modernistes taïwanais, se situe véritablement
au niveau de son utilisation du chinois (vernaculaire et classique) et des autres langues
parlées à Taiwan (le taigi, le hakka (kejiahua客家話)…) et les langues qui proviennent
des diverses relations culturelles et historiques du Monde avec l’île, comme l’anglais et
1 Edouard Glissant, L’intention poétique, Paris, Gallimard, 1997 (1969), p.45. 2 Voir par exemple, Cheng Ch’ian-ju鄭倩如, Shuangmian fanyi – lun wang zhenhe « Meigui meigui wo ai ni »
de kua wenhua yu kua yuji jiaohuan 雙面翻譯-論王禎和《玫瑰玫瑰我愛你》的跨文化與跨語際交
換 [Double traduction – Echanges transculturels et translinguistiques dans Rose, Rose, I Love You de
Wang Chen-ho] Taiwan daxue taiwan wenxue suo lunwen 台灣大學台灣文學所論文, 2008. 3 Bill Ashcroft, Gareth Griffiths and Helen Tiffin, The Empire Writes Back: Theory and Practice in Post-colonial Literatures, New York, Routledge, 1989, p.39.
60
le japonais, témoins du vestige colonial de Taïwan. La taïwanité est d’ailleurs plus
qu’une langue (d’ailleurs nous montrerons que si langue il y a, on est loin d’en avoir
une seule), c’est un langage. Comme le rappelle à ce propos justement Chiu Kuei-fen,
la « langue taïwanaise » (taiwan yu 台灣語 ) n’est pas le taigi (台語 ) 4 , la langue
taïwanaise est une composante de plusieurs langues, le taigi y prenant évidemment
une place importante. Pour elle, Rose, Rose, I Love You est le parfait exemple de
l’utilisation de la langue taïwanaise dans sa diversalité :
從後殖民論述的觀點,我們可以說這部小說的語言事實上是台灣幾百年來被殖民歷史的
縮影,融合了台灣的國去、現在、未來,以不同語言的混合代表台灣被殖民史所鎔鑄的跨
文化特質。5
[D’un point de vue postcolonial, on peut dire qu’au niveau linguistique, ce roman [Rose, Rose, I Love
You] est une diapositive des siècles d’histoire coloniale de Taïwan. Par un métissage de différentes
langues, il représente les particularités du moule transculturel de l’histoire coloniale de l’île et fusionne
ainsi son passé, son présent, et son futur.]
Cette transculturalité des langues à Taïwan, leurs échanges, leurs conflits, leurs
interpénétrations avec son histoire coloniale nous rappellent inévitablement les
archipels du monde postcolonial, et avec Edouard Glissant, nous pouvons dire que
l’identité, ou plutôt les identités taïwanaises s’articulent en fonction de leurs relations,
« à l’ici » (au sol, au terroir) et au Monde. On peut alors parler d’ « Identité-Relation »,
ou d’ « Identité-rhizome »6. Pour Glissant, l’identité s’articule par essence autour d’une
4 Chiu Kuei-fen 邱貴芬 « 「Faxian taiwan」 : jiangou taiwan houzhimin lunshu » 「發現台灣」建
構台灣後殖民論述 [« Découvrir Taiwan » : construire un discours postcolonial taïwanais], Zhongwai
wenxue 中外文學, vol.21, n 2̈, juillet 1992, p.155. 5 Chiu Kuei-fen, « 「Faxian taiwan」 : jiangou taiwan houzhimin lunshu », p.167. 6 Edouard Glissant, Traité du Tout-Monde : Poétique IV, Paris, Gallimard, 1997, p.21 : « L’idée de l’identité comme racine unique donne la mesure au nom de laquelle ces communautés furent asservies par d’autres, et au nom de laquelle nombre d’entre elles menèrent leurs luttes de libération. Mais à la racine unique, qui tue alentour, n’oserons-nous pas proposer par élargissement la racine en rhizome, qui ouvre Relation ? Elle n’est pas déracinée : mais elle n’usurpe pas alentour. Sur l’imaginaire de l’identité
61
relation à l’autre, au Monde : l’identité n’est pas fixe et enracinée, elle n’« est » pas, elle
est toujours en mouvement, en devenir. Ce qui nous intéresse donc ici, c’est comment
Wang Chen-ho articule les langues dans Rose, comment celles-ci entretiennent une
relation avec la représentation de l’identité pour Wang, et de quelle manière il poursuit
la quête de ce qu’il appelle la « voix vraie » (zhenshi de shengyin真實的聲音)7.
2. Renverser le monolinguisme et faire naître la Créolité :
traduction et appropriation
Dans la lignée de ce que nous avons vu dans le chapitre précédent, on a pu
observer que Wang porte une interrogation sur les relations entre culture locale et
culture « extérieure », en particulier entre la relation de Taiwan avec les Etats-Unis.
Une des principales caractéristiques de Rose provient de cette description des
déplacements, des appropriations, des incompréhensions provoquées par la mise en
contact des langues et des cultures dans un même lieu : la ville de Hualian. Ce
phénomène est notamment accentué par l’utilisation de la traduction et de la
retraduction des différentes langues en contact8.
Pour Edouard Glissant,
racine-unique, boutons cet imaginaire de l’identité-rhizome. A l’Être qui se pose, montrons l’étant qui s’appose. » p.21. 7王禎和 Wang Chen-ho, « Yongheng de xunqiu », 永恆的尋求 [La quête perpétuelle], Rensheng de
gewang 人生的歌王 [Le roi des chansons de la vie], Taipei, Lianhe wencong, 1987, p.4. Dans cette
préface à son roman Rensheng de gewang, Wang explique que ce qu’il recherche à travers ses romans c’est
donner au lecteur la « vérité entière » (給讀者徹底的真實) p.3, et il indique qu’il ne cesse de chercher
la « voix vraie » (真實的聲音) p.4. 8 Pour une analyse plus poussée sur les méthodes de « traduction » dans Rose, Rose, I Love You, voir Lee
Yu-lin 李育霖, « Fanyi yu difang de shengchan – yi wang zhenhe xiaoshuo « Meigui meigui wo ai ni »
wei li » 翻譯與地方的生產-以王禎和小說《玫瑰玫瑰我愛你》為例 [Traduction et production
du lieu : le cas de Rose, Rose, I Love You de Wang Chen-ho], Fanyi yujing : zhuti, lunli, meixue 翻譯閾境:
主體、倫理、美學 [Liminalité de la traduction : sujet, éthique et esthétique], Taipei, Shulin, 2009,
pp.135-157 et Cheng Ch’ian-ju, Shuangmian fanyi – lun wang zhenhe « Meigui meigui wo ai ni » de kua wenhua yu kua yuji jiaohuan.
62
C’est pour magnifier les échappements que ménage entre langues et langages l’exercice de la
traduction : […] Traduire ne revient pas à réduire une transparence, ni bien entendu à conjoindre deux systèmes de
transparence. Dès lors, cette autre proposition, que l’usage de la traduction nous suggère : d’opposer à la transparence des
modèles l’opacité ouverte des existences non réductibles.9
L’opacité de la traduction est un des procédés mis en œuvre dans le langage
littéraire de Rose, et on observe une perpétuelle retraduction (populaire) des concepts,
des idées, et même des idéologies. Par exemple, ce que dit Dong Si-wen en anglais (et
parfois en chinois même mandarin) est la plupart du temps retraduit par les autres
personnages dans une autre langue, dans laquelle on essaie de trouver un équivalent
(phonétique) à celle-ci. Il est important de noter que la plupart du temps cette
traduction sert le comique et le grotesque du roman.
Ainsi, des mots anglais tels que Cognac sont traduits (en taigi) par « Nique sa
mère » (gan yi nia 幹伊娘) (106), morning par « tripoter les seins » (mo-ning摸奶 : le mot
奶 nai en chinois se prononçant ning en taigi) (155), position par « détruire l’idéal » (po
lixiang 破理想) (164) etc. Un certain nombre de noms en anglais sont également
traduits par des insultes, ou des références au sexe, comme Stella par « meurs ! » (sidiao
la死掉啦 !) ou Ruth par « mort par étranglement » (lesi 勒死), ou la phrase en anglais
My name is Patricia traduit dans un taigi un peu étrange par « t’insulter c’est comme te
frapper jusqu’à ce que tu meurs » (me li dioh si pa li ki si la) 罵你即是打你去死啦)
(237). La traduction de certaines expressions provenant du japonais n’échappe pas
non plus à cette retraduction grotesque (98, 139). Ici, contrairement à l’analyse
d’Edouard Glissant, on est loin d’assister à la « magnification » des échanges de
traduction, mais on peut constater qu’il y a bel et bien destruction de la transparence,
9 Edouard Glissant, Traité du Tout-Monde : Poétique IV, Paris, Gallimard, 1997, p.28-29.
63
les interpénétrations linguistiques ne sont pas égales, les retraductions sont délicates,
mais les contacts entre toutes ces langues sont, comme semble l’indiquer Wang,
inévitables, lui qui utilise aussi des mots en anglais dans la plupart de ses interviews.
La traduction est justement un symbole de la confluence, de l’existence de
contacts culturels et linguistiques complexes, et souvent inégaux. Dans Rose, la ville de
Hualian est justement un véritable lieu de confluences, on y trouve des gens de toute
origine ethnique (des Hoklos, des Hakkas, des Aborigènes, des Continentaux, le
personnage de Sœur Hongmao (hongmao jie紅毛姐 : littéralement « grande sœur aux
cheveux rouges » laisse même penser que celle-ci pourrait être une descendante des
colons hollandais du XVIIe siècle, surnommés « cheveux-rouges » (hongmao紅毛) par
les Taïwanais.). L’expérience historique de certains des personnages est parfois plus
marquée que pour d’autres (pour le personnage de Ahen, on sent le poids linguistique
de la colonisation japonaise d’avant 45, car elle utilise énormément le japonais, pour
Dong Si-wen, c’est l’importance de l’anglais...). De cette multitude d’expériences
historiques, naît une société polyphonique, où s’expriment, à travers plusieurs langues,
ou plusieurs mélanges de langues, des discours différents.
On peut noter ensuite que la polyphonie en œuvre dans le roman Rose, Rose I Love
You est une réaction qui s’inscrit en droite ligne de la « tradition » critique de la
littérature du terroir : on tente de mettre en branle le discours gouvernemental, le
mythe chinois nationaliste et Nationaliste (KMT), enfin, on souhaite lui substituer
l’imaginaire de la langue populaire10. Comme nous l’avons en effet déjà évoqué dans
notre première partie, dès son arrivée à Taïwan, en 1945, la première mesure du
gouvernement Nationaliste chinois fut de déjaponiser l’île en lui substituant
l’imaginaire d’une Chine unie et unique, avec une seule histoire, dont les Taïwanais
10 Chiu Kuei-fen, « Empire of the Chinese Sign: The Question of Chinese Diasporic Imagination in Transnational Literary Production », The Journal of Asian Studies, Vol.67, n°2, mai 2008, pp.593-620.
64
seraient les héritiers, dans la même mesure que les Chinois. Par conséquent, en plus
d’une négation de l’histoire du peuple déjà présent à Taïwan, cette tentative de la part
du gouvernement central priva ce peuple de ses langues. Comme l’exprime très bien
la chercheuse belge Ann Heylen, dans le Taiwan d’après 1945, « Cultural and
linguistics markers were presented as the same and the Taiwanese had little to argue
against. 11 » [Les marqueurs culturels et linguistiques étaient présentés comme un
ensemble et le taïwanais ([ici : le taigi] avait peu pour rivaliser.] La langue taïwanaise
était donc décrétée inférieure, ou imparfaite, par opposition au chinois « standard »
mandarin. Comme on peut le deviner, ce chinois standard mis en place par les
Nationalistes s’étendait également sur les arts et les lettres, et la littérature, la poésie,
les chansons des Taïwanais de souche étaient également perçus comme artistiquement
inférieurs, puisque leurs capacités de s’exprimer en chinois mandarin « standard »
étaient forcément moins élevées que les Chinois continentaux12.
Ainsi, le fils de Lion le gros-nez, qui fait ses études à Taipei est considéré comme
« plus évolué » car il parle le chinois des Continentaux (Waishengren) et utilise leurs
expressions :
幹,人道主義,他奶奶的熊!「他奶奶的熊」什麼意思?那你就要去問我那個讀大專的
兒子了。他們這一輩青年人,比我們進步了,懂斯文了,才不要講什麼「幹伊娘」「他媽
的」,他們現在流行講:他奶奶的熊,你知莫?哼!人道主義!他奶奶的熊!他奶奶的熊
人道主義!幹,唸起來還相當逗句,像在唸詩咧!13
[Putain ! Humanisme ? L’ours de sa grand-mère, oui ! « L’ours de sa grand-mère », qu’est-ce que ça
veut dire ? Eh bien, tu n’as qu’à demander à mon fils, qui est en école supérieure. Leur génération de
11 Ann Heylen, « The legacy of Literacy Practices in Colonial Taiwan. Japanese-Taiwanese-Chinese: Language Interaction and Identity Formation », Journal of Multilingual and Multicultural Development, vol 26, n°6, décembre 2005, p.506. Ann Heylen explique qu’on est en véritable situation « diglossique » à cette époque (p.498). 12 Alan M. Wachman, « Competing Identities in Taiwan », in Dafydd Fell, The Politics of Modern Taiwan, London, Routledge, Vol.1, 2008, p.164. 13 Wang Chen-ho, Meigui, meigui, wo ai ni [Rose, Rose, I Love You], pp.173-174.
65
jeunes est plus évoluée que la nôtre, ils comprennent le raffinement, eux, ils ne disent pas « Nique sa
mère » ou « Merde » comme nous ! La mode, c’est de dire : « l’ours de sa grand-mère », tu piges ? Eh,
humanisme ! L’ours de sa grand-mère oui ! Humanisme de l’ours de sa grand-mère ! Putain, ça sonne
bien ça, on dirait qu’on est en train de réciter un poème !]
Ici, si la traduction de l’injure « l’ours de sa grand-mère » (une expression typique
des Continentaux arrivés à Taiwan après 45) est étrange en français, elle l’est tout
autant pour un Taïwanais de souche, qui ne l’a jamais entendu non plus, mais
puisqu’elle appartient au chinois mandarin standard imposé par le Gouvernement,
cette insulte est considérée comme plus évoluée, plus raffinée. On rejoint là-encore
l’expérience coloniale antillaise, où les expressions en créole (ou dialectales) sont
considérées comme inférieures face au « raffinement suprême » du français14.
Il y a également dans Rose une moquerie plus générale sur le mythe culturel
chinois. Parmi l’une de ses nombreuses digressions, le narrateur indique ainsi qu’on
« a jamais entendu parler de bar à Hualian depuis Pangu »15 (55-56), on y cite encore
Confucius (63), les prostituées posent également en qipao16 (103) pour exciter les
désirs exotiques des GI’s états-uniens, etc.
A travers les sarcasmes sur les mythes culturels chinois Nationalistes, Wang
Chen-ho essaie dans Rose de montrer l’impossibilité d’une mono-langue, d’un chinois
unique. Sung-sheng Yvonne Chang note ainsi justement la « juxtaposition de
14 Frantz Fanon, Peau noire, masques blancs, p.14-16. Fanon explique ainsi qu’ « en France, on dit : parler comme un livre. En Martinique : parler comme un Blanc. » p.16. 15 Pangu 盤古 est un géant mythique chinois, le premier personnage à être sorti du chaos originel, et
dont la mort serait à l’origine de la création du monde. Contrairement à Margaret Hillenbrand (Margaret Hillenbrand, Literature, Modernity and the Practice of Resistance: Japanese and Taiwanese fiction, 1960-1990, p.164), nous estimons que cette digression n’est pas là pour montrer que la venue des occidentaux à Taiwan est une rupture dans l’ordre confucéen, mais manifeste plus d’une volonté de rire du mythe de la Chine éternelle, qui connaîtrait là son premier bouleversement. 16 La qipao (旗袍) est une robe traditionnelle mandchoue, à la mode sous la dynastie des Qing (清).
66
différents langues » dans le roman17. On peut prendre pour exemple les expressions
suivantes :
對啦!有件事得跟你參詳一下!18
[Oui ! Il y a une chose dont je souhaiterais bavasser avec toi !]
擔,你嗎好啊!(這是流行語。「擔」為台音,其他為國語發音) […]19
[Da, t’es zinzin ! (C’était une expression à la mode. « Dan » était prononcé en taigi (da), et le reste
en mandarin.)]
我趕忙解釋這幾位小姐都去美侖檢查檢查身體去啦!-什麼黑白講?不是檢查身體,那
麼是檢查什麼? ?好好好,ㄇㄞˋ講這難聽得。20
[Je suis justement en train de t’expliquer que ces demoiselles étaient allées se faire inspecter à
l’Hôtel Meilun ! Comment ça n’importe quoi ? Si c’est pas une inspection du corps, alors c’est quel
genre d’inspection ? De la chouchoune ? Ok, ok, ok, j’dois pas dire des choses aussi vulgaires.]
On note ici, dans une même phrase la présence à la fois du taigi et du mandarin,
simultanément. Par exemple, dans la première phrase, le mot 得 (dei) n’existe pas en
taigi, mais il est utilisé en mandarin, alors que le mot 參詳 (cam-hsiong) n’existe pas en
mandarin : cette phrase est d’ailleurs imprononçable d’un seul coup, et contrairement
à la deuxième phrase d’exemple (qui passe pour une expression à la mode), celle-ci est
une pure invention de l’auteur. La troisième phrase quant à elle est parsemée
d’éléments provenant du taigi, mais sans indication aucune, les caractères « »
sont un néologisme de l’auteur pour traduire le mot prononcé « ji bai » (vagin) en
taïwanais (plus drôle encore si on comprend le chinois, dans la mesure où les
17 Sung-Sheng Yvonne Chang, Modernism and the Nativist Resistance, Contemporary Chinese Fiction from Taiwan, Durham, Duke University Press, 1993, p.73. 18 Wang Chen-ho, Meigui, meigui, wo ai ni [Rose, Rose, I Love You], p.99. 19 Wang Chen-ho, Meigui, meigui, wo ai ni [Rose, Rose, I Love You], p.105. 20 Wang Chen-ho, Meigui, meigui, wo ai ni [Rose, Rose, I Love You], p.163
67
caractères sont formés à partir du caractère mao « poil » (毛 mao)), le terme « 黑白
講 o-be kong» signifie « parler noir et blanc » en chinois mandarin mais signifie « dire
n’importe quoi » en taigi, tandis que l’auteur utilise enfin le zhuyin fuhao (注音符號
zhuyin fuhao, système phonétique en vigueur à Taïwan) ㄇㄞˋ pour retranscrire un son
taigi qui existe pourtant en chinois (mai4).
La création de telles phrases et de telles structures grammaticales n’est d’ailleurs
pas propre uniquement à Rose, Rose, I Love You et est à l’œuvre dans d’autres œuvres
de Wang Chen-ho (la nouvelle « Un char à bœufs pour dot » (1967) en est un des
meilleurs exemples) :
漸漸地,萬發竟自分和姓簡底已朋友得非常了,雖然仍舊一面都未謀面過地。21
[Peu à peu, Wanfa était déjà devenu de lui-même un très bon ami de « celui qui s’appelle Nique»,
même si ils ne s’étaient jamais vus.]
Cette phrase est absolument symptomatique de l’expérimentation littéraire de
Wang au niveau de la langue : pour un lecteur non averti, cette phrase est très difficile
à comprendre et nécessite un long effort de compréhension, car ce n’est pas du
chinois mandarin standard22. En effet, la grammaire de la phrase est issue de l’anglais
(la place des mots dans la phrase), les caractères sont écrits en chinois, mais on note la
présence du taigi (姓簡底 : qui devrait se lire xing jian di en chinois mandarin, se lit en
fait xing gan e, provoquant une homophonie avec le mot gan (« niquer »)). Enfin le mot
21 王禎和, « Jiazhuang yi niu che » 嫁妝一牛車[Un char à bœufs pour dot], in Taiwan bendi zuojia
duanpian xiaoshuo xuan 台灣本地作家短篇小說選 [Nouvelles choisies d’écrivains locaux taïwanais],
Taipei, Dadi, 2003 (1968), p.33. 22Le critique Lu Cheng-hui va même jusqu’à parler d’ « handicap » (zhang’ai 障礙) au niveau de la
lecture à propos de Wang Chen-ho. Voir Lu Cheng-hui 呂正惠, Xiaoshuo yu shehui 小說與社會
[Roman et société], Taipei, Lianjing, 1988, p.77.
68
自分 (zifen) n’appartient pas au mandarin, mais au japonais et signifie 自己 (ziji : soi-
même).
Ce que cherche sans doute à montrer Wang, c’est l’impossibilité d’une langue et
d’une grammaire chinoise absolument standardisée, dans la mesure où dans une
même phrase, les différences grammaticales et de vocabulaire entre taigi et chinois,
entre chinois et anglais peuvent coexister.
Il est à ce propos intéressant d’observer que contrairement à d’autres auteurs
taïwanais du terroir, chez Wang, le taigi n’apparaît pas uniquement dans les dialogues,
mais fait partie prenante du récit, même si le chinois mandarin reste la langue la plus
utilisée pour les descriptions23, par exemple, le meiyou (沒有 : il n’y a pas) mandarin est
ainsi remplacé par moyou (bo u en taigi 莫有), shenme (什麼 : quoi, quelque chose) est
remplacé par shami (hsia mi en taigi 啥咪), haoxiang (好像 : il semble, on dirait) est
remplacé par ganna (gan-a en taigi 甘那), xiaohai (小孩 : enfant) est remplacé par jianzi
(gin-a en taigi 囝仔), zheyang (這樣 : ainsi, comme ça) est remplacé par annie (an-ne en
taigi : 安聶), ta (她 : elle) est remplacé par yi (i en taigi 伊), il s’agit bien sûr ici d’une
liste non exhaustive et les exemples de mots ou d’expressions en taigi sont très
nombreux dans le roman. La présence d’éléments taigi à l’intérieur même du récit
signifie pour Wang la possibilité d’une écriture littéraire utilisant cette langue, face à la
mono-écriture en langue chinoise, Wang montre ainsi que le taigi peut être une langue
littéraire en soi, possédant ses propres caractéristiques, ses rythmes24… Il propose le
taigi en tant que langue légitime pour une représentation artistique.
23 Voir aussi Chiu Kuei-fen, « Empire of the Chinese Sign: The Question of Chinese Diasporic Imagination in Transnational Literary Production », p.602. 24 Il existe aussi à Taiwan une tradition littéraire entièrement en taigi, malgré l’utilisation fréquent des
caractères chinois pour la transcrire (le taigi n’ayant pas d’écriture propre), voir Chang Chun-huang 張
春凰, Taigi bun-hak kai-lun, 台語文學概論 [Introduction à la littérature en taigi], Taipei, Qianwei, 2001.
69
Chez Wang Chen-ho, le taigi ne remplace cependant pas le chinois mandarin, il
n’en est ni le successeur, ni le remplaçant car il s’agirait pour lui d’un nouveau outil
idéologique. Dans une interview donnée en 1973, Wang annonce qu’ « il a peur
qu’en entendant le nom de Wang Chen-ho, les gens pensent qu’il est écrivain de
littérature dialectale (fangyan wenxue方言文學) »25. Ce refus du monolinguisme s’opère
donc aussi contre une utilisation exclusive du taigi : pour Wang, refuser d’utiliser
plusieurs langues c’est refuser la « voix vraie », car pour lui, la vérité se manifeste par
la polyphonie. Nous utilisons ici particulièrement le terme de « polyphonie » dans la
mesure où la « voix », le « son », l’ « oral » sont particulièrement importants dans
l’œuvre de Wang, et dans Rose, notamment. La polyphonie littéraire ne désigne
donc pas seulement une pluralité de voix mais aussi une pluralité de consciences et
d'univers discursifs. Le récit peut ainsi être perçu comme un perpétuel dialogue, entre
les personnages d’une part, et entre l’auteur et le lecteur d’autre part (c’est sans doute
pourquoi tant de chercheurs ont vu dans Rose une application du principe
hétéroglossique cher au russe Mikhaïl Bakhtine)26.
Comme nous l’avons montré, le chinois mandarin, en tant qu’outil d’expression
littéraire est loin d’être banni dans Rose, malgré la présence d’éléments grammaticaux
et lexicaux taigi, japonais ou anglais, le chinois mandarin constitue la colonne centrale
sur laquelle repose le récit27. Mais on est loin d’un chinois épuré, standard (biaozhun標
25 Yu Su 余素, « Wenxue duitan : wuyue sanshi jie – cong hongloumeng dao wang zhenhe xiaoshuo»文
學對談:〈五月三十節〉-從紅樓夢到王禎和小說 [Entretien littéraire : « La fête du 30ème jour
du 5ème mois de l’année lunaire – du Rêve dans le Pavillon rouge jusqu’aux romans de Wang Chen-ho],
Daxue zazhi 大學雜誌, n°70, décembre 1973, pp.57-65.
26 Voir par exemple David Der Wei Wang 王德威 , « Cong lao she dao wang zhenhe : xiandai
zhongguo xiaoshuo de xinüe qingxiang » 從老舍到王禎和-現代中國小說的戲謔傾向 [De Lao-
she à Wang Chen-ho : la tendance à la blague dans les romans chinois modernes], Cong liu’e dao wang
zhenhe 從劉鶚到王禎和 [De Liu’E à Wang Chen-he], Taipei, Shibao wenhua chubanshe, 1986,
pp.149-182. 27 Comme le note Jeffrey C. Kinkley, les mots en taigi et en japonais passent pour l’immense majorité par une écriture en caractères chinois. Voir Jeffrey C. Kinkley, « Mandarin Kitsch and Taiwanese Kitsch in the Fiction of Wang Chen-ho », Modern Chinese Literature, Vol.6, 1992, p.102.
70
準 ) collant avec les nécessités idéologiques du gouvernement Nationaliste ou du
mythe culturel d’une Chine une. La chercheuse taïwanaise Sung-sheng Yvonne Chang
fait la remarque suivante :
The populist Nativist critics blamed Wang for “brutalizing the standard Chinese language.28
[Les critiques nativistes [du terroir] populistes blâment Wang pour « avoir brutalisé » la langue
chinoise standard.]
A travers les critiques de certains des partisans du terroir, on s’aperçoit que Wang
ne détruit pas complètement le chinois mandarin, il accepte de s’en servir, mais il le
« brutalise ». Le chinois de Wang est un chinois dénaturé, un chinois qui dévoile sa
propre idéologie. Il s’agit toujours du chinois, mais d’un chinois qui diffère totalement
de celui utilisé par le gouvernement centralisé. Pour comprendre cette idée, on peut
utiliser les termes des théoriciens du postcolonialisme : abrogation et appropriation29.
Pour eux :
The first, the abrogation or denial of the privilege of ‘English’ involves a rejection of the
metropolitan power over the means of communication. The second, the appropriation and
reconstruction of the language of the centre, the process of capturing and remoulding the language to
new usages, marks a separation from the site of colonial privilege.30
[Le premier, l’abrogation ou le refus du privilège de « l’Anglais » implique un rejet du pouvoir
métropolitain sur les moyens de communication. Le second, l’appropriation et la reconstruction du
langage du centre, le processus de capture et de remodelage du langage pour des nouveaux usages,
marque la séparation du terrain du privilège colonial.]
28 Sung-Sheng Yvonne Chang, Modernism and the Nativist Resistance, Contemporary Chinese Fiction from Taiwan, p.114. 29 Bill Ashcroft, Gareth Griffiths and Helen Tiffin, The Empire Writes Back: Theory and Practice in Post-colonial Literatures, New York, Routledge, 1989, pp.38-44. 30 Bill Ashcroft, Gareth Griffiths and Helen Tiffin, The Empire Writes Back: Theory and Practice in Post-colonial Literatures, p.38.
71
Bien évidemment, l’analyse d’Ashcroft, Griffiths et Tiffin s’applique avant tout
aux colonies britanniques et à la langue anglaise, mais on peut y faire un parallèle avec
l’utilisation du chinois dans Rose (et dans les œuvres de Wang en général). Dans Rose,
on s’aperçoit qu’il y à la fois défamiliarisation du chinois avec la tradition littéraire
historique chinoise, et en même temps une refamiliarisation de la langue avec son
contexte, historique et local. Il y a bel et bien appropriation de la langue chinoise par
Wang, qui va apprivoiser cette langue, la confronter avec d’autres, et l’utiliser comme
nouvel outil littéraire. Contrairement à des écrivains modernistes taïwanais comme
Wang Wen-hsing et Ch’i Teng-sheng qui voient dans la tortuosité de la langue
chinoise un moyen d’accéder à de nouvelles formes artistiques et de rompre avec
l’héritage traditionnel, chez Wang, le travail sur le chinois provoque une
reconfiguration de la marge31. C’est d’ailleurs à ce niveau qu’on remarque l’influence
de James Joyce sur Wang Chen-ho : la bâtardisation de l’anglais, l’utilisation des
accents et termes locaux dans Dubliners et surtout Finnegans Wake ont sans doute
inspiré Wang Chen-ho dans sa recherche d’une langue chinoise bâtarde, travaillée et
inégale32. Chez Wang, la recherche de « la voix vraie », la quête (peut-être inconsciente)
de sa taïwanité ne peut donc s’effectuer de manière monolingue, mais dans le même
temps, ne peut s’effectuer sans l’utilisation du chinois mandarin, comme moyen
d’expression littéraire.
31 Chiu Kuei-fen, « Empire of the Chinese Sign: The Question of Chinese Diasporic Imagination in Transnational Literary Production », p.603. 32 Si on peut être quasiment sûr que Wang Chen-ho a lu Dubliners et a été influencé par cette œuvre
(Ch’en Fang-ming 陳芳明, « Liuling niandai xiandai xiaoshuo de yishu chengjiu » 六 0年代現代小說
的藝術成就 [Succès artistiques des romans modernistes des années 60], Unitas 聯合文學, n°208,
février 2002, p.161), on ignore en revanche si Wang a lu ou non Finnegans Wake qui semble pourtant être l’oeuvre de Joyce la plus proche de l’imaginaire de Wang.
72
Comme l’explique les auteurs de l’Eloge de la Créolité, « les jeux entre plusieurs
langues (leurs liens de frottements et d’interactions) est un vertige polysémique»33 et
ce vertige plonge d’emblée le lecteur dans la complexité sociolinguistique de Taïwan.
3. De la polyphonie à la taïwanité : la Créolité comme méthode
Si comme nous l’avons vu, nous pouvons considérer que Rose, Rose, I Love You est
une œuvre importante de l’imaginaire postcolonial taïwanais, on a pu aussi s’attarder
sur l’imaginaire que Wang construit à travers son utilisation des langues, et on a pu
voir comment il appréhendait les contacts culturels et linguistiques qui se sont mis en
œuvre durant les plusieurs siècles de colonisation étrangère à Taïwan. Notre
interprétation est qu’il y a chez Wang « une intuition profonde de la Créolité »34
taïwanaise. Pour mieux comprendre notre propos, nous devons avant tout expliquer
ce choix terminologique. Le terme de « Créolité » provient bien sûr du mot « créole ».
Si celui-ci désigne à la base les descendants des esclaves noirs ou des colons blancs
vivant dans les Caraïbes, des antillais tels que Confiant, Bernabé, Chamoiseau ou
Glissant élargissent le sens des mots « Créolité » et « Créolisation », en proposant qu’il
s’agit d’une caractéristique prenant place au niveau mondial. Edouard Glissant définit
ainsi le processus de créolisation :
J’appelle créolisation la rencontre, l’interférence, le choc, les harmonies et les disharmonies entre
les cultures, dans la totalité réalisée du monde-terre. Les exemples de créolisation sont inépuisables et
33 Jean Bernabé, Patrick Chamoiseau et Raphaël Confiant, Eloge de la Créolité, Paris, Gallimard, 1989, p.48. 34 Le terme est issu du manifeste Eloge de la Créolité : Jean Bernabé, Patrick Chamoiseau et Raphaël Confiant, Eloge de la Créolité, p.27.
73
on observe qu’ils ont d’abord pris corps et se sont développés dans des situations archipéliques plutôt
que continentales. Ma proposition est qu’aujourd’hui le monde entier s’archipélise et se créolise.35
Ainsi, la Créolité est une « façon » de voir le monde et le lieu, de l’envisager, de le
lire. Pour aller un peu plus loin qu’une lecture postcoloniale un peu trop
universalisante et surtout valable dans les régions où n’a sévi qu’une seule force
colonisatrice (bien souvent la France et le Royaume-Uni), nous proposons par
conséquent d’utiliser la grille de lecture de la Créolité pour mieux comprendre Rose,
Rose, I Love You. Pour l’argentin Walter D. Mignolo, la Créolité est également plus
qu’un phénomène isolé, et peut-être utilisée comme méthode :
Thus, as far as Creoleness is a mode of being, of thinking and writing in a subaltern language, from
the subaltern perspective and appropriating a hegemonic language – all this is not limited to a
particular local history but is similar to several local histories made at the intersection with global
designs, the coloniality of power, and the expansion of the modern world system.36
[Ainsi, la Créolité est une manière d’être, de penser et d’écrire dans un langage subalterne, à partir
d’une perspective subalterne et en s’appropriant un langage hégémonique. Ceci n’est pas limité à une
histoire locale particulière, mais s’apparente à de nombreuses histoires locales placées à l’intersection
entre les projets du global, la colonialité du pouvoir et l’expansion du système mondial moderne.]
Ou encore :
Creoleness offers another “methodology”, thinking at the crossroads and in the borders of
colonial history which, like French language for Creole cannot be avoided but must be appropriated
and then turned inside out, so to speak.37
35 Edouard Glissant, Traité du Tout-Monde : Poétique IV, Paris, Gallimard, 1997, p.194. 36 Walter D. Mignolo, Local Histories/Global Designs, Princeton, Princeton University Press, 2000, p.243. 37 Walter D. Mignolo, Local Histories/Global Designs, p.246.
74
[La Créolité offre une autre méthodologie, une pensée au carrefour et aux frontières de l’histoire
coloniale, comme le langage français pour le créole, qui ne peut pas éliminer celui-ci, mais se
l’approprier, et, pour ainsi dire, le mettre sans dessus dessous.]
La Créolité propose ainsi de repenser les liens entre histoire et littérature, entre
langues et histoire, entre langues et littérature et de mettre en évidence leurs
interrelations 38 . La Créolité n’implique donc pas une dichotomie simpliste entre
Occident et Orient, ni entre Chine et Taïwan, comme on pourrait parfois l’imaginer
dans le cadre de la littérature du terroir à Taïwan, mais elle s’intéresse à ce « tout », à
ce « magma » complexe et inégal. Dans Rose, Rose, I Love You, l’utilisation du chinois,
du chinois « taïwanisé », du taigi, de l’anglais, du japonais et l’addition de diverses
formes linguistiques et littéraires (blancs, digressions, traductions aléatoires entre
parenthèses, signes ou dessins) créent une sorte de kaléidoscope « créole » multicolore
de langues.
Dans le même temps, l’expérimentation linguistique de Wang Chen-ho dans Rose
tente aussi de mettre en évidence les particularités linguistiques et historiques de la
ville de Hualian, et à travers elle de l’île de Taïwan. L’emploi multiple des langues par
Wang dans Rose possède également une dimension diachronique : dans la mesure où
celui-ci a fait le choix d’écrire sur un événement passé, les personnages parlent avec la
langue de l’époque. Wang multiplie ainsi les indications historico-linguistiques, ou
sociolinguistiques concernant les différences entre le moment où il parle (années 80)
et le moment dont il parle (années 60) (44, 118, 131, 145). Interviewé par le
professeur Chiu Yan-ming ( 邱 彥 明 ), Wang Chen-ho explique que ses
38 Walter D. Mignolo, Local Histories/Global Designs, p.246.
75
expérimentations sur la langue sont destinées à faire percevoir au lecteur la « vérité
d’une époque 39».
L’agencement de la langue chez Wang révèle par conséquent une volonté de
dévoiler les rapports complexes entre la langue d’une communauté et son histoire (la
langue parlée dans les années 80 n’est pas la même que dans les années 60), en
montrant d’abord que la langue taïwanaise (incluant le chinois, le taigi, le japonais,
l’anglais) n’est pas fixe, mais ne cesse d’évoluer, de façon parallèle à l’histoire de l’île,
et qu’elle s’enrichit de ces expériences sans cesse renouvelées de relations
interculturelles. Ainsi tout un langage métalinguistique parcourt le récit dans le but
d’expliquer les fluctuations de la (des) langue(s) à Taiwan par le biais de digressions
plus ou moins longues rompant le cours de l’histoire (44, 145), ou encore parfois par
des interventions plus ponctuelles (118, 131).
De la même manière que le passé colonial de l’île modifie l’identité taïwanaise, la
langue, elle, est aussi bouleversée et remodelée par les traces de ce passé historique
particulier (japonais, « dialectes », chinois mandarin, chinois taïwanisé, anglais…).
Chez Wang, la langue est donc le « symbole » de cette identité en mouvement.
« La Créolité est une annihilation de la fausse universalité, du monolinguisme et de
la pureté. 40», c’est donc une manière d’envisager une identité hybride, une méthode
pour comprendre des processus d’identification complexe. La « pureté » rejetée par
les partisans de la Créolité ne rejette cependant pas la recherche d’une « authenticité »
39 Chiu Yan-ming 丘彥明, « Ba huanxiao saman renjian – fang xiaoshuojia wang zhenhe » 把歡笑撒
滿人間 – 訪小說家王禎和 [Répandre le rire parmi les hommes – Interview de l’écrivain Wang Chen-
ho], Meigui meigui wo ai ni 玫瑰玫瑰我愛你 [Rose, Rose, I Love You], Taipei, Hongfan shudian, 1994,
p.258. (« 我盡量把一個時代的語言寫出來。那時台灣用的是日語、台語、國語和現在一久八
三、八四的國語、台語不一樣,我想用對照的方式也許可能使那個時代鮮明得給推演出
來。 » [Je fais tout mon possible pour écrire la langue d’une époque. A cette époque on utilisait le
japonais, le taigi, le chinois, mais le chinois et le taigi n’étaient pas les mêmes qu’en 1983 ou 1984, j’essaie d’utiliser la méthode du contraste, peut-être qu’ainsi la langue de l’époque pourra être inférée de manière plus distincte.]) On pourrait rapprocher une telle démarche de la volonté d’écrire la « mémoire vraie » chez les auteurs antillais de la Créolité. Voir Katia Levesque, Entre tradition d’oraliture créole et tradition littéraire française, Québec, Nota Bene, 2005, p.87. 40 Jean Bernabé, Patrick Chamoiseau et Raphaël Confiant, Eloge de la Créolité, p.28.
76
créole41. Les expériences linguistiques de Wang dans Rose, son utilisation simultanée
de différentes langues et grammaires, non seulement dans les dialogues (Dong Si-wen
arrive en une phrase à utiliser chinois mandarin, taigi et anglais : 164) participent à
l’élaboration de cette identité. La poursuite de l’identité taïwanaise, de la « taïwanité »
chez Wang Chen-ho ne cesse ainsi de s’articuler autour de la quête, nous l’avons vu
d’une « voix vraie », d’une « vérité entière » (zhenshi de shengyin, chedi de zhenshi 徹底的
真實), et il propose la Créolité de la langue comme le marqueur d’une mémoire (vraie)
face à un monolinguisme officiel qui nierait ainsi la « vérité » de l’histoire. Chez Wang
Chen-ho, tout est à la fois création et authenticité : la traduction, les injures : tous les
éléments linguistiques empruntés à différentes langues et cultures participent à la mise
en place d’une nouvelle langue sensée être la plus légitime et la plus juste pour
représenter la vérité de l’histoire.
Cette recherche d’ « authenticité » linguistique (et historique également, lorsque
comme nous l’avons vu, Wang Chen-ho effectue un travail sur la langue dans son
contexte historique donné) à travers la diversalité, tend à montrer l’existence d’une
« vérité » à l’intérieur de cet état de Créolité. Cette recherche peut être mise en relation
avec les efforts d’autres intellectuels du XXème siècle.
Par exemple, dans le monde sinophone, l’intellectuel marxiste Qu Qiubai (瞿秋白)
avait, au début du XXème siècle, déjà tenté d’imaginer une langue nationale, utilisant
la richesse des différents dialectes chinois, avant la mise en place officielle d’une
langue chinoise complètement standardisée, et ne laissant pas d’espace au dialecte, le
putonghua (普通話 : langue commune)42. Dans le monde postcolonial des Antilles,
l’écrivain de la Barbade Edward Kamau Braithwaite propose lui aussi une langue
41 Katia Levesque, Entre tradition d’oraliture créole et tradition littéraire française, Québec, Nota Bene, 2005, pp.155-159. 42 Voir Florent Villard, Le Gramsci chinois : Qu Qiubai, penseur de la modernité culturelle, Lyon, Tigre de Papier, 2009, 379p.
77
nationale, mettant l’accent sur son caractère populaire et son expérience historique
particulière :
[Nation language] may be in English: but often it is in an English which is like a howl, or a shout
or a machine-gun or the wind or a wave. It is also like the blues. And sometimes it is English and
African at the same time.43
[[La langue nationale] peut être en anglais, mais souvent c’est un anglais qui est comme un
hurlement ou un cri ou une mitraille ou un vent ou une vague. C’est aussi comme le Blues. Et parfois
c’est anglais et africain en même temps.]
La langue nationale pour le caribéen Braithwaite peut-être anglaise, mais c’est un
anglais hybride, créole, dépouillé de l’idéologie métropolitaine et adaptée à son
contexte socioculturel44. La recherche d’une langue taïwanaise authentique n’équivaut
cela dit pas chez Wang à la recherche d’une langue nationale, comme elle peut l’être
chez Qiu ou chez Braithwaite car à ce moment-là en tout cas, pour lui, Taiwan n’est
pas envisageable en termes de nation. Malgré tout, il y a chez Wang et dans Rose une
intuition, un sentiment, d’une identité « différente ». Pour lui, les expériences sur la
langue semblent être plus qu’une simple recherche esthétique moderniste, mais
s’inscrivent dans une recherche identitaire qui peut être rattachée à un certain degré
aux slogans « nationalisants » de la littérature du terroir (xiangtu wenxue de kouhao 鄉土
文學的口號).
4. Cacophonie et langue populaire : le grotesque dans Rose, Rose, I
Love You
43 Edward Kamau Braithwaite, « Nation Language », in Bill Ashcroft, Gareth Griffiths et Helen Tiffin, The Post-Colonial Studies Reader, New York, Routledge, 2006, p.283. 44 Edward Kamau Braithwaite, « Nation Language », pp.282-285.
78
Ultime étape dans l’univers du langage de Wang Chen-ho, nous pouvons observer
que l’influence de la langue populaire, du vocabulaire grotesque de la place publique45
marquent profondément les œuvres de Wang Chen-ho, et tout particulièrement ses
derniers romans : Rose, Rose, I Love You (1984) et Portrait des gens beaux (1982)46. Avant
d’entrer un peu plus en détails, il est essentiel d’expliquer ce que nous entendons par
« grotesque ». Pour Katrina E. Triezenberg :
[Grotesque literature is a] literature that distorts its characters, either physically as in the masks and
hump-backed costumes of commedia del’arte characters, or in their personalities and actions, as in
many Victorian novels. 47
[[La littérature grotesque est une] littérature qui déforme ses personnages, aussi bien physiquement
comme dans les masques et les costumes avec bosses des personnages de la Commedia del’arte, et dans
leurs personnalités et leurs actions, comme dans beaucoup de nouvelles victoriennes.]
Mikhaïl Bakhtine quant à lui voit dans le « réalisme grotesque » un aspect positif
du rire, son trait marquant étant « le rabaissement, c’est-à-dire le transfert de tout ce qui
est élevé, spirituel, idéal et abstrait sur le plan matériel et corporel, celui de la terre et
du corps dans leur indissoluble unité. 48», et le grotesque utilise abondamment du
langage de la « place publique » :
45 Le terme de « vocabulaire de la place publique » est ici utilisé en référence à l’ouvrage du théoricien russe Mikhaïl Bakhtine : Mikhaïl Bakhtine, L’œuvre de François Rabelais et la culture populaire au Moyen  ge et sous la Renaissance, trad. du russe par Andrée Robel, Paris, Gallimard, 1970. 46 On peut cela dit noter une persistance de l’esprit grotesque dans les nouvelles, dans son traitement
des « petits personnages ». Ainsi, Wanfa (萬發) le personnage principal de la nouvelle « Un char à
bœufs pour dot » (1967) est ainsi presque entièrement sourd, mais pas assez pour ne pas s’apercevoir que sa femme (extrêmement laide) le trompe avec son voisin (lequel sent atrocement mauvais). Les personnages de « L’histoire des trois printemps » (1968) sont eux aussi marqués par des attributs physiques défavorables, tels que l’impossibilité d’avoir une érection, des diarrhées incontrôlables etc. 47 Katrina E. Triezenberg, « Humour in Literature », in Victor Raskin, The Primer of Humour Research, Berlin, N-Y, Mouton de Gryter, 2008, p.522. 48 Mikhaïl Bakhtine, L’œuvre de François Rabelais et la culture populaire au Moyen Âge et sous la Renaissance, p.29.
79
Le langage familier de la place publique est caractérisé par l’emploi assez fréquent de grossièretés,
c’est-à-dire de mots et d’expressions injurieuses, parfois assez longues et compliquées. Sur les plans
grammatical et sémantique, les grossièretés sont habituellement isolées dans le contexte du langage et
interprétées comme des formules fixes, dans le genre des proverbes.49
La place publique était le point de convergence de tout ce qui n’était pas officiel, elle jouissait en
quelque sorte d’un droit d’« exterritorialité » dans le monde de l’ordre et l’idéologie officiels, et le
peuple y avait toujours le dernier mot.50
La place du scatologique, du pornographique dans Rose, Rose, I Love You rappelle
ainsi indéniablement François Rabelais, et les rapprochements avec le célèbre écrivain
français sont fréquentes chez de nombreux chercheurs qui s’intéressent à Rose51.
Ce que nous cherchons à comprendre ici, ce n’est finalement pas tellement de
savoir ce qui est grotesque dans Rose52, mais plutôt pourquoi c’est grotesque, et quel
rôle joue ce langage dans la représentation de la taïwanité chez Wang. C’est avant tout
la puissance du rire qu’invoque Wang Chen-ho dans son roman, car comme pour
Bakhtine et pour Charles Baudelaire :
Jamais le pouvoir, la violence, l’autorité n’emploient le langage du rire.53
49 Mikhaïl Bakhtine, L’œuvre de François Rabelais et la culture populaire au Moyen Âge et sous la Renaissance, p.25. 50 Mikhaïl Bakhtine, L’œuvre de François Rabelais et la culture populaire au Moyen  ge et sous la Renaissance, p.157. 51 Voir par exemple David Der Wei Wang, « Cong lao she dao wang zhenhe : xiandai zhongguo xiaoshuo de xinüe qingxiang », mais aussi Huang I-min, « A Postmodernist Reading of Rose, Rose, I Love you », Tamkang Review, 1986, Vol. XVII, No.1, pp.27-43 ou encore la traduction du roman en anglais par Howard Goldblatt, dans laquelle celui-ci compare le personnage de Dong Si-wen à Panurge. (Wang Chen-Ho, Rose, Rose, I Love you, trad. du chinois par Howard Goldblatt, Columbia University Press, New York, 1998, p.viii). 52 Les études précitées (note 51) effectuent déjà une bonne présentation de l’humour grotesque dans Rose, en utilisant abondamment des théories de Bakhtine sur le grotesque « carnavalesque ». 53 Mikhaïl Bakhtine, L’œuvre de François Rabelais et la culture populaire au Moyen Âge et sous la Renaissance, p.97.
80
Le Sage, c’est-à-dire celui qui est animé de l’esprit du Seigneur, celui qui possède la pratique du
formulaire divin, ne rit, ne s’abandonne au rire qu’en tremblant. Le Sage tremble d’avoir ri ; le Sage
craint le rire, comme il craint les spectacles mondains, la concupiscence. Il s’arrête au bord du rire
comme au bord de la tentation.54
Le grotesque, premièrement par l’intermédiaire du rire qu’il apporte, et
deuxièmement à cause du sujet dont il traite propose une alternative au sérieux
officiel. Face à l’imaginaire à la fois moraliste confucéen et nationaliste du langage
gouvernemental, Wang Chen-ho lui oppose l’éclat de rire grotesque du langage
populaire. L’utilisation du grotesque possède d’ailleurs par essence un sens politique
certain, « un caractère à la fois populaire et radical.55 »
Parfait exemple de cette ridiculisation du discours officiel, le slogan Nation to
Nation, People to People, qui devient littéralement «Les pensées intimes aux pensées
intimes, le cul au cul » (neixin dui neixin, pigu dui pigu 內心對內心,屁股對屁股)
(168). Quand au personnage de Dong Si-wen, il est malgré lui le plus représentatif de
cet « esprit grotesque » qui sévit dans le roman : atteint de flatulences (17-18, 40,
131)56, il est également énorme (18), mais est en même temps un maniaque de la
propreté (18) et pratique pour cela régulièrement la masturbation (63-65) tout en
dévorant des tonnes de vitamines (17) : son « raffinement » est donc très éloigné du
sens originel de son nom (en chinois mandarin, le nom de famille dong3 董 est un
homonyme du mot dong3 懂 : ce qui, associé au prénom Si-wen 斯文, signifierait
littéralement « celui qui s’y comprend à la culture, qui connaît la finesse, le raffiné »).
54 Charles Baudelaire, De l’essence du rire, 1855, http://baudelaire.litteratura.com, consulté le 10 avril 2010. 55 Mikhaïl Bakhtine, L’œuvre de François Rabelais et la culture populaire au Moyen Âge et sous la Renaissance, p.10. 56 Ironiquement encore, le mot « pèter » en chinois (fangpi 放屁 ) signifie aussi « dire des choses
absurdes » en chinois, comme si le langage de Dong n’avait absolument aucun sens pour les autorités traditionnelles, voir Huang I-min, « A Postmodernist Reading of Rose, Rose, I Love you », p.30.
81
Le rôle du rabaissement du corps (à tout ce qui concerne le « bas » corporel) tout
comme la mise sans dessus dessous des normes morales est d’ailleurs indissociable du
langage grossier dans la littérature grotesque57.
Cependant, si l’utilisation de l’imaginaire populaire grossier est particulièrement
présent chez Wang Chen-ho, Sung-sheng Yvonne Chang rappelle que « le laid, le
scandaleux et le choquant » sont des caractéristiques de la littérature Moderniste à
Taïwan, dans la mesure où l’avant-garde littéraire doit de se dresser contre la
littérature « austère» traditionnelle, mais il a aussi une autre signification chez Wang58.
Ainsi, comme le note Mikhaïl Bakhtine, le grotesque et l’esprit du « carnaval » sont
inexorablement liés, provoquant un concert de cris multiples, s’échappant du langage
officiel. Chez Wang, comme chez Rabelais (ou chez l’écrivain martiniquais Raphaël
Confiant59), la restructuration des normes par les règles du grotesque sont intimement
liés à cette représentation carnavalesque du monde60.
Plus que symbole d’une recherche artistique, l’utilisation du vocabulaire de la place
publique permet à Wang Chen-ho de célébrer « la cacophonie du réel » taïwanaise. En
effet, au lieu de polyphonie, David Der Wei Wang parle à ce propos de cacophonie
(baiyin caoza百音嘈雜) en rupture avec le système monophonique (danyin xitong 單音
系統) de la littérature officielle61. Comme nous l’avons vu précédemment, il y a des
perpétuelles traductions, retraductions, « métraductions » culturelles et linguistiques à
l’intérieur du roman. De l’absurde (ou plus souvent du grotesque) qui en découle naît
une part de cette cacophonie, créant ainsi une fanfare de voix et de sens chaotiques.
57 Mikhaïl Bakhtine, L’œuvre de François Rabelais et la culture populaire au Moyen Âge et sous la Renaissance, p.37. 58 Sung-Sheng Yvonne Chang, Modernism and the Nativist Resistance, Contemporary Chinese Fiction from Taiwan, p.25. 59 Voir Katia Levesque, Entre tradition d’oraliture créole et tradition littéraire française, p.34 et Roy Chandler Caldwell Jr « L'Allée des Soupirs, ou le grotesque créole de Raphaël Confiant », Francographies 8, 1999, pp. 59-70. Une comparaison entre les deux auteurs serait sans aucun doute très intéressante. 60 Pour Katrina E. Triezenberg, être carnavalesque c’est « bouleverser les normes, les mettre à l’envers » (Katrina E. Triezenberg, « Humour in Literature », p.522). 61 David Der Wei Wang, « Cong lao she dao wang zhenhe : xiandai zhongguo xiaoshuo de xinüe qingxiang », p.172.
82
Dans son étude de la Créolité dans les romans antillais, Katia Levesque estime
que :
Le roman créole doit être cacophonique (et non harmonique, ce qui impliquerait la notion d’ordre),
à l’image de la cacophonie du réel. 62
La cacophonie des langues et des discours dans Rose, Rose, I Love You, de même
que l’explosion et le détournement des règles morales participent à la représentation
de ce « vertige polysémique ». Face à la représentation par et pour le discours de
l’ « Autre » (chinois et états-unien), et contre la perte d’identité dans l’altérité, l’auteur
se force de déterrer la « vérité entière », la vérité crue et de faire exploser le système
identitaire du pouvoir néocolonial : il plonge le roman tout droit dans cet abîme
d’identités qu’est pour lui la taïwanité.
5. Conclusion
Le pouvoir de la langue est sans limite dans Rose, Rose, I Love You. Non seulement,
elle révèle (ou réinvente ?) la vérité d’une histoire, celles des années 60-70 dans la ville
de Hualian, mais elle fait aussi éclater le système monophonique ambiant. La société
taïwanaise d’après-guerre, fait, comme nous l’avons vu, face à deux phénomènes
majeurs : d’une part, l’obligation par le gouvernement Nationaliste d’une « acquisition
totale d’une identité autre 63» (de son histoire, de sa langue), et d’autre part, Taiwan se
confronte au Monde, au néocolonialisme économique et culturel états-unien.
62 Katia Levesque, Entre tradition d’oraliture créole et tradition littéraire française, p.34. 63 L’expression provient de Jean Bernabé, Patrick Chamoiseau et Raphaël Confiant, Eloge de la Créolité, p.15. Dans le cas de la Chine pour Taïwan, il serait faux de dire que l’imaginaire culturel chinois ne fasse pas partie d’une des branches qui constitue l’arbre identitaire taïwanais, mais les processus officiels Nationalistes d’identification s’inscrivent eux aussi dans l’idée d’une acquisition d’une identité
83
Face à ces deux phénomènes « globaux », Wang Chen-ho effectue d’abord un
retour sur le local, son histoire se passe dans la ville de Hualian, et il se réclame de son
passé. Ensuite, Wang Chen-ho exécute un véritable travail sur le langage, il conçoit
des néologismes, mélange différents styles d’écriture (raffinée, bâtarde ou
profondément vulgaire…), utilise simultanément les grammaires chinoises, anglaises,
du taigi, des expressions japonaises… il est en cela intéressant de noter que Wang
Chen-ho n’exclut rien, ni langue, ni identité : contre l’unicité de l’histoire et de la
langue officielle, il propose la multitude des histoires et des représentations populaires.
Comme nous l’avons observé, le grotesque sert aussi cette identification langagière du
gouffre cacophonique du réel.
Si l’on propose d’utiliser la méthode de la Créolité, pour étudier Rose, Rose, I Love
You, c’est aussi pour dépasser les limites du terrain postcolonial, qui entretient parfois
un rapport trop dichotomique entre colonie et ancienne colonie 64 . La Créolité
propose de réfléchir plus abondamment dans des termes de confluence et d’Identités-
Relations : dans Rose, Rose, I Love You la taïwanité ne se construit pas seulement «
contre », mais « avec ».
L’absence des GI’s états-uniens dans le roman permet aussi de s’interroger sur
ces processus d’identification engagés par les Taïwanais eux-mêmes, et comme
l’exprime le taïwanais Lee Yu-lin (李育霖) :
« autre », même si elle n’est pas aussi radicalement « autre » que l’a pu l’être la France pour l’Afrique par exemple. 64 Pour Sandrine Marchand, aussi, quand on parle de littérature taïwanaise, il faut « […] quitter ainsi le cercle de la dichotomie pour entrer directement dans le champ fécond des différences, de la multiplicité, et de la nature rhizomique […] », Sandrine Marchand, Sur le fil de la mémoire : Littérature taïwanaise des années 1970-1990, Lyon, Tigre de Papier, 2009, p.27.
84
因此,在書寫中,作家展示了一場新的社會秩序重整的無限可能性,同時也預見了潛在
未來人民的出場。65
[C’est pourquoi, à travers l’écriture, l’auteur révèle l’existence d’un nouvel ordre social qui restitue
une infinité de possibilités, et qui dans le même temps, prédit l’entrée en scène d’un peuple d’avenir
jusqu’alors bien enfoui.]
65 Lee Yu-lin 李育霖, « Fanyi yu difang de shengchan – yi wang zhenhe xiaoshuo « Meigui meigui wo
ai ni » wei li » 翻譯與地方的生產-以王禎和小說《玫瑰玫瑰我愛你》為例 [Traduction et
production du lieu : le cas de Rose, Rose, I Love You de Wang Chen-ho], Fanyi yujing : zhuti, lunli, meixue
翻譯閾境:主體、倫理、美學 [Liminalité de la traduction : sujet, éthique et esthétique], Taipei,
Shulin, 2009, p.156.
85
V- Conclusion générale
La représentation de la taïwanité chez Wang Chen-ho passe avant tout par
l’expression littéraire d’un certain nombre de critères de définition de celle-ci.
Dans un premier temps, nous avons observé la place de Rose, Rose, I Love You dans
son contexte à la fois historique et littéraire. Il en ressort que le roman s’inscrit dans la
continuité du discours du terroir (xiangtu lunshu 鄉土論述), réflexion lancée dans les
années 70, et qui connaît son paroxysme à la fin de cette décennie. A l’intérieur de ce
discours, la critique du néo-colonialisme culturel et économique états-unien, la remise
en cause de l’histoire officielle du gouvernement Nationaliste et la louange du local
exercent, à un degré plus ou moins important, une influence sur l’œuvre de Wang.
Parmi ces caractéristiques, Rose, Rose, I Love You proclame avant toute chose un
retour sur le local, une tentative d’expliquer le global à travers le filtre du terroir
(Hualian). L’identité taïwanaise imaginée par Wang, comme nombre de ses
contemporains partisans du terroir implique avant tout un enracinement dans le sol
qui les a vus naître où s’émanciper. Cependant, on s’en doute, le récit du local prend
vite une dimension plus large, comme l’explique Arif Dirlik :
In these cases, ironically, local society would also emerge as a source of national identity, against
the cosmopolitanism of urban centers drawn increasingly into the global culture of capitalism.1
[Dans ces cas, ironiquement, la société locale pourrait apparaître comme une source de l’identité
nationale, contre le cosmopolitisme des centres urbains entremêlés de plus en plus avec la culture
globale du capitalisme.]
1 Arif Dirlik, « The Global in the Local », in Bill Ashcroft, Gareth Griffiths, Helen Tiffin, The Post-Colonial Studies Reader, New York, Routledge, 2006, p.464.
86
Il semblerait pourtant que l’identité « nationale » ne soit pas forcément ce qui
importe le plus à Wang Chen-ho, qui, comme la majorité des Taïwanais à l’époque ne
parle pas de Taiwan en termes « nationaux », et ce, malgré l’évènement de Formose en
1979 (meilidao shijian) qui voit la renaissance d’une contestation indépendantiste
taïwanaise.
Le texte sert de dépositaire de la mémoire chez Wang Chen-ho, il transcende le
local pour lui donner une vision plus globale, il ne s’agit pas (ou alors inconsciemment)
d’une tentative nationaliste de définition d’un « destin national », mais il est certain
que Wang Chen-ho à la conscience d’appartenir à une histoire, celle de Hualian (son
terrain d’expérience) qui peut s’agrandir pour prendre la forme de l’île de Taïwan.
Comme nous l’avons vu, la réflexion de Wang Chen-ho sur l’histoire, provient d’une
volonté d’être témoin de celle-ci (lishi de jianzheng), de mettre à jour sa profonde vérité
(chedi de zhenshi).
Cette volonté ne peut être envisagée, comme nous avons essayé de l’expliquer
dans notre troisième chapitre, sans une remise en question de l’interprétation
historique officielle. Il y a dans Rose, Rose, I Love You une lutte contre l’hégémonie
monophonique, le monolinguisme et le mythe culturel Nationaliste. A cela, il appose
(il oppose) l’éclatement de l’histoire, le vertige de la Créolité et l’imaginaire populaire
du vulgaire. Et il est d’ailleurs essentiel de noter que le vulgaire, à travers l’expression
littéraire grotesque a un sens historique clair :
On peut dire, […], que dans la conception grotesque du corps, est né et a pris forme un nouveau
sentiment historique, concret et réaliste, qui n’est pas l’idée abstraite des temps futurs, mais la sensation
vivante qu’à chaque être humain de faire partie du peuple immortel, créateur de l’histoire. 2
2 Mikhaïl Bakhtine, L’œuvre de François Rabelais et la culture populaire au Moyen Âge et sous la Renaissance, trad. du russe par Andrée Robel, Paris, Gallimard, 1970, p.365.
87
Pour pouvoir pleinement sentir le sens de l’identité taïwanaise dans Rose, Rose, I
Love You, mais également dans l’ensemble des œuvres fictionnelles de Wang Chen-ho,
il est indispensable de se pencher sur et de comprendre les multiples expériences
linguistico-littéraires de ce moderniste singulier. Le travail sur la langue (et sur la voix),
est ainsi, du propre aveu de celui-ci, sa plus grande priorité lorsque il écrit des
nouvelles ou des romans3.
Dans notre travail, nous avons proposé la Créolité comme méthode à la
compréhension de la représentation identitaire de Wang Chen-ho dans Rose. Chez ses
théoriciens, plusieurs facteurs entrent en compte afin d’être en état de Créolité :
1.L’enracinement dans l’oral 2.La mise à jour de la mémoire vraie 3.La thématique de
l’existence 4.L’irruption dans la modernité 5.Le choix de sa parole4. Nous pouvons
dès à présent voir que chez Wang Chen-ho, l’expression littéraire de la taïwanité
s’articule aussi grâce et en fonction de ses mêmes critères. Tout d’abord,
l’enracinement dans l’oral manifeste chez Wang du désir de retourner « aux racines »,
à l’oralité du local en tant qu’expression différente de la culture officielle écrite ; d’une
même ambition, naît la volonté de « mettre à jour », de déterrer la « mémoire vraie »,
une histoire confisquée non seulement par le gouvernement Nationaliste, mais par
l’avilissement au service des nouvelles forces coloniales états-uniennes, il y a donc en
effet chez Wang Chen-ho une relecture de la mémoire collective, et comme l’explique
précisément Maurice Halbawchs :
3 Chiu Yan-ming 丘彥明, « Ba huanxiao saman renjian – fang xiaoshuojia wang zhenhe » 把歡笑撒滿
人間 – 訪小說家王禎和 [Répandre le rire parmi les hommes – Interview de l’écrivain Wang Chen-
ho], Meigui meigui wo ai ni 玫瑰玫瑰我愛你 [Rose, Rose, I Love You], Taipei, Hongfan shudian, 1994,
p.255. 4 Jean Bernabé, Patrick Chamoiseau et Raphaël Confiant, Eloge de la Créolité, Paris, Gallimard, 1989.
88
En d’autres termes, il y aurait dans l’esprit de tout homme normal vivant en société une fonction
de décomposition, de recomposition et de coordination des images, qui lui permet d’accorder son
expérience et ses actes avec l’expérience et les actes des membres du groupe. 5
La thématique de l’existence est un marqueur important de Rose, qui interroge les
comportements mimétiques, les relations entre ces attitudes et leurs intentions.
L’irruption dans la modernité à travers sa traduction, sa (mauvaise) interprétation, ses
fantasmes et ses échecs dans l’imaginaire des personnages du roman trace le cadre de
l’histoire. Enfin, point peut-être le plus important dans Rose, Rose, I Love You, le choix
d’une parole, d’un langage, qui ne soit ni monophonique (peut importe qu’il soit
chinois, ou taigi), mais d’une langue éclatée, bâtarde, qui soit une « diapositive » du
défilé carnavalesque de l’imaginaire grotesque populaire, enfin, une langue qui mette
en valeur une identité qui ne se définit qu’à travers la Relation6.
Qu’en est-il enfin de la taïwanité ? Pour Chiu Kuei-fen :
我認為「台灣性」並沒有單一固定的內容,而是一種相對性的概念,在不同的脈絡裡會
展現不同的面貌,端看它被策略性地放在什麼樣的位置來呈現。7
[J’estime que la « taïwanité » n’a absolument pas de contenu unique ou figé, mais c’est un concept
relatif ; dans différents esprits, il aura différents aspects, il faut finalement voir à travers quelle tactique
et dans quel espace on le place et on lui offre d’apparaître.]
De la même façon, chez Wang Chen-ho, la taïwanité est une construction, un
agencement multiple de mémoires, d’histoires et de langues, reflétant la volonté de
s’identifier à Taïwan, mais sans jamais entrer dans la dichotomie des modèles, en
5 Maurice Halbawchs, Les cadres sociaux de la mémoire, Paris, Albin Michel, 1994 (1925), p.70. 6 Edouard Glissant, Traité du Tout-Monde : Poétique IV, Paris, Gallimard, 1997, p.21 . 7 Chiu Kuei-fen邱貴芬, Houzhimin ji qiwai後殖民及其外 [Le postcolonial et son en-dehors], Taipei,
Maitian chubanshe, 2003, pp.135.
89
conservant et en jouant du merveilleux abîme des identités nouvelles de l’île de
Formose.
Bibliographie
Ouvrages de fiction :
A Sheng 阿盛, « Cesuo de gushi »廁所的故事 [L’histoire des toilettes], A Sheng
jingxuan ji 阿盛精選集 [Sélection des meilleures œuvres d’A Sheng], Taipei, Jiuge
chubanshe, 2004 (1978), pp.294-300
90
CHEN Ying-chen陳映真, « Liuyue li de meiguihua » 六月裏的玫瑰花 [Roses de
juin], Shangban zu de yi ri 上班族的一日 [Une journée de travailleur], Taipei, Renjian
chubanshe, 1988 (1967) pp.1-22
CHENG Ch’ing-wen鄭清文, « Sanjiao ma » 三腳馬 [Le cheval à trois pattes], Zheng
qingwen duanpian xiaoshuo quanji 3 鄭清文短篇小說全集 3 [Œuvres complètes de
Cheng Ch’ing-wen : Nouvelles : Volume 3], Taipei, Maitian chubanshe, 1998 (1979), pp.169-205
HWANG Chun-ming 黃春明 , « Pingguo de ziwei »蘋果的滋味 [Le goût des
pommes], Erzi de da wan’ou兒子的大玩偶 [Le pantin de son fils], Taipei, Huangguan
chubanshe, 2000 (1972), pp.41-73
HWANG Chun-ming, Shayounala, zaijian 莎喲娜拉‧再見 [Sayonara, Au revoir],
Taipei, Yuanjing, 1975
HWANG Chun-ming, Wo ai mali我愛瑪莉 [I Love Mary], Taipei, Yuanjing, 1979
HWANG Chun-ming, « Xiao guafu » 小寡婦 [Petite veuve], Xiao guafu 小寡婦
[Petite veuve], Taipei, Yuanjing, 1975 (1968), pp.93-213
LI Ch’iao 李喬, Hanye san bu qu 寒夜三部曲 [Trilogie de la nuit d’hiver], Taipei,
Yuanjing, 1979
WANG Chen-ho王禎和, « Jiazhuang yi niu che » 嫁妝一牛車 [Un char à bœufs
pour dot], in Taiwan bendi zuojia duanpian xiaoshuo xuan 台灣本地作家短篇小說選
[Nouvelles choisies d’écrivains locaux taïwanais], Taipei, Dadi, 2003 (1968), pp.27-54
WANG Chen-ho王禎和, Meigui meigui wo ai ni玫瑰玫瑰我愛你 [Rose, Rose, I Love
You], Taipei, Hongfan shudian, 1994 (1984)
WANG Chen-ho, Meiren tu 美人圖 [Portrait des gens beaux], Taipei, Hongfan
shudian, 1985 (1982)
WANG Chen-ho, «San chun ji » 三春記 [L’histoire des trois printemps], Xianggelila
香格里拉 [Shangri-la], Taipei, Hongfan shudian, 1980 (1968), pp.1-29
WANG Chen-ho, « Xiaolin lai Taibei » 小林來台北 [Hsiao-lin vient à Taipei],
Wenxue jikan, 文學季刊 [Trimestriel littéraire], octobre 1973
WANG Chen-ho, Xianggelila 香格里拉 [Shangri-La], Taipei, Hongfan shudian, 1970
WANG Chen-Ho, Rose, Rose, I Love you, trad. du chinois par Howard Goldblatt, Columbia University Press, New York, 1998
WU Zhuo-liu 吳濁流 , Yaxiya de gu’er 亞細亞的孤兒 [Orphelin d’Asie], Taipei,
Yuanjing, 1993 (1949)
91
ZOBEL Joseph, Rue Case-Nègres, Paris, Présence Africaine, 1974 (1950)
Ouvrages en français :
BAKHTINE, Mikhaïl, L’œuvre de François Rabelais et la culture populaire au Moyen Âge et sous la Renaissance, trad. du russe par Andrée Robel, Paris, Gallimard, 1970 BAUDELAIRE Charles, De l’essence du rire, 1855 http://baudelaire.litteratura.com, consulté le 10 avril 2010. BERNABE Jean, CHAMOISEAU Patrick et CONFIANT, Raphaël, Eloge de la Créolité, Paris, Gallimard, 1989 BRAUDEL François, « Préface », La Méditerranée et le Monde méditerranéen à l'époque de Philippe II, Paris, Colin, 1949 FANON Frantz, Les Damnés de la Terre, Paris, La Découverte, 2002 (1961) FANON Frantz, Peau noire, masques blancs, Paris, Editions du Seuil, 1971 (1952) GLISSANT Edouard, L’intention poétique, Paris, Gallimard, 1997 (1969) GLISSANT Edouard, Traité du Tout-Monde : Poétique IV, Paris, Gallimard, 1997 HALBAWCHS Maurice, Les cadres sociaux de la mémoire, Paris, Albin Michel, 1994 (1925) LEE Hsiao-feng, Histoire de Taïwan, trad. du chinois par Yan Hsia-hou, Paris, Editions L’Harmattan, 2004 LEVESQUE Katia, Entre tradition d’oraliture créole et tradition littéraire française, Québec, Nota Bene, 2005, p.87 MARCHAND Sandrine, Sur le fil de la mémoire : Littérature taïwanaise des années 1970-1990, Lyon, Tigre de Papier, 2009 VILLARD Florent, Le Gramsci chinois : Qu Qiubai, penseur de la modernité culturelle, Lyon, Tigre de Papier, 2009
Ouvrages en anglais :
ASHCROFT Bill, GRIFFITHS Gareth and TIFFIN Helen, The Empire Writes Back: Theory and Practice in Post-colonial Literatures, New York, Routledge, 1989
92
CHANG Sung-sheng Yvonne, Modernism and the Nativist Resistance, Contemporary Chinese Fiction from Taiwan, Durham, Duke University Press, 1993 HILLENBRAND Margaret, Literature, Modernity and the Practice of Resistance: Japanese and Taiwanese fiction, 1960-1990, Leiden, Brill, 2007 LAI Ming-Yan, Nativism and Modernity, Cultural contestations in China and Taiwan under Global Capitalism, New York, State University of New York Press, 2008 MIGNOLO Walter D., Local Histories/Global Designs, Princeton, Princeton University Press, 2000 RYDEN Kent C., Mapping the Invisible Landscape: Folklore, writing and sense of place, Iowa City, University of Iowa Press, 1993
Ouvrages en chinois :
BERGMAN Ingrid and BURGESS Alan, Yinggeli Baoman zihuan 英格麗褒曼自傳
[Autobiographie d’Ingrid Bergman], trad. de l’anglais par WANG Chen-ho 王禎和,
Taipei, Yuanjing, 1985
CHANG Chun-huang 張春凰, Taigi bun-hak kai-lun, 台語文學概論 [Introduction à
la littérature en taigi], Taipei, Qianwei, 2001 (ouvrage en taigi)
CH’EN Chien-chung, CHIU Kuei-fen陳建忠 et邱貴芬 (Dir.) Taiwan xiaoshuo shi lun
台灣小說史論 [Discussions sur l’histoire des romans taïwanais], Taipei, Maitian
chubanshe, 2007
CH’EN Fang-ming 陳芳明, Houzhimin Taiwan : wenxue shi lun ji qi zhoubian 後殖民台
灣-文學史論及其周邊 [Taiwan postcolonial : discussions sur l’histoire littéraire et
ses marges], Taipei, Maitian chubanshe, 2002
CHIU Kuei-fen邱貴芬, Houzhimin ji qiwai後殖民及其外 [Le postcolonial et son en-
dehors], Taipei, Maitian chubanshe, 2003
GAO Quan-zhi 高全之 , Wang chen-ho de xiaoshuo shijie 王禎和的小說世界 [Le
monde des romans de Wang Chen-ho], Taipei, Sanmin Shuju, 1997
LU Cheng-hui 呂正惠, Xiaoshuo yu shehui 小說與社會 [Roman et société], Taipei,
Lianjing, 1988
YOU Sheng-guan 游勝冠, Taiwan wenxue bentulun de xingqi yu fazhan 台灣文學本土論
的興起與發展 [L’essor et le développement du discours nativiste dans la littérature
taïwanaise], Taipei, Qunxue, 2009
Articles en français :
93
CALDWELL Roy Chandler Jr « L'Allée des Soupirs, ou le grotesque créole de Raphaël Confiant », Francographies 8, 1999, pp. 59-70 DIAS Nélia, « Imitation et Anthropologie », Terrain, 44, 2005, http://terrain.revues.org/index2610.ht, (consulté le 2 avril 2010) KLÖ TTER Henning, « Vers une société multilingue ? », Perspectives Chinoises, n°85, 2004, http://perspectiveschinoises.revues.org/document685.html (consulté le 11 mars 2010)
Articles en anglais :
BHABHA Hommi, « Of Mimicry and Man: the Ambivalence of Colonial Discourse », October, n° 28, 1984, pp. 125-133 BERRY Michael, « The Translator’s Studio: A Dialogue with Howard Goldblatt », Persimmon: Asian Literature, Arts and Culture, été 2002 BRAITHWAITE Edward Kamau, « Nation Language », in ASHCROFT Bill, GRIFFITHS Gareth, TIFFIN Helen, The Post-Colonial Studies Reader, New York, Routledge, 2006, pp.281-284 CHIU Kuei-fen, « Empire of the Chinese Sign: The Question of Chinese Diasporic Imagination in Transnational Literary Production », The Journal of Asian Studies, Vol.67, n°2, mai 2008, pp.593-620
CORCUFF Stéphane, « Introduction. Taiwan: A Laboratory of Identities », in CORCUFF Stéphane, Memories of the Future: National Identity Issues and the Search for a New Taiwan, New York, Armonk, M.E.Sharpe, 2002, pp.xi-xxv DIRLIK Arif, « The Global in the Local », in ASHCROFT Bill, GRIFFITHS Gareth, TIFFIN Helen, The Post-Colonial Studies Reader, New York, Routledge, 2006, pp.463-467 HARISSON Mark, « Writing Taiwan’s Nationhood », in SHIH Fang-Long, THOMPSON Stuart and TREMLETT Paul-François, Re-Writing Culture in Taiwan, New York, Routledge, 2009, pp.123-139 HEYLEN Ann, « Loading the Matrix: Taiwanese in Historical Perspective », in HARRISON Mark and STORM Carsten, Margins of Becoming. Identity and Culture in Taiwan, Harrasowitz Verlag, 2007 pp.35-49 HEYLEN Ann, « The legacy of Literacy Practices in Colonial Taiwan. Japanese-Taiwanese-Chinese: Language Interaction and Identity Formation », Journal of Multilingual and Multicultural Development, vol 26: 6, 2005, pp.496-511
HUANG I-min, « A Postmodernist Reading of Rose, Rose, I Love you », Tamkang Review, 1986, Vol. XVII, No.1, pp.27-43
94
KINKLEY Jeffrey C., « Mandarin Kitsch and Taiwanese Kitsch in the Fiction of Wang Chen-ho », Modern Chinese Literature, Vol.6, 1992, pp.85-115 MEYERS Ramon H., « A Unique Relationship », in MEYERS Ramon H., A Unique Relationship : The United States and the Republic of China Under the Taiwan Relations Act, Standford, Hoover Institution Press, 1989, pp.1-24 STORM Carsten, « Introduction », in HARRISON Mark and STORM Carsten, The Margins of Becoming. Identity and Culture in Taiwan, Harrasowitz Verlag, 2007, pp.7-18 TRIEZENBERG Katrina E., « Humour in Literature », in RASKIN Viktor, The Primer of Humour Research, Berlin, N-Y, Mouton de Gryter, 2008, p.522 WACHMAN Alan M., « Competing Identities in Taiwan », in FELL Dafydd, The Politics of Modern Taiwan, London, Routledge, Vol.1, 2008, pp.126-192
Articles en chinois :
CH’EN Fang-ming 陳芳明, « Er’er’ba shijian hou de wenxue rentong yu lunzhan »
二二八事件後的文學認同與論戰 [Controverses et identité littéraire après
l’évènement du 28 février], Unitas 聯合文學, n°198, mars 2001, pp.162-175
CH’EN Fang-ming, « Liuling niandai xiandai xiaoshuo de yishu chengjiu » 六 0年代
現代小說的藝術成就 [Succès artistiques des romans modernistes des années 60],
Unitas聯合文學, n°208, février 2002, pp.151-163
CH’EN Fang-ming, « Taiwan xinwenxue shi de jiangou yu fenqi »台灣新文學史的
建構與分期 [Construction et périodisation de l’histoire de la nouvelle littérature
taïwanaise], Unitas 聯合文學, n°178, août 1999, pp.162-173
CH’EN Fang-ming, « Wenxue zuoqing yu xiangtu wenxue de queli » 文學左傾與鄉
土文學的確立 [Radicalisation à gauche de la littérature et établissement de
la littérature du terroir], Unitas 聯合文學, n°183, 2000, pp.128-136
CH’EN Fang-ming, « Xiangtu wenxue yundong de juexing yu zai chufa » 鄉土文學
運動的覺醒與再出發 [Le réveil et le nouveau départ du mouvement de la littérature
du terroir], Unitas 聯合文學, n°221, mars 2003, pp.138-159
CH’EN Pei-feng 陳培豐, « Rizhi shiqi taiwan huawen pai de piaoyou yu xiangxiang :
diguo hanwen, zhimindi hanwen, zhongguo baihuawen, taiwanhuawen » 日治時期台
灣漢文派的飄遊與想像:帝國漢文、殖民地漢文、中國白話文、台灣話文
[Imaginaires et errances des partisans du chinois à Taiwan sous la gouvernance japonaise : chinois impérial, chinois colonial, chinois vernaculaire et « langue
taïwanaise »], Taiwan Lishi yanjiu 台灣歷史研究 [Etudes sur l’histoire de Taïwan],
Volume 5, n°4, décembre 2008, pp.32-83
95
CH’EN Ying-chen 陳映真, « Wenxue laizi shehui, wenxue fanying shehui » 文學來
自社會,文學反映社會 [La littérature vient de la société, la littérature reflète la
société], in YU Tian-cong 尉天驄 , Xiangtu wenxue taolunji, 鄉土文學討論集
[Anthologie de discussions sur la littérature du terroir], Taipei, Yuanjing, 1978, pp.53-67
CHIU Kuei-fen 邱貴芬 « 「Faxian taiwan」 : jiangou taiwan houzhimin lunshu »
「發現台灣」建構台灣後殖民論述 [« Découvrir Taiwan » : construire un discours
postcolonial taïwanais], Zhongwai wenxue 中外文學, vol.21, n 2̈, juillet 1992, pp.151-
168
CHIU Yan-ming 丘彥明 , « Ba huanxiao saman renjian – fang xiaoshuojia wang
zhenhe » 把歡笑撒滿人間 – 訪小說家王禎和 [Répandre le rire parmi les
hommes – Interview de l’écrivain Wang Chen-ho], Meigui meigui wo ai ni 玫瑰玫瑰我
愛你 [Rose, Rose, I Love You], Taipei, Hongfan shudian, 1994 pp.253-261
HSU Nan-cun 許南村 (Ch’en Ying-chen), « « Xiangtu wenxue » de mangdian » 「鄉
土文學」的盲點 [Le scotome de la « littérature du terroir »], in YUTian-cong,
Xiangtu wenxue taolunji, pp.93-99
LEE Yu-lin 李育霖, « Fanyi yu difang de shengchan – yi wang zhenhe xiaoshuo
« Meigui meigui wo ai ni » wei li » 翻譯與地方的生產-以王禎和小說《玫瑰玫瑰
我愛你》為例 [Traduction et production du lieu : le cas de Rose, Rose, I Love You de
Wang Chen-ho], Fanyi yujing : zhuti, lunli, meixue 翻譯閾境:主體、倫理、美學
[Liminalité de la traduction : sujet, éthique et esthétique], Taipei, Shulin, 2009, pp.135-157
LU Cheng-hui呂正惠, « Huangmiu de huaji ju : Wang Chen-ho de rensheng tuxiang
»荒謬的滑稽劇:王禎和的人生圖像 [L’absurde comédie burlesque : Portrait de la
vie de Wang Chen-ho], Wenxing 文星, n°109, 1987, pp-32-36
LU Cheng-hui « Qi, ba shi niandai taiwan xiangtu wenxue de yuanliu yu bianqian »
七、八十年代台灣鄉土文學的源流與變遷 [Les sources et les transformations de
la littérature taïwanaise du terroir dans les années 70-80], in Lu Cheng-hui, Wenxue
jingdian yu wenhua rentong 文學經典與文化認同 [Classiques littéraires et identité
culturelle], Taipei, Jiuge chubanshe, 1995, pp.65-85
LUNG Ying-tai龍瀛台, « Wang Chen-ho zou cuo lu le » 王禎和走錯路了 [Wang
Chen-ho a fait fausse route], Long yingtai ping xiaoshuo 龍應台評小說, [Critique de
romans par Lung Ying-tai], Taipei, Erya Congshu, 1986, pp.77-82
PAI Hsien-yung 白先勇, « Hualian fengtu renwu zhi » 花蓮風土人物誌 [Annales
des coutumes et des personnages de Hualian], in Gao Quan-zhi高全之, Wang chen-ho
de xiaoshuo shijie 王禎和的小說藝術 [Le monde des romans de Wang Chen-ho],
Taipei, Sanmin Shuju, 1997, pp.1-21
96
P’ENG Ko 彭歌, « Bu tan renxing, he you wenxue? » 不談人性,何有文學 ?
[Comment y a-t-il de littérature si on ne parle pas d’humanité?], in YU Tian-cong, Xiangtu wenxue taolunji, 1978, pp.245-267
TUNG Nien東年, « Meiguo meiguo wo ai ni : naoju « Meigui meigui wo ai ni » de
huangmiu yuyi » 美國美國我愛你 -鬧劇《玫瑰玫瑰我愛你》的荒謬寓意 [USA,
USA, I Love You : allusions absurdes dans la farce « Rose, Rose, I Love You »],
Unitas 聯合文學, n°74, décembre 1990, pp.33-36
WANG Chen-ho 王禎和 , « Yongheng de xunqiu », 永恆的尋求 [La quête
perpétuelle], Rensheng de gewang 人生的歌王 [Le roi des chansons de la vie], Taipei,
Lianhe wencong, 1987, pp.1-9
WANG David Der Wei王德威, « Cong lao she dao wang zhenhe : xiandai zhongguo
xiaoshuo de xinüe qingxiang » 從老舍到王禎和-現代中國小說的戲謔傾向 [De
Lao-she à Wang Chen-ho : la tendance à la blague dans les romans chinois modernes],
Cong liu’e dao wang zhenhe 從劉鶚到王禎和 [De Liu’E à Wang Chen-he], Taipei,
Shibao wenhua chubanshe, 1986, pp.149-182
WANG David Der Wei, « Wang zhenhe zou cuo lu le ma ? »王禎和走錯路了嗎?
[Wang Chen-ho a-t-il fait fausse route ?], Yuedu dangdai xiaoshuo 閱讀當代小說
[Lecture de romans contemporains], Taipei, Yuanliu chubanshe, 1991, pp.21-25
WANG T’uo 王拓, « Shi xianshi zhuyi wenxue, bu shi xiangtu wenxue » 是現實主義
文學,不是「鄉土文學」 [C’est la littérature réaliste, non la littérature du «
terroir »], in YU Tian-cong, Xiangtu wenxue taolunji, 1978, pp.100-119
YEH Shih-tao葉石濤, « Taiwan xiangtu wenxue shi daolun » 台灣鄉土文學史導論
[Introduction à l’histoire de la littérature du terroir taïwanais], in YUTian-cong, Xiangtu wenxue taolunji, pp.69-92
YU Kwang-chung 余光中 , « Lang lai le» 狼來了 [Au loup !], in YU Tian-cong,
Xiangtu wenxue taolunji, pp.264-267
YU Su 余素, « Wenxue duitan : wuyue sanshi jie – cong hongloumeng dao wang
zhenhe xiaoshuo»文學對談:〈五月三十節〉-從紅樓夢到王禎和小說
[Entretien littéraire : « La fête du 30ème jour du 5ème mois de l’année lunaire – du Rêve
dans le Pavillon rouge jusqu’aux romans de Wang Chen-ho], Daxue zazhi 大學雜誌,
n°70, décembre 1973, pp.57-65
ZONG Yan-ling et LI Tai-fang 縱燕玲, 李臺芳, « Xunzhao zhenshi de shengyin :
fang Wang Chen-ho » 尋找真實的聲音-訪王禎和 [A la recherche de la voix vraie :
interview de Wang Chen-ho], Taipei Pinglun 台北平論 [Critiques de Taipei], n°1, 1987,
pp.24-29
Autres :
97
Mémoires de master :
CH’EN Chien-chung 陳建忠, Song zelai xiaoshuo yanjiu 宋澤萊小說研究 [Etude des
romans de Song Ze-lai], Qinghua daxue zhongguo wenxue yanjiusuo lunwen 清華大
學中國文學研究所論文 http://ws.twl.ncku.edu.tw/hak-chia/t/tan-kian-tiong/sek-
su/sek-su.htm, consulté le 3 avril 2010.
CH’ENG Ch’ian-ju鄭倩如, Shuangmian fanyi – lun wang zhenhe « Meigui meigui wo ai ni »
de kua wenhua yu kua yuji jiaohuan 雙面翻譯-論王禎和《玫瑰玫瑰我愛你》的跨
文 化 與 跨 語 際 交 換 [Double traduction – Echanges transculturels et
translinguistiques dans Rose, Rose, I Love You de Wang Chen-ho] Taiwan daxue taiwan
wenxue yanjiusuo lunwen 台灣大學台灣文學研究所論文, 2008
Articles Internet : Article sur la chanson « Rose, Rose, I Love You » : http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,935240,00.html Articles sur la présence des GI’s à Taiwan : http://mypaper.pchome.com.tw/iolkk/post/1309820344 http://mypaper.pchome.com.tw/kuan0416/post/1313635815
Biographie et photos de Wang Chen-ho : http://www.lib.ntu.edu.tw/cg/manuscript/wch/life.htm
98
Liste des caractères chinois
Transcription des mots en chinois : Dans notre travail, nous utilisons pour les mots en chinois la transcription en pinyin
(ex : 鄉土文學 xiangtu wenxue). En revanche, pour la plupart des Noms propres
(noms d’écrivains, d’auteurs taïwanais), nous utilisons la transcription Wade Giles actuellement en vigueur à Taïwan, car utilisée par les écrivains eux-mêmes ou par les
maisons d’édition pour transcrire phonétiquement le Nom chinois (ex : 王禎和 Wang
Chen-ho, ou 王文興 Wang Wen-hsing). Pour le lecteur non familiarisé avec le
système Wade Giles, nous pouvons trouver la transcription pinyin des Noms en Wade Giles (ex : Wang Chen-ho : Wang zhenhe) dans la liste ci-dessous.
A
Ahen (Ahen) : 阿恨
B
Banü (prostituées) : 吧女
Baiyin caoza (cacophonie) : 百音嘈雜
Baodiao yundong (mouvement de la protection de Diaoyutai) : 保釣運動
Benshengren (taïwanais « de souche ») : 本省人
Biaozhun (standard, standardisé) : 標準
C
Cao Yu : 曹禺
Chanpin (produit) : 產品
Chedi de zhenshi (profonde vérité) : 徹底的真實
Chen Gexin : 陳歌辛
Cheng Ch’ing-wen : 鄭清文 zheng qingwen
Ch’en Fang-ming : 陳芳明 chen fangming
Ch’en Jo-hsi : 陳若曦 chen ruoxi
99
Ch’en Pei-feng : 陳培豐 chen peifeng
Ch’en Ying-chen : 陳映真 chen yingzhen
Ch’i Teng-sheng : 七等生 : qi dengsheng
Chiu Kuei-fen : 邱貴芬 qiu guifen
Chiu Yan-ming : 邱彥明 qiu yanming
D
Dabishi (Lion le gros-nez) : 大鼻師
Danyin xitong (système monophonique) : 單音系統
Daode (morale) : 道德
Dazhong wenhua (culture de masse) : 大眾文化
De’en tang (la Chapelle de la Grâce) : 得恩堂
Diaoyutai (archipel Diaoyutai) : 釣魚台
Dong Si-wen (le professeur Dong) : 董斯文
Dujia zhongxin (centre de vacances) : 度假中心
E
Er’er’ba shijian (évènement du 28 février) : 二二八事件
F
Fangpi (péter) : 放屁
Fangyan wenxue (littérature dialectale) : 方言文學
Feng Fei-fei : 鳳飛飛
Fuwu (servir, service) : 服務
G
Ganjing (propres) : 乾淨
Guan Jie-ming : 關傑明
100
Gui. beifeng. ren (« Le fantôme, le vent du Nord et l’homme ») : 鬼‧北風‧人
Guomindang (Parti Nationaliste (KMT)) : 國民黨
Guoyu (langue nationale) : 國語
H
Haiyang wenxue (littérature océane) : 海洋文學
Hanye san bu qu (Trilogie de la nuit d’hiver) : 寒夜三部曲
Hongmao jie (sœur Hongmao, grande sœur aux cheveux rouges) : 紅毛姐
Houzhimin jingshen (esprit postcolonial) : 後殖民精神
Houzhimin shiqi (période postcoloniale): 後殖民時期
Hsiao-lin (Hsiao-lin) : 小林 xiao lin
Hualian : 花蓮
Hualian xian : 花蓮縣
Huangminhua (Kominka) : 皇民化
Hwang Chun-ming : 黃春明 huang chunming
J
Jiazhuang yi niu che (« Un char à bœufs pour dot ») : 嫁妝一牛車
Jimo hong (« Le rouge solitaire ») : 寂寞紅
K
Kao-hsiung : 高雄 gaoxiong
Kejia hua (langue hakka) : 客家話
L
Lao She : 老舍
Lee Yu-lin : 李育霖 li yulin
Li Ang : 李昂
101
Li Ch’iao : 李喬 li qiao
Lishi de jianzheng (témoin de l’histoire) : 歷史的見證
Li Yu : 李漁
Lin Yutang : 林語堂
Lu Cheng-hui : 呂正惠 lü zhenghui
Lu He-jo : 呂赫若 lü heruo
Lung Ying-tai : 龍應台 long yingtai
M
Meigui (rose) : 玫瑰
Meigui meigui wo ai ni (Rose, Rose, I Love You): 玫瑰玫瑰我愛你
Meiguo (Etats-Unis) : 美國
Meilidao shijian (évènement de Formose) : 美麗島事件
Meiren tu (Portrait des gens beaux) : 美人圖
Meiyuan (aide financière états-unienne) : 美援
O
Ouyang Tzu : 歐陽子 ouyang zi
P
Pai Hsien-yung : 白先勇 bai xianyong
P’eng Ko : 彭歌 peng ge
Putonghua (putonghua, langue commune) : 普通話
Q
Qingjie (propre et pur, purifier) : 清潔
Qu Qiubai : 瞿秋白
Qu zhongguohua (désinisation) : 去中國化
102
S
San chun ji (« L’histoire des trois printemps ») : 三春記
Sanjiao ma (« Le cheval à trois pattes») : 三腳馬
Seqing goudang (intrigue sexuelle) : 色情勾當
Shanghai gongbao (Communiqué de Shanghai) : 上海公報
Shechang zhizao chanpin (ouvrir une entreprise de production) : 設廠製造產品
Shejing tiantang (paradis de l’éjaculation) : 射精天堂
Shen lai zhi bi (« venir du pinceau de Dieu ») : 神來之筆
Shidai de jianzheng (témoins d’une époque) : 時代的見證
Sulai yao chujia ! (« Sulai va se marier ! ») : 素來要出嫁 !
T
Taigi (taïwanais): 台語 : taiyu
Taiwan huawen (langue taïwanaise) : 台灣話文
Taiwan teshuxing (particularité taïwanaise) : 台灣特殊性
Taiwan wenxue (littérature taïwanaise) : 台灣文學
Taiwan xiangtu wenxue (littérature du terroir taïwanais) : 台灣鄉土文學
Taiwan yu (langue de Taïwan) : 台灣語
T’ang Wen-biao : 唐文標
Tung Nien : 東年 dong nian
W
Waishengren (chinois Continentaux): 外省人
Wanfa : 萬發
Wang Chen-ho : 王禎和 wang zhenhe
Wang Dewei : 王德威
103
Wang T’uo : 王拓 wang tuo
Wang Wen-hsing : 王文興 wang wenxing
Wendanyou (pomelos) : 文旦柚
Wenxue jikan (Trimestriel littéraire (revue)) : 文學季刊
Wenyanwen (langue classique) : 文言文
Wo ai mali (« I Love Mary ») : 我愛瑪莉
Wu Cun : 吳村
Wu Nien-jen : 吳念真 wu nianzhen
Wu Zhuo-liu : 吳濁流 wu zhuoliu
Wusi yundong (mouvement littéraire chinois du 5 mai 1919) : 五四運動
X
Xiandai wenxue (Littérature moderne (revue)) : 現代文學
Xiandai zhuyi wenxue (littérature Moderniste) : 現代主義文學
Xianggelila (« Shangri-la ») : 香格里拉
Xiangtu (terroir) : 鄉土
Xiangtu lunshu (discours du terroir) : 鄉土論述
Xiangtu wenxue (littérature du terroir) : 鄉土文學
Xiangtu wenxue de kouhao (slogans de la littérature du terroir) : 鄉土文學的口號
Xiangtu wenxue lunzhan (polémique de la littérature du terroir) : 鄉土文學運動
Xiao congming (mesquineries) : 小聰明
Xiao renwu (petits personnages) : 小人物
Xiaolin lai taibei (« Hsiao-lin vient à Taipei ») : 小林來台北
Xin taiwan wenxue (nouvelle littérature taïwanaise) : 新台灣文學
Xueyuan (étudiantes) : 學員
104
Y
Yang K’uei : 楊逵 yang kui
Yishi (conscience) : 意識
You Sheng-guan : 游勝冠
Yu Kwang-chung : 余光中 yu guangzhong
Yu Tian-cong : 尉天驄
Yuanliao (matières premières) : 原料
Yuedu zhang’ai (handicap de lecture) : 閱讀障礙
Z
Zai zhimin shiqi (période de recolonisation) : 再殖民時期
Zhang Ailing : 張愛玲
Zhenshi de shengyin (voix vraie) : 真實的聲音
Zhimin shiqi (période coloniale) : 殖民時期
Zhongguo baihuawen (chinois vernaculaire) : 中國白話文
Zhongguo pubianxing (universalité chinoise) : 中國普遍性
Zhongjian renwu (personnages intermédiaires) : 中間人物
Zhuyin fuhao (système phonétique zhuyin) : 注音符號
Annexe 1
105
Liste des œuvres de fiction de Wang Chen-ho :
Nom de l’oeuvre Lieu de publication (Revue)
Année de publication
1. 〈真相〉
[« La vérité »]
台大青年
Jeunesse de Taida
1961
2. 〈鬼‧北風‧人〉
[« Le fantôme, le vent du Nord et l’homme »]
現代文學
Littérature Moderne
1961
3. 〈永遠不再〉(夏日)
[« Plus jamais »] (« Jour d’été »)
現代文學
Littérature Moderne
1961
4. 〈寂寞紅〉
[« Rouge solitaire »]
作品
Œuvres
1963
5. 〈快樂的人〉
[« L’homme heureux »]
現代文學
Littérature Moderne
1964
6. 〈來春姨悲秋〉
[« Les chagrins d’automne de Tante Lai-chun »]
文學季刊
Trimestriel littéraire
1967
7. 〈嫁妝一牛車〉
[« Un char à bœufs pour dot »]
文學季刊
Trimestriel littéraire
1967
8. 〈五月三十節〉
[« La fête du 30ème jour du 5ème mois du calendrier lunaire »]
文學季刊
Trimestriel littéraire
1967
9. 〈三春記〉
[« L’histoire des trois printemps »]
文學季刊
Trimestriel littéraire
1968
10. 〈永遠不再〉
[« Plus jamais »]
文學季刊
Trimestriel littéraire
1969
11. 〈那一年冬天〉
[« L’hiver de cette année là »]
文學季刊
Trimestriel littéraire
1969
12. 〈月蝕〉
[« L’éclipse »]
文學季刊
Trimestriel littéraire
1970
13. 〈兩隻老虎〉
[« Deux petits tigres »]
幼獅文藝
Youth Literary
1971
14. 〈小林來台北〉
[« Hsiao-lin vient à Taipei »]
文學季刊
Trimestriel littéraire
1973
15. 〈伊會唸咒 !〉
[« Elle sait lancer des malédictions !»]
中外文學
Chungwai Literary
1974
16. 〈素來要出嫁 !〉
[« Su-lai va se marier !]
聯合報
United Daily
1976
17. 〈香格里拉〉
[« Shangri-la »]
中國時報
China Times
1979
18. 《美人圖》
[Portrait des gens beaux]
中國時報
China Times
1981-1982
19. 〈老鼠捧茶請人客〉
[« Le rat sert le thé aux invités »]
文季
Wenji
1983
106
20. 《玫瑰玫瑰我愛你》
[Rose, Rose, I Love You]
聯合報
United Daily
1984
22. 〈素來要出嫁-終身大事〉
[« Su-lai va se marier – un grand évènement »]
聯合報
United Daily
1985
23. 《人生歌王》
[Le roi des chansons de la vie]
聯合報
United Daily
1986
24. 《兩地相思》
[La nostalgie des deux lieux]
聯合文學
Unitas
1993 (posthume et incomplet)
107
Annexe 2
Photos de Wang Chen-ho
Source : http://www.lib.ntu.edu.tw/cg/manuscript/wch/life.htm
Wang Chen-ho (deuxième en partant de la gauche), avec ses
« camarades modernistes » : debout en partant de la droite :
Ouyang Tzu 歐陽子, Chen Jo-hsi 陳若曦, Wang Wen-hsing 王
文興, Pai Hsien-yung 白先勇 notamment. Debout à gauche de
Wang Chen-ho : le poète Du Guo-qing : 杜國清. 1961
Photo avec Zhang Ailing 張愛玲, de
visite à Taïwan. 1961.
Photo prise dans les années 70 dans le domicile de Wang
Chen-ho avec ses amis du Trimestriel Littéraire (wenxue
jikan文學季刊): debout en partant de la gauche : Yu
Tian-cong 尉天驄, Pai Hsien-yung 白先勇, Wang Chen-
ho et son épouse, Ch’en Ying-chen 陳映真.
Assis en partant de la gauche : Le professeur Yao Yi-wei
姚一葦 et son épouse, en 4e position : Hwang Chun-ming
黃春明.
Jeune diplômé de
l’Université Nationale de
Taïwan. 1961.