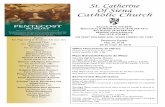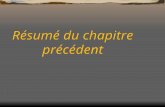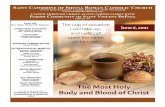Louis Josserand ou la construction d'une autorité doctrinale (avec Catherine Fillon)
Transcript of Louis Josserand ou la construction d'une autorité doctrinale (avec Catherine Fillon)
1
RTD Civ. RTD Civ. 2009 p. 39 Louis Josserand ou la construction d'une autorité doctrinale Frédéric Audren, Chargé de recherche au CNRS (Maison française d'Oxford) Catherine Fillon, Maître de conférences à la Faculté de droit de Lyon (Université Lyon III) Louis Josserand est à l'honneur. Plusieurs études lui ont été récemment consacrées (1) et les deux volumes de ses Essais de téléologie juridique viennent d'être réédités opportunément aux éditions Dalloz par les soins de David Deroussin (2). La plupart des travaux consacrés au professeur lyonnais appartiennent au domaine de l'histoire des idées : ils portent sur sa pensée juridique, l'étendue de son influence, voire les présupposés idéologiques qui la fondent. Cette approche s'efforce de reconstruire la cohérence des énoncés produits par l'auteur, tente de suivre les méandres de sa pensée et d'en saisir toutes les subtilités. Dans cette perspective, si Josserand peut être élevé à la dignité de « grand juriste », c'est à la force de son argumentation et la pertinence de ses analyses qu'il doit son rang. Ces travaux n'en sont pas moins frappés par une ambiguïté : ils assimilent purement et simplement pensée juridique et doctrine. Assimilation, en réalité, qui les conduit à se saisir de l'oeuvre de Josserand comme une simple production intellectuelle (aussi intéressante soit-elle) alors qu'elle prétend être autre chose et, sans doute, bien plus : les écrits du juriste lyonnais se donnent fondamentalement comme opinions doctrinales et cherchent à peser sur le droit lui-même, à faire autorité dans le champ doctrinal (3). Etudier Josserand comme un auteur de la doctrine suppose donc de partir d'un fait essentiel : le juriste s'efforce de faire discuter ses opinions, de les faire reconnaître, par ses collègues, comme judicieuses, originales, intéressantes ou encore incontournables. Bref, faire de ses propositions sur le droit des points de passages obligés pour tout autre auteur traitant des mêmes objets que lui. Peut-être même peut-il espérer marquer de son empreinte l'activité législative ou encore l'évolution jurisprudentielle (4). A la différence d'une histoire de la pensée juridique qui s'attache principalement à l'originalité et aux apports scientifiques d'un auteur, l'histoire de la doctrine s'intéresse avant tout à la force des propositions doctrinales. Comment tirer les conséquences historiographiques de ce léger déplacement ? Il faut considérer que ce ne sont pas les qualités intrinsèques, argumentatives de l'oeuvre d'un auteur qui la projettent sur le devant de la scène doctrinale. Nombreux sont, en effet, les travaux brillants et solidement argumentés qui restent oubliés, sans postérité ni lecteur, sur les rayonnages des bibliothèques ! C'est parce que certaines opinions sont jugées intéressantes et utiles par d'autres auteurs qu'elles deviennent, à leur tour, des ressources mobilisables, qu'elles circulent et se propagent dans le champ doctrinal. Le crédit d'un auteur est toujours entre les mains de ses collègues ; la force d'une proposition de droit est déterminée de l'extérieur, au contact d'un environnement hostile ou favorable. Rejetant une démarche purement philologique, l'histoire de la doctrine travaille, avant tout, à élucider les modalités, les formes et les usages de la reconnaissance savante. Ainsi, le problème est moins de déterminer si un auteur appartient ou non à la doctrine que de restituer les multiples opérations qu'un tel auteur accomplit pour se singulariser dans le champ doctrinal. Là où l'histoire des idées privilégie l'exégèse des énoncés contenus dans la littérature juridique, l'histoire de la doctrine se consacre à la description des formes de l'énonciation du discours savant (les façons de dire) (5). Le cas de Louis Josserand est, à cet égard, particulièrement instructif. Tout au long de sa carrière, le professeur lyonnais n'a pas ménagé ses efforts pour capter un public sensible à ses arguments, il a déployé une activité intense pour intéresser à ses thèses les collègues français et étrangers, les membres du Palais, voire le législateur. Aucun cynisme dans cette attitude : plus simplement une incontestable clairvoyance sur les moyens nécessaires à mobiliser pour la victoire d'une certaine vision du droit. Au début de sa carrière, il s'appuiera
2
sur quelques soutiens parisiens et n'hésitera pas à user, voire à abuser, de la polémique pour faire connaître ses opinions. Elles apparaitront rapidement trop radicales à un milieu parisien qui les tient pour suspectes. Puis, s'adossant à la Faculté de droit de Lyon dont il a exercé pendant plus de vingt ans le décanat, il travailla inlassablement au renforcement de son propre crédit comme au rayonnement de l'institution qu'il dirigeait. Grandir dans le champ doctrinal, c'est d'abord s'associer à des forces plus durables. Sa personnalité et son oeuvre, elles aussi, ne manquèrent pas de faire l'objet de multiples enrôlements et usages dans les batailles doctrinales et institutionnelles de l'époque. Au sommet de sa carrière, étendant sa surface sociale et scientifique, il a été élevé par de nombreux collègues au rang de porte-parole des facultés de droit de province en lutte contre l'hégémonie parisienne avant d'être nommé à la Cour de cassation (6). S'installant, autour de 1930, au centre du champ doctrinal, le « civiliste ordinaire » était devenu un civiliste consacré (7), une autorité doctrinale, mais une autorité sans véritable descendance. Figures du rénovateur Comment entrer dans la carrière ? Docteur en droit, Josserand a inscrit ses premiers écrits dans le sillage des civilistes animés par la volonté d'une rénovation de la culture juridique française (8). Repéré par Raymond Saleilles, soutenu par Eugène Garsonnet et Edmond Thaller, Josserand s'est vu ainsi associé, au tournant de XX
e siècle, à plusieurs manifestations
parisiennes du réseau des réformateurs (9). Mais, désireux de souligner son originalité scientifique, le jeune civiliste s'est rapproché progressivement de ses collègues lyonnais dont certains s'illustraient par la radicalité de leurs positions scientifiques et politiques. Face à une faculté de droit parisienne engagée fermement dans la promotion de la dogmatique, sa concurrente lyonnaise prenait ostensiblement le parti des sciences sociales et du droit comparé en affirmant sa sensibilité aux questions sociales (10). Josserand s'efforça alors de faire reconnaître sa démarche en maintenant un équilibre difficile entre conformité aux canons de la discipline et singularité d'une oeuvre à faire. Enclencher le cycle de crédibilité scientifique : le soutien du milieu parisien Brillant étudiant, Josserand a accumulé les marques de l'excellence académique : plusieurs fois lauréat de la Faculté de droit de Lyon (notamment, les 1
er prix de droit romain et de droit
civil), distinction au concours général des Facultés de droit pour l'année 1889 (première mention) (11). Il s'inscrivit au barreau de Lyon et ajouta, en 1892, à son palmarès le prix Mathevon (1
er secrétaire de la conférence du stage). Cette même année était surtout marquée
par la soutenance de ses deux thèses sous la présidence de Charles Appleton. Il reçut pour ce travail un prix décerné au nom du département du Rhône. L'Union patriotique de Rhône lui décerna, à cette occasion, un prix pour s'être distingué pendant toute la durée de ses études. Sa thèse de droit romain est un Essai sur la nature des actions qui sanctionnent les negotia nova. Face à un « problème aussi scabreux » (12), il s'efforçait de discuter les théories de Cujas et celles de Calixte Accarias sur les contrats innommés. Sa thèse de droit français, Des successions entre époux, est une ferme prise de position en faveur de la récente loi du 9 mars 1891 qui « en conférant une vocation successorale à l'époux en concours avec les héritiers légitimes [...] a réalisé une oeuvre vraiment humanitaire et a mis le code civil en harmonie avec nos moeurs, notre civilisation » (13). Sujet d'actualité mais, en définitive, assez peu controversé dans les milieux universitaires. A l'origine de la loi de 1891, une proposition du député Delsol, déposée en 1872, avait fait l'objet d'une consultation des facultés de droit entre 1873 et 1875. Sur les neuf facultés de droit ayant répondu dans les temps, huit avaient approuvé l'extension de la vocation héréditaire des époux (14). Grâce à l'initiative de Delsol, aux efforts de jurisconsultes tels que Gustave Boissonade, « se trouve comblée une des lacunes les plus regrettables qu'ait jamais présentées une législation » (15). Les années qui suivirent la soutenance des thèses ouvraient une période plus difficile pour Josserand. Il échoua à deux reprises au concours d'agrégation et conserva un souvenir très amer de ses échecs (16). Néanmoins sa prestation remarquée aux épreuves de 1896 l'avait désigné aux fonctions de chargé de cours à Lyon (où il assura les cours d'histoire du droit public et de droit administratif pour les aspirants au doctorat) puis, à contre coeur, à Alger pour enseigner le droit romain. En 1898, concourrant une nouvelle fois, il était reçu premier (section droit privé et droit criminel). Le président du jury, Eugène Garsonnet relevait que
3
Josserand « s'est distingué dans toutes les épreuves, même dans sa leçon de procédure, où il est resté à la même hauteur. C'est dès maintenant un excellent professeur apte à rendre de grands services » (17). Sans aucun doute, le sectionnement du concours (droit privé, droit public, histoire du droit et économie politique), expérimenté pour la première fois à l'occasion des épreuves de 1898, avait placé certains candidats dans des conditions plus ou moins favorables. Privatiste, peu versé dans les domaines du droit public et de l'histoire du droit, Josserand, tirait, quant à lui, un net parti de la réforme introduite en juillet 1896. Si le jury du concours affirmait n'avoir pas repéré « l'apparition de sujet d'une valeur exceptionnelle », il n'en était pas moins sensible au talent de ce jeune civiliste qui avait su, l'année précédant le concours, se faire remarquer en publiant une étude De la responsabilité du fait des choses inanimées (1897). Bénéficiant d'un accueil positif (18), son travail avait été alors aussitôt rapproché par les commentateurs de celui d'Ernest Tarbouriech (professeur au collège libre des sciences sociales) et de Raymond Saleilles (19). Au même moment, ce dernier avait en effet publié un essai d'une théorie objective de la responsabilité délictuelle, Les accidents du travail et la responsabilité civile (20). Si chacun des deux hommes avait travaillé dans l'ignorance de la brochure de l'autre, Josserand ne cachait pas sa dette à l'égard d'une étude antérieure de Saleilles dont il tirait le plus grand bénéfice pour sa propre réflexion (21). Josserand regrettait néanmoins le caractère trop étroit de la théorie de son aîné parisien et préconisait de substituer à l'obligation née du fait de l'industrie l'obligation du fait des choses, à la notion du risque professionnel la notion de risque créé (22). Malgré de telles réserves, il soulignait l'exactitude et l'équité de la solution développée par Saleilles. Aussitôt, ce dernier félicita chaleureusement son jeune collègue de s'engager, avec lui, en faveur d'une théorie objective de la responsabilité (23). Son essai sur la responsabilité du fait des choses inanimées était un coup de maître. La publicité qui lui fut donnée, l'écho qu'il rencontra auprès de certains civilistes et de spécialistes de la législation industrielle ne furent incontestablement pas étrangers à son succès à l'agrégation. Josserand était alors attaché à la Faculté de droit de Lyon où il devait faire toute sa carrière enseignante. Il assurait les enseignements de procédure civile et de voies d'exécution dont la réunion formait la chaire abandonnée par Etienne Bartin sur laquelle il était nommé professeur titulaire de droit civil en décembre 1902 après le départ à Paris du même Bartin. Sa réussite au concours, venant confirmer les espoirs placés en lui, et ses premiers travaux le situant dans la mouvance de juristes réformateurs qui militaient en faveur d'une « socialisation du droit » assurèrent aussitôt à sa plume une certaine visibilité dans le champ doctrinal. La Faculté de droit de Paris portait, à ce moment, un regard bienveillant sur les premiers pas du professeur lyonnais. Il collabora dès 1899 au Dalloz périodique en confiant des notes. Dès la création de la Revue trimestrielle de droit civil (1902), il prenait en charge, sept ans durant, la Chronique de jurisprudence en matière de droit civil consacrée aux personnes et au droit de la famille (24). La même année, il commençait à assurer une chronique Transports terrestres dans le Bulletin de jurisprudence des Annales de droit commercial. Ce périodique était animé par le professeur parisien Edmond Thaller (ancien professeur de Josserand à Lyon) avec le soutien de Raymond Saleilles, d'Albert Wahl (deux fondateurs de la Revue trimestrielle de droit) ou encore de Paul Pic (professeur à la Faculté de droit de Lyon). Signe supplémentaire de ce lien privilégié avec la Faculté parisienne : en 1900, Josserand était associé à la parution de la 3
e édition du Traité élémentaire des voies
d'exécution d'Eugène Garsonnet (qui avait présidé « son » jury d'agrégation) (25). Le jeune agrégé prit également part au Congrès international de droit comparé, organisé du 31 juillet au 4 août 1900, sous le patronage de la Société française de législation comparée, à l'occasion de l'Exposition universelle (26). Sa présence dans cette assemblée doit autant à ses bonnes relations parisiennes (notamment avec Saleilles) qu'à son intérêt, partagé d'ailleurs par de très nombreux collègues (27), pour le droit comparé déjà manifeste dans De la responsabilité du fait des choses inanimées, et concrétisé par son adhésion, en 1899, à la Société de législation comparée. A l'occasion de ce Congrès, il présenta un mémoire intitulé Conception générale du droit comparé devant la section Théorie générale et méthode. Cette grande manifestation se donnait pour objectif de « fournir à la science du droit comparé une formule précise et une direction sûre, dont elle a besoin pour assurer son développement ». (28). Dans sa contribution, Josserand soutenait que le droit comparé « remplit, vis-à-vis du législateur, cette mission élevée qui lui est naturellement dévolue de révélateur de
4
l'orientation juridique » (29). A ses yeux, le droit comparé ne peut aucunement se limiter à une simple description des législations étrangères. Il est un instrument au service de la rénovation juridique : « Une multitude de grands courants juridiques sont ainsi révélés au législateur par le droit comparé, courants qu'il doit suivre, qu'il peut descendre plus ou moins rapidement, mais auxquels il ne saurait impunément résister » (30). Comme Saleilles et Lambert, Josserand considérait que le droit comparé n'est pas une science spéculative, mais un instrument de progrès législatif national, et un moyen pour rapprocher autant que faire ce peut des législations nationales. Ce lien étroit entre droit civil comparé et rénovation juridique est illustré également par la réflexion de Josserand menée, en 1904, sur la propriété collective. Dans cet « Essai » paru dans le livre jubilaire de la commémoration du Centenaire du Code civil, initiée par la Société d'études législatives (31), il cherchait à fixer les contours de la « physionomie juridique » de « propriété en main commune » (Gesammte Hand) susceptible de concurrencer utilement les formes traditionnelles de propriété commune que sont la personnalité morale et l'indivision. Sous l'influence de Saleilles, le système allemand et suisse de la Gesammte Hand avait fait l'objet d'un débat spécifique lors du Congrès international de droit comparé et retenait alors l'attention de la doctrine (32). La conclusion de Josserand est sans ambiguïté : « la propriété commune est susceptible de supplanter avantageusement l'indivision romaine dans tous les groupes qui ne sont pas suffisamment étroits, durables et vivants pour comporter la personnification » (33). Conforme aux évolutions sociales contemporaines, cette forme de propriété lui apparaissait comme « le triomphe des idées collectives appliquées à la propriété ». Ne masquant pas sa répugnance pour l'indivision jugée fragmentaire et individualiste, Josserand prédisait que « dans notre droit même, les progrès de l'institution germanique se poursuivront fatalement aux dépens de l'institution romaine » (34). Le classement proposé par le professeur lyonnais (Personnalité morale, Patrimoine tenu en mains communes et indivision) a été accueilli favorablement par certains de ses collègues comme Hauriou, Charmont ou Percerou (35). De l'abus des controverses : se rapprocher de ses collègues lyonnais Josserand poursuivit sa réflexion sur la responsabilité en publiant en 1905 une étude consacrée à l'abus des droits (36). Ce petit ouvrage contribua à asseoir la réputation un peu sulfureuse de son auteur. L'intérêt qu'il manifestait pour l'abus de droit était alors partagé par une partie des milieux juridiques. La loi du 27 décembre 1890, faisant suite à une intense mobilisation des agents des chemins de fer (37), avait provoqué un regain d'actualité pour l'abus de droit et élevé le contrat de louage de services à durée déterminée au rang « de champ de réalisation par excellence de l'abus de droit de résiliation unilatérale » (38). Surtout, le monde juridique européen débattait à la même époque de la théorie de l'abus de droit, à commencer dans l'Empire allemand engagé depuis 1874 dans les travaux préparatoires de son code civil (39). Il n'est pas besoin de rappeler ici les sévères critiques formulées par la doctrine classique française à l'égard d'une telle théorie et les résistances qu'elle lui opposa (40). Ceux qui apparaissaient comme les plus chauds partisans de cette thèse ne s'y rallièrent clairement, non sans tergiversations (41), qu'après la parution de la thèse d'Ernest Porcherot soutenue à Dijon en 1901 (42). Cette promotion de la théorie de l'abus de droit était, il est vrai, inséparable d'enjeux politiques et sociaux que l'idée de « solidarité sociale » avait fait alors surgir. Personne ne se dissimulait les implications proprement politiques, inquiétantes aux yeux d'une large fraction de la doctrine, que cette théorie recèle. Cependant, pour ses partisans déclarés, la théorie de l'abus de droit devint rapidement le symbole d'une vision du droit comme fait social et économique. Ce lien entre la théorie de l'abus de droit et les ambitions réformatrices de plusieurs civilistes était souligné dès la première année de la Revue trimestrielle de droit civil (1902) (43). D'une manière plus générale, ce qui se jouait autour de l'abus de droit était non seulement une vigoureuse critique des limites du droit individuel, mais encore une certaine manière de défendre un modèle sociologique de l'interprétation juridique (44). Certes, les rénovateurs de la science du droit n'étaient pas tous des partisans de l'abus de droit ; mais ces derniers firent de cette théorie un instrument au service de leur offensive de modernisation juridique. Rien ne le prouve mieux que les efforts de Saleilles, au sein de la commission de révision du code civil, pour tenter d'introduire la théorie de l'abus de droit dans le titre préliminaire du code civil, « sous la forme d'un
5
principe absolu dont on eût le droit de tirer logiquement toutes les conséquences qui dériveraient d'une violation d'ordre public » (45). La tentative a fait long feu et Saleilles devait reconnaître qu'il avait eu « dans cette commission du code civil à lutter contre forte partie » (46). En publiant en 1905 son étude De l'abus des droits, Josserand n'ignorait pas qu'il intervenait sur un terrain particulièrement miné. Prenant parti vigoureusement en faveur de l'abus de droit, le professeur lyonnais se rangeait aux côtés de ceux qui combattent « le bloc syllogistique des traditionalistes qui ne savent rien comprendre au mouvement de la vie »
(47). Plus encore que les témoignages de sympathie des partisans (déjà convaincus) de l'abus de droit, c'est plutôt la discrétion entourant l'immédiate réception de son opuscule qui frappe l'observateur (48). Il n'est pas impossible que la diffusion de l'opuscule ait été, il est vrai, particulièrement réduite - comme en témoigne la rareté des exemplaires actuellement disponibles. Plus fondamentalement encore, son étude arrivait en quelque sorte un peu tard : Josserand prétendait généraliser la théorie de l'abus de droit à l'ensemble des règles juridiques, en faire un principe général d'interprétation alors même que la commission de révision du code civil venait justement de la cantonner au rôle de théorie spéciale, restreinte quant à sa portée et à ses effets, renvoyée à l'article 1382 du code civil (49). Circonstance aggravante, la radicalité de l'argument et le ton volontairement combatif, pour ne pas dire provocateur, conduisaient les commentateurs à juger De l'abus des droits avec un certain scepticisme. « L'abus des droits est, affirme Josserand, une notion sociale qui implique la recherche des mobiles individuels ; elle est une théorie qui fait passer au crible social les actes des individus » (50). Et d'ajouter : « Un droit ne peut être réalisé impunément (et encore sous la réserve de la théorie du risque) qu'à la condition d'être mis par son titulaire au service d'un objectif licite, d'un motif légitime » (51). En somme, la théorie de l'abus a « une valeur sociale, une signification morale de tout premier ordre » (52). Même si le juriste lyonnais s'efforçait d'établir que la conception finaliste de l'abus de droit, bien loin de contredire la conception d'une responsabilité objective, s'articulait avec elle, une large partie de la doctrine ne manqua pas de déplorer la tendance subjective et moralisatrice d'une telle approche. Comme le constatait le chroniqueur du Dalloz, les idées développées par Josserand « sont trop nouvelles pour n'être pas un peu aventureuses » (53). Une autre dimension de L'abus des droits heurtait manifestement bien des lecteurs : l'opposition tranchée, mise en scène par l'auteur, entre le Palais et l'Ecole. Cette dernière représente « sur cette question l'extrême arrière-garde du mouvement juridique ». Concernant l'abus de droit, Josserand constatait que « l'Ecole est vaincue d'avance ; l'expérience démontre que toutes les résistances par elle opposées à la pratique ont été stériles et qu'on ne saurait avec des mots, arrêter l'essor d'un mouvement jurisprudentiel » (54). L'un de ses critiques lui opposa pourtant que, bien souvent, « l'Ecole a victorieusement combattu la jurisprudence, qui faisait fausse route, et l'a poussée dans des voies nouvelles et fécondes » (55). La conviction, partagée avec ses collègues lyonnais tels que Lambert et Lévy (56), d'une prescience de la jurisprudence devait conduire à une transformation de la méthode juridique : les constructions de l'Ecole devaient se fonder sur le recueil et le classement précis des manifestations jurisprudentielles, c'est-à-dire du « droit vivant » (57). Plutôt que d'élever des cathédrales théoriques susceptibles de servir de guide ou de modèle aux professionnels du droit immergés dans la quotidienneté de la pratique (58), Josserand invitait les jurisconsultes à une démarche, plus modeste, d'ordre expérimental : se placer au ras du droit pour observer et coordonner le mouvement juridique (59). Non pas entretenir le rêve de l'application pratique de théories savantes (primat de la théorie), mais promouvoir une théorie de la pratique jurisprudentielle attentive au traitement judiciaire de la réalité sociale (primat de la pratique). En définitive, si les positions de Josserand sur l'abus des droits furent jugées originales par la doctrine, elles n'en occupaient pas pour autant une position centrale dans les débats sur la responsabilité. Cet accueil mitigé réservé à son Abus des droits n'a sans aucun doute pas été étranger à la volonté de l'auteur de publier, plus de vingt ans plus tard, dans un contexte fort différent, De l'esprit des droits et de leur relativité (1927). Face à un tel accueil, Josserand a plutôt préféré consolider sa réputation de spécialiste du droit des transports comme l'atteste la parution en fascicules, entre 1909 et 1911, du volume qu'il a rédigé pour le Traité de droit commercial, sous la direction d'Edmond Thaller. Cette vaste entreprise débutée autour de 1905 (60), confirmant un intérêt déjà ancien,
6
l'engageait sur une voie originale sans négliger pour autant les questions de responsabilité civile (61). Cette somme d'une facture académique fut accueillie favorablement par la doctrine. La distinction claire qu'il opérait entre force majeure et cas fortuit retint tout particulièrement l'attention de plusieurs auteurs (62). Le nom de Josserand fut même évoqué pour une éventuelle chaire des Transports à Paris (63). Cette situation ne manque pas d'ironie : le juriste lyonnais s'était tout particulièrement illustré en 1908 dans le domaine du droit des transports à l'occasion d'une controverse l'opposant à un professeur parisien, Ambroise Colin, sur le problème de la responsabilité civile des automobilistes. Le Parlement et l'opinion publique s'étant saisis du problème de la responsabilité relative aux accidents d'automobiles, la Société d'études législatives décida alors d'intervenir dans le débat. Dans l'une de ses séances, Ambroise Colin rapporta en avril 1907 sur un projet de loi sur la matière (64). La discussion se prolongea dans les pages de la Revue politique et parlementaire où s'opposèrent frontalement Ambroise Colin et un avocat P. Dupuich (65). Colin « cherche à imposer aux chauffeurs une prudence et une modération salutaire pour eux-mêmes, pour le public et pour le progrès de l'industrie » (66). Il ajoutait : « nous dirions dans notre matière que, si un engin périlleux est jeté dans la circulation, les risques inhérents à son fonctionnement, doivent être supportés par celui qui en retire du plaisir ou du profit plutôt que par le public » (67). Par conséquent, le professeur parisien préconisait l'extension au domaine des accidents d'automobile du principe contenu dans la loi du 9 avril 1898 sur les accidents du travail. Il proposait également « l'institution d'un fonds de garantie, alimenté par les contributions de tous les propriétaires d'automobiles, et qui assurerait le service des indemnités dues aux victimes d'accidents ou de dommages accidentels, lorsque l'auteur en serait inconnu ou insolvable » (68). Cette position provoqua une fureur d'autant plus grande des associations d'automobilistes que Colin présidait une Société protectrice contre les excès de l'automobile [à laquelle adhèrent certains de ses collègues comme Adrien Audibert (69)] destinée à porter ses projets de réforme et à lutter plus efficacement contre les « énergumènes du cent à l'heure » (70). Lorsque Josserand, grand amateur d'automobiles, annonça sa décision d'intervenir sur la question de « l'automobile et du droit » à l'Automobile club du Rhône, en février 1908, cet événement fut aussitôt interprété par la presse automobile comme une manifestation d'« anticolinisme » (71). Si Josserand a refusé ce rôle de porte-parole des Automobile-clubs et s'est efforcé de ménager Ambroise Colin, sa communication n'en formulait pas moins de sévères critiques contre la Société protectrice (dont la campagne était jugée « anti-démocratique ») et contestait les statistiques qu'elle prétendait apporter à l'appui de sa critique de la violence routière (72). Mais son plaidoyer modéré, en faveur de la modernisation des routes, de l'élaboration d'un « code de roulage », d'un délit de fuite, d'une sévérité accrue pour les chauffards fut, en définitive, bien accueilli par les amis de la « démocratisation de l'automobile » (73) comme par le parti des « autophobes ». En dépit d'un rejet de l'idée du fonds de garantie, Ambroise Colin reconnut lui-même, dans le Bulletin de la Société d'études législatives, que le programme de son collègue lyonnais « concorde sur beaucoup de points avec celui qui a été soutenu devant la SEL au nom de sa Commission et, au-dehors, par la Société protectrice contre les excès de l'automobile » (74). En somme, la paix était préservée. Dans cette controverse, l'intervention habile de Josserand le plaçait au premier rang des membres du « parti [des] chauffeurs raisonnables » (A. Colin) et renforçait son autorité dans le champ des questions juridiques liées aux transports. En 1911, sa contribution au Traité général théorique et pratique de droit commercial, qui s'attachait tout particulièrement au transport de marchandises et au transport des personnes, était saluée par ses collègues. L'introduction de l'ouvrage insiste sur l'évolution des transports comme fait de civilisation et rappelle les querelles liées à la création des chemins de fer, les colères soulevées par la bicyclette et contre l'automobile. L'ouvrage Les transports venait couronner un intérêt ancien pour les progrès du machinisme. Dès les premières pages, son De la responsabilité du fait des choses inanimés ne fait-il pas une place de choix à cette figure du « voyageur victime d'un accident de chemin fer » ? Cependant, le machinisme et les transports étaient pour Josserand bien plus qu'une simple matière sur laquelle exercer son habilité juridique. Il ne s'agit pas seulement d'observer les mutations du paysage technique et ses conséquences juridiques mais également, et d'une manière plus originale, de dessiner le paysage juridique contemporain du point de vue du voyageur embarqué dans une machine en mouvement. Le
7
transport mécanique était, chez Josserand, un prisme perceptif qui modela largement son approche de l'univers juridique. L'apparition de l'automobile à la fin du XIX
e siècle a soulevé
bien des difficultés (adapter les chaussées, développer les signalisations, assurer la sécurité des piétons, ...). La révolution qu'elle a provoquée entraîna, par la même occasion, « un conflit de libertés, de droits et d'intérêts [...] qui s'envenime chaque jour » (75). L'augmentation de la circulation en ville l'a transformée en théâtre des conflits qui appelait une réglementation urgente (76). « L'omniprésence de la vitesse en ville propage les dangers liés à la circulation motorisée et des lieux jusqu'alors paisibles deviennent peu sûrs. L'impression ressentie est celle d'une force aveugle, d'une abstraction » (77). L'espace concurrentiel ouvert par la circulation automobile (78) était une parabole adéquate pour désigner les luttes de la vie sociale : « La vie est une mêlée où les intérêts, légitimes ou non, s'entrecroisent et se heurtent sans répit ». Et de souligner : « Dans une société quelconque, tous les droits sont mitoyens et le rôle du législateur consiste, non pas à assigner à chacun d'eux un refuge inviolable, mais à organiser leurs luttes, à conditionner sagement, pour l'amortir, le choc des intérêts en présence, - en un mot à réaliser le juste équilibre des forces individuelles qui gardent perpétuellement le contact » (79). La civilisation du machiniste laissait entrevoir au juriste un autre point. Les objets techniques devenaient si complexes que le sujet ignorait généralement tous les principes sur lesquels ils sont fondés. Le sujet était devenu un usager agissant suivant un mode d'emploi, un apprentissage particulier ou alors se contentant d'être transporté, déplacé, orienté, ... Glissement sensible de la souveraineté du sujet de droit vers les intérêts de l'usager du droit qui irrigue profondément la démarche du professeur lyonnais. Dans un univers où les individus sont appréhendés comme des « forces vives » (selon la formule de Jhering) qui tentent d'étendre d'une manière infinie leurs droits, il importe, aux yeux de Josserand, que « le droit ne peut être mis au service que de mobiles plausibles » (80). Bref, « utiliser son droit dans son intérêt effectif » et non dans un but antisocial (81). On comprend bien ici combien la référence à Jhering (82) permet de soutenir la vision réaliste du droit de Josserand (83). Cette vision réaliste, qui trouvait sa matrice empirique dans l'expérience de la culture technique, constitua le socle de son combat contre « l'absolutisme des droits subjectifs » (84). Cette approche du paysage juridique a contribué, dans la première décennie du XX
e siècle, à
rapprocher Josserand de ses collègues lyonnais, à commencer par Edouard Lambert et Emmanuel Lévy, militant socialiste actif, dont il ne partageait pourtant pas les options politiques. Au fur et à mesure que la Faculté lyonnaise affirmait ses ambitions scientifiques, sans craindre de s'engager dans des controverses âpres, les liens se distendaient avec la Faculté de Paris. A la veille de la Grande guerre, Lyon n'était plus l'antichambre de son aînée parisienne ; cette dernière fermait sa porte à plusieurs candidats de la capitale des Gaules
(85). Pour Josserand également l'attrait de la Capitale semblait s'être dissipé : élu doyen, il ne manqua pas de défendre l'orientation comparatiste et sociale de la Faculté de Lyon qui la distinguait particulièrement de sa rivale parisienne. Figures de l'administrateur Lorsque le 2 mai 1913 il accédait officiellement au décanat, Louis Josserand héritait non seulement de la fonction, mais encore d'une conception bien lyonnaise de celle-ci, inaugurée par son ancien maître Exupère Caillemer (1875-1908) et poursuivie, dans la mesure où sa santé vite défaillante le lui avait permis, par Octave Flurer (1908-1913) (86). Certes, l'élégance et le sens de la mesure de Josserand lui interdisaient de renouer avec l'autoritarisme et la pompe chers au doyen Caillemer. Mais si son style, en sa qualité de doyen, fut beaucoup moins ostentatoire et délibérément consensuel, il ne remit nullement en question les buts supérieurs du décanat tels que ses prédécesseurs les avaient définis. Ils tenaient en quelques propositions très simples : le corps professoral devait être convaincu qu'il était primordial d'étendre le rayonnement de la Faculté de droit de Lyon et il appartenait naturellement au doyen de prendre ou de soutenir fermement toutes les initiatives dès lors qu'elles pourraient servir cette finalité. Que Josserand ait fait pleinement sienne cette conception ne souffre aucun doute, non plus que son souci permanent de protéger et même d'enrichir le patrimoine d'inventivité universitaire dont il était devenu, beaucoup plus rapidement que prévu, le dépositaire (87). Pierre Garraud, son successeur à la tête de la Faculté de droit, ne s'y était d'ailleurs pas trompé, lorsqu'il déclarait en 1936 à son collègue depuis peu promu conseiller à la Cour de cassation : « Cette puissance de travail, ce souci de
8
toujours faire plus et mieux (...) expliquent encore que dans toutes les initiatives qui ont développé l'activité et le rayonnement de la Faculté de droit et de l'Université de Lyon, vous ayez, Monsieur le Conseiller, tantôt joué le rôle de promoteur, tantôt fourni un appui efficace à ceux qui avaient eu l'idée d'une réalisation nouvelle ». Levier de pouvoir classique, le décanat auquel il fut reconduit par ses collègues, sans interruption jusqu'en 1935 (88), a été pour Josserand l'occasion d'accroître son propre crédit ainsi que le rayonnement de l'institution dont il avait la charge. Très naturellement, le doyen a été amené, en effet, à capitaliser au profit du professeur les réseaux de relations universitaires que non seulement ses activités administratives propres, mais encore les relations intellectuelles de ses collègues avaient contribué à tisser autour de la Faculté de droit de Lyon. Celle-ci avait de bonne heure parié, avec la fondation d'une filiale à Beyrouth, sur une ouverture internationale qui s'élargira plus encore dans l'entre-deux-guerres avec la création de l'Institut de droit comparé. Méthodiquement organisée, la mobilisation des nombreux contacts noués à l'étranger par sa Faculté a permis au professeur Josserand d'assurer une large diffusion de ses thèses juridiques et d'affermir sa notoriété au sein de la doctrine française quitte, pour ce faire, à effectuer un détour par l'étranger. Affirmer les ambitions d'une Faculté provinciale Probablement parce qu'elle était de création récente (1875), la Faculté de droit lyonnaise a eu à coeur de compenser sa jeunesse et, partant, son défaut de crédibilité classique, celle qui repose sur le sacre du temps, par une vitalité institutionnelle que ses chefs ont voulu hors pair. Dès la fondation de la Faculté de droit, le doyen Caillemer, bien aiguillonné en ce sens il est vrai par les recteurs d'académie successifs, a ainsi manifesté, à longueur de discours de rentrée annuelle, son obsession de faire de la jeune institution dont il était le chef une faculté d'élite. Puisqu'il était lucidement admis qu'elle ne pourrait jamais détrôner la Faculté parisienne et prétendre à la première place en France, du moins se devait-elle de devenir la première des facultés de droit de province. Le doyen fondateur pouvait rapidement jubiler devant le constat que sa faculté était devenue, en effet, quantitativement la première par le nombre de ses étudiants et, qualitativement, une faculté d'excellence. En témoignaient le nombre des lauréats lyonnais au concours généraux et les prouesses accomplies par les jeunes docteurs au concours d'agrégation. Pareille politique d'excellence supposait encore un corps professoral lui-même de premier ordre et l'une des plus grandes inquiétudes du doyen Caillemer devait longtemps résider dans l'hémorragie régulière de professeurs (89) qui frappa sa faculté au cours des années 1890, au profit de la rivale entre toutes : la Faculté de droit de Paris. Dans ce pays de vieille tradition centralisatrice, le prestige dont jouit la capitale a, à coup sûr, contribué pour beaucoup à ces départs successifs. Mais l'exode dont la Faculté de droit lyonnaise fut la victime s'explique aussi par la discrimination que l'Etat lui-même avait instauré au profit des professeurs parisiens dont les traitements étaient de très loin supérieurs à ceux de leurs collègues en poste en province (90). Plus de considération et plus d'argent en faveur des collègues parisiens : il n'en fallait pas plus pour que, bien au-delà des seuls juristes (91), cette discrimination alimentât au sein du corps professoral lyonnais le sentiment pénible de ne constituer que des professeurs de « seconde zone » (92), toujours éclipsés par leurs collègues parisiens et devant leur céder systématiquement la préséance intellectuelle. Le doyen Caillemer put toutefois calmer ses alarmes touchant à son personnel enseignant à la fin des années 1890. Avec les réussites à l'agrégation de Paul Pic (1891), puis de Jean Appleton (1895), d'Emile Bouvier (1897), de Louis Josserand (1898) et enfin de René Gonnard (1901), la Faculté de droit de Lyon tenait enfin un noyau dur d'enseignants sinon tous de souche, du moins tous de formation universitaire intégralement lyonnaise, dont on pouvait espérer que leurs divers motifs d'attachement à Lyon seraient plus forts que le chant des sirènes parisiennes. Dans les premières années du XX
e siècle, Caillemer pouvait être d'autant
plus rassuré que les jeunes agrégés de formation parisienne, qui venaient d'être récemment nommés, tels que Edouard Lambert (1896), Paul Huvelin (1899) ou Emmanuel Lévy (1901), contrairement à leurs prédécesseurs, ne semblaient pas être en mesure de quitter Lyon au plus vite et le renom qui devait rapidement entourer les travaux des uns et des autres allait contribuer à conforter le capital de crédibilité de la Faculté lyonnaise. Pour autant, l'ambition
9
de cette dernière n'était pas parfaitement comblée par ce premier résultat. Tout comme les autres composantes de l'Université lyonnaise, elle savait que si être la première en province est une chose, exister de façon significative, sinon face, du moins à côté, de Paris en est une autre. « Un autre voeu, c'est que nos Universités élargissent leur horizon, qu'elles ne restent pas des Facultés juxtaposées, égoïstement confinées dans leurs sphères, qu'elles ne se contentent pas de laisser leurs membres poursuivre isolément et modestement un labeur souvent glorieux. Il importe qu'elles rayonnent au dehors, qu'elles se fassent connaître dans le monde en tant que centres de recherche scientifique, qu'elles détruisent une légende trop répandue, hélas, à l'étranger, celle d'une France dont toute l'énergie intellectuelle a reflué vers Paris, tandis que la Province est une steppe morne où sont égarées quelques individualités de mérite » (93). Il est indéniable que l'Université lyonnaise, toutes facultés confondues, avait développé la conviction profonde que pour sortir de l'ombre projetée par l'Université parisienne sur ses petites soeurs provinciales, il n'y avait de meilleure stratégie que celle reposant sur la recherche d'une reconnaissance hors des frontières françaises. Aussi s'est-elle engagée avec enthousiasme et détermination dans l'aventure internationale lorsque, à l'orée du XX
e siècle,
celle-ci lui fut proposée par le ministère de l'Instruction publique. Pour faire barrage à l'influence intellectuelle exercée par l'Allemagne via ses universités, le gouvernement français demanda, en effet, aux siennes, dont il venait de rénover les structures, de déployer toute leur inventivité pour, dans un double mouvement, attirer vers elles des étudiants étrangers et exporter par-delà les frontières les lumières françaises. Sous la houlette du recteur d'Académie Paul Joubin, l'Université lyonnaise fut de celles qui répondirent à l'appel. De ses efforts entrepris à partir de 1910 devait naître, à la veille de la Première guerre mondiale, une implantation universitaire remarquable dans l'empire ottoman
(94). L'Université lyonnaise a, en effet, donné le jour à Beyrouth à deux écoles : une école d'ingénieurs et une école de droit délivrant la licence française. Remarquable par son ampleur, l'oeuvre lyonnaise ne l'était pas moins par son originalité. En effet, alors que ses homologues parisienne, nancéenne, bordelaise et grenobloise avaient misé sur l'exportation des lettres françaises, Lyon avait été la seule à oser jouer des cartes scientifiques et juridiques, ce dont le ministère des Affaires étrangères la louait puisqu'elle accomplissait ainsi, en faveur des populations auxquelles les établissements s'adressaient, oeuvre salutaire de professionnalisation. La Faculté de droit de Lyon, quant à elle, pouvait rendre grâce à la persévérance, à l'énergie et à la passion que l'un de ses professeurs, l'historien du droit Paul Huvelin, avait déployées dans cette entreprise. Grâce à lui, non seulement la Faculté de droit de Lyon était devenue détentrice d'une filiale dans l'Orient méditerranéen, mais encore elle pouvait désormais y rivaliser avec la Faculté de droit de Paris. En effet, la seule école de droit français créée à l'étranger antérieurement à l'initiative lyonnaise était celle du Caire. Fondée en 1891 à l'initiative du corps diplomatique en poste en Egypte, cette dernière institution avait été rattachée, au chapitre des examens subis par ses étudiants, à la Faculté de droit de Paris et elle était rapidement apparue, en conséquence, comme son annexe orientale. Son homologue lyonnaise avait dû fournir un effort beaucoup plus soutenu pour parvenir à ses fins, mais en 1913 elle avait la satisfaction d'être désormais en mesure de faire jeu égal au Proche-Orient avec son aînée et rivale parisienne. Les conditions étaient réunies pour que les antagonismes Paris-Lyon puissent une nouvelle fois trouver matière à s'exprimer. Et de fait, durant tout l'entre-deux-guerres, le Proche-Orient allait devenir le théâtre d'un conflit, certes infiniment moins dramatique que ceux qu'il lui fut donné de connaître depuis : le micro conflit universitaire dans lequel les Facultés de droit de Lyon et de Paris firent assaut d'ingéniosité pour limiter le rayonnement de l'autre. Dans ce conflit permanent, le doyen Josserand allait fermement défendre les couleurs de sa faculté et ce d'autant plus naturellement que le rayonnement international accru de l'institution dont il avait pris la tête fut manifestement l'un des objectifs premiers de son décanat. Richesses orientales d'un décanat Inaugurée en novembre 1913, six mois après l'accession de Josserand au décanat, l'Ecole de droit de Beyrouth était l'un des fleurons de ce patrimoine universitaire lyonnais que le nouveau doyen devait s'attacher à faire fructifier, quelles que fussent les nombreuses
10
difficultés qui se dressèrent sur sa route. Pour cause de guerre mondiale, il fallut en effet fermer l'Ecole de droit de Beyrouth en 1914 et sa réouverture, à partir de 1917, est apparue des plus incertaines, à l'image des destinées de la Syrie et du Liban, alors que se profilait dans la région une fin du conflit mondial fort avantageuse pour l'Angleterre. Il serait trop long de relater ici en détail la complexe opération, réalisée par le front solidaire formé par l'Université et les chambres de commerce de Lyon et Marseille, afin de sensibiliser l'opinion publique à l'urgence de sauvegarder dans cette partie du monde l'influence française en général et les divers intérêts des institutions susmentionnées en particulier. Le doyen Josserand y prit inévitablement part es qualité de doyen de la Faculté de droit et de membre du Conseil de l'Université, comme il prit part, assidûment, aux jurys qui, à partir de 1919, effectuèrent chaque hiver le voyage au Liban pour y faire passer les examens de la licence et du doctorat en droit délivrés par l'Ecole française de droit de Beyrouth finalement rescapée de la guerre mondiale. Président du jury en 1921, puis en 1927, et encore en 1933, le doyen lyonnais a visiblement tenu, par sa présence personnelle, à manifester tout l'intérêt que le chef de la Faculté mère portait à sa lointaine filiale. Cette présence régulière était sans nul doute encore nécessaire pour que soit bien défendu, contre les entreprises parisiennes, le pré carré libanais des juristes lyonnais. En effet, afin de réduire les frais engendrés par les voyages en Orient des missions d'examen, le ministère de l'Instruction publique avait imposé la constitution d'un jury unique, composé d'universitaires parisiens et provinciaux, proposés à parité par les deux facultés implantées dans cette région du monde et choisis au final par le ministère. Après leur passage à Beyrouth, les professeurs en mission devaient gagner Le Caire pour examiner à leur tour les étudiants égyptiens. Présidé au Liban par un professeur lyonnais, le jury passait sous l'autorité d'un professeur parisien une fois franchie la frontière égyptienne. Il est peu de dire que la cohabitation entre les juristes parisiens et leurs collègues lyonnais fut régulièrement tendue (95). Les premiers ont très tôt tenté par divers biais symboliques de prendre pied au Liban (96), pour la plus grande exaspération de leurs collègues lyonnais lesquels, par la voix de leur doyen, devaient régulièrement réclamer la dissociation, qui leur fut toujours refusée, des deux jurys d'examen. Beyrouth constituant toutefois une position lyonnaise inexpugnable, la sourde querelle opposant Parisiens et Lyonnais s'est finalement déplacée et cristallisée sur l'Ecole arabe de droit de Damas. Officiellement créé 1923, ce foyer du nationalisme syrien financé par l'émir Fayçal inquiétait les autorités françaises, lesquelles avaient rapidement constaté tant la radicalité des positions politiques anti-françaises qui s'exprimaient en son sein que la prodigieuse médiocrité des études qui y étaient dispensées. Faire passer délicatement, par le biais d'un jeu d'équivalence entre licence syrienne et licence française, cette inquiétante école sous une tutelle universitaire métropolitaine était devenu l'objectif recherché par le Haut commissariat au Liban et en Syrie. Il ne devait pas manquer de bonnes volontés : pour les professeurs parisiens comme pour leurs collègues lyonnais, l'Ecole de Damas représentait évidemment une nouvelle perspective d'implantation universitaire et, par le fait, un nouveau champ de lutte où les antagonismes universitaires Paris/province trouvaient une occasion neuve de se déployer. Si Josserand a pu obtenir gain de cause en 1927 auprès du ministère de l'Instruction publique, sa satisfaction a été de courte durée. Ni les professeurs, ni les élèves damasquins n'étaient prêts à accepter la tutelle lyonnaise (97), car elle était synonyme, pour ces nationalistes syriens, de tutelle libanaise. Aussi les professeurs de Damas, lesquels n'avaient sans doute pas manqué de relever les palpables tensions existant entre les membres de la commission d'examen qui venait chaque année inspecter leur établissement, jetèrent-ils de l'huile sur le feu en revendiquant de ne relever que de Paris... Même si le ministère de l'Education nationale opposa sur le coup un refus catégorique (98), il semble bien que cette solution ait, en pratique (99), triomphé jusqu'en 1939. Ce coup d'arrêt infligé à l'influence lyonnaise en Syrie ne porta nul préjudice à sa situation bien établie au Liban, d'autant que cette dernière avait été confortée, sous le décanat de Josserand, par une judicieuse gestion pédagogique de l'Ecole de Beyrouth. Composé du doyen, du président de l'Association lyonnaise pour le développement de l'enseignement supérieur et technique à l'étranger (100) et du directeur de l'Ecole de Beyrouth, le trio qui présidait aux destinées intellectuelles de la filiale lyonnaise avait rapidement compris non seulement la nécessité d'ouvrir ses enseignements sur le droit musulman et le droit comparé, mais encore de recourir à des talents libanais pour dispenser ces derniers cours. Loin de s'arc-
11
bouter sur une position purement défensive d'enseignement du seul droit français par des enseignants eux-mêmes importés de métropole, la Faculté lyonnaise semble avoir admis de bonne heure le caractère inéluctable de l'indépendance à venir du Liban et, en conséquence, la nécessité de dispenser, avec le concours des élites libanaises, une formation juridique intégrant le droit local. Cette main tendue à la culture juridique autochtone et aux hommes du pays sous mandat n'était certes pas du goût du ministère de l'Instruction publique qui y a opposé une résistance dont le doyen Josserand a fini, à force d'opiniâtreté, par venir à bout. Il est vrai que c'est au détriment de l'histoire du droit, une discipline qu'il n'a jamais portée dans son coeur, que Josserand entendait réaliser les aménagements proposés. Quand bien même il pouvait invoquer, dès 1919 (101), tout à la fois les mauvais résultats et le peu d'intérêt des étudiants pour l'histoire du droit, ainsi que le soutien, difficilement suspect d'hostilité à cette discipline, de Paul Huvelin, le ministère ne capitula totalement que dans les années Trente. Bien en a pris au doyen Josserand de se montrer aussi obstiné, car cette ouverture d'esprit a produit, humainement parlant, des conséquences fructueuses. La correspondance que les deux enseignants libanais, Nagib Aboussouan et Choucri Cardahi, ont entretenue avec leurs collègues lyonnais atteste des sentiments de confiance, d'affection et même, lorsque le destinataire est Josserand, d'admiration qui s'étaient établis. Aussi lorsque Choucri Cardahi, qui professait le cours de droit comparé depuis 1925, accéda deux ans plus tard aux fonctions de ministre de la Justice de la République du Liban, c'est tout naturellement Josserand, d'ailleurs présent pour cause de présidence de jury d'examen à Beyrouth, qu'il associa à la rédaction du code libanais des obligations et des contrats (102). Cette décision fut perçue par les collègues du doyen comme une récompense décernée par le Liban à leur faculté toute entière (103). Elle n'en devait moins apparaître surtout - et le temps écoulé n'a rien changé à l'affaire - comme une marque de reconnaissance des talents et des compétences du seul civiliste Louis Josserand lequel était désormais en situation de faire triompher dans la nouvelle loi libanaise les thèses qui lui étaient chères depuis longtemps. Comment construire à son profit un réseau international ? Pour le doyen lyonnais, 1927 a été sans nul doute une année d'accélération dans sa carrière professionnelle. Non seulement elle voyait sa promotion à une qualité - celle de codificateur - dont bien peu de ses collègues métropolitains pourraient se prévaloir, mais encore le doyen lyonnais faisait paraître L'Esprit des droits et leur relativité, un des ouvrages majeurs qui restent attachés à son nom et dans lequel il avait repris, en le creusant plus profondément, ce sillon de jeunesse qu'est l'abus des droits. Sa correspondance à propos de ce dernier ouvrage est sans équivoque sur la diffusion internationale qu'il était désormais en mesure de lui donner. Jusqu'en 1926, la politique d'envoi de ses ouvrages était restée centrée sur le monde universitaire français et elle ne touchait que de façon très marginale les pays limitrophes (Belgique, Italie). L'élargissement de la sphère géographique de diffusion de ses ouvrages est perceptible, déjà, au cours de l'année 1926 pendant laquelle ses archives privées, à propos de la seconde édition des Transports, enregistrent l'apparition de deux nouveaux correspondants belges, appelés à devenir des fidèles entre les fidèles du doyen lyonnais (Georges Cornil et Maurice Ansiaux), d'un universitaire suisse (Ernest Roguin) et d'un magistrat roumain (Eugen Petit) lequel, pendant les cinq années qui suivirent, devait s'avérer dans son pays natal un propagandiste zélé autant qu'enthousiaste des thèses juridiques de Josserand. La correspondance de l'année 1927, reçue à l'occasion de la parution de L'Esprit des droits, confirme cette tendance à la recherche d'une reconnaissance internationale, laquelle prend alors une ampleur nouvelle tant par le nombre de personnes concernées que par la diversité de leur nationalité. L'ouvrage avait été adressé non seulement à des collègues de la vieille Europe (anglais, suisses, roumains, polonais, serbes, tchécoslovaques), mais encore à quelques-uns du Nouveau Monde. Josserand ne parvint certes pas à établir des liens épistolaires durables avec chacun d'entre eux. Toutefois, les professeurs anglais Buckland (Cambridge), Gutteridge (Londres), Lee (Oxford), leurs homologues américains Garner (Université d'Illinois) et Wigmore (Université de Chicago), enfin le tchèque Stieber (Université de Prague) sont venus, à cette occasion, allonger la liste des correspondants étrangers réguliers de Louis Josserand. La publication, l'année suivante, des Mobiles dans les actes juridiques de droit privé témoigne de la persistance des efforts de son auteur pour toucher un lectorat universitaire international, en même temps que de la dynamique d'accroissement des
12
relations et contacts étrangers qui s'était mise en place et devait désormais s'alimenter, semble-t-il d'elle-même, jusqu'à la fin de la carrière de Josserand. En 1928, ses liens avec le monde anglo-saxon s'étaient manifestement renforcés, notamment par des contacts durables noués avec le professeur anglais Walton, Mikailo Konstantinovitch offrait désormais un relais fidèle en Serbie, et le Japon lui-même, via Masaichiro Ishizaki, devenait accessible au doyen lyonnais. Dès l'année suivante l'entremise d'Ishizaki l'avait mis en relation avec l'une des plus grandes autorités japonaises, le professeur Sugiyama. Il est relativement aisé de reconstituer les mécanismes ayant présidé à l'établissement de ce large réseau international. Certains pays, comme la Roumanie et le Japon, sont devenus accessibles au doyen par le truchement d'anciens étudiants venus se former à Lyon, auprès de lui-même ou bien auprès de son collègue comparatiste Edouard Lambert. Ainsi, quand le magistrat roumain Eugen Petit avait été l'élève, reconnaissant autant qu'éperdu d'admiration, de Josserand, Masaichiro Ishizaki avait été celui d'Edouard Lambert sous la direction duquel il avait réalisé, en 1928, une thèse consacrée au droit corporatif de la vente des soies. De façon plus générale, c'est bien sur l'activité d'Edouard Lambert qu'il faut se pencher pour retracer tant l'histoire du développement des relations internationales de la Faculté de droit de Lyon que celle, intimement liée à la précédente, de la renommée internationale de son doyen pendant l'entre-deux-guerres. Un temps marginalisé par le scandale qui avait entouré en 1907 sa démission fracassante de l'Ecole Khédiviale du Caire (104), Lambert n'en avait pas moins involontairement travaillé, dès avant la Première guerre mondiale, à l'ouverture internationale de la Faculté lyonnaise. Ses déclarations en faveur de l'indépendance de l'Egypte ayant attiré à Lyon une colonie d'étudiants égyptiens (105), l'ombrageux professeur avait organisé pour eux un séminaire d'études orientales qui fut assurément le laboratoire expérimental duquel devait finalement naître en 1921 l'Institut de droit comparé de Lyon. Certains des buts assignés à ce dernier portent ostensiblement l'empreinte du contexte dans lequel il a été pensé. Conçu à la fin de la Première guerre mondiale, alors que l'Université lyonnaise, comme tant d'autres, accueillait un important contingent de soldats américains auxquels un enseignement devait être dispensé en attendant leur démobilisation et leur retour au pays, l'Institut de droit comparé entendait consacrer ses réflexions à l'analyse des systèmes juridiques des deux pays alliés de la France, l'Angleterre et les Etats-Unis, et travailler au rapprochement de la jurisprudence anglo-saxonne de la jurisprudence française. Sans oublier ni démentir son intérêt premier pour le droit musulman, Edouard Lambert donnait à ses travaux une nouvelle direction tournée désormais vers le monde anglo-saxon, ce qui ne devait pas manquer de le mettre lui-même et ses étudiants en liens avec les collègues d'outre-Manche comme d'outre-Atlantique. La création de l'Institut de droit comparé n'aurait évidemment pas été possible sans le soutien institutionnel que le doyen Josserand a fourni à cette initiative pionnière pour en faire triompher l'intérêt et le bien-fondé devant le ministère de l'Instruction publique. Pour autant que les sources dont nous disposons permettent d'en juger, il semble que Josserand avait compris immédiatement tout le profit que la Faculté de droit de Lyon pourrait retirer de l'entreprise proposée par Lambert, entreprise déjà réalisée à l'étranger, mais encore sans égale en France. En mars 1919, une délibération prise par le conseil de la Faculté à l'instigation du doyen avait affecté la somme de 3 000 F, léguée par un ancien étudiant « mort pour la patrie » (106), à l'achat des premiers ouvrages de la future bibliothèque de l'Institut encore à naître. Dans son rapport sur la situation de la Faculté pour l'année 1918-1919, il soulignait que la décision de procéder à la création de l'Institut de droit comparé avait été une décision unanime de ses collègues et il se disait convaincu que celui-ci « constituerait un organisme unique dans nos Universités dont l'action pourrait être singulièrement féconde ». La dépense occasionnée par cette création, ajoutait-il quelques lignes plus loin, serait peu de chose par rapport à l'importance des buts poursuivis. Chaque année il devait relater, à l'occasion de son discours de rentrée de la Faculté, les étapes de la construction de ce nouvel édifice qui reçut sa consécration finale du ministère de l'Instruction publique en 1922. L'attachement du doyen à cette création ne devait pas faiblir passé le cap de sa naissance. Les activités de l'Institut de droit comparé figurent toujours en bonne place dans le rapport décanal annuel durant tout l'entre-deux-guerres. Par ailleurs, Josserand ne devait pas manquer de tirer un parti original de la création de l'Institut lorsqu'il organisa les fêtes du Cinquantenaire de la Faculté de droit, lesquelles se déroulèrent le 18 mars 1926. Mobilisant
13
les carnets d'adresses de ses collègues et, une nouvelle fois, au premier chef celui d'Edouard Lambert (107), il avait convié à Lyon nombre d'universitaires anglais, américains, belges, tchèques, grecs, italiens et espagnols. La distinction du doctorat honoris causa fut alors solennellement remise aux professeurs anglais Lee, Gutteridge, Buckland, au professeur américain James Garner, au professeur tchèque Stieber, aux professeurs belges Maurice Ansiaux et Georges Cornil, au professeur espagnol Saldaña. L'opération était triplement profitable : les liens à l'étranger que le jeune Institut de droit comparé avait pu d'ores et déjà nouer étaient resserrés par cette démonstration d'amitié et de reconnaissance universitaire (108) ; la Faculté de droit, quant à elle, marquait de la sorte la route déjà parcourue sur le chemin du rayonnement international autant que sa détermination à persévérer dans cette voie ; enfin, le doyen Josserand lui-même n'était pas en reste au chapitre des bénéfices, puisque l'ordonnateur des festivités lyonnaises avait étoffé son cercle de relations étrangères. Sa correspondance indique qu'il devait parvenir, non seulement à fidéliser l'amitié de nombre des personnes rencontrées à cette occasion, mais encore à mobiliser la plume de certains d'entre eux en sa faveur comme le prouvent les comptes rendus qu'ils commirent désormais bien volontiers à chacune des parutions portant le nom du doyen lyonnais. Les plus fidèles, dans cet exercice du compte rendu régulier d'ouvrage, furent incontestablement le Belge Georges Cornil (109) et le Tchèque Stieber qui ne manquèrent pas d'utiliser les revues de leur université respective pour faire connaître les travaux de leur collègue lyonnais. L'Institut de droit comparé fut encore utilisé par le doyen via, cette fois-ci, certains de ses étudiants. L'originalité et le caractère innovant du nouveau centre de recherches ayant rapidement attiré sur lui l'attention et les bienfaits de la fondation Rockefeller, les bourses dont cette dernière fit profiter plusieurs étudiants du jeune Institut de droit comparé leur permirent de porter jusqu'aux Etats-Unis non seulement la bannière de leur université d'origine, mais encore, et à sa demande, le nom même de leur doyen (110). C'est en particulier au fellow Robert Valeur, l'un des doctorants de Lambert, que Josserand avait confié, en 1927, le soin d'établir la liste des professeurs américains les plus susceptibles d'être intéressés par ses travaux. Le jeune homme, qui deux années durant sillonna l'Angleterre et plus encore les Etats-Unis et enseigna même à Columbia, constituait, il est vrai, un informateur de premier ordre qui remplit bien volontiers l'office pour lequel son doyen l'avait sollicité (111). Il faut bien admettre, qu'en dépit de tous ses efforts, les travaux de Josserand n'eurent pas aux Etats-Unis l'écho que leur auteur espérait, même si Ernst Freund fit bien dans l'Illinois Law Rewiev (112) une recension de l'Esprit des droits et si, quelques années plus tard, le doyen Wigmore promit de rendre compte de la publication du Cours de droit civil positif dans la même revue. Il n'en reste pas moins une certitude : le doyen Josserand a délibérément cherché à acquérir une audience internationale, dans le but probable de conforter son autorité en France même. Celle-ci n'était pourtant pas inexistante dans les années Vingt. Même si sa production intellectuelle, dans les années 1919-1926, n'était pas encore soumise à la cadence soutenue, pour ne pas dire affolante, qui sera la sienne entre 1927 et 1939, elle n'apparaît ni languide, ni paresseuse. En plus des chroniques et notes sous arrêts au Dalloz, de plus en plus fréquentes à partir de 1923, elle s'était concentrée sur les mises à jour et rééditions du manuel (113) et du traité auxquels il avait déjà contribué avant-guerre. La seconde édition des Transports (que les développements de l'aéronautique et de l'industrie automobile rendaient indispensables) parue au début de l'année 1926, accueillie dans les comptes rendus et auprès de ses correspondants avec force éloges, semble lui avoir permis d'apparaître comme un spécialiste incontesté de ces délicates questions que le développement des moyens de locomotion rendait d'une brûlante actualité. Josserand, en outre, ne pouvait décemment déplorer, comme son collègue Lambert devait le faire, d'être tenu en ostracisme par la communauté universitaire. En effet, on peut relever divers signes qui témoignent d'une forme de reconnaissance de son groupe professionnel. La suggestion faite par son ancien professeur, Henry Berthélemy, devenu doyen de la Faculté de droit de Paris, de faire présenter L'Esprit des droits et leur relativité à l'Institut (114) et l'accueil chaleureux qu'un autre ancien doyen de la Faculté de droit de Paris, par ailleurs secrétaire dudit Institut, Charles Lyon-Caen
(115), réserva à cette idée constituent l'un de ces signes. De même, la participation de Josserand au jury d'agrégation en 1922 à l'invitation d'Emile Garçon (116) et, plus encore,
14
le choix de sa personne par le ministre de l'Instruction publique pour présider le même jury quatre années plus tard sont également des manifestations de la montée en autorité du doyen lyonnais. Cette entrée dans le cercle des élus appelés à procéder au renouvellement du corps professoral est, certes, bien loin de constituer un gage certain de pérennité intellectuelle. Néanmoins, cette admission dans le club des membres du jury d'agrégation vaut, pour l'époque où elle est décidée, certificat d'intégration professionnelle attestant, sinon de la visibilité intellectuelle grandissante du professeur concerné, du moins de la solidité de ses amitiés et de son réseau professionnel. Mais, comme le cas de Louis Josserand devait le démontrer, l'estime de ses pairs et une production intellectuelle - fût-elle intense et soutenue comme l'a été la sienne - ne sauraient être des conditions suffisantes pour s'imposer en figure d'autorité. Ce n'est que par la grâce de la polémique et de la contestation de ses thèses juridiques que le provincial Louis Josserand a fini par tenir dans les années trente une place centrale dans le petit monde de la doctrine civiliste, traditionnellement dominé par ses collègues parisiens. Figures de l'auctorialité L'on ne peut exclure que Josserand ait cherché, consciemment ou non, à provoquer autour de son nom et de ses thèses débats et passes d'armes. La publication en 1928 de l'ouvrage Les mobiles dans les actes juridiques de droit privé correspondait probablement à une tentative de cette sorte. Avec ce nouvel opus, présenté par son auteur comme le prolongement de L'Esprit des droits et leur relativité, le doyen lyonnais entrait, en effet, dans l'une des lices favorites des spécialistes du droit des obligations : la lice de la cause à laquelle le professeur parisien Capitant avait récemment apporté, pour la soutenir, la lance de son ouvrage éponyme, couronné par l'Institut. Toutefois, ce n'est pas de cette réflexion sur les intentions que devait naître la polémique opportune. Opportune - car si elle peut être rude, inélégante et parfois déplacée - elle fut l'instrument de l'amplification des thèses juridiques en présence et d'une publicisation spectaculaire autour des noms des protagonistes. La polémique n'est pas née davantage des positions novatrices prises à répétition bien avant 1930 par Josserand, dans ses notes sous arrêt et autres chroniques. Sans doute les fleurets qui furent croisés sur cette question d'une actualité brûlante entre Josserand et Capitant et plus encore entre Josserand et Ripert n'étaient pas toujours exactement mouchetés, mais ils n'eurent jamais le tranchant aussi acéré que ceux croisés par Josserand et Ripert autour de l'Esprit des droits et leur relativité. C'est en effet de la théorie de l'abus des droits que devait naître, avec un retard qui s'avéra finalement heureux, une virulente polémique. Coïncidant à peu de chose près avec la parution du premier volume du Cours de droit civil positif français du doyen lyonnais, elle est venue, à point nommé, non seulement faire autour de son nom une considérable publicité, mais encore le poser dans un rôle qui n'était pour lui déplaire : celui du héraut/héros des facultés de droit de province. Quand les circonstances se présenteront, il ne manquera pas, dans différentes instances représentatives, de consolider son rôle de porte-parole de la province (117). Incarner l'esprit lyonnais ? Le contradicteur de Josserand n'était pas le moindre des professeurs, puisqu'il s'agit du Parisien Georges Ripert (118). De quelques années le cadet de Josserand, Ripert occupait une place de premier ordre dans le petit monde des civilistes de l'entre-deux-guerres. Directeur de la très influente Revue critique de législation et de jurisprudence depuis 1918, associé par Marcel Planiol à partir de 1925 à la direction du fameux Traité pratique de droit civil, il apparaissait d'autant plus comme le continuateur de ce dernier qu'il devait en hériter encore du soin de poursuivre son Traité élémentaire de droit civil. En demandant à Georges Ripert une recension de cet ouvrage, Josserand devait immanquablement se douter que celle-ci ne lui serait pas en tous points favorables. Les développements que, quatre ans plus tôt, Ripert avait consacrés à l'abus des droits dans La règle morale dans les obligations civiles étaient en effet sans ambiguïtés sur l'acceptation fort étroite que le professeur parisien entendait donner à cette dernière théorie. Ripert n'admettait guère, et encore avec bien des réserves, que le critère de l'intention de nuire, lequel lui permettait tout à la fois de restreindre la portée de la théorie de l'abus des droits et de la cantonner dans le champ traditionnel de la responsabilité pour faute. Quant aux extensions
15
que la jurisprudence avait d'ores et déjà données à la théorie en invoquant le défaut d'intérêt légitime, elles lui paraissaient certes relever d'un souci louable de moralisation du droit, mais elles n'en étaient pas moins jugées par lui périlleuses dans la mesure où elles ouvraient la porte au « redoutable danger de contrôle arbitraire du juge sur l'exercice des droits » (119). Plus largement, si Ripert et Josserand avaient en commun d'être deux juristes ouvertement soucieux de ne pas rompre le lien entre morale et droit et, mieux encore, de nourrir le second de la première, leurs conceptions respectives de l'une comme de l'autre puisaient à des sources tellement différentes que la possibilité d'un dialogue intellectuel fructueux entre les deux auteurs paraissait difficile. Elle se révéla, en l'occurrence, définitivement chimérique. La démarche intellectuelle observée par Josserand à l'occasion de ce nouvel opus ne présentait pourtant pas un caractère de nouveauté très marquée. Elle obéissait aux convictions proclamées par l'auteur dès ses premiers travaux et confirmées à nouveau quelques années plus tard dans l'introduction de son Cours de droit civil positif, à savoir que la vérité du droit gît d'abord et essentiellement dans la jurisprudence. De l'esprit des droits réalisait une synthèse des évolutions jurisprudentielles nationales, puis scrutant la législation et la jurisprudence étrangères, il pouvait affirmer la réalité et la vitalité de l'idée d'abus des droits, tout autant que son défaut de systématisation. C'est à cette dernière que s'attache finalement un ouvrage décidé à dépasser la casuistique jurisprudentielle et soucieux de déterminer la pierre angulaire de la théorie. Parmi les multiples critères que la jurisprudence avait d'ores et déjà dégagés - l'intention de nuire, le défaut d'intérêt légitime, la faute dans l'exécution ou le détournement du droit de sa fonction sociale - Josserand ne dissimulait pas que le dernier emportait de loin sa faveur. Le civiliste rappelait donc, une fois encore, cet axiome qui, des premières aux dernières années de son activité intellectuelle, constitue l'une des charpentes maîtresses de sa pensée : tout le droit, objectif comme subjectif, est d'essence et de finalité sociale ; toute prérogative, quelle qu'elle soit, est conférée par la société dans un but social lequel, par définition, assigne à son titulaire des limites au-delà desquelles il engage sa responsabilité. En somme, De l'esprit des droits reprenait, sans aucune modification substantielle, en l'actualisant, la thèse soutenue en 1905 (avec le succès mitigé que l'on sait). Est-ce parce que le contexte politique avait notablement changé en l'espace de vingt ans ou parce que Georges Ripert lui-même se raidissait alors sur des positions juridiques intransigeantes ou encore parce que l'autorité montante de Josserand irritait son collègue parisien ? Toujours est-il que la formulation de la conclusion à laquelle était parvenu le doyen lyonnais constitua le détonateur d'une très violente polémique. « C'est donc un critère à la fois social et téléologique que nous adoptons, celui-là même qui est consacré par le Code soviétique » (120). Provocation délibérée ou inconscience d'un juriste à l'esprit large que les conflits politiques de son temps paraissent avoir laissé de marbre, du moins tant qu'ils ne ruinaient pas une certaine idée du droit ? Il est impossible de se prononcer. Mais considérant les réflexes épidermiques de rejet que le communisme pouvait engendrer dans les milieux bourgeois de la France de l'entre-deux-guerres, cette référence équivalait à agiter un chiffon - rouge, bien sûr - sous le nez des pourfendeurs de la nouvelle doctrine politique. Georges Ripert en faisait partie et devait le faire savoir avec une extraordinaire virulence dans la recension qu'il finit par livrer en 1929. Sollicité par Josserand, Ripert avait promis, dès réception de l'ouvrage, un compte rendu dans la Revue critique. Les termes mêmes de la promesse étaient lourds de sibyllines menaces (121) mais, en dépit de l'engagement de rendre compte au plus vite de l'ouvrage, il fallut à Josserand attendre dix-huit mois avant d'en découvrir la teneur exacte. Ce n'est qu'en février 1929 que le professeur parisien déclenchait ouvertement les hostilités avec la parution d'un article long d'une trentaine de pages, intitulé « Abus ou relativité des droits. A propos de l'ouvrage de M. Josserand, De l'esprit des droits et de leur relativité ». Le professeur lyonnais avait été incidemment averti de la virulence des foudres qui menaçaient de s'abattre sur lui puisque dans un courrier du 2 février, Ripert avait glissé in extremis en post-scriptum une « prière » ainsi formulée : « Excusez l'indépendance et parfois la trop grande vigueur de ma critique. Mais il y a matière à faire autre chose que le compte rendu éternellement appréciatif ».
16
Plus que vigoureuse, la critique peut être qualifiée de violente. Certes, son analyse de l'ouvrage du doyen lyonnais a fourni à Ripert une occasion de définir avec autant de vigueur que d'intransigeance ce qui devait devenir dans les années suivantes les grands axes immuables de sa pensée juridique : pouvoirs de l'homme, les droits subjectifs, dont l'origine divine n'est pas douteuse pour celui qui ne manque pas d'en référer à Saint Paul (122), sont par essence absolus. Ils ne sauraient être intrinsèquement mauvais, même s'ils peuvent être occasionnellement source de malveillance ou de malfaisance. En outre, c'est en puisant à la seule source de la morale chrétienne, dont Ripert se faisait le défenseur et le rempart, que le législateur et le juge pourront valablement réfréner « ce penchant de l'âme à l'absolutisme du pouvoir ». Cependant Ripert n'a pas entendu se limiter à constater l'opposition intellectuelle irréductible qui existait entre Josserand et lui-même. C'est bien au discrédit des thèses, via le discrédit de la personne de son adversaire, qu'il entendait travailler, dût-il, pour ce faire, sortir du terrain strictement juridique et ériger l'affrontement en un conflit politique majeur dans lequel il prenait la posture avantageuse du barrage humain contre le communiste haï. Retranché pour sa part derrière l'autorité d'un auteur à succès de l'Action Française (123), Ripert n'a donc pas manqué de s'emparer de la référence faite au code soviétique pour brosser de Josserand le portrait d'un dangereux juriste révolutionnaire. Le doyen lyonnais était toutefois trop obsédé de morale - même si la sienne était ouvertement sociale et non chrétienne -, il était trop critique à l'égard du matérialisme pour être sérieusement crédible dans un tel rôle. Ripert laissait donc entendre qu'il s'agissait là moins d'un bolchevique de conviction que d'un bolchevique, pêle-mêle, par irréflexion, inconscience et imprégnation. Rien d'étonnant, en effet, à ce que le doyen de Lyon fût contaminé par le fléau du socialisme juridique (124). A en croire Ripert, ce dernier avait trouvé dans la Faculté lyonnaise un asile autant qu'un foyer comme en témoignaient depuis longtemps les écrits d'Emmanuel Lévy et comme en attestait encore la curiosité d'Edouard Lambert pour les fameux codes soviétiques que le comparatiste, promu au rang d'internationaliste dangereux (125), avait pris l'initiative de faire traduire en français. Loin de limiter sa charge au seul Louis Josserand, Ripert diabolisait la Faculté lyonnaise et si les professeurs susnommés étaient désignés avec insistance à la vindicte collective, ils ne s'en trouvaient pas moins en bonne compagnie, celle du défunt Léon Duguit, dont la dépouille était elle aussi exposée aux foudres « ripertiennes ». Quelles que fussent les divergences entre les uns et les autres - et elles étaient nombreuses entre Josserand et Lévy, entre Josserand et Duguit - il faut croire que l'intérêt revendiqué que tous avaient porté à la science sociale, l'utilisation qu'ils s'étaient efforcé ou s'efforçaient encore d'en faire pour revitaliser leur discipline, le solidarisme qui imprégnait leurs écrits et les coups plus ou moins rudes qu'ils avaient portés à l'absolutisme des droits subjectifs leur valaient de rejoindre le doyen lyonnais dans le camp des réprouvés (126). Pareille charge appelait l'exercice d'un droit de réponse. Tout en en convenant bien volontiers, Ripert ne montra cependant aucune hâte à ouvrir à son contradicteur les colonnes de la Revue critique. Ce n'est semble-t-il que durant l'été 1929, après avoir allégué maints contretemps dont Ripert rejetait la responsabilité sur l'éditeur (127), que parut enfin la réponse du doyen Josserand. Brève et posée, elle démontrait avec un humour caustique l'outrance des accusations politiques portées contre lui, dont l'inanité était évidente. Elle concluait sur la détermination de l'auteur de l'Esprit des droits à poursuivre sur la route qu'il avait tracée, quels que fussent les anathèmes proférés contre lui et qu'il accueillait d'ailleurs avec le sourire narquois du « mécréant » (128). Mais, plus encore, elle est très significative de la façon dont le conflit avait été perçu par le premier intéressé et en conséquence des dimensions qu'il a souhaité lui donner à travers sa réponse. Josserand analysait la querelle, au fond, comme relevant de l'opposition insurmontable entre l'immobilisme juridique, confinant dans le cas de Ripert à une crispation réactionnaire jugée chimérique par son contradicteur (129), et le mouvement, seule attitude sensée, car en phase avec une réalité sociale elle-même en évolution constante. Elle était aussi, et peut-être avant tout, aux yeux de Josserand, une énième manifestation de l'arrogance universitaire parisienne à l'égard des collègues de province : « ... depuis trop longtemps, nous souffrons d'une carence à peu près complète de toute critique sincère ; les comptes rendus d'ouvrages sont composés dans une tonalité grisaille et uniforme, la même pour les productions les meilleures et pour les autres ; si l'article de M. Ripert est le signal d'un ordre nouveau, si la revue qu'il dirige avec tant d'autorité assume la mission de juger
17
vraiment les productions juridiques, en elles-mêmes, sans distinction d'origine (130), qu'elles proviennent de Paris ou d'ailleurs, alors une révolution aura été accomplie dont il conviendra de féliciter notre savant collègue ». Plusieurs de ses correspondants habituels, auxquels il avait pris soin d'adresser un tiré à part de sa réponse à Ripert, en abondant dans le sens de cette lecture de l'incident, disent ainsi que le sentiment d'être injustement tenus en infériorité intellectuelle du fait de leur statut d'universitaire provincial était partagé au-delà de Lyon. Le bordelais Julien Bonnecase, que Ripert avait d'ailleurs égratigné à l'occasion dudit article, était de loin le plus explicite : « (...) ... je suis particulièrement bien placé pour apprécier votre réplique à Ripert. Il faut que nos collègues de Paris et leurs amis se fassent à l'idée que la province sait penser et penser librement, qu'elle sait en outre se défendre et ne pas subir silencieusement, sinon même en remerciant », écrivait-il dans un courrier du 21 septembre 1929. Exprimée dans un style plus mesuré, l'appréciation du strasbourgeois Joseph Delpech était plus élogieuse encore pour la personne de Josserand : « J'(y) ai, bien cher doyen, bien reçu votre réponse à R. Elle est excellente de fermeté, tout à fait convaincante par son argumentation. Et combien la province vous doit de reconnaissance : vous avez des titres rares à relever le gant avec toute votre autorité » (131). Ces quelques lignes d'où se dégage la vision d'un Josserand, porte-parole et champion de la province toute entière face à Paris, émanait d'un ami de vingt ans. A ce dernier titre, elle peut paraître excessivement subjective et peu représentative de la perception que le petit monde des juristes universitaires pouvait avoir du doyen lyonnais. Pourtant, il semble bien que cette appréciation ait fini par être assez rapidement partagée comme l'indiquent les réactions et les commentaires que firent naître, dans la foulée de la controverse avec Ripert, la publication, puis les rééditions rapprochées, des trois volumes du Cours de droit civil positif français. Devenir le porte-parole des Facultés de province « Ouvrage justement récompensé par l'Institut et assez injustement méconnu aujourd'hui »
(132), le Cours de droit civil positif français ne figure jamais en première ligne des ouvrages spontanément associés au nom du doyen de Lyon. Et, sans doute, le défaut de continuateur est-il responsable de l'oubli qui l'entoure aujourd'hui en France. Il avait pourtant, en son temps, notablement marqué les esprits et pour beaucoup contribué à asseoir confortablement l'autorité de Josserand au point que, dans la foulée de sa parution, le doyen lyonnais apparaissait désormais en mesure de jouer parfaitement jeu égal avec ses deux collègues parisiens et principaux contradicteurs, Ripert et Capitant. A leur instar, et avec plus de mérite encore puisque l'ouvrage était une pure oeuvre de son seul esprit quand les autres n'étaient que des continuateurs, fussent-ils brillants, Josserand avait acquis avec le Cours de droit civil positif français une large audience auprès du public des juristes chevronnés comme balbutiants. L'histoire du Cours apporte donc une confirmation éclatante à la thèse soutenue par Philippe Jestaz et Christophe Jamin, selon laquelle la littérature de manuels, quintessence de la littérature doctrinale, jouait, depuis la fin du XIX
e siècle, un rôle déterminant dans
l'établissement de la hiérarchie entre les auteurs (133). En effet, le doyen lyonnais ne cherchait pas à dissimuler que la conception même de son Cours de droit civil positif français obéissait au premier chef à cette préoccupation de faire oeuvre doctrinale : « Sans doute, cet ouvrage est de dimensions modestes, mais nous ne pensons pas qu'il soit d'ordre purement scolaire ; nos efforts ont tendu à y mettre de la pensée et de l'information juridiques sous une forme aussi ramassée que possible (...) la publication d'un cours n'est-elle pas le plus sûr, le seul moyen efficace d'exposer ses idées et de les défendre ? » écrivait-il en 1929 dans la préface de la première édition. L'extraordinaire, pour les contemporains, n'en restait pas moins la percée spectaculaire d'un manuel n'émanant pas d'une autorité professorale de la capitale, alors que depuis deux décennies les professeurs parisiens semblaient régner en maîtres incontestés du genre, du moins pour le droit civil. Le succès du traité de droit civil de Josserand tenait sans aucun doute à ses qualités intrinsèques, mais il s'explique probablement aussi par la conjonction de deux autres facteurs. Accueilli et soutenu avec chaleur par nombre de juristes provinciaux, dès la parution du premier tome à l'automne 1929, le Cours de droit civil positif français leur est apparu comme une sorte de douce revanche intellectuelle par procuration sur la Faculté parisienne que beaucoup se sont fait un plaisir de recommander à leurs étudiants. Plus encore, le Cours devait prendre, à partir de février 1930, au moment
18
même où paraissait le tome second consacré aux obligations, une dimension nouvelle, inattendue pour son propre auteur. Avec le célèbre arrêt des chambres réunies du 13 février 1930, le Cours devenait l'oeuvre d'un professeur auquel la Cour de cassation se référait explicitement, avant de faire triompher, sinon totalement, du moins largement, sa lecture audacieuse de l'article 1384 alinéa 1 du code civil. Autant dire qu'il devenait l'oeuvre d'une figure désormais installée au centre de la doctrine. Sorti des presses de la Librairie du Recueil Sirey à l'automne 1929, le premier tome du Cours de droit civil positif français a été complété rapidement, les deux tomes suivants paraissant respectivement à l'orée du printemps et à l'automne 1930 (134). Au sein du concert unanime de louanges que suscita l'entreprise, la tonalité particulière de celles chantées par les collègues de province ne peut pas échapper au lecteur des archives Josserand. Quand les félicitations de rigueur des collègues parisiens semblaient relever d'une simple politesse, celles des collègues provinciaux étaient beaucoup plus chaleureuses, quand elles n'étaient pas enthousiastes. A l'évidente satisfaction de nombre d'entre eux, il ne faisait nul doute que les qualités de l'oeuvre du doyen lyonnais étaient de nature à lui permettre de soutenir avantageusement la comparaison avec les manuels parisiens devenus hégémoniques, le « Colin-Capitant » ou le « Planiol-Ripert » comme on les appelait familièrement. Avant même sa clarté d'exposition et l'élégance du style de son auteur, nombre des correspondants de Josserand plaçaient au premier rang « la nouveauté », voire « la modernité » de son ouvrage. Il se démarquait en effet de ses prédécesseurs et s'affichait ostensiblement en rupture avec les traditions bien établies de ce genre de littérature juridique. Au motif de son incompétence en la matière, Josserand avait rangé les traditionnels développements d'histoire du droit au rayon poussiéreux des « préludes rituels et quasi-séculaires » (135) et il ne leur consacrait en conséquence que la portion congrue : « nous n'avons décrit le passé que dans la mesure où sa connaissance est strictement indispensable à la compréhension du présent ». L'espace d'expression ainsi gagné était consacré à des « institutions dont le développement ou l'évolution ne sont pas toujours suffisamment soulignés dans les livres d'enseignement », c'est-à-dire, pêle-mêle, la famille naturelle, la cause, l'abus des droits, la stipulation pour autrui, la responsabilité. Le même souci d'entretenir un contact étroit avec la réalité du droit, telle qu'il la concevait, conduisait encore son auteur à consacrer à la jurisprudence une place de premier choix. « ... le droit que nous avons pris pour objet de notre étude est avant tout le droit jurisprudentiel, c'est-à-dire celui qui se réalise : nous avons entendu faire de la science, non du roman. C'est la jurisprudence qui constitue la matière première sur laquelle doivent s'exercer nos recherches ; le droit est tel qu'elle la comprend et qu'elle l'aménage, les documents législatifs n'étant que certains des matériaux dont l'assemblage et la mise en oeuvre lui sont confiés... » En plus d'être conforme aux convictions profondes et anciennes de Josserand, cette focalisation sur les décisions judiciaires présentait encore l'avantage de rendre le manuel potentiellement attractif aux yeux des professionnels du droit avec lesquels le doyen lyonnais avait toujours eu à coeur, depuis les débuts de sa carrière, d'entretenir le dialogue. Il affichait ouvertement, d'ailleurs, son ambition de leur fournir un outil de travail enfin adapté à leurs besoins. Devant ce concentré de qualités nouvelles, les prophètes provinciaux ne manquèrent pas d'annoncer que, dans la compétition entre les manuels, le dernier-né présentait toutes les qualités requises pour l'emporter sur ses prestigieux devanciers parisiens. Ces prédictions durent être d'autant plus douces à lire aux yeux de Josserand qu'elles n'émanaient pas seulement du clan de ses proches collègues et amis lyonnais [Paul Pic, Jean Appleton (136), Edouard Lambert (137) notamment) ou de ses supporters de longue date (Julien Bonnecase
(138)] ou bien encore de ses anciens étudiants (André Rouast, Jean Radouant). Elles pouvaient être aussi le fait de collègues avec lesquels l'unanimité doctrinale n'était pas parfaite et les liens personnels guère serrés, à l'exemple du civiliste montpelliérain Gaston Morin (139). Et que, non seulement l'ouvrage obtienne le prix Chevalier décerné par l'Institut en 1931, mais encore que, dans la tourmente d'une crise économique n'épargnant pas l'industrie de l'édition, il ait fait l'objet de rééditions rapides leur est vite apparu (140), ainsi qu'à son auteur lui-même, comme le signe objectif de la justesse de leurs prédictions quant à sa valeur et à son succès mérité. Deux rééditions en effet, assurées par Josserand lui-même, suivront à une cadence soutenue. La seconde est parue entre le printemps et l'automne 1933.
19
La troisième - dont l'auteur soulignait sans fausse modestie qu'elle avait été rendue indispensable par l'épuisement de la seconde édition - a pris davantage de temps. Josserand s'était assigné, non pas simplement un travail de mise à jour, mais une réécriture désireuse de donner au droit comparé une place plus substantielle ; en outre, il fut probablement retardé par des soucis de santé qui l'atteignirent durant l'été 1938 (141). Entamée à l'automne 1937, la publication de la troisième édition ne fut donc achevée qu'au début de l'année 1940. Devant cette offensive couronnée de succès, les collègues parisiens avaient dû, bon gré, mal gré, s'incliner et saluer la prouesse réalisée. Georges Ripert lui-même avait fini par le reconnaître : « Votre traité est aujourd'hui classique » (142). Dans cette seconde moitié des années trente, il aurait été absurde de nier l'évidence : le traité de droit civil de Josserand avait réalisé et même dépassé en un temps record les objectifs que son auteur lui avait assignés, car à la conquête des deux lectorats ouvertement courtisés en 1929 - le lectorat universitaire français et le lectorat professionnel - Josserand pouvait fièrement ajouter, dès octobre 1931 (143), alors qu'il avait déjà remis son ouvrage sur le métier en vue de la seconde édition, la conquête d'un lectorat international. La reconnaissance internationale qu'il avait résolument recherchée depuis 1926 lui a été, en effet, pleinement donnée à partir de 1931. Dans les annales personnelles du doyen Josserand, cette année universitaire 1930-1931 fut celle du couronnement international, celle au cours de laquelle il entreprit, en qualité de professeur d'échange ou de conférencier, une tournée triomphale qui le vit successivement au Portugal - où il reçut le doctorat honoris causa des Universités de Lisbonne et de Coïmbra -, en Espagne, au Maroc français, en Roumanie et en Belgique. L'élan ne devait pas retomber de sitôt : docteur honoris causa de l'Université de Bruxelles en 1932, il recevait deux années plus tard, à l'occasion des fêtes du quatrième centenaire de la découverte du Canada, cette même distinction de l'Université de Montréal. En compagnie des parisiens Henri Capitant, René Demogue et Maurice Picard, le lyonnais Louis Josserand avait en outre pris part aux journées du code civil français avec la triple qualité de rapporteur, délégué de l'Université de Lyon et représentant du ministère de l'Education nationale. Quand il ne parcourait pas le monde en personne, Josserand pouvait avoir la satisfaction d'apprendre de son réseau de correspondants étrangers que ses idées, elles, poursuivaient bel et bien leur essaimage et, avec lui, le travail de fécondation des esprits. On lui apprenait ainsi que son Cours de droit civil positif français était fréquemment utilisé avec profit par les étudiants et les professionnels belges et roumains (144), quand il n'était pas purement et simplement devenu objet d'études pour les étudiants japonais du professeur Sugiyama (145) de l'Université de Tokyo. Ses collègues français eux-mêmes pouvaient témoigner du succès de l'ouvrage hors des frontières et si les assurances en cette matière données par Edouard Lambert (146) peuvent paraître partiales en raison de trop de proximité amicale, celles fournies par Léon Julliot de La Morandière (147) à propos de l'audience de son oeuvre en Amérique latine, ne risquent pas, en revanche, d'encourir pareil reproche. De la doctrine à la pratique : le choix (malheureux ?) du monde judiciaire Les succès éditoriaux remportés par le Cours, comme la consécration internationale de son auteur, peuvent difficilement être séparés du retentissement considérable que connut en son temps l'arrêt Jand'heur pris par les chambres réunies de la Cour de cassation le 13 février 1930. L'auteur du Cours de droit civil positif français avait affiché, dans la préface de sa première édition de 1929, sa volonté d'accorder à la responsabilité une place (148) à la hauteur de celle qu'elle occupait dans la vie juridique, mais qui lui faisait encore défaut dans la plupart des manuels de droit. Il n'imaginait certainement pas, même s'il l'espérait, combien l'actualité judiciaire et doctrinale de l'année suivante allait le justifier dans ce choix. Elle devait en effet se polariser sur cette responsabilité objective du fait des choses dont il s'était fait depuis 1897 l'invariable promoteur ; un promoteur qui, à partir de février 1930, semblait en passe de triompher des dernières réticences judiciaires et apparaissait comme l'un des principaux inspirateurs de l'arrêt si controversé rendu par les chambres réunies de la Cour de cassation. Depuis 1921, la jurisprudence, sans aller jusqu'à consacrer la théorie du risque défendue par
20
Josserand, s'en était toutefois beaucoup rapprochée. Si elle restait officiellement fidèle à la présomption de faute, en matière d'application de l'article 1384 alinéa 1, elle ne se contentait plus d'une preuve négative que le gardien n'avait pas commis d'imprudence ou de négligence. Elle demandait à ce dernier d'apporter la preuve d'un fait extérieur générateur du dommage (cas fortuit, force majeure ou faute de la victime ou d'un tiers). En l'absence d'un tel fait, le gardien demeurait responsable. En outre, le champ d'application de l'article 1384 alinéa 1 s'était progressivement et laborieusement étendu dans les cas, de plus en plus fréquents, d'accidents d'automobile. Longtemps, la Cour de cassation avait refusé d'appliquer l'article 1384 aux dommages causés par une chose dès lors que celle-ci était mue ou dirigée par la main de l'homme ; elle privilégiait en pareille occurrence l'application classique de l'article 1382 et n'admettait l'article 1384 que dans l'hypothèse d'un accident résultant d'une défectuosité de la chose elle-même. Cette distinction entre le fait de l'homme et le fait de la chose emportait des conséquences étranges que Josserand ne s'était pas privé de dénoncer : « ... si l'on décide que le fait de l'homme chasse le fait de la chose, on aboutit à ce résultat que la responsabilité de droit fonctionnera surtout dans le monde des choses inertes et inoffensives, mais bien rarement dans celui des choses vivantes et dangereuses, c'est-à-dire qu'elle aura une valeur théorique bien plutôt qu'une signification pratique et qu'elle apparaîtra dans son ampleur là où l'on pourrait aisément se passer d'elle ; elle fonctionnera à peu près dans le vide » (149). En outre, le maintien de la responsabilité pour faute faisant peser la charge de la preuve sur la malheureuse victime, la situation de cette dernière était pour le moins difficile. Au nom de la justice, de l'équité et de la sécurité juridique du plus faible, ici le piéton « le pot de terre », bien désarmé face à l'automobiliste « le pot de fer », Josserand persistait donc à réclamer l'extension de la responsabilité objective sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1. L'arrêt de la Cour de cassation du 21 février 1927 était venu lui offrir partiellement satisfaction. En déclarant l'article 1384 applicable au cas du piéton écrasé par une automobile en marche, la juridiction condamnait, à son tour, la distinction entre le fait de l'homme et le fait de la chose. Toutefois, le même arrêt introduisait une distinction nouvelle, celle-là même que Georges Ripert soutenait, entre les choses dangereuses et les choses inoffensives. L'on ne s'y trompa guère : affirmer que la responsabilité du gardien n'était engagée que dans la mesure où la chose dont il avait la garde était dangereuse revenait à présumer une faute dans la surveillance particulière exigée par cette chose périlleuse pour autrui. Josserand pouvait donc encore déplorer dans les colonnes du Dalloz Hebdomadaire de janvier 1930 « le travail de refoulement de la responsabilité des choses inanimées » (150) auquel la majorité de la doctrine se livrait. Il se disait toutefois convaincu que la jurisprudence ne saurait tarder à se rallier à la thèse du risque, « cette conception réaliste, la seule qui convienne à notre vie complexe et agissante ». Cette prophétie sembla se réaliser moins d'un mois plus tard. Arrêt solennel et de principe, l'arrêt Jand'heur (151) venait mettre un terme à la résistance déployée depuis trois ans par les cours d'appel de Besançon et de Lyon. Le procureur général Paul Matter, qui avait conclu à la cassation de l'arrêt rendu par la récalcitrante Cour d'appel de Lyon, ne dissimulait nullement ses sources d'inspiration : elles n'étaient autres que Saleilles et Josserand, dont des passages de la récente chronique au Dalloz étaient ouvertement cités. Rejetant une nouvelle fois la distinction du fait de la chose et du fait de l'homme, l'arrêt consommait ensuite la défaite de Georges Ripert en renonçant à la distinction que le procureur général Matter, reprenant l'expression même de Josserand, avait qualifiée à son tour de « presque byzantine », entre les choses dangereuses et celles qui ne le sont pas. L'arrêt mentionnait enfin, non plus une présomption de faute, mais une « présomption de responsabilité » qui allait, instantanément, faire couler beaucoup d'encre. Pour Josserand, comme pour le commentateur anonyme de la Gazette du Palais, il n'était pas douteux qu'en substituant la présomption de responsabilité à la présomption de faute, la Cour de cassation avait « fait un pas dans le sens de l'objectivation de la responsabilité du fait des choses inanimées, sur la voie de la substitution de la notion de risque au concept traditionnel de la faute, concept vieilli, qui, sans doute est toujours indispensable, mais qui ne suffit plus à supporter, sur une base désormais trop étroite, l'édifice, devenu formidable et pesant de la responsabilité » (152). Dans le camp adverse, le premier réflexe de Ripert (153) partagé, dans une moindre mesure par Capitant (154), avait été de minimiser l'importance de la décision et d'affirmer que, sous les lambris dorés de la Cour de cassation, il ne s'était, en réalité, rien produit de neuf. Selon les deux auteurs, l'emploi des termes « présomption de responsabilité » n'avait aucune portée nouvelle et c'était toujours de présomption de faute qu'il s'agissait. Ils ne devaient pas être profondément convaincus par leur propre
21
argumentation car ils ne pouvaient simultanément s'empêcher de tenter une nouvelle opération de diabolisation du doyen Josserand. Certes la méthode était moins brutalement directe et outrancière que celle employée l'année précédente par le directeur de la Revue critique ; elle préférait désormais procéder par des insinuations, au demeurant transparentes. La théorie du risque était ainsi associée immanquablement dans leurs commentaires au code civil soviétique pour mieux souligner que même ce dernier était plus modéré que certains partisans français de l'extension de la responsabilité objective (155)... Les notes, chroniques et commentaires qui se multiplièrent dans les années trente sur la responsabilité du fait des choses ne laissent aucun doute sur l'hostilité que faisait naître au sein de la majorité de la doctrine civiliste la thèse de la responsabilité objective soutenue par Josserand. Si ce dernier devait toujours faire face aux assauts de Ripert et de Capitant, il lui fallait en outre tenir tête à deux de ses anciens élèves (156) qui s'étaient rangés ostensiblement derrière la bannière du second. Le front des défenseurs inconditionnels de la responsabilité pour faute s'est, en effet, consolidé dans les années trente avec le renfort apporté par deux jeunes professeurs : les frères Léon et Henri Mazeaud. Du moins rendaient-ils involontairement hommage à Josserand en reconnaissant, à son imitation, la place centrale prise, en quelques décennies, par la responsabilité au sein du droit civil, puisqu'ils lui consacraient en 1931 un traité entier (157). Incontestablement, dans la seconde moitié des années trente, Josserand était bien positionné au centre de la doctrine, mais il l'était comme peut l'être le coeur de la cible, c'est-à-dire qu'il était celui sur lequel convergeaient toutes les flèches tirées par de multiples forces d'opposition, bien déterminées à faire échec à toute extension de la responsabilité objective. Certains de ses adversaires ne cachaient pas, d'ailleurs, que le rejet catégorique de ses idées leur interdisaient d'envisager ne serait-ce qu'une trêve avec sa personne (158). Est-ce la lassitude devant une opposition doctrinale qui ne désarmait pas et l'espoir de faire triompher définitivement l'une de ses plus chères théories qui le conduisirent à, finalement, accepter la proposition qui lui avait été faite dès 1930 d'intégrer la Cour de cassation ? Nos sources ne permettent pas de répondre de façon tranchée à cette question. Une seule chose est certaine : l'arrêt Jand'heur fut encore décisif pour le destin professionnel du doyen lyonnais et, même s'il a résisté cinq années aux chants des sirènes de la Cour de cassation, sa correspondance est sans équivoque sur le rôle-clef que cet arrêt a joué pour lui ouvrir les portes de la juridiction suprême. Il y avait plusieurs années déjà que Louis Josserand entretenait des relations amicales avec deux conseillers à la Cour de cassation : son ancien collègue, doyen honoraire de la Faculté de droit de Strasbourg, Robert Beudant, qui avait intégré la cour suprême le 8 janvier 1929
(159), et le conseiller Fernand Bricout, rencontré à la faveur du concours d'agrégation de 1926 que le doyen lyonnais avait présidé. Il était alors de tradition que le jury fût complété par un magistrat de la Cour de cassation dont la désignation incomba, cette année là, aux services judiciaires. La correspondance de Josserand indique que cette rencontre fortuite s'est rapidement muée en une chaleureuse relation amicale où il pouvait être assuré du soutien inconditionnel et de l'admiration sans réserve que lui portait le magistrat parisien. Sans surprise, c'est de ces deux amitiés à la Cour de cassation que sont venues spontanément dès le mois de mars 1930 les premières propositions, plus ou moins explicites, d'abandonner la carrière universitaire au profit de la haute magistrature (160). Robert Beudant confirme d'ailleurs ce que laissaient déjà fortement entendre, non seulement les conclusions du procureur général Matter, mais le courrier qu'il avait envoyé à Josserand en remerciement de l'envoi du tome second du Cours de droit civil positif français (161) : Paul Matter était acquis à sa cause et prêt à lui offrir tout son soutien au cas où Josserand souhaiterait intégrer la Cour de cassation. Il y eut manifestement une hésitation, suivie d'un premier refus qui, on le sait, n'eut rien de définitif, puisque Josserand franchissait finalement le pas en juin 1935 sans, toutefois, que sa correspondance nous livre la plus petite lumière sur les raisons ayant finalement déterminé cette nouvelle orientation de carrière. Pour un professeur qui avait toujours proclamé sa confiance, pour ne pas dire sa foi, dans la capacité des juges et de la jurisprudence à réaliser l'adaptation harmonieuse et sage de la règle de droit aux mutations de la société, il était sans doute tentant de s'essayer soi-même,
22
plus immédiatement que par les voies incertaines de la doctrine, à cette oeuvre de pacification sociale qui était à ses yeux la raison d'être et le but suprême du droit. A un échelon plus modeste, le fait même que le professeur se voue à la pratique était en soi, à ses yeux, une offre de paix et un témoignage de son souci d'oeuvrer à la réconciliation de l'Ecole et du Palais. Il devait le dire de façon explicite dans le discours de remerciement qu'il prononça le 23 janvier 1936 à l'occasion de la cérémonie organisée en son honneur : « ... les Facultés de droit, quelles que soient leur activité et leur autorité, ne sont pas les uniques dispensatrices de la science du droit ; elles ne représentent pas à elles seules, toutes les forces juridiques du pays ; à côté d'elles d'autres forces se manifestent qui, sur un plan différent, participent au grand oeuvre, et ce n'est pas une mince satisfaction pour moi de constater qu'en ce jour et qu'en cette cérémonie, la pratique voisine avec la théorie, la jurisprudence avec la doctrine ; pour les besoins de la cause, les « soeurs ennemies » se sont réconciliées (...) Ainsi la famille juridique est complète... » (162). On peut parier, toutefois, que la perspective d'intégrer la Cour de cassation avait été d'autant plus séduisante qu'on n'avait pas manqué de lui assurer, à de multiples reprises (163), que son autorité intellectuelle sur la juridiction était considérable. Si ce dernier argument fut bien l'argument déterminant, alors le conseiller à la Cour de cassation Louis Josserand n'a pas dû être pleinement satisfait. Sans doute la chambre civile a-t-elle suivi Josserand, rapporteur dans l'affaire Mercier c/ Nicolas, à l'occasion de laquelle fut affirmée l'obligation, pour le médecin, de donner des soins attentifs, consciencieux et conformes aux données acquises de la science (164). Sans doute encore dans la célèbre affaire de l'automobile volée (165), qui ouvrit un nouveau débat doctrinal passionné autour de la garde juridique et de la garde matérielle, la chambre civile s'est-elle, dans un premier temps, rangée par son arrêt du 3 mars 1936 à sa thèse. Mais sa présence au sein de la chambre civile n'a pas permis de faire franchir à la cour suprême le dernier pas décisif en faveur de la théorie du risque et, en décembre 1941 (166), en épilogue à la même affaire de la voiture volée, la faute opérait un retour en force salué, comme il se doit, par la satisfaction triomphante de Georges Ripert. Depuis peu Josserand n'était plus de ce monde et ses thèses elles-mêmes subissaient un net recul. Le temps a, certes, fait cruellement défaut au doyen honoraire de la Faculté lyonnaise pour qu'il puisse donner sa pleine et entière mesure au sein de la Haute juridiction. « ... trois ans ne s'étaient pas écoulés qu'une loi avançant pour les hauts postes de la magistrature l'âge de la retraite, interrompit son activité judiciaire »
(167) rappelait l'avocat général Rey dans l'hommage qui lui fut rendu par la Cour de cassation. La loi dont il est question, fixant à 70 ans l'âge du départ à la retraite des conseillers à la Cour de cassation, avait en fait été adoptée le 18 août 1936. Un an après avoir intégré la juridiction suprême, Josserand savait donc à quel point son temps y était étroitement compté... Cela fut-il une cause de démobilisation ? Toujours est-il qu'il avait été régulièrement détourné des tâches judiciaires par diverses causes, notamment sa participation aux travaux du comité pour l'unification de la responsabilité civile des automobilistes (168), la rédaction de chroniques sur la théorie du contrat (169), mais aussi sa nomination comme membre du jury du concours d'agrégation à l'automne 1937. Son collègue Gaston Morin, qui l'avait sollicité directement le 19 juin de la même année (170), ne lui avait pas caché ses scrupules à demander à un ancien président de jury de revenir y siéger en qualité de simple suffragant, mais il ajoutait qu'il tenait beaucoup à une collaboration que Josserand lui accorda visiblement sans se faire prier puisque le jury était constitué au début du mois de juillet. Cet empressement à reprendre sa place au sein d'une instance universitaire, certes des plus prestigieuses, confirme l'impression, sinon de mal-être au sein de la Cour de cassation, du moins de vive nostalgie du monde qui avait été le sien près de quarante ans, nostalgie qui se dégage d'ailleurs des quelques lignes qu'il avait rédigées, en mars 1936, en préface à son recueil de conférences Evolutions et Actualités, comme du discours qu'il prononça à Lyon en janvier 1936 (171). Peut-être Josserand avait-il trop tardé à opter pour la Cour de cassation ; à n'en point douter, aussi, est-il beaucoup plus facile d'exercer une autorité sur une institution lorsqu'on lui est extérieur que lorsque l'on a pris place en son sein. Peut-être, enfin, faut-il avoir avec soi et après soi, sinon de parfaits disciples, du moins de solides continuateurs, pour que l'autorité, si obstinément recherchée, si laborieusement édifiée, soit constamment étayée et consolidée par des apports rajeunis et renouvelés. Ceux-ci sont plus nécessaires encore pour que l'autorité
23
ne se dissolve pas avec la mort de l'intéressé. Dans l'article qu'elle a consacré au doyen lyonnais, Dominique Fenouillet s'interrogeait à juste titre à la fois sur les raisons de l'extrême discrétion qui entoura la disparition de Josserand (172) et, plus largement, sur les causes de l'oubli qui entoure aujourd'hui largement le nom du doyen lyonnais ; silence et occultation qui contrastent avec la célébrité acquise dans les années trente. Elle proposait les éléments d'explication suivants : trop progressiste à bien des égards pour son époque et dans le même temps trop conservateur, pour la nôtre, sur les questions de droit des personnes et de droit de la famille (173), le doyen Josserand s'est éteint le 4 novembre 1941, dans une époque mouvementée. Il paraît difficile, en effet, d'occulter le contexte de cette disparition. Louis Josserand est mort à un moment qui n'était guère propice aux grandes célébrations funèbres, tout simplement parce que dans une France morcelée par l'Occupation allemande ni les nouvelles, ni les hommes ne parvenaient à franchir aisément, et encore moins rapidement, la ligne de démarcation. L'oubli dans lequel le nom de Josserand est rapidement tombé peut, peut-être, en partie, s'expliquer par la pensée même de l'auteur, par ce grand écart entre certaines positions demeurées aujourd'hui encore, en France du moins, extrêmement novatrices et d'autres, beaucoup trop traditionnelles et vite démenties par cette évolution de la société sur laquelle il voulait, pourtant, avoir les yeux rivés. Mais on ne peut exclure que cet oubli tienne aussi au tempérament profondément réservé, voire solitaire, de l'homme en question. Des quelques huit cents courriers consultés, émanant de plus de trois cents correspondants, c'est, en effet, paradoxalement, l'impression d'une grande solitude qui se dégage. Solitude en partie subie sur le plan privé (174), elle lui était apparemment naturelle en matière amicale. Louis Josserand avait beaucoup de relations qu'il a cultivées avec soin et, vraisemblablement, avec une grande urbanité, certaines d'entre-elles lui ont d'ailleurs porté une admiration et une déférence plus que vives ; mais il n'avait, dans son univers professionnel, que de très rares amis intimes (175), comme s'il avait instauré autour de lui une infranchissable distance que l'on retrouve encore dans ses relations avec ses étudiants les plus fidèles. Solitaire, il l'a été encore dans le travail - même si, au vrai, le travail paraît lui avoir tenu lieu de compagne. Sans que l'on puisse dire avec certitude s'il s'agissait d'une négligence ou de la marque d'une excessive pudeur, le fait est néanmoins là : Louis Josserand, cette autorité très solitaire encore dans ses positions doctrinales les plus avancées, n'avait pas soigneusement préparé sa succession intellectuelle. Ce n'est pas la moindre des singularités de cet homme dont la conservation méticuleuse des courriers, recensions et marques de reconnaissance suscités par sa pensée et son oeuvre trahit, précisément, l'extrême besoin de reconnaissance qui l'a animé tout au long de sa carrière universitaire... Mais il faut bien constater qu'il n'a pas associé de son vivant l'un de ses collègues ou l'un de ses étudiants à la poursuite de son Cours de droit civil positif français et il a mené (orgueilleusement ?) seul, à deux reprises, l'épuisant travail de mise à jour et de réédition de l'ouvrage qui lui avait apporté la consécration et qui, remis à temps entre de bonnes mains, aurait peut-être pu assurer à sa pensée et à son nom une forme de pérennité. L'importance que revêtait la poursuite du Cours n'a pourtant pas échappé à Josserand, mais ce n'est que bien tardivement, in extremis au sens premier de l'expression, qu'il s'est préoccupé de façon originale d'organiser sa succession intellectuelle. Le 4 octobre 1941, exactement un mois avant sa mort, c'est par testament que Louis Josserand a désigné les possibles continuateurs de son oeuvre : « Un de mes désirs les plus chers est que mon « Cours de droit civil positif français » soit continué par un civiliste de la Faculté de droit de Lyon, soit M. Paul Roubier, soit, à son défaut, M. André Brun ; au cas où ceux-ci déclineraient pareille mission, il y aurait lieu de s'adresser, soit à M. Marcel Nast, Conseiller à la Cour de cassation, soit à un civiliste d'une Faculté de droit de province (176) ». Cette insistance ultime fournit la preuve, si l'on doutait encore, que la vie intellectuelle du doyen lyonnais avait bien été placée sous le signe d'une profonde et viscérale aspiration au rayonnement universitaire lyonnais, et plus largement provincial, dont il s'est voulu l'emblème contre la capitale... A l'évidence, Paul Roubier a décliné la faveur dont il avait été l'objet. En revanche, André Brun s'est attelé à la tâche et en 1950 est parue une nouvelle édition, mise à jour par ses soins. Il serait parfaitement vain de la rechercher dans les catalogues des bibliothèques françaises. Une fois de plus, il nous faut faire aveu d'ignorance et reconnaître que nous ne savons pas pourquoi les éditions Sirey n'ont pas pu ou voulu publier le travail d'André Brun. En revanche, cette quatrième édition réalisée par l'élève de Josserand demeure en Argentine, où elle a été traduite et publiée (177), ainsi que dans divers pays d'Amérique latine où elle a
24
vite circulé, un ouvrage classique de référence. Le nom de Josserand est international avait déclaré en 1930 le professeur portugais (178) qui présentait devant le conseil de la Faculté de Lisbonne la candidature du doyen lyonnais au doctorat honoris causa et l'étonnante destinée du Cours de droit civil positif français en atteste. Le contraste entre la pérennité internationale de Josserand et l'occultation de sa pensée en France amène, au final, à relativiser la profondeur de cet oubli. Il oblige, aussi, pour expliquer celui-ci, à rechercher d'autres causes qui tiennent sans doute bien davantage à l'attitude des civilistes hexagonaux. L'hétérodoxe Louis Josserand avait encouru les foudres de l'un des pontifes de la discipline, lequel, en outre, devait lui survivre pendant plus de quinze ans. L'anathème lancé par Ripert avait, certes, conféré à Josserand une célébrité de son vivant, mais il a probablement aussi contribué à accélérer le processus d'effacement intellectuel une fois que le doyen lyonnais n'était plus là pour répondre personnellement des accusations dont il était l'objet. Enfin et surtout, dans les années Cinquante, ceux qui allaient exercer l'ascendant le plus considérable sur le droit civil français, les frères Léon et Henri Mazeaud, n'avaient jamais fait mystère de l'étendue de leur opposition doctrinale à Josserand. Il leur fut probablement aussi naturel que facile de passer sous silence le nom et les thèses du civiliste lyonnais auquel ils devaient leur formation initiale dans la discipline. Si le champ doctrinal est un champ de batailles, l'histoire de la doctrine se doit d'être attentive aux vainqueurs, aux vaincus et aux oubliés. Mots clés : GENERALITES * Source du droit * Doctrine * Louis Josserand * Autorité doctrinale (1) J.-L. Halpérin a attiré l'attention des juristes sur l'originalité de Josserand in Histoire du droit privé depuis 1804, Puf, éd. 2001, p. 188-190 ; D. Fenouillet, Etienne Louis Josserand (1868-1941), Revue d'histoire des facultés de droit, 1996, n° 17, p. 27 s. ; surtout, les importantes études de D. Deroussin, Josserand, le Code civil et le Code libanais des obligations et des contrats, in Le Code civil français et le dialogue des cultures juridiques, Bruxelles, Bruylant, 2007, p. 49-94 : du même auteur, Josserand et la science sociale, in Le renouvellement des sciences sociales et juridiques sous la III
e République. La Faculté de droit
de Lyon, Actes du colloque tenu à Lyon les 4 et 5 févr. 2004. Contributions réunies par David Deroussin, Editions La Mémoire du droit, 2007, p. 63-119. V. également une vive polémique : C. Baillon-Passe, Relire Josserand, D. 2003. 1571 ; J.-P. Chazal, « Relire Josserand », oui mais... sans le trahir !, D. 2003. 1777-1781 ; C. Baillon-Passe, Réponse à Jean-Pascal Chazal : mission accomplie, on va relire Josserand, D. 2003. 2190-2191 . (2) Les deux volumes sont précédés par des préfaces substantielles de David Deroussin : L. Josserand, De l'esprit des droits et de leur relativité. Théorie dite de l'abus des droits. Essais de téléologie juridique I, Dalloz, 2006, p. V-XXXVI et Les mobiles dans les actes juridiques du droit privé. Essais de téléologie juridique II, Dalloz, 2006, p. V-XXI. (3) Sur la doctrine, N. Hakim, L'autorité de la doctrine civiliste française au XIX
e siècle, LGDJ,
2002 ; Ph. Jestaz, Ch. Jamin, La doctrine, Dalloz, 2004. Sur la notion de « champ doctrinal », Ph. Jestaz, Genèse et structure du champ doctrinal, D. 2005. Chron. 19-22 . Pour une analyse de la controverse autour de « l'entité doctrinale », J.-L. Bilon, Controverses et querelles de la doctrine, Cahiers des Ecoles doctorales, n° 1 (Les controverses doctrinales), Montpellier, 2000, p. 17-36. (4) Par ex., J. Foyer, Les professeurs de droit civil, législateurs ?, in M. Hecquard-Théron (dir.), Les Facultés de droit inspiratrices du droit ?, PU sciences sociales de Toulouse, 2005, p. 41-49 ; G. Canivet, La Cour de cassation et la doctrine, in Propos sur les obligations et quelques autres thèmes fondamentaux du droit. Mél. offerts à Jean-Luc Aubert, Dalloz, p. 373-393 ; P.-Y. Gautier, L'influence de la doctrine sur la jurisprudence, D. 2003. Chron. 2839-
25
2844 . (5) Nous suivons ici les propositions formulées par la sociologie des sciences : D. Pestre, Introduction aux Sciences studies, La Découverte, 2006 ; B. Latour, La science en action : introduction à la sociologie des sciences, La Découverte, éd. 2005 ; M. Akrich, B. Latour et M. Callon, Sociologie de la traduction. Textes fondateurs, Presses de l'Ecole des mines de Paris, 2006. (6) Sur ce conflit entre Paris et la province comme dimension structurante de la doctrine juridique française, V. la très importante thèse de G. Sacriste, Le droit de la République (1870-1914). Légitimation(s) de l'Etat et construction du rôle de professeur de droit constitutionnel au début de la III
e République, th. pour le doctorat en science politique, Paris I
Panthéon-Sorbonne, déc. 2002. Lire également les remarques de J.-A. Mazères, Les facultés de droit de Paris et de province dans la production de la pensée juridique : vers une géophilosophie du droit ?, in Les Facultés de droit inspiratrices du droit ?, op. cit. p. 107-119 (7) C. Atias, Debout les ouvriers du droit ! Autorité et poids de la doctrine, in Propos sur les obligations et quelques autres thèmes fondamentaux du droit. op. cit., p. 361-371 (8) C. Jamin, Dix-neuf cent : crise et renouveau dans la culture juridique, in D. Alland et S. Rials (dir.), Dictionnaire de la culture juridique, Puf, 2003, p. 380-384 (9) Sur la nébuleuse réformatrice sous la III
e République, C. Topalov (dir.), Laboratoires du
nouveau siècle. La nébuleuse réformatrice et ses réseaux en France 1880-1914, Ed. de l'EHESS, 1999. (10) Sur la Faculté de droit de Lyon, cf. Le renouvellement des sciences sociales et juridiques sous la III
e République, op. cit. ainsi que La Faculté de droit de Lyon. 130 ans d'histoire,
Editions lyonnaises d'art et d'histoire, 2006. (11) Les Archives nationales ne semblent pas avoir conservé son dossier lié à l'obtention de la Légion d'honneur. Pour son dossier personnel, Archives Nationales BB/6/II/959. (12) L. Josserand, Droit romain : Essai sur la nature des actions qui sanctionnent les negotia nova ; Droit français : Des successions entre époux (loi du 9 mars 1891), th. pour le doctorat soutenue le 30 juin 1892 devant la Faculté de droit de Lyon, 1892, p. 6. Le jury de la thèse est composé de C. Appleton (président), Audibert, Caillemer, Leseur. (13) Ibid., p. 115. (14) Ibid., p. 136. V. M. Nicod, Les facultés de droit et le projet de réforme successorale de 1872 (proposition Delsol), in Les Facultés de droit inspiratrices du droit ?, op. cit., p. 35-39. (15) Ibid., p. 139. (16) Le doyen Caillemer note dans son rapport de 1901-02 que Josserand « ne se console pas des échecs qu'il a subis dans les concours pour l'agrégation et il ne dissimule pas les
26
sentiments que lui causent les épreuves qui ont été la suite de ses échecs » (AN dossier personnel, BB/6/II/959). (17) Rapport de M. Garçonnet, concours d'agrégation 1898, section de droit privé et de droit criminel, 13 juill. 1898 (Arch. nat. F/17/4444). Les autres agrégés sont Percerou, Ferron, Ghensi, Margat, Perreau. (18) Deux exemples : E. Bouvier, L'évolution de l'idée de responsabilité, Revue critique de législation et de jurisprudence, 1898. 177-185 ; M. Dufourmantelle, Compte rendu de : De la responsabilité du fait des choses inanimées de L. Josserand et Les accidents du travail et la responsabilité civile de R. Salleiles, Bulletin de la société de législation comparée, 1897. 629-630. (19) Pour une mise en perspective des débats autour de la responsabilité civile au tournant du XX
e siècle, on consultera l'ouvrage classique de F. Ewald, L'Etat providence, Grasset, 1986.
(20) R. Saleilles, Les accidents du travail et la responsabilité civile. Essai d'une théorie objective de la responsabilité délictuelle, Paris, Arthur Rousseau, 1897. (21) R. Saleilles, Compte rendu de : P. Rencker, De la non-responsabilité conventionnelle (thèse de doctorat, Dijon), Revue bourguignonne de l'enseignement supérieur, 1894, t. IV, p. 647-666 (22) Sur la théorie du risque chez Saleilles et Josserand, V. D. Deroussin, Histoire du droit des obligations, Economica, 2007, p. 843-846. (23) Archives privées Louis Josserand (à présent, APJ), lettre de R. Saleilles, 28 sept. 1897. (24) Josserand assure, consciencieusement mais manifestement sans passion, la responsabilité de cette chronique jusqu'en 1908. A partir de 1909, son successeur, Eugène Gaudemet, donne à cette chronique, à travers des contributions longues et très fouillées, une tout autre ampleur. (25) E. Garsonnet, L. Josserand, Traité élémentaire des voies d'exécution, 3
e éd., Paris,
Larose, 1900. Garsonnet décède accidentellement en 1899. Josserand assure la réactualisation de l'ouvrage jusqu'en 1920 (6
e éd.).
(26) Sur ce Congrès, Ch. Jamin, Le vieux rêve de Saleilles et Lambert revisité. A propos du centenaire du Congrès international de droit comparé de Paris, Revue internationale de droit comparé, 2000, vol. 52, n° 4, p. 733-751. Sur les enjeux politiques et scientifiques des débats consacrés au droit public, Guillaume Sacriste, Le droit de la République (1870-1914), op. cit. (27) Sur le développement du droit comparé sous la III
e République, A. Stora-Lamarre, La
République des faibles. Les origines intellectuelles du droit républicain (1870-1914), Armand Colin, 2005, p. 115-132. (28) Le comité d'organisation, composé exclusivement de Parisiens, principalement
27
professeurs de droit, avocats et magistrats, structure le congrès en six sections (théorie générale et méthode, droit international privé, droit commercial, droit civil, droit public, criminologie) et nomme, pour chacun d'entre elles, des rapporteurs généraux. Ces derniers, pour la plupart professeurs dans des facultés de province, comptent notamment Edouard Lambert, un autre lyonnais. V. Congrès international de droit comparé tenu à Paris du 31 juillet au 4 juillet 1900. Procès-verbaux des séances et documents, LGDJ, 2 tomes, 1905. (29) L. Josserand, Conception générale du droit comparé, in Congrès international de droit comparé, op. cit., p. 238 (souligné dans le texte). (30) Ibid., p. 240. (31) L. Josserand, Essai sur la propriété collective, Le Code civil. 1804-1904. Livre du Centenaire, Paris, Arthur Rousseau, 1
re éd., 1904, rééd. Bibliothèque Dalloz, 2004, p. 357-
379. Josserand n'est pas membre de la Société d'études législatives ; sa participation au libre jubilaire est une fois encore liée à sa proximité du réseau Saleilles. Pour une analyse du livre du Centenaire, V. J.-L. Halpérin, Présentation, Le Code civil. 1804-1904, op. cit. Sur la Société d'études législatives, M. Milet, La fabrique de la loi. Les usages de la légistique sous la III
e
République (1902-1914), in O. Ihl, M. Kaluszynski, G. Pollet (dir.), Les sciences de gouvernement, Paris, 2003, p. 123-141. (32) V. la bibliographie donnée par L. Josserand, Essai sur la propriété collective, op. cit., p. 359, n° 1 ainsi que le débat dans le cadre du Congrès international de droit comparé, op. cit., t. 1, p. 109-112. (33) L. Josserand, Essai sur la propriété collective, op. cit., p. 379. (34) Ibid., p. 377. Plus sévère encore, il remarque que « de nos jours, (le système de l'indivision) devient un non-sens, à mesure que nos institutions, et notamment la propriété, se socialisent davantage » (p. 379). (35) APJ, Lettre de Maurice Hauriou, 18 déc. 1904 ; lettre de Jean Percerou, 19 déc. 1904 ; lettre de Joseph Charmont, 22 janv. 1905. (36) Paris, Arthur Rousseau éditeur, 1905 ainsi que plusieurs notes dans le Dalloz (par ex. : DP 2, 1906. 105-1907 ; DP 2, 1908. 73-75). (37) E.-H. Perreau, Origines et développement de la théorie de l'abus du droit, Revue générale du droit, 1913. 481-507. Cette mobilisation des agents des chemins de fer débute dès 1871 (pétition des mécaniciens des chemins de fer. S. 1891, Lois annotées, p. 140-147). Sur l'importance des agents de chemin de fer dans l'invention du contrat de travail : A. Cottereau, Droit et bon droit. Un droit des ouvriers instauré puis évincé par le droit du travail (France, XIX
e siècle), Annales HSS, nov.-déc. 2002, n° 6, p. 1521-1557.
(38) L. Josserand, De l'abus des droits, op. cit., p. 38. (39) Saleilles tente une première systématisation de l'abus de droit dans son étude sur Les accidents du travail et la responsabilité civile, Paris, Rousseau, 1897, p. 66-67 et, surtout, à
28
l'occasion de la publication de la seconde édition (1895) de son Etude sur la théorie générale de l'obligation d'après le premier projet de Code civil pour l'Empire allemand, Paris, Pichon, p. 370-373, n° 1. V. M. Xifaras, La Veritas Iuris selon Raymond Saleilles. Remarques sur un projet de restauration du juridisme, Droits, n° 47, 2008, p. 77-148. (40) Au premier rang des critiques, il faut naturellement citer Marcel Planiol (Ph. Rémy, Planiol : un civiliste à la Belle Epoque, RTD civ. 2002. 31-45 ). V. sur cet aspect, D. Deroussin, Histoire du droit des obligations, op. cit. et sa préface à De l'esprit des droits et de leur relativité, op. cit., p. VIII-XVI. (41) V. les remarques de Saleilles dans son Etude sur la théorie générale de l'obligation, op. cit. et celles de J. Charmont dans son Examen doctrinal : Questions de responsabilité, Revue critique de législation et de jurisprudence, 1898. 137-145. (42) E. Porcherot (juge suppléant à Besançon), De l'abus de droit, th. pour le doctorat, Université de Dijon, 1901. (43) J. Charmont y confie notamment une longue analyse favorable aux thèses de Jean Bosc et d'Ernest Porcherot : J. Charmont, L'abus de droit, RTD civ. 1902. 113-125. Sur le programme de la RTD civ., C. Jamin, Les intentions des fondateurs, RTD civ. 2002. 646-655
. (44) Sur ce paradigme sociologique, B. Frydman, Le sens des lois. Histoire de l'interprétation et de la raison juridique, Bruxelles, Bruylant, 2005 ainsi que Y-a-t-il en droit des révolutions scientifiques ?, Journal des tribunaux, Bruxelles, 7 déc. 1996, n° 5821, p. 809-813. (45) Selon la remarque de R. Saleilles, Bulletin de la Société d'études législatives, 4
e année,
1905. 323-325. Son rapport intitulé De l'abus de droit présenté à la première sous-commission de révision du code civil est publié dans ce même Bulletin, p. 325-350. (46) APJ, lettre de Saleilles, 5 juill. 1905. Charmont regrette quant à lui que « la commission n'ait pas adopté les conclusions du rapport de Saleilles, pourtant si modérées (...). Et surtout, c'eut été une chose importante et significative que d'inscrire le principe à l'entrée du code, de manière à lui donner une porter générale. Mais si les réformateurs n'en veulent point, la jurisprudence fara da se » (APJ, lettre de Charmont, 27 juin 1905). (47) Selon la suggestive formule de Saleilles qui ajoute à l'attention de Josserand : « Surtout où il y a un de ces bons combats à combattre (sic), on vous trouve au premier rang » (APJ, lettre de Saleilles, 5 juill. 1905). (48) Dans la seconde édition du Traité théorique et pratique de droit civil (1905) de G. Baudry-Lacantinerie et L. Barde, dans le volume consacré aux contrats et aux obligations du Cours de droit civil français de Charles Beudant publié par son fils Robert (1906) ou encore dans la 4
e édition du Traité élémentaire de droit civil de Planiol (1907), l'étude de Josserand
sur l'abus de droit n'est pas mentionnée. Les auteurs se contentent le plus souvent de renvoyer à une note de celui-ci au D. 1906. 2. 105. En 1906, l'étude d'A. Martin (professeur à Genève) sur « l'abus de droit et l'acte illicite », Zeitschrift für schweizerisches Recht, n.f. XXV, 1906, p. 21-60 ignore purement et simplement Josserand ; la thèse de R. Jannot (De la responsabilité civile par suite de l'abus de droit, th. Dijon, 1906) lui fait référence d'une manière tout à fait marginale.
29
(49) A cet égard, les thèses, hostiles à la théorie de l'abus, de M. Vallet, De l'exercice fautif des droits (th. Poitiers,1907), de C. Dobrovoci, De l'abus de droit (Paris, 1909) ou encore d'A. Bardesco, L'abus de droit (Paris, 1913) ne s'appuient guère sur une production scientifique postérieure à 1905. Comme si le débat doctrinal s'était figé à l'issue de cette décision de la commission. (50) L. Josserand, De l'abus des droits, op. cit., p. 50. (51) Ibid., p. 56. (52) Ibid., p. 86. (53) D. 1905, Bull. biblio, p. 11. (54) L. Josserand, De l'abus des droits, op. cit., p. 17. (55) G. Appert, Compte rendu de : Louis Josserand, De l'abus des droits, Paris, Rousseau, 1905, Nouvelle revue historique de droit français, 1905. 805. Sur Josserand et la jurisprudence, V. les remarques de C. Chêne, Jean Carbonnier et la querelle de la source ou de l'autorité : permanence d'un vieux débat ? : http://www.courdecassation.fr/IMG/File/3-intervention_ chene.pdf. (56) V., sur cette séparation de la doctrine et de la jurisprudence, la position d'E. Lambert, Une réforme nécessaire des études de droit civil, Revue internationale de l'enseignement, 1900. 216-243. De son côté, Emmanuel Lévy répète que « Le droit est pratique ; l'homme fort est le praticien » : E. Lévy, Notes sur le droit considéré comme une science (Questions pratiques de législation et d'économie sociale, 1910, t. XI, p. 299). (57) L'expression est de Paul Pic (APJ, lettre de Paul Pic, 25 juin 1905). Traduisant exactement la pensée de Josserand, Emmanuel Lévy peut affirmer que « la jurisprudence a raison contre la doctrine, tout simplement parce qu'elle est. Et tout ce qui est, est possible, est vrai, a sa logique » (La vision socialiste du droit, Paris, 1933, p. 25). (58) Sur le développement des théories générales du droit au début du XX
e siècle, Ph. Jestaz,
Ch. Jamin, op. cit., p. 150-155. (59) L. Josserand, De l'abus des droits, op. cit., p. 18. Quelques années plus tard, Maurice Hauriou félicite Josserand d'être l'un de « ceux, bien rares, qui savent monter des faits à la théorie » (APJ, lettre de M. Hauriou, 1
er mai 1910).
(60) APJ, lettres de Thaller, 25 juin et 8 juill. 1905. Le volume sur Les transports était initialement prévu pour octobre 1906. (61) Josserand assura entre 1902 et 1907 la chronique Transports terrestres dans les Annales droit commercial, 1902 à 1907. Il publia dans cette revue, en 1909, un article sur La force
30
majeure en matière de droit commercial et, en 1911, un autre intitulé De la pluralité des voituriers et de la commission de transport, envisagées spécialement du point de vue de la responsabilité des voituriers successifs. Certains commentateurs de son traité des transports y voient un véritable traité de responsabilité. (62) APJ, lettre d'Albert Wahl, s.d. ; lettre de M. Hauriou, 1
er mai 1910 ; lettre d'Olivier-
Martin, 6 janv. 1910. (63) APJ, lettre de René Gonnard, 24 déc. 1909. (64) Séance du 18 avr. 1907 (question n° 15 : responsabilité en matière d'accidents automobiles) : Bulletin de la Société d'études législatives, 1907, tout particulièrement 273-305. (65) A. Colin, L'accident d'automobile et la loi, Revue politique et parlementaire, 10 janv. 1908. 120-147 ; P. Dupuich, L'accident d'automobile et la loi, Revue politique et parlementaire, févr. 1908. 309-324. A. Wahl publie La responsabilité civile relative aux accidents d'automobiles, RTD civ. VII, 1908. 5-48. (66) A. Colin, L'accident d'automobile et la loi, op. cit., p. 129. (67) Ibid., p. 136. (68) Ibid., p. 140. (69) APJ, lettre d'Adrien Audibert à Josserand (s.d.) : « Vous avouerai-je qu'en matière d'automobilisme, j'ai un peu les opinions ou si vous préférez les préjugés de « ceux qui n'en font pas ». J'ai même adhéré à Ligue de notre collègue Ambroise Colin, sans approuver d'ailleurs tous ses projets ». (70) Ambroise Colin intervient en novembre 1907 à l'Université populaire du faubourg Saint Antoine sur le thème : Des moyens et des mesures à prendre pour enrayer la propagation de l'automobilisme (La conférence Colin, L'Auto, 23 nov. 1907). (71) Anticolinisme, Paris-Sport, 1
er févr. 1908 : « C'est avec des raisons que M. Josserand va
démolir les prétentions du trop fameux juriste, M. Colin ». V. également Les professeurs de droit contre M. Colin, Sports, 31 janv. 1908. (72) Comme le reconnaît L. Josserand dans L'automobile et le droit. Conférence faite à l'Automobile Club du Rhone (12 févr. 1908), Lyon, 1908, p. 2 les « excès de zèle » « risquent de compromettre les intérêts de ceux qui s'y livrent ; puis ils me placent dans une situation bien délicate ». (73) APJ, lettre d'Armand Bouvier-Bangillon à Josserand, s.d. (74) Bulletin de la Société d'études législatives, 1908. 176.
31
(75) L. Josserand, L'automobile et le droit, op. cit., p. 2. (76) Sur le code de la route, A. Kletzlen, L'automobile et la loi. Comment est né le Code de la route ?, L'Harmattan, 2000 ; S. Beaucreton, La rue saisie par le droit. L'automobile et la réglementation juridique à la Belle époque, in F. Thélamon (dir.), La rue, lieu de sociabilité ? Rencontres de la rue, PU Rennes, 1997, p. 123-132. (77) M. Desportes, Paysages en mouvement. Transports et perception de l'espace. XVIIIe-XX
e
siècle, Gallimard, 2005, p. 247. (78) L. Boltanski, Les usages sociaux de l'automobile : concurrence pour l'espace et accidents, Actes de la recherche en sciences sociales, 1975, vol. 1, n° 2, p. 25-49. (79) L. Josserand, De l'abus des droits, p. 2-3. (80) Ibid., p. 40. (81) Ibid., p. 21. Par exemple, à propos du droit de grève, Josserand remarque qu'il « existe pas de droit qui porte en lui-même sa raison d'être et sa propre justification, donc pas de droit qui puisse prétendre échapper à tout contrôle et choisir librement son terrain de réalisation pratique (...) ». C'est pour la sauvegarde des intérêts professionnels des ouvriers ou des employés que « le droit de coalition leur a été accordé et c'est seulement s'ils le font servir à cet usage qu'ils auront carte blanche et qu'ils pourront prétendre à l'immunité à raison des faits de grève » (p. 27). (82) Sur Jhering, on consultera P. Coulombel, Force et but dans le droit selon la pensée juridique de Jhering, Archives Phil. dr., n° 4, 1957, p. 609-631 ainsi que O. Jouanjan, Jhering ou l'amour du droit, présentation de R. Von Jhering, La lutte pour le droit, Dalloz, 2006, p. V-XXXIII. (83) Dans son Essai sur la propriété collective (op. cit., p. 360, n° 2), Josserand dispute vigoureusement à Planiol et Vareilles-Sommières la référence à Jhéring à propos de la question de la personnalité morale. Pendant la Grande guerre, patriotisme oblige, Josserand prend Ihering comme représentant par excellence de la conception allemande du droit qui confondrait droit et force : L. Josserand, La force et le droit, Conférence faite à l'Université, Trévoux, 1917. (84) V. D. Jutras, Louis and the Mechanical Beast or Josserand's Contribution to Objective Liability in France, in K. Cooper-Stephenson et L. Gibson (éd.), Tort Theory, Captus University Publications, 1993, p. 317-339. (85) En 1901, Bartin sera le dernier à quitter Lyon pour Paris avant l'entre-deux-guerres. Les candidatures parisiennes de Paul Huvelin et d'Emmanuel Lévy échouent respectivement en 1907 et 1914. (86) Les dates mentionnées entre parenthèses sont celles du décanat.
32
(87) L'état de santé très défaillant du doyen Octave Flurer l'avait contraint dès le mois de mars 1913 à renoncer au décanat. Il est décédé quelques mois plus tard. (88) Pour l'élection de Josserand au décanat, on consultera son dossier personnel aux Archives nationales (AN BB/6/II/959) ainsi que les Archives de la Faculté de Droit de Lyon, Procès verbaux de l'Assemblée de la Faculté. (89) Marc Sauzet quitta Lyon pour Paris en 1891. Il fut imité deux ans plus tard par Edmond Thaller et Paul Leseur. L'exode se poursuivit avec le départ pour la capitale de Henry Berthélemy en 1898. Charles Audibert prit le même chemin en 1899. (90) En 1919, le traitement des agrégés était de 14 000 F à Paris et de 10 000 F en province. Association des membres des facultés de droit (IX
e Bulletin), Compte rendu de l'Assemblée du
30 octobre 1919, Paris, 1920, p. 16. (91) Les sentiments d'exaspération que faisaient naître l'Université parisienne et les divers privilèges dont elle jouissait n'étaient en effet nullement le monopole des juristes. Les registres du Conseil de l'Université de Lyon contiennent de multiples manifestations de la communion qui, en la matière, réunissait littéraires, médecins, scientifiques et juristes. Ainsi, lors de la séance du 15 novembre 1900, « Des protestations sont formulées par plusieurs membres contre les prétentions du ministère d'imposer aux facultés des sciences ou des lettres des maîtres de conférences sur le choix desquels ces facultés ne sont pas consultées, les facultés de Paris, au contraire, émettent toujours un avis, au moins officieux. M. Lacassagne en prend thème (sic) pour protester à nouveau contre les différences injustifiables maintenues par tous les régimes successifs entre les professeurs parisiens et les professeurs de province ; il demande au Conseil de renouveler le voeu, déjà émis sur la proposition de M. Reynaud en faveur du droit pour les provinciaux d'être admis à faire partie de l'Institut de France sur le simple vu de leurs titres scientifiques, sans être astreints à la résidence à Paris », Archives départementales du Rhône, 1, t. 273, Registre des séances du Conseil de l'Université (6 mai 1897-12 févr. 1903). (92) L'expression a été employée par l'un des collègues de Josserand, le professeur Pierre Garraud, dans un rapport adressé au ministère de l'Instruction publique et publié dans la Revue de l'Université de Lyon, 1929. 87. (93) A. Ehrhard, professeur à la Faculté de lettres de Lyon, Le centenaire de l'Université de Berlin, Bulletin de la société des amis de l'Université de Lyon, janv. 1911. 15. (94) C. Fillon, La Faculté de Droit lyonnaise et l'expansion universitaire sous la Troisième République, La Fondation de l'Ecole de Droit de Beyrouth, Le renouvellement des sciences sociales et juridiques sous la III
e République - La Faculté de droit de Lyon (Actes du colloque
tenu à Lyon les 4 et 5 févr. 2004), contributions réunies par David Deroussin, Paris, Editions La Mémoire du droit, 2007, p. 303-331. (95) Bien que la matière soit abondante, on ne prendra ici qu'un seul exemple : celui du conflit de préséance survenu en 1931 entre le Lyonnais Pierre Garraud et le Parisien Camille Perreau, alors que la mission en escale à Istanbul devait répondre à une invitation du recteur de la Faculté de la même ville. L'affaire a donné lieu à une très sérieuse délibération de la commission de la Faculté de droit de Paris. Elle est fort significative du caractère parfaitement
33
factice de la cordialité qui présidait aux relations des universitaires embarqués, sans jeu de mots, sur le bateau : « Ce n'est pas la Faculté de Paris qui a sollicité la fusion des missions d'examen envoyées à Beyrouth et au Caire. L'administration de l'enseignement supérieur y a vu une mesure d'économie et un moyen de détourner en même temps moins de professeurs de leurs fonctions en France. Cela nous a paru raisonnable, malgré quelques inconvénients qu'on peut d'ailleurs éviter ou atténuer. (...) nous considérons comme absolument indispensable que la mission envoyée au Caire soit composée de quatre délégués désignés par la Faculté de Paris, d'accord avec le Directeur et correspondant aux quatre branches de notre enseignement. (...) Imprécision du rôle des deux présidents : Aucun conflit soit au Caire, soit à Beyrouth. Mais si l'on fait escale ou si on s'arrête- par exemple à Stamboul (sic) ou à Damas - à qui revient la préséance ? Les Lyonnais prétendent l'avoir dans le Proche-Orient (Stamboul et Damas). C'est injustifié et inélégant. Les Lyonnais sont souvent obligés d'envoyer un jeune professeur. Les Parisiens en envoient un ancien. Ex : conflit à Stamboul entre M. Garraud de Lyon et M. Perreau de Paris. Il y a lieu de préciser que -hors les deux écoles - la préséance revient au plus ancien - ou au Parisien » (souligné dans le texte original), Centre des Archives diplomatiques de Nantes, Services des Oeuvres françaises à l'Etranger, Egypte, n° 362. (96) Il est peu de dire que l'on fit assaut de prévenances à l'égard des étudiants libanais... Au prix créé à l'initiative du professeur parisien Collinet en faveur du meilleur étudiant de première année, l'on répliqua, par veuve ou épouse interposée de professeur lyonnais, par le prix décerné par M
me Huvelin (pour la 2
e année) et celui offert par M
me Bouvier-Bangillon (pour
la 3e année). La Faculté de droit de Lyon enfonça le clou final en faisant frapper diverses
médailles remises aux étudiants libanais méritants... (97) « Reprenant le desideratum qu'elle avait déjà émis le 19 mars 1934, l'Université syrienne désire voir siéger à Damas le jury du Caire et non celui de Beyrouth, c'est-à-dire que la présidence de l'examen soit confié à un professeur parisien. A tort ou à raison, les professeurs syriens ont vu dans la décision prise il y a sept ans une tentative victorieuse de la Faculté de Lyon pour les soumettre à son contrôle et pour les tenir en subordination. Cette cause, s'ajoutant à d'autre (sic), a donné aux Damasquins une aversion assez grande pour l'Ecole de Beyrouth et la Faculté française, dont elle dépend », Lettre du ministre des Affaires étrangères au ministre de l'Education nationale (s.d.), Centre des archives diplomatiques de Nantes, Service des Oeuvres françaises à l'Etranger, Syrie, 378. (98) Pour le ministère de l'Education nationale, l'Ecole de Damas n'étant ni la filiale de Paris, ni celle de Lyon, il était tout simplement hors de question de privilégier ou d'exclure radicalement l'une ou l'autre des facultés. (99) Les rapports d'examen relatifs à l'Université de Damas, certes incomplètement conservés, que l'on peut trouver dans les archives nantaises du Service des Oeuvres françaises à l'Etranger sont en effet rédigés par des plumes parisiennes. (100) Cette association avait été constituée en 1913 et c'était à elle, officiellement, qu'incombait la charge de l'administration des écoles libanaises de droit et d'ingénieurs. Elle avait été, à l'origine, placée sous la présidence de Paul Huvelin qui conserva cette fonction jusqu'à sa mort survenue en 1924. Josserand assura à cette date une présidence intérimaire, en attendant le retour à Lyon de Paul Roubier. Ce dernier, ancien étudiant lyonnais qui avait été, de 1919 à 1922, directeur de l'Ecole de droit de Beyrouth, devait réintégrer son université d'origine en 1924 et assumer immédiatement les fonctions de président de l'Association. Il a conservé ces dernières jusqu'en 1949. Depuis 1922, la direction de l'Ecole était passée des mains de Paul Roubier à celles d'Antoine Mazas, un professeur lyonnais issu de la Faculté catholique. Il a exercé cette fonction pendant tout l'entre-deux-guerres.
34
(101) Archives départementales du Rhône, 1, t. 338, Lettre du doyen Josserand au ministre de l'Instruction publique du 18 sept. 1919. (102) D. Deroussin, Josserand, le Code civil et le Code libanais des obligations et des contrats, op. cit., p. 49-94. (103) Archives conservées à l'Université, Ecole de Beyrouth Dans une lettre du 8 décembre 1927 adressée à Choucri Cardahi, Roubier commentait en ces termes la nouvelle que venait de lui apprendre son correspondant : « J'ai eu beaucoup de plaisir à apprendre que notre doyen avait été chargé par le Gouvernement libanais de la révision du code des obligations, c'est une manifestation dont la Faculté de Droit de Lyon ne peut être que très touchée, et une récompense pour elle des efforts poursuivis avec tant de persévérance pour le développement de votre beau pays ». (104) Sur cette affaire, M. Milet, Les professeurs de droit citoyens. Entre ordre juridique et espace public, contribution l'étude des interactions entre les débats et les engagements des juristes français (1914-1995), th. pour le doctorat en science politique, Université Panthéon-Assas, Paris II, 2000, t. 1, p. 59-65. (105) L'un d'entre eux, M. Fathy (avocat au tribunal de Beni Souëf) soutint, en 1912, une thèses sur La notion de l'abus des droits dans la jurisprudence musulmane (Lyon) tout à la gloire de Josserand. Cette thèse est l'occasion pour E.-H. Perreau de traiter dans la Revue générale du droit, des « origines et développement de la théorie de l'abus du droit », op. cit. (106) Archives de la Faculté de droit de Lyon, délibération du 10 mars 1919, Dossier Dons et Legs, Legs Balaÿ. (107) Comme le montre le dossier 1, t. 310 des Archives départementales du Rhône, à l'exception de la candidature Saldaña (probablement défendue par René Garraud), tous les rapports sur les professeurs étrangers, officiellement faits par le doyen Josserand devant le Conseil de l'Université, avaient été préalablement établis par Edouard Lambert. Ce dernier avait d'ailleurs été envoyé en mission en Pologne en 1921 ; le voyage de retour ayant eu lieu par la Tchécoslovaquie, des contacts avec des collègues praguois avaient été noués à cette occasion. Lambert avait été également professeur d'échange en Belgique, en 1924. (108) Dans le discours qu'il prononça à la rentrée 1926, au lieu et place de Josserand retenu à Paris par la présidence du concours d'agrégation, Edouard Lambert a dressé la liste des rétributions symboliques que les fêtes du Cinquantenaire avaient d'ores et déjà rapportées à la Faculté en général et à l'Institut de droit comparé en particulier. Il mentionnait notamment l'association des Lyonnais, en qualité de représentants de la science française, aux travaux de la Société de Législation comparée de Londres et la décision du Bureau international du Travail de s'adresser à l'équipe lyonnaise pour la confection de la partie en langue française du Recueil International de la Jurisprudence du Travail. Université de Lyon, Faculté de droit de Lyon, Année scolaire 1925-1926, Lyon, A. Rey imprimeur, 1927, p. 25. (109) Il est vrai que Josserand et Cornil avaient en commun un puissant intérêt pour la théorie de l'abus des droits dont le second était le défenseur en Belgique. (110) L. Tournès, La fondation Rockefeller et les économistes lyonnais (1925-1935), in D. Deroussin (éd.), Le renouvellement des sciences sociales et juridiques, op. cit., p. 263-278.
35
(111) APJ, Lettre Robert Valeur du 18 juin 1928. Ce courrier mentionne « la liste des professeurs américains que je vous avais fait parvenir l'année dernière ». Cette liste, conservée dans les papiers Josserand, comporte, entre autres, les noms suivants que Robert Valeur recommandait tout particulièrement à son doyen : Hessel E. Yntema (Columbia University School of Law), Roscoe Pound et Félix Frankfurter (Harvard University Law School), Walter G. Cook (Yale University School of Law), Ernst Freund et Ernst W. Puttkammer (University of Chicago Law School), John H. Wigmore (Northwestern University School of Law Chicago), James Garner (University of Illinois), Orrin K. Mc Murray (University of California School of Jurisprudence, Berkeley). En 1928, Robert Valeur compléta la liste initiale en ajoutant les noms de Henry Bates (University of Michigan Law School) et de PF. Walton (Oxford University). (112) Illinois Law Review, mars 1928, vol. XXII, n° 7, p. 809-812. (113) Le traité relatif aux voies d'exécution a fait l'objet de rééditions actualisées en 1920, puis en 1925. (114) APJ, Lettre Berthélémy du 8 juill. 1927. (115) Idem, Lettre Lyon-Caen du 9 août 1927. L'ouvrage fut effectivement présenté à l'Institut à l'automne 1927. (116) Le jury d'agrégation de l'année 1922 fut finalement présidé par Albert Wahl, Emile Garçon étant décédé brutalement au cours de l'été. (117) Son activité au sein du Conseil supérieur de l'Instruction publique ou encore dans l'Association des membres des Facultés de droit, fondée en 1909 (dont Josserand a exercé un temps les fonctions de président) mériterait une étude approfondie. Josserand lutte fermement en faveur du relèvement du statut et du traitement des professeurs de province. (118) Sur Georges Ripert : J.-L. Halpérin, Georges Ripert, in P. Arabeyre, J.-L. Halpérin, J. Krynen (dir.), Dictionnaire historique des juristes français, Puf, 2007, p. 669-670. Pour son dossier personnel : AN F/17/25290 (soumis à dérogation). (119) G. Ripert, La règle morale dans les obligations civiles, LGDJ, 1925, p. 174. (120) L. Josserand, L'Esprit des droits et leur relativité, op.cit., n° 293, p. 370. Dans la seconde édition de l'ouvrage parue en 1939, il pourra compléter la même phrase en ajoutant au code soviétique des références moins compromettantes : les codes polonais et libanais, ainsi le projet de franco-italien d'un code des obligations, projet à la rédaction duquel Georges Ripert avait participé... (121) « Monsieur le Doyen, Vous m'avez procuré un très grand plaisir, celui de lire un ouvrage d'une pensée claire et précise où tout est savamment ordonné et dont pourtant un art profond ne laisse au lecteur que le plaisir d'une lecture facile. Je n'ai pris d'ailleurs encore avec votre ouvrage qu'un premier contact trop superficiel. Je vais l'emporter en vacances et là je pourrais le méditer à loisir. Vous aurez peu de lecteurs aussi attentifs. (...) Je vais avec vous reprendre
36
le problème. Je pourrais mieux vous dire ensuite si vous m'avez convaincu. J'entrevois dès la première lecture quelques points sur lesquels je ne partage pas complètement votre sentiment : mais c'est la réaction individuelle contre toute théorie et je ne prétends nullement avoir raison contre vous (...) », APJ, Lettre Georges Ripert, Paris, 13 juill. 1927. (122) « Or le droit subjectif c'est bien un pouvoir de l'homme. Ce pouvoir existe. (...) Il dérive de la grande loi naturelle de l'inégalité. Ceux qui dénoncent ce pouvoir méconnaissent ce qu'il y a de divin dans l'idée de puissance : omnis potestas a Deo », G. Ripert, Abus ou relativité des droits, A propos de l'ouvrage de M. Josserand, Revue critique de législation et de jurisprudence, année 1929, t. 49, p. 62. (123) Ripert cite en effet l'ouvrage d'H. Massis, Défense de l'Occident, qui venait tout juste de paraître. (124) Sur le socialisme juridique et la Faculté de droit de Lyon, le dossier Croyance et révolution dans le droit : Emmanuel Lévy (1871-1944) dirigé par F. Audren, B. Karsenti dans Droit & société, n° 56-57, juill.-août 2004 ainsi que C. M. Herrera, Droit et socialisme à la Faculté de droit de Lyon, in D. Deroussin (éd.), Le renouvellement des sciences sociales et juridiques, op. cit., p. 279-302. (125) « L'Université de Lyon paraît avoir quelque inclination pour le Code civil des Républiques socialistes soviétiques. Son Institut de droit comparé nous en a donné la traduction et M. Lambert l'a présenté comme le « miroir magique » où l'on voit « se dessiner les lignes directrices du régime juridique nouveau ». M. Josserand à son tour regarde le droit dans ce miroir », G. Ripert, Abus ou relativité des droits, A propos de l'ouvrage de M. Josserand, Revue critique de législation et de jurisprudence, année 1929, t. 49, p. 35. « ... Par trop d'ardeur ou trop de faiblesse, M. Josserand s'est laissé prendre à cette invitation. Tout près de lui M. Lambert saluait avec admiration le Code soviétique. Trop près de lui M. Emmanuel Lévy affirmait que par des formules juridiques il transformerait la société... », idem, p. 37. L'acharnement à l'endroit d'Edouard Lambert se vérifiait dans la conclusion de l'article « Récemment encore M. Ed. Lambert appelait à la lutte « les agissantes minorités d'hommes d'enseignement » qui veulent dresser le droit social nouveau contre « les traditions nationalistes des techniques juridiques établies », et il ne désavouait pas cette définition de la socialisation du droit donnée par un auteur étranger : « une réorientation de la science du droit et un renouvellement des notions juridiques conformément aux idées sociales mondiales ». Ces idées sociales qui les crée et prétend nous les imposer ? Où sont leurs titres et leurs patrons ? Contre ce nouveau et dangereux dogmatisme, nous maintiendrons le droit que dans une communauté des idées morales nos sociétés occidentales ont lentement formé », idem, p. 63. (126) Dans les années 1930, Josserand consacre au « nouvel ordre contractuel » plusieurs chroniques qui, sans renier ses aspirations sociales passées, témoignent bien de ses préventions à l'égard du capitalisme et du socialisme : J.-P. Chazal, Louis Josserand et le nouvel ordre contractuel, RDC 2003. 325-332. (127) « Monsieur le Doyen, L'article que vous avez bien voulu écrire sur mon étude m'a fort intéressé et je l'ai remis à notre éditeur qui vous enverra des épreuves. Il n'y a qu'un point sur lequel je voudrais qu'il n'y eût aucun doute dans votre esprit. Il était tout à fait loin de ma pensée de critiquer une conception ou l'ambiance de l'université de Lyon et de vous considérer comme l'apôtre du bolchevisme. Je voulais uniquement montrer le danger d'une formule. Il est possible que je l'ai exagéré. Il est bien difficile d'entourer sa pensée de toutes les réserves qu'elle comprenait. Je suis en tout cas heureux que vous ayez bien voulu voir dans cette étude un signe de l'intérêt que je porte à vos ouvrages. Vous le trouverez d'ailleurs
37
expressément dans le Traité des obligations », APJ, Lettre Georges Ripert du 29 avr. 1929. (128) A défaut d'apporter la réponse à une question qu'on s'est souvent posé à propos de Louis Josserand (Quelles étaient ses opinions politiques ?), du moins le texte d'une conférence, « En mission des rives du Tage aux bords du Danube », prononcée devant l'association des amis de l'Université le 5 mars 1933, permet-il de trancher quant à ses opinions religieuses car c'est ainsi que Josserand lui-même se qualifie. (129) « ... sans doute, il est très bien de demeurer, comme le proclame M. Ripert, attaché à la tradition ; mais un jour vient où c'est la tradition elle-même qui nous abandonne ; il n'est pas de communauté qui ne soit tributaire de la loi inéluctable de l'évolution ; le droit de Justinien n'était plus celui des XII Tables ; le droit du XX
e siècle ne peut plus être celui de
l'aube du XIXe. Toutes les législations récentes sacrifient plus ou moins au concept de la relativité... Contre un courant de cette force et de cette envergure, on ne lutte pas avec des mots, même en se raccrochant désespérément à un passé qui nous fuit », L. Josserand, A propos de la relativité des droits, réponse à M. Ripert, Revue critique de législation et de jurisprudence, 1929, t. 49, p. 280-281. (130) En italique dans la version originale, idem, p. 277. (131) APJ, Lettre Joseph Delpech du 23 sept. 1929. (132) D. Fenouillet, Etienne, Louis Josserand (1868-1941), op. cit., p. 38. (133) Ph. Jestaz et Ch. Jamin, op. cit., p. 161. (134) Le plan du Cours était calqué sur l'invariable programme de la licence en droit. Le premier tome était donc consacré à la théorie générale du droit et des droits, à la famille, à la propriété et autres droits réels principaux, le tome second à la théorie générale des obligations, aux principaux contrats et aux sûretés, le tome 3 s'intéressait aux régimes matrimoniaux, successions et libéralités. (135) Préface à l'édition de 1929. (136) « Mon cher ami, Je reçois et j'ai déjà parcouru à la fois avec sympathie et avec joie ton second volume. C'est une oeuvre de premier ordre. Depuis Baudry-Lacantinerie, les traités de droit civil paraissaient devenus le privilège des professeurs de Paris. Sans doute Planiol était précieux : mais que de timidité ; quelle (sic) manque d'audace dans ses vues sur l'avenir ; quelle incompréhension des besoins, souvent quelle interprétation étroite et archaïque du droit ! A. Colin et Capitant sont supérieurs, très supérieurs même. Mais comme on sent qu'au fond ils ne s'entendent pas ! L'un des deux est un bourgeois qui raisonne sagement, mais qu'on sent complètement fermé à toute idée moderne, presque féroce dans sa méfiance à cet égard, l'autre est un élégant esprit français, constructif, éveillé, mais sans cesse éteint par son acolyte. Tu nous donnes aujourd'hui le traité moderne, débarrassé des controverses vieillies, vivant et clair, dégageant les raisons profondes des évolutions législatives et jurisprudentielles. Ce livre te fait le plus grand honneur. Je l'ai déjà cité plusieurs fois après la publication du premier volume. J'aurai maintenant bien d'autres occasions de le citer et d'en profiter. Merci mille fois pour ton cordial envoi, et bien amicalement à toi », APJ, Lettre Jean Appleton du 16 mars 1930.
38
(137) « (...) Je ne doute pas que tout en s'imposant comme le bréviaire des étudiants curieux et avertis, votre oeuvre ne soit appelée à supplanter les manuels ou traités antérieurs dans l'estime des juristes (...) », APJ, Lettre Edouard Lambert du 11 janv. 1930. (138) « (...) Votre livre est destiné tout d'abord à ruiner les petits Précis et puis, en outre, à concurrencer dangereusement le Planiol-Ripert et le Colin-Capitant. En ce qui me concerne, je m'efforcerai par tous les moyens de l'introduire dans notre Faculté et de lui faire prendre toute la place qui lui revient », APJ, Lettre Julien Bonnecase du 21 sept. 1929. (139) « Monsieur le Doyen, Quand j'ai reçu le Tome I de votre cours de droit civil, j'ai pensé que l'envoi d'un ouvrage d'une si haute importance méritait plus qu'un accusé de réception et un remerciement avant lecture. (...) J'ai lu et médité (j'enseigne en 1
re année) vos deux
premières parties et parcouru votre 3e partie. Il m'est fort agréable de vous dire quel
enrichissement intellectuel m'a procuré votre livre qui est assuré de prendre une très grande place à côté des traités de Planiol et de Capitant. J'ai fait mon profit, notamment, du plan que vous avez adopté pour l'étude des personnes que vous envisagez individuellement, puis collectivement dans l'institution de la famille - de votre étude de la famille naturelle - de vos observations, lumineuses dans leur concision, sur la personnalité morale. J'ai été particulièrement satisfait de lire votre proposition - que j'enseigne à mon cours : « il faut parler aujourd'hui non de propriété, mais des propriétés » - et aussi votre critique de la conception individualiste de l'usufruit dans notre droit. (...) Ce que, par-dessus tout, j'apprécie dans votre livre c'est ce modèle d'architecture des idées qu'il nous donne et sa méthode : bien que dépouillé de toute érudition en ce que concerne le droit antérieur au Code civil, votre traité, plus que celui de vos devanciers obéit à un esprit historique et critique et non plus dogmatique et logique, puisque vous prenez comme centre de vos exposés, non les formules figées des textes, mais le mouvement continu de la jurisprudence sous la pression et, peut-on dire, sous l'étreinte de la vie économique et sociale. Et je suis convaincu que, de cette manière, la description juridique, cessant d'être une froide casuistique, s'élève en dignité dans l'ordre spéculatif, en se pénétrant d'un esprit vraiment scientifique ; et qu'elle gagne également dans l'ordre pragmatique et utilitaire et pour la formation intellectuelle des magistrats qui doivent acquérir un sens avisé des transformations nécessaires.Voilà quelques-unes des réflexions très nombreuses qui m'ont été suggérées par la lecture de votre ouvrage », APJ, Lettre Gaston Morin, 30 janv. 1930. (140) APJ, Lettre Paul Pic, 12 avr. 1932 : « Votre traité est l'un des rares ouvrages scientifiques dont le succès ne s'est pas démenti même au plus fort de la crise, et le fait seul suffit à en attester la valeur. » Reprenant la même idée dans un courrier du 22 nov. 1932, le même ajoutait avec une évidente jubilation : « On n'en revient pas à Paris ! ». APJ, Lettre Julien Bonnecase, 23 nov. 1937 : « (...) Malgré les sombres pronostics des Parisiens au temps jadis, votre livre a pris, qu'on le veuille ou non, la place des Traités parisiens et cela en très peu de temps. Je vais lui consacrer une très longue étude dans la Revue Générale du Droit de décembre. Ce sera le meilleur moyen pour moi de vous remercier de votre attention tout en rendant justice à la science (...) ». (141) Ces problèmes de santé nous sont connus par la correspondance de l'automne 1938. Ils ont certainement pesé dans la décision de Josserand de renoncer définitivement à entreprendre le voyage au Japon, qu'à l'invitation de plusieurs professeurs nippons, il souhaitait faire depuis 1932. (142) APJ, Lettre Georges Ripert du 27 oct. 1937. (143) Dans l'avant-propos de la deuxième édition, qui porte la date d'octobre 1931, Josserand
39
remerciait « le public de l'accueil réservé à son oeuvre... elle a pénétré, en France et à l'étranger, beaucoup plus rapidement et plus complètement qu'il n'avait osé l'espérer, dans les différentes catégories de juristes auxquels elle s'adressait : étudiants, avocats, avoués, notaires, magistrats, professeurs ». (144) « (...) parmi les cours connus et réputés, c'est le plus vivant, le plus réaliste. Le style coloré et personnel exprime un contenu très riche d'une façon lapidaire mais très claire. L'histoire des institutions n'a que la place qu'elle mérite et c'est ainsi que vous avez pu écrire des pages de droit comparé très intéressantes et tellement profitables pour les étudiants. Mes étudiants qui travaillent sur votre cours sont très contents et j'obtiens de très bons résultats avec : c'est donc un devoir de vous exprimer toute notre reconnaissance et je l'ai fait avec le plus grand plaisir (...) », APJ, Lettre Traian Ionasco, professeur à Jassy (Roumanie), 31 oct. 1933. « ... votre renommée de civiliste a dépassé les frontières de votre pays et vos avis sont très écoutés en Belgique, où je vous citerai d'ailleurs à l'occasion de mon enseignement ou de mes plaidoiries !(...) », APJ, Lettre Xavier Jeanne, professeur à l'Université de Liège, vice-président de la Fédération des avocats belges, 23 nov. 1933. (145) « (...) J'ai choisi dans cette année universitaire (d'avril 1931 à février 1932) « le tome second de votre cours » comme le livre obligatoire d'étude pour les étudiants de la deuxième année aussi bien que de la troisième année de la section du droit français, et je le lis devant eux toutes les deux semaines pendant deux heures de suite. Une centaine d'étudiants travaillent ainsi avec moi votre ouvrage avec un grand intérêt. Je tiens à témoigner ainsi toute mon appréciation de votre ouvrage (...) » APJ, Lettre Naojiro Sugiyama, Tokyo, 3 oct. 1931. (146) « (...) Plus que jamais, sous cette réadaptation sans brusquerie, votre cours de droit civil positif consolidera la situation qu'il a prise, non seulement en France, mais au dehors, de l'exposition d'ensemble par excellence du droit civil français vivant aujourd'hui : situation dont j'ai pu suivre graduellement le développement du dehors, au travers des revues et périodiques étrangers, et en particulier ceux des Etats-Unis (...) », APJ, Lettre Edouard Lambert, 1
er nov. 1937.
(147) « (...) J'ai pu constater, lors de mon séjour en Amérique du sud l'an dernier, combien elle (votre oeuvre) était appréciée de tous. La clarté de sa présentation, la solidité de ses développements, sa très abondante documentation et son caractère social nettement accentué en font l'oeuvre représentative du droit civil français actuel (...) », APJ, Lettre Léon Julliot de la Morandière, Faculté de droit de Paris, 8 févr. 1940. (148) Pour donner une idée du chemin parcouru par la responsabilité, il rappelait en 1931 à divers auditoires étrangers : « Du temps que j'étais étudiant, mon professeur de droit civil traitait de la responsabilité en une seule et unique leçon, comme d'un sujet tout à fait secondaire ; et les répertoires de jurisprudence étaient alors bien pauvres en décisions touchant aux délits ou aux quasi-délits civils. Actuellement, dix ou douze leçons suffisent à peine au professeur pour donner à ses élèves une idée du même sujet... En vérité, la responsabilité est la grande vedette du droit civil mondial, elle fait prime partout », L. Josserand, Evolutions et Actualités (conférences de droit civil), L'évolution de la responsabilité, Librairie du Recueil Sirey, 1936, p. 29. (149) DP 1925. 2.105, note ss. T. civ. Lectoure, 10 avr. 1925, p. 107. (150) C'est le titre de la chronique parue au DH 1930. 1. 5.
40
(151) Cass., ch. ré., 13 févr. 1930, DP 1930. 1. 57-70. (152) L. Josserand, La responsabilité du fait des automobiles devant les chambres réunies de la Cour de cassation, p. 27, DH 1930. 1. 25. (153) DP 1930. 1. 57, note Ripert, « Faut-il attacher une grande importance à cette formule de la présomption ? Y-a-t-il dans la pensée de la Cour une différence entre présomption de faute et présomption de responsabilité ? Nous ne le croyons guère ». (154) H. Capitant, La responsabilité du fait des choses inanimées d'après l'arrêt des chambres réunies du 13 février 1930, DH 1930. 1. 29. Même écho chez cet auteur qui affirme « une lecture attentive du texte nous conduit à penser qu'il ne faut pas attacher tant d'importance à cette nouvelle expression ». Le même concluait toutefois : « Au fond, M. Josserand a raison : la notion de faute n'est plus qu'une fiction. Sans bien s'en rendre compte, la jurisprudence lui substitue celle de risque », idem, p. 32. (155) « Aussi aucune législation, à l'exception du code civil soviétique, n'a-t-elle adopté cette thèse ; et encore, le code civil soviétique lui-même, n'a-t-il pu proscrire cette notion de faute, laquelle reparaît fréquemment, soit dans les textes législatifs, soit dans les décisions de jurisprudence », Chronique Capitant préc., p. 31. « Le code civil des Républiques socialistes soviétiques lui-même ne condamne que les personnes et les entreprises « dont l'activité cause une aggravation de danger pour l'entourage » (art. 404). Il y a du moins dans cette idée d'aggravation du danger une restriction à l'idée abstraite du risque créé », note Ripert préc., p. 60. (156) C'est à la Faculté de droit Lyon qu'ils avaient effectué leur formation juridique initiale et soutenu leur thèse, c'est au concours d'agrégation de 1926, présidé par Josserand, que Henri Mazeaud avait brillamment fait son entrée dans le cercle des professeurs des facultés de droit. (157) H. et L. Mazeaud, Traité théorique et pratique de la responsabilité civile délictuelle et contractuelle (préface Capitant), Sirey, 1931. (158) Il est significatif de regarder quels étaient les collègues de Josserand n'ayant pas souscrit à l'Hommage qui, à l'instigation de l'Association des anciens élèves de la Faculté de droit de Lyon, lui a été consacré en janvier 1936. Georges Ripert et Paul Esmein, en particulier, brillent par leur absence. En revanche, Henri Capitant avait accepté de figurer dans le comité d'honneur, ce dont Josserand devait le remercier très explicitement dans le discours qu'il prononça le 23 janvier 1936. (159) Date fournie par l'annuaire de la magistrature. (160) « (...) Ah comme vous seriez bien à votre place à la Chambre civile ! Et comme je serai heureux de vous y voir venir. Je ne crois pas que Pilon et moi ayons donné trop mal à penser de la gent enseignante et je crois que d'aucuns ne verraient pas d'un mauvais oeil qu'on y fît un nouvel appel. N'y avez vous jamais pensé ? Bien entendu, cette suggestion est tout à fait spontanée. N'y voyez que la marque de ma grande considération pour vos travaux et de ma sympathie, que vous savez très cordiale, pour votre personne », APJ, Lettre Robert Beudant du 15 mars 1930.
41
(161) « Mon cher ami, (...) Vous m'avez dit, pendant les quelques minutes que nous avons passées ensemble le mois dernier, que vous vouliez lâcher le décanat. Ce m'est une raison de plus pour vous redire combien il me paraît que vous devriez venir me rejoindre à la Cour. Et il me paraît que les circonstances pourraient bien être favorables d'ici peu. Voici pourquoi. Aux termes d'un projet de loi récemment déposé par feu Raoul Perret, il serait nommé à la cour trois nouveaux conseillers, sans compter un certain nombre d'assesseurs. Bien entendu, l'assessorat ne saurait vous concerner. Mais peut-être la désignation des trois nouveaux titulaires serait-elle de nature à offrir pour vous une bonne occasion (...) Mais, si vous entriez dans mes vues, il faudrait, de toute nécessité, votre candidature. J'ajoute qu'il n'est pas besoin d'écrire une lettre ; une visite au Premier et au Procureur général ferait aussi bien, même mieux. Je sais que vous trouveriez très aimable accueil après de Matter. Peut-être suis-je indiscret. Ne voyez dans mon insistance que l'effet du grand désir que j'ai de vous voir là pour le bien de la Cour et pour le bon renom de nos Facultés. Bien Cordialement », APJ, Lettre Robert Beudant, 20 nov. 1930. (162) Hommage à Louis Josserand, Doyen honoraire de la Faculté de droit de Lyon, Conseiller à la Cour de cassation, Lyon, Réponse de M. Louis Josserand. (la brochure ne comporte ni date, ni pagination). (163) « Mon cher doyen, j'ai trouvé tout à l'heure à la Cour de cassation le Tome II de votre cours de droit civil. Comme je vous suis reconnaissant d'avoir pensé à me l'envoyer et avec quelle ardeur je me plonge dans sa lecture ! Il n'est pas possible de rencontrer un ouvrage plus solide et plus substantiel. Je vais l'avoir constamment à ma portée et je ne serai pas le seul. S'il est vrai, comme le dit le proverbe, que les oreilles de celui dont on parle doivent tinter, vous devez le ressentir souvent car il ne passe guère de délibérés sérieux sans que votre nom soit prononcé. Il l'a été tout spécialement dans la réunion de nos chambres réunies lorsqu'il est s'agi de fixer définitivement notre jurisprudence sur la responsabilité des automobilistes et l'application de l'article 1384. Notre arrêt à dû vous donner satisfaction et tout le monde s'accorde pour y voir votre triomphe. Je crois qu'on finira par admettre votre théorie du risque, les anciens voudraient laisser au législateur le soin de l'inscrire dans la loi et répugnent à l'admettre par la voie jurisprudentielle. Mais si le législateur tarde encore, les arrêts finiront par proclamer ce qui est devenu la réalité. On annonce d'ailleurs que les constructeurs d'automobiles penseraient à réclamer eux-mêmes une loi nouvelle. Ils admettraient le risque en fixant un forfait. Pour obtenir une somme supérieure à ce forfait, il faudrait prouver la faute. Aujourd'hui encore nous avons beaucoup discuté sur la faute contractuelle et la faute délictuelle dans une rupture de contrat de louage de services. Il a fallu vos notes et vos écrits pour que la vérité apparaisse. Beaucoup ne dégageaient pas les différences essentielles qui existent entre les deux et auraient admis leur cumul dans des rapports contractuels. La jurisprudence, après quelques hésitations, s'affirmera, j'en suis convaincu, dans votre sens. Nous aurions besoin d'avoir deux professeurs dans chaque chambre civile. Il y a tant de nouvelles théories de droit qui se sont dégagées depuis l'époque ou nous suivions les cours de droit (...). Ne vous voit-on plus à Paris ? J'aurai toujours grand plaisir à vous rencontrer.Veuillez agréer, Mon cher Doyen, avec mes plus vifs remerciements l'assurance de mes sentiments de haute considération et tout dévoués », APJ, Lettre Fernand Bricout, 17 mars 1930 - « ... Depuis quatre mois que j'appartiens à la Cour de cassation, j'ai pu constater de quelle considération vous y êtes entouré et de l'influence que vous exercez sur ses décisions », APJ, Lettre Eustache Pilon, ancien doyen de la Faculté de droit de Lille, conseiller à la Cour de cassation, 13 mars 1930 - « ... Combien notre tâche est facilitée par des commentateurs tels que vous et combien pour ma part je serai heureux si vos commentaires portaient sur les lois nouvelles où nous rencontrons de si grosses difficultés d'interprétation. Il ne se passe pas un jour à la Cour de cassation où votre autorité soit invoquée et vous avez dû remarquer combien vos théories sont en faveur. Hier encore tout le monde s'entretenait de la remarquable note que vous venez de publier au Dalloz hebdomadaire sur la situation des concubins. Quel dommage que vous n'ayez pas poursuivi dans une résolution que j'aurais été heureux de voir aboutir ! Pas dans votre intérêt certes, mais dans le nôtre. Je ne m'en console pas », APJ, Lettre Fernand Bricout, 12 avr. 1932.
42
(164) Cass. 25 mai 1936. DP 1936. 1. 88-96, rapp. Josserand, concl. av. gén. Paul Matter. (165) La controverse fit rage à partir de 1936 sur la question de savoir si le propriétaire d'une automobile volée pouvait être tenu, en application de l'article 1384 alinéa 1, pour responsable du dommage causé par la voiture qui lui avait été dérobée. Josserand soutenait cette position (responsabilité du gardien juridique) contre Capitant et Ripert, partisans de la responsabilité du gardien matériel, en l'occurrence le voleur. (166) Cass., ch. ré., 2 déc. 1941, DP 1942. 1. 25-35, note Ripert. (167) In memoriam du Doyen Louis Josserand (1868-1941), discours prononcé à l'audience solennelle de la Cour de cassation du 16 oct. 1942, Lyon, Imprimerie Bosc, s.d., p. 25. (168) Il était membre de comité, lui-même rattaché à l'Institut international de Rome pour l'unification du droit privé créé sous l'égide de la SDN, depuis 1935. Il participa à différentes sessions à Rome, Milan, Abbazia entre 1935 et 1937. (169) J.-P. Chazal, Louis Josserand et le nouvel ordre contractuel, op. cit. (170) APJ, Dossier agrégation 1937. (171) Ces conférences lui permettaient, disait-il, de revivre ces « heures abolies à jamais, couronnement de ma carrière professorale » et il avait déclaré en janvier 1936, à l'occasion de la cérémonie organisée en son honneur : « Ce qui m'a le plus désorienté, dans mon changement de profession et d'existence, ce n'est pas spécifiquement le passage de l'Ecole au Palais, du cours à l'audience, de l'habitude de parler à l'obligation d'écouter, de l'interprétation des arrêts à leur cassation ; non, c'est d'avoir soudain perdu le contact avec la jeunesse universitaire ». (172) D. Fenouillet relève judicieusement que si la faculté lyonnaise et la Cour de cassation lui ont bien rendu hommage, aucun article nécrologique n'est paru ni au Dalloz, ni à la Revue trimestrielle de droit civil. (173) Les positions de Josserand en matière familiale sont, en effet, des plus traditionnelles : concubinage et famille naturelle n'avaient guère la faveur de celui qui, dans son Cours comme dans ses chroniques des années 1930, a regretté ouvertement le déclin du mariage et l'érosion que subissaient la puissance paternelle et la puissance maritale. (174) Devenu veuf en 1917, Louis Josserand ne s'est jamais remarié. (175) Il n'y a en tout et pour tout que deux de ses correspondants qui ont eu le privilège de le tutoyer. Tous deux sont des camarades d'université : son collègue Jean Appleton, avec lequel il partageait de surcroît une fraternité de concours d'agrégation, et Paul Chenevière, un ancien condisciple lyonnais devenu magistrat. (176) Souligné dans la version originale du document, dont une copie est conservée dans les
43
archives de la Faculté de droit (Dossier Dons et legs/Legs Josserand). Le doyen honoraire avait fait don à sa Faculté d'une partie de sa bibliothèque (livres de droit comparé et de droit étranger) et d'une somme de 20 000 F dont il laissait l'emploi à la sagesse de ses collègues. Elle fut affectée à la création d'un prix Louis Josserand pour la meilleure thèse de droit privé. (177) L. Josserand, Derecho civil, completado y revisado por André Brun, traduccion de Santiago Cunchillos y Manterola, Ediciones juridica Europa-América, Bosch y Cia, Buenos Aires, 1950. (178) Revista da Faculdade de direito da Universidade de Lisboa, an II, 1934, p. 440. Un grand remerciement renouvelé à Antonio Manuel Hespanha et à Luis Cabral de Oliveira pour nous avoir procuré les documents relatifs aux distinctions décernées à Josserand par les deux grandes universités portugaises. Copyright 2014 - Dalloz – Tous droits réservés