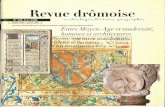«L’icône de Saint Jean le Précurseur du chevalier Jacques de Bourbon à la cathédrale...
Transcript of «L’icône de Saint Jean le Précurseur du chevalier Jacques de Bourbon à la cathédrale...
L'icône de saint Jean le Précurseur du chevalier Jacques de Bourbon à la cathédrale d'Apt* Par Konstantia KEFALA
À la mémoire de Marc de Montalembert
La ca thédra le Sa in te -Anne d'Apt (Vaucluse), à une c inquanta ine de ki lomètres à l'est d 'Avignon, abrite une grande icône peinte sur bois représentant saint Jean Baptiste avec, à ses pieds, un chevalier agenouil lé en donateur (fig. 1). L 'œuvre, connue des habitants de la région c o m m e « l ' i cône de R h o d e s » , offre au premier regard un singulier mélange des tradit ions picturales byzant ines et occidentales de la fin du Moyen Age qui en fait toute la saveur. Elle se dis t ingue, en outre, par un décor héraldique très présent. Pour tant , en dépit de son intérêt his tor ique et ar t i s t ique majeur, elle est encore la rgement méconnue 1 .
L'icône, ord ina i rement pou rvue d 'un large cadre en bois doré de style classique, montre saint Jean Baptiste, debout et de face, pra t iquement g randeur na ture 2 , encadré par trois g rands écus a rmor iés . Le saint se dé tache sur un fond d'or meublé d 'un paysage montagneux , et sur le fond d'or se lisent encore des inscript ions grecques t radit ionnelles qui l ' ident i f ient . Le pied droit légèrement en avant, il lève la ma in droite dont l ' index désigne l 'Agneau, couché sur le livre relié qu'il porte de la gauche (fig. 2). Le Précurseur semble en m ê m e temps tenir un phylactère sur lequel se lit l ' inscr ipt ion: AGNV/S DEI / QVI T O / L L I S P E / C C A T A / M U N D / I M I S E / R E R E / N O B I / S » (Jean, 1,29). Si la p ré sence conjointe d ' inscr ip t ions grecques et latines conf i rme que l 'œuvre est issue d 'un milieu où Grecs et Lat ins se côtoient, elle n'a en elle-m ê m e rien d ' inhabi tuel 4 . Le saint est revêtu d 'une mélote gris-bleu qui épouse le corps et soul igne les formes sous-jacen tes , en par t icul ier au niveau des cuisses et des genoux. La mélote est serrée à la taille à l'aide d 'une ceinture blanche nouée. Un manteau vert olive, également noué sur la poi tr ine, couvre ses épaules et son bras gauche. Le paysage déser t ique qui entoure saint Jean se d is t ingue par des rochers gr is e sca rpés qui forment c o m m e deux hautes falaises derr ière lui, peuplées de maigres buissons et où apparaissent l 'arbre et la cognée qui font référence au récit des Évangiles (Luc 3, 9).
L ' icône a é té res taurée entre 1999 et 2 0 0 2 pa r Jacques de Grasset . Une photographie antér ieure à cette restaurat ion a été publiée en 2003 (fig. 3) 5 . Elle montre les d o m m a g e s alors subis par l 'œuvre, en part icul ier une grande fente verticale qui suivait les lignes d 'assemblage du support de bois et qui avait ent ra îné une per te de matière sur presque toute la hauteur, sans compter plusieurs fissures collatérales. La peinture présentait égale
ment de nombreuses altérations et des soulèvements de la couche picturale, no tamment au niveau du visage du saint. La restaurat ion récente pose à son tour le problème des interventions antér ieures , at testées par de nombreux repeints ponctuels «par t ie l l ement déna tu rés» et constituant des « zones de soulèvements » dûment relevés par le dernier res taurateur 6 .
L ' i conographie de saint Jean Bapt is te se réfère manifes tement à des modèles byzant ins . Elle met en évidence une var iante d 'un type familier qui présente le saint debout et de face, tenant un phylactère et accosté de l 'arbre et de la cognée . Une icône du monas tè re de S a i n t e - C a t h e r i n e du Sinaï , au t ou rnan t des x n e et X I I I e siècles, où se remarque en outre un donateur proste rné , en offre un bel exemple (fig. 4) 7 . Le type se retrouve, quoique sans arbre ni cognée , sur une icône bilatérale de grande d imension de la ca thédra le ca tholique de Naxos at t r ibuée à la fin du x m e siècle où apparaissent t imidement , en outre, des rochers (fig. 5) . Sur cet te dernière icône, Jean por te également une ceinture blanche qui rappelle celle d 'Apt et celles qu'on trouve no tamment , aux X I V e et x v c siècles, dans la peinture véni t ienne 9 . De même , le manteau noué sur la poi t r ine apparaî t déjà sur une icône de saint Jean Baptiste du x i v c siècle au musée Correr de Venise'". A la fin du X V e siècle, une icône de la chapel le Saint-Nicolas du monastère de Saint-Jean-le-Théologien à Pa tmos (fig. 6) montre à son tour des rochers qui , c o m m e sur notre icône, forment deux hautes falaises". Malgré quelques divergences iconographiques , en part icul ier la présence du Chris t bénissant et la tête coupée du saint dans un bassin, l ' icône de Pa tmos , malheureusement difficile à at tr ibuer à un centre précis , par tage néanmoins avec l ' icône d'Apt plusieurs traits stylistiques propres à la fin du X V e siècle, en part icul ier l ' inscription du personnage dans l 'espace et les vêtements qui moulent les corps . Enfin, l 'usage d 'un m ê m e pli en cloche pour soulever avec é légance l 'extrémité du manteau contr ibue encore à rapprocher les deux œuvres et à situer leur exécution à une époque voisine.
En revanche, l ' image de l 'agneau couché sur le livre et tenant un é tendard rouge t imbré de la c ro ix 1 2 n 'appartient pas à la tradition byzantine et relève de l ' iconographie occidentale latine. A la différence de l'art byzantin qui bannit l 'Agneau chris t ique dès les derniers siècles de l 'Antiquité, la tradition occidentale l'a toujours conservé.
L'ICÔNE DE SAINT JEAN LE PRÉCURSEUR DU CHEVALIER JACQUES DE BOURBON 143
Fig. 1. Apt (Vaucluse), cathédrale Sainte-Anne, icône de saint Jean Baptiste (cl. Kefala).
À l 'époque gothique, dès le XIII e siècle, l 'Agneau est devenu un attribut du saint, c o m m e par exemple celui inscrit dans un disque que porte le Précurseur au portai l du t ransept nord de Char t res , et se place volontiers sur le livre des Évangi les que tient le saint au X V e siècle. Autour des a n n é e s 1450, E n g u e r r a n d Qua r ton en donne un exemple célèbre avec la Vierge de Miséricorde du musée Condé de Chanti l ly et, peu avant 1500, le maî t re du retable de la char t reuse de Thuison- les-Abbevi l le avec le saint Jean Bapt is te au jourd 'hu i à l 'Art Inst i tute de Chicago (fig. 7 ) 1 3 .
De m ê m e , les écus a rmor iés qui can tonnent les angles de la par t ie supér ieure et l 'angle inférieur gauche de l ' icône appar t iennent à la tradition occidentale , m ê m e
si l 'usage d 'a rmoir ies s'est parfois introduit dans l'art byzant in à l 'époque pa léologue 1 4 . Deux écus dominent de part et d 'autre de la tête du saint. En haut à droite (fig. 8), on identifie celui de Phi l ippe de Vill iers de l ' Is le-Adam (1464-1534) 1 5 , g rand maî t re de l 'ordre des Hospital iers de Saint-Jean-de-Jérusalem de 1521 à 1530: «Ecartelé aux 1 et 4 de gueules à la croix d'argent, qui est la Religion, aux 2 et 3 d'or au chef d'azur, chargé d'un dextrochère d'argent vêtu d'hermine avec un fanon du même, brochant sur l'or». L'identification ne fait guère de doute et les mêmes a rmoir ies apparaissent d 'ai l leurs précisément sur la façade sud du bât iment connu c o m m e « l 'Auberge de la langue de F r a n c e » dans la ville médiévale de Rhodes (fig. 9 ) 1 6 , de la m ê m e manière que sur le frontis-
144
L'ICÔNE DE SAINT JEAN LE PRÉCURSEUR DU CHEVALIER JACQUES DE BOURBON 145
Fig. 2. Apt, icône de saint Jean Baptiste, détail de l'Agneau.
Fig. 3. Apt, icône de saint Jean Baptiste, état avant la restauration de 1999-2002 (cl. Documentation de la Médiathèque du Patrimoine).
Fig. 4. Sinai, monastère de Sainte-Catherine, icône de saint Jean Baptiste (d'après Manafis).
pice des statuts de l 'ordre publié à Sa lamanque en 1534 (fig. 10)' 7. Elles figurent encore sur plusieurs livres de c h œ u r p rovenan t de R h o d e s et un évangé l i a i r e , aujourd 'hui à Mal te , qui viennent étoffer le peu que l'on sait sur les réalisat ions art ist iques de l 'ordre à l 'époque du manda t de Phi l ippe de Villiers de l ' I s le -Adam 1 8 . En revanche, l'écu qui lui fait face sur l ' icône d'Apt, «d'azur à trois fleurs-de-lis d'or, à la cotice de gueules posée en bande, aiguisée à senestre» (fig. 11), pose problème. En effet, si les trois fleurs de lis font référence à un pr ince appar tenant à la famil le royale de F rance 1 9 , ce qui à l 'époque n'a r ien de surprenan t dans le contexte de l 'o rdre 2 0 , la br isure avec une cotice a iguisée ne semble pas a t tes tée dans l 'héra ld ique des pr inces capét iens . L'écu est, en outre, surmonté d 'une couronne dont le dessin ne paraî t lui aussi guère compat ib le avec les données normales de l 'héraldique. Une explication possible
serait d ' imaginer que les a rmes , passablement détér iorées c o m m e sans doute la couronne , aient été « b r i s é e s » à l 'occasion d 'une restaurat ion ancienne et d 'une mépr ise sur un élément quelconque, ou que la br isure, pr imit ivement complète , ait été alors mal comprise .
Quan t au troisième écu (fig. 12), en bas à gauche de l ' icône, il est placé en vis-à-vis du donateur. La représentation de ce dernier, agenouil lé aux pieds de saint Jean et les ma ins jo intes en prière, obéit à une typologie largement par tagée aux X I V e et X V e siècles en Occident c o m m e en Or ien t 2 1 . La prière que le donateur adresse au saint est t ranscr i te sur un phy lac t è re : I N T E S P E / R A N T E S / D I R I G E / A D I U V A / E T P R O / T E G E / P R E C U R / S O R XPI [s t i ] /SANCT/ISSIME. Le donateur est un chevalier et por te la tenue habituelle des membres de l 'ordre, le surcot rouge t imbré de la croix blanche qui se devine sur son dos , et l 'épée à la tail le, rangée dans son fourreau.
146
Son casque est posé par terre en signe de respect. Sa tenue est conforme à celles des chevaliers de l 'ordre, telles qu'el les apparaissent à plusieurs reprises dans les peintures du manuscr i t des Gestorum Rhodie obsidionis commentarii réal isé entre 1482 et 1489 et offert par le vice-chancel ier français de l 'ordre, Gu i l l aume Caours in , au grand maî t re Pierre d 'Aubusson, conservé aujourd 'hui à la Bibl iothèque nat ionale de France (ms. latin 6 0 6 7 ) 2 2 . À p ropos de l ' a rmure sur l ' icône d'Apt, on remarque également que les détai ls en ont été peints avec une g rande précision, c o m m e le montrent , par exemple, les rivets de la jugula i re du casque soigneusement comptés (fig. 13) et l 'at tention mét iculeuse appor tée aux épe rons ou aux genouil lères. Le visage juvéni le du chevalier est lui aussi minut ieusement rendu et plein de vie, marqué par un évident sent iment d ' inquiétude d 'une grande finesse psychologique (fig. 14). Il y a là l 'expression d 'un cer ta in réa l isme qui paraî t cor respondre à une volonté de portrait, et qui semble s 'exprimer ju sque dans la couleur bleue des yeux du donateur et sa coiffure peinte avec une très g rande attention.
L'écu qui paraî t s 'abriter sous le manteau du saint et fait face au donateur (fig. 12) est très ce r ta inement le sien. «D'azur semé de fleurs de lis d'or au filet de gueules posé en bande, aux flancs d'or, et sur le tout un chef de l'ordre de Saint Jean de Jérusalem, de gueules à la croix d'argent», il est celui d 'un chevalier de l 'ordre issu de la famil le des Bourbon , branche cadet te de la famil le royale de F rance . Il s 'agit ici des a r m e s de Jacques , bâtard de Bourbon , membre de l 'ordre dès 1503 et pr ieur de la langue de F rance 2 3 . P roche de Phi l ippe de Vill iers de l ' I s le-Adam, il était présent à ses côtés lors du siège de Rhodes par les O t tomans en 1522, événement décisif pour le destin de la ville et celui de l 'ordre, puisque l 'ordre dût quit ter l ' île le 1 e r janvier 1523. Jacques de Bourbon en a d 'ai l leurs laissé une célèbre relation, édi tée à Paris dès 1526 2 4 . Son père, Louis de Bourbon , bien que p romu pr ince-évêque de Liège en 1456 grâce à l 'appui de son oncle Phi l ippe le Bon, duc de B o u r g o g n e 2 5 , eut néanmoins de son union avec Cather ine d 'Egmont trois fils, tous trois qualifiés de « b â t a r d » 2 6 , t e rme utilisé par Jacques lui -même dans son œuvre l i t téraire 2 7 . C'est aussi ce qui explique la brisure qui bar re t ransversalement ici l'écu des Bourbons . En dessous de l'écu, cour t une banderole sur laquelle sont inscri ts , en grec , les mots d 'une dev i se : Π Α Λ Ε ΘΑΡΟ, probablement mal o r thographiée pour π ά λ ι θ α ρ ρ ώ , c 'est-à-dire en français : « J e reprends c o u r a g e » ou «J ' e spè re de n o u v e a u » (fig. 15) 2 S . La m ê m e devise, t ransl i t térée cette fois en lat in: PALI T H A R O se trouve également sur une plaque de marbre sculpté en remploi sur la façade orientale de l 'ancien Hôpital de l 'ordre à Rhodes où elle accompagne l ' image d 'un sablier (fig. 16-17). L e motif du sablier, symbole de l 'écoulement du temps et de l ' instabilité des choses , s'accorde parfai tement avec le sens général de la devise. Le relief, dont l 'origine pr imit ive est inconnue, est représenté sur une gravure de Pierre-Joseph Wi tdoeck publiée en 1830 par Bernard-Eugène-Anto ine Rott iers dans sa Description des monuments de Rhodes19. Il se trouvait
Fig. 5. Naxos, cathédrale catholique, icône de saint Jean Baptiste (d'après Vassilaki).
L'ICÔNE DE SAINT JEAN LE PRÉCURSEUR DU CHEVALIER JACQUES DE BOURBON 147
alors sur un édifice improprement appelé par ce dernier « l ' A m i r a u t é » (fig. 18). L e relief provenait sans doute d 'un palais de Rhodes que la présence de la m ê m e devise sur l ' icône d'Apt, choix personnel du porteur, lie sans doute à Jacques de Bourbon lui -même. Prat ique courante en Occident , l 'usage d 'une devise associée à un blason est par ai l leurs attesté à R h o d e s : un écu de marbre exposé au musée de Rhodes , daté de 1513 et provenant d 'une maison médiévale , par exemple , est ainsi accom
pagné d 'une citation tirée des p s a u m e s : Ό θ(εό)ς εις την βοήθε ιαν μ/ου πρόσχες, Κ(ύρι)ε εις τό βοηθήσ/αι μοι σ π ε ΰ σ σ ο ν (70/69, 2) (fig. 19) 3 0 .
L ' identif icat ion du dona teu r et la p r é sence des a rmes de Vill iers de l ' Is le-Adam permet tent une datat ion relativement précise de l ' icône. Cet te dernière , en effet, i ndépendamment de la date du t répas de Jacques de Bourbon placée en 1527 ou 1537 3 1 , ne peut guère être antér ieure à la promot ion de Phi l ippe de Vill iers de
148
Fig. 6. Patmos, monastère de Saint-Jean-le-Théologien, icône de saint Jean Baptiste (d'après Chatzidakis, 1985).
Fig. 7. Chicago, Art Institute, saint Jean Baptiste du retable de la chartreuse de Thuison-les-Abbeville (d'après Thiébaut,
Lorenz et Martin).
l ' Is le-Adam c o m m e grand maît re , le 17 septembre 1521, et en aucun cas postér ieure à 1534, date de sa mort . L'icône est probablement m ê m e antér ieure au I e ' j anvier 1523, date à laquelle les chevaliers furent contraints par So l iman le Magn i f i que d ' abandonne r déf in i t ivement R h o d e s 3 2 . Grâce à leur vai l lance au combat , cependant , qui suscita le respect de Sol iman, les chevaliers eurent le privilège de pouvoir empor te r avec eux leur trésor et leurs b iens les plus p réc ieux , p a r m i lesquels des
Fig. 8. Apt, icône de saint Jean Baptiste, détail des armes de Philippe de Villiers de l'Isle-
Adam.
Fig. 9. Rhodes, «Auberge de la langue de France », armes de Philippe de Villiers de l'Isle-Adam (d'après Ko/lias).
reliques et plusieurs icônes , avant d 'entreprendre le pénible périple qui les conduisit en Crête puis à Messine , Viterbe et Nice, avant de se fixer en 1530 à Malte . Le repli des chevaliers à Nice en 1527-1529 explique aisément l 'arrivée à Apt de l ' icône, par un détour inconnu auquel la présence séculaire de l ' insigne relique du voile de la Vierge n'est peut-être pas tout à fait é t r angère 3 6 . A Nice, no tamment , les chevaliers auraient offert un t r iptyque représentant la Vierge avec saint Jean Baptiste et
L'ICÔNE DE SAINT JEAN LE PRÉCURSEUR DU CHEVALIER JACQUES DE BOURBON 149
Fig. 10. Armes de Philippe de Villiers de l'Isle-Adam sur le frontispice des Statuts de l'ordre
(d'après De Rhodes à Malte, 2004).
Fig. 12. Apt, icône de saint Jean Baptiste, détail des armes de Jacques, bâtard de Bourbon.
Fig. II. Apt, icône de saint Jean Baptiste, détail des armes royales
françaises brisées.
Fig. 13. Apt, icône de saint Jean Baptiste, détail du casque du donateur.
saint Sébast ien, c o m m e ils ont laissé à l 'église des saints Faust ino e Giovita de Viterbe, accordées aux chevaliers par le pape Clément VII en 1523, une quaranta ine de reliques et la fameuse icône de la Madonna di Costanti-nopoli qui s'y trouve toujours" . On peut donc supposer un geste semblable pour l ' icône de Jacques de Bourbon, soit d i rec tement à l 'endroit de la ca thédra le d'Apt, soit à l 'endroit d 'un établ issement de Nice ou de la région avant le transfert de l ' icône à Apt. La Provence, d 'ai l leurs, était étroitement liée à l 'ordre du fait m ê m e que beaucoup de ses membres étaient or iginaires de la région. De plus, les chevaliers occupaient depuis longtemps dans cette région plusieurs commander i e s et ces liens s'étaient encore renforcés à l 'époque du grand maître Juan Fernandez de Heredia (1376-1383) qui avait no tamment dir igé pour le compte des papes la construct ion des rempar t s d'Avi-
18
gnon . L'icône, qui peut donc vraisemblablement être da tée
de la fin de l 'année 1521 ou de 1522, const i tue sans doute aussi un remarquable témoin sur les échanges art ist iques à Rhodes à la fin du x v c et au début du X V I e siècle, où
150
Fig. 14. Apt, icône de saint Jean Baptiste, détail du visage du donateur.
Fig. 15. Apt, icône de saint Jean Baptiste, détail de l'inscription grecque.
Fig. 16. Rhodes, l'ancien Hôpital de l'ordre des chevaliers de Rhodes, plaque en marbre sculpté en remploi
sur la façade orientale (cl. J.-B. de Vaivre).
Fig. 17. Rhodes, l'ancien Hôpital de l'ordre des chevaliers, plaque de marbre en remploi, détail de l'inscription
(cliché C. Kefala).
Grecs et Lat ins se côtoient depuis longtemps, c o m m e en Crè te et à C h y p r e 3 9 . L 'usage conjoint d ' inscr ip t ions latines, l 'emploi d 'une technique picturale byzant ine et le mélange de traits iconographiques et stylistiques tant grecs que latins indiquent, outre la quali té intr insèque de l 'œuvre, que l ' icône est issue d 'un centre art ist ique de premier plan, à l ' instar de Chypre ou de la C r è t e 4 0 . Ma lg ré l 'absence d 'archives qui , c o m m e pour la Crète, viendraient conf i rmer la présence d'ateliers d ' icônes à Rhodes au temps des chevaliers , on s 'accorde néanmoins sur le fait que les art istes qui ont travaillé aux décors de fresques à Rhodes ont sans doute pu également produire des œuvres peintes sur bo i s 4 1 . L' icône d'Apt s'inscrit parfaitement, semble-t-il , dans le courant éclect ique de la peinture rhodienne de la fin du Moyen Age, au moment précis du renouveau général qui suivit les difficultés du siège de 1480 par les Turcs et les désastres du t remblement de terre de 1481 4 2 . Les caractér is t iques de la peintu re rhod ienne de cet te pé r iode , quo ique la rgement par tagées alors dans l 'ensemble des terres grecques sous dominat ion latine, en ont été définies par Elias Kol-l i a s 4 3 et la fresque de la Crucif ixion de la c rypte de l 'église Saint-Spir idon à Rhodes en offre un des mei l leurs exemples (fig. 2 0 ) 4 4 . Toutefois, les icônes du x v c et du début du x v i e siècle at tr ibuables à des ateliers rho-diens sont encore bien rares, de quali té souvent inégale,
L'ICÔNE DE SAINT JEAN LE PRÉCURSEUR DU CHEVALIER JACQUES DE BOURBON 151
152
Fig. 18. Β.-Ε.-Α. Rottiers, Description des monuments de Rhodes, 1830, «l Amirauté ».
Fig. 19. Rhodes, musée archéologique, écu de marbre daté de 1513 provenant d'une maison médiévale
(d'après Kollias).
Fig. 20. Rhodes, crypte de l'église Saint-Spiridon : la Crucifixion (d'après Kollias).
Fig. 21. Rhodes, Palais des grands maîtres, icône de saint Georges (4e Ephorie des Antiquités byzantines.
Archives photographiques).
et se caractér isent par un équi l ibre plus ou moins réussi des é léments byzant ins et occ iden taux 4 5 : l ' icône de saint Geo rges te r rassan t le d ragon du Pala is des g rands maî t res à Rhodes (fig. 2 1 ) 4 6 et celle de la Vierge Phi los-torgos des collect ions de l 'évêché de Cos en sont de bons exemples (fig. 22 ) 4 7 .
A ce petit ensemble , on peut aussi rat tacher l ' icône du Chris t He lkoménos de l 'église de la Panagia tou Kas-trou à Léros , bien qu'elle ait été at t r ibuée jusqu ' à présent à l 'école Cretoise (fig. 2 3 ) 4 8 . Le Chris t , représenté en buste sur le chemin du Calvaire , por tant la croix et vêtu d 'une tunique rouge, porte sur la tête la couronne d 'épines et son visage est marqué par un sent iment de douleur intense. L'œuvre se dis t ingue par l 'acuité du dessin, le t rai tement doux des volumes et le soin appor té à peindre tous les détails de la scène de façon natural is te , c o m m e par exemple les effets de matière sur le bois de la croix. La finesse des traits, la tr istesse et la douceur du visage du Chris t , ainsi que le lyrisme de la composi t ion qui isole le pe rsonnage rappellent ceux d 'une icône de saint Jean
Baptiste de Rhodes de la fin du x v e s i è c l e 4 . Enfin, une or igine rhodienne vraisemblable a également été avancée pour l ' icône de la Vierge Iamat iki de l 'église Sainte-Mar ina à Ephtagonia près de Limassol (fig. 24), da tée des années 1510-1520: il s'agit, en effet, d 'un don du chevalier de l 'ordre, Jacques Gât ineau, c o m m a n d e u r de la langue d 'Auvergne, dont le blason est précisément inséré dans la par t ie droite de la compos i t ion 5 0 .
Il est m a l h e u r e u s e m e n t imposs ib le de savoir à quelle église l 'œuvre était dest inée à l 'origine ni même quelle pouvait être sa fonction primit ive. Les grandes d imens ions et le format étiré en hauteur, bien que rares, n'étaient pas inconnus à Byzance, en part icul ier pour les grandes icônes placées de part et d 'autre du templon. On peut citer les icônes de la Vierge Episcopiani du χ ι I e siècle du musée de Z a n t e 5 1 , de la Vierge Hodighi t r ia du début du X I I I e siècle du musée de Kas to r i a 5 2 , de la Vierge à l 'Enfant du début du X I V e siècle du monas tère de Vato-pédi ou encore les icônes de la Vierge Glykophi lousa et de l 'Archange Michel du milieu du X I V e siècle au monas tère de D e c a n i 5 4 . En m ê m e temps , les hautes icônes votives chypriotes des X I V e et X V e siècles, installées sous enfeus et sur lesquelles sont représentés des saints et des donateurs aussi bien grecs que latins, vivants ou morts , invitent à s ' interroger sur un usage paral lèle à Rhodes^ 5 .
Fig. 22. Cos, collections de l'évêché, icône de la Vierge Phi/ostorgos (4e Éphorie des Antiquités byzantines,
Archives photographiques).
L'ICÔNE DE SAINT JEAN LE PRÉCURSEUR DU CHEVALIER JACQUES DE BOURBON 153
Fig. 23. héros, église de la Panagia tou Kastrou, icône du Christ Helkoménos (d'après H Παναγία του
Κάστρου).
En tous cas , l ' icône de saint Jean Baptiste, exécutée pour un personnage cultivé et influent, si elle n 'ornait pas la chapel le pr ivée de son palais , devait probablement se t rouver dans une église impor tan te de la ville, voire m ê m e dans l 'église conventuel le de l 'ordre, l 'église de Saint-Jean à Collachio.
L'icône de saint Jean Baptiste à Apt s'ajoute donc déso rma i s au petit g roupe des œuvres at t r ibuables à Rhodes . Elle répondai t à la c o m m a n d e d 'un haut d ignitaire de l 'ordre, faite à un art iste cer tes doué mais pas
par t icul ièrement inspiré et qui connaissai t aussi bien les leçons de la tradition byzant ine que celles de l'art occidental . Son éclect isme, si visible ici, convenait assurément au commandi t a i r e , c o m m e probablement d 'ail leurs aux éli tes g recque et latine de R h o d e s du début du X V I e siècle. Créée dans les dernières heures de la présence des cheval iers sur l ' î le, l ' icône d 'Apt i l lustre aujourd 'hui en France , de manière aussi insolite qu'éclatante, un aspect singulier de l 'histoire et du pat r imoine art ist ique des anciens chevaliers de Rhodes .
Notes
* L'étude de l'icône, présentée brièvement au XXVI e Symposium d'Art byzantin et post-byzantin d'Athènes en 2006, a pu être réalisée grâce à une bourse de la Fondation Marc de Mon-talembert, obtenue en avril 2003. Je tiens à exprimer ici ma plus profonde gratitude à Manuela et Marc-René de Montalem-bert pour leur soutien indéfectible, ainsi qu'à Mme Anna Maria Kasdagli pour son aide. Je voudrais également évoquer la mémoire d'Elias Kollias, aujourd'hui disparu, qui m'a fait partager sa passion de l'étude de la peinture rhodienne et qui m'a toujours entourée de ses conseils et de ses encouragements. Enfin, je voudrais dire ma dette à l'égard de M. Jean-Bernard
de Vaivre qui a bien voulu me faire partager ses observations et suggestions, ainsi qu'à l'endroit de M. Jacques de Grasset, restaurateur, de Mme Fabienne Dufey, à la Médiathèque de l'Architecture et du Patrimoine, et, au département des Objets d'art du musée du Louvre, à Mme Isabelle Balandre, pour leur aide. Nous voudrions aussi dire notre gratitude à Mme Ioanna Rapti et M. Jannic Durand pour leur relecture attentive et les précisions relatives à la bibliographie ancienne de l'œuvre, ainsi qu'à Mme Elisabeth Vidal-Naquet, au musée Granet d'Aix-en-Provence.
154
Fig. 24. Ephtagonia (Chypre), église Sainte-Marina, icône de la Vierge lamatiki. (d'après Cyprus,
Jewel in the Crown of Venise,).
1. L'icône, classée Monument historique par arrêté du 28 février 1907, est signalée par J. Courtet, Dictionnaire géographique, historique, archéologique et biographique des communes du département de Vaucluse, Avignon, 1857, p. 12, et L. H. Labande qui lui a consacré une notice dans Les primitifs français, peintres et peintres verriers de la Provence occidentale, Marseille, 1932, p. 215, en s'interrogeant sur une éventuelle facture provençale. Elle est aussi décrite par A. Roux, La cathédrale d'Apt, Apt, 1949, p. 59-60, et note 12, p. 98. L'œuvre a également figuré à l'exposition Les icônes dans les collections de Provence, organisée au musée Granet par Louis Malbos en 1971 (catalogue dactylographié, n° 52) et attribuée à l'école dite « italo-crétoise », au début du χvi c siècle. Elle est mentionnée par V. Doukhovskoy et R. Cabal, Icônes grecques et russes. Galerie Nikolenko, Paris, 1975, à propos du n° 3, note 31 ; Cl. Pion, Basilique Sainte-Anne dApt, s.d., p. 18; Ch. Freigang, La Provence. Art, architecture et paysages, Könemann, 1999, p. 168-169 ; R. Bruni, Apt. Plurielle et Singulière, Barbentane, 2000, p. 26. L'icône a également été reproduite dans La Bible et les saints, Guide iconographique, Paris, 1990, p. 179 et dans le catalogue de l'exposition De Rhodes à Malte, le Grand maître Philippe de Villiers de l'Isle-Adam (1460-1534) et l'ordre de Malte, L'île-Adam, musée d'Art et d'Histoire Louis-Senlecq, 2004, p. 41. Elle a, en outre, à l'occasion de sa dernière restauration en 1999-2001, fait l'objet d'une notice de Ch. de Saulnier, «Le retour de l'icône de saint Jean Baptiste dans la cathédrale d'Apt», Société de l'histoire et du patrimoine de l'ordre de Malte, n° 13, 2003, p. 40-41, et d'un «Compte rendu de la restauration de l'icône et du cadre» par J. de Grasset, ibidem, p. 42-43. L'icône a depuis été citée et reproduite par K. Kefala, «H εικόνα του αγίου Ιωάννη του Προδρόμου στην ομώνυμη εκκλησία της Ρόδου », 15 χρόνια έργων αποκατάστασης στη Μεσαιωνική Πόλη της Ρόδου, Athènes, 2007, ρ. 448-449 et fig. 389.
2. Les dimensions du panneau de bois, fait de deux planches, sont les suivantes: 204 x 105 cm (restreintes à 198,5 x 101 sous feuillure du cadre). Cf. J. de Grasset, op. cit., p. 42.
3. Ο ΑΓ[ιος] 1ω[άννης] ΠΡΟΔ[ρομο]ς: «saint Jean (le) Précurseur». J. de Grasset, op. cit., p. 42, propose de lire Πρόδρομος Θεου mais la vrille qui apparaît en-dessous paraît bien correspondre seulement à un trait de plume qui prolonge souvent dans les abréviations le sigma final.
4. Comme sur plusieurs icônes Cretoises des X V e et X V I e siècles. Par exemple: Chr. Baltoyanni, «Παραλλαγή της Παναγίας του Πάθους σε εικόνα της Θεσσαλονίκης από τον κύκλο του Ανδρέα Ρίτζου », Θυμίαμα στη μνήμη της Λασκαρίνας Μπούμα, Athènes, 1994, vol. I, p. 2 3 ; M. Vassilaki, «Παρατηρήσεις για τη ζωγραφική στην Κρήτη τον πρώιμο 15ο αιώνα», Ευφρόσυνον. Αφιέρωμα στον Μανόλη Χατζηδάκη, ν. 1, Athènes, 1991, ρ. 65-77, fig. Β', Γ'.
5. J. de Grasset, op. cit., p. 43. Le travail a été achevé en 2002. M. Grasset nous a aimablement confié le double du rapport de restauration.
6. Ibidem, p. 42. Ch. de Saulnier, op. cit., p. 40, mentionne une restauration «maladroite» qui aurait eu lieu en 1950. Un bordereau de restauration du peintre Jean Chauffrey, daté du 20 décembre 1950, est effectivement conservé à la Médiathèque de l'Architecture et du Patrimoine. Nous remercions Mmes Isabelle Balandre et Fabienne Dufey de nous avoir communiqué cette pièce.
7. The Treasures of Sinai, éd. Κ. A. Manafis, 1990, p. 116.
8. Voir le catalogue de l'exposition Μήτηρ Θεού. Απεικονίσεις της Παναγίας στη βυζαντινή τέχνη/Mother of God. Representations of the Virgin in Byzantine Art, éd. M. Vassilaki, Athènes et Milan, 2000, n° 67.
9. Par exemple, L. Testi, Storia della pittura veneziana, I, Ber-game 1909, p. 364.
10. M. Alpatov, «Sur la peinture vénitienne du trecento et la tradition byzantine», dans Venezia e il Levante fi.no al secolo XV éd. A. Pertusi, II, Florence, 1974, p. 5 et fig'. 8 ; R. Palluc-
chini, La pittura veneziana del trecento, Venise et Rome. 1964, fig. 157.
11. Ν. Chatzidakis, Icons of the Cretan School (15th-16th c). Exhibition Catalogue, Benaki Museum, Athènes, 1983, p. 32, n° 22, fig. 22 (p. 35) ; M. Chatzidakis, Icons of Patmos. Questions of Byzantine and Post-bvzantine Painting, Athènes, 1985, p. 84, n° 35, fig. 35 et 96.
12. D'après Ch. de Saulnier, op. cit., p. 40, qui reprend notamment Roux (op. cit., p. 59) et Labande (op. cit., p. 215), saint Jean portait l'agneau accompagné, avant la restauration survenue en 1950, par «une banderole aux armes de l'ordre de Saint-Jean-de-Jérusalem, où l'on pouvait lire: Ecce Rhodi capte Creteque superstes imago». Cette inscription, nécessairement postérieure à la perte de Rhodes et donc à la date de l'œuvre elle-même (voir infra), était une addition suffisamment manifeste pour avoir été jugée digne d'être alors enlevée.
13. Cf. D. Thiébaut, Ph. Lorentz et F.-R. Martin, Primitifs français. Découvertes et redécouvertes, Paris, 2004, p. 112-113 et fig. 63 (Vierge de Miséricorde de Chantilly), et p. 20-21 et fig. 7 (saint Jean de Chicago).
14. Voir J. Durand, «Innovations gothiques dans l'orfèvrerie byzantine sous les Paléologues», Dumbarton Oaks Papers, 58, 2004, p. 345.
15. Sur la production artistique pendant la courte durée du pouvoir de Philippe Villiers de l'Isle-Adam à Rhodes, les attestations sont rares. On sait toutefois qu'il a offert à l'église rhodienne sept livres chorals, qui sont encore conservés à Malte : K. Setton, A History of the Crusades, IV : The Art and Architecture of the Crusader States, London 1977, p. 249-250; M. Buhagiar, The Iconography of the Maltese Islands (1400-1900), Painting, Valetta 1987, p. 34-37. Sur les portraits de Philippe Villiers de l'Isle-Adam, v. Julia Toffolo, Image of a Knight, Portrait Prints and Drawings of the Knights of St John in the Museum of the Order of St John, Hampsire 1988, p. 18-20.
16. Reproduit dans E. Kollias, Les chevaliers de Rhodes, le Palais et la ville, Athènes, 1992, p. 107 et fig. 110 («Auberge de la langue de France»). Pour J.-B. de Vaivre, il s'agit de «l'Auberge de la Catalogne»: voir: J.-B. de Vaivre, «Les armes des grands maîtres de l'ordre de Saint-Jean-de-Jérusalem à Rhodes», Archivum heraldicum, 2009-1, p. 68-70 et fig. 63. Nous remercions J.-B. de Vaivre pour la photographie qu'il nous a confiée et que nous reproduisons ici avec son autorisation.
17. Reproduit dans le catalogue de l'exposition De Rhodes à Malte, le Grand maître Philippe de Villiers de l'Isle-Adam (1460-1534) et l'ordre de Malte, op. cit., p. 47.
18. De Vaivre, «Les armes des grands maîtres», op. cit., p. 70. Sur le mécénat latin à Rhodes: I. Christoforaki, «Χορηγικές μαρτυρίες στους ναούς της μεσαιωνικής Ρόδου (1204-1522)», Ρόδος 2400 χρόνια. Η πόλη της Ρόδου από την ίδρυση της μέχρι την κατά/,ηψή της από τους Τούρκους (1523), Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο (Ρόδος 24-29 Οκτωβρίου 1993), Athènes, 2000, vol. 2, p. 449-464.
19. Les trois fleurs-de-lis ont remplacé le semé sous Charles V (1364-1380). F. Oppenheimer, Frankish Themes and Problems, Londres, 1952, p. 171-235. Une page d'un antiphonaire aux armoiries de Villiers de l'Isle-Adam, offert par lui à l'église conventuelle de Rhodes, aujourd'hui au musée de la cathédrale Saint-Jean de La Vallette est reproduit dans le catalogue de l'exposition De Rhodes à Malte, le Grand maître Philippe de Villiers de l'Isle-Adam (1460-1534) et l'ordre de Malte, op. cit., p. 27. Voir aussi: O. Neubecker, Heraldry: Sources, Symbols and Meaning, Londres, 1977, p. 98-103.
20. De Vaivre, «Les armes des grands maîtres», op. cit., p. 65.
21. Sur les images des donateurs dans les icônes de la même période, voir le catalogue de l'exposition La France aux portes de l'Orient. Chypre Xlf-ΧΫ' siècle, Paris, 1991, p. 154 ; I. Christoforaki, «An Unusual Representation of the Incredulity from Lusignan Cyprus », Cahiers archéologiques, 48, 2000,
L'ICÔNE DE SAINT JEAN LE PRÉCURSEUR DU CHEVALIER JACQUES DE BOURBON 155
p. 71-87 ; S. Sophocleous, Τα Παλαιχώρια, κληρονομιά αιώνων, Nicosie, 2002, ρ. 106-107; Α. Stavropoiilou, «Storie devozio-nali nella pittura post-bizantina», Η συμβολή της Βενετίας στη διαμόρφωση των αισθητικών προτιμήσεων των Ελλήνων ( 15°ς-17Η αιώνας), Πρακτικά συνεδρίου, Βενετία, 2-3- Ιουνίου 2000, éd. Chr. Maltezou, Venise, 2001, p. 147-163.
22. Voir: Fr. Avril et N. Reynaud, Les manuscrits à peintures en France, 1440-1520, catalogue de l'exposition de la Bibliothèque nationale de France, Paris, 1993, n° 149.
23. D. Bouhours, Pierre d'Aubusson, μεγάλος μάγιστρος της Ρόδου, Athènes, 1996, p. 327, 337; G. Kiadakis, Ta ιπποτικά τάγματα, Athènes, 2003, p. 113; H. J. A. Sire, The Knights of Malta, New Haven et Londres, 1994, p. 132, 136.
24. Jacques de Bourbon, La grande et merveilleuse et très cruelle oppugnation de la noble cité de Rhodes prinse nagueres par sultan Seliman, a present Grand Turcq (...), Paris, 1526.
25. K. De Vries, «Gunpower at the Siege of Constantinople, 1453 », dans War and Society in the Eastern Mediterranean, 7th-15th centuries, éd. Y. Lev, Leyde, 1997, p. 345-346; R. Vaughan, Philip the Good: The Apogee of Burgundy, Londres, 1970; J. Richard, «Louis de Bologne, patriarche dAntioche, et la politique bourguignonne envers les états de la méditerranée orientale», Publication du centre européen d'études burgondo-médianes, 20 (Rencontres de Milan, 1978), Bâle, 1980, p. 63-64.
26. Lexikon des Mittelalters, II, Munich et Zurich, 1983, p. 505-506; F.-A. de la Chesnaye-Desbois, Dictionnaire de la noblesse, t. II, Paris, 1863, p. 777; R. Aubert de Vertot, Histoire des chevaliers hospitaliers de S. Jean de Jérusalem, appelez depuis les chevaliers de Rhodes (...), Paris, III, 1726, p. 165 ; J. Favier, Dictionnaire de la France médiévale, Paris, 1993, p. 163.
27. Jacques bâtard de Bourbon, La grande et merveilleuse et très cruelle oppugnation de la noble cité de Rhodes prinse naguères par Sultan Selyman Grand Turc, Paris 1970 ; Z. Tsir-panles, «Μελέτες για την ιστορία της Ρόδου στα χρόνια των Ιπποτών», Δωδεκανησιακά Ανάλεκτα 1, Θεσσαλονίκη 1970, ρ. 57-58, η. 4.
28. Le verbe θαρρώ signifie aussi, en effet, «j'espère», «j'attends»: E. Kriaras, Λεξικό της μεσαιωνικής δημώδους γραμματείας 1100-1669, t. VI, Thessalonique, 1980, 83-85, et Ch. Du Cange, Glossarium, Lyon, 1688, 485-486. Cependant, M. Jean-Bernard de Vaivre (à paraître) suggère une lecture πάλι θα pJw' (« Je coulerai de nouveau»), dont le sens général est de toute façon très voisin, mais qui demeure bien difficile à admettre pour des raisons philologiques et epigraphiques.
29. B.-E.-A. Rottiers, Description des monuments de Rhodes, Bruxelles, 1830. Je remercie M. Jean-Bernard de Vaivre, qui prépare une étude sur ce sablier, de m'avoir généreusement confié la photographie reproduite ici. A. M. Kasdagli, «Hospitalier Rhodes: the Epigraphic Evidence», dans The Hospitaliers, the Mediterranean and Europe, Festchrift for Anthony Luttrel, éd. K. Borchardt etalii, Aldershot, 2007, p. 111.
30. Musée de Rhodes (Palais du Grand maître), inv. Φ 74, Ε. Kollias, H μεσαιωνική πόλη της Ρόδου και το παλάτι του μεγάλου μαγίστρου, Athènes, 1994, ρ. 141, fig. 81 ; idem, Η Ρόδος από τον 4" αιώνα μ. Χ. μέχρι την κατάλιηψή της από τους Τούρκους (1522), ΠαλΛτι μεγάλου μαγίστρου, Athènes, 2004, ρ. 91.
31. Cf. M.-P. Loicq-Berger, «Un Liégeois au siège de Rhodes de 1522», Revue belge de philologie et d'histoire, 67, 1989, p. 714-747.
32. C. A. Bertini Frassoni, // sovrano militare ordine si S. Giovanni di Gerusalemme detto di Malta, Rome, 1929, p. 11; I. Delendas, Οι ιππόται της Ρόδου, Athènes, s.d., p. 265 ; Ε. Brockman, The Two Sieges of Rhodes 1480-1522, Londres. 1969, p. 111-159.
33. H. J. A. Sire, The Knights of Malta, New Haven et Londres,
1994, p. 58-59; Th. Archontopoulos, «Ο Θησαυρός των Ιωαννιτών ιπποτών, από την Ιερουσαλήμ στη Μάλτα», Corpus, 4, avril 1999, p. 70-78; Ε. Brockmann, «The Lost Treasure of the Conventual Church », Annales de Tordre Souverain Militaire de Malte, 20, 1962 ; A. Luttrell, « The Rhodian Background of the Order of St. John on Malta», The Order's Earlv Legacy in Malta (ed. C.J. Azzopardi), La Valette, 1989, p. 6."
34. Ch. Oman, «The Treasure of the Conventual Church of St. John at Malta», The Connoisseur, 1970, p. 101-107; M. Bacci, «Vera croce, vero ritratto e vera misura: sugli archetipi bizan-tini dei culti cristologici del medioevo occidentale», Byzance et les reliques du Christ, éd. J. Durand et B. Flusin, Paris, 2004, p. 234. Ce fut, en particulier, le cas de la relique de la main de saint Jean Baptiste : J. Durand, «A propos des reliques du monastère du Prodrome de Pétra à Constantinople », Cahiers Archéologiques, 46, 1998, p. 152-154.
35. Notamment trois icônes de la Vierge, dont celle très célèbre de Philerimo. A. Mitsani, «Παναγία η Δαμασκηνή: Μια βυζαντινή εικόνα στην ιπποτοκρατούμενη πόλη της Ρόδου», 15 χρόνια έργων αποκατάστασης στη Μεσαιωνική Πόλη της Ρόδου, op. cit., ρ. 433-444; G. Porsella Flores, «L'icona di nostra signora di Damasco e la chiesa parrocchiale di rito greco cattolico alla Valetta», // Delfino, 18, 1987; Z. Tsirpanles, «Από τη Ρόδο στη Μάλτα (1523-1530). Οι ροδίτες πρόσφυγες και οι βυζαντινές εικόνες της Παναγίας Δαμασκηνής και της Παναγίας Ελ.εημονήτρας», Dodone, 16, 1988, ρ. 197-236; Υ. Piatnitsky, « Wonder-working Icon. Our Lady of Filerimo in Russia», Ρόδος 2400χρόνια. Η πόλη της Ρόδου από την ίδρυση της μέχρι την κατάληψη της από τους Τούρκους (1523), op. cit., ρ. 473-477.
36. Ch. de Saulnier, op. cit., p. 41, sans citer ses sources, associe l'arrivée de l'icône à Apt au chevalier d'Astoaud de Bézaure, «soit qu'il en eut la mission, soit qu'il en fut acquéreur», pour l'autel fondé dans la cathédrale par sa famille. Elle aurait plus tard quitté la cathédrale pour la commanderie de Joucas jusqu'à la Révolution, avant de revenir ensuite à Apt. De son côté, Augustin Roux (op. cit., p. 98, note 12), en s'appuyant sur l'Histoire manuscrite d'Apt de Joseph-François de Remer-ville (1653-1730) à la Bibliothèque de Carpentras (ms. 1670, fol. 9-14), cite aussi un chevalier d'Astoaud de Bézaure et l'autel de la chapelle Sainte-Anne, consacrée en 1664, qui avait remplacé l'ancien oratoire de Sainte-Anne, lui-même achevé vers 1510. En ce cas, il ne peut guère s'agir que de Charles d'Astoaud, chevalier cité en 1539 par de Vertot (op. cit., p. 6).
37. L. Schiavone, Pietrino del Ponte nella storia dell'ordine gerosolimitano, Asti 1995, fig. XII.
38. H. Ratyé-Chorémi, Villages en Provence entre Rhône et Durance, Marguerittes, 1992, p. 110-111; H. Aliquot et R. Merceron, Armoriai d'Avignon et du Comtat Venaissin, Avignon, 1987, p. 21.
39. En outre, de nombreux Grecs de Constantinople se sont réfugiés en Crète, à Chypre et à Rhodes après 1453. L'Anglais William Lily, en route pour Jérusalem vers 1480, apprend le grec à Rhodes de réfugiés constantinopolitains : P. Botley, «Learning Greek in Western Europe, 1476-1516», Literacy, Education and Manuscript Transmission in Byzantium and Beyond, éd. C. Holmes et J. Waring, Leyde, 2002, p. 200; A. Katsioti, « Αμφίγραπτη παλαιολόγεια εικόνα στη Νίσυρο», Deltion tes christianikes archaiologikes Etaireias, 25, 2004, p. 75.
40. Sur la peinture «italobyzantine» chypriote: M. Garidis, «Peintures murales à Chypre pendant la seconde moitié du X V e siècle : Traditions byzantines, apports du gothique et de la Renaissance», Cahiers balkaniques, 11, 1987, p. 25-57; S. Sophocleous, «L'évolution de la peinture chypriote durant la période franque et vénitienne», dans La France aux portes de l'Orient, op. cit., p. 140-143. Il convient de signaler ici l'attribution à des ateliers crétois du polyptyque de Monopoli (Pouilles), plus ancien, qui passe pour une commande des chevaliers de Saint-Jean au début du xv e siècle, aujourd'hui au musée de Boston: M. Constantoudaki-Kitromilides, «Ένθρονη Βρεφοκρατούσα και άγιοι. Σύνθετο έργο ιταλοκρητικής
156
τέχνης», Deltion tes Christianities archaiologikes Etaireias. 17, 1993-1994, p. 285-302; eadem, «Icône cretesi de xv° secolo e la pittura italiana del tardo medioevo», Corso di cultura sull'arte ravennate e bizantina, 38, 1991, p. 125-129; voir aussi Icône di Puglia e Basilicata dal medioevo al set-tecento, éd. P. Belli D'Elia, Milan, 1988, p. 32.
41. Th. Archontopoulos et A. Katsioti, «H ζωγραφική στη μεσαιωνική πόλη της Ρόδου από τον 11° αιώνα μέχρι την κατάληψη της από τους Τούρκους: Μια εκτίμηση των δεδομένων», dans 15 χρόνια έργων αποκατάστασης στη Μεσαιωνική Πόλη της Ρόδου, op. cit., ρ. 462-465.
42. Ν. Vatin, L'ordre de Saint-Jean-de-Jérusalem, l'Empire ottoman et la Méditerranée orientale entre les deux sièges de Rhodes (1480-1522), Paris, 1994.
43. E. Kollias, H μνημειακή εκλεκτική ζωγραφική στη Ρόδο στα τέλη του 15ου και στις αρχές του 16ου αιώνα. Μνήμη Μανόλη Χατζηδάκη (Académie d'Athènes, 29 février 2000), Athènes, 2000 ; idem, « H Διαπόμπευση του Χριστού στο ζωγραφικό διάκοσμο του Αγίου Νικολάου στα Τριάντα Ρόδου», Ευφρόσυνον. Αφιέρωμα στον Μανόλη Χατζηδάκη, Athènes, 1991, vol. 1, p. 243- 261 ; idem, Δύο ροδιακά ζωγραφικά σύνολα της εποχής της ιπποτοκρατίας. Ο Άγιος Νικόλαος στα Τριάντα και η Αγία Τριάδα (Ντολαπλί Μετζίντ) στη μεσαιωνική πόιλη, thèse de doctorat, Athènes, 1986.
44. E. Kollias, Les chevaliers de Rhodes, op. cit., p. 40-41.
45. K. Kefala, «H εικόνα του αγίου Ιωάννη του Προδρόμου στην ομώνυμη εκκλησία της Ρόδου», op. cit., ρ. 445-453. Sur les apports de l'art occidental à Rhodes: Ch. Bouras, «The Impact of Frankish Architecture on Thirteenth-Century Byzantine Architecture», The Crusades from the Perspective of Byzantium and the Muslim World, éd. A. Laiou et R. P. Mot-taheden, Washington, 2001, p. 255; D. Stöckly, «Sur les chemins des galères vénitiennes vers la Terre Sainte: l'étape de Rhodes», Thesaurismata, 27, 1997, p. 79-88.
46. H Ρόδος από τον 4° αιώνα μ. Χ. μέχρι την κατάληψη της από τους Τούρκους (1522), op. cit., ρ. 92.
47. Th. Archontopoulos, «Παναγία η Φιλόστοργος: μία εικόνα από τον ναό του Ευαγγελισμού στ'Ασφενδιού Κω », Χάρις Χαίρε, Μελέτες στη μνήμη της Χάρης Κάντζια, vol. 1, Athènes, 2004, p. 317-328; Κ. Kefala, «Ο Χριστός αίρων τον σταυρόν. Μια ροδιακή εικόνα της εκλεκτικής τάσης», Del
tion tes christianikes archaiologikes Etaireias, 30, 2009, p. 215-224.
48. H Παναγία του Κάστρου, Athènes, 1989, p. 144-145.
49. Kefala, « H εικόνα του αγίου Ιωάννη του Προδρόμου στην ομώνυμη εκκλησία της Ρόδου», op. cit., ρ. 445-446. Voir aussi : S. Sophoclcous, Le patrimoine des icônes dans le diocèse de Limassol, Chypre, XIIe-XVIe siècle, thèse de doctorat, Strasbourg et Limassol, 1990, p. 148, 152-153.
50. J.-B. De Vaivre, «Icône offerte en Chypre par un commandeur des Hospitaliers», Compte rendus de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, 1999, p. 649-683. Cf. aussi le catalogue de l'exposition Cyprus, Jewel in the Crown of Venise, Nicosie, The Anastasios G. Leventis Foundation, 2003, p. 210-211; D. Talbot Rice, The Icons of Cyprus, Londres, 1937, p. 219, n. 43, pl. XXII, 43.
51. M. Acheimastou-Potamianou, Εικόνες της Ζακύνθου, Αθήνα 1997, ρ. 42-45.
52. Ε. Tsigaridas, «Φορητές εικόνες στη Μακεδονία και το Άγιον Όρος κατά τον 13° αιώνα», Deltion tes christianikes archaiologikes Etaireias, 21, 2000, p. 126, fig. 7 ; idem, «La peinture à Kastoria et en Macédoine grecque occidentale vers l'année 1200», Studenica et l'art byzantin autour de l'année 1200, Belgrade 1988, p. 317-318, fig. 34-37; E. Pelekanidou, «H εικόνα της Οδηγήτριας της αρχαιολογικής συλλογής Καστοριάς», Αφιέρωμα στη μνήμη Στ. Πελεκανίδου, Thessalo-nique, 1983, p. 389-396.
53. Ιερά Μεγίστη Μονή Βατοπαιδίυυ. Παράδοση, ιστορία, τέχνη, Mont Athos, 1996, t. 2, p. 373, fig. 317.
54. K. Weitzmann, G. Alibegasvili, A. Volskaja et alii, The Icon, New York, 1987, p. 180; V. Djuric et S. Radojcic, Icônes de Yougoslavie, Belgrade 1961, p. 102-104, fig. XLV-XLVIII.
55. A. Weyl Carr. « Italians and Byzantines in Cyprus: Images from Art», Dumbarton Oaks Papers, 49, 1995, p. 340-342; eadem, «A Palaiologan Funerary Icon from Gothic Cyprus », Πρακτικά του Γ' Διεθνούς Κυπρολογικού Συνεδρίου (Nicosie, 16-20 avril 1996), vol. Β, éd. Α. Papageorgiou, Nicosie, 2001, p. 600, 605-606; A. Papageorgiou, Icons of Cyprus, Nicosie, 1992, fig. 39; D. Talbot Rice, The Icons of Cyprus, op. cit., p. 195-197.
L'ICÔNE DE SAINT JEAN LE PRÉCURSEUR DU CHEVALIER JACQUES DE BOURBON 157