L’ Ardèche à la fin de l’âge du Bronze et aux âges du Fer (IXe siècle-Ier siècle avant notre ère)
Les torre. Tours de l’âge du Bronze de Corse
-
Upload
museu-altarocca -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of Les torre. Tours de l’âge du Bronze de Corse
Les torreEnigmatiques toursde l'âge du BronzeDans le sud de la Corse, au cours de la première moitié dull" millénaire avant notre ère, apparaît un type d'édifice parti-culier, la torra" Ces tours de pierre sèche, implantées en posi-tion dominante au ccour de l'habitat, constituent l'élémentemblématique des sociétés insulaires de l'âge du Bronze.Krwrru PEeHe-Qulrrcp,lr\xr
p nresrnn et Foce, les premières torref-l reconnues en Corse, sont décrites etfouillées par Roger Grosjean à la fin desannées 1950. Ce dernier, informé de l'exis-tence de ces vieilles tours par des collabo-rateurs locaux, les interprète à l'originecomme des caveaux funé-
Ci-C§L!T&§ Carte de répartition des tore.Les pointillés marquent les limitesde leur distribution géographique.@ K. Peche-Ouilichini
PÀGf n# §AUÇtl* Torra de Contorba depuisle nord. @ K. Peche-Quilichini
Par la suite, avec la datation antique deces tombes et la multiplication desfouilles d'habitats (Filitosa, Alo-Bisughjè,Cucuruzzu, Tappa, Ceccia, Araghju,Torre, etc.) et de sites mégalithiques,R. Grosjean fera évoluer son interpréta-tion pour considérer les torre comme dessanctuaires édifiés par une populationintrusive originaire de Méditerranéeorientale, les Shardanes.
Mise à mal par les progrès de la recherchearchéologique et par le décès de R. Gros-jean, cette vision évènementielle dessociétés corses de l'âge du Bronze serapeu à peu abandonnée. À partir desannées 1970, ce sont les travaux de terrainet de synthèse réalisés par G. Camps,J. Cesari et F. de Lanfranchi qui vontcontribuer à renouveler l'état des connais-sances sur la chronologie, la fonction etl'architecture de ce type de monuments.
§0ilffi§§ ËT e*MpLHX§§Ces édifices sont entièrement élevés enpierre sèche au moyen de blocs de cali-bre moyen à gros.
Les torre ont une forme de tour devolume tronconique rétréci vers le haut.
raires organisés en plusieurs
chambres, du fait de Ia
découverte de sépulturesà l'intérieur.
/^>/ //,,''-\> ,a\(«ul )\ \----l /
Tappa
/^ \/ .t1-----.\ \/0\4 l\N/4 )\l (./Foce
r1);(\«»)\ \,' /
Tusiu
/'\/ r2\L\(G?i\\- V-\,
Alo-Bisughjè
_r-\r,â1\u))\t1(v\-q \
\UContorba
/:> ^(ô.§\\ \ \/ l\\-v/\ -,/
Cucuruzzu
ouestFilitosa ouest
Pozzone Araghju
N
A50mCalzola
Beaucoup intègrent à leur structure les
aspérités de la roche affleurante, qui a
probablement aussi servi de carrière. La
torra est parfois élevée sur une plate-forme préalablement aménagée pour éta-
blir un terrain horizontal (Tusiu, Pozzone).
Son parement externe est assez soigné,
voire parfaitement régulier (Torre). La
porte est dans la plupart des cas placée
dans le cadran sud-est, afin de limiter Ia
pénétration des vents dominants.
À l'intérieur, au centre du rez-de-chaus-
sée, se trouve toujours une chambre sub-
circulaire, sauf dans le cas de Torre, où
cette pièce prend la forme d'un couloir.
Cette première chambre est presque tou-jours plafonnée par une voûte encorbel-lée. Seule la voûte de Cucuruzzu est
entièrement conservée. À Torre, le pla-
fond est formé de dalles. À Contorba età Calzola, la base du mur interne de la
torra est divergente, ce qui pourrait fairepenser à une couverture n'utilisant pas la
voûte mais plutôt un plafond de bois.
La chambre est toujours précédée d'unvestibule cruciforme distribuant la circu-
lation. La branche la plus longue relie la
chambre à l'extérieur. La branche la plus
courte relie une niche peu profonde à un
escalier. Celle-ci se trouve toujours à
Ëf{ HAUT Plan simplifié de quelques torre.D'après les travaux de J. Cesari, F. deLanfranchi et R. Grosjean, DAO : F, Leandri).
{I-CûNTRË Structure axonométrique d'une torraou d'un nuraghe à un étage. D'après F. Laner.
.-q{1.ryJe
:."-:.:
'..:*"?âl;'":
droite en pénétrant dans la torra, sauf à
Cucuruzzu et Tappa, où elle est à gauche.
L'escalier (ou la rampe d'accès) est amé-
nagé dans l'épaisseur des murs. Sa
conception est planifiée dès les premières
assises; il mène à Ia chambre supérieure
et à la plateforme sommitale et progresse
en colimaçon autour de la voûte. On sup-pose qu'un demi-tour suffisait pour accé-
der à l'étage supérieur. Au-delà des
aspects liés à la circulation, il permet d'al-léger la structure du monument. Son pla-
fond voûté crée un contrefort qui redis-
tribue les poussées vers les murs
externes. ll se pourrait que ce soit par
l'escalier que progresse la constructionde l'édifice.Dans de nombreux cas, Ies dalles formantle sol de l'escalier servent de plafond aux
niches rayonnant depuis la chambre. Ces
l.§.',;
{]a-üf*§i,js La torra de Balestra dans son étâtactuel. @ K- Peche-Ouilichini
dernières, lorsqu'elles sont présentes,
sont au nombre d'une à trois. Aménagées
dans le remplissage interne, elles visentà agrandir l'espace de la chambre.
Ë,Fi*Tü##f;S#]"*,&: *il$ ffi!qfl*:ruik*On ne sait combien d'étages les torrecomptaient. On peut cependant estimerque la moyenne des élévations était plus
faible qu'en Sardaigne à cause de l'em-ploi ici généralisé du granite, qui supportemoins les pressions verticales que le
basalte ou le calcaire, matériaux utilisés
dans I'île voisine. Les roches corses pré-
sentent en effet une densité plus impor-tante, supposant des techniques architec-
turales plus difficiles à mettre en æuvre.
Le sommet du monument prenait l'aspectd'une plateforme à balustrade portée par
un mâchicoulis soutenu par des corbeaux.
L'ensemble de ces descriptions trouve de
strictes analogies en contexte nuragique,
au point que les phénomènes d'apparitionet de multiplication des torre et des nura-
ghi (qui constituent l'équivalent sarde des
torre) ne semblent pouvoir être dissociés.
Les torre nous apparaissent au finalcomme des monuments complexes etbien pensés, probablement planifiés etqui optimisent les caractéristiques natu-
relles du terrain. Sur la plupart des sites
d'implantation, la tour est protégée par
une ou plusieurs enceintes en pierre
sèche, localement appelées caste//i ou
casteddi, dont l'espace interne accueille
parfois des habitations.
Siêî"
LA FONer!*§q *ffi§ r#Ëtr§,*U§§-T[*N ft $iCU ffi ft HElTffi
Reste à déterminer à quoi servaient ces
constructions. L'historiographie leur a tour
à tour accordé le statut de châteaux, de
maisons de chef, de palais, de tombes, de
temples ou d'autres attributions ne méri-
tant pas d'être mentionnées' ll y a en fait
deux façons d'observer une torra: son
architecture et son remplissage archéolo-
gique. La combinaison des deux condi-
tionne la compréhension des différents
moments et des formes de l'utilisation.
Les architectures renvoient de façon assez
directe à un rôle défensif (massivité des
structures, élévations importantes, retran-
chement derrière des systèmes d'en-
ceintes, forme circulaire parfaitement
adaptée aux règles poliorcétiques) et sug-
gèrent l'idée que les torre ont été conçues
pour protéger ce qui était contenu dans
leur espace interne. De taille trop exiguë
pour servir de dernier refuge à un groupe
humain, on rejettera d'emblée un rôle de
donjon. Ce caractère défensif peut aussi
être ampli{ié par l'existence d'une plate-
forme sommitale liée à la surveillance des
environs, voire à la communication avec
les groupes voisins. Le dernier élément
jouant en faveur d'une destination défen-
sive de la torra est la stratégie d'implanta-
tion optant systématiquement pour lepoint culminant d'un chaos rocheux'
L interprétation des données fournies par
les fouilles renvoie cependant une image
nettement moins militaire.
La récurrence de Ia présence d'un grand
foyer dans la chambre (Filitosa, Alo-
Bisughjè, Pozzone, Contorba, Tusiu), acti{
sur de longues durées, permet d'évoquer
une utilisation quotidienne pour chauffer,
cuire et/ou produire de la lumière. Près
des murs de la chambre, c'est le matériel
de meunerie qui prédomine. Dans les
niches, le mobilier est caractérisé par la
présence de grandes jarres et de produits
céréaliers et, plus généralement, alimen-
taires (fromages, salaisons, miel, glands
de chêne, etc.). Le mobilier métallique ou
précieux y est rare mais plus fréquent que
dans les autres contextes (habitations
sépultures, sites mégalithiques, etc.)'
À la lueur de ces données, il semble que
l'espace interne soit consacré au stockage,
à la transformation (grillage, torréfaction
cuisson) et à la redistribution (?) des pro-
duits alimentaires de base, avec comme
fonction annexe la dissimulation de biens
de thésaurisation. Laspect défensif de a
tour s'expliquerait par le besoin du groupe
- ou de ses élites - de protéger les denrées
entassées à l'intérieur mais aussi peut-être
de masquer l'état des stocks aux envieux
intérieurs comme extérieurs' Sa positio'
dominante pourrait quant à elle résulte'
d'une volonté d'accès plus facile aux reÿ
sources en matériaux de construction (pa'
exploitation directe du site d'implantation
tout autant que d'un besoin d'établir une
vigie. La torra a aussi pu avoir un rôle p!5
symbolique, en tant qu'édifice représenta:
et emblématique du groupe, aspect éga e-
ment renforcé par l'implantation sommitae
et par une construction ayant impliqué ure
grande partie de la communauté.
LA THÉONIE DES SHARDANES
Plus d'un siècle après les prémices d'une
activité archéologique en Corse, c'est à
Roger Grosjean (19?0-1975) que l'on doitles premières véritables recherches sur la
Protohistoire insulaire.
Missionné sur l'île au milieu des années
1950 par le CNRS (sous le parrainage de
l'Abbé Breuil), ce chercheur a pour mission
de rassembler et d'analyser les données
éparses sur les premiers peuplements.
Accompagné de nombreux in{ormateurs
locaux, il va multiplier les chantiers et les publi-
cations. Très vite, les données accumulées vont
lui permettre de proposer des synthèses,
notamment sur l'âge du Bronze, période qu'il
privilégie entre toutes.Ses travaux sur les sociétés du ll" millénaire
sont orientés vers deux types de sites: les
torre et les statues-menhirs (monolithes
anthropomorphes portant souvent des attri-buts figurés: vêtements, armes défensives et
offensives). L'interprétation de l'étude archi-
tecturale, couplée à celle proposée pour les
monolithes, joue un rôle fondateur dans l'éla-
boration d'une thèse restée célèbre dans l'his-
toriographie corse sous le nom de « théorieshardane ».
LE MYTHE
D'UN ENVAHISSEUR BRILLANTCette théorie envisage l'invasion de l'île par
un peuple guerrier, les Shardanes, illustre
groupe de la coalition des « Peuples de la
Mer », arrivés de Méditerranée orientale pour
s'installer en Corse et en Sardaigne à la suite
d'un raid mené et manqué contre l'Égyptevers le troisième quart du ll" millénaire. Après
avoir écrasé la résistance indigène grâce à leur
supériorité technologique (métallurgique sur-
tout), les Shardanes s'implantent et édifientleurs caractéristiques temples circulaires en
forme de tours (les torre) dédiés au culte du
feu, souvent à l'endroit où vivaient leurs adver-
saires d'hier. lls deviennent à cette occa-
sion les « Torréens ».
lls détruisent les sanctuaires des autoch-
tones, plus particulièrement ceux qui
furent élaborés pour commémorer les vic-
toires de ces derniers sur les envahisseurs :
les alignements de statues-menhirs armées
représentant les chefs shardanes abattus
avec tous leurs attributs guerriers. Ces élêments gravés sur les monolithes sont d'ail-
leurs identifiés à ceux représentés sur les
bas-reliefs de plusieurs temples égyptiens,
notamment Medinet Habu'
FIN DE TÉPOPÉE!Durant les années 1960 et 1970, cette
vision évènementielle de la Préhistoire
récente de la Corse trouvera un important
succès dans une île qui redécouvre son
identité et son patrimoine culturel. Le cha-
risme et l'omniprésence de R. Grosjean
feront le reste, malgré sa mort prématurée
en 1975.
Par la suite, le développement des métho-
des d'analyses entraînera l'abandon de
cette théorie, au profit de points de vue
privilégiant une évolution sur place des
groupes protohistoriques, selon un modèle
méditerranéen assez classique.
À GAUCHE Roger Grosjean. Collection privÉa {
.t
.:.rèt'tÈ
*"i"*t"ttia it{iï}sI rî sÂq]Â: {}rdilEn l'état actuel des données. les torresemblent apparaître dans les vallées dusud de la Corse vers la fin du Bronzeancien, autour de '1 800-1600 avant J.-C.C'est néanmoins au Bronze moyen (1600-
1200 av. J.-C.) que ces édifices sont les
plus nombreux et connaissent Ieur apogéearchitectural. Cette chronologie est assu-
rée par les mobiliers et les datations radio-métriques. À partir de 1200 av. J.-C., avec
les profondes transformations socio-cul-turelles marquant le début du Bronze final,les torre vont connaître un abandon, unedestruction ou une réoccupation contras-tant avec les formes d'utilisation consta-tées aux époques précédentes.
En Sardaigne, il existe actuellement unecontroverse sur la période d'apparition etla typologie des premiers édi{ices nura-
giques. Certains chercheurs évoquentune contemporanéité du développementdes architectures turriformes dans les
deux îles, avec une datation assez haute(Bronze ancien) des monuments primitifs.D'autres archéologues, plus fidèles à la
vieille tradition d'étude nuragique, imagi-nent une apparition au Bronze moyen etune évolution en deux phases : des nura-ghi « archaiques » à chambre en forme decouloir dans un premier temps, des nura-ghi voûtés dans un second moment.Ces points de vue divergents se rejoi-gnent dans l'idée d'une évolution assez
marquée vers la fin du Bronze moyen,matérialisée par le développement desnuraghi complexes, munis d'imposantssystèmes d'enceintes et de bastions.
Ce phénomène de complexification desarchitectures ne connaît que peu ou pas
*l-#*5:;l-r; Vue d'ensemble de la torrade Tappa. On aperçoit Ia rampe hélicoidalesur la gauche. @ K. Peche-Ouilichini
d'équivalent à cette époque en Corse, où
les torre sont progressivement abandon-nées. Les deux îles entrent alors dans une
phase de différenciation sur ce point pré-
cis et ce, même si de nouvelles formesd'échanges illustrent la pérennité descontacts entre les deux rives des Bouches
de Bonifacio.
Les divergences observées entre Corse etSardaigne trouvent leur paroxysme dansle nombre des constructions : 6500 nura-ghi pour seulement 44 torre, même si ce
dernier chiffre peut raisonnablement êtrerevu à la hausse et estimé à 65-70 élé-ments si I'on inclut quelques monumentsincertains, ceux qui ont été détruits etceux qui restent à découvrir.
§ffir
NURAGH' DE SARDAIGNE,LES AUTRES TOURS DE EAGE DU BRONZE
Des milliers de tours protohistoriquesont été repérées en Sardaigne. Leurlien avec les torre de Corse est une
énigme passionnante.
Le nuraghe est une construction apparentée à
une tour, de volume tronconique, élevée en grosappareil de pierre sèche (essentiellement enbasalte et en calcaire, en granite dans le nord;appareillage régulier ou non), caractéristique duBronze moyen de Sardaigne, qui en compte prèsde 6500. Ces édifices présentent une structuretrès voisine des tore de Corse méridionale.
LES PLUS HAUTS MONUMENTSPRÉHISTORIOUES DU MONDELes nuraghî, qui s'organisent verticalement enune succession d'étages voûtés en encorbelle-ment, pouvaient se développer sur plus de 20 mde hauteur et comptaient donc parmi les monu-ments préhistoriques les plus hauts du monde.À partir du Bronze récent, vers 1350/1300avant J.-C., ces tours se dotent de construc-tions annexes, notamment d'enceintes et debastions ; on parle alors de nuraghi complexes.5i leur fonction originelle et principale était liéeau stockage et à la transformation des denrées
de subsistance, notâmment des céréales, les
nuraghi pouvaient à l'occasion servir de refuge(pour abriter les populations en cas de péril)ou comme vigie sur le territoire alentou[ avantque certains ne soient transformés en lieu deculte au cours de l'âge du Fer.
Leur implantation territoriale est assez irrégu-lière; il existe des zones de forte concentration,notamment en bordure des plateaux dominantles principales plaines, et des secteurs dépour-vus de tours. Le nuraghe devient au gré dutemps le centre symbolique de l'habitat, avec
des maisons circulaires qui vont progressive-
ment s'agglutiner autour pour former d'impor-tantes entités villageoises. Le terme de nuraghea donné son nom à la période « nuragique » etaux cultures matérielles qui lui sont associées.
CI-DES§US Le nuraghe complexe de Losa, l'un desplus imposants de Sardaigne. @ K. Pech+,Quilichini
CI-DESSOUS Le nuraghe Santu Antine, au milieuduquel émerge la tour originelle du monument.@ K. Peche-Quilichini
TSU"'OLJR§,EU §IJffiLes torre ont été reconnues uniquementdans le sud de la Corse, à l'exception de
I'extrême sud. Cette constatation va dans
le sens d'une origine sarde du modèlearchitectural et fonctionnel. Les monu-ments du nord de llle décrits dans la biblio-
graphie (Rusumini, Castellare) comme des
torre ont récemment fait l'objet de vérifi-cations et ne cadrent en fait pas avec lemodèle de définition.Le schéma de distribution territoriale est
assez récurrent. malgré des différences de
fréquence en fonction des secteurs. Les
torre sont préférentiel Iement implantées
sur les collines dominant les principaux
cours d'eau, à moins de 8 km de la mer
mais toujours à plus de 1 000 m du littoral.Certaines microrégions intérieures,
comme I'Alta Rocca, n'en sont toutefoispas dépourvues. Trois zones (la basse val-
lée du Taravu, le Sartenais et le bassin du
Stabiacciu) présentent des concentrations
remarquables, presque comparables aux
contextes nuragiques. Comme en Sardai-
gne, on suppose un fonctionnement com-
plémentaire des différents monuments,
dans le cadre d'une exploitation optimisée
des ressources sur un territoire donné. La
question d'une éventuelle hiérarchie des
sites, qui est l'objet d'une abondante lit-
térature en contexte nuragique, nê peut
être développée en Corse, faute de don-nées archéologiques suffisantes.
Les torre ont joué un rôle important dans
la construction du discours archéologiqueen Corse, toutes périodes confondues.
el-Bü§§lJS Entrée de la torra de Torre.@ K. Peche-Ouilichini
L'écho des recherches et des théories de
R. Grosjean résonne encore en arrière-plan des études protohistoriques déve-loppées aujourd'hui dans l'île. Malgré la
déconsidération collégialement admise
des propositions émises par ce chercheur,
on ne pourra lui retirer son statut de pion-
nier dans le domaine d'étude des socié-
tés insulaires de l'âge du Bronze.
Kewin Peche-Ouilichini, docteuren Protohistoire, UMR 5140 Montpellier-Lattes
CAI\4PS G., 1988, Préhistoire d'uneîle. Les originesde la Corse, Paris, Errance.
CESARI J., 1989, « Tore et castelli a torra. Contribution
à l'étude des habitats de l'âge du Bronze de la Corse
du Sud », Bulletin de la Société des Sciences Histo-
riques et Nature/les de ia Corse 656, p.345-372.PECHE-OUILICHINI K.,2011, « Les monuments turri-formes dg l'âge du Bronze en Corse: tentative de
caractérisation spatiale et chronologique sur fond d'his-
toriographie », dans: D. Garcia ldr.), L'âge du Bronze
en Méditerranée. Recherches récentes, Séminaire
d'Antiquités nationales et de Protohistoire européenne
d'Aix-en-Provence, Paris, Errance, p.'155-169.
VlRlLl F.-1., GROSJEAN J., 1979, Guide des sltestorréens de I'âge du Bronze corse, Paris, Vigros.
m.filitosa.fr











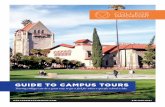









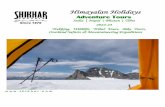





![Le mobilier métallique [de San Paolo, Méria, Haute-Corse]. In : Lechenault M. et al., San Paolo (Méria, Haute-Corse). Document final de Synthèse 2014. Evaluation archéologique,](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/63224539078ed8e56c0a5419/le-mobilier-metallique-de-san-paolo-meria-haute-corse-in-lechenault-m.jpg)


