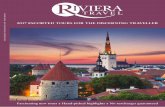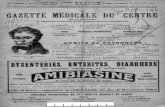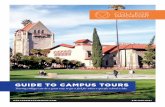« Les arts somptuaires à Tours autour de 1500 : état de la recherche », dans Boudon-Machuel...
-
Upload
univ-lorraine -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of « Les arts somptuaires à Tours autour de 1500 : état de la recherche », dans Boudon-Machuel...
Art et société à Toursau début de la Renaissance
Sous la direction de
Marion Boudon-Machuel et Pascale Charron
Art
et so
ciét
é à T
ours
au d
ébut
de
la R
enai
ssan
ce
Sous
la di
recti
on de
Mar
ion Bo
udon
-Mac
huel
et P
asca
le Ch
arro
n
Centre d’études supérieures de la Renaissance
Qualifiée d’« ombilic du royaume » par l’humaniste florentin Francesco Florio, Tours est à partir de la décennie 1440 le lieu de séjour favori des rois de France et de la cour et, dès lors, l’une des villes les plus importantes du domaine royal. Dès la seconde moitié du siècle, elle s’impose comme l’un des grands foyers artistiques, reconnue comme capitale du luxe autour des années 1500. C’est ce foyer que le colloque organisé en mai 2012 au Centre d’études supérieures de la Renaissance, et dont les actes sont publiés ici, a choisi d’étudier. Le regard des chercheurs s’est porté sur la cité elle-même à la fois comme lieu de naissance des œuvres et comme plaque tournante de la création artistique lar-gement ouverte vers d’autres villes. Territoire investi par les com-manditaires et les artistes tourangeaux ou étrangers, il fut un lieu d’échanges privilégiés entre ces différentes catégories d’acteurs pour une production touchant aux arts monumentaux (architec-ture, sculpture), aux arts précieux (broderie, orfèvrerie), aux arts de la couleur (enluminure, peinture) ou aux arts de la guerre.
Marion Boudon-Machuel est Professeur en Histoire de l’art pour la période moderne : XVIe-XVIIIe siècle, à l’université François-Rabelais de Tours, rattachée au Centre d’études supérieures de la Renaissance.Pascale Charron est Maître de conférences en Histoire de l’art du Moyen Âge à l’université François-Rabelais de Tours, rattachée éga-lement au Centre d’études supérieures de la Renaissance.
Collection | Études Renaissantes
centre d'études supérieures de la renaissanceUniversité François-Rabelais de Tours - Centre National de la Recherche Scientifique
Collection | Études Renaissantes Dirigée par Philippe Vendrix
2016
Sous la direction de
Marion Boudon-Machuel et Pascale Charron
Actes du colloque « Tours 1500, art et société à Tours au début de la Renaissance » organisé au CESR du 10 au 12 mai 2012
Art et société à Toursau début de la Renaissance
Conception graphique, mise en pageAlice Loffredo-Nué
© Brepols Publishers, 2016ISBN 978-2-503-56930-7
D/2016/0095/187All rights reserved. No part of this publication may be reproduced stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording,
or otherwise, whithout the prior permission of the publisher.
Printed in the E.U. on acid-free paper
Couv. : La Fuite en Égypte, Livre d’heures à l’usage de Rome, Tours, B.M. ms 2104, f. 37v. ©Tours, Bibliothèque municipale. p. 1 : Jean Poyer, Les quatre évangélistes, Heures Petau, c. 1495-1500, Paris, Musée des Lettres et Manuscrits. Cliché de M. Hofmann.
p. 2 : Attribué à Jean Bourdichon, page héraldique, Guillaume de Digulleville, Pèlerinage de la vie humaine, vers 1490, Paris, Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 823, page de garde © BnF.
p. 4 : Vierge à l’Enfant adorée par saint Joseph, Livre d’heures à l’usage de Rome, Tours, B.M. ms 2104, f. 10. ©Tours, Bibliothèque municipale
Les arts somptuaires à Tours autour de 1500 : état de la questionFrédéric Tixier | Nancy, Université de Lorraine
L’étude des arts somptuaires dans le Royaume de France incite dans la plupart des cas, à évo-quer des souvenirs d’un passé glorieux, mais dont il ne reste aujourd’hui que des fragments épars. De fait, bien peu de pièces anciennes d’orfèvrerie nous sont parvenues, sinon dans des états le plus souvent lacunaires ou bien très remaniés. Plusieurs raisons historiques peuvent expliquer cet état de fait, au premier rang desquelles figure le besoin de récupérer, lors de la période révolutionnaire, les matériaux précieux de ces objets envoyés à la fonte. Le milieu tou-rangeau ne fait pas exception à la règle, même s’il convient également de souligner l’impor-tance des destructions des Huguenots survenues entre mai et juin de l’année 1562. En effet, ces derniers pillèrent la majeure partie des plus importants trésors religieux de la ville, tels ceux du monastère Saint-Martin1, de la cathédrale Saint-Gatien2 ou encore de l’abbatiale de Marmoutier3. Les procès-verbaux des événements, publiés en 1863 par l’archiviste du dépar-tement d’Indre-et-Loire, Charles de Grandmaison, relatent la destruction des nombreuses châsses (dont celle de saint Martin) et des autres ustensiles liturgiques4. Mais ils soulignent également la richesse des églises tourangelles en joyaux d’orfèvrerie en cette seconde moitié du xvie siècle5. Si les œuvres viennent donc à manquer, en revanche, les documents d’archives, qu’il s’agisse de chartes, de comptes royaux ou encore d’inventaires, évoquent la longue tradi-tion de création somptuaire de la ville. En effet, dès 1275, le roi Philippe III fait rédiger une charte afin de lutter contre l’usage et la circulation de faux poinçons tourangeaux6. À la fin
1 Lelong (C.), La basilique Saint-Martin de Tours, Chambray-lès-Tours, 1986, p. 114.2 Andrault-Schmitt (C.), La cathédrale de Tours, La Crèche, 2010.3 Grandmaison (C. de), « Inventaire des reliques et de l’argenterie de la sacristie de Marmoutier en 1505 », Bulletin
de la Société archéologique de Touraine, I, 1868-1870, p. 31-32 et surtout Martène (E.), Histoire de l’abbaye de Marmoutier. 1104-1792, t. 2, publiée par l’abbé C. Chevalier, dans Mémoires de la Société archéologique de Touraine, vol. XXV, 1875, p. 373-376. Je remercie ici Thomas Creissen pour ces informations. Cf. également Chapu (P.), « Le trésor de Marmoutier », dans Art, objets d’art, collections. Hommage à Hubert Landais, Paris, 1987, p. 168-170.
4 Grandmaison (C. de), Procès-verbal du pillage par les Huguenots des reliques et joyaux de Saint-Martin de Tours en mai et juin 1562, Tours, 1863.
5 Grandmaison (C. de), « Notice sur les anciennes châsses de Saint-Martin de Tours », Bulletin de la Société archéologique de Touraine, I, 1868-1870, p. 110-123.
6 « Philippus Dei gratia Francorum rex, amicis et fidelibus suis ac universis justiciariis in regno Francie constitutis […]. Cum nobis datum sit intelligi quod non nulli aurifabri in locis et potestatibus vestri commorantes, in vasis
162
fréd
éric
tixi
erdu xiiie siècle, les pièces orfévrées en provenance de la ville étaient ainsi déjà suffisamment renommées pour engendrer l’apparition de contrefaçons.
Pour la période comprise entre 1460 et 1530 environ, les différents témoignages textuels et les rares œuvres conservées ou bien documentées semblent se rejoindre sur un point essentiel : l’orfèvrerie tourangelle connaît sa période d’apogée7. La présence de riches commanditaires dans le Val de Loire, tels le roi et son proche entourage, à l’instar d’une classe bourgeoise enrichie par le commerce, favorisent incontestablement l’émergence de la corporation des orfèvres au sein de la ville de Tours aux prémices de la Renaissance.
Un premier corpus d’œuvres « à la fazcon de Tours »
Malgré les nombreuses disparitions, quelques œuvres « à la fazcon de Tours » comme le précisent certains documents, permettent d’avoir un aperçu de la production somptuaire tourangelle dans le cours des années 1500. Lors de son couronnement en 1461, Louis XI commande à André Mangot – premier d’une longue lignée d’orfèvres-émailleurs qui s’implante à Tours8 – un imposant buste-reliquaire de sainte Marthe9. Terminée en 1463, l’œuvre est payée selon les comptes royaux 3000 écus d’or et transportée la même année à la collégiale royale de Tarascon, sanctuaire de dévotion de la sainte10. Cinq ans plus tard, le roi juge le reliquaire trop petit et demande au même orfèvre d’agrandir le buste, avant de faire à nouveau appel à Mangot en 1476 pour que ce dernier appose un socle précieux, orné des principales scènes émaillées de la vie de la sainte. Achevée en 1478, la pièce en or massif est considérée, avec le chef de saint Loup de Troyes (1503)11, comme l’une des plus belles réalisations d’orfèvrerie de la fin du xve siècle. Conservé jusqu’à la Révolution dans le trésor de l’église tarasconnaise, le buste connaît par la suite les vicissitudes d’une époque troublée puisqu’il est offert à la Nation en 1794 avant d’être envoyé à la Monnaie de Marseille un an plus tard. Un acte de vente, daté du 11 germinal An III (soit le 31 mars 1795) cède le précieux reliquaire « au citoyen Etienne Olombel », moyennant le paiement de « sa valeur intrinsèque en écus et la moitié en sus »12. Néanmoins, l’achat semble finalement ne pas avoir lieu et la trace du buste de sainte Marthe
argenteis que fabricant ponunt signum simile signo quod aurifabri Castri Turonensis in operibus suis ponunt et ponere consueverunt […] ». Grandmaison (C. de), Documents inédits pour servir à l’histoire des arts en Touraine, Paris, 1870, p. 242.
7 Ibid., p. XXVI-XXVII. Plus récemment, voir l’ouvrage fondamental Chevalier (B.), Tours, ville royale 1356-1520, Paris-Louvain, 1975, notamment p. 342-345.
8 Giraudet (E.), Les artistes tourangeaux, Tours, 1885 (rééd. Lormaye, 2000), p. 280-283. Hans (ou Jehan ?) Mangot succède au précédent et réalise une statuette de saint Maurice pour le chapitre cathédral d’Angers. Farcy (L. de), « Hans Mangot, orfèvre tourangeau (xvie siècle) », Bulletin de la Société archéologique de Touraine, III, 1874-1876, p. 236-238. Enfin, un Pierre Mangot obtient la commande de la couronne d’or utilisée lors des obsèques de Louis XII.
9 Chevalier (C.), « Châsse de sainte Marthe donnée à Tarascon par Louis XI et exécutée par André Mangot, orfèvre de Tours », Bulletin de la Société archéologique de Touraine, III, 1874-1876, p. 13.
10 Pour l’historique complet de la commande du buste-reliquaire, voir surtout Lapeyre (A.), Louis XI mécène dans le domaine de l’orfèvrerie religieuse, Nogent-Le-Rotrou, 1986, notamment p. 98-110. Plus récemment, voir Cassagnes-Brouquet (S.), Louis XI ou le mécénat bien tempéré, Rennes, 2007, p. 230-234 et Frizet (Y.), « Les apports culturels de deux grands princes français en Provence, René d’Anjou et Louis XI », Connochie-Bourgne (C.), Gontero-Lauze (V.) dir., Les arts et les lettres en Provence au temps du roi René, Aix-Marseille, 2013, p. 141-157, notamment p. 150.
11 Ouvrage réalisé par l’orfèvre troyen Jean Papillon. Sur le chef-reliquaire de saint Loup de Troyes, voir Brault-Lerch (S.), Les orfèvres de Troyes en Champagne, Genève, 1986, p. 228.
12 Grandmaison ( J. M.), Église Sainte-Marthe à Tarascon de Provence, 2e éd. complétée et mise à jour, Tarascon, 1984, p. 27.
163
les arts somptuaires à tours
se perd à Paris dans les dernières années du xviiie siècle13. Malgré cette disparition, l’œuvre réalisée par l’orfèvre tourangeau Mangot est connue par plusieurs représentations iconographiques14. Dès le début du xviie siècle, le reliquaire est le sujet d’un imposant tableau de dévotion, très proba-blement réalisé pour la cathédrale d’Arles, et appartenant aujourd’hui aux collections du musée de Cluny15 (fig. 1). Sainte Marthe y apparaît portant une couronne fleurdelisée. Sur un large socle prennent place, en émaux translucides sur basse-taille, les différents épisodes de sa vie. À ses côtés, Louis XI est agenouillé, les mains jointes en prière, en signe de dévotion. Deux séries d’inscriptions sont présentes sur le pourtour du buste, dont l’une précise que « Rex Francorum Ludovicvs vndeci-mus hoc fecit fieri opus anno dni MCCCCLXXVIII »16. De structure traditionnelle17, l’œuvre était donc d’une très grande qualité, reflet d’un véritable savoir-faire du maître-orfèvre tourangeau18. Elle constituait également un jalon important dans la quête de monumentalité, en cette fin de Moyen Âge, d’un type d’objets dévotionnels, culminant avec le fameux buste-reliquaire de saint Lambert de Liège du début du xvie siècle.
13 Rolland (H.), « La Monnaie de Marseille pendant la Révolution », Revue numismatique, IX, 1946, p. 183-184.14 Notamment par le biais de plusieurs gravures des années 1650-1700. Cf. Lapeyre (A.), op. cit., 1986, fig. 4 et 5.15 Inv. Cl. 9286 (en réserve). Dim. : H. 88 cm × L. 69 cm. Vachon (M.), « L’état actuel du musée de Cluny »,
Gazette des Beaux-Arts, t. XVI, 1877, p. 389-390.16 « Louis XI roi des Français, fit faire cet ouvrage l’an du Seigneur 1478 ». Grandmaison (J. M.), op. cit., 1984, p. 27.17 Voir Tomasi (M.), « L’or, l’argent, la chair : remarques sur l’usage de la couleur dans les bustes reliquaires
en métal du xive siècle », Boudon-Machuel (M.), Brock (M.) et Charron (P.) dir., Aux limites de la couleur. Monochromie et polychromie dans les arts (1300-1600) (actes du colloque international organisé par l’INHA et par le CESR, 12 et 13 juin 2009), Turnhout, 2011, p. 133-140 ainsi que ibid, « Il busto di Sant’Agata a Catania e i reliquiari a busto medievali », Tixier (F.) dir., Sant’Agata. Il reliquiario a busto. Nuovi contributi interdisciplinari, Catane, 2014, p. 23-41.
18 Dans la seconde moitié du xixe siècle, un riche bourgeois de Tarascon décide de faire réaliser une réplique du buste-reliquaire de sainte Marthe. En cuivre doré, l’œuvre est encore visible aujourd’hui dans la collégiale (fig. 2).
Fig. 1 - Anonyme, Buste-reliquaire de sainte Marthe de Tarascon, début du XVIIe siècle, Paris, musée de Cluny © RMN
Fig. 2 - Copie du XIXe siècle du buste-reliquaire de sainte Marthe, église, Tarascon
164
fréd
éric
tixi
er
La seconde œuvre qui peut être rattachée à ce premier corpus bien documenté est la nef de sainte Ursule19, un cadeau offert par le maire et les échevins de Tours à la reine Anne de Bretagne, lors de son entrée solennelle dans la ville le 26 novembre 1500 (fig. 3). Les récents travaux de Michèle Bimbenet-Privat20 et de Thierry Crépin-Leblond21 ont souligné l’intérêt de cette pièce pour l’étude de l’orfèvrerie tourangelle dans la mesure où il s’agit de la seule œuvre conservée portant le poinçon « aux deux tours couronnées », associé à la lettre « R » (fig. 4), que l’on identifie tantôt à Pierre Rousseau (ou Robin Rousseau ?), tantôt à Raymond Guyonnet22, deux orfèvres actifs à Tours à la fin du xve siècle. Ce dernier, en particulier, est d’ailleurs payé en
19 La nef est aujourd’hui conservée dans les collections du Palais du Tau à Reims. 20 Bimbenet-Privat (M.), « L’orfèvrerie de François Ier et de ses successeurs d’après des inventaires inédits de 1537,
1563 et 1584 conservés aux Archives nationales », Bulletin de la Société de l’Histoire de l’Art français, année 1995, 1996, p. 41-67, notamment p. 46-47.
21 Bresc-Bautier (G.), Crépin-Leblond (T.), Taburet-Delahaye (E.) dir., France 1500. Entre Moyen Âge et Renaissance (cat. exp., Paris, 6 octobre 2010-10 janvier 2011), notice 31, p. 105, fig.
22 Cf. Verlet (P.), « les poinçons des reliquaires de la Sainte-Épine et de Sainte-Ursule à Reims », Bulletin de la Société nationale des Antiquaires de France, 1937, p. 139-140. Plus récemment, cf. Arminjon (C.), Lavalle (D.) dir., 20 siècles en cathédrales (cat. exp.), Paris, 2001, p. 460. Je remercie Maxence Hermant pour m’avoir transmis la photographie du poinçon de la nef.
Fig. 3 - Nef-reliquaire de sainte Ursule, Tours, vers 1500 et remaniements postérieurs, Reims, Palais du Tau
Fig. 4 - Poinçon « aux deux tours couronnées » avec la lettre « R », nef de sainte Ursule, Reims, Palais du Tau. Cliché Maxence Hermant
165
les arts somptuaires à tours
janvier 1501, deux cents écus d’or pour avoir réalisé « un navire enrichi tout autour de pavoiz à la devise de la reine »23. À l’origine, la nef est un décor de table, sans doute pour désigner la place d’une personnalité de haut rang24. En 1505, l’œuvre connaît un premier remaniement, à la demande d’Anne de Bretagne, qui charge l’orfèvre blésois Henry Duzen, de la transformer en reliquaire de sainte Ursule et des Onze mille Vierges. Au cours du xvie siècle, elle subit à nouveau plusieurs restaurations avant d’être offerte, le 13 février 1575, à la cathédrale de Reims lors du sacre d’Henri III. S’il ne subsiste de la nef que peu d’éléments originels (notamment le vaisseau de cornaline et le mat), du moins est-il possible de souligner, là encore, son exceptionnelle qualité, reflet d’une production somptuaire de prestige en ce début des années 150025.
Moins connue est une petite croix-reliquaire du bois de la Vraie Croix (?) en argent doré, de quarante centimètres de hauteur, datée du second quart du xvie siècle26 (fig. 5). Elle appartenait au
23 Giraudet (E.), op. cit., 1885, p. 215.24 Et non, comme on l’a souvent écrit, pour ranger les condiments et autres serviettes ; l’œuvre étant trop fragile.
Je remercie Thierry Crépin-Leblond pour cette information.25 Braem (A.), « Anne de Bretagne - Art entre memoria, représentation et mobilier », Braem (A.), Mariaux (P.-A.)
dir., À ses bons commandements… La commande artistique en France au xve siècle, Neuchâtel, 2002, p. 309-373, notamment p. 317.
26 Je remercie Guy Du Chazaud, CAOA d’Indre-et-Loire pour m’avoir transmis des photographies de l’œuvre.
Fig. 5 - Croix-reliquaire, vers 1520-1530 (?), Tours, église Notre-Dame-La-Riche, cl. G. du Chazaud
166
fréd
éric
tixi
er
trésor de l’abbaye de Beaumont-lès-Tours27, avant d’être offerte en 1828, par la dernière abbesse de la communauté Marie-Agnès de Virieu, à l’église Saint-Saturnin28. Après la désaffection de l’édi-fice, l’objet est alors transféré à Notre-Dame-La-Riche. De moindre envergure que les deux pièces précédemment citées, la croix-reliquaire est néanmoins ornée sur son avers, d’un intéressant décor de rinceaux feuillagés et de trois motifs gravés, représentant un agneau mystique, un aigle avec un phylactère et un ange portant les instruments de la Passion (fig. 6). Au revers, sont présents les mêmes rinceaux feuillagés accompagnés de quatre médaillons d’émail translucide bleu profond qui laisse apparaître, le monogramme du Christ à la graphie élégante. Enfin, des feuillages ciselés et en semi-relief ornent le nœud du reliquaire. Dès 1888, Léon Palustre proposait une datation de l’œuvre dans les années 1520-153029, sous l’abbatiat de Françoise de Marafin30, datation qui semble corres-
27 La Chronique de l’abbaye évoque la présence en 1629 d’une « vraye croix d’argent doré ». Grandmaison (C. de), Chronique de l’abbaye de Beaumont-lez-Tours, Tours, 1877, p. 106.
28 Palustre (L.), Mélanges d’art et d’archéologie. Objets exposés à Tours en 1887, Tours, 1888, notice V, p. 9-10. La croix-reliquaire conservait différentes reliques dans des cavités et dans sa partie centrale (de la Vraie Croix, de saint Luc, de sainte Marguerite…).
29 Ibid., p. 9.30 Sainte-Marie (A. de), Histoire généalogique et chronologique de la Maison Royale de France…, 2, Paris, 1726, p.
418 : « Il y a dans l’abbaïe de Beaumont contre le mur dans le chœur, une épitaphe de cuivre, de sœur Françoise de Marafin, abbesse en 1519 et premiere reformatrice de ce monastère, qui déceda le 1 avril 1554, et à qui succeda Charlotte de la Tremoille ».
Fig. 6 - Croix-reliquaire, détail des rinceaux végétaux, vers 1520-1530 (?). Cliché G. du Chazaud
167
les arts somptuaires à tours
pondre aux motifs ornementaux de la croix31, même si cette dernière a subi plusieurs remaniements postérieurs (couronne d’épines, cavités vitrées…). En l’absence d’un poinçon, il s’avère difficile de rattacher cet objet à un centre précis de production ; sa typologie – avec les extrémités tréflées – étant courante dès le xive siècle. Toutefois, la décoration soignée, la présence d’un émail translucide de qualité et le fait qu’elle appartenait à une abbaye locale laissent à penser que la croix-reliquaire est issue d’un atelier tourangeau.
Une provenance similaire pourrait également être proposée pour le reliquaire de la côte de saint Éloi, aujourd’hui conservé à la basilique Saint-Martin32 (fig. 7). Daté de la seconde moitié du xve siècle, l’objet en cuivre, que l’on rattache aux œuvres dites de « dinanderie »33, reste une fois encore difficilement attribuable à la production tourangelle dans la mesure où
31 Les minces rinceaux et les feuillages peu développés du décor de la croix-reliquaire ne sont pas sans rappeler ceux présents dans l’ornementation du cloître de la collégiale Saint-Martin (dont le chantier s’est interrompu en 1519). Guillaume ( J.), « Les débuts de l’architecture de la Renaissance à Tours », Chancel-Bardelot (B.), Charron (P.), Girault (P.-G.), Guillouët ( J.-M.) dir., Tours 1500. Capitale des arts (cat. exp.), Tours, 2012, p. 93-96. Voir également Thomas (É.), « L’originalité des rinceaux français », Guillaume ( J.) dir., L’invention de la Renaissance, Paris, 2003, p. 177-186.
32 À la fin du xixe siècle, le reliquaire est conservé à l’Hôtel-Dieu Saint-Gatien de Tours. Cf. Palustre (L.), op. cit., 1888, notice IV, p. 7-8.
33 Cf. Notin (V.) dir., Cuivres d’orfèvres. Catalogue des œuvres médiévales non émaillé des collections publiques du Limousin (cat. exp.), Limoges, 1996.
Fig. 7 - Reliquaire de la côte de saint Eloi, seconde moitié du XVe siècle, Tours, basilique Saint-Martin © coll. J. Doucet - INHA
168
fréd
éric
tixi
eraucun décor n’est présent sur le reliquaire. De même, l’inscription en lettres gothiques carrées, qui se déploie sur le phylactère du pied, n’offre pas de caractères significatifs. Cependant, il convient de signaler la présence dès le xiie siècle d’une église placée sous le vocable du patron des orfèvres et qu’en 1446, Jehan Gillebert fait reconstruire à ses frais, la chapelle dédiée à saint Éloi sans doute pour abriter des reliques du saint34.
D’une vaste production d’orfèvrerie évoquée par les sources textuelles, seules quelques pièces éparses ont donc été conservées. Si elles donnent un (modeste) aperçu de la création somptuaire à Tours autour des années 1500, ces œuvres permettent également de questionner le statut social et l’influence des maîtres-orfèvres tourangeaux au sein de la « ville-capitale », et plus largement dans le domaine royal, à une époque charnière, entre un Moyen Âge finissant et le début des Temps modernes.
Les orfèvres tourangeaux autour de 1500 : statuts, réseaux et rayonnement artistique
Entre les années 1460 et 1530, environ quatre-vingts orfèvres demeurent dans la ville de Tours35. Ce nombre est loin d’être négligeable une fois comparé, pour la même période, à la ville de Nantes – proche par sa structure et le nombre de ses habitants (soit entre 14 000 et 16 000 per-sonnes36) – qui n’en compte qu’une vingtaine37. Mais, tous ne sont pas originaires de la région du Val de Loire : ainsi, trouve-t-on un Conrad (ou Conrat) de Cologne38, actif entre les années 1493 et 150539. Beaucoup d’entre eux, tels Étienne Boucault, Jehan Charruau, Jehan Lambert, Jehan Poissonnier ou encore Pierre Rousseau mettent en place de longues dynasties d’orfèvres, ratta-chés à la Maison royale ou bien travaillant pour l’élite sociale de la ville40. De fait, le métier d’or-fèvre se structure autour d’un système corporatif : le 20 mai 1413, une ordonnance de Charles VI accorde des statuts aux orfèvres tourangeaux, confirmés en janvier 1470 par Louis XI41, puis une nouvelle fois par François Ier en 154242. La corporation prend alors pour blason « D’azur à une sainte Anne de carnation vêtue d’or sur gueules, assise et montrant à lire à la sainte Vierge, contournée aussi de carnation, vêtue d’argent » (fig. 8), un thème iconographique rare dans les armoriaux de l’époque43. Elle possède également dans l’église paroissiale Saint-Hilaire, et pour
34 La chapelle fut consacrée le 21 décembre 1446 en présence de l’archevêque de Tours. Grandmaison (C. de), op. cit., 1870, p. 257.
35 Ce chiffre s’appuie sur les différentes publications des xixe et xxe siècles, d’Eugène Giraudet, Charles de Grandmaison et de Bernard Chevalier, notamment.
36 Matz ( J.-M.), « Couvents mendiants et polycentrisme religieux dans les cités épiscopales de la province ecclé-siastique de Tours (xiiie - début du xvie siècle) : état de la question », dans Expériences religieuses et chemins de perfection dans l’Occident médiéval. Études offertes à André Vauchez par ses élèves, Paris, 2012, p. 311-333, notam-ment p. 312.
37 Muel (F.) dir., L’orfèvrerie nantaise : dictionnaire des poinçons de l’orfèvrerie française, Paris, 1989.38 Chevalier (B.), op. cit., 1975, p. 342.39 Giraudet (E.), op. cit., 1885, p. 79. Cf. également Archives nationales KK83, f. 129v. (trésorerie de la reine Anne
de Bretagne). Je remercie Tania Lévy pour m’avoir signalé cette mention.40 La Morinerie (Baron de), « Pierre de Lacourt, orfèvre de Tours », Archives de l’art français, V, 1857-1858,
p. 367-368.41 Pastoret (Marquis de), Ordonnances des Rois de France de la troisième race, XVII, Paris, 1820, p. 379 sqq.42 Chauvigné (A.-A.), Histoire des corporations d’arts et métiers de Touraine, Tours, 1885, p. 23.43 Cette iconographie renvoie peut-être au thème plus général de la transmission du savoir et de l’apprentissage
du métier, à l’instar de sainte Anne qui éduque la Vierge en lui apprenant à lire. Notons également que sainte
169
les arts somptuaires à tours
son propre usage liturgique, un coffre fermé par quatre clés contenant divers objets religieux pour la messe44.
Si Hélène Noizet a évoqué la présence, dès la fin du xie siècle, de boutiques d’orfèvres sur l’actuelle place de Châteauneuf45, les registres paroissiaux et municipaux de la ville renferment pour les périodes plus tardives, des renseignements topographiques pré-cieux quant aux lieux d’habitation et de commerce de ces artisans. En effet, ces derniers se concentrent pour l’essentiel, au sein de trois paroisses importantes de la cité royale : Saint-Pierre-du-Boile, Saint-Hilaire/Saint-Vincent et Saint-Saturnin (comme à Nantes)46. À titre d’exemples, les frères Gallant et la famille Contant, orfèvres de plusieurs rois, possèdent des maisons et des ateliers rue de la Scellerie47, tandis que les Mangot ha-bitent à partir de 1501, rue Traversaine dans la paroisse Saint-Pierre-du-Boile48. Grâce à leurs affaires floris-santes, certains maîtres s’enrichissent. Par le biais de nombreuses donations en argent ou en objets précieux – autrement dit par une pratique d’évergétisme –, ils montrent ainsi leur nouveau statut social : vers 1470, l’orfèvre Thomas de Saint-Pol offre à l’abbaye de Saint-Julien une importante statue-re-liquaire de sainte Catherine en argent doré49. De même, André Mangot réalise en 1473 une châsse en miniature de sainte Marthe, qu’il dépose à Saint-Saturnin, l’église de sa paroisse50. Mais l’ascen-sion sociale des orfèvres tourangeaux se traduit également par des alliances matrimoniales entre membres de ladite corporation, d’armuriers ou encore de peintres promis à de belles carrières. Dans les années 1520, Gacian Boucault, « orfèvre et bourgeois de Tours », marie sa fille Jehanne à Jean Clouet, peintre et futur valet de chambre du roi. Un acte notarial, en date du 6 juin 1522, signale
Anne est, avec saint Éloi, la patronne des orfèvres. Charland (P. V.), « Les anciennes “gildes” ou confréries de Sainte-Anne », Revue canadienne, 31, 1895, p. 662-666. Cf. également Lacroix (P.), Seré (F.), Histoire de l’orfèvrerie-joaillerie et des anciennes communautés et confréries d’orfèvres-joailliers de la France et de la Belgique, Paris, 1850, p. 170, fig. 99 et Moor (L.), L’orfèvrerie civile de la Jurande de Tours et ses poinçons sous l’Ancien Régime, Paris, 2011, fig. 36. Sur ce thème iconographique apparu au xive siècle, cf. Sheingorn (P.), « “The Wise Mother”: The Image of St. Anne Teaching the Virgin Mary », Gesta, XXXII-1, 1993, p. 69-80.
44 On connaît plusieurs inventaires des pièces d’orfèvrerie conservées dans ce coffre, inventaires qui furent réalisés par les maîtres-jurés de la corporation Pierre Durant, Pierre Grillon et Guy Lehutel entre 1538 et 1562. Giraudet (E.), op. cit., 1885, p. 142-143, p. 209 et p. 258.
45 Noizet (H.), La fabrique de la ville. Espaces et sociétés à Tours (ixe-xiiie s.), Paris, 2007, p. 398.46 Tixier (F.), « Des orfèvres… aux pelletiers : prolégomènes à l’étude du commerce du luxe à Nantes à la fin du
Moyen Âge », Faucherre (N.), Guillouët ( J.-M.) dir., Nantes Flamboyante, Nantes, 2014, p. 169-178. Il est intéressant de noter que les orfèvres tourangeaux se concentrent dans des habitations qui sont quelque peu éloignées des grands cours d’eau, portant nécessaires au nettoyage des matériaux. À Nantes, en revanche, ils résident surtout dans la ville, près des points d’eau passante.
47 Betgé (M. A.), « L’atelier des frères Gallant, orfèvres de Tours », Mémoires de la Société des Sciences et Lettres de Loir-et-Cher, 28, année 1930, 1931, p. 82.
48 Giraudet (E.), op. cit., 1885, p. 280.49 Ibid., p. 365-366.50 Ibid., p. 280.
Fig. 8 - Blason de la corporation des orfèvres de Tours © coll. J. Doucet - INHA
170
fréd
éric
tixi
ermême que le riche beau-père de Clouet avait fourni à son gendre, divers bijoux comme garantie d’achat d’une rente en grains51.
Bourgeois fortunés, plusieurs orfèvres accèdent même à la petite aristocratie : Thomas de Saint-Pol, déjà mentionné, est le premier à être anobli. Orfèvre de la reine Charlotte de Savoie, il est élu échevin de la ville en 1471, une position qui lui permet d’acheter le fief de Jallanges52. Le second est le maître Claude Contant, actif dans les premières décennies du xvie siècle53. Marié à Simonne Charruau – elle-même fille et petite-fille d’orfèvres tourangeaux –, il conçoit et/ou réalise de nombreux chefs-d’œuvre dont le tombeau de l’évêque de Luçon Lancelot du Fau, ac-compagné d’un aigle-lutrin émaillé, tous deux « à l’enticque », en septembre 152354. Sa réussite professionnelle lui permet d’acquérir de nombreuses possessions immobilières dans la ville, dont une boutique rue de la Scellerie et un imposant corps de logis situé dans la paroisse Saint-Pierre-du-Boile, rue du « Signe ». Il achète également une seigneurie rurale (sur la commune de Saint-Martin-le-Beau55 ?) et prend alors le patronyme de sire Claude Contant, sieur de la Tousche56.
Premier commanditaire de pièces d’orfèvrerie, le roi n’est évidemment pas le seul à faire travailler la corporation des orfèvres de Tours. L’aristocratie, la classe bourgeoise et les com-munautés religieuses de la ville participent, pour une large part, à son essor. Ainsi, les ducs de la Trémoïlle par exemple, commandent de la vaisselle d’argent aux maîtres Jean Bodin, Guillemin Poissonnier, Charles Faulcon et son fils Louis57. Anne de Laval, femme du vicomte de Thouars, achète au défunt Pierre Durant, « demeurant audict lieu et ville de Tours, bon orfeuvre et no-table marchant, bien estimé et fort expert en son art (…) », des bijoux, une saincte Anne, divers calices et autres croix en or58. Les abbayes de Saint-Martin, de Saint-Julien et le chapitre cathédral se fournissent également en ustensiles liturgiques, à l’instar de plusieurs autres édifices religieux du Val de Loire. De fait, la renommée de la production tourangelle dépasse très rapidement les seules enceintes de la cité et l’on vient de tout l’Anjou pour acheter des pièces somptuaires : entre 1498 et 1505, la fabrique de l’église collégiale de Bueil envoie des « procureurs […] vac-qué à Tours marchandez (…) » un calice à Jehan Fournier et une croix d’argent accompagnée d’un « benoistier » (bénitier) à l’orfèvre Jehan Chausser59. En 1509, le chapitre de la cathédrale d’Angers préfère s’adresser au maître tourangeau Hans Mangot plutôt qu’à un Angevin, dont dépend la jurande, pour réaliser une imposante statue d’argent doré de saint Maurice destinée à orner le maître-autel60.
51 Salmon (A.), « Nouvelles notes sur les Clouet », Archives de l’art français, III, 1853-1855, p. 290-295.52 Giraudet (E.), op. cit., 1885, p. 365.53 Sur cet orfèvre, voir Ardouin-Weiss (I.), « L’orfèvre tourangeau Claude Content, mort en 1532 », Mémoires de
l’Académie des Sciences, Arts et Belles-Lettres de Touraine, t. 25, 2012, p. 135-143.54 Grandmaison (C. de), « La tombe de Lancelot du Fau, évêque de Luçon et l’orfèvre Claude Content (1523) »,
Réunion des sociétés des Beaux-Arts des départements, XXII, 1898, p. 461-467.55 Ardouin-Weiss (I.), op. cit., 2012, p. 140.56 Giraudet (E.), op. cit., 1885, p. 88.57 Trémoïlle (L. de la), Chartrier de Thouars : documents historiques et généalogiques, Paris, 1877, p. 219-221.58 Id., Les La Trémoïlle pendant cinq siècles. Charles, François et Louis III 1485-1511, Nantes, 1894, p. 29-30.59 Bourassé ( J.-J.), « Notice historique et archéologique sur l’ancienne église collégiale de Bueil », Mémoires de la
Société archéologique de Touraine, VII, 1855, p. 190, 192.60 Farcy (L. de), op. cit., 1874-1876, p. 236-238.
171
les arts somptuaires à tours
Ayant un rôle artistique majeur, les orfèvres ont également un poids politique important au sein de l’élite dirigeante de la ville ou dans l’administration royale. Proches du souverain, certains semblent même être chargés de missions diplomatiques : ainsi trouve-t-on une énigmatique men-tion de paiement dans les comptes royaux, datée de 1479, évoquant l’envoi de « Jehan le Fortier, orphevre demeurant à Tours, pour un voyage que le roy luy a fait faire en Bretagne, pour aucunes choses qui fort touchent le fait du Roy, dont il ne veult autre declaration en estre faite (…) »61. Si beaucoup de membres de la corporation de saint Éloi vivent et travaillent dans la cité touran-gelle, d’autres en revanche voyagent au gré des diverses commandes ou bien par décision royale. Le cas le plus exemplaire est le repeuplement de la ville d’Arras-Franchise, décidé par Louis XI entre 1479 et 1481, pour lequel un certain Jehan Barbier « povre (…) ouvrier que de grosserie » est rapidement passé maître-orfèvre pour y être envoyé de force62. Les frères Gallant sont quant à eux d’abord présents à Bourges, à l’instar de Jean Gilbert, avant de rejoindre Tours pour s’y installer définitivement63. En 1491, les comptes municipaux berruyers signalent un séjour de huit jours d’un J[ehan] Chopillon « pour avoir et achepter de luy un reliquaire d’or et d’argent par la ville (…) »64. Il s’agit très probablement du maître-orfèvre Jehan Chapillon, par ailleurs célèbre pour avoir réalisé – en collaboration avec le sculpteur Michel Colombe –, la médaille en or de l’effigie de Louis XII, à l’occasion de son entrée solennelle à Tours en 150165. D’autres mentions d’archives signalent le passage d’orfèvres tourangeaux à Paris, au Mans, à Blois, à Amboise ou encore à Lyon, en cette seconde moitié du xve siècle66. De même, des liens étroits unissent la ville de Nantes et la cité tourangelle, en particulier sous Jean V de Bretagne qui y fait plusieurs séjours. Les ducs, grands amateurs d’objets de luxe, ont très certainement passé plusieurs commandes d’œuvres aux orfèvres de Tours67. Ainsi, lorsqu’en mars 1490, Alain d’Albret pille le château de Nantes, il s’empare d’une partie du trésor ducal. Parmi les pièces somptuaires emportées par le prétendant éconduit d’Anne de Bretagne figurent des reliquaires d’or et de la vaisselle d’apparat ainsi que plusieurs coffres contenant de riches parures dont un « papillon d’or, le corps d’ice-luy d’une coque de perle, garny sur les elles de deux petiz rubiz et de deux petites esmeraudes (…) »68. Ces cassettes (avec leur contenu ?) avaient été achetées par le grand maître d’hôtel de la maison des ducs, Tanneguy IV Duchastel, pour le compte du duc François II. L’inventaire conservé évoque des coffres « de la faczon de Tours, rond et fort, que feu Messire Tanneguy
61 Grandmaison (c. de), op. cit., 1870, p. 281. En cette période de profonde crise politique entre le duché et le Royaume de France, Louis XI envoie-t-il un diplomate en Bretagne ? En effet, certains orfèvres ont parfois joué le rôle d’agents de liaison auprès des autres grandes cours d’Europe.
62 Lachese (P.), « Translation d’angevins et de tourangeaux à Arras sous Louis XI », Mémoires de la Société impé-riale d’agriculture, sciences et arts d’Angers, IX, 1866, p. 257-293, notamment p. 289.
63 Verlet-Réaubourg (N.), Les orfèvres du ressort de la Monnaie de Bourges, Genève, 1977, p. 253-254.64 Girardot (Baron de), Les artistes de la ville et de la cathédrale de Bourges, Nantes, 1861, p. 27.65 France 1500, op. cit., 2010, notice 29, p. 104. Plus récemment ibid., notice 10, p. 69 (notice I. Villela-Petit). 66 Chevalier (B.), op. cit., 1975, p. 345.67 Comme le fait remarquer Pascale Charron « le savoir-faire des artistes tourangeaux, dont l’écho est notable
jusqu’à Nantes pour les œuvres d’orfèvrerie, est aussi reconnu pour la peinture ». Charron (P.), « La peinture à Tours après Jean Fouquet », Tours 1500, op. cit., 2012, p. 239.
68 Nicolliere (S. de la), « Description du chapeau ducal, de l’épée de parement, de la nef de table, et d’un grand nombre de bijoux du trésor des ducs de Bretagne d’après des titres originaux et inédits », Bulletin de la Société archéologique de Nantes et du département de la Loire-Inférieure, I, année 1859-1861, 1862, p. 395-458.
172
fréd
éric
tixi
erDuchastel fist tenir (venir) de Tours, pour mectre les riches bagues (…) »69. Puis, c’est au tour d’Anne de Bretagne70 de commander aux célèbres orfèvres Gallant, une corbeille à deux anses « tenues par hommes et femmes sauvaiges71 » et de recevoir une petite nef d’argent, réalisée par les mêmes artisans, lors de son entrée dans la ville en 149172. Avec le rattachement du duché de Bretagne à la couronne de France, les liens artistiques dans le Val de Loire s’intensifient, favorisés en cela par la présence d’une haute aristocratie proche du pouvoir royal, en particulier lorsque le vicomte de Thouars, Louis II de la Trémoïlle est nommé amiral de Bretagne et capitaine de la ville de Nantes73.
Pour la création somptuaire tourangelle, les années 1500 sont synonymes de grande prospérité due à la présence de riches commanditaires royaux, aristocrates et bourgeois, mais également à des facteurs économiques favorables. Entre Paris qui reste l’un des plus grands centres de produc-tion d’orfèvrerie du royaume74 et avec l’émergence de Lyon75, les orfèvres de Tours ont su habi-lement profiter de l’essor de leur ville, bénéficiant de fait d’une élévation de leur statut social. La renommée et le savoir-faire de ces maîtres-orfèvres tourangeaux dépassent alors très largement les seules enceintes de la cité, et malgré le progressif désintérêt du pouvoir royal pour le Val de Loire, on passe encore commande, dans les premières décennies du xviie siècle, de pièces d’orfè-vrerie en « fasson de Tours »76.
69 Ibid., p. 436. Voir également Barrier (M.-F.), L’Hermine de Lumière. Mémoires d’Anne de Bretagne, Paris, 1992, p. 21 et 44 ainsi que Tixier (F.), op. cit., 2014, p. 175.
70 Sur les collections d’Anne de Bretagne, voir la contribution de Caroline Vrand dans le présent ouvrage.71 Giraudet (E.), op. cit., 1885, p. 195.72 Chevalier (B.), op. cit., 1975, p. 344, note 155.73 Maître (L.), « Le gouvernement de la Bretagne sous la duchesse Anne, deux fois reine de France d’après les
mandements de sa chancellerie (1489-1513) », Annales de Bretagne, 32, 1917, p. 1170-171. Plus récemment, Vissière (L.), « Sans poinct sortir hors de l’orniere ». Louis II de la Trémoille 1460-1525, Paris, 2008, p. 491.
74 Bimbenet-Privat (M.), Les orfèvres parisiens de la Renaissance 1506-1620, Paris, 1992.75 Chalabi (M.) dir., L’orfèvrerie de Lyon et de Trévoux du xve au xxe siècle, Paris, 2000. Plus récemment, cf. Lyon
Renaissance. Arts et Humanisme, (cat. exp. Lyon, Musée des Beaux-Arts, 2015).76 « Un bassin fasson de Tours (…) » (11 mai 1623). Dangibeaud (C.), La Maison de Rabaine, publication de la
Société des archives historiques de la Saintonge et de l’Aunis, La Rochelle, 1891, p. 118. Cf. également Gauléjac (B. de), Histoire de l’orfèvrerie en Rouergue, Rodez, 1938, p. 88 (pour un calice tourangeau).
Table des matières
7 | Marion Boudon-Machuel & Pascale Charron Art et société à Tours au début de la Renaissance
Les artistes et la ville
15 | David Rivaud Tours 1500, aspects topographiques
29 | Jean-Luc Porhel Aménagement et décor du premier hôtel de ville de Tours, autour de 1500
41 | Alain Salamagne Louis XI et l’architecture brique et pierre en Val de Loire
59 | Xavier Pagazani Les demeures aux champs des maires de Tours (1462-1528), lieux de délices du « jardin de France »
75 | Jean-Marie Guillouët Pour la micro-histoire d’un savoir-faire technique : le témoignage de l’enluminure tourangelle du xve siècle
Commande royale, commandes de luxe
93 | Pierre-Gilles Girault Quelques artistes tourangeaux et leurs clients en quête d’identité : de Jean Fouquet au Maître de Claude de France (Éloi Tassart ?)
115 | Mara Hofmann Un chef-d’œuvre de Jean Poyer peu connu : Les Heures Petau de la collection Weiller
129 | Nicholas Herman Bourdichon héraldiste
147 | Alexandra Zvereva Jehannet Clouet : étranger, peintre, officier royal, notable de Tours
161 | Frédéric Tixier Les arts somptuaires à Tours autour de 1500 : état de la question
173 | Caroline Vrand Reflets d’or et d’argent. Orfèvres et brodeurs tourangeaux au service de la cour royale vers 1500
185 | Éric Reppel Les armuriers à Tours de 1480 à 1520
Circulation des modèles et des artistes
197 | Teresa D’Urso La diffusion du style all’antica à Tours : de Jean Bourdichon au Maître de Claude de France
213 | Pascale Charron Un exemple de la circulation des modèles dans les ateliers d’enluminure tourangeaux au début du xvie siècle : le manuscrit 2104 de la Bibliothèque Municipale de Tours
233 | Évelyne Thomas Le répertoire ornemental « Tours 1500 »
241 | Jean Guillaume L’architecture « antique » à Tours : premières expériences