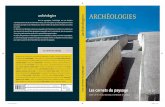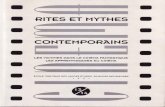Les seuils du paysage: la culture française de l’exploration du Tibet (In: Le Paysage à travers...
Transcript of Les seuils du paysage: la culture française de l’exploration du Tibet (In: Le Paysage à travers...
Table des maTières
Introductionpar Louis bergès et Martine François ........................................................................................ 3
Jourdain-annequin ColetteRegards sur quelques paysages héracléens : entre géographie et imaginaire grec ........................... 5
Vuillemin NathalieD’un pittoresque inhumain : le paysage américain dans le Voyage autour du monde de Louis-Isidore Duperrey (1822-1825) .............................. 13
lagarde-FouqueT AnnieLes volcans de Mme Pfeiffer (1797-1858)....................................................................................... 25
lemaîTre Jean-LoupLe paysage dans l’Iter Helveticum de dom Calmet (1748) ......................................................... 45
ThéVoz SamuelLes seuils du paysage : la culture française de l’exploration du Tibet ........................................... 61
ThibaulT Gabriel-RobertPratique et théorie du paysage dans l’œuvre de Bernardin de Saint-Pierre .................................. 73
CaradeC NathalieLe paysage instantané : le choix du haïku ................................................................................... 87
meldolesi TommasoTransformations et intériorisations du paysage en chemin de fer ................................................. 93
Les seuils du paysage : la culture française de l’exploration du Tibet
Samuel ThévozUniversité de Lausanne
Extrait de : Louis Bergès et Martine François (dir.), Le Paysage à travers les voyageurs et les écrivains, éd. électronique, Paris, Éd. du Comité des travaux historiques et scientifiques (Actes des congrès des sociétés historiques et scientifiques), 2012.
Cet article a été validé par le comité de lecture des Éditions du Comité des travaux historiques et scientifiques dans le cadre de la publication des actes du 135e Congrès national des sociétés historiques et scientifiques tenu à Neuchâtel en 2010.
Dans une situation d’exploration, c’est-à-dire, au sens où il convient de comprendre la notion historiquement, dans une confrontation à un ailleurs géographique, aux confins des territoires connus par la science et saisis par la culture propre, il paraît au prime abord peu évident que le terme « paysage » puisse donner sens à pareille expérience des limites, sans se voir redéfini dans le même mouvement.Pour se donner les moyens de cerner les enjeux du problème posé d’emblée ici, il convient de se demander si les explorateurs appréhendent les régions qu’ils découvrent en termes de paysage, ou du moins de cerner la valeur que revêt pour eux le paysage. S’agirait-il alors d’une projection de schèmes configurants, impliquant que l’on rapporte l’inconnu au connu, en termes, notamment, de catégories esthétiques1 ? Ou au contraire les explo-rateurs manifestent-ils des processus cognitifs se rapportant moins à une « assimilation » qu’à une « accommodation », selon le distinguo piagétien2, donnant ainsi à la notion du paysage une extension plus large ? Bien entendu, les enjeux de cette enquête se rapportent à la définition même de ce qu’est le « paysage ». La théorie du paysage a insisté depuis les travaux d’Augustin Berque sur la nécessité de penser ensemble les polarités constitutives de la notion3. Afin de gagner en clarté, je me référerai ici à un projet de recherche récent qui propose que le paysage soit modélisé sous la forme de quatre pôles en tension, schémati-sables selon deux axes égaux et croisés perpendiculairement : ce sont les pôles physique, subjectif, symbolique et intersubjectif4. Tout en soulignant la nécessité de tenir compte de
1. On reconnaît ici le soubassement théorique du problème formulé précédemment : le paysage est-il réductible aux théories culturalistes en tant qu’il peut être conçu comme une reproduction de schèmes culturels prédéterminés par l’art (modèle perspectif, catégories esthétiques), contestant de fait que le paysage puisse ouvrir à la question d’une altérité ? Ici, l’ailleurs ne pourrait être appréhendé que dans les termes et selon les schémas d’une culture propre, induisant une immuable reproduction du même. Voir dans cette perspective A. Roger, Nus et Paysages : essai sur la fonction de l’art et Court traité du paysage ; M. Conan, « Postface » ; A. Cauquelin, L’Invention du paysage et, pour des questions qui nous intéresseront ici, P. Descola, « Les sociétés exotiques ont-elles des paysages ? ». On l’aura compris, la présente réflexion s’interroge sur les conditions d’une évolution et les possibilités d’un changement à partir de la notion même de paysage.2. Je reprends cet usage du distinguo à P. Descola, Par-delà nature et culture, 2e par., « Structures de l’expérience », p. 135-182.3. Voir A. Berque, Le Sauvage et l’Artifice : les Japonais devant la nature. Berque conçoit un modèle triangulaire du paysage, articulant pôles biophysique, subjectif et symbolique.4. Voir N. Backhaus, C. Reichler et M. Stremlow, Paysages des Alpes : de la représentation à l’action ; synthèse thé-matique relative au thème de recherche I « Processus de perception et représentation des paysages et des habitats des Alpes », p. 41-43. En fonction de l’objet spécifique sur lequel s’est constitué ce modèle, les auteurs proposent différentes actualisations, ou dimensions du paysage. Ce sont les dimensions corporelle et sensorielle (accentuant le pôle « subjectif »), esthétique (accent sur le pôle « culturel » dans ses relations avec les pôles « subjectif » ou « intersub-jectif »), identificatoire (on peut parler alors du paysage comme « lieu de mémoire »), politique (relation entre le pôle « physique » et « sociétal », le paysage comme un « bien » commun), économique (le « paysage » considéré comme ressource) et écologique (la gestion du paysage dans la perspective de l’équilibre biosphérique). Ce modèle général est accueillant ; ainsi différentes dimensions se font jour en fonction de l’objet étudié. Par conséquent, le
Le Paysage à travers les voyageurs et les écrivains 62
ces « pôles » du paysage, je chercherai à montrer la diversité des actualisations possibles et la variabilité empirique de la notion de paysage telles que le modèle théorique esquissé permet de les penser.Mon enquête s’orientera de fait autour de deux ensembles de questions que je traiterai conjointement. Dans un premier temps, il s’agit de se demander : jusqu’où va la notion ? Quelles en sont les vertus heuristiques ? Ou en d’autres termes : quels sont les seuils du paysage d’un point de vue « théorique » ? Dans un second temps, je voudrais montrer qu’un tel questionnement autour du paysage amène à interroger des processus historiques en termes de fractures et d’évolutions microhistoriques et de temporalités hétérogènes. En d’autres termes alors : quels sont les seuils du paysage d’un point de vue « historique » ?
Les seuils cognitif et épistémique du paysage
Pour rendre sensible la démarche que je suivrai ici et ses enjeux propres, et avant d’évo-quer les spécificités du corpus sur lequel se fonde mon enquête, corpus constitué de récits français d’exploration du Tibet du tournant des xixe et xxe siècles, il est encore nécessaire de préciser à quel titre celui-ci prend place dans le champ de questionnement évoqué. L’ex-ploration française du Tibet est ici non seulement un « cas » servant à la démonstration, mais un « objet » historique complexe pour lequel la notion de paysage apparaît comme une clé de compréhension fondamentale, si l’on tient compte précisément de la labilité de la notion. J’aimerais ainsi montrer les « dimensions » du paysage qui s’actualisent dans ce que j’appelle la culture française de l’exploration du Tibet5 et tenter de comprendre leur évolution sur la durée d’une période relativement brève, mais qui, dans sa condensation même, se révèle particulièrement instructive en ce qui concerne la complexité et l’évolu-tion rapide des représentations du Tibet en termes de paysage. Je pourrais ainsi résumer mon enquête en une question : qu’ont fait au paysage les explorateurs français du Tibet ?On l’aura compris, les questions d’ordre théorique posées d’entrée de jeu prennent sens non in abstracto mais dans l’épaisseur de l’histoire, en fonction non seulement de conditions de possibilité déterminantes (localisables dans l’outillage mental et le bagage cognitif des explorateurs, lesquels, à la fin du xixe siècle, sont imprégnés d’une véritable « culture du paysage »), mais en fonction surtout de « possibilités d’expérience » s’offrant au hasard de situations concrètes et ponctuelles, et invitant à penser, en même temps que la question du paysage, la question de la « découverte ». C’est bien ici que prend corps le problème posé en introduction. Les explorateurs au Tibet comptent parmi les derniers « explorateurs », au sens propre, de l’histoire mondiale : en effet, le Tibet représente dans la seconde moitié du xixe siècle une ultime terra incognita, alors même que l’on proclame le recouvrement de la planète et que s’imposent à toutes les consciences « les limites de notre cage », pour reprendre la formule du géographe Jean Brunhes en 19106. Le Tibet est un ultime « blanc de la carte », tant en termes géographiques qu’imaginaires, qui, à vrai dire, a longtemps représenté peu d’intérêt pour les nations européennes en termes de colonisation, avant de se retrouver au cœur des luttes géopolitiques que l’on a appelées le « Grand Jeu », lequel
corpus étudié ici, historiquement circonscrit, permettra de faire apparaître des dimensions qui ne recoupent pas, ou partiellement seulement, les dimensions énumérées ci-dessus, relatives à un contexte géographique, historique et culturel spécifique.5. Voir S. Thévoz, « Le paradoxe tibétain : Théodore Pavie et les explorateurs du Tibet ». La période, comprise entre le voyage du premier missionnaire français à pénétrer au Tibet, le célèbre père Huc, et ceux du dernier explo-rateur français à proprement parler, Jacques Bacot, s’étend de 1846 à 1912. Mais, du voyage de Huc à la première exploration scientifique menée par Gabriel Bonvalot (1889) s’écoulent quarante-trois années… Pour le récit de Huc, voir ses Souvenirs d’un voyage dans la Tartarie et le Thibet, pendant les années 1844, 1845 et 1846 [1850].6. J. Brunhes, Au seuil de l’année 1910 : les limites de notre cage.
Les seuils du paysage : la culture française de l’exploration du Tibet63
se joue en Asie dans la dernière décennie du siècle entre les Empires britanniques, russes et chinois7. C’est sur le fond de ce basculement historique que je me suis intéressé plus spécifiquement aux explorateurs français du Tibet. Contrairement à leurs homologues bri-tanniques, pour qui le paysage tibétain relève avant tout d’une dimension « territoriale8 », les enjeux de leurs explorations ne sont que lointainement d’ordre géopolitique et relèvent d’une orientation prioritairement « scientifique9 ».Au cours du xixe siècle, on le sait, le paysage devient, après Humboldt, une notion clé de la pensée géographique10. Les explorateurs français sont ainsi d’abord tributaires des travaux de Reclus11 – c’est le cas de Gabriel Bonvalot12 – et, pour les suivants, Fernand Grenard13 et Jacques Bacot14, de Vidal de La Blache qui met au centre de la discipline le « paysage » comme catégorie de connaissance, au point où l’on parle de la géographie vidalienne comme d’une « science du paysage15 ». Dans le même mouvement, du débat qui oppose géographes vidaliens et sociologues durkheimiens autour de la question du « milieu » dans l’Anthropogéographie de Friedrich Ratzel16, émerge l’autonomisation des sciences humaines, graduellement méfiantes, avec Marcel Mauss, envers les principes déterministes hérités du xixe siècle17.Si, rapidement esquissés, apparaissent ici les linéaments d’une histoire des « sciences », il s’agit moins d’y rapporter de manière rigide les explorateurs – quoiqu’ils témoignent parfois avec une pertinence étonnante de cette évolution épistémologique des sciences géographiques et anthropologiques – que de comprendre le rôle fondamental qu’a joué le paysage au sein de la culture française de l’exploration du Tibet dont j’ai évoqué trois des noms les plus importants parmi un corpus d’une petite dizaine de récits18.
7. Voir, pour le contexte géopolitique du « Grand Jeu », P. Hopkirk, Trespassers on the Roof of the World: the Race for Lhasa ; pour la position du Tibet comme État-tampon et les relations anglo-tibétaines, voir A. McKay, Tibet and the British Raj: the Frontier Cadre, 1904-1947.8. Voir S. Thévoz, « Exploration et colonialisme : les valeurs du paysage dans les récits des voyageurs français et anglais au Tibet ».9. En France, l’intérêt naît moins d’enjeux géopolitiques que d’un programme de recherche (pour parler en nos termes actuels) orientaliste (T. Pavie, « Le Thibet et les études thibétaines »). Accéder au Tibet, c’est accéder aux traductions de textes canoniques du bouddhisme indien, disparus dans leur version sanskrite. L’explorateur devient globalement une figure nécessaire de la connaissance « orientaliste » du Tibet – ou de ce que Pavie appelle les « études thibétaines », qui deviendront la tibétologie au début du xxe siècle.10. Voir J.-M. Besse, « Entre modernité et postmodernité : la représentation paysagère de la nature » et « La géo-graphie dans le mouvement des sciences au tournant du siècle ».11. Notons que Reclus s’inscrit dans la tradition de la géographie allemande. Voir, pour sa présentation du Tibet, É. Reclus, Nouvelle géographie universelle : la Terre et les hommes, t. VII, L’Asie orientale.12. G. Bonvalot, De Paris au Tonkin à travers le Tibet inconnu.13. J.-L. Dutreuil de Rhins, Mission scientifique dans la haute Asie, 1890-1895 et F. Grenard, Le Tibet : le pays et les habitants.14. J. Bacot, Dans les Marches tibétaines, autour du Dokerla, novembre 1906-janvier 1908 et Le Tibet révolté. Vers Népé-makö, la Terre promise des Tibétains.15. Je suis en cela les études de V. Berdoulay, La Formation de l’École française de géographie : 1870-1914. Voir de P. Vidal de La Blache lui-même, « De l’interprétation géographique des paysages ».16. Outre la synthèse de V. Berdoulay, « The Vidal-Durkheim Debate », voir É. Durkheim, « Friedrich Ratzel, Anthropogéographie. Compte rendu » ; P. Vidal de La Blache, « Les conditions géographiques des faits sociaux », et « Rapports de la sociologie avec la géographie ».17. Je me réfère en premier lieu à l’« Essai sur les variations saisonnières des sociétés eskimos », écrit en collabo-ration avec H. Beuchat (1905). Voir parallèlement B. Karsenti, L’Homme total : sociologie, anthropologie et philosophie chez Marcel Mauss et C. Tarot, De Durkheim à Mauss, l’invention du symbolique : sociologie et science des religions.18. H. d’Orléans, Du Tonkin aux Indes, janvier 1895-janvier 1896 ; E. Roux, Aux sources de l’Irraouaddi : voyage de Hanoï à Calcutta par terre ; A.-F. Legendre, Le Far-West chinois : au Yun-Nan et dans le massif du Kin-Ho (Fleuve d’or) ; J. Dessirier, À travers les Marches révoltées : Ouest chinois : Yu-Nan, Se-Tchouen, Marches thibétaines ; H. d’Ollone, Les Derniers Barbares : Chine, Tibet, Mongolie ; A. David-Néel, Journal de voyage, vol. I, Lettres à son mari : 11 août 1904-27 décembre 1917.
Le Paysage à travers les voyageurs et les écrivains 64
Le premier des explorateurs français au Tibet, Gabriel Bonvalot, témoigne bien d’une ten-sion entre la processualité de la connaissance et la représentation paysagère. De tous les explorateurs évoqués, il est sans doute celui qui développe le plus amplement dans son récit l’événement qu’est l’arrivée dans l’inconnu, où l’homme n’est plus guidé par aucune carte19. Cette expérience de l’inconnu est amplifiée dans les hauts plateaux du Tibet sep-tentrional, par où Bonvalot pénètre dans le pays alors interdit aux étrangers. Évoquons l’extrême aridité des contrées découvertes, pour cette raison quasi inhabitées, si ce n’est par des nomades durant l’été, et traversées par de rares caravanes marchandes. On devine les marches longues et pénibles dans des conditions climatiques et atmosphériques faisant du voyage une expérience de survie. Cette aridité subie aux dépens de l’explorateur se double des métamorphoses permanentes du terrain sous les effets du climat ainsi que des phénomènes géomorphiques actifs. C’est alors l’impossibilité de traduire son expérience en termes de paysage qui apparaît dans le récit de l’explorateur. L’expérience paysagère ne semble guère correspondre ici à la catégorie rassurante du pittoresque, à celle invitant à la contemplation du beau, ni même aux délicieux vertiges et aux agréables espèces d’hor-reur qu’était le sublime pour les voyageurs romantiques dans les Alpes20. Pourtant, l’explorateur ne renonce pas à la description. Se font jour alors les processus cognitifs par lesquels l’explorateur parvient à se réorienter, à attribuer un sens à son expé-rience. Ces processus sont consignés au plus près de l’expérience sensorielle et percep-tive, comprise dans toute sa complexité proprioceptive et sensori-moteur. Ce sont là les « dessous du paysage », ses dimensions proprement phénoménologiques : un paysage inchoatif se dessine. Au seuil du « Tibet inconnu », l’explorateur élabore ainsi comme un procès de la connaissance, ce qui prête à penser qu’il se montre potentiellement ouvert à une remise en cause des modèles d’intelligibilité préalables. Mais, au terme de ce procès, Bonvalot opère comme un saut heuristique entre connaissance et représentation. D’abord impossible, le paysage s’impose en revanche brutalement dans ses formes les plus conve-nues selon des modalités picturales flamboyantes, éreintées par le xixe siècle romantique, et selon des critères scientifiques en passe de tomber en désuétude21. Ainsi est rabattue sévèrement la valeur épistémique du voyage de Bonvalot. Il semble ici que l’expérience critique de l’espace ne débouche sur aucune possibilité de représentation neuve, et que l’explorateur se replie in fine sur des modalités descriptives dont l’ampleur surprenante cache mal l’inadéquation. Dans leur extrémisme même, ces deux dimensions du paysage peinent à communiquer l’une avec l’autre et s’ouvrent sur un espace vide où le Tibet appa-raît comme privé de toute réalité intrinsèque. Le titre du récit, À travers le Tibet inconnu,
19. Voir G. Bonvalot, De Paris au Tonkin à travers le Tibet inconnu, p. 183-184 et 188. Les lignes qui suivent se proposent comme une synthèse des éléments en présence dans le récit de Bonvalot. Pour plus de précisions, voir S. Thévoz, Un horizon infini : explorateurs et voyageurs français au Tibet, 1846-1912, chap. ii.20. Dans les récits des explorateurs et, avant eux, des missionnaires, le paysage tibétain invite à en souligner la démesure, laquelle se traduit par une comparaison contrastive avec les Alpes et une disqualification des catégories esthétiques usuelles du paysage alpin. Avant les explorateurs dont il est question ici, la description du paysage tibétain bute sur son irreprésentabilité ; la négativité même du paysage tibétain est au fondement d’une rhétorique que l’on peut dire « apophatique » qui se retrouve des récits des premiers missionnaires jésuites à Jules Verne en passant par Pavie et Reclus. Voir S. Thévoz, « Figures d’espaces tibétaines : le voyage au Tibet et les sciences de l’homme à la Belle Époque. De Gabriel Bonvalot à Jacques Bacot ». On comprend donc que « dire le paysage tibétain » double, pour les explorateurs, l’enjeu premier de leurs missions, à savoir « combler les blancs de la carte ». Voir P. Forêt, « Les blancs du Tibet : histoire des solutions adoptées pour résoudre “le plus magnifique problème de la géographie” ». Le heurt de l’expérience suscite une difficulté à dire ce qui, ailleurs et en d’autres conditions, se serait traduit en termes paysagers, difficulté que l’écriture cherche à surmonter. On voit en quoi il convient de parler ici de « seuil du paysage » : seules des « ressemblances de famille » permettent de rapporter l’expérience vécue au paysage. Or, dans le même mouvement, c’est au moment où le paysage se dégage des implicites, où il doit être décrit, réécrit, qu’il prend sens, dans toute la processualité que l’expression engage. Voir, pour une réflexion sur de pareils problèmes dans le cadre de l’écriture ethnographique, L. Bonoli, Lire les cultures : la connaissance de l’altérité culturelle à travers les textes.21. Voir G. Bonvalot, De Paris au Tonkin à travers le Tibet inconnu, p. 183-184, 188 et 442 et suiv.
Les seuils du paysage : la culture française de l’exploration du Tibet65
désignerait ainsi moins une entrave à la connaissance surmontée qu’un état que le voyage n’aurait guère perturbé. À la fois trop proche et trop distant, Bonvalot aurait, sur un trajet de 3 000 kilomètres parcourus à pied, traversé le Tibet à l’aveugle.Pensée dans le cadre de l’histoire des sciences, cette ambivalence témoigne d’un moment critique des procédures de connaissance, temporairement et artificiellement résorbées. Pensée dans l’histoire des représentations du Tibet, elle ne prête guère à conséquence, les stéréotypes sur le pays et ses habitants étant mécaniquement reproduits22. Pensée dans le cadre plus restreint d’une culture française de l’exploration du Tibet, elle marque l’écart entre un discours sur le Tibet et la déroute des connaissances que suscite la rencontre in situ et in vivo d’une altérité.Historiquement, le récit de Bonvalot peut être pensé comme un premier moment de la culture française de l’exploration du Tibet. Si l’on peut parler ici d’une « culture », c’est que les explorateurs se répondent les uns aux autres ; et selon le principe de l’expérimen-tation qui régit toute entreprise de découverte, ils envisagent les uns après les autres de nouvelles voies d’accès au Tibet, dans une tension entre savoirs acquis, modèles prédéter-minés et hasard empirique. À son tour, Fernand Grenard23, deuxième explorateur notoire du Tibet, membre de la mission Dutreuil de Rhins en haute Asie et scripteur du voyage, entre dans le pays interdit par une voie inédite, parallèle à celle de Bonvalot quelques années plus tôt. Il témoigne lui aussi d’une même procédure cognitive au moment où disparaissent les repères usuels ; mais, pour ce contemporain de Vidal de La Blache, le paysage s’avère un ensemble de signes géographiques dont il peut décoder les critères, en fonction d’un savoir global sur l’histoire des phénomènes géologiques que révèlent, comme à livre ouvert, les aspects de la roche, sa texture, les formes de la montagne. Il s’efforce ainsi de délimiter des unités géographiques, sur le modèle vidalien de la région24 et de classer les « paysages » en fonction de leur âge géologique. Il découvre ainsi, à son entrée au Tibet, la ligne de fracture entre ce que le géologue viennois Edouard Suess25, à la même époque, appelait le « Faîte primitif » et le « Môle sérindien », selon une modéli-sation préfigurant, toute précaution gardée, la tectonique des plaques d’Alfred Wegener26.
Le voyage de Grenard s’affiche ainsi comme une remontée dans l’histoire de la Terre, pour laquelle le Tibet apparaît comme un lieu primordial. Or, c’est précisément la valeur mythique d’un axis mundi que Grenard prête aux « pyramides de cristal », sur lesquelles « la désolation du monde apparaissait […] dans son linceul blanc27 ». Ainsi, selon une modalité distincte de ce qu’on trouve chez Bonvalot, les descriptions de paysage dans le récit de Grenard proposent comme un contrepoint à sa démarche scientifique. En effet, celles-ci se développent en une rêverie, aux accents de poésie parnassienne28, sur un
22. Voir, par exemple G. Bonvalot, De Paris au Tonkin à travers le Tibet inconnu, p. 130. J’anticipe ici quelque peu sur un problème qui, d’annexe, deviendra crucial dans l’histoire des représentations du paysage tibétain.23. Dutreuil de Rhins avait engagé Grenard comme ethnographe et orientaliste. Mais l’explorateur est tué lors d’une échauffourée dans le Tibet oriental, et Fernand Grenard assume seul la publication des résultats scientifiques de la mission. Il poursuit ensuite une carrière diplomatique. Grenard est chargé de la présentation de la haute Asie et du Tibet dans la Géographie universelle de Vidal de La Blache et Gallois. Voir F. Grenard, « La haute Asie ».24. On sait que Vidal développe le modèle de son approche géographique dans Le Tableau de la géographie de la France en 1903. Mais ses nombreux travaux précédents font, selon V. Berdoulay, remonter la naissance de « l’école française de géographie » aux années 1870.25. E. Suess, La Face de la Terre. L’édition originale est publiée entre 1883 et 1909 sous le titre Das Antlitz der Erde. Vidal fonde sa conception de la géographie humaine sur la géologie de Suess. Voir P. Vidal de La Blache, « Des caractères distinctifs de la géographie ».26. On sait que les travaux d’Alfred Wegener, dont la théorie de la dérive des continents remonte à 1912, ne seront reconnus que tardivement dans les années soixante.27. F. Grenard, Le Tibet : le pays et les habitants, p. 51.28. Le voyageur fait référence au poème de Leconte de Lisle, « Les Hurleurs », publié dans les Poésies barbares en 1862 (ibid., p. 49-50).
Le Paysage à travers les voyageurs et les écrivains 66
univers minéral précédant toute vie végétale, animale, humaine. Sa stérilité serait le témoin de temps préhistoriques et l’homme y serait comme naturellement relégué au statut d’épi-phénomène29. Après l’impossible paysage de Bonvalot, la culture française de l’exploration du Tibet semble évoluer vers une appropriation du paysage tibétain en termes sublimes, mais un sublime abouché à une nouvelle compréhension de l’étendue terrestre, que l’on peut appeler une « systématique biologique ». La poétique géologique de Grenard développe ainsi conjointement deux dimensions du paysage. D’abord sa dimension épistémique ; ici, en effet, la description « sublime » permet de saisir et transmettre par l’image poétique une « réalité » orogénique à la complexité de laquelle seul le géographe initié peut accéder. Paradoxalement, en même temps qu’il revêt une valeur épistémique sans précédent, le paysage tibétain se voit investi d’une dimension mythique et sacrée. L’image du Tibet que donne Grenard, tout entière assimilée à un paysage souverain et monolithique, aura une fortune durable jusqu’à nos jours30 en termes d’histoire des représentations. Dans le même mouvement, le pays se voit comme « vidé de ses habitants31 », privé de toute réalité cultu-relle. Là encore, l’expérience paysagère semble mobiliser des procédures cognitives rele-vant de l’ordre de l’assimilation plutôt que de l’accommodation ; elle semble se confondre in fine avec une « culture propre ».
Le seuil culturel du paysage
L’on peut alors se demander quels sont les obstacles qui s’imposent au dessillement du regard des explorateurs. Il faut pour l’expliquer se rapporter à une configuration des savoirs mise en place dès 1847 dans le programme scientifique de Théodore Pavie, que je considère comme le point de départ, précoce, de la culture française de l’exploration du Tibet32. Chez Pavie, le Tibet n’a de valeur qu’en tant qu’il est le palimpseste culturel du bouddhisme indien, dont il héritait au viiie puis au xie siècle. C’est ce que j’appelle le « paradoxe tibétain » : héritier pour les orientalistes de la plus haute civilisation d’Asie, le Tibet en apparaît comme le dépositaire passif. Frustes et primitifs, à l’image de leur pays, les Tibétains, loin de conserver et développer la brillante culture indienne, en ont singé les formes et dégradé le sens sous les traits du « lamaïsme ». Seuls les livres intéressent l’orientaliste ; le géographe et l’ethnographe ne trouvent au Tibet que des populations dépourvues de toute culture propre.Ce portrait doublement négatif des Tibétains – tour à tour évincés du champ de vision ou réduits à la barbarie la plus inculte – est, on le comprend, directement lié aux conceptions du « milieu » qui sont au fondement des théories déterministes marquant le xixe siècle. Les premiers explorateurs français du Tibet, eux, ne remettent pas en cause, selon des critères épistémologiques différents au sein d’une pensée globalement géographique, ces impli-cations cachées de leur saisie du paysage tibétain. Or, il revient à un troisième voyageur, Jacques Bacot, de problématiser cette évidence des récits des explorateurs, marquant ainsi un troisième seuil du paysage tibétain et le dernier « moment » de la culture française de l’exploration du Tibet. En effet, pas moins que ses prédécesseurs, Bacot pense le Tibet en termes de paysage. Mais dès son premier récit publié à l’issue de son premier voyage, il prend ses marques par rapport aux représentations héritées de Bonvalot et de Grenard et
29. Cette dimension perceptible dans le récit du voyage sera développée plus tard dans les termes du discours scientifique dans la monographie sur le Tibet de la Géographie universelle.30. Ce type de représentation est identifiable dans l’histoire des représentations du Tibet. Voir P. Bishop, The Myth of Shangri-La: Tibet, Travel Writing and the Western Creation of Sacred Landscape.31. Je reprends ici librement l’expression de Laurent Tissot à propos des Anglais dans les Alpes (L. Tissot, Naissance d’une industrie touristique : les Anglais et la Suisse au xixe siècle).32. T. Pavie, « Le Thibet et les études thibétaines ».
Les seuils du paysage : la culture française de l’exploration du Tibet67
à leur attitude vis-à-vis des enjeux de l’exploration. À ce titre, son premier récit peut se lire comme une dénonciation des approches monolithiques et des projections culturelles auxquelles se sont, selon lui, complu les explorateurs à propos du paysage tibétain33. En levant le paradoxe tibétain, Bacot montre d’une part combien le Tibet est constitué d’une diversité que l’on dirait aujourd’hui écologique34, et montre d’autre part, non sans ironie, que si les Tibétains correspondent à leur pays, c’est bien dans les termes d’une diversité qui ne permet en rien de les associer de manière rigide à leur environnement35. Par un réexamen du paysage tibétain, le parcours de Bacot débouche sur la reconnaissance de la culture tibétaine.Sa démarche est bien le fruit d’une rencontre vécue in situ. Bacot n’est accompagné d’au-cun compatriote et progresse dans le Tibet avec des Tibétains, qui lui fournissent un accès à leur univers culturel36. Le paysage devient le lieu d’une démarche réflexive. Remettant en cause la valeur projective de la jouissance paysagère, l’explorateur s’interroge sur l’existence de pareille catégorie chez les Tibétains37. Chemin faisant, il gagne en familiarité avec les valeurs symboliques et sacrées auxquelles ceux-ci rapportent les caractéristiques géophysiques du monde environnant38. Son second récit approfondit considérablement la réflexion paysagère du voyageur – réflexion en action, faudrait-il préciser – et en fait plus nettement apparaître les ouvertures interculturelles. Les descriptions de paysage cèdent le pas à ce que j’appellerai des mouvements paysagers39. Si les paysages inchoatifs de Bonvalot et de Grenard marquaient un seuil que les explorateurs n’enjambaient guère, Bacot en montre la pleine vertu heuristique. Le passage d’un col donne accès à un monde toujours nouveau, tout en s’articulant de manière indéfectible au monde parcouru avec ses com-pagnons tibétains. À la dimension phénoménologique de l’expérience vécue du paysage s’emboîte la dimension interculturelle40. Cette expérience du paysage tibétain est signalée comme vécue ensemble, de telle sorte que la situation du voyage ouvre sur une partici-pation pleine au monde de l’autre. Ce que Bacot perçoit dans les termes du paysage se rapporte à ce que le géographe Augustin Berque a appelé récemment une « médiance41 » : dans les récits de Bacot apparaissent ainsi les dimensions d’un sens du milieu tibétain.Ce mouvement initié, le voyageur suit, plus qu’il ne mène, ses compagnons jusqu’à un Orient insoupçonné de l’horizon du Tibet. À un horizon externe du paysage tibétain – selon lequel le Tibet apparaîtrait comme un objet géographique ajouté aux autres unités délimitées par le géographe – se substitue un horizon interne, qui serait, pour reprendre
33. Voir J. Bacot, Dans les Marches tibétaines…, p. ii.34. Dans Le Tibet révolté, le voyageur constate : « Tous les mois, presque toutes les semaines, nous changeons de pays. Les aspects sont autres, les hommes et les coutumes aussi » (J. Bacot, Le Tibet révolté…, p. 176).35. « Pas plus que leur pays, les Tibétains ne sont barbares et incultes » (ibid., p. 93-94).36. Voir, par exemple, ibid., p. 220-221.37. Ibid., p. 306-307.38. Ce mouvement est amorcé dès son premier voyage, où il suit le chemin de pèlerinage du Dokerla. Voir J. Bacot, Dans les Marches tibétaines…, p. 58 et suiv.39. Quoique les deux aillent de pair, je préfère parler ici de « mouvement paysager » plutôt que de « paysage en mouvement ». À savoir que Bacot insiste autant sur la dimension cinétique de la perception du paysage que sur la pluralité des mondes – biophysiques et culturels – qu’articule la configuration propre à la géographie du Tibet. Cela en fait une caractéristique non seulement propre au mouvement du voyageur mais encore spécifique à la « médiance » tibétaine dans son ensemble. Voir, par exemple, le passage du col de Litang (J. Bacot, Le Tibet révolté…, p. 102), à laquelle occasion le voyageur résume : « Autant de cols, autant de surprises au-delà. » Cette disposition phénoménologique du Tibet se retrouve dans la conception même qu’ont les Tibétains de leur pays et deviendra emblématique dans la dernière étape du voyage de Bacot, dans le dernier « mouvement » qui le dirigera – sans y atteindre – vers Népémakö, horizon interne et « mythique » du Tibet.40. Ainsi la réforme, en ces moments signifiants, du sujet d’énonciation, passant du « je » au « nous » et insistant sur la valeur interculturelle de ces moments de transition.41. La « médiance » est « le sens d’un milieu ». Voir A. Berque, Médiance : de milieux en paysages.
Le Paysage à travers les voyageurs et les écrivains 68
la formule parlante de Michel Collot, comme l’envers de la table offerte au regard42. Cet horizon interne se caractérise comme une relation à l’espace spécifique à la culture tibétaine. En effet, une tradition religieuse importante envisage que, dans les plis de la surface tourmentée du Tibet se cachent des espaces encore inexplorés, et révélés en temps de crise43. Or, au moment où y pénètre Bacot, c’est bien un temps de crise que vivent les régions tibétaines limitrophes de l’empire des Qing, qui, dans un dernier soubresaut avant sa chute, cherche à reprendre son ascendant sur un territoire dont il soupçonne l’alliance menaçante avec le Raj britannique44. À son retour en France, Jacques Bacot s’imposera comme le premier représentant de la tibétologie moderne française45.
Finir ce tour d’horizon sur l’inscription de la fin de la culture française de l’exploration du Tibet dans une congruence simultanée d’événements multiples, d’amplitudes variables et de dynamiques parfois contraires, permet de comprendre la prudence méthodologi-que à laquelle j’ai cherché à être attentif dans mon analyse du paysage dans les récits des explorateurs. Différentes temporalités interagissent, différentes « histoires » se superpo-sent. L’observation de phénomènes complexes invite à penser ensemble une histoire des savoirs, une histoire des sensibilités, une histoire des rencontres, une histoire culturelle du paysage et les expériences paysagères singulières, tout en éprouvant leur retentissement propre. Mais il convient de se méfier des « ressemblances de famille » entre une macro et une microhistoire ; si les rapports existant demandent indéniablement à être pensés, les évolutions sur le plan microscopique nous rappellent sans cesse à une pensée de la rupture fondée sur l’accident de parcours singulier et subjectif, à des expériences vécues individuelles, qui, bien plus que les grands mouvements diachroniques, paraissent don-ner sens aux heurts de l’histoire. Le paysage, envisagé dans les quatre pôles entre les-quels s’orientent les différentes dimensions dont témoignent les explorateurs au Tibet, est apparu comme un analyseur particulièrement opératoire de ces relations intriquées entre les sujets, les sociétés, les cultures et l’espace biophysique dans lequel ils évoluent conjoin-tement. Mais, en premier lieu, le paysage s’est illustré comme le modèle d’intelligibilité privilégié des explorateurs, dont la lecture chronologique a montré la permanence autant que la labilité de ce que la notion en est venue à représenter pour chacun d’eux. Or, ce n’est que mené jusqu’à ses seuils – cognitifs, épistémiques et culturels – que le paysage a pris véritablement sens dans la culture française de l’exploration du Tibet.
42. Pour le distinguo, voir M. Collot, La Poésie moderne et la Structure d’horizon.43. Voir J. Gyatso, « Down With the Demoness. Reflections on a Feminine Ground in Tibet » ; A.-M. Large- Blondeau, « Les pèlerinages tibétains » et K. Buffetrille, « “Pays caché” ou “Avenir radieux ?” : le choix de Shes rab rgya mtsho ».44. Ces événements n’ont pas été vécus sur place par l’auteur, mais sont relatés en conclusion de son second récit. À ce titre, Le Tibet révolté constitue comme l’épitaphe de la culture française de l’exploration du Tibet.45. Ainsi la fin de la culture française de l’exploration du Tibet apparaît-elle comme le renouveau de la tibétologie. Dès son retour de son premier voyage, Jacques Bacot suit les cours de sanskrit et de tibétain de Sylvain Lévi à l’École pratique des hautes études. À l’issue de son second voyage, il rédige son travail de diplôme à la même école sous la direction du même S. Lévi. Il s’agit de la traduction d’une pièce de théâtre, Drimékundan ; Bacot en avait assisté à la représentation dans l’enceinte du monastère de Gata. Il est chargé de cours en 1919 et assure l’enseignement du tibétain à l’École pratique des hautes études à la place de S. Lévi, qui fait créer une chaire de tibétain à son attention et à qui il succède comme directeur d’études en 1936, après un séjour au Sikkim en 1930-1931. Il succède en outre à Paul Pelliot, qu’il avait accompagné en 1914 dans la mission de Sibérie, à la présidence de la Société asiatique en 1946. Il développera de manière originale les études tibétaines françaises en laissant une place importante aux traditions et à la littérature populaires, dressant un tableau d’une véritable civilisation dont ses élèves, collègues et successeurs, Marcelle Lalou, Rolf Stein, Anne-Marie Blondeau, continueront d’étudier les dimensions multiples à travers l’histoire du Tibet.
Les seuils du paysage : la culture française de l’exploration du Tibet69
Résumé
Les explorateurs décrivent-ils les régions inconnues de la planète en termes de paysage ? De quel paysage parle-t-on dès lors ? Cet article désire apporter des éléments de réponse par l’analyse des récits des explorateurs français au Tibet. En effet, ces récits relatant la tra-versée des dernières terrae incognitae de l’histoire de la découverte du monde ne peuvent se comprendre indépendamment de la culture paysagère que partagent les auteurs. Or, s’il faut évoquer une tradition esthétique liée à la description de la montagne notamment, il convient avant tout de rapporter leurs descriptions du paysage tibétain tant à un contexte épisté-mologique spécifique qu’à leur expérience paysagère propre, aux franges du monde connu. L’évolution de la notion de milieu en géographie et en anthropologie en France agit directe-ment sur les représentations des explorateurs. Par ailleurs, la découverte de paysages jamais décrits et la situation interculturelle qui caractérise leurs voyages amènent les voyageurs à penser en des termes nouveaux leur relation au paysage. Ainsi, la notion même de paysage, si elle demeure signifiante, doit pourtant être reconsidérée en fonction de sa porosité même, de son ouverture possible, en fonction de l’histoire, en fonction des sujets, sur des actualisations nouvelles.
Bibliographie
Backhaus Norman, ReichleR Claude et sTRemlow Matthias, Paysages des Alpes : de la repré-sentation à l’action ; synthèse thématique relative au thème de recherche I « Processus de perception et représentation des paysages et des habitats des Alpes », Zürich, Éd. de la Haute École, 2007.
BacoT Jacques, Dans les Marches tibétaines, autour du Dokerla, novembre 1906-janvier 1908, Paris, Plon-Nourrit et Cie, 1909.
BacoT Jacques, Le Tibet révolté. Vers Népémakö, la Terre promise des Tibétains, Paris, Peuples du monde / R. Chabaud (Domaine tibétain, 3), 1988.
BeRdoulay Vincent, « The Vidal-Durkheim Debate », dans Ley David et Samuels Marwyn S. (dir.), Humanistic Geography: Prospects and Problems, Londres, Croom Helm, 1978, p. 77-90.
BeRdoulay Vincent, La Formation de l’École française de géographie : 1870-1914, Paris, Biblio-thèque nationale (Mémoires de la section de géographie, 11), 1981.
BeRque Augustin, Le Sauvage et l’Artifice : les Japonais devant la nature, Paris, Gallimard (Bibliothèque des sciences humaines, 84), 1986.
BeRque Augustin, Médiance : de milieux en paysages, Montpellier, Reclus (Géographiques), 1990.
Besse Jean-Marc, « Entre modernité et postmodernité : la représentation paysagère de la nature », dans Robic Marie-Claire (dir.), Du milieu à l’environnement : pratiques et représentations du rapport homme/nature depuis la Renaissance, Paris, Economica, 1992, p. 89-121.
Le Paysage à travers les voyageurs et les écrivains 70
Besse Jean-Marc, « La géographie dans le mouvement des sciences au tournant du siècle », dans actes du colloque « Autour de 1905 : Élisée Reclus-Paul Vidal de La Blache. Le géographe, la cité, et le monde », 5 juillet 2005, en ligne : http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00113263/en/.
Bishop Peter, The Myth of Shangri-La: Tibet, Travel Writing and the Western Creation of Sacred Landscape, Londres, The Athlone Press, 1989.
Bonoli Lorenzo, Lire les cultures : la connaissance de l’altérité culturelle à travers les textes, Paris, Kimé (Philosophie en cours), 2008.
BonvaloT Gabriel, De Paris au Tonkin à travers le Tibet inconnu, Genève, Olizane (Objectif Terre), 2008.
BRunhes Jean, Au seuil de l’année 1910 : les limites de notre cage, Fribourg, impr. de l’Œuvre de Saint-Paul, 1911.
BuffeTRille Katia, « “Pays caché” ou “Avenir radieux ? ” : le choix de Shes rab rgya mtsho », dans Kellner Birgit (éd.), Pramāṇakīrtiḥ. Papers dedicated to Ernst Steinkellner on the Occasion of his 70th Birthday, Vienne, Arbeitskreis für tibetische und buddhistische Studien (Wiener Studien zur Tibetologie und Buddhismuskunde, 70), 2007, vol. I, p. 1-22.
cauquelin Anne, L’Invention du paysage, Paris, Presses universitaires de France (Quadrige, 307), 2000.
colloT Michel, La Poésie moderne et la Structure d’horizon, Paris, Presses universitaires de France (Écriture), 2005.
conan Michel, « Postface », dans Gilpin William, Trois essais sur le beau pittoresque : sur les voyages pittoresques et sur l’art d’esquisser les paysages, Paris, Éd. du Moniteur (Le Temps des jardins, 4), 1982.
david-néel Alexandra, Journal de voyage, vol. I, Lettres à son mari : 11 août 1904-27 décembre 1917, Paris, Plon, 1975.
descola Philippe, « Les sociétés exotiques ont-elles des paysages ? », Études rurales, nos 121-124, janvier-décembre 1991, p. 151-158.
descola Philippe, Par-delà nature et culture, Paris, Gallimard (Bibliothèque des sciences humaines), 2005.
dessiRieR Jean, À travers les Marches révoltées : Ouest chinois : Yu-Nan, Se-Tchouen, Marches thibétaines, Paris, Plon-Nourrit et Cie, 1923.
duRkheim Émile, « Friedrich Ratzel, Anthropogéographie. Compte rendu », L’Année sociolo-gique, 3e année, 1898-1899, p. 551-558.
duTReuil de Rhins Jules-Léon, Mission scientifique dans la haute Asie, 1890-1895, Paris, E. Leroux, 1897-1898, 3 vol.
foRêT Philippe, « Les blancs du Tibet : histoire des solutions adoptées pour résoudre “le plus magnifique problème de la géographie” », dans Laboulais-Lesage Isabelle
Les seuils du paysage : la culture française de l’exploration du Tibet71
(dir.), Combler les blancs de la carte : modalités et enjeux de la construction des savoirs géo-graphiques (xviie-xxe siècle), Strasbourg, Presses universitaires de Strasbourg (Sciences de l’histoire), 2004, p. 173-192.
GRenaRd Fernand, Le Tibet : le pays et les habitants, Paris, A. Colin, 1904.
GRenaRd Fernand, « La haute Asie », dans Blanchard Raoul et Grenard Fernand, Géogra-phie universelle, t. VIII, Asie occidentale, Paris, A. Colin, 1929, p. 235-379.
GyaTso Janet, « Down With the Demoness. Reflections on a Feminine Ground in Tibet », dans McKay Alex (dir.), The History of Tibet, vol. I, The Early Period: to c. AD 850, the Yarlung Dynasty, Londres New York, Routledge Curzon, 2003, p. 307-321.
hopkiRk Peter, Trespassers on the Roof of the World: the Race for Lhasa, Londres, J. Murray, 1982.
huc Évariste-Régis, Souvenirs d’un voyage dans la Tartarie et le Thibet, pendant les années 1844, 1845 et 1846, Paris, Omnibus, 2001.
kaRsenTi Bruno, L’Homme total : sociologie, anthropologie et philosophie chez Marcel Mauss, Paris, Presses universitaires de France (Pratiques théoriques), 1997.
laRGe-Blondeau Anne-Marie, « Les pèlerinages tibétains », dans Jacques Claude, Pèlerina-ges en Inde, Paris, Éd. du Seuil (Sources orientales, 3), 1960, p. 199-246.
leGendRe Aimé-François, Le Far-West chinois : Kientchang et Lolotie, Chinois, Lolos, Sifans, impressions de voyage, étude géographique, sociale et économique, Paris, Plon-Nourrit et Cie, 1910.
leGendRe Aimé-François, Le Far-West chinois : au Yun-Nan et dans le massif du Kin-Ho (Fleuve d’or), Paris, Plon-Nourrit et Cie, 1905.
mauss Marcel, « Essai sur les variations saisonnières des sociétés eskimos », L’Année socio-logique, t. IX, 1904-1905, p. 39-132.
mckay Alex, Tibet and the British Raj: the Frontier Cadre, 1904-1947, Richmond, Curzon (London Studies on South Asia, 14), 1997.
ollone Henri d’, Les Derniers Barbares : Chine, Tibet, Mongolie, Paris, P. Lafitte et Cie, 1911.
oRléans Henri d’, Du Tonkin aux Indes, janvier 1895-janvier 1896, Calmann Lévy, 1898.
pavie Théodore, « Le Thibet et les études thibétaines », Revue des deux mondes, t. XIX, 1847, p. 37-58.
Reclus Élisée, Nouvelle géographie universelle : la Terre et les hommes, t. VII, L’Asie orientale, Paris, libr. Hachette et Cie, 1882.
RoGeR Alain, Nus et Paysages : essai sur la fonction de l’art, Paris, Aubier, 2001.
RoGeR Alain, Court traité du paysage, Paris, Gallimard (Bibliothèques des sciences humaines), 1997.
Le Paysage à travers les voyageurs et les écrivains 72
Roux Émile, Aux sources de l’Irraouaddi : voyage de Hanoï à Calcutta par terre, Paris, Hachette et Cie, 1897.
suess Eduard, La Face de la Terre, Paris, A. Colin, 1902-1918, 4 vol.
TaRoT Camille, De Durkheim à Mauss, l’invention du symbolique : sociologie et science des reli-gions, Paris, La Découverte (Recherches. Sér. bibliothèque du MAUSS), 1999.
Thévoz Samuel, « Figures d’espaces tibétaines : le voyage au Tibet et les sciences de l’homme à la Belle Époque. De Gabriel Bonvalot à Jacques Bacot », Versants. Revue suisse des littératures romanes, no 50, 2005, p. 37-69.
Thévoz Samuel, « Exploration et colonialisme : les valeurs du paysage dans les récits des voyageurs français et anglais au Tibet », Colloquium Helveticum. Cahiers suisses de littérature générale et comparée, no 38, Images littéraires du paysage, 2007, p. 297-320.
Thévoz Samuel, « Le paradoxe tibétain : Théodore Pavie et les explorateurs du Tibet », dans Dufief Anne-Simone (dir.), Louis, Victor et Théodore : les Pavie, une famille angevine au temps du romantisme, Angers, Presses universitaires d’Angers, 2010, p. 149-157.
Thévoz Samuel, Un horizon infini : explorateurs et voyageurs français au Tibet, 1846-1912, Paris, Presses universitaires de Paris-Sorbonne (Imago mundi, 18), 2010.
TissoT Laurent, Naissance d’une industrie touristique : les Anglais et la Suisse au xixe siècle, Lausanne, Payot (Histoire), 2000.
vidal de la Blache Paul, « Les conditions géographiques des faits sociaux », Annales de géographie, vol. XI, 1902, p. 13-23.
vidal de la Blache Paul, « Des caractères distinctifs de la géographie », Annales de géogra-phie, vol. XXII, no 124, 1913, p. 289-299.
vidal de la Blache Paul, « Rapports de la sociologie avec la géographie », Revue interna-tionale de sociologie, no 12, 1904, p. 309-312.
vidal de la Blache Paul, « De l’interprétation géographique des paysages », dans Claparède Arthur de (éd.), 9e congrès international de Géographie : Genève, 27 juil-let-6 août 1908 : comptes rendus des travaux du congrès, vol. III, Travaux scientifiques, séances des sections IX-XIV, Genève, Société générale d’imprimerie, 1911, p. 59-64.