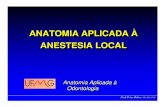Les Seml sont-elles vouées à disparaitre ?
-
Upload
univ-grenoble-alpes -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of Les Seml sont-elles vouées à disparaitre ?
LES CAHIERS DE LA DÉCENTRALISATION
Couv
ertu
re :
C1 /
B. D
aixISBN 978-2-909872-66-7 - 20,00 e
9 782909 872667
CCAS/CIAS : de l’urgence au
développement social durable
Quel financement de la
politique de logement social ?
Trimestriel N° 90 III/2011 (septembre)z
IDN
° 90
III
/201
1 (
sept
embr
e)20
,00
eIS
SN
099
8-82
89
Vinc
ent A
ubel
le z
Ber
nard
Bon
nici
z S
ébas
tien
Bram
eret
z M
artin
e Bu
rdill
at z
Xav
ier C
arpe
ntie
r-Ta
nguy
z A
uror
e De
ligne
z F
abie
n De
sage
z D
avid
Gué
rang
er z
Ant
oine
tte H
astin
gs-M
arch
adie
r
z É
ric J
ougl
a z
Pat
rick
Kann
er z
Jea
n-Pi
erre
Lay
z L
aure
nce
Lem
ouzy
z P
atric
ia L
oncl
e z
Clé
men
tine
Mar
tin z
And
rée
Miz
rahi
z A
rié M
izra
hi z
Phi
lippe
Mos
sé z
Nor
bert
Nabe
t z
Élis
e Or
tis z
Fréd
éric
Pie
rru
z V
anes
sa P
inhe
iro z
Sté
phan
e Ri
can
z C
élin
e Ro
ndol
z G
érar
d Sa
lem
z P
hilip
pe T
chen
g z
Pas
cal T
erra
sse
z L
aure
Thi
baul
t z
Fra
nçoi
s To
nnel
lier z
Zoé
Vai
llant
Un constat s’impose, celui de l’indissolubilité du lien unissant les sociétés d’économie mixte locales aux col-lectivités territoriales qui en sont les actionnaires majo-ritaires. Les sociétés ne peuvent en effet être créées que par des collectivités, pour réaliser des missions liées à la satisfaction de l’intérêt général. L’approche relation-nelle du sujet était dès lors déduite de la notion même d’économie mixte locale.
L’économie mixte locale a toujours été assimilée par le législateur au support d’une action économique souple des collectivités territoriales. Pourtant, cette position a été systématiquement remise en question depuis que le juge de l’Union européenne a refusé d’appliquer la théorie des prestations intégrées dans ces relations, assimilant de fait les sociétés d’économie mixte locales à des sociétés de droit commun devant être mises en concurrence dans leurs relations contractuelles avec les collectivités territoriales4. Prenant acte de cette juris-
prudence défavorable, les autorités françaises semblent se détourner de l’économie mixte locale, privilégiant les sociétés publiques locales à capitaux intégralement publics ou les partenariats public-privé institutionnali-sés au sein desquels l’actionnaire minoritaire serait mis en concurrence. Quant aux instances de l’Union euro-péenne, elles encouragent l’utilisation d’une société d’économie mixte d’une forme nouvelle – dénommée partenariat public-privé institutionnalisé – au sein de laquelle l’actionnariat privé est mis en concurrence lors de la création de la société. C’est à cette seule condition qu’elles autorisent le recours à la théorie des presta-tions intégrées. Cette multiplication des réformes est souvent présentée comme une menace pour la péren-nité de l’économie mixte locale dans sa forme classique. Une lecture moins radicale de ce mouvement de désaf-fection permet cependant d’en comprendre les causes et, éventuellement, d’y apporter des solutions. Les
parSÉBaStIEN BraMErEt, Maître de conférences, Membre du Groupe de Recherches en Droit Public Économique (GRDPE), Université Grenoble II
Les SEML sont-elles vouées à disparaître ?
É c o N o M i e
Les relations des collectivités territoriales avec les sociétés d’économie mixte locales (SEML)1
L’économie mixte locale est souvent présentée comme le résultat d’une alchimie entre deux milieux opposés, celui des collectivités territoriales et celui des affaires. Le précipité obtenu, la société d’économie mixte locale, serait une solution d’équilibre, à mi-chemin entre les sphères publique et privée, auxquelles elle emprunterait des caractères. Solution d’équilibre, elle ne permet pourtant pas l’instauration d’un partenariat public-privé équilibré : dotée d’une personnalité morale de droit privé, elle demeure sous l’emprise directe des collectivités territoriales. Elle illustre ainsi la tension liée à la superposition de caractéristiques difficilement compatibles au sein d’une société commerciale. Pourtant, l’économie mixte locale semble menacée par le développement de nouveaux instruments concurrents : la société publique locale2 et le partenariat public-privé institutionnalisé3. Malgré cette évolution des techniques – et du vocabulaire – la société d’économie mixte locale n’en demeure pas moins l’archétype de la structure de droit privé permettant l’institutionnalisation d’un partenariat public-privé en France. Dépassant la simple coopération contractuelle, elle permet d’en pérenniser les effets.
Pouvoirs Locaux N° 90 III/2011 w 33
É c o n o m i e
34 w Pouvoirs Locaux N° 90 III/2011
relations des collectivités territoriales avec les socié-tés d’économie mixte locales sont en effet et par nature ambivalentes. Les collectivités territoriales en sont les actionnaires majoritaires, ainsi que les principaux partenaires contractuels. C’est cette ambivalence qui est diversement appréciée par le juge administratif et le juge de l’Union européenne, entraînant un décalage entre, d’une part, une appropriation réussie des socié-tés par les collectivités territoriales et, d’autre part, une utilisation des sociétés qui demeure perfectible.
L’appropriation réussie des SEML par les collectivités territoriales L’appropriation des sociétés par les collectivités ter-ritoriales peut être considérée comme réussie dans les relations institutionnelles. Les collectivités sont les actionnaires majoritaires des sociétés d’économie mixte locales et s’adaptent progressivement à cette fonction. Elles sont de plus en plus largement assi-milées à des actionnaires de sociétés commerciales, même si elles ne sauraient se limiter à ce rôle, dispo-sant de prérogatives de contrôle renforcées sur le fonc-tionnement des sociétés.
L’assimilation des collectivités territoriales à des actionnaires et l’appropriation subséquente des tech-niques du droit des sociétés concernent en premier lieu les modalités de représentation des élus locaux au sein des sociétés. Ceux-ci ne peuvent pas, par principe, exer-cer les fonctions d’un actionnaire, car ils sont soumis à un régime spécifique d’inéligibilité et d’incompati-bilité. Par ailleurs, l’exercice de ces activités de repré-sentation peut s’avérer dangereux et a nécessité des adaptations de leur responsabilité. En second lieu, le législateur a progressivement adapté les mécanismes de financement des sociétés d’économie mixte locales pour permettre aux collectivités territoriales d’apporter des financements aux sociétés. S’éloignant du principe de l’interdiction des participations publiques dans le capital de sociétés commerciales énoncé par les lois de décentralisation en 1982, le législateur a progressi-vement étendu les exceptions, pour permettre d’abord les prises de participations et les modifications de ces participations au capital, puis l’octroi de financements plus ponctuels par des techniques inspirées du droit des sociétés. En particulier, la loi du 2 janvier 2002 a offert la possibilité de financements des sociétés par l’octroi d’avances en compte courant d’associés. Inspirée du droit des sociétés, cette technique n’en demeure pas moins sujette à un encadrement important dans les relations des collectivités territoriales avec les sociétés d’économie mixte locales. Les collectivités territoriales ne disposent pas de pouvoirs équivalents à ceux d’ac-tionnaires de sociétés commerciales.
Les collectivités territoriales ne se limitent pas au seul rôle de l’actionnaire d’une société commerciale. Elles sont également dotées de prérogatives renforcées, leur permettant de dominer tous les aspects de la vie sociétale. Elles déterminent l’objet social des sociétés, qui ne peuvent être créées que pour réaliser des mis-sions présentant un intérêt général et interviennent principalement pour le compte de leurs actionnaires majoritaires. Les collectivités territoriales actionnaires maîtrisent également l’organisation interne des sociétés et bénéficient de contrôles renforcés sur leur fonction-nement, exercés par l’intermédiaire de leurs représen-tants ou par leurs organes exécutifs. L’importance de ces pouvoirs conduit à relativiser l’efficacité des règles du droit des sociétés, en particulier lorsque l’entreprise rencontre des difficultés financières. Le rôle des collec-tivités est d’autant plus important que les actionnaires minoritaires ne sont généralement pas de véritables par-tenaires privés, mais plutôt des organismes publics ou parapublics, telle la Caisse des Dépôts et Consignations et ses filiales, chargées d’apporter un appui technique et financier aux collectivités territoriales pour la réali-sation de leur projet via la participation au capital des sociétés d’économie mixte locales. Dès lors, l’idée d’un partenariat entre le secteur public et le secteur privé demeure largement théorique, les sociétés favorisant en réalité un partenariat principalement financier entre personnes publiques.
L’implication des collectivités territoriales à tous les stades de la vie sociale souligne l’étroitesse des rela-tions. Tirant les conséquences de ce constat, le juge administratif subordonne l’intervention des sociétés à l’existence d’un intérêt public local, comme s’il s’agis-sait d’une personne publique5. Le juge financier, pour sa part, n’hésite pas à les qualifier de « démembrement » de l’un de leurs actionnaires6, voire parfois de « coquille vide » 7.
La nature particulière des relations institutionnelles des collectivités territoriales avec les sociétés d’écono-mie mixte locales les éloigne du modèle classique de la société commerciale, pour les rapprocher de simples services personnalisés de leurs actionnaires publics. Cette position devrait faciliter le recours aux sociétés par leurs actionnaires majoritaires. Pourtant, l’analyse des relations contractuelles souligne le caractère perfec-tible de leur utilisation par les collectivités territoriales.
L’utilisation perfectible des SEML par les collectivités territorialesL’utilisation des sociétés d’économie mixte locales par les collectivités territoriales par le développement de relations contractuelles demeure perfectible. Le juge de l’Union européenne et, à sa suite, le juge adminis-
É c o n o m i e
Pouvoirs Locaux N° 90 III/2011 w 35
tratif n’appréhendent pas les relations des collectivi-tés territoriales avec les sociétés dans leur ensemble, contrairement à la position du juge financier. Adoptant une approche organique de l’économie mixte locale, ils refusent de considérer la société comme un démem-brement de ses actionnaires. Se limitant à une analyse stricte de la composition du capital social, ils consi-dèrent qu’une société à capital mixte ne peut être appré-hendée comme un démembrement d’une personne publique, car celle-ci ne saurait exercer sur cette der-nière un contrôle « analogue » à celui qu’elle exerce sur ses propres services8. Elles ne peuvent pas bénéficier de la théorie des prestations intégrées, développée par la Cour de justice de l’Union européenne et permettant de qualifier les contrats conclus entre des personnes publiques et certains de leurs services dotés de la per-sonnalité morale de relation in house échappant aux obligations de mise en concurrence9. Cette position a justifié la généralisation des procédures de mise en concurrence à tout type de relation contractuelle (délé-gation de service public, marché public, concession d’aménagement, etc.).
À bien des égards, l’ambivalence des relations des collectivités territoriales avec les sociétés d’économie
mixte locales confine pourtant à l’incohérence, née de la contradiction entre la souplesse du modèle et la rigidité des conditions de son utilisation. Alors même que les relations institutionnelles sont un facteur d’attractivité de l’économie mixte locale, les relations contractuelles deviennent une source de désintérêt, à tel point que le législateur est tenté d’abandonner le modèle de l’éco-nomie mixte locale en autorisant la création de sociétés publiques locales, à capital intégralement public10 et que le gouvernement réfléchit aux modalités d’introduction dans le droit interne du partenariat public-privé insti-tutionnalisé11. Pourtant, les recherches aboutissent à la conclusion qu’une approche fonctionnelle de l’écono-mie mixte locale est nécessaire, car elle met en lumière la complémentarité naturelle des relations institution-nelles et contractuelles. Il importe en effet de tenir compte, au stade de l’analyse contractuelle, de la nature des relations institutionnelles : parce que les premières sont frappées du sceau de la domination, la passation des contrats devrait être exemptée de mise en concur-rence, car elle constitue le complément nécessaire de la création de la société. Dans cette optique relationnelle, le contrat apparaît comme la continuation d’une opéra-tion qui n’a été qu’amorcée par la création de la société.
La nature particulière des relations institutionnelles des collectivités territoriales avec les sociétés d’économie mixte locales les éloigne du modèle classique de la société commerciale, pour les rapprocher de simples services personnalisés de leurs actionnaires publics. Cette position devrait faciliter le recours aux sociétés par leurs actionnaires majoritaires. Pourtant, l’analyse des relations contractuelles souligne le caractère perfectible de leur utilisation par les collectivités territoriales.
Créd
it p
hoto
: W
ikim
edia
com
mon
s
É c o n o m i e
36 w Pouvoirs Locaux N° 90 III/2011
Sans l’obtention du contrat (ou des contrats) pour lequel elle a été instituée, la société n’a pas de raison d’être, car elle ne dispose pas de la capacité de réaliser, sans l’ap-pui de ses actionnaires majoritaires, son objet social.
L’analyse approfondie des relations des collectivités territoriales avec les sociétés d’économie mixte locales permet également de nuancer l’enthousiasme avec lequel la création des sociétés publiques locales a été accueillie et de relativiser l’intérêt que pourrait repré-senter la création de partenariats public-privé institu-tionnalisés au sens communautaire. D’une part, les collectivités territoriales actionnaires disposent, au sein des sociétés d’économie mixte locales, d’un contrôle très étendu, qui ne saurait être renforcé par la seule détention de l’intégralité du capital social. Par contre, la disparition des actionnaires minoritaires les prive d’apports financiers non négligeables, ainsi que du sou-tien d’acteurs para-publics spécialisés dans la plupart des domaines d’intervention des sociétés (en particulier le Groupe Caisse des Dépôts et Consignations)12. D’autre part, la proximité tant recherchée des collectivités ter-ritoriales avec les sociétés publiques locales pourrait conduire le juge administratif à considérer que ces der-nières sont non seulement des prestataires intégrés, mais également des organismes transparents au sens de sa jurisprudence Commune d’Aix-en-Provence13. Dès lors, toutes les actions réalisées par les sociétés pour-raient engager directement la responsabilité des collec-tivités territoriales, par transparence14.
En second lieu, le déplacement des obligations de mise en concurrence du stade contractuel au stade
institutionnel, tel que proposé par la création de partenariats public-privé institutionnalisés, est susceptible de créer davantage de difficultés que de solutions. La question de la mise en concurrence n’est que déplacée et, outre les difficultés d’adaptation de la législation interne soulignée par le Conseil d’État15, se repose pour tout renouvellement de contrat ou pour l’obtention de tout contrat ne corres-pondant pas à une définition stricte de l’objet social. La société perd alors son caractère institutionnel pour se réduire à une structure d’exercice d’un contrat particulier. Une telle
structure peut être utilisée lorsqu’il s’agit de l’exercice d’une mission de service public strictement définie (par exemple la gestion d’un service de transport intercom-munal), mais elle perd son efficacité lorsque la société exerce plusieurs activités concomitamment, telle que l’aménagement. Interrogée, la société d’économie mixte locale n’est pas pour autant menacée.
La logique relationnelle propre à l’économie mixte locale devrait par contre conduire le juge administra-tif à tirer toutes les conséquences de sa jurisprudence Commune d’Aix-en-Provence16 en reconnaissant que les sociétés d’économie mixte locales exercent, par nature, une activité de service public au bénéfice de leurs actionnaires majoritaires. Dans cette perspective, l’acte de création de la société revêt une importance toute particulière, puisqu’il fonde l’attribution d’une activité à la société. La relation contractuelle revêt dès lors un caractère secondaire, se limitant à apporter à la société les moyens juridiques de réaliser son objet social. Cette présomption d’administrativité de l’objet social n’est pas totalement absente du raisonnement du juge, qui n’hésite pas à assimiler les sociétés d’éco-nomie mixte locales à des pouvoirs adjudicateurs ou à des entités adjudicatrices dans leurs relations avec des tiers, preuve qu’il n’est pas indifférent à leur proximité avec les collectivités territoriales actionnaires. Le para-doxe atteint alors un paroxysme par la condamnation des sociétés d’économie mixte locales à une sorte de double peine : ne pouvant passer un contrat avec leurs actionnaires majoritaires qu’à l’issue d’une procédure de mise en concurrence, elles doivent à leur tour mettre en concurrence leurs contrats avec des tiers. Elles ne sont pas assimilées à des démembrements des collec-
“Le renouveau de l’économie mixte locale
passe davantage par l’acceptation
de l’ambivalence des relations des sociétés
avec leurs actionnaires majoritaires que par
la création d’instruments concurrents, à l’efficacité pour le moins incertaine.”
La proximité tant recherchée des collectivités territoriales avec les sociétés publiques locales pourrait conduire le juge administratif à considérer que ces dernières sont non seulement des prestataires intégrés, mais également des organismes transparents au sens de sa jurisprudence Commune d’Aix-en-Provence.
Créd
it p
hoto
: W
ikim
edia
com
mon
s
É c o n o m i e
Pouvoirs Locaux N° 90 III/2011 w 37
tivités territoriales d’un côté, mais doivent se comporter comme des organismes de droit public de l’autre.
En conclusion, nous insisterons sur la nature profondément complémentaire des relations institutionnelles et contractuelles des collectivités territoriales avec les socié-tés d’économie mixte locales. Le choix de recourir à l’économie mixte locale ne résulte pas d’une mise en concurrence, mais de la création même de la société rendant les pro-cédures de mise en concurrence inefficaces. L’attractivité de la formule réside dans le fait que si la société d’économie mixte locale est une structure indubitablement partenariale, elle favorise l’émergence d’un partenariat intrinsèquement déséquilibré au profit des collectivités territoriales. Sous couvert d’une indépendance structurelle, les sociétés ne sont qu’une technique d’externalisation d’une activité présentant un fort degré d’intérêt général. Le renouveau de l’économie mixte locale passe dès lors davantage par l’acceptation de l’ambivalence des relations des sociétés
6. CrC Midi-Pyrénées, rOD 28 novembre 2000, Société d’économie mixte de construction et de gestion Midi-Pyrénées (COGEMIP), point 3.3.
7. CrC Provence-alpes-Côte d’azur, 18 décembre 2002, Société d’économie mixte de Saint-Tropez (SEMITROP), p. 6-7 ; CrC Champagne-ardenne, rOD 30 septembre 2003, Société anonyme d’économie mixte Sparna Distri Énergie, p. 15 ; CtC Polynésie française, rOD 31 janvier 2011, Société Assainissement des Eaux de Tahiti (SAET), n° 2.1.2.
8. CJCE, 11 janvier 2005, Stadt Halle, préc.
9. CJCE, 18 novembre 1999, Teckal SRL, C-107/98, conclusions Cosmas, BJCP, 2000, n° 8, p. 43 et s.
10. Loi n° 2010-559 du 28 mai 2010 pour le développement des sociétés publiques locales (SPL), op. cit.
11. CE avis, Sect. administration, 1er décembre 2009, n° 383.264, op. cit.
12. BraMErEt (S), « Les partenariats public-privé institutionnalisés : l’exemple des sociétés d’économie mixte locales », in actes du colloque consacré aux « Partenariats publics/privés : Partenariats contractuels et institutionnalisés », organisé par le GrDPE à Grenoble le 8 avril 2011, JCP A, 2011, à paraître.
13. Sur l’application de la théorie de la transparence organique aux associa-tions, cf. CE, Sect., 6 avril 2007, Commune d’Aix-en-Provence c/Armand, RFDA, 2007, p. 812 et s. conclusions Séners.
14. Pour une illustration à propos d’une association, cf. CE, 21 mars 2007, Commune de Boulogne-Billancourt, rec. 130, Contrats et Marchés publ., sept. 2007, comm. 14, note Lichère.
15. CE avis, Sect. administration, 1er décembre 2009, préc. Le Conseil d’État s’est montré très réticent à l’égard de ce nouvel instrument, considérant que son intégration en droit interne nécessiterait une réforme profonde du droit de la commande publique [en ce sens, cf. HOEPFFNEr (H)], « L’avenir compromis des partenariats public-privé institutionnalisés. À propos de l’avis de la section de l’administration du Conseil d’État n° 383264 du 1er décembre 2009 », Contrats et Marchés publ., décembre 2010, étude 11).
16. CE, Sect., 6 avril 2007, préc.
1. Le présent article est un résumé d’une thèse de doctorat portant sur Les rela-tions des collectivités territoriales avec les sociétés d’économie mixte locales (université de Grenoble II, 542 p.), soutenue le 16 novembre 2010 devant un jury composé des professeurs J.-L. autin (président du jury), S. Bernard (directeur des recherches), N. Kada, M. Lombard (rapporteur) et S. Nicinski (rapporteur). La thèse est en cours de publication aux éditions LGDJ, au sein de la Collection Bibliothèque de droit public. L’auteur de ces lignes exprime ses plus vifs remer-ciements à la rédaction de la revue Pouvoirs Locaux, qui lui ont fait l’honneur de lui proposer de publier ces quelques lignes.
2. Loi n° 2010-559 du 28 mai 2010 pour le développement des sociétés publiques locales, JORF, 29 mai 2010, p. 9697, JCP ACT, juil. 2010, comm. 2229, note Devès, AJDA, 2010, p. 1759 et s., note Nicinski, RLCT, 2010, n° 60, Dossier spécial. Voir également les actes du colloque organisé par l’association des étudiants du Master 2 Juriste-Conseil des Collectivités territoriales en avril 2011 et portant sur « La société publique locale, un nouvel outil de gestion des services publics locaux » (RDP, 2011, p. 717 et s.).
3. Commission des Communautés européennes, 30 avril 2004, Livre vert sur les partenariats public-privé et le droit communautaire des marchés publics et des concessions, COM/2004/0327 final, BJCP, 2004, n° 37, p. 419 et s., com-mentaire teissier ; Commission des Communautés européennes, 15 novembre 2005, Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, Comité économique et social européen et au Comité des régions concernant les partenariats public-privé et le droit communautaire des marchés publics et des concessions, COM/2005/0569 final, Contrats Marchés publ., janv. 2006, repère 1, comm. Llorens et Soler-Couteaux.
4. CJCE, 11 janvier 2005, Stadt Halle RPL Recyclingpark Lochau GmbH Arbeitsgemeinschaft Thermische Restabfall und Energieverwertungsanlage TREA Leuna, C-26/03, rec. CJCE I-8121, BJCP, 2005, n° 40, p. 180 et s., conclusions Stix-Hackl.
5. CE, 5 juillet 2010, Syndicat national des agences de voyages (SNAV), req. 308564, AJDA, 2011, p. 18 et s., note Nicinski, confirmant Caa Nancy, 14 juin 2007, Société anonyme d’économie mixte Reims champagne congrès expo, req. 06NC01474, AJDA, 2007, p. 1933 et s., note Clamour.
Légende
Créd
it p
hoto
: M
arc
Rous
sel,
Wik
imed
iaco
mm
ons
avec leurs actionnaires majoritaires que par la création d’instruments concurrents, à l’efficacité pour le moins incertaine.
S.B.