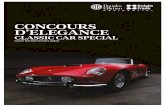Les républiques du concours. L’identification du mérite bureaucratique en France et aux...
-
Upload
sciencespo-grenoble -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of Les républiques du concours. L’identification du mérite bureaucratique en France et aux...
2
Les républiques du concours
L'identification du mérite bureaucratique en France et aux États-Unis
Olivier lHL
Avec l'avènement des premières démocraties électorales, le pouvoir des urnes a prétendu subordonner les administrations publiques. En France comme aux États-Unis , l'entrée en république s'est faite, faut-il le rappeler, contre toute prétention à l' autonomie de la part de l'État. Et l'idée d'élire les administrateurs fut largement mise en avant. Pourtant, au XJX< siècle , l'idée de soustraire l'appareil bureaucratique à l'emprise du suffrage a fini par s'imposer. Un processus qui s'est effectué en France au nom de corps d'État présentés comme de véritables aristocraties du savoir, aux États-Unis au nom d'un government by merit devenu le re~sort d'une administration rationnelle1
• Cependant, au-delà des motifs avancés par les acteurs, d'autres dynamiques sont perceptibles. Celles qui tiennent au lien entre stratégies des chefs d'administration et structure du leadership politique sont les plus importantes. Le détour socio-historique permet d'en rendre compte en répondant à une question essentielle : sous quelles
1. Sur cette revendication d' une « administration scientifique >> aux ÉtatsUnis, voir : Altshuler 1965 .
-~~
158 L'IDENTITÉ EN lEUX
conditions le mérite a-t-il pu se développer comme lep . . critère du recrutement bureaucratique ? nnc1PII
Interroger la manière dont fut constituée cette autor"té «talent » ou de la « compétence », c'est se donner les rn1 du de penser les fondements réels de la république des conco~Yens Non pas de célébrer la primauté mystérieusement acquise rs. · · un principe (la démocratie du mérite), non pas de dénonce:f constitution d'un mandarinat public (la noblesse d'État) maïs ~ penser l'action propre de cette ingénierie de gouvernement (objectiver le mérite) en la mettant en rapport avec la position de certains milieux menacés par le suffrage universel. Loin d'apporter aux activités humaines leur «juste » rétribution, le concours aura permis de moraliser les inégalités d'accès aux emplois publics. N'est-il pas une élection par le mérite, sinon du mérite
2
? II est tenu, en tout cas, pour le fondement de l'idée d'égalité attachée, en régime républicain, aux services d'« intérêt général ». D'où son rôle pour comprendre la professionnalisation des agents d'État. Restituer les conditions d'avènement de cet art de gouvernement, scruter ses pratiques et ses usages, notamment ses revendications à la scientificité : telle est la ligne d'horizon qui ordonne cette brève incursion dans l'histoire comparée des concours d'État.
« Barrer la route des bureaux à la politique »
Si l'on veut comprendre les rapports qui se nouent entre élection et concours dans la désignation des élites dirigeantes, il importe de délaisser les considérations juridiques ou l'argument des cultures nationales, sortes de fétiches à qui trop d'analystes ont fait jouer le rôle de deus ex machina. Pour la sociologie
2. Pour Max Weber, le caractère rationnel de la domination exercée par l'administration bureaucratique tient notamment à cette condition : << dans le cas le plus rationnel , les fonctionnaires sont nommés (non élus) selon une qualification professionnelle révélée par l'examen, attestée par le diplôme >> (Weber 1995, t.1 : 298).
LES RÉPUBLIQUES DU CONCOURS 159
. l' plication est ailleurs. Elle réside dans la précocité bistonque,ll e~autonomie de la puissance publique s'est trouvée avec .t~que, epar la défense de l'intérêt général. Dans la façon condJtJOnne;épondre à ce défi, il lui a fallu bureaucratiser ses dont, p~urrecrutement. Une prétention à laquelle le mérite -en rn~es
1. :r sous tes dehors du concours - a apporté une légitimité
PartJCU 1 l'. l. 1 (elle Max Weber en a perçu Importance en re Iant a essen 1 . . , l' . d . ( n de bureaucratie a existence e recrutements par vme ~? ~~mens et de diplômes. À la réserve près qu'identifier le « ~aient » ou la « vertu » a toujours posé de redoutables problèmes. Et d'abord un problème politique: le concours, c'està-dire « la sélection faite entre les candidats d'après leur mérite par un jury compétent » (Sibert 1912 : 3), avait pour effet de concurrencer la légitimité des élites nommées par le suffrage universel. De renforcer aussi la logique des corps au sein de la bureaucratie. Non seulement le concours d'État confère une certaine indépendance, mais il favorise une patrimonialisation des fonctions en assurant aux membres « leurs grades et leurs positions comme une qualité personnelle, pour ainsi dire indélébile, et comme une propriété» (Block 1873 : 540) .
C'est pourquoi le degré de structuration et de différenciation de la bureaucratie d'État est bien ce qui détermine la mise en œuvre de ces techniques d'identification. Si le premier effet d'un concours est de limiter le pouvoir de nomination des autorités politiques3 , son usage dépend de la supériorité acquise par l'argument du mérite. Régularité, publicité, impartialité : tels sont les avantages attendus de ce mode de recrutement qui, par sa force propre, arracherait l'appréciation de l'aptitude au pouvoir discrétionnaire des autorités. L'examen socio-historique dément cette manière de voir. L'identification bureaucratique du mérite n'a jamais eu la belle simplicité d'un « règlement» qui protégerait les nominations de l'influence partisane ou personnelle. Les contextes d'emploi des concours pèsent autant sur leur mode de fonctionnement que leur ingénierie propre. Notamment les rapports de force qui existent historiquement entre système de partis et agences gouvernementales.
3. D'où , pour la doctrine, la conviction publique que tout s'est passé conformément au « droit et à la justice >> (Jèze 1909) .
-...,J'·
160 L'IDENTITÉ EN JEUX
Si, comme le suggère Léon Epstein (1967), les structures d'État sont protégées par des lois budgétaires et statutaires avant l'avènement du système des partis, les leaders politiques auront du mal à organiser un patronage administratif. C'est généralement le cas en Europe. Aux États-Unis, à l'inverse, le système partisan s'est affirmé antérieurement à 1' adoption de tels gardefous. Les leaders politiques ont du coup pu s'aménager un accès privilégié aux emplois d'État sous la forme du spoils system. La constitution précoce d'une bureaucratie nationale a donc une incidence sur la capacité qu'ont les partis de subordonner l'action administrative. En revanche, lorsque le système des partis s'est développé avant la naissance des agences gouvernementales, ils sont en position de force. Grâce à une mobilisation interne, ils peuvent extraire des agences gouvernementales les ressources nécessaires à leur institutionnalisation. C'est ainsi que furent créés, on le sait, la plupart des partis centristes et conservateurs en Europe (Schefter 1994: 62).
Type d'Etat
Tableau 1. La structuration stratégique des modes de recrutement des élites bureaucratiques
Type de partis
Fort Faible Fort Tests «scientifiques » Nomination méritocratique
Notabilisation ou Faible Système de dépouilles communautarisation des
offices
Schématiquement, plusieurs modes de recrutement peuvent être distingués. Lorsque les partis dominent l'appareil d'État, ils peuvent contrôler les arènes électorales et bureaucratiques. Il leur est facile de générer un système de patronage : c'est le développement des « machines » électorales, avec leur système de dépouilles. Les États-Unis ou le Japon l'ont pratiqué à une large échelle. En revanche, là où les partis et les bureaucraties sont également puissants, chacun peut dominer 1 'autre dans son
1
LES RÉPUBLIQUES DU CONCOURS 161
arène de prédilection, c'est-à-dire imposer une discipline à ses membres et protéger ses frontières. Cet équilibre pousse à objectiver les critères de recrutement des élites bureaucratiques. II encourage des revendications de scientificité en matière d'épreuves de recrutement, comme l'usage des tests de QI, qui objectivent l'obtention de compromis. Quand la puissance bureaucratique rencontre des partis faibles, les agences gouvernementales sont capables d' autonomiser leur propre recrutement : une configuration propice à des concours dits de nomination (c'est-à-dire ouvrant droit par eux-mêmes à un emploi) par opposition à un concours de présentation de type pass examinations4, un système dans lequel un classement au mérite est réalisé mais en laissant l'autorité ministérielle choisir celui qui sera désigné (ou choisir de ne pas recruter). Dernière catégorie: lorsque partis et bureaucratie sont institutionnellement faibles, plusieurs cas de figure sont possibles. Soit des dignitaires locaux peuvent « recommander » certains emplois publics à leur parentèles ou clientèle : je propose de parler ici de notabilisation des offices (la France de la première moitié du XIX• siècle, les États-Unis de Jefferson, l'Italie d'avant la loi du 22 novembre 1908 sur les concours publics). Soit une configuration communautaire se dégage dans laquelle des groupes linguistiques ou religieux s'arrogent certains secteurs de 1' administration et imposent leurs candidats dans une logique de « pilarisation » des emplois publics). L'expression de système communautaire permet d'en rendre compte. Qu'il soit ouvert ou restreint, centralisé ou décentralisé, rare ou fréquent, le concours d'État a donc accompagné l'expansion des fonctions publiques. Analyser le succès d'un tel dispositif, c'est revenir sur les mobilisations de soutien et de défiance qu'il a suscitées. C'est, plus encore, évaluer l'efficacité qui lui est propre, celle que ses
4. Depuis le Reform Act de 1832, les partis se servaient des emplois publics pour conférer des faveurs à des amis ou des relations ou pour récompenser des services rendus. Un système de patronage néanmoins entouré de mesures renvoyant formellement à l'aptitude : cette concession à l'ambition des classes moyennes se traduisit par des examens de passage (pass examinarions) qui furent progressivement remplacés à la fin du siècle par l'ingénierie d'un concours ouvert et purement scolaire . Sur le cas britannique, voir : Dreyfus 2000 : 179 .
-.....
162 L'IDENTITÉ EN JEUX
promoteurs lui accordent en tant que techniques d'assignation et d'identification du mérite5•
Un recrutement républicanisé
Poser l'impératif d'un classement par ordre de mérite, c'est, en république, dire que les fonctions publiques ne peuvent être ni le fait d'une transmission héréditaire, ni le résultat d'une capacité discrétionnaire. En France, perçu comme une garantie d'égalité, le concours fait partie des mythes fondateurs de la République. Depuis l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, les citoyens ont été proclamés « également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents ». Une universalisation du droit de concourir qui se heurta longtemps ... à la rareté des concours publics. La méfiance des autorités politiques pour ce mede de désignation fut tenace. Depuis la Révolution française, leur souci a d'abord été d'organiser la« loyauté» des agents d'État. D'où l'importance du serment politique ou du recours au parrainage, notamment sous la forme de la « lettre de recommandation », une pratique qui dérive du monde nobiliaire et dont la persistance souligne combien le jugement des « supérieurs » resta longtemps la meilleure façon de qualifier une personne dans une société dominée par 1 'éthique, voire par 1 'étiquette des «ordres» d'Ancien Régime.
Inventée dans le cadre académique (pour faciliter l'accréditation par les pairs), la notion de concours a migré vers le monde des écoles militaires (Saint-Cyr ou Polytechnique) au début du XIXe siècle, puis, timidement, vers les administrations civiles6
• Initialement, il s'agissait de disposer d'agents plus efficaces dans les domaines sensibles de l'artillerie, du génie mili-
5. Sur ce cadre théorique, voir : Ihl, Kaluszynski, Pollet dir. 2003. 6. Sur le contexte social et intellectuel de cette « reconnaissance par le
mérite >> chère aux Lumières , voir: lhl 2007: 77 sq.
LES RÉPUBLIQUES DU CONCOURS 163
taire ou des ponts et chaussées ... Mais bientôt ces « capacités » vont servir de modèle à d'autres secteurs bureaucratiques. Comme avec la magistrature dès 1835. En 1844 est avancée l'idée d'un « recrutement au mérite » à l'entrée de toutes les fonctions publiques7
• Modeste, la proposition ne visait qu 'à conditionner 1' accès aux carrières publiques soit par un concours, soit par un examen à la sortie d'une école, soit par un diplôme de faculté, soit encore par un surnumérariat (c'est-àdire un système de stage) précédé et suivi d'un examen : elle sera rejetée par une voix de majorité. Si la Seconde République fit du concours un véritable outil d'émancipation civique, elle ne parvint pas à en imposer l'usage (Wright 1976). Quant au Second Empire, il reviendra sur nombre de ces concours, depuis les facultés de droit jusqu'aux écoles vétérinaires.
Il n'empêche. Les raisons politiques ont eu, dans ce pays, moins de poids que les prévenances sociales. Jusque dans les années 1840, il fallait être riche pour entrer dans l'administration. Une« position de fortune» synonyme de« sérieux »,à la fois de modération et d'attachement à 1 'ordre social. Les places de l'administration restant à la discrétion du gouvernement, un cens pouvait réguler les prétentions à l'exercice de l'autorité bureaucratique. En retour, les traitements étaient peu élevés, jouant le rôle de signe extérieur du désintéressement. Peu à peu, ces mécanismes vont être démantelés. Le savoir ( « les capacités ») va prendre le relais, une notion ramenée au XIXe siècle autant à des connaissances attestées qu'à des savoir-faire mondains. Ce sont les facultés de droit qui monopolisaient la certification de ce talent social. Puis, avec le souci de démocratiser l'accession à l'administration et l'échec du projet d'une Ecole nationale d'administration en 1848, c'est à l'École libre des sciences politiques que revint cette tâche. Une structure privée qui allait, en assurant la promotion des milieux de la bourgeoisie du négoce et de l'industrie, surpasser les facultés de droit8
•
Après la débâcle de 1870 et l'arrivée au pouvoir de ceux que Gambetta appelait les « nouvelles couches », le concours s'est largement imposé. Mais sous la forme d'épreuves particulières,
7. Rapport Dufaure du 13 juillet 1844 (Moniteur universel , 30 janvier 1845). 8. Sur cette rivalité bien connue, voir Kessler 1978 : 5-34.
-......;!'
164 L'IDENTITÉ EN JEUX
soumises à chaque pouvoir ministériel, non sous celle, chère aux hommes de 1848, de procédures centralisées et uniformisées auxquelles préparerait une école générale d'administration9 • Un nombre grandissant de fonctions administratives, mais aussi d'activités scientifiques, économiques, militaires, juridictionnelles vont ainsi être conditionnées par cette méritocratie qui offrait aux « compétences » de plus grandes facilités de reconnaissance10. Un ordre du mérite qui touchera jusqu'à la magistrature (loi Sarrien d'août 1908) au point de définir désormais le « mode normal de nomination aux emplois publics » (Bonnard 1907). Directeur d'école pratique d'agriculture, architecte des monuments historiques, médecin-adjoint des asiles d'aliénés, percepteur, auditeur de la Cour des comptes : on n'en fmirait pas d'énumérer les fonctions ouvertes à cette émulation administrée. Chaque année, plusieurs centaines de concours étaient organisés, pour ne rien dire de ceux organisés dans les préfectures, les Conseils généraux ou les municipalités. Les relations clientélaires n'en étaient pas exclues 11
• Elles resteront significatives jusqu'au milieu du XX• siècle. Et pour une raison simple: les concours restaient assujettis à des mœurs qui en faisaient le propre de « classes naturelles » du service de 1 'État.
La transformation du concours en règlement d'administration va desserrer cet étau social. Avec la massification des emplois publics, les recours au Conseil d'État vont progressivement endiguer les « excès de pouvoir » et 1 'arbitraire des chefs d'administration. D'autres garanties vont être données, à partir des années 1930, avec le combat syndical contre les « privilèges » et la « féodalité bureaucratique ». La sélection sur concours va alors non seulement se généraliser mais se codifier. Un processus renforcé en 1946, par l'adoption d'un statut
9. Un schéma que l'ingénieur Laine-Fleury avait imaginé calqué sur le modèle de Polytechnique (Le Journal des économistes LXXXI-LXXXV, 1864-1865: 43-47 .).
10. D'où son assimilation à un progrès au « développement continu » dont bénéficierait l'ensemble de la société (Jèze 1904 : 39) .
11 . Le constat du juriste Alexandre-François Vivien (Vivien 1862 : 94) garda longtemps de son acuité : le concours << n ' est pas toujours sérieux : l ' administration se réserve le droit de désigner les juges , et non les questions et les candidats , c ' est trop d'arbitraire à la fois » .
1
1
1
1
1
1
1
1
LES RÉPUBLIQUES DU CONCOURS
Tableau 2. La standardisation des concours d'État de l'Ancien Régime à la Troisième République
165
Date Fonction Modalité 1566 (un
arrêt qui ne les chaires des << professeurs Des << leçons royales » soutenues fut jamais royaux>> devant les anciens professeurs exécuté)
une disputatio : << sera préféré celui
les docteurs regens en droit qui aura par leçons, un mois durant et
Arrêt 1579 canon ou en droit civil par répétition publique, été trouvé le
plus digne par le jugement des docteurs regens en la dite facu~é »
Ordonnance les places de docteurs agrégés
« au concours par choix et de la faculté des Arts de 1766 l'Université de Paris nomination >>
« le jury arrêtera la liste, par ordre de mérite, de tous les candidats jugés en
Concours d'admission à l'Ecole état d'être admis et il l'adressera au Loi an VIII Polytechnique ministre de l'Intérieur qui expédiera les
lettres d'admission suivant l'ordre de la liste et jusqu'à concurrence des
places à remplir >> « un concours public dont les
Loi an Xli Professeurs des facultés de Droit professeurs seront les juges » {art. 36}
« le jury dressera une liste, par ordre de mérite, de tous les candidats jugés
Ordonnance Elèves de l'Ecole militaire admissibles. lrla présentera au
1817 de Saint-Cyr ministre de la Guerre, qui fera expédier les lettres d'admission
suivant l'ordre de cette liste, en raison du nombre de places à remplir » << Les auditeurs sont nommés au
concours dans les formes et suivant Loi1849 Conseil d'État les conditions qui seront déterminées
par un règlement d'administration publique»
Loi1871 Conseil général « désigner par concours ses
employés>> « Au terme des opérations, le jury
d'examen dresse la liste par ordre de mérite des candidats admissibles. Le
Décret 1883 Ecoles du service de santé ministre de la Guerre nomme élèves militaire du service de Santé militaire en
suivant l'ordre de cette liste, ceux de ces candidats qui remplissent les
conditions voulues .. . » art 9 : « La liste des candidats reçus
Administration centrale du au concours est dressée par ordre de Décret 1885 Ministère des Travaux Publics mérite et soumise au ministre qui
pourvoit ensuite aux emplois vacants suivant l'ordre de classement »
1 Décret 1890 Administration centrale du « les commis stagiaires sont nommés
Ministère des Finances au concours »
·~~-
166 L'IDENTITÉ EN JEUX
général de la fonction publique et la création de 1 'Ecole nationale d'administration, une école chargée de démocratiser 1 'accès à la haute fonction publique. La bureaucratisation du concours était complète. L'identification du mérite était dorénavant une forme légale et standardisée de recrutement.
Si, en France, le poids de la société d'ordres a longtemps fait obstacle au concours, aux États-Unis, en revanche, c'est le mécanisme du patronage partisan qui s'y est le plus durablement opposé: le fameux spoils system. On pense à la formule du sénateur Macy, en 1832 : « Au parti vainqueur des dépouilles » (Bryce 1901 : t.3, 177). Revendiqué comme un moyen de contrôler démocratiquement le pouvoir des bureaux 12 , d'éviter aussi le retour d'une noblesse à l'européenne, le procédé reposait sur une rotation des élites «en possession d'État ».Il avait pour but la subordination des nominations aux vœux de l'électorat. D'où le Tenure of Office Act qui limitait à quatre ans le temps d'emploi de nombre d'employés. Le président Andrew Jackson, dans son premier message au Congrès, en a fixé les motifs:
« Whether the efficiency of the Government would not be promoted and official industry and integrity better served by a general extension of the law which limits appointments ta four years [ .. .] The proposed limitation [. . .] would, by promoting that rotation which constitutes a leading princip le of the republican creed, give healthful action to the system » 13 •
Reste que ce patronage démocratique, tout entier dressé contre l'arrogance et la selfishness des hauts fonctionnaires, fut progressivement délégitimé. Il aurait favorisé corruption et dilettantisme administratif. Après bien des batailles d'opinion, le Pend/eton Act en 1883 y a mis un terme en créant un Conseil de commissaires du Civil Service : nommé par le Président, celui-ci a pour tâche de mettre au concours un nombre considérable d'emplois de la « machinerie » fédérale. Son application fut toutefois assez laborieuse.
12. Sur cette récusation de la professionnalisation administrative voir : Hoogenboom 1991 : 180.
13. Cité dans Richardson 1903: t. 2, 448-449.
LES RÉPUBLIQUES DU CONCOURS 167
....:'..!~~,:;-
« lt's sure hard to get help in these da ys ... » : une caricature de la politisation des concours fédéraux aux États-Unis.
Source: The Herblock Book, Beacon Press, 1952.
Au départ, la loi concernait moins de 14 000 emplois. En 1901, près de 43 000 d'entre eux y étaient assujettis. La mobilisation réformatrice de 1907 accéléra le passage à cette « administration rationnelle ». De sorte que vers 1910, le chiffre était porté à 222 000, sur un total de 352 000 postes de l'administration fédérale. En somme, il aura fallu un quart de siècle pour qu'une majorité de fonctionnaires d'État soient nommés au mérite. Et de nombreuses croisades de milieux académiques et d'associations militantes. Un processus qui fut tout sauf linéaire, surtout si l'on considère la situation des grandes cités ou des États de l'Union plus réticents à s'y conformer.
Par ailleurs, certains présidents y ont dérogé. Comme Dwight D. Eisenhower qui a accru le nombre de postes pouvant être pourvus sans se soumettre aux régulations du Civil Service. Ce dernier a d'ailleurs reconnu que certains emplois pouvaient être tellement spécialisés ou tellement politiques qu'il était « impraticable» de les recruter par voie « d'examens compétitifs ». Trois classes d' excepted positions furent alors établies :
·-...._J'
168 L'IDENTITÉ EN JEUX
les Schedule A jobs pour lesquels aucun concours ne peut être organisé ; la Schedule B list pour laquelle les meilleures preuves de compétence sont apportées par l'exemple des précédents travaux des candidats et par des témoins, garants des qualités de la personne ; des Schedule C jobs dont la qualification repose sur un confidential or policy-determining character14 • Si la très grande majorité des postes fédéraux sont dans le competitive civil service (plus de 85 % à la fin des années 1950), certains départements ont leurs systèmes de mérite séparés : Federal Bureau of Investigation, Public Health Service, Foreign Service of The Department of State ...
En même temps, aux États-Unis, pays fédéral, l'une des préoccupations essentielles fut d'instaurer une centralisation des modes de certification du mérite. La Commission du Civil Service créée en 1883 est une centralized recruiting agency: pour des raisons de coût comme pour des raisons sociologiques. En l'absence de corps d'État constitués, en présence aussi de multiples structures bureaucratiques, à la fois autonomes et disséminées sur un large territoire, 1 'identification du mérite devait être une compétence fédérale. C'était le gage de recrutements réellement soumis à l'adage: a fair field and no favor. C'était aussi une manière d'intensifier la relation entre récompense, motivation et performance. Pourvoir lors d'un même concours des emplois vacants dans plusieurs départements est plus stimulant, notamment pour mettre à prix des compétences : one competition with many prizes is far more attractive than many competitions with few prizes.
L'identification du mérite
Si cooptation sociale et politisation des recrutements ont longtemps prévalu en matière de sélection de la « haute administration », les concours ont rencontré une autre difficulté : celle des critères capables d'assurer un recrutement impartial.
14. En pratique, beaucoup de ces emplois« réservés>> ont été pourvus par des noms présents sur les listes de la Commission du Civil Service (Paget 1957: 93).
LES RÉPUBLIQUES DU CONCOURS 169
« Does he or she have the necessary ability, education, experience and character ? » : formulée à l'adresse des jurés étatsuniens du Civil service, l'interrogation souligne l'imprécision qui caractérisa longtemps 1' opération de sélection des aptitudes (Carr, Bernstein, Murphy 1963 : 459). Certes, les plus aptes doivent seuls être préférés, mais cette « capacité »,comment la constater ? Au vu des efforts, des résultats, de traits de caractère, d'une expérience ? Même hésitation dans les concours d'État français. Pour Maurice Block, le choix des fonctionnaires « doit porter sur des personnes remplissant des conditions de moralité, d'âge, de savoir et d'aptitude » (Block 1901 : 1011). C'était croiser mais sans les hiérarchiser plusieurs sources hétérogènes de mérite.
Comment mesurer les qualités d'un candidat à une fonction publique ? À cette question, deux types assez différents de réponse ont été apportés de part et d'autre de l'Atlantique. En France, les particularismes de l'Ancien Régime 15 ont été vigoureusement rejetés au profit d'une définition universaliste des « talents et des vertus ». Observons toutefois que ceux-ci ne se limitent pas à une « culture générale » ou à des apprentissages techniques. De ce point de vue, les déclarations de principe qui, telle la loi du 25 mai 1909 proposée à la Chambre, proclament : « Les fonctions publiques doivent aller au mérite» entretiennent une certaine illusion. Le projet de loi dispose aussi que le candidat doit « justifier de conditions morales et physiques le rendant apte à l'emploi qu'il sollicite». Plus encore,« le gouvernement qu'il est appelé à servir » doit pouvoir « faire fond sur son loyalisme et son attachement aux institutions républicaines». Un argument repris par la doctrine: «Les gouvernants doivent pouvoir exiger des futurs fonctionnaires un minimum de loyalisme et comme, d'autre part, le procédé du concours limite singulièrement leur pouvoir de nomination, il est naturel qu'ils exercent, avant tout concours, un contrôle sans limite sur les opinions politiques des futurs fonctionnaires » (Sibert 1912 :
15. Les lettres patentes du 3 mai 1766 précisent que seront« admis au dit concours ceux qui auront justifié aux dits juges d'icelui de leur catholicité, mœurs et bonne conduite, qui seront maîtres ès art de notre dite Université (Jourdain 1888 : 423).
·----~·
170 L'IDENTITÉ EN JEUX
129). Le fonctionnaire ne doit pas seulement être efficace : il doit être exemplaire. D'où les autorisations à concourir qui, sous forme d'agrément préalable du chef de service, ont longtemps préservé un contrôle des nominations. Ce ne sont pas les seules « probité, bonnes mœurs, droiture de caractère » - ces traits dont Vivien (1862 : 185) disaient qu'elles étaient « les plus vulgaires et les plus indispensables qualités du fonctionnaire » - qui comptent. Joue également la« vertu» des candidats'6
, une qualité dont l'appréciation a toujours été soumise à des controverses. En témoigne l'interdiction faite aux prêtres séculiers de concourir aux épreuves d'agrégation d'histoire et de géographie en 1904. Le ministre de l'Instruction publique considérait que « l'état ecclésiastique » auquel ces prêtres s'étaient voués « s'oppose à ce qu' [ils soient] admis dans le personnel de l'enseignement dont le caractère est la laïcité.» Une lecture attaquée par le recteur de l'Institut catholique : « Tous les citoyens sont également admissibles à tous les emplois publics » 17
• Le pouvoir de nomination primait sur le caractère réglementaire du concours. Ce que le ministre de l'Instruction publique résumait d'une phrase : « On ne saurait imposer au gouvernement des fonctionnaires dont il ne veut pas ».
Aux États-Unis, société protestante sans noblesse ni religion d'État, l'universalisation du recrutement par concours s'est moins focalisée sur la notion de vertu que sur les moyens de scientificiser la mesure du mérite. La vigueur des oppositions raciales (contre les native Americans ou les African Americans) y a favorisé le souci de différencier objectivement les performances individuelles. D'où le succès des instruments comme l'échelle psychométrique de Binet et Simon. Introduite aux États-Unis par Henry Goddard, révisée par Lewis M. Terman,
16. Comme avec cette << liste des aspirants >> dressée quinze jours avant le concours d'agrégation pour l'enseignement secondaire des jeunes filles (1884) ou celle pour l'auditorat de la Cour des comptes (1904) ou le recrutement des attachés d'ambassade et des élèves-consuls (1907) . Soit le Ministre arrête seul ces listes, soit il les approuve après enquête faite par d'autres services , comme pour les écoles normales primaires (décret du 2 juillet 1866). Sur ce point, Anty 1936: 116 sq .
17 . Sur ce cas qui fit jurisprudence et suscita une interpellation parlementaire, Journal officiel, Chambre , Débats , 1904 : 1790.
LES RÉPUBLIQUES DU CONCOURS 171
elle s'exprime depuis 1912 en quotient intellectuel (Q .1.). Elle est adossée à une « science de la nature humaine », tantôt la psychologie, tantôt l'anthropologie raciale, tantôt la biologie. L'ère du progressivism fut un moment de cristallisation particulièrement important de cette revendication, en naturalisant un mérite entendu comme « construit biologique mesurable » (Carson 2006 : 5). N'ayant jamais connu de noblesse héréditaire, les États-Unis ont eu moins d'hostilité à faire de la naissance un critère des« hommes de caractère». Membre de la Commission d'enquête sur les personnels du service public , Lucius Wilderming en formule l'idée dans son rapport de 1935 :
« The odds are determined by our progenitors [ . .. ] Potential brains and hereditary predispositions are the raw materials which go into the production of a man of character
and competence » 18•
Une croyance qui sera largement répandue'9 • Ce faisant, les tests d'intelligence, à défaut de toujours convaincre , ont été défendus comme un moyen pratique de filtrer les aptitudes
20•
Certes, d'autres épreuves se virent promues , comme les tests de sens commun. Soutenus par la Commission du Civil Service, ils s'adressent à tous et mettent en valeur les capacités de jugement pratique. Evidemment, ce type d'épreuve ne fournit, en retour, aucune opportunité de valoriser le raisonnement qui a conduit à chaque réponse. Ni de montrer sa compréhension de la pertinence ou de la signification de chaque énoncé. Les tests de mémoire ou d'éducation générale ont presque constamment été tenus pour secondaires , a fortiori si on les compare au rôle qu'ils tiennent en France ou en Allemagne. Revenant sur l'une des questions posées à l'entrée d'un concours au Foreign Service : « Select the numbered word which completes the following statement correctly. The Patroon system of seulement was
18. Wilderming 1935 : 70 . Nous soulignons . 19. Comme chez Frederik S. Oliver, auteur d'un des best sellers de la
littérature politologique de l'entre-deux-guerres (Oliver 1931 : 83) . 20. Wi1merding en fait une première épreuve des concours bureaucra
tiques, certes non suffisante, mais nécessaire à bien des titres (1935 : 105).
·-...,.,.
172 L'IDENTITÉ EN JEUX
established in the Colony of(/) New Jersey, (2) Maryland, (3) Virginia, (4) New York, (5) Georgia », Wilderming en fait la remarque : ne pas trouver la réponse est sans doute ici une indication sur des connaissances lacunaires mais répondre de façon exacte reste un moyen insatisfaisant d'explorer les capacités d'un individu (Wilderming 1935 : 107). Les tests dits de « caractère » et « d'expérience » ont toujours eu beaucoup d'importance aux États-Unis, plus que les dispositions valorisées par les written examinations, chers à la tradition britannique ou française. Pas de meilleure recommandation, aux yeux de nombre d'analystes de la public administration, que la réussite antérieure dans des activités comparables. Pour les emplois ouverts à des candidats plus jeunes, il est proposé, en revanche, une mise en situation. D'où l'importance du stage professionnel : de six mois à un an, il fut érigé en épreuve à part entière. Et comme ces périodes probatoires peuvent être ambivalentes, Henry Taylor le souligne dans l'une des premières études de l'administration publique (Taylor 1992: 126-127), une mise en compétition peut être imaginée : trois stagiaires doivent être nommés pour chaque poste ouvert ... Une manière de préserver le sens de l'émulation au-delà des épreuves du jury.
La France comme les États-Unis ont développé une stratification bureaucratique basée tantôt sur une hiérarchie aristocratique des talents et des vertus, tantôt sur une inégalité «naturelle» des aptitudes individuelles. Dans un cas, le talent y sert surtout à intégrer la méritocratie à la bureaucratie. Dans l'autre, il vise à intégrer la méritocratie à la démocratie. Deux façons différentes de légitimer les hiérarchies tout en respectant le principe d'égalité. La dignité, cette grandeur individuelle qui commande le respect (du latin dignus, ce qui est montré, signalé, distingué) ne procède plus du fief, de l'épée ou de la foi. Depuis l'entrée en République, elle s'attache a priori à l'individu. Et non plus d'expérience. C'est pourquoi fut inventée une notion qui, elle, permet de juger et de différencier : le « talent ». Défini par le Grand Dictionnaire du XIX• siècle comme une « disposition naturelle de 1 'esprit à réussir dans certaines choses »21 , ce terme
21. Pierre Larousse dir., Grand Dictionnaire du XIX' siècle, t. 14, Paris, 1877: 1415.
LES RÉPUBLIQUES DU CONCOURS 173
reste de nature largement métaphysique. Sorte de « don » ou d' « habileté naturelle », la catégorie est utilisée pour individualiser le processus de la réussite. Mais il n'existe qu'à travers les évaluations dont il fait l'objet. Qu'à travers une émulation sanctionnée qui vise, depuis la bureaucratisation des concours, à encourager et à inciter. Comme si, en capturant et en naturalisant les différences individuelles, ce langage pouvait moraliser les inégalités sociales.
Si la bureaucratie a, en France, fait des emplois des honneurs publics, en les liant à un véritable sacerdoce de la vertu, elle a, aux États-Unis, cru davantage au libre développement des talents « through hard work and determination » (Carson 2006 : 74). Pour cela, elle s'est soumise aux surenchères de sciences de gouvernement qui ont fait assaut d' «objectivité » pour rationaliser l'art de recruter. L'anthropologie métrique fut l'une de ces ingénieries expérimentales destinées à refonder le langage des hiérarchies du mérite. La craniométrie (mesure des crânes comme mesure de 1' intelligence), décriée comme le support de certaines théories racistes, a certes échoué. Mais 1 'échec de cette « science » n'a pas dissipé la croyance en la possibilité de mesurer « objectivement » l'intelligence : l'anthropométrie ou les tests à choix multiples (les fameux scholastic aptitude tests introduits en 1901 et proposés depuis à l'entrée de tous les colleges états-uniens), avec leur obsession d'accéder à la matérialité de la « capacité mentale ». La France de la Troisième République s'est, elle aussi, enquise de la possibilité de mesurer un mérite réduit à l'intelligence. Avec un Hippolyte Taine concevant celle-ci comme une « machine intellectuelle », puis Claude Bernard ou Jean-Martin Charcot, voire Théodule Ribot. Mais en France la psychologie expérimentale limita ses tests cliniques à des sujets pathologiques. Aux États-Unis, elle quitta le monde des laboratoires pour celui des administrations et des Universités. Le Q.I. devint alors une version métrique de l'intelligence. Lors de la première guerre mondiale, l'armée y eut recours comme outil de qualification et de classification de ses recrues. C'est ainsi que furent créés les grades (de A à E) qui serviront à la répartition fonctionnelle des individus. Une prétention objectiviste qui doit beaucoup à l'action de Robert M. Yerkès, le président de l'APA, l'American Psychological
·-.....,.r
174 L'IDENTITÉ EN JEUX
Association (Kamin 1974 ; Herstein 1973). De sorte que le mérite, mesuré par cet outil quantificateur et« naturel » qu'est le test d'intelligence, fut promu comme fondant un ordre social basé sur la croyance aux « différences humaines », « l'égalité d'opportunité » et le « besoin d'efficience ». La France a, pendant ce temps, dédaigné ce type de mesure, ayant déjà avec les grandes écoles et les concours d'État de puissants opérateurs d'identification du mérite.
Comment continuer à en douter ? Les militantismes scientifiques qui donnent à cette ingénierie du mérite ses lettres de noblesse diffèrent profondément de chaque côté de l'Atlantique. Usages socio-politiques, environnement religieux, rapports entre partis et administrations demeurent, eux aussi , dissemblables. Certes, la république est un régime qui prétend valoriser le mérite personnel au détriment de la fortune et de la naissance , dégager une élite censée être, au sens propre, un « gouvernement des meilleurs ». Mais pour bien comprendre comment se légitime une telle revendication, il faut examiner les cheminements qu'y suit l'organisation des concours publics.
Du mérite aux « résultats »
En France, l'origine sociale des serviteurs de l'État a longtemps dissuadé de mettre en œuvre un contrôle effectif des aptitudes . L'étiquette sociale restait un attribut que la codification bureaucratique rechignait à encadrer. Mais 1 'expansion des tâches bureaucratiques en a décidé autrement. Les concours furent alors le moyen de s'attacher les « hommes nouveaux ». Partout sur le continent européen, le développement de 1 'État nécessitait la mise sur pied de bureaux et d'organismes permanents, la délimitation de juridictions et de règles de procédure. Une réorganisation des services qui poussa à généraliser 1 'usage des examens et des tests d'aptitude. La naissance d'un pouvoir des bureaux, à la fois insularisé et professionnalisé, doit beaucoup à l'adoption de ces critères réputés objectifs de sélection et de promotion. En France, où la tradition monarchique et nobi-
LES RÉPUBLIQUES DU CONCOURS 175
Jiaire a donné naissance à de puissants corps d'État , cette fonction publique s'est autonomisée avant l'irruption du suffrage universel et de son corollaire, le système des partis. Aux ÉtatsUnis, terre protestante où le prestige de la bureaucratie a toujours été limité, le Civil Service s'est professionnalisé contre l'emprise des partis, sinon contre la démocratie électorale . Des configurations socio-historiques qui expliquent, mieux que des stéréotypes nationaux ou des arguties juridiques , les formes qu 'y a prise l'identification du mérite22
•
Toutefois , depuis une vingtaine d'années , un nouveau réformisme gagne le monde de la bureaucratie . À la question : « comment sélectionner une fonction publique cumulant qualités intellectuelles, intégrité morale et excellence professionnelle?» se substitue une autre préoccupation : « comment détecter et maximiser la motivation des fonctionnaires ? ».Une managérialisation de l 'État dont l'actualité porte de plus en plus l'empreinte. Exemple parmi d'autres : en 2006 fut adoptée par décret « l'attribution d'une indemnité de performance en faveur des directeurs d ' administration centrale »23
• La « rémunération à la performance » venait de supplanter l'ancien « traitement au mérite ». Parler de « performance » pour qualifier l'activité des « élites » est encore chose nouvelle. Les hauts fonctionnaires sont censés avoir fait montre de leur mérite en passant avec succès les épreuves de Sciences-Po Paris et de l'ENA. Toujours est-il qu'ils sont de plus en plus nombreux à voir leur rémunération indexée à leurs « résultats ». À croire qu ' aux notions de « régularité » ou de « légalité » chères au modèle bureaucratique wébérien s'est substitué un vocabulaire nouveau, celui d'une science de gouvernement (le « management public ») obsédée par l'accroissement de la « motivation » des hommes au travail. Une politique qui, désormais, arraisonne les bureaucraties d'État partout dans le monde en prétendant faire de la mesure des aptitudes une épreuve permanente, sinon même le levier de la rémunération des agents d'État.
22. Pour une illustration d'une méritocratie permettant, comme en France, de mêler dans un même système de formation haute fonction publique et leaders politiques et, partant, de limiter les tensions entre élites dirigeantes, voir: Tan 2008 .
23. Décret n° 2006-1019 du Il août 2006, Journal officiel , 12 août 2006, texte n° 25 .
·---~·