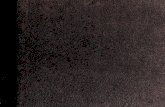Les animaux vertébrés et les maladies dues à des bactéries vectorisées par les tiques
LES PEUPLES DES KURGANS SUR LES PLATEAUX DE LA PETITE POLOGNE. REFLETS D’UNE COMMUNAUTE DU...
Transcript of LES PEUPLES DES KURGANS SUR LES PLATEAUX DE LA PETITE POLOGNE. REFLETS D’UNE COMMUNAUTE DU...
61
Piotr WŁO
DA
RCZ
AK
• LES PEUPLES D
ES KU
RGA
NS SU
R LES PLA
TEAU
X…
Piotr WŁODARCZAK LES PEUPLES DES KURGANS SUR LES PLATEAUX…
LES PEUPLES DES KURGANS SUR LES PLATEAUX DE LA PETITE POLOGNE.
REFLETS D’UNE COMMUNAUTE DU NÉOLITHIQUE FINAL À TRAVERS
SES PRATIQUES FUNÉRAIRES
Piotr WŁODARCZAK1
La dispertion de nombreux kurgans qui se trouvent dispersés dans différentes régions de l’Europe Centrale, date au début du IIIe millénaire av. J.-C. Sur plusieurs de ces territoires, la coutume de recouvrir les tombes individuelles d’un remblai à plan en forme de cercle constitua une nouveauté toute particulière. Elle représenta également une architecture funéraire monumentale et innovatrice, créée quelques siècles après le Néolithique moyen où les communautés locales construisirent des tombeaux mégalithiques. Le nouveau rite des kurgans des communautés du Néolithique final ne se limita pas à la construction du tertre lui-même ; effectivement, ce rite englobe tout un système des comportements liés non seulement à la construction du tombeau, mais aussi au placement et orientation des défunts et à la disposition de leur mobilier. Son caractère nouveau et suggestif a été à l’origine d’une conception sur leur sujet2 ; elle suggérait que de vastes territoires de l’Europe Centrale, de l’Est et du Nord furent soumis à une « indo-éuropéisation » due à l’expansion des communautés des steppes pontiques qui pratiquèrent le rite des kurgans. Aujourd’hui, le lien entre les kurgans et l’expansion des communautés steppiques de l’Est de l’Europe demeure évident seulement dans le cas des terrains de la Bulgarie, Roumanie, du nord de la Serbie et de l’est de la Hongrie actuelles3. Sur les terrains situés plus au nord et plus à l’ouest, la force de cette relation s’atténuait visiblement et par contrecoup dans les reconstructions préhistoriques. Dès lors, on est
1 Institute d’Archéologie et d’Ethnologie de l’Académie Polonaise des Sciences, Cracovie, Pologne. Courrier électronique : [email protected]
2 Gimbutas 1979.3 Récemment : Nikolova 1999, 369-389 ; Włodarczak 2010 ; Heyd 2012.
62
ARC
HÉO
LOG
IE • Varsovie – Paris 2013
amené à prêter plus d’attention à la comparaison de ce nouveau rite funéraire avec les traditions autochtones. Néanmoins, même dans ce cas, il existe de nombreuses similitudes indiquant que la question de la relation originelle du nouveau rite avec la propagation de l’idéologie des communautés steppiques reste toujours actuelle. Une influence importante sur les études de cette relation s’exerce dans le domaine de l’analyse des rites funéraires des communautés du Néolithique final occupant des terrains peu éloignés de la zone habitée par les communautés steppiques, à savoir de la partie orientale de l’Europe Centrale (Fig. 1). Un lieu particulier, les plateaux de la Petite Pologne, fournit des données dont le nombre et la qualité sont de loin meilleurs que celles recueillies sur des terrains voisins1. Les kurgans du Néolithique final y ont été découverts notamment sur les plateaux lœssiques de la partie occidentale de la Petite Pologne (aux environs de Cracovie et de Sandomierz2), dans la région de Précarpates3, sur le plateau de Lublin et dans la partie occidentale du plateau de Wołyń4.
Figure 1. Les kurgans du Néolithique final de la partie orientale du complexe de la civilisation de la Céramique Cordée relativement aux kurgans de la civilisation Yamnaya et des civilisations sélectionnées du bassin de Carpates.
1 Machnik 1966 ; Włodarczak 2006.2 Włodarczak 2000.3 Jarosz 2011.4 Machnik 1966 ; Machnik, Bagińska, Koman 2009.
63
Piotr WŁO
DA
RCZ
AK
• LES PEUPLES D
ES KU
RGA
NS SU
R LES PLA
TEAU
X…
Les kurgans du Néolithique final de la Petite Pologne sont de dimensions modestes ; il s’agit notamment de constructions de 1 à 3 mètres de hauteur pour un diamètre de 10 à 25 mètres (Fig. 2). Dans leurs dimensions et constructions, ils diffèrent peu les uns des autres, contrairement à ceux de la zone steppique, ce qui est lié à leur caractère de construction monophasée. Ce n’est que dans quelques cas isolés qu’on a pu constater des efforts pour leurs ampliation, dont le résultat fut un remblai plus important. Portant, on n’a jamais découvert un kurgan de construction compliquée, polyphasée. Par contre, comme dans la zone steppique depuis le Néolithique final, les kurgans furent fréquemment réutilisés pour y inhumer de nouveaux corps soit dans le tumulus même, soit dans son voisinage direct (Fig. 2). Une régularité claire s’est fait remarquer quant à la situation de nouvelles sépultures dans les parties est et sud-est du kurgan déjà existant1.
Figure 2. Kurgan no 2 de Pałecznica, la voïvodie de Petite-Pologne. L’exemple typique du kurgan du Néolithique final avec remblai monophase et des tombes postérieurs enterrés dans leur partie orientale et ses environnements. Recherches de Liguzińska-Kruk 1989.
1 Włodarczak 2006 : 48-50.
64
ARC
HÉO
LOG
IE • Varsovie – Paris 2013
De la même manière, on « réutilisait » également les tombeaux mégalithiques – c’est-à-dire les constructions remontant au Néolithique moyen1 (Fig. 3). On observe aussi le même comportement, durant la même période, dans la zone des steppes, où l’on pratiquait de nouvelles sépultures dans des kurgans récents ainsi que dans les tombeaux antérieurs. Toutefois, on plaça ces nouvelles sépultures plutôt dans la partie est ou sud-est du kurgan2.
Figure 3. Malżyce, site no 30, tombeau no 2. Localisation des tombes du Néolithique final relativement au tombeau mégalithique du Néolithique moyen (env. moitié du IVe millénaire av. J.-C). (D’après : Jarosz, Tunia, Włodarczak 2009).
Les kurgans du Néolithique final furent construits en surélevant les tombes individuelles en forme de fosses à profondeur variable (Fig. 4).
1 Tunia, Włodarczak, en cours de publication.2 Dergachev 1986 : 93 ; Kaiser 2003, 35 ; Ślusarska 2006 : 66, 67, fig. 14.
65
Piotr WŁO
DA
RCZ
AK
• LES PEUPLES D
ES KU
RGA
NS SU
R LES PLA
TEAU
X…
Figure 4. Tombe no 1 (centrale) du kurgan de Gabułtów, la voïvodie de Petite-Pologne. (D’après : Górski, Jarosz 2006).
Les détails de ces constructions diffèrent les uns des autres. La plupart furent des fosses rectangulaires dont les dimensions sont relativement grandes – jusqu’à 3x2 mètres1. À l’intérieur de ceux-ci, on découvrait occasionnellement des traces de constructions en bois, tels un revêtement de parois ou une caisse. Leur conception ressemble à des « maisons des défunts », à savoir des constructions sépulcrales plus compliquées, connues des autres terrains de l’Europe Centrale2. Une autre analogie constituent aussi certains traits des tombes des communautés steppiques de la même période, où l’on déposait le défunt dans le tombeau muni des éléments de construction tels que le plancher, les parois ou la toiture3. La cage avec le défunt resta dans un tombeau non comblé jusqu’à la détérioration naturelle de la toiture. Cette tendance des rites funéraires évolua vers la conception
1 Włodarczak 2000 : 486 ; Jarosz 2011 : 260-263.2 par exemple : Behm-Blancke 1953-1954 ; Bátora 2006.3 par exemple : Dergachev 1986 : 32-36 ; Ivanova 2001 : 30-34.
66
ARC
HÉO
LOG
IE • Varsovie – Paris 2013
des catacombes, présentes dans les rites funéraires des communautés steppiques depuis le IVe millénaire av. J.C et généralisées vers le milieu du IIIe millénaire av. J.C. Les terrains de la Petite Pologne se situent le plus à l’ouest parmi ceux dans lesquels les catacombes de construction analogue aux tombes de la zone des steppes furent adoptées comme l’un des comportements funéraires (Fig. 5). Un nombre important et toujours croissant de découvertes de ce type d’objets n’exclue pas le fait qu’ils constituèrent un épisode court, vu leur disparition complète vers 2400 av. J.C., sans jamais réapparaître dans la préhistoire de la Petite Pologne. Il fut, en revanche, pratiqué encore longtemps par différentes tribus de la zone des steppes.
Figure 5. Profil (A) et plan (B) de la tombe no 10 du tombeau no 2 de Malżyce, la voïvodie de Petite-Pologne (d’après : Jarosz, Tunia, Włodarczak 2009). L’exemple de la construction de catacombe typique. (Photo © P. Włodarczak).
67
Piotr WŁO
DA
RCZ
AK
• LES PEUPLES D
ES KU
RGA
NS SU
R LES PLA
TEAU
X…
Les catacombes s’enfoncèrent en principe dans les remblais des kurgans et dans des tombeaux mégalithiques. Par ailleurs, ils constituaient parfois des éléments des nécropoles plates. En Petite Pologne, parmi toutes les tombes recouvertes de kurgans, seulement deux ont la contruction de catacombe : celles dans les sites de Miernów II et de Pałecznica1.
On peut distinguer deux étapes de la présence des catacombes au cours du Néolithique final dans cette région (Fig. 6) :– la première – remontant à la période entre 2800 av. J.C. et environ
2600 av. J.C, où il y eut des tombeaux-catacombes à différentes formes et orientations de leurs éléments (entrées, couloirs [dromos] et cryptes). La plupart des tombes servirent de sépulture à plusieurs morts.
– la deuxième – depuis environ 2600 av. J.C. jusqu’à environs 2400 av. J.C. Pendant cette étape, on observe une standardisation du tombeau-catacombe au niveau de sa forme aussi bien que celui des principes de son orientation. Les tombeaux individuels commencèrent à dominer.
Figure 6. Deux phases de cimetières avec tombeaux à la construction catacombe de la Petite Pologne. Les exemples des tombes de Książnice, tombe no 2a/06 (B) (Photo © S. Wilk) et Malżyce, kurgan no 1, tombe no 7 (D) (Photo P. © Włodarczak).
1 Kempisty 1978 ; Liguzińska-Kruk 1989.
68
ARC
HÉO
LOG
IE • Varsovie – Paris 2013
Pendant longtemps, les sépultures à niches ne furent connues que dans la partie occidentale de la Petite Pologne, à savoir sur les terrains lœssiques des environs de Cracovie et de Sandomierz. Ce n’est que récemment qu’on les a également découvertes dans la partie occidentale du plateau de Wołyń1. Une concentration a été fouillée à l’occasion des travaux d’aménagement d’une autoroute sur le devant de la partie orientale des Carpates polonais2. On peut en déduire que ce rite spécifique ne fut guère une particularité locale, mais qu’il caractérisait toute la région de Petite Pologne.
L’un des traits caractéristiques des tombes du Néolithique final de l’Europe Centrale est la tendance d’orienter géographiquement les tombes elles-mêmes ainsi que les corps qui y enterrés. Ceci s’appliqua aussi bien aux tombes sous les kurgans qu’à celles enfouies dans les remblais. Comme dans d’autres régions, en Petite Pologne, les tombeaux sous les kurgans et les corps y gisaient furent orientés suivant l’axe est-ouest. On orientait aussi les défunts en fonction de leur sexe : les hommes sur leur côté droit et les femmes sur leur côté gauche, les visages dirigés vers le sud. Ces principes ritueles accentuent les différences entre le rite de l’Europe Centrale et celui de la partie ouest de la zone steppique, où l’on plaçait tous les défunts de la même manière (la tête vers l’ouest), indépendamment de leur sexe3. Il faut souligner toutefois que la grande majorité des kurgans de la Petite Pologne couvrirent les corps des hommes adultes et donc couchés sur leur côté droit, la tête dirigée ver l’ouest. On ne perçoit donc aucune différence par rapport à la zone des steppes, et l’on peut même parler d’une analogie entre les terrains comparés. Pourtant, on note d’autres principes dans le cas des tombes secondaires (c’est-à-dire dans des remblais de kurgans) et celles localisées dans les nécropoles plates de la Petite Pologne. Comme dans toute l’Europe Centrale, on respecta en Petite Pologne, on suivit des règles assez rigoureuses quant à la façon de coucher et d’orienter le corps du défunt suivant son sexe, ce qui constitue une différence frappante en comparaison avec les nécropoles constituées de kurgans en Europe de l’Est (Fig. 7).
1 Machnik, Bagińska, Koman 2009.2 Machnik 2011.3 Häusler 1992 ; 1994 : 23.
69
Piotr WŁO
DA
RCZ
AK
• LES PEUPLES D
ES KU
RGA
NS SU
R LES PLA
TEAU
X…
a b
Figure 7. Exemples des tombes typiques du IVe millénaire av. J.-C. A – la civilisation Yamnaya, Porohy, région de Yampil, Ukraine, kurgan no 3, tombe no 10 (recherches de l’expédition polono-ukrainienne en 2011), B – Smroków, la voïvodie de Petite-Pologne, site no 17, tombe no 1. (Photo © P. Włodarczak).
Les sépultures creusées dans des remblais de kurganes et dans des tombeaux mégalithiques furent d’habitude orientées suivant l’axe nord – sud ou bien celle nord-est – sud-ouest, comme dans le cas de nécropoles plates. Par contre, les sépultures dans les kurgans furent d’habitude orientées suivant l’axe est-ouest. Le changement du placement du tombeau qui eut lieu dans les cimetières du Néolithique final en Petite Pologne apporta aussi une approche nouvelle face au traitement du corps du défunt. Pendant cette période, on introduisit un standard du placement des corps, tout en prêtant une attention particulière aux détails, notamment la position des mains, celle des membres supérieurs et inférieurs. On coucha d’habitude le défunt sur le dos, avec la tête et les membres inférieurs orientés vers l’un des côtés. Ce type de principes n’est pas aussi évident durant la période antérieure – le Néolithique récent, où l’on observe une grande liberté des comportements. Par contre, on constate ces principes de placement dans les kurgans des communautés steppiques, toutefois avec une différence importante : on n’y utilisa guère de l’ocre pour recouvrir le corps du défunt. À la différence des terrains de l’Europe de l’Est, on ne connaît que des cas isolés dans lesquels on le fit en Petite Pologne.
Les tombeaux du Néolithique final de la Petite Pologne sont relativement riches en objets (Fig. 8). On peut classer le mobilier selon les catégories suivantes :
70
ARC
HÉO
LOG
IE • Varsovie – Paris 2013
(1) pièces de poteries(2) armes(3) outils(4) objets de parure(5) dépôts de semi-matières premières.
Les sépultures munies du panel d’offrandes le plus riche se trouvèrent dans les catacombes insérées dans les tombeaux antérieurs. D’autre part, dans une grande partie des sépultures placées sous les kurgans on n’a pas trouvé d’offrandes sauf certaines mais qui en possédèrent très peu – principalement des vases céramiques ou des lames de silex.
Si l’on analyse ce qui se trouve à l’intérieur des tombeaux-catacombes, on peut y distinguer facilement le groupe des sépultures masculines, richement équipées d’un éventail d’offrandes variées où les armes et les outils constituent des éléments importants de leur mobilier. Comme dans d’autres régions de l’Europe Centrale, la hache de bataille en pierre fut particulièrement importante. Ce qui attire aussi l’attention des chercheurs c’est le grand nombre de tombeaux munis d’arcs et leurs accessoires, notamment, des points de flèches en silex. Ce type de mobilier fit son apparition sur les terrains de la Petite Pologne vers 2600-2500 av J.C., et donc un peu plus tôt que dans les régions situées plus à l’ouest de l’Europe, où on a constaté leur préseance dans les tombes datées après 2400 av J.C. Quant aux objets de parure découverts dans les tombaux en Petite Pologne, ils étaient analogues à ceux connus des communautés des steppes, notamment les pendants d’oreilles en métal (bijoux de tête)1.
L’une des découvertes spectaculaires de ces dernières années a été le premier tombeau du Néolithique final de la Petite Pologne. Le tombeau, muni d’une hache en cuivre, se situe dans le site 6 (tombe no 4), dans un petit village de la région de Précarpates – Szczytna2. La forme de la hache est proche de celles connues des sites liés aux communautés des kurgans de l’Europe de l’Est3. Dans une autre nécropole, située dans la commune de Święte, on a découvert un vase à fond pointu associé aux communautés steppiques4. Ces trouvailles semblent confirmer l’importance des contacts entretenus entre les communautés de la Petite Pologne et celles qui occupèrent les terrains des bords de la mer Noire.
1 Nikolova 1999 : 303-307 ; Ivanova 2002.2 Autostradą... 2011 : 249.3 Klochko 2001 : 124.4 Kos’ko, Klochko, Olshevski 2012.
71
Piotr WŁO
DA
RCZ
AK
• LES PEUPLES D
ES KU
RGA
NS SU
R LES PLA
TEAU
X…
Figure 8. Trois catégorie des mobilier trouvés dans les tombeaux du Néolithique final de Petite Pologne : I- pot en céramique, II- armes, III – équipement d’outils (exemple tombe no 3 de Zielona, la voïvodie de Petite-Pologne (D’apres : Włodarczak 2004).
Les recherches concernant la datation absolue des tombes du Néolithique final de la Petite Pologne ont été bien approfondies ces dernières années, grâce notamment à une série de datations par le radiocarbone des os récupérés des corps humains enterrés1. Sur cette base, on a pu dater les kurgans les plus anciens aux environs 2800-2700 av. J.C. Leur nombre diminue considérablement au cours de la période suivante – vers la moitié du IIIe millénaire av. J.C. Durant la phase la plus récente, entre 2500-2400 av. J.C., prédominaient les tombes enfoncées dans les remblais des kurgans. Au début de recherches sur le Néolithique en Petite Pologne, ondistinguait la partie occidentale s’est distinguée des autres terrains où le rite des kurgans aurait été prédominant jusqu’à l’Âge du bronze2. Les recherches récentes ont rapporté néanmoins un nombre considérable de témoignages de la succession massive des cimetières adjacents aux kurgans aussi sur les terrains des Précarpates polonais et ceux du centre-est de la Pologne.
On peut constater donc que le même schéma chronologique général des changements dans le rituel funéraire s’applique aux steppes de
1 Machnik 1999 ; Włodarczak 2001 ; 2006 ; 2013 ; Jarosz, Włodarczak 2007.2 Machnik 1997.
72
ARC
HÉO
LOG
IE • Varsovie – Paris 2013
l’Europe orientale. Là aussi, à partir de la seconde moitié du IIIe millénaire, le nombre de nouveaux kurgans diminue et la coutume de réutiliser les sépultures antérieures commence à prédominer. La relation entre les nouvelles nécropoles et les kurgans déjà existants fut assez forte ; en Petite Pologne par contre elle perdait en importance même si les tombes y furent enfouis dans les kurgans jusqu’à l’Âge du bronze ancien1. Néanmoins, la majorité de défunts furent enterrés alors dans des cimetières plats de dimensions importantes2.
On dispose actuellement de très peu de données sur le caractère d’etablissement de communautés du Néolithique final. Au cours des dernières années, on a noté des traces de ceux-ci dans les parties basses de vallées ; elles remontent à la période 2800-2600 av. J.C3. Du point de vue de leur chronologie, elles correspondent à l’étape de la création des kurgans sur les culminations des plateaux voisins. Bien que d’autres fouilles importantes dues aux investissements fassent découvrir de plus en plus de sites d’habitation, il s’agît toujours de trouvailles pauvres et peu distinctives. En plus, on n’a toujours pas découvert de matériaux sédimentaires liés à la phase suivante (vers 2600-2400 av. J.C.). L’inexistence de sites d’habitation durables a conduit les chercheurs à créer la conception que celles existant au Néolithique final en Petite Pologne eurent un caractère nomade ou semi-nomade4. Cette conviction a trouvé son fondement dans la construction proposée dans les années 1970 par Janusz Kruk, toujours prédominante dans l’archéologie polonaise ; il croyait en une certaine évolution des structures économiques néolithiques5. La conception repose sur la thèse d’une augmentation graduelle d’importance de l’élevage, avec une réduction, en parallèle, d’activité liée à la culture des plantes qui eurent comme résultat l’apparition d’un style de vie semi-nomade6. Or, le caractère du rite funéraire ne constitue-t-il pas un appui pour cette théorie ? Certainement, les vestiges de la culture matérielle, tels les différents types de vases en céramique cordée ou les objets appelés « haches de bataille », qui forment ensemble un système culturel commun suprarégional, ne la renforcent guère. Car ces objets, découverts dans de nombreux sites archéologiques en diverses parties de l’Europe, témoignent de profils économiques bien variés. Quant aux rites funéraires, l’adoption des éléments caractéristiques pour la zone des kurgans de l’Europe de l’Est pourrait également témoigner de l’acquisition du style de vie propre à l’univers de la steppe. Si dans
1 p. ex. : Kempisty 1978 : 10-34.2 Kadrow, Machnikowie 1992 : 93, 94.3 Jarosz, Włodarczak, Włodarczak 2012.4 Machnik 1966 : 189-203.5 Kruk 1973 ; 1980.6 Kruk, Milisauskas 1999 : 250-257.
73
Piotr WŁO
DA
RCZ
AK
• LES PEUPLES D
ES KU
RGA
NS SU
R LES PLA
TEAU
X…
le cas de la Petite Pologne, les relations, dans le domaine idéologique, entre les communautés de l’Europe de l’Est de l’époque du bronze ancien furent plus fortes que dans d’autres régions de l’Europe Centrale, il se peut qu’en définitive, leurs structures économiques se rapprochèrent aussi. Bien que ce propos paraisse probable, il ne reste pour le moment qu’une construction hypothétique. Par contre, ce qui rend difficile d’adopter cette hypothèse, ce sont entre autres les différences évidentes au niveau de l’environnement et du climat entre la zone des steppes de l’Est et le territoire de l’Europe Centrale. Elles s’avèrent décisives à tel point qu’il aurait fallu vraiment une forte détermination pour ne pas devenir pasteur dans le premier de ces espaces, et agriculteur sédentaire dans l’autre. Si l’on tient ces conceptions comme correctes, il faudrait reconnaître que, sur le territoire de la Petite Pologne, il y eut une déstabilisation d’habitation qui, par sa force et par son caractère, fut sans précédent, ni avant – à savoir dans le Paléolithique récent – ni après ; elle ne se répéta plus jamais, y compris aux temps historiques. Ainsi les structures sociales et économiques ne furent pas subordonnées de manière optimale aux conditions climatiques et environnementales. La conception de J. Kruk est donc un essai pour fournir une explication fonctionnelle à cette situation : elle suppose notamment que le paysage des plateaux lœssiques de la Petite Pologne devinrent steppiques suite à des changements de l’environnement causés par l’agriculture sur brûlis pratiquée au Néolithique moyen1. C’est une théorie controversée, vu l’intervalle entre la période pour laquelle on date de riches traces d’habitation du Néolithique moyen et celle de l’apparition des peuples des kurgans. L’échelle des changements de l’environnement causés par l’économie néolithique fait, elle aussi, l’objet de controverses et mérite une attention particulière.
Le but des considérations précédentes a été de mettre l’accent sur les relations entre le rite funéraire des communautés du Néolithique final en Petite Pologne et celles de la zone des steppes. Du fait de la présence des tombeaux-catacombes ainsi que certains traits d’aménagement des tombeaux, elles paraissent être plus fortes que dans les autres régions de l’Europe Centrale. Outre les traits de construction des tombeaux et le caractère des sépultures, ce qui souligne l’importance de ces relations ce sont les dernières découverts dans les sites de cimetières de la Petite Pologne. En gardant en mémoire la situation géographique de ces terrains, on devrait croire que l’axe principal des contacts entre les communautés de la Petite Pologne et celles habitant les steppes constituait les voies de communication situées au nord de
1 Milisauskas, Kruk 1989 : 79, 80.
74
ARC
HÉO
LOG
IE • Varsovie – Paris 2013
l’arc des Carpates1. Le rôle des communautés steppiques des kurgans sur les terrains de la Hongrie orientale semble moins important, cependant on ne peut pas l’exclure.
Une expédition mixte polono-ukrainienne, organisée par Aleksander Kośko, a conduit des fouilles archéologique aux environs de Jampol en Ukraine afin d’étudier les relations et influences mutuelles des communautés du Néolithique final occupant les terrains du bassin versant de la mer Baltique et des groupements d’habitants de steppes de l’Âge du bronze ancien2. Le lieu de ces travaux se situe aux bords du Dniestr moyen, à la frontière nord-ouest de la zone des kurgans des communautés steppiques – à proximité des kurgans classifiés de l’Europe Centrale les plus avancés vers l’est (Fig. 9). Les découvertes faites dans cette région steppique témoignent, quant à elles, de l’apparition des traits caractéristiques pour les communautés de l’Europe Centrale dans l’univers des habitants des abords de la mer Noire. Dans le contexte des tombes de kurgans, on a découvert des objets en silex importés et des vases dont le style est caractéristique pour les terrains situés au nord-ouest de Jampol. La relation entre les terrains de la zone pontique et ceux de l’Europe Centrale n’a pas eu donc de caractère unidirectionnel.
Figure 9. La partie sud-ouest du complexe de la civilisation de la Céramique Cordée et la civilisation Yamnaya dans la partie occidentale de la zone pontique.
1 Kośko 2000.2 Kośko 2011.
75
Piotr WŁO
DA
RCZ
AK
• LES PEUPLES D
ES KU
RGA
NS SU
R LES PLA
TEAU
X…
RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES
AUTOSTRADĄ... 2011, Autostradą w przeszłość,. Czopek S., (dir.), Rzeszów, 2011.
BÁTORA J. « K problematike hrobov s domami mŕtvych v praveku », Študijné Zvesti Archeologickégo Ústavu SAV, n° 39, 2006, p. 11-18.
BEHM-BLANCKE G., « Die schnurkeramische Totenhütte Thüringens, ihre Beziehungen zum Grabbau verwandter Kulturen und zum neolithischen Wohnbau », Alt-Thüringen, n° 1, 1954, p. 63-83.
DERGACHEV V. A., Moldaviya i sosiedniye territorii w epokhu bronzy, Kishiniev, 1986.
GIMBUTAS M., « The three waves of Kurgan people into Old Europe, 4500–2500 BC », Archives Suisses d’anthropologie genérale, n° 43(2), 1979, p. 113–137.
GÓRSKI J., JAROSZ P., « Cemetery of the Corded Ware and Trzciniec Cultures in Gabułtów », Sprawozdania Archeologiczne, n° 58, 2006, p. 401-451.
HÄUSLER A., « Zum Verhältnis von Ockergrabkultur und Schnur-keramik », p. 341-348, in Die kontinentaleuropäischen Gruppen der kultur mit Schnurkeramik. Schnurkeramik-Symposium 1990, Praehistorica, n° 19, BUVHVALDEK M., STRAHM C., (dir.), 1992, Praha.
HÄUSLER A., « Zum Ursprung der Indogermanen. Archäologische, anthropologische und sprachwissenschaftliche Gesichtpunkte », Ethnografisch-Archäologische Zeitschrift, n° 39, 1994, p. 1-46.
HEYD V., « Yamnaya groups and tumuli west of the Black sea », p. 535-555, in Ancestral Landscapes : Burial mounds in the Copper and Bronze Ages (Central and Eastern Europe – Balkans – Adriatic – Aegean, 4th-2nd millennium BC), Travaux de la Maison de l’Orient et de la Méditerranée, n° 58, MÜLLER-CELKA S., BORGNA E., (dir.), Lyon, 2011.
IVANOVA S. V., Socialnaya struktura naseleniya yamnoy kultury severo-zapadnovo Prichernomorya, Odessa, 2001.
IVANOVA S. V., « Sieriebrianyi viek » Sieviero-Zapadnogo Pricherno-morya, Vid neolitu do Kimeriyciv », Materyaly ta doslidzheniya z archeolo-gii Schidnoy Ukrainy, n° 72, 2007, Lugansk, p. 85-91.
JAROSZ P., « Kurhany kultury ceramiki sznurowej na pogórzach i wysoczyznach karpackich », p. 255-278, Kurhany i obrządek pogrze-bowy w IV-II tysiącleciu p.n.e., KOWALEWSKA-MARSZAŁEK H., WŁODARCZAK P., (dir.), Kraków-Warszawa, 2011.
76
ARC
HÉO
LOG
IE • Varsovie – Paris 2013
JAROSZ P., TUNIA K., WŁODARCZAK P., « Burial mound no. 2 in Malżyce, the district of Kazimierza Wielka », Sprawozdania Archeologiczne, n° 61, 2009, p. 175-231.
JAROSZ P., WŁODARCZAK E., WŁODARCZAK P., « Ratownicze badania autostradowe w Dolinie Wisły – Kraków-Bieżanów stanowisko 33 », p. 555-576, in Raport 2007-2008. Tom 1, KADROW S., (dir.), Warszawa, 2012.
JAROSZ P., WŁODARCZAK P., « Chronologia bezwzględna kultury ceramiki sznurowej w Polsce południowo-wschodniej oraz na Ukrainie », Przegląd Archeologiczny, n° 55, 2007, p. 71-108.
KADROW S., MACHNIKOWIE A. et J., Iwanowice. Stanowisko Babia Góra, część II. Cmentarzysko z wczesnego okresu epoki brązu, Kraków, 1992.
KAISER E., « Studien zur katakombengrabkultur zwischen Dnepr und Prut », Archäooologie in Eurasien, n° 14, Mainz am Rhein, 2003.
KEMPISTY A., Schyłek neolitu i początek epoki brązu na Wyżynie Małopolskiej w świetle badań nad kopcami, Warszawa, 1978.
KLOCHKO V. I., Weaponry of societies of the Northern Pontic culture circle : 5000-700 BC, Baltic-Pontic Studies, n° 10, Poznań, 2001.
KOS’KO A., KLOCHKO V. I., OLSHEVSKI A., « Ritualniy obiekt nasieleniya prichornomorskoy kulturnoy spilnoti dobi rannoy bronzi na r. San », Archeologiya, n° 2/2012, 2012, p. 67-75.
KOŚKO A., « From research into the issue of the developmental dependencies of the Corded Ware culture and Yamnaya culture », p. 337-346, in A Turning of Ages. Im Wandel der Zeiten. Jubilee Book Dedicated to Professor Jan Machnik on His 70th Anniversary, KADROW S., (dir.), Kraków, 2000.
KOŚKO A., « Z badań nad kontekstem kultur wczesnobrązowych strefy pontyjskiej w rozwoju społeczności środkowoeuropejskich dorzecza Wisły w III tys. BC », p. 183-194, Na rubieży kultur. Badania nad okresem neolitu i wczesną epoką brązu, STANKIEWICZ U., WAWRUSIEWICZ A., (dir.), Białystok, 2011.
KRUK J., Studia osadnicze nad neolitem wyżyn lessowych, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk, 1973.
KRUK J., Gospodarka w Polsce południowo-wschodniej w V-III tysiącleciu p.n.e., Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk, 1980.
LIGUZIŃSKA-KRUK Z., « Kurhan kultury ceramiki sznurowej w Pałecznicy, woj. Kielce », Sprawozdania Archeologiczne, n° 40, 1989, p. 113-126.
77
Piotr WŁO
DA
RCZ
AK
• LES PEUPLES D
ES KU
RGA
NS SU
R LES PLA
TEAU
X…
MACHNIK J., Studia nad kulturą ceramiki sznurowej w Małopolsce, Wrocław-Warszawa-Kraków, 1966.
MACHNIK J., « Zwei Entwicklungdwege der Schnurkeramikkultur in den Flußgebieten der oberen Weichsel, Bug und Dniester », p. 147-156, in Early Corded Ware Culture. The A-Horizon – fiction or fact? International Symposium in Jutland 2nd-7th May 1994, Arkæologiske Rapporter, no 2, SIEMEN P., (dir.), Esbjerg, 1997.
MACHNIK J., « Radiocarbon chronology of the Corded Ware Culture on Grzeda Sokalska. A Middle – Dnieper traits perspectivies », p. 221-250, in The foundations of radiocarbon chronology of cultures between the Vistula and Dnieper : 3150-1850 BC, Baltic-Pontic Studies, n° 7, KOŚKO A., (dir.), Poznań, 1999.
MACHNIK J., « Znaczenie archeologicznych badań ratowniczych na trasie planowanej budowy autostrady A4 na odcinku Przeworski-Radymno dla znajomości problematyki schyłku neolitu i początków epoki brązu », p. 61-78, in Autostradą w przeszłość, CZOPEK S., (dir.), Rzeszów, 2011.
MACHNIK J., BAGIŃSKA J., KOMAN W., Neolityczne kurhany na Grzędzie Sokalskiej w świetle badań archeologicznych w latach 1988-2006, Kraków, 2009.
MILISAUSKAS S., KRUK J., « Economy, migration, settlement organisa-tion and warfare during the late Neolithic in southeastern Poland », Ger-mania, n° 67/1, 1989, p. 77-96.
NIKOLOVA L., The Balkans in later prehistory. Periodization,chronology and cultural development in the Final Copper and Early Bronze Age (fourth and third millenia BC), B.A.R. International series 791, Oxford, 1999.
ŚLUSARSKA K., Funeral rites of the Catacomb community : 2800-1900 BC. ritual, thanatology and geographical origins, Baltic-Pontic Studies, n° 13, Poznań, 2006.
TUNIA K., WŁODARCZAK P., à paraitre, « Organisation spatiale des sépultures autour des tombeaux monumentaux du TRB dans le bassin de la haute Vistule (Néolithique récent – Age du Bronze ancien) ».
WŁODARCZAK P., « Barrows of the Corded Ware Culture in the western Little Poland », p. 481-506, in A Turning of Ages. Im Wandel der Zeiten. Jubilee Book Dedicated to Professor Jan Machnik on His 70th Anniversary, KADROW S., (dir.), Kraków, 2000.
WŁODARCZAK P., « The absolute chronology of the Corded Ware Culture in the south-eastern Poland », p. 103-129, in The absolute chronology of Central Europe 3000-2000 BC, Studien zur Archäologie in
78
ARC
HÉO
LOG
IE • Varsovie – Paris 2013
Ostmitteleuropa 1, CZEBRESZUK J., MÜLLER J., (dir.), Poznań – Bamberg – Rahden/Westf., 2001.
WŁODARCZAK P., Kultura ceramiki sznurowej na Wyżynie Małopolskiej, Kraków, 2006.
WŁODARCZAK P., « Dunajski szlak kultury grobów jamowych a pro-blem genezy kultury ceramiki sznurowej », p. 299-325, in Mente et rutro. Studia archaeologica Johanni Machnik viro doctissimo octogesimo vitae anno ab amicis, collegis et discipulis oblata, CZOPEK S., KADROW S., (dir.), Rzeszów, 2010.
WŁODARCZAK P., « Projekt badań chronologii absolutnej eneolitu i początków epoki brązu w Małopolsce », p. 373-387, in Otázky neolitu a eneolitu našich krajín – 2010, CHEBEN I., SOJÁK M., (dir.), Nitra, 2013.