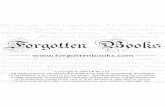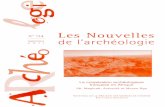Les Nouvelles Observations Que Vous Avez Présentées sur le Texte ...
-
Upload
khangminh22 -
Category
Documents
-
view
2 -
download
0
Transcript of Les Nouvelles Observations Que Vous Avez Présentées sur le Texte ...
Mons ieu r e t honorab l e am i ,
Les nouvel les ob serva t i on s que vou s avez présen tées su rl e texte de Maccar i dan s les comp tes rendus de la Soci é téroya l e des sc ien ces en Saxe ‘ , m ’ on t i n sp i ré un i n té rê tt rès-v if. J ’ava i s touj ou rs regretté que la cra i n te de rendren o tre éd i t i o n t rop coû teuse n ous eût empêché s , mes collaborateurs et moi , de pub l ie r , dan s n os Add i t ion s e t Correc t i on s , vos anc i enn es n otes in eælenso , et j e m e I
‘éJOU IS
que vous vous ê tes déc idé à les présen te r vous-m êm e avecles dével oppemen t s qu ’el le s c ompor ten t . Vos n ouvel les observa tions m ’on t semb lé auss i d ’un e grande va leur . San sdo ute el les n ’on t pas t ou tes la même impor tan ce ; i l y ena qu i porten t sur des peccad i l les or thograph iques , e t l ’onpourra it se demander s i vous n e poussez pas l ’exac t i tudeu n pe u loi n , quan d vous ob servez à p lus ieurs repri ses quecerta i n es fautes d ’ impress i on , que n ous av ion s signa léescomme t el les dan s n os Correct i on s , n e se trouven t pasdan s l ’éd i t i on de Boulac ou dan s le m an uscr i t de L eip z igma i s beauco up de vos n otes son t des modèles d e b onn e
1) B er ich t e der ka n . sa ch s . Ges e l lsch aft der Wi ss enschaft en , ph ilo lo
gisch -h is to risch e C la sse , t . XIX ,p . 1 5 1— 2 2 0 , t . XX , p . 2 3 6—3 0 8 ,
t . XXI , p . 3 9— 1 1 8, e t p . 1 4 7—2 1 0 .
c ri tique conj ec tura l e , et por ten t un te l caractére d ’évidenceque nous n ous demandons commen t n ous n ’y av ion s passongé . Cependan t , tou t e n rendan t u n h ommage s i n cèreà votre sagac i té e t à vot re savoi r , j e do i s vous avouer queje su i s souv en t en désaccord avec vou s , e t qu ’en outrevous me semblez avo i r n égl igé d e corriger pl us ie urs passages qu i son t a l téré s dan s les manusc r i ts . Je cro i s don cfa i re u ne gh ose u t i le en donnan t à m on tou r m es remarques . Quelques-unes d ’en t re el les son t des conj ec tures ;d ’au tres s ’appuyen t su r l ’éd i t i on de Maccar i qu i a paru àBonlao e t que j e désign era i ord ina i rem en t par l es l et tres
o u b ien su r des m anuscri ts d ’au tr es ouvrages .Parm i ces dern i ers j e doi s s igna l er un exem pla i re du Motrib d
’
Ibn-Dihya , don t l e Musée br i tan n ique a fa i t récemmen t l ’acqu i si t i on (or ien t . n° . 7 7) et qu i en géné ra l estfor t correc t . I l a été achevé de copi er e n 649 ,
sei ze années aprés la mort de l ’auteu r . Not re excel le n t ami , M .
Wrigh t , a e u la bon té de m ’en fourn i r beaucoup d ’extra i ts .Mon trava i l , j ’en sui s conva i n cu , ne sau ra i t ê tre le der
n ier mo t de la sc ience . Une rest i tu t i on complé té, b ien
1) J e do is rem a rqu e r , n o n pa s po u r M. Fle isch e r , m a is pou r le s au
t re s l ec te u rs de ce t é c rit , qu e j ’av ais déj à co l la t ion n é l ’édition de Bon
lac a v an t qu e m o n illu stre am i comm en çâ t la pu bl ica tion de se s n ou
v e l le s rem a rqu e s , où il a an n on cé qu ’il com p ta it s’e n se rvir dès qu ’il
l ’au ra it à sa dispo sitio n . Il e n a fa it u sage dan s s e s n o te s su r la de r
n i e re pa r tie , c e l le qu i a é té pu b l ié e par M . D u ga t ; m a is d an s u n e l e t
t re d a 2 4 a o ût 1 8 6 9 , il m’a appr is qu ’il n e do n n e ra it pas su ite à so n
pr oj e t d e co l la tio n n e r a u ssi le re ste e t qu ’il m ’
ab a udo n na it la t â ch e de
n o t e r l e s v a ria n te s d ign e s d ’ê tre c o n n u e s
en ten du dan s les l im i tes d u poss ib l e , n e peu t ê tre espé réeque de l ’é tude ré i té ré e d u tex te , a i dée par l e temp s e tpar l e h asard .
J’
ent rera is en m a t iere dès à pré sen t e t san s autre préan
'
1hu le ,s i j e n ’ava i s à d i re encore quelques m ots su r
cel les de vos ob servat i on s qu i con cern en t la par t i e d e Maccar i pub l i é e par moi—même . Mes col lab ora te urs n e semb len t pas avoi r d i scuté a vec vou s l es remarques que vou sle u r av i ez fou rn i es . J ’e n ai agi a ut rement . Aprés avoi rreçu vos n otes
,j e vou s ai fa i t con na î tre mes dou tes e t
m es obj ec t i o n s , e t vous y avez répon du . Mes n otes , vousl e savez au ss i b ien que moi , n ’é ta i en t n ul lemen t dest i n éesp our l e publ i c
,m a i s pou r vous seul . J
’
ai don c é té su rp ri s d ’une m ame re b i en désagréable , j e l ’avou e , e n voyan tque , dan s vos n ouvel les observa t i on s e t après d ix ans d ’intervalle , vou s en avez fa i t impr imer pl us i eurs , la pl upar td u temps pou r les réfuter . E tre va i n cu par vous n ’estj am a i s u n désh onn eu r , j e l e sa i s ; m a i s i l m e semble qu ’enimpriman t , sans m ’
e n préven i r e t san s avoi r ob ten u m on
au tori sa t i on , mes no tes s uran nées pour l es comba t tre ,vou s vo us ê tes préparé u ne v i c to i re t rop fac i l e e t peu d ignede vous . Pourquo i n e m ’
avez-vous pas demandé s i j e pers i s ta i s en core dan s mes vues d ’ i l y a d ix ans ? Un orie ntaliste d i st i n gué 1 l ’a dit avec ra i son : « Dix ans dan s lav i e d ’ un h omm e , sur tout l orsqu ’ i l fa i t t rava i l le r son i n tell igence ,
c ’es t plus q u ’un s iècl e dan s la durée d ’un e socié té .
» Né dev i ez-vous pas soupçon ner que j ’a va i s changéd ’av i s su r b i en des poi n ts dan s ce gran d espace de temps
,
e t qu ’auj ourd ’hu i j e sera i s l e prem i er à con damner mes
1) M. l
’ab b é Ba rgès , T l em cen
,s ouv en i r s d ’
u n v oy age , Préface ,p . xv.
4
anc iennes opin i on s ? Peut—ê tre me sera i s—je m ême appuyésur plu s de preuves que vous n ’en avez fourn i . I l y a pl us .Quoique vo tre m an i è re d ’agi r me semb l e peu en h armon i eavec les lo i s de la dél i catesse , j e la c omprendra i s en coredan s les cas peu n omb reux où j e n ’ava i s pas accepté votreOp in ion ; m a i s la pl upart de mes n otes concerna i ent despassages que j ’ava i s corr igés conformément à vos vues dan sles Addi t i on s et Correc t ion s , l es dou tes que j ’ava i s eu sd ’ab ord ayan t été levés par votre répon se . Dès lors
,c e
m e semb le , vous ne dev iez avoi r auc un “mot i f pour rappeler le sou ven i r de mes v i ei lles erreurs . Que d i ri ez-vous ,s i j e m ’
av isa is à m on tou r de fa i r e i mpr imer celles de vosanc ien nes n o tes que j e croi s avoi r ré futées pé rempto i remen t e t su r lesquel les vous vous ê tes bi en gardé de reven i r ?Ma i s br ison s lin-dessu s et examinon s l e texte de n otre
au teu r"
T OM E 1.
p nnruÈnn PART IE ,PUBL IÉE PAR M . WR IGHT .
Page 0 , l . 15 . Mah ome t es t n ommé icirl -l t
Vou s l i se zrl. l e t vous t rad uisez noble pa lm ier .
Jecroi s au con tra i re que la lecon des man . est bonn e . Ellese trouve aussi dan s Bou l e t dan s le Voyage d’Abdari, où
5
j’
a i rencon tré la même expressi o n emp l oyée en parlan t duProphè te , l e man . (n
°
. 1 1 fol . 107 v°
) por te trèsd i st i n ctemen t a.x.ÏJ . Chez Ibn-al—Kha t ib (man . de M . deGayangos , fol . 141 r
°
) on lit éga lemen t , en parlan t d ’unsul ta n de Tun is (lis . ÂÂ.L,) xx,l
Vous voyez que la con struct i on de ce passagen e permet pas de fa i re l e changemen t que vous proposez .
A mon avi s , i l fau t pron oncer libna (br i que) e t t radu i re« la b r i que qu i a complé té c ’es t-à-d i re , la derniére br ique de l ’éd ifice , l e couron nemen t de l ’éd ifice ,comme nous d i r i on s . Deux con s idé ra t i on s recommanden t ,j e cro i s
,ma m an ière de vo i r . En prem ier l i e u , j e la i s se
i n tac te la l eç on que présen ten t l e s m an . de Macca r i , d ’Abdar i et d’Ibn-a l-Kha t ib , e t qu i est confi rmée par u ne edit i on ori en ta le . Eu second l ie u , j e la i sse au mo t
rL.xlt sa
vér i tab le s ign ificat i on,c el le d e comp lém en t , et les t ro i s
passages où l ’ express i on se t rouve ex igen t impér i eusemen tde n e pas l u i e n a tt r ibue r une a utre . En effe t , Maccar id i t après son
pl.a X5l XÂ ;J ï r
Llc‘
zz l l a ll}, &Ul $ La n ) l ;l.l&3 (is, ,
cel u i par l eque l la sér i e des prophè tes de D ieu et de sesi l l ustres env oyé s est devenue comp léte . » Chez l u i-W l es t don c la m ême chose que s L. x -x .âä
lt l e t i treque Mah ome t por te ord i na i remen t , e t l edifice que l ’au teura en vue est celu i de la proph é ti e . Chaque prophè te est
c on si déré comme un e b r ique de ce t éd ifi ce, e t Mahome t
en est la dern ié re . Chez Abdarî l ’ i dé e est au fon d la même ,seulemen t e lle es t un peu modifiée . I l a ppel le le Prophè te
‘Ôïl b 3 l d l a a :fil.
l A> ccrL4..x. l l X.g l “.Lnï l l ù:…l l
DL£n
Pl a—33 , « l e se ign eur , l ’imâ m , la brique qu i
a complété le moullw de
except ion , cel u i qui a é té envoye pm
se rapporte aux 0maiyada
truction et l e double sens du « m n
trouve aussn dans Boul. ) en —L. .
sous s i lence . J e cro is qu '
il a a : i
’ O 0 ’ o .…u,connue on li t ti.-r l
pru ne pas res gra ins de beau te
ce pays , où ils é ta ient adorfi .
6
a complé té ( l ’éd ifice) l e mei l leur de tous les h ommes san sexcep t ion , cel u i q u i a é té envoyé pou r complé ter les n ob les qua l i tés (desP
. 6 ,l . 16 . Vos observa ti on s sur l e sen s d u vers qu i
se rappor te aux 0maiyades
1Â LÀD U‘
o)3 l l.;5 v
t"%3 la ; LLS j) g
?.
son t certa i nemen t b on nes pour ce qu i concern e la con st ruc t i on e t l e double s en s du dern ier m ot ; m a i s l e versn ’é tan t pas difiicile , vous les avez don nées seu lemen t pourrecommander vo tre changemen t de W x . a ( leçon qui set rouve auss i dan s Boul .) e n l_, 9…t u
, que M . Wrigh t a passésous s i len ce . Je c roi s qu ’ i l a agi sagemen t . La V° form ede ne s ign ifie pas ,
comme vous t radu isez : s ’emparer violemment d ’une ch ose , m a i s b i e n , comme vou s l ’expliquez en arabe : c ’es t-à—d i re , opprimer ,
ty rann iser
’ 0 1 0 comme on l it dan s le Câ m ous inique et in
inste tractavit dans F reytag . C’ es t l e syn onyme de la I“6
forme (voyez l e Glossa i re sur Bel â dzori , p . e t el le secons trui t auss i avec comme dan s un passage duVoy age d
’
Abdarî , qui , en c i tan t un vers satyrique s urTun is , s ’exprime en ces termes (man . fol . 82 v
°
)
L,,t:‘ J tsw‘
bC
°
,
d’
opprimer , de tyranniser n e con v ien t en auc un e m an i ère.cc ; j zc 3l LÊ ; . OP , l
’
ldéB
quand on parl e des gra i n s d e bea u té q u ’un aman t rema rque sur le v i sage de sa m a i tresse
,ca r a ssurémen t i l n ’
ap
prime pas ces gra i n s de bea u té . Elle n e conv i en t pas davan tage quand i l s ’ag i t de la dom ina t ion des 0ma iyadessur la Syr i e , ca r ces monarques n
’
opprima ien t n u l lemen tce pays , où i l s é ta i en t adorés
,comme ils oppr ima ie n t
l’
l râ c e t l’Arab ie , où on les dé tes ta i t . Votre changemen tn e se recommande don c par rien ; la langue , l e bon sen se t l ’h i s toi re l e répud ien t éga l emen t . Pourquo i l ’avez-vouspr0posé
? Qu ’y a-t-i l à reprendre dan s la l econ des manuscrits ? Vous n ’en d i tes r i en . La const ruc t io n deœÂ : $
avec l ’accusa tif vous a-t—e l le semb l é é trange ? Dan s ce cas ,
vous en t rouverez des exemples dan s un vers que c i teMaccar i , t . I , p . 858 , l . 19 : e t dan s ce tautre , 1. II , p . 195 , l . 2 1 : « Lorsqu ’ i l é ta i t e nco re a u
m a i l l ot , i l s ’es t déjà épr i s de la c u irasse (é d—l i ÜÂ u ) ,
et auss i tô t qu ’ i l eut vu un ch eva l , i l pr i t l e b erceau e nhorreur . S
’
e'
prendre de est auss i j ustemen t le sen s qu ’
exige
l e vers qu i n ous occupe ; i l con v ie n t aux gra i n s d e beau tédon t s
’
éprend un aman t , auss i b i e n qu ’à la Syr i e que les0maiyades préfé ra i en t à to utes les au tres prov i n ces de leu rva s te empi re et où i l s ava i en t é tabl i l eur rés iden ce .Quan t à la fi n de vo tre n o te , j e n ’en ai pas par l é parceque j ’y rev i end ra i dan s ma remarque su r la p . 7 92 ,
I. 2 SL
P . 10 , 1. 14 . …,aÊæ …… nsUA, . M . Wrigh t deman
de , dan s les Add i t i on s e t Correct i on s , s ’ i l n e faut pas l ireM . Vous n e vous ê tes pas pronon cé sur cet te quest i on . Je n ’
a i pas l e d ro i t de concl ure de vo tre s i len ce quevou s approuvez la conj ec ture d e n otre savan t am i , m a i sb i e n que vou s con s idérez auss i la le con d u t exte commefaut i ve , car s ’ i l e n é ta i t a u tremen t , vou s l ’au riez défendue , comme je cro i s devoi r l e fa i re . J ’avoue volon t i ersque s i l e M de M . Wrigh t se t rouva i t dan s les man . ,
j e n’
hésiterais pas à l ’approuver , car . nœäzX5l es t , sel on l eCâ mou s , Œ
îi xl l
, i l peu t don c for t b i en s’
employer
8
en pa rlan t de b ran ches qui , ag i tées par le zéphyr, se ou
la ncent . Ma i s dan s les m an . i l n ’y a pas plus de va r iante .
que dans l ’éd i t i on de Bou lac , e t la Ve forme de _,àh ë , qu i
n ’es t pas dan s les d ict i on na i res , ex i s te , car j e l i s dan sles Mil le et une nuits (t . III , p . 5 257 éd . Hahich t ) : dl) 315
J L,;ç, 5la 3wu, _, à Êzxx i , Evidemmen t ces
troi s verbes son t synonymes et s ign ifien t : pencher de côté
et d’
a utre , se tourner a droite et à gauche , ba lancer . C’est
p réci sémen t l e sen s que demande l e vers c i té par Maccari.P . et 15 :
un, ga nt L5
l .c wa,
dl a C, .LÀ> Œâ
‘.ë>l L5
3Li »L5
. .ll -ÀL5
“ ”_,l,
Ce t te fo i s vous approuvez déc idémen t par vo tre s i len ce l echangemen t de Œs
)lxo
61: en Œ=
,Læ
L5. l l , que M . Wrigh t a
proposé en son propre nom ; car comme vous revenez su rvou s é t i ez ob l igé de parler en même temps de
cetU ,l l s i vous l e condamn iez , comme j e n ’hési te pas à
le fa i re . Il fau t conserver leL5
“
.Ls des man . e t de Bon]car s i on lit Œil , l e vers m anque , non-seu l emen t de poi nte ,m a i s a uss i de sen s . Il s ign ifie : « J
’
a i v i s i té les dem eures de mes amis , ple i n du dési r de revo i r , non pas
ces demeures m êmes,m a i s ceux qu i l es hab i ten t ; car s i
j e dés i ra i s revoi r les hab i ta t i on s de m es ami s , j e pla i nd ra i s m on cœur .
» C’est u n j e u de m ots sur le verb e
ü>
rcon s tru i t a vec l l e t avec6 O
' > deszrcr revozr
quelqu’
un, G
.L= a voir p itié de . En d ’au t res termesSi j e dé si ra i s revoi r des endro i ts a u ss i peu i n téressan ts ene ux—mêmes que le son t ceux où demeuren t mes amis , j e
9
sera i s b i e n à pla i nd re , car j e prouvera i s dan s ce cas quej e s u i s u n h omme san s cœur e t qui , au l i e u d e s ’a t tacherà des ê tres v i va n ts , s ’a t tach e à cer ta i n es l oca l i tés . C
’es t ,j e c roi s , un sen s c la i r e t ra i son nab le , tand i s que le changemen t de
L512 en
dit don nera i t un con tre-sen s . E n ef
fet , que sera i t-ce q ue : « Car s i j e dés i ra i s revoi r les hab ita tions de mes amis , j e dés i rera i s revo i r mon cœur ?»P . 18 , l . 5 . ©
)L>
Ü+.t è
U. l
J.;œ. Le vers a uque l
c et hém i s t i ch e appart i en t , se tro uve dan s mes L oci deAbbadidis , t . II , p . 100 , dem . l i gne .
P . 40 , l . 5 ,2 5 e t 25 . Les leç on s san s
)l) )-l son t a uss i dan s Boul .
P . 42 , l . 16 . LM ”. Même rema rque .
P . 46 , l . 1 1 . B oul . a comme dan s l es Add .
ar t i c l e e t
e t Corr .P . 47 , l . 1 9 . Bou l . ES I
P . 5 1 , l . 16 . Vot re correc t i on äm Lo est con fi rmée parBoul .P . 7 5 , l . 22 .
Ül….l dan s Bo ul .
O ..
P . 7 5 , 1. 6 . là.?‘.Lt . 3t Ja n .
Os m e, . Je
doi s vous avouer fran ch emen t que vous me semb lez avo i reu un e i dé e b i en s ingul ière en a t tr ibuan t a M l e sen sde et en contred i san t M . L ane qu i ava i t s i b i enrema rqué q ue l e d u Tâ dj c l—’a rous est u ne faute du
-s m . Me t tez a la place de Q sM
a l o r s vous verrez que cela n e donne aucu n sen s , car oncop i ste pour
ne peu t pas d i re —.i l Les paroles d u tex tesign ifien t : « Lorsque j e fus d ’av i s de term in er cet écr it . »
10
c. . c
'
lrc d’
a ves ,se trouve dan s le d ic t ionna ire de Helo t ;
voyez auss i le s a r t i c le s croire , p enser e t se persuader dansBoc thor , e t comparez B urckhard t , Travels in Nu bia , p . 409
dans la n o te : 3 ,« n e croyez pas , ne pen sez pas . »
P. 7 7 ,l . 10 . Il est presque i n u ti l e de d i re que _à m t . fil
est con firmé par Boul .P . 80 3 . . lâ > est dans l edition ; l e po i n t du _.la
est casse ,m a i s dans mon exempla i re i l est encore v i s i
ble .
l b id 9 . 0 auss i dan s Boul .P . 87 , 1. 7 .
0,
L5..n -ii xt,,ls,
Dan s la no te a , M . Wrigh t avoue q u ’ i li gnore ce que sign ifie i c i l e m o t xlA 5 . C
’es t tout s implemen t 211115 , l e d im in u t i f de cruche . I l n ’est pas rareque les savan ts n e reconna i ssent pas l es d im i n u t i fs . A i n s il ’ i l l us tre Qua tremère (Hist . des sa l t . mam l . , II , 1 , p . 60)a t radui t un passage de Macriz i où i l est ques t i on d ’ un e».ÆÇ>ï.æ .sw
, e t i l a dit dans une note que ce t te lecon« n e présen te pas une s ign ifica t i on sa t i sfa i san te ;» aprè squoi i l aj ou te : « On peut l i re ou une lame , o uü $ w , un p la t . Dan s la Vie de Kelaoun , e t dans l ’H is
oA
lozrc de Nowam , on t ro uve le mo t une bozte cequi para î t la meil leure leçon .
» Cependan t personn e n ecroi ra qu ’ un cop is te ait corrompu le mo t ene t ce dern ier terme , qu ’ i l fa u t pron oncer x51à è , est par
fa itement correc t. C’es t l e d im in ut if de Xâ $ m ; Frey tag l ’a
no té sous ce dern ier mo t,e t P. de Al ca la (sous sa lsera o
sa lsereta ) le donne dans le sen s de saucière .
P. 88 ,l . 19 . {. La l a . l
L‘
)M U:o)
äll C),—S t
Tel le est la le çon de to us les man . e t de d’
édition de Boulac . M . Wrigh t y a s ub s t i tué e t i l a rej e té la leç on des m an . dan s un e n o te . J ’avoue que j e n ’au ra i s pasosé le fa i r e . I l est vra i que
Do.. 5 ne se trouve pas dan s
Freytag , m a i s ce terme est en usage comme l e pl ur . deOle—1 5 . Aux qua tre exemples de ce pl ur . que M . Mülle r a
c i tés ( D ie letz ten Zeiten von Granada , p . 1 5 5 dan s la no te) ,on peu t aj ou ter ceux-c i : Ibn-Khaldoun , Hist . des B erbères ,
t . I , p . 149 ,l . 2 a f. , p . 1. l o, p . 29 5 ,
l . 7 a f. , p . 5 7 2 , l . 4 a f. e t p . 7 1 , 1. 6 a f. ,
p . 108 , l . 1 , p . 245 ,l . 5 a f. ; P role'gom e‘nes , t . I , p . 220 ,
dem . t . III , p . 104 , l . 5 ; B ibl . Ara be-S icu la , p . 6 17 ,
4 ; Bocthor v°
. arp en t . Comme le person nage don t i le s t quest i on dans n o tre tex te peu t avoi r possédé pl u s d ’unchamp ,
l ’aute ur peut for t b i en avoi r employé l e pl ur i el .P . 90 , l . 4. L
’
Espagne est , sel on Baz i z x a.…Jj
Xäls ül Vo tre conj ec ture , li æ ,£z au l i eu decomme por ten t l es man . e t l ’éd it i o n de Boulac ,
me semb lerait d ’un e hard i esse extrêm e , même s i ce â ,la lt » : b
cadra i t a ssez b i en a vec l ’en semb l e d u passage , ce qu i , j ec roi s , n ’es t pas l e cas . Il n ’y a r i en à changer , e t j e met ien s persuadé que v ous auri ez la i ssé l e tex te i n tact , s i ,à l ’époque où vous —écr i v iez cet te remarqu e , vous av iezdéj à e u à vo tre d i spos i t i on l e Lex ique de M . Lan e , car
Freytag a expl i qué d ’un e m an ière p eu sa t i sfa i san te .M . Lane dit : « XàÏE> pr imar i ly S ign ifies a mode , or manner,
oof general l y as mean ing crea ti on ; a part icu lar make
a nd hencc , constitution ;» etc . Or , comme -9 s ign ifie na
tura ,indo les a na tura in sita , i l est cla i r que les paroles
de n o tre texte présen ten t ce sen s : l e sol de l’Espagne est
fer t i le par la na ture de sa constitu tion ; i l n ’est pas n écessa ire de rendre ce sol fer t i l e par des moyen s a r t ifici el s ,car i l l ’es t par sa n ature même .Ibid .
,l . 24 . M . Wr igh t n ’aura i t pas dû écr i re
d e… ,ma i s ce qu i se rapproch e plus
de la lecon de ses man . , q ui ont (auss i dan sEn effe t , c ’es t de ce t te m an iè re que c e m ot s ’écr i t
en a rabe . I l est dans Freytag ; dans l e L a tâ z‘f c l-ma’
â rifde Tha ’à lib î (p . 1 16 ,
l . 8 éd . de Jong) c ’es t e t
dans le Mosta’
înî (man . 15 ) L5 .>l . .ll forme que Freytag a auss i .P . 9 25 , l . 6 . L13 3 …;w XÊ L.33.3 ; ma i s les man .
(de même que Boul . ) por ten t ,,st i e t M . \Vrigb t a
e u tor t de bifi’er le mo t qu i n ’es t n ul lemen t de tm p ,
comme i l l ’a pensé ‘ . L’
eXpression fiç l)o _
)LAp ,
qu i ne set rouve pas dans les d i c t ion na i res , n ’es t pas ra re ch ez lesau teurs arab es . On lit chez Ibn-a l-Con t ia (m an de Par i s ,fol . 12 p ) o )
LÀJ .>. .53 l œ, gL.: car ces
1) Pe u t—ê tre m e d ire z-v o u s qu e j e m e s u is t rom pé , m o i au ss i , e n n
’ad
m e t ta n t pa s l e t . II , p . 5 4 , l . 9 ; m a is a lo rs j e v ou s répo ndra i
qu e le ca s n’e s t pa s le m êm e . J ’a i rej e té le m o t e n qu es t ion , n on pas
parce qu ’il n e po u v a it pa s ê tre p lacé après m ais pa rce qu e Mac
ca ri d it fo rm e l lem en t qu ’il 0 0 p ie Ib n -Kh a l lic â n, e t qu e ce de rn ie r n
’a
pa s le n i dan s l’
édi t io n de M . Wus te nfe ld (Fa sc . II I,p . 1 24 ,
l . a) , n i da n s c e ll e de i i . de S la n e (r. I , p . 3 2 2 ,l . 11 n e se
t rou v e pas n on p lu s dan s le Macca ri de Bo u lac .
15
v oyel le s son t dan s le man . , est pour Dan s un eH istoire des [Ia/rides (dan s le J ourn . asia t. de 185 1 t . I ,p . 5 8 ,
l . ., a1t. -â _ î lUn
01 1
Dan s le s Voyages d ’
lhn-Ba touta ( t . I , p .
LS_ .ll
p b.>) L .L go hifi… Plus lo i n (1. II , p .
” fil l
L5_ 5 J .: 5 5 . A i l leurs (t . II ,
p .
,5 i,s
Umx. .as
U..
__çà …f ,.
Plus bas (t . II , p . o3 .… Lg}. a Œ â Ï>}l U , : gæ
)LÀ3Ô Dan s u n a ut re endro i t (t . III ,
p . l ) : x; g)t L.a LP LLu , . Voyez auss i
t . III , p . 15 , 14 , etc . Dan s un F ormu la ire de contra ts
(man . 1 7 2 , p . 9 ) on tro uve : 0 903 521
03 5
Ù3.5
w UÇ lC}:l ‘ l
L55 UZ,—)3 l
Ü'° m
12 3 . l a l ic e .)
8 4> Ù3 5
l,Là,p Les savan t s t raduc teurs
d’
Ibn-Batouta on t rendu l ’express i on don t i l s ’agi t par din â r d
’
a rgen t , et j e c ro i s auss i que c ’é ta i t u ne m onna i ed ’argen t , car l e voyageu r que j e v ien s de n ommer , se sert(t . I , p . 428) de l ’express ion U
’° q 3 t
Pa rm i les passages que j ’a i c ité s de l u i , i l y en a auss ip l us i eurs d ’où i l ré sul te que cet te mon na i e équ iva la i t àun quar t de din â r du Magrib . On peut don c l ’évaluer àenv i ron t roi s fran cs , e t quan t à l ’express ion a rabe , ou peu tcomparer ce passage de Prosper A lp i n (H ist . Aegyp ti na tur .
p a rs p rim a , p .« E t tam v i l i pret io haben tur , u t pue r
puellave non pl us aureo a rgen teo apud e os aestime tur .»
P . 94 , l . 5 e t 6 . I l fau t corr ige r t ro i s fautes dans'
ces
deux vers . La l eç on 2h 5 \1L4 ,que l ’éd iteur n
’
a t rouvé eque dan s un seu l man . , doi t ê tre remplacée par al . ?comme por ten t les autres man . e t Boul . Selon t ou te ap
14
parence , M .Wrigh t l’a adm i se parce qu ’ i l c roya i t que l e
dern ier p ied deva i t avo i r deux syllab es ; m a i s dan s l espoèmes modernes e t popu la i res , l e dern i er p ied du m on
sarih n ’en a souven t qu ’ un e se ul e (voyez , par exemp l e ,t .I,p . 5 10 ,
l . 18 et.
e t i l fau t pronon ce ret é ld—xfi l a lùu .ll 5.11:Î>
Ibid .,
22 et n . f. La c orrec t i o n d e l ’éd i teur est c onfi rmée par Boul .P . 9 7 ,
l . 2 . La bonne leco n , i n d iquée dan s l es Add .
e t Corr . , est dans Boul . .
P . 105 , l . 20 . Le texte d it que dan s l ’Aragon on t ro uveä13Llaæ e t la n ote e est con c ue en ces t ermes : «Les
m an . por ten t Vous d i tes qu ’ i l faut res t i tuer lal ec on des man .; que Yâ cout a b i e n en t ro i s end ro i ts X_
ç
°
n fi ,
m a i s que c ’est évidemmen t u n e c orrup t i on d e XA Lh ; Britan n ia , la Bretagne . Quel n om de v ille o u de pays , demandez-vous , répondra i t à ce Barb a t â n ia ? Aprè s q uo i vo usaj ou tez que l ’ex ten sio n du n om de la Bretagn e à la par ti en ord-es t de l ’Espagne s ’expl ique nat urel lemen t par la -c i rconstance que les ch ré t ien s , ven us d u sud—o ues t de la France , se son t avancés j usque dan s cet te part i e de la pen insule ibé r ique . Parm i tou tes vos n otes i l y en a peu
d ’auss i ma lheureuses . Barb itania, car c ’est a i n s i q u ’ i l fa ut
prononcer , é ta i t l ’an c ie n nom du Sobra rbe . «Quod mododic itur Superarhium , clim vocaba tur terr it or i um Barb i tan um ,
» lit-ou dan s l e F ragmen tam histor icum ex car tu la rio
Alaouis , pub l i é dan s l ’E sp aña sagrada , t . XLVI , p . 5 28 .
Vous aur i ez p u t rouver cela dan s la seconde éd i t i on de m esRech erches , que j ’a i e u l e pla i s i r de vous e nvoye r i l y a
dix ans . A la page 5 5 7 du tome 11, j
’
ai c i té,dan s la
16
1nina tif e t tradui re : « Quand el le eu t fin i de pa rler , l ’aveugle tousse ; a lors el le dit : « Il a m a l à la gorge .… a.1
do it é tre j o in t à e t n on pas àIbid . ,
10 . lJ.,gl 3 1 Lÿ l)
l 3 , 155 5 3 1 a.…L%8 M l 3 . I l
fau t b ifier avant l e mot 3 1, qu i ne se trouve n i dan sBoul . , n i dans les deux m an . d
’
l bn-al-Kha tib , cel u i de M .
de Gayangos et cel u i de Berl i n . Ce n ’est pas un souha i t( l’ensemb l e du passage mon tre a ssez que le poè te aveugl en e souha i te r ien de bon à son i nterloc ut r i ce) , m a i s un eimprécat i o n , une m a léd ict i on . Si l ’on con serve ce t 3 l , la
répl ique de Nazhoun n e don ne pas de sen s ; m a i s tou t estcla i r quand on l e ret ranche . Au res te , l ’éd i te ur a n égl igéde fa i re remarquer que ces deux ph rases r imen t ; i l aura itdû les fa i re imprimer a i n s i : L.@l
)l 3
,‘ l,1> 5 111 l.n 3
@ cc l î 31Ibid .
, 12 . Dan s l e vers
l e mot .c}m .ll est un con tre-sen s . I l faut y sub st i tuer
Ü ,m j l,
leçon qu i se t rouve dan s les deux m an . d’
Ibn-al-Khat ib .
Ce m o t s i gn ifie pudeur , de'
cence , retenu e ,honnêteté . Voyez
Maccar i , t . I , p . 6 78 , l . 20 ; Ibn -Khaldoun ,H ist . des B er
bères , t . I , p . 2 5 5 , l . 1 1 ; P rolegom enes ,t . I , p . 19 ,
l .14 , p . 29 , l . 5 ; Ibn-Abdalmelic Marrécoch î , man . de Par i s , n ° 6 82 suppl . ar fol . 7 4 v ° : Q Làfll, Ù) u l l
ÙL{ .
Ibid . ,1. 18
}.xw e n e sign ifie r i en . I l faut
l ire comme on trouve dan s Boul . e t dan s le man .
de Berl in d ’ l bn-a l-Kha t ib .
17
P. 122 ,
n . a . Comme i l s ’agi t d’un mot qu i é ta i t enu sage en Espagn e , M . Wrigh t aura i t m ieux fa i t d e c i te r ,au l i e u d u terme i ta l i e n coniglio , l e terme valencien conti!
e t l e terme portuga i s coelh o , qu i est pou r cone!ho , le sPor tuga i s a iman t à suppr imer la co nson n e qu i se trouvee ntre deux voyel les .P . 126 ,
l . 15 . Vou s d i te s avec ra i son que LgÂ_,m> L5.5,
est b on auss i . Je n e vo i s pas pou rquo i on changera i tce tt e l econ ,
qu i est con fi rmée par Boul .Ibid. ,
22 . L>,ÏzΫ n e conv ien dra i t pas , et
_ je n e pu i sadop ter (dan s les Add . e t parce que
g ti “;
n ’ex i s te pas , que j e sache . Je c ro i s devoi r l ireavec Bou l .P. 128 ,
l . 5 e t n . a . Ce LPLà .<5, qu i n’es t dan s aucunm an . e t que M . Wrigh t a aj outé de son chef , n ’es t n ull emen t n écessa i re
, car « aprè s un e propos i t i o n suppos i t i veexprimée par on fa i t quelquefo i s l ’ellipse de la p roposition corré la t i ve » (de Sacy , Gramm . a ra be , t . II , p .
en d ’aut res term es : ce qu ’ on appel l e l e l de, . l est
q uelquefo i s sous-en tendu . On en t rouve un autre exempl e p . e t su iv . , passage s ur leque l l ’éd i teu r deBou lac remarque c e qui s u i t : u i
}> 8 L..su l sc3.9> 1
3 2»v
.i äl Œl ,.Läd l U n tb : ê
-ËYJ e$ . l .3 , 1. I l d i t d em êm e au suj e t d u qu ’on t rouve t . II , p . 147 , l . 7de notre éd i t i on : LQ L£z£1Œl Q ,
À 5 \æ,l
A la page 128 Bou l . a6510 m a i s—se lo n toute apparen ce ,
c e mo t a été aj ou té par l ’éd i te ur , qu i n e sava i t pas en
core , au momen t où i l imprima i t c e passage , queest sou s-en tendu ; i l n e s ’en es t aperc u que lorsqu ’ i l im
18
prima i t le second passage . La m ême ré ti cen ce se trouvea uss i p . 5 17 ,
l . 14 ,passage don t j e sera i ob l igé de par
l er plus lo i n,pa rce que vous avez voul u en changer l e
t ex te . Au res te , j e fera i en core ob server que les auteursm odernes a im en t à aj ou te r la propos i t i on corrélat i ve , queles écr iva i n s pl us a nc i en s supprimen t . A i n s i on lit ch ezIbn-al-Kha tîb (man . de M . de Gayangos , fo l . 44 v
° e t man.
de Berl i n) : G.l i
ÜL. { 1 5 \Llo
Ügl J Lä5
Zf’v °: ,1, après quo i l e réc i t con t i n ue . I l y a
donc i c i el l i pse de la propos i t i o n corré lat ive ; m a i s Macca r i (t . II , p . 209 , l . 7 ) qu i a cop i é ce t a rt i c l e d’Ibn-alKha t ib
,l’
a aj ou tée : l.Àî â lg La .
Ibid . , 1. 10 . 1. 1111 5O
..Ulm: G en.
—x,,
xlu 1.o ;L..a Vous proposez de l i re et Boul . a
réel lemen t “
C t“…m a i s la l econ de M . Wrigh t est certa i
n emen t la bonn e , comme le prouve un pa ssage to ut à fa i tsemb labl e ,
p . 298 , 1. 1—5 : 8)L.a l l
L.
)l J L5
Ùt{
Ùt wsw8t }
.11,
a ijej—St, x, b
,5
u’ wlÆ;l
J L…) 1. t,. e Le verbequ i semb l e vou s avo ir embarrassé , est un de ceux qu i on tperd u presque en t iè remen t l eu r s ign ificat i on pr im i t i ve .Les au teurs arabes s ’en serven t là où nou s met tr i on s l everb e a voir ,
comme dan s ce passage de la B ibl . Ara b. S i
ou la (p . 45 5 ,l .
Ù )b ä.i
L5 ’)
l i « l’
un d ’en tre eux pré tend i t avo i r v u quel es escl aves d u gouverneu r ava i en t des épées n ues . » Dan sl e passage de Maccar i i l fau t tradu ire de même : « l es hab itants su r l es deux r i ves ont des lampes a l l umées . »
19
P . 15 4 ,l . 1 1 (voyez les Add i t . e t Il n ’y a r ien
à change r i c i .Ibid . ,
l . 25 . Lg ts 8 11 5 81 121,
U:oL’
5 % >o ÙL{, Ü
la â î l, ,
.La.l l p l__ç5 . C
’es t a i n si qu ’ i lfaut l i re avec les man . , san s changer Umt5 enW L
‘
5 , commel’
a fa i t l ’éd i teur , car s i l ’on adopta i t c e changemen t , l ’aut eur d i ra i t que l e moh tesib é ta i t u n cad i , c e qu i sera i t b i enl o i n de la vé r i té . I l fau t prononcer U:o L. 5 Lg1>Lm 318 e t
t radui re : « et ce l u i qu i rempl i t cette charge e s t c omme uncad i , » c ’est-à-di re : en Espagn e , un m oh tesib n ’es t pas ,comme en Orien t , u n homme san s b ea ucoup d ’éduca t i onau c on tra i re , par sa profonde con na i ssanc e de la l o i , ile st l ’éga l d ’un cad i e t j ou i t d ’a utan t de con s idé ra t i on quece dern i er . Boul . a a uss i uæL.5 , e t l ’éd i teur n e s ’es t pa st rompé sur le sen s de la phrase , car i l a fa i t i mpr ime r
P . 1 5 5 , l . 2 5 . Ce n e peut pas ê tre bon . Boul .aë J5 13, , ce qu i n e vaut pas m ieux . Je croi s q u ’ i l fau t
l i re l ’au teu r d onn e à entendre qu ’en Ori en tl es faqui rs mend ia i en t sur les m arché s après s ’ê tre b l esséle v i sage afin d ’exciter la p i t i é des passan ts . Je profi tera ien core de ce tte occasi on pour corri ger un e e rreu r où j esu i s tomb é dan s ma j eu nesse : dan s mon D ictionna ire desnoms des vêtemen ts , p . 182 , i l faut b i ffer l ’ar ti c le
0 ;
Ce m ot , en persan l,,o , s1gn1fie m emb er .
P . 156 , l . 5 . Je n e saura i s approuver le changemen tde en
j’y que vous proposez . Le sen s es t q ue le
2 *
20
savan t es t t ra i té avec respec t par ses vo i s in s e t par l esmarchands chez lesquel s i l achè te quelque ch ose .
a )
La l eçon du texte , qu i es t confi rmée par Boul . ,es t b on ne , e t i l n e faut pas y subst i tuer d Ë \JÇm J , , COIÏ IŒB
l e veu t l ’éd i teur dan s l es Add i t . e t Corr . Sel on tou te apparence , i l n ’
a pas con n u l e sen s que l e verb e _ à5 tm ava it
en Espagne e t qui n ’est pas dan s les d i c t i on na i res . I l s ignifiait être présomp tueuæ , car chez P . de A l ca la presum ir
_o
de si mesmo est i l donn e auss1 sous mues.
tra de vanagloria e t so us presuncion , et l ’adj ec t if …u 5 \…sou s a ttira , orgu lloso et p resuntuoso. Vous voyez que c esen s conv ien t parfa i t emen t i c i e t que …ô.5 1…3 expr im e lam ême i dée que x…s
‘
13,.L
‘
u u e t u 5 t a li,glà 3 .
Ibid . ,l . 24 . I l fau t i n sérer avan t la part i c ul e 3
,
que le sen s exige impér ie usemen t . Je soupçon n e que l ’on1 ission de ce 3 n
’est qu ’ un lap sus ca lami de l ’éd i teu r,
car i l est dan s l e man . de Gotha (voyez Freytag , Chres( cm .
,p . 148 ,
l . dan s cel u i de Leyde et p robablemen tauss i dan s les autres . Boul . l ’a . Quan t à la n o te dan sl es Add i t . e t Corr . , sel on laquel le i l faudra i t p lacer l e
,.gt .o
aprèsÙ, 1 Ê “ 11, j e n e pui s l ’approuver. Ce changemen t
m e para i t a rb i tra i re et i n u t i le ; Boul . a a uss i le aprè s&re—l
).
P . 147 l . 10 . Au l i e u de i l fau t certa i n emen tl i re
â. u
, , comme l ’édi teur le d it dan s le s Add i t. e t Corrm a i s j e ne comprends pas pou rquo i i l a pron oncéc ’es t 1113 qu ’ i l faut .
2 1
P . 15 4 , l . 1 1.
Ü.o LS, ,
1L3 —L….lb l l u£U
L i se z comme dan s Boul .P . 16 2 , l . 2 1 e t n . B oul . a la bonn e lecon .
P . 16 6 , l . 17 e t n . c . L.5 tm auss i da ns Boul . La vé
ritab le l eç on , qu i n ’es t pas cel le que l ’éd i te u r propose dan sles Add . e t C orr . , est encore à t ro uver .P. 193 , l . 4 e t II. Il .
rL—t îl O
m > l sera i ten oppos i t i o n a vec l ’h i s to i re . La trace de la b on n e leconest dan s l e Ma tmah L . Le au l ie u de est
réel lemen t une a l té ra t i o n de s,…l , comme l ’éd i teu r l ’a
soupçon né , car ce tte dern iè re leco n se ren con tre dans lesfragment s du Ma tmah qu i se tro uve n t à la fi n du m an.
d’
l bn-Bassam que possède M . Moh l (of. mes L oci de Abbadidis , t . II I , p .
P . 202 , l . 14. Vous proposez o l:Ë l La ; B oul . a  Π. Ïï Le,
c e qui , j e c roi s , est m ie ux . Le sen s sera i t l e même ;m a i s la VIIe form e est fréquen te , tandis que la VIII°, s i e l leex i s te , n ’es t pas class ique , car M . Lane ne la donn e pas .
P . 209 , l . 22 . &215, e Je pré
s ume qu ’on doi t l i r e avec B oul . Si c ’é ta i tà la forme , ou n
’
hésiterait pas à prendre c e verb e dan sl e sen s d ’avoir le vertige ; c ’es t auj ourd ’h u i , comme voussavez , l e sen s ord i na i re d e e t on l it dan s l e Lex iquede M . L ane , que probab lemen t i l l ’ava i t auss i dan s l ’anc i en n e langue . Je c ro i s devoi r a tt ribuer à la 11° forme lamême si gn ifica t i on . I l es t vra i que , dans l e d i ct i on na i red e M . Lan e et dan s ceux d e la langue modern e , c ’es t donner le ver tige ; m a i s Roland de B ussy (L ’
idiome d’
A lger ,
p . 590) a n oté la ph rase : ,L,f 551à ,
c\ 3 La .
22
« j e n’
ai le mal de mer que dan s les grands b â t iment s . »C
’es t au fond le même sen s qu ’a voir le ver tige , e t s i l ’auteur ne s ’es t pas t rompé en aj ou tan t l e techdid au verbe ,il s ’ensui t que la Il 6 forme est l ’équi va len t de la On
0 n ’pourra i t auss i prononce r au pass i f w ie) . En
tout cas i l es t certa i n que la l eç on du t ex te es t v ide desens (cf. l e Lexi que de Lan e sous Zl.>avec l e hd) , e t quele rhé te ur a voulu d i re : « les o i seaux de pro ie ava i en t l evert ige et décr i va i en t des cercles dan s les a i rs ,» ou commenous d i r ion s : l es o iseaux de pro i e décr iva i e n t des cerclesdans les a i rs , comme s ’ i l s ava i en t l e ver t i ge .P. 2 14 , l . 5 . Je n e cro i s pas qu ’ on do i ve changer laleçon des man . , qu i es t auss i cel le de Boul . ; &M l
;fi en
comme le veut l ’éd i teu r dan s les Add i t . e t C orr .J’
ai déj a eu l ’occas i on de prouver a i l leu rs (Glossa ire desmots esp . dérivés de l
’
ara be , p . 2 5 6 , v° bara ço) que UwJ -A
(corde) es t un s ing ; a ux exemples que j ’en a i donnés , onpe u t aj outer cet hém is t i che d ’Abou-Tamm â m (D ivan ,
man .
899 )
l /O$ lÜ
A w;æ° À 3\£5
e t Ibn Djobair , p . 9 4 ,l . 10 et 1 1 . Au pl ur . on d i t non
seulemen t ma i s auss i comme deetc . Auj ourd ’hu i en core ce pl uri el est en usage en Alger ie . A in s i on l it chez le généra l Daumas (L a vie a ra be ,
Te loug le m cro ss . Il t radu i t : « l e l â chemen t desl évri ers ;» ma i s dan s une l e ttre qu ’ i l a b i en voul u m ’
a
dresse r en répon se à quelques quest i on s que j e l u i a va i sfa i tes , i l d it : «Mcro ss ne veut pas d i re te'rriers ,
m a i s col
24
p. vin de la Préfa ce) on lit : 1, 13L5, « t
f>>t
Dan s Ahd-al-wâ h id , p . 206 , l . 16 : &…l r,,l l 6 5 Œ.£ Î l,
Chez Bâ dj i , H istoire des ém irs d ’I/rikiy a , p . 92 éd .
de Tun i s :,.g.5 Lä3l, ,
.Àà ê ; p . 1 17 :O
‘ “
1,x:e .x, ; p . 129 :
U. il, .s . e ,
,-it. x. 3 1xn,
…A Àb
5 p . 15 7 1,.g3l.â ë l Ü
'° l}gaÏ{
,.gà è l.fl3l.5 ; p . 145
8fié -l
L52>
L5. 5 Lî â l
, . Le par t i c i pe setrouve chez Ibn-Gab ib a ç -ç alâ t , m an . d
’
Oxford ,fol . 9 1 v
°:
M o,.09
08 5 51
08 3
Œ,Lu t l t x. 53 .>lU
n x..KÏÂ le s voyel l es son t dan s l eman . P. de Al ca la don n e la IVe form e aux art i c le s apos
temar a otro , concoxar a otro , enconar a otro , nzolestar ,
provocar a yra , et l e parti c ipe , qu ’ i l écr i t munguî , sou sdespechado p ar enoj ado , enconado ,
enoj ado , irado subite
m ente , m olesta cosa . Remarquez que , dan s la prononciat io n grenad i ne , le par t i c ipe ac t i f e t l e par t i c ipe pass if dela lV° forme des verbes défec tueux se c on fonden t . Dan sles quat re prem iers ar t i c les c ’e‘s t Œ£1«u (pour dan sl e cinqu 1eme c ’est (pou r Bocthor a
sous l es mo ts enrayer (fa i re en rager quelqu ’ un ) , p ique(fa i re pique à quelq u ’un) , p iquer (fâ cher , i rri ter) , lequ in er , e t l e par t i c ipe
L5Kà.« sous tagu in . Voi là don c c i nq ar
t icles de Bocthor , d i x d ’Alcala , e t d ouze exemples t i ré sd ’au teurs arabes ; j ’espè re qu ’ i l s suffi ron t pour vous conva i n cre que la IVe forme de Î £s ou Œ£3 , quo iqu ’
el le man
que chez Freytag , ex i s te , e t que , par co nséquen t , i l n ’ya r i en à changer dan s le tex te de Macca r i . Au res te , M .
de Goeje a prom is de parler de ce tte IV° forme dans le
Î ’.b
G lossa i re q u ’ i l a l ’ i n ten t i o n de j o indre à ses F ragmentahistoricorum Ara bicorum , e t i l en don nera des exemples àson tou r . C ec i é ta i t é c ri t l orsque j e reçus vo tre dern ière l i v ra i son . J ’y a i v u avec surprise qu ’en parlan t dupassage qu i se trouve l . 11 , p . 822 , l . 10 , vous voulez yl i re cette mêm e IVe forme (ce qu i n e me para î t pas néces
sa i re) , e t qu ’à l ’appu i d e votre op i n i o n vou s c i tez prec isément l e passage q ui a don né l i e u a ce t te n ote , m a i s san sré tracter votre an c ien ne remarque e t san s y fa i re la moi ndre a l l u s i on .
P . 225 , l . 2 . Quoique Boul . ait auss i e j e cro i savec vo us qu ’ i l fau t l ire m a i s c e qu i me para i tm o i n s certa i n , c ’es t que dan s l e B ay â n , t . II , p . 88 , l .7 , i l faudra i t l i re de toute n écess i té , au l i e u de
Ce tte dern iè re leçon est dan s l e m an . d’
Ibn-al
Abb â r , comme j e l ’a i d i t dan s la n o te e ; m a i s l ’a u tredon ne auss i un for t b on sen s , pourvu qu ’on pren n e Œl b .o ldan s l e sen s de brû ler (in s uum commodum ) , qu i n ’estpas dan s Freytag , m a i s q u ’on t ro uve dan s ce vers de Chanfarà (apud de Sacy , Chrest . , t . I I , p . tft , 5 )
U
'
.jän 612…
U..â â .i,i,
que de Sacy t radu i t (p . en s u i van t l ’ i n terpré tat i o nd u scol ias te (p . 5 88 , n . qu i expl ique Œ par
O «Combie n de foi s , pendan t une n u i t r igoure use oùle chasseur b rû la i t , pour se chauffer , e t son arc et sesflèches , son u n i que t ré sor , » etc . Ahdérame Il pouva i td ire for t b ien ce m e sembl e , qu ’ i l s ’é ta i t serv i des crucifix comme de boi s de chauffage .P . 227 , l . 2 1 . Le changemen t de LJ en L.J , dans les
26
Add i t . e t Corr . , es t non- seu lemen t i n u ti l e , ma i s i l a ura i tm ême pour résul ta t que ces pa roles sera i en t vi des de sen s .La leçon LJ , qui es t auss i dan s Boul . , est b onn e . Ibn
Khaldoun renvoi e , dan s ce rap i de aperç u , à l ’exposi t io ndé ta i l lée qu’ i l d on nera dan s la su i te .P . 229 ,
l . 18 . à)l . Le man . quas i-autograph e
d’
Ibn-Khaldoun ,que possède le Musée b ri tan n ique et su r
l equel M . Wrigh t a b i en voulu cop i er pour moi , i l y a
quelques an nées , ce tte l i s te de cadeaux , a la même leçon ,ce qu i
,toutefo i s , n e prouve pas en core q u ’el le est b onne .
L’
autori té d ’Ibn—Khaldoun e t de ses con tempora i n s est presque n ul le quand il s ’agi t de choses anc ien nes . C
’
é taient
de s imples copis tes qui m anqua i en t des con na i ssances e tde la cri t i que nécessa i res pour corriger les m an . fauti fssu r lesquels i l s t rava i l la i en t . Dan s n otre endro i t i l a é téques ti on d ’abord de cet te espèce de b oi s d ’a loès qu ’on n omma i t a ç
-Çan/i (voyez la n ot e a ) , et i c i i l do i t ê tre quest i on d ’une au tre espèce de c e b oi s . Or
,l es aute urs ara
bes , tel s qu ’
Avicenne (t . I , p . 2 5 1) Serap ion ,l bn-Djazla ,
Ibn—al—Bait â r, Ant â kî etc . , l e s ont é n umérées avec l e p l us
grand soi n ; ma i s chez e ux on n ’e n t ro uve aucun e qu is ’appelle a.,À l l , ou don t l e n om se rapproch e de ce t te orthographe , ce qu i prouve que la fau te es t l o i n d ’êt re légère . A mon av i s
, Ibn—Khaldoun a en so us les yeux quelque chose comme M l ou m il
,un m o t écr i t indistinc
tement et qu i , par un hasard quelconq ue , ava i t perdu sesdeux dern ières lettres , à savo i r
61 car i l m e para î t cer
ta i n qu ’ i l fau t l i re è5.3.1111 c ’es t de cette espèce deboi s d ’aloès , la mei l leure de tou tes selon l es Arabes , qu’ i ldoi t être questi on i c i ; c ’es t du mo in s cel le don t l e nom se
7
rapproche le pl us de Au reste la corrup t i on , quelque grave q u’el le so i t , n
’
a r ien de su rprenan t , car en général les adj ec t i fs qu i i nd iquen t l e s d iffé ren tes espèces deboi s d ’a loès e t qu i dé ri ven t de n oms propres indiens , son thorr ibl emen t m u t i lé s par l es c op is tes . Les man . des aut eurs que j ’a i n ommés e t l ’éd i t i on d’Av icenne en fourn i ssen t de n omb reux exemples .Ibid . , 19 . Da n s les Add i t . e t Corrl ’éd i teu r a rest i t ué avec ra i son à la 2° l ig n e de la p . 2 50 ,
la l ec on des man .
L51L. Ici et p . 25 0 , l . 4 , i l a ura i t dû
fa i re la même co rrec t i on . L’éd i teu r de Bou lac n e s ’y est
pas t rompé ; i l a par to u t avec l e ’
a in, ex cel len t ,
superflu . Dans le G lossa ire sur le Man ç ouri (man . 5 5 1
v° T i bet) on l it : LS . it..ii et l ec op i ste de n otre excel len t m an . a pr i s s o i n d ’aj ou te r u npet i t ’
a in sous le gra nd . Dan s un passage des M il le et une
nuits , où i l est quest i on de b o i s d ’a loès c omme dan s n o tret exte , ou t ro uve ( 1. III , p . 65 ,
l . 1 éd . Macnagh ten)
L5,Ls äl l Ü» ,
a, (lis . èàî£î l 1) Œx. .a l t L%1 5, , e t
l’éd i t i o n de Hab i ch t por te en cet endro i t (1. IV, p . 95 )
L5 )L.äl l o
_,a l l
,P,
ce que l ’on peut cons idérer comme un e b on n e i n terpré ta t i on d u compara t i f
Ce t JL : est l e sy non yme de) ,5Lfll l
dan s la dern ie re l ign e de ce t te page .P . 250 , 1. 5 .
615
, g, . 31 11 es tcer ta i n q ue l e dern i er mot es t a l téré . Vous proposez de
1) Ce tte correction a déj à é té faite par n. Lane .
28
l i reÛl f>
Un m
, e t vous pen sez que ce Ê \ à> es t le persan e
'
la/fe de soie blanche . Cet te conj ec ture m e semb le i nadm iss ib l e pou r deux ra i son s . En prem ier l i eu , l egén i e de la langue arabe s ’y oppose Votre sera i t det rop . Quan d on veu t parler d ’une p i ece de soie , on peutb i en employer l e
va, ma i s à la cond i t i on que l e nom de
l ’é toile ait l ’a r t i c le , S H m .æ , comme à la prem ie reU
l igne de cette page de Maccar i . Or , votre n’
a pas
d ’a r t i cl e , et l ’on n e dit pas Un ce sera i t un
b arb ari sme , tou t comme s i l ’on d i sa i t en a l lemand : ein
S luc/c von Seide , au l i e u de : ein S ta ck Seide; on d i t XË.‘J:A i n s i on l it dan s l ’Akhbâ r madj m ou ’
a (p . 69 , l . 1 1éd . Lafuen te) : }5 là …. Chez lbn—Iyâ s (H istoire d ’Egyp te ,man . 5 6 7 , p . 3 7 7 ) -L b l Xä…
U" °
Vous en t rouverez en core deux exemples chez Quatremère ,
H isl . des su it . m am l . , t . Il , par t . 2 , p . 2 12 , e t j e pourra i s en c i ter beaucoup d ’au tres , m a i s j e c ro i s que ce sera i t i n ut i le . Eu second l ieu , vous a ur i ez dû p rouver queles Arabes du moyen â ge ont réel lemen t employé l e m o t
persan pou r dé sign er u n e cer ta i n e é toffe . J’
exige
en core davan tage . Les n om s d ’étofi‘
es n ’ex i ste nt ord ina i rem en t , comme vous savez , qu ’
à un e cer ta i n e époque; chaque sxecle a pour les étoffes des n oms que pl us tard on
n’
employait plus , parce qu ’on ava i t remplacé les é toffe sm êmes par d ’au tres . I l en a é té a i n s i e n Ori en t auss ib i en que parm i n ous . I l n ous faut donc un nom d ’é toilequ i s
’
employa it du t emps d ’Abdérame III , c ’es t-à—di re a u
X e s i ècl e , et qui s’écrivait a peu près comme le de
29
no tre tex te . Eh b ien , un te l mot , d ’or ig i n e persan e e t
employé par le s Arabes au Xe s iècl e , ex i s te , b ie n qu ’ i l n ese trouve n i dan s le s d i c t i onna i res arabes , n i dan s les d i ct ionnaires persan s : c ’est
6315)ou Un éc r i va i n d u
X e s i èc le , Tb a ’ â lib î , n omme le dan s deux de seso uvrages (voyez son L a tâ i/ a l p . 1 16 ,
l . 12 ,e t
comparez l e Glossa ire que M . de Jong a aj ou té à son édit i o n de ce l i vre) ; c ’é ta i t , se lo n l u i , une é toil e qu i sefabr i qua i t à Naisâ bour e t qu i ava i t d e la rép utat i on . Jel i s par con séquen t : 'ÂËz.£o e t j ’ose con s idérer ce ttecorrec t i on comme cer ta i n e . Si vous voulez p lu tô t l irecomme chez Tha ’â lib î , j e n e m ’y opposera i pas; m a i s j esera i s porté à c ro ire que le m o t s
’
écriva it avec o u san se'
li/. En effet , es t un e or thographe qu i deva i t p la i reaux Arabes pl us que â ÀÂ -l) . Permettez-moi encore u nerem arque ava n t de term i n er cet te n ote . Th a
’
â lib î , comm evous l ’avez v u , n ous a m is en é ta t de corriger dan s cettel igne l e tex te de Maccarî ; en revan ch e ce dern ier , dan s lal ig ne su i van te , n ou s m et à même de corr ige r cel u i d eTha
’
â libî , p . 7 2 , l . 8 . M . de Jong y a fa i t impr imer,e n
s u ivan t l e m an . de Leyde : M l,
a g» J l s .Ïa l…5$ iî 9 Lâ i i l ,
e t dan s un e n o te i l a dit que le man . de Gotha porteM &x& 3i, (sic) . C
’est év idemmen t aL »œJ l , e t quoique j en e pui sse pas expl i quer l ’or ig i n e d u n om de ce tte étoffe ,j e cro i s cependan t que cette lecon est la vér i table , d ’abordparc e que le man . de Gotha est l e p l us correc t des deux
,
en su i t e parce que chez Maccar i on l i t auss iIbid . , l . 1 1 et n . c . Boul . a
Û ,Üà l l , et l e man . quas iautographe d’Ibn-Khaldoun porte
Ü )3}àl l (sic) . Cependan t ,
50
comme un te l m ot est i n con n u , j e c ro i s devoi r l ire O , ;fi il ,comme l’a proposé l ’éd i teur , car cet te é tofi‘
e é tait e n usageau X e s iècle ; voyez Tha ’â lib î , L a tâ i/ a l-ma
’
â rif, p . 125 ,
l. 8 . Je regret te de n e pas pouvoi r d i re quel est l e dern ier mot de cet te l ign e dan s le m an . quas i-autographe , carm alheureusemen t un v i la i n i n sec te y a fa i t u n grand t rou .
Dan s les Add i t . et Corr . , l ’édi teu r se borne à d ire que lal eçon du tex te , œ% l l , es t b on ne . J ’aura i s vo ulu qu ’ i l l ’eùtexpl iquée . x . l.@ n e s ign ifie que cadeau : or , quel sera i t l esen s de
ë ’3M ? Des sel le s q u ’o n don n e en cadeau ?
Ma i s cela ne se dit pas a i n s i . Ou b ien : des sel les pou r l e schevaux qu ’on donn e en cadeau ? Al or s i l faudra i t prouverque a ce sen s ; j e n e l e l u i con na i s pas , et j e c ro i sque l ’éd i teur é ta i t p l u s près de la vé r i té
,l orsqu ’ i l soup
connaît , dan s la n ote d , que l e m o t es t a l té ré . Au resteBoul . a auss i wL+%l l.Ibid . , n . e . Dan s le man . qua s i-a utographe d’Ibn-Kha l
doun , c ’est œL….ä. a en deux mot s , ma i s avec deuxpoi n t s sous le E videmmen t l e secré ta i re d’l bn—Khaldounne l e comprena it pas ; ce qu ’ i l a é cr i t n ’es t qu’un facsimile . Je c ro i s qu ’ i l faut l i re Le mot Œ;est auss i l ’épithète d ’une pièce d’étoife chez Ibn-Badroun ,
p . 45 , l . 7 , e t semb l e ê tre , comme je l ’ai d i t dan s l eGlossa i re , l ’équ i va l en t de L5 )
s a, long de dia: coudées.
P . 241 l . 5 . &äâjs n
0x9, F
' SJ ‘ La compara i sondu Ma lmah (L . et que Maccar i a ab régé i c i , vous conva i n cra à l ’ i n stan t m ême que votre so i-d isan t correc t i on ,ww au h eu de (leçon qui est auss i dan sest m sou tenab le . Il porte : x…: 5.5i F
SJ
5 2
Ibid . ,20 . Votre i ngén ieuse conj ect ure , es t
confirmée par Boul .P . 245 ,
l . 15 . Je croi s a vec vous qu ’ i l faut hifi‘
er l eaprès Dan s B oul . la d i ffic u l té es t é l udée ; i l a
Lç5 J Î M 5 ; m a i s c ’es t m auva i s .P . 244 , l . 6 . Certa i n emen t comme vous led ites . Boul . 5.3t
L5“ 9l'
P . 15 . u.£L» C’es t
a i n s i que l ’éd i teur a for t b ien corr igé i c i la l eç on faut ivedes man . (auss i dan s Boul .) ma i s i l a été m al i nspi re , lorsque , dan s les Add . e t C or r . ,
i l es t reven u su rson Op i n i on , en d isan t qu ’ i l faut l i r e m x .> et que c ’es tl ’équi valen t de x. 5, Je ne m ’
arrê terai pas à prouve rque xè
,Ë> …t :ç ne se d i t pas et n e pou rra i t
O '
.
pas se d ire ; I l m e suffi ra de remarquer que n’
ex1ste
pas comme nom d ’ac t i on du verbe c ’est,comme
l’
a fa i t obser ver M . Lan e , un e faute dan s l e Câ mous; i l5 O 4 O ofau t Or , comme la run e avec a â Àc et … ex1ge
un a i dan s le mo t don t i l s ’ag i t , i l s ’en su i t que m 5 se0 o o
ra1t 1nadm1smble . aw , au con t ra1re , es t parfa i temen tb on . Le verbe c.
èL> s ’emplo ie préc i sémen t quan d on parlede cel u i qu i ravage e t qu i p i l l e l e pays de son en nem i ;comparez ch ez Maccar i , t . II, p . 8 10 ,
l . 22 (of. Add . e tC orn ) : ts
k° .. 5L> « l es chré t i e n s ravagèren t e t p i llèrent l e pays des musulman s ,» voyez a uss i Ibn-Djobair ,p . 504 , l . 9 ;Zeitschr . der d . maryen i. Gesellschaft , t . XXII ,
5 5
p . 105 , n. 58 . La Ve forme su rtou t est fréquen te en ce
sen s , b ien que les d ict i on na i res n ’en d isen t r i en ; voyezMaccar i , t . I , p . 208 , l . 2 1 (où X.SLm J l son t : l eshab itan t s des fron t i è res) , p . 87 4 , l . 22 ; Ibn-Khaldoun ,
P rolegom . , t . I I , p . 2 14, l . 4 ; H ist. des B erbères , t . II ,p . 85 , l . 6 a f. : « p i l le r les voyageurs . »Ibid . , 16 . Boul . comme dan s les Add . e t Corr.Ibid. , 1. 19 . xstt.t:i
U..
Vou s d i tes qu ’ i l fau t l ire et m a i s permettezmoi de vous d i re que vous vous ê tes trompé . I l y a d an sle texte une a l l us io n à ce vers de Nâ higa (p . 87 , vs . 18
é d . Hartwi g Derenbourg) , qu i se t rouve c i té dans la Seconde Part ie de Maccari (t . II I , p . 152 , l . 10 éd . de Boulac) :
04113 X5LÈzUl 0 Lfl: a5LÀ: ÎÎ LŸ U 4 5 '
)…«ÈÈ lîç
Al-Fa th fa i t a uss i a l l u s i on à ce vers quand i l d i t (Ca lâ ïd ,p . 96 , 1. z éd i t . de Pa r i s) : L.,îtî
« 0 523 3.5L'a Ul Vous voyez don c
que l editeur a e u ra i so n san s l e savo i r , l orsqu’ i l a prononcé 0 1513 I l s ’en su i t que l ’a utre verb e do i t ê tre aussiau pass i f , san s compter que votre 0 .5 Î : n e don nera i t pasde sen s . I l s ign ifie critiqu er , comme j e l ’ai observé dan sme s L oci de A bbadidis, t . I I , p . 148 , l . 2 1. Vous c onna i s sez for t b i en cett e accept i on ,
comme l e prouven t deuxde vos correct i on s s u r la B ibl . Ara b . S ica la , p . 6 45 , dem .
l . , et p . 6 46 , l . 9 ; cependan t , comme el le manque chezF rey tag , j e c itera i en core ces exemples : Macca r i , t . I ,
3
5 4
p. 2 ,
p . 5 47 ,I. 8 , p . 662 , l . 16 , p . 6 7 9
1. II , p . 286 ,l . 5 a i. , p . 406 , l . 1 6 , p . 4 ,
p. 6 5 1 l
. 19 ; Ibn-Khallicâ n , t . I , p . 195 , l . 1 2 éd . deS lane ; l bn-al-Kha t i b dan s Mül le r , B eitrage , p . 1 2 , l . 1 1l bn-Khaldoun ,
P role'
gom . , t . I I , p . 16 5 , I. 5 ; Ihn-Haiy â n
(apud Ibn-Bassâ m ,t . I , m an . de M . Mohl , fol . 49 r
°
)0 .:œ « ses poés ies son t b elles selon
l ’opi n i on des cr i t iques , » e t a i ll eurs (apud eundem , t . III ,
man . de Gotha , fol . 5 X.5L5613(AM E 330 ,
« par
con séquen t,aucun e r im e n ’é ta i t à l ’abr i de sa. cr i t i que . »
Ibid . ,l . 2 1 . Dan s l ’hém istiche
u lË .ll & : 4 2A ÔL.S \LË \J l W ,
i l faut prononcer x . : ËÂ e t l ire , au l i eu de X: 4Â A , qu i nes ign ifiera i t r i en , m a» , comme o n trouve dan s le Ma tmah
(dan s Boul . c ’est W ) c ’est-à—d i re  . : Ïzl . Voyezmes L oci de Abbadidis , t . I , p . 10 1 n . 147 , oùj
’
ai c i tée t expl iqué ces paroles .P . 247 , l . 6 et n . f. Chez ’ Ibn Bassâ m , t . I , man . de
M . Moh l , fol 7 5 v°:
c }ñx : ŒÊU i;L«> LÀA;Â> LÀÎ Ê J
,
Ibid . , 2 1 e t 11 . k . L i sez ou e tvoyez mon Glossaire des m ots esp . dérivés de l
’
ara be , p . 295 ,
I] .
P . 2 50 , I. 5 e t n . a .
)l la sël l Œil w :
35 5 3 1 ,.æ ll )L$ \xl l U
n 3 L@ . Le m o t
pour l equel Boul . a ce qu i est u n de ce s changemen ts a rb i tra i re s que les éd i teurs ori en taux se perm et te n ttrop sou ven t , est a l téré , comme M . Wrigh t l ’a soupçonné ;
35
ma i s les deux conj ec tures qu ’ i l propose son t i nadm iss ib les .I l ava i t la b on ne leçon sous les yeux , à savoir cel l e desdeux man . d
’
Ibn-Khaldoun : C’es t selo n toute ap
parence l ’ i n suffi san ce des d ic t i on na i res qu i l ’a empêché del’
adme ttre ; ma i s l e verb e pour l equel Ibn-Khaldouna un e grande préd i lect i o n , s ig n ifi e envoy er , so i t secrète
m en t , soi t ou vertem en t , e t i l se con str u i t avecc
‘ ” ou avecde la person n e à qu i l ’on en vo i e quelque chose . Il
s ’emplo i e surtou t en parlan t d ’un envo i d ’a rgen t,m a is
auss i en parlan t d’un en vo i d ’a rmes , de t roupes , e tc .A i n s i o n lit dan s l’H istoire des B erbères (t . I , p . 1 65 ,
l .L513 L%M :
, L55 al l, :nl
Üm $ ül fi l ÙUa L—l
x
Ï
:Î 5 « l e s ul tan Abou—’l-Hasan e nvoya des sommescons idérab l e s aux fi l s de la pr i n cesse Gb im si et aux gen sde la t r ib u , afin de se fa i re l ivrer l ’avent urier ; m a i s e l l es ’y opposa .
» A i l l eurs (p . 2 25 , l . 0 . . Ê L551gr
s "
s£s LloL55,
«AI-Câ id se p orta au-devan t de l ’en n em i et fi tpasser sec rè temen t d e for tes sommes d ’argen t aux t roupeszenatiennes. Hamm â m a , s ’en é tan t aperç u , dem anda lapa i x e t fi t sa soumi ss i on . » Pl us lo i n (p . 5 80 , I. 2 a f .)
ss, .s : L,1. .ta.ts , « i l l u i
con serva sa place et l u i envoya régul iè remen t assez d ’argen t pour s ubven i r à t ou tes ses dépen ses e t à la solde del ’armée . Dan s un autre endro i t (p . 47 1 , l . 9 ) cr
… ,
s .l l xx: L> . . si , « i l s ’engagea envers l u i de l u ifa i re parven i r régul1erem ent l es impôts fourn i s par ce pays . »Pl u s loi n (p . 5 16 ,
l . àl, .æ>l lO
‘ ”
3 *
5 6
« i l le ur envoya i t de s secours en argen t ,en a rmes et en troupes . » Voyez auss i p . 5 07 , l . 4 a i. ,
p . 5 58 ,l . 15 ,
p . 5 94 , l . 5 , p . 5 a i. , p . 62 1 ,
l . 16 ,p . 12 , p. 655 , l . 6 a f. , etc . Dans un au
t re endroi t (t . II , p . 437 , l . 14) l e texte estg ravement
a l téré . On y lit : s0. : g fä.l l
L531 Œ? LSJü1
I l faut y subst i tuer : s0. :61: U
}4‘
a .ll Œil
c omme on l i t dan s l ’éd i t i on de Bou lac , c ’es t-à-d i re : «AI
Fercâ dp donna secrètemen t l ’avi s de refuser sa pa ie à ce
chef. » Dan s un passage des P role'gomènes (t . III , p . 23 1,
ce verbe s ign ifie mettre de la fausse monna ie en circula tion ,
Q..U. lt Ώ
‘
Au reste , on se trompera i t si l ’on pensai t qu ’
Ibn-Khaldoun est l e seu l qu i emp l o ie ce verbe dansl’
acception que j ’ai i n di quée . Je la t rou ve auss i chez un
au teur b eaucoup p l u s an c i en , Ibn—Bassâ m . En par lant duj u i f qu i ava i t prom i s à Mo
’
taèim d’
Almérie de l e p lacers ur le trôn e de Grenade , i l dit (1. I , man . de M . Mohl ,fol . 20 1 65 5 5 1 Ü :
l —Si « a l orsMo
’
tacim l u i en voya secrè temen t des sommes for t considèrables. »
Ibid . , 2 5 e t note c .
t' “3‘ä3
35 3 531 L11
&x £>lL5
..l l U:o: gÀlL: J. â x>
r« lfl:
Œ: t. L
’éd iteur d i t que le s man . porten tI l n ’au ra i t pas dû changer ce tte l ec on , qu i est auss i dan sBoul . e t qu i est la b on ne . Le sen s est : « i l ordon na à
Dja ' far de se met tre en rou te p our a ller chercher son frère . »La prépos i t io n
us" a quelquefo i s ce sen s , comme dan s la
Chrestoma thie de Kosega rten ,p . 1 13 ,
l . 12 :LÀ LL
°
> Lç %Â A Q .>l, Ô'° UM 3:A Â î ä_
x_J,
« i l s m ’
envoyèrent
pour a l ler cherche r ces deux person nages , a fin que Mounis eû t avec chac un d ’e ux un en tret i en secre t . » E t 15
r
x>;äè , « Dzaki par ti t pour a l ler le s cherche r . »
Chez Ibn-D ibya (man . d u Musée b r i tan n iq ue , fol . 107 vo)
0 1] lit : Ôl}£ l l
Jf0 sg Uw} _
5 \À l W L:J ,
s l,ï i x..
ê,e t pl us l o i n (fo l . 109 LQ
,: 38
Et chez n otre a uteur ( t . I I , p . 804 ,
1. :,î Ïi
: Lî .x: L.: Dan s vos n o uvel les observat i on s vous d i tes , au suj e t de ce pa ssage (p . 20 1 qu ’ i lfau t subst i t ue r Œi l , comme on l i t dan s Boul . , à Lsè ; m a i sc ’e s t un e e rre u r . Le qu i san s d ou te n ’es t qu ’ unchangemen t a rb i t ra i re d e l ’éd i te ur égypt i en , n e c onv ieudra i t pas , car l ’aute u r n e veu t pas d i re que le pri ncech ré t i e n « en voya un message » a u s ultan , m a i s qu ’ i l l ’envoya chercher , qu ’ i l l e fi t ven i r en sa p résence , commel e mon tren t les parole s qu i su i ven t .Ibid. , 1. 24 e t n . d .
C,.
&,mül 5 5 631 Le : ) I l y a i c i deux fau
tes à corr iger . D ’
abo rd i l fau t l i re avec l e h âvoyez ce que j ’ai dit dans l e J ourn . asia t . de 1869 , t . I I ,p . 158 . B oul . a la bon n e leçon . En second l i eu , i l fau tconserver la l eçon de presque tous l e s man . e t qu i estaussi cel le de Boul . , à savo i r et ne pas la changere n
551. Les express i ons Ùëls U n Un g.3 e t C915 L,
. à
sont synonymes ; l ’ une et l ’autre s ign ifien t : a ller chercher
quelqu’
un . Dan s la remarque précéden te , n ous avon s vu
5 8
qu ’on ditÜëL5
u" il envoy a cherch er un tel , e t l ’on
ditU>Lê
Un ou
Ù\J .:
Üdan s l e même sens .
A i n s i on t rouve chez Maccar i (t . II , p . 25 , l . 0 m £s l,
:,0 a l l
Lgl i,.gà :
Dan s u n autre passage (t . I I , p . 413 ,
l . 2 e t 5) Maccar i a é cr i t : : .Ëç
.xx ii l,M è _ _ wlfl m lü
.» Xl lL5
. 5l U“ L;° U? , : l
x: .l l r%J Î M Ù; ma i s l bn-Bassâ m , qu ’ i l pré
tend cop ier,a écri t (t . I , m an . de M . Moh l , fol . 78 v
°
)
xl iOs - x$, et Evidemmen t n ot re a uteu r a
voul u évi ter i c i cet id i ot i sme , qu i de son temps n ’ é ta i tpeut-ê tre pl us en usage . C ependan t i l n ’en ag i t pas t ouj ours a i n s i , comme nous l ’a von s v u e t comme le prouveauss i ce passage qu i se trouve dan s la Seconde Pa rt i e deson l i vre (t . III , p . 5 7 , l . 2 3 éd . de Boulac) : x
,:
Œt= Dan s l ’Histoire de Maroc
i n t i tulée a l-Hola l a l-mauchiya on l i t (man . fol . 5 7 r°)LIS,
z:Ç\ê£ : Ë,,
a,gt. C hez Ihn—al-Khat i b (man . de M . de Gayan
gos,
. fol . 99 VO) : :J6’ a l .: On peu t
auss i comparer , pour ce qu i con cern e cet emplo i de lapréposi t ion
on, ce passage d’Ibn-a l-Khat ib (man . de M . de
Gayangos , fol . 9 7 r°
) ty< l . l i
ÛÎ l}
°
-
°
S di W È,
‘çÎyælf25 Ü
A ©0 0 55,
a $ \l« fi l ( « on se rend i t aux arsenaux pou r y chercher des armes
40
trouve (man . 15 50 , t . IV, fol . 5 5 ale ,Ï,Œ$
cul»Uidl l —$ Sb Lîx b . Dan s son H istoire des B erbères
(t . I , p. 45 2 , aw611835
MÙtL531 &g,
œ5 . A i l le urs (p . .L=M 1
agit,» U" ° P lus lo i n (p . 5 19 , l . 7 a
UnQt.l —Dan s un autre endroi t (p . 5 20 ,
l .O” aïä, J _ zü
,gLS
. l :=Ul la l…dl
ÙLf
e t un peu pl us b as ( l . -,l…l î M il, »
Un .
Voyez auss i p . 5 52 , l . 7 a f. , p . 5 44 , dem . I. , p . 5 5 5 ,
1. 9 ,p . 5 5 8 , l . 4 , p . 2
, p . 7 a f. , p . 625 ,
l . 2 ; t . I I , p . p . 8 , e tc . Une foi s(t . II , p . 5 5 1 l . 5 a f.) on t ro uve e, ,3La ,
&3L?}læ o
U" a…
Um
,et l à où l ’éd i t i o n ( t . II , p . 5 54 ,
l . 12 ) porte : U" °
Üî, xo,
n ot re man . 15 50
offre ma i s j e m e t ien s pe rsuadé que c ’est u nefau te , et que , dans le p rem ier passage , i l fau t sub s t i tuer
à Avan t de qu i tter ce suje t , j ’observerai encore qu ’on a formé d u pl ur .
ë ,lÊ= l ’adjec t i f
L5J t, J t , l i t-on dan s l’Histoire des B erbères , t .
I , p . 3 .
Ibid . , 1. 19 .
(,aDans la n ote 0 ,
l editeur don ne la var ian te e t dan s les Add . e tCorr . i l dit qu ’ i l fau t l i re a i n s i . I l est vra i que c
’
est l em o t vér i tab l e , e t comme Ibn-Khaldoun ,
que Maccar i asu iv i , a constammen t -M …t , on doi t adopter i c i cet telec on . Ma i s en généra l l e s au te urs o u leurs cop i stes écriven t i nd ifféremmen t o u dan s ce t te phrase ,qui es t extrêmemen t fréquen te chez les ch ron iqueurs;voye z
4 1
Maccari , t . I , p . 146 , l . 16 et n . e , p . 5 5 8 , l . 12 e t n .
f , où Boul . a auss i L’
au te ur du Cartâ s écr i tcon stammen t l e mot de ce tte man i è re .P . 2 5 9 , l . 1 1 . Au l i e u de l i se zdan s BoulP . 26 1 ,
n . 9 . On lit comme l ’éd i teur le propose
,dan s l es fragmen ts du Ma tmab qu i s e t rouven t à la
fi n du man . d’
Ibn-Bassâ m que possède M . Mohl .P . 269 , n . c.
Un,a uss i dan s Boul .
P. 285 ,l . 10 . Chez Ibn—Bassâ m (t . I , m an . de M . Mohl ,
fol . 1 1 v°
)
.1,
—. as as
,. 1.
P . 290 ,l . 2 1 . Bon ] . comme dan s les Add . e t Cor r .
P. 298 ,l . 2 1 . Boul . a a uss i
,tç—l .
P . 505 , l . 1 5 . Ce se trouve auss i 1. II , p . 84 ,
l . 15 ; m a i s là vous l ’avez changé (p . 509) en -. M l.
I l faut fa i re i c i la même correc t i on , car la X° forme deâ fi
n ex1ste pas .
P . 506 ,l . 1 . Boul . 32 5 1» (bon) .
P. 508 ,l . 8 . a. L» un .} Pron oncez au passi f
353
5 , « il pr i t la somme à laquel le l ’épée ava i t é té é va l uée . »P . 5 09 , 1. 18 . S..—a s
t‘
a}. l I l faut pron on cer e t l i recomme on trouve dan s Boul . , au l i eu de « nous nousten i on s les côté s de r i re , ‘ à cause de sa p i quan te plaisanterie .
» Vous voyez que le pronom est absolumen t nécessa ire . Le mot sig n ifie p laisan terie , comme j e l ’ai déjàd i t a i l leurs (L oci de Abbad . , t . I I , p . 25 4 , n . e t on
42
le trouve souven t dan s ce t te accep ti on ch ez Maccar i . é) ;est propremen t tranchan t , a/Ïi le
'
, en parlan t d ’ un e épée , etfigurément (comme dan s a ca tnm dictnm) p iquan t , en parlan t d ’une pla i san ter ie . A i n s i l bn-ai-Kha tîh (man . M . deGayangos , fol . 22 r
°
) fa i t men t i o n d ’un person nage qu iava i t la c ou tum e de d i re
O‘ “ ajL5 \ll
.5. 5 1.m ê, il älàüî,
« des b on s mots ‘ ,quand i l se
{
trouva i t dan s une ré un ion de gen s s imples e ti gn oran ts , sans en r i re et san s qu ’aucune de c es plaisanteries , quelque p iquan te qu ’el l e fû t , l u i fit fa i re u n mouvemen t . » C
’est , j e cro i s , de ce qu ’on a formé leL..
n om d ’act i on qui s ign i fie dire des p la isanteries , acception qu ’on cherchera it en va i n dan s les d ic t ion na i res .A i n s i l ’au teur que j e v ien s de n ommer , a placé (man . ,
fol . 158 r°
) dan s la v i e d u sul tan de Grenade sous leque li l a é té prem i er m in i st re , u n paragraph e i n t i tu lé :W
,.
ÜLb l… l i , où i l racon te ce q ui s u i t :
131, L5
1 s,
J..f, it a l l l .SLäè après quo i i l aj oute
t p“
,fll Ai l leur s (fol . 142 v
°
) i l d i t
Ü…> ;L>. Dan s la Seconde Par t i e de Mac
car i (t . III , p . 6 7 9 , l . 24 éd . de Boulac) , on t rouve
1) Plu s lo in j e parlerai de l ’expre ssion 25 L>
45
8 3s u n s Le Plur . s ign ifie bons m ots , commechez Macca r i , t . I , p . 224 , l . 4 .
P . 5 15 , l . 6 . _Êfi Au l i e u de ce m a le ncontreux . b 3, qu i n e s ign ifie r ien , Bou l . donne l ’excel len teleç on . b 5 LË: è) .
Ibid . , 7 e t n . d . Dan s l e Glossa ire des m ois esp . de'
r ive'
s de l’
a ra be , p . 269 , n . 1 , j’
a i déj à eu l ’occa s ion deré trac ter l ’expl i cat i on d e la seconde moi t i é de ce vers quej’
ai don née dan s la n ote d . El le é ta i t u n peu aven tu reuse,
m a i s permettez-moi de vous d i re q ue la vô tre n e l ’es t pasmoin s . Vous t radu isez : «Di s : « ô to i , c ’està-dire , aj outez—vous : ô toi , ba rb are ! Ma i s j e vous pri ede voulo i r b i e n remarque r que Maccar i a emprun té cet techan son , connu e i l l e d i t l u i—même (p. 5 12 , l . 1 e t
à l ’ ouvrage d’Ibn-Sa ’ i d , c ’es t—à-d i re , d ’Ali ibn-Sa ’ i d , e t quec e dern i e r la t ena i t de son père , c ’es t—à-d i r e , de Mousâ
i bn-Sa ’ îd , qu i la t ena i t d e l ’au teur . Par con séquen t , el l ea é té c omposée avan t la mor t de Mousâ i b n-Sa ’id , c ’es tà-di re avan t l ’an née 1242 , tand i s q ue l e cé lèbre T im ourou Tamerlan n aqu i t e n 1 5 56 . Commen t don c l e chan sonn i er a—t-il pu l e n ommer ? Les conquéran ts sera i en t-i l sdéj à fameux un s i ècl e a van t l eur na i ssance ? I l es t vra 1que cela arr i ve quelquefo i s , e t s ’ i l s ’ag i ssa i t d ’un au teu rhébreu
,j e n ’
osera is pas vous con tred i re . Isa ïe , à en cro i rel es i n t erprè tes b i en pen san t s de la B ible , a b i e n n omméCyrus , qu i n e deva i t ven i r au monde qu ’ un s i ècl e e t dem ip l u s tard . On a même t rouvé l e n om de Napoléon dan sl’
Apocalypse . I c i , t ou tefoi s , n ous avon s à fa ire , n on pasà un p rophète , ma i s à un poète popula i re qu i chan ta i t l e
44
vin e t l es b el les , sans se p iquer de pouvo i r préd ire l ’aven i r
.Je cro i s que nous feron s b i en , vous e t moi , de n e
plus n ous occuper de ce t h ém is t i ch e et d’
avouer franchemen t que nous n e le compren on s pas .
P . 3 15 ,l . Boul . auss i
P . 5 16 ,l . 6 . L i sez J aLÎ £t tii Les deux vers se trou
ven t chez Ihn-Bassam ( t . I , man . de M . Mbhl , fol . 1 1 7pas de var ian tes .P . 5 17 , l . 14. Dan s vot re prop re i n té rê t , j ’aura i s vouluque vous n
’
eussiez pas déclaré que les mots : L Â . Î _, J ,
son t v ides de sens , e t que vous vous fuss i ezépargné la pei n e de proposer u ne conj ecture extrêmemen tm alheureuse . Le tex te est parfa i tem en t correct e t s igu ifie
,comme j ’ai tradu i t dans mes Recherch es (t . I , p . 240)
«E t s i Mortadh â a va i t s u gagn er n os cœurs o u plu sl i tté ra lemen t : « Et s i n ous é ti on s avec l u i de cœur e td ’â me à sou s-en tendre : la v i c to ire se sera i t déjà déclarée pour l u i , vous auri ez déj à é té ba tt us , ou quelquechose de semblable . I l y a el l ipse de la propos i t i on corréla tive après la propos i t i on suppos i t i ve expr imée par , . l
voyez ce que j ’ai d i t p l us hau t , p . 1 7 ,18 . Je s ui s b ien
é tonné , j e l ’avoue , qu’ un savan t te l que vous , un p rofondgramma i r ien , un grand con na i sseur du Coran , se soi t la i s s éarrê ter par un e el l ipse de ce gen re , qui es t i n d iquée dansl es gramma i res ‘ , don t on trouve des exemples dans leCoran , et qu i est fréquen te ch ez l es h i s tor i en s .
1) De Sacy , Gramm . a r . , t . I I , p . 4 64 ; Ewald , Gramm. cri t . , t . I I ,p . 3 1 8 .
45
5 18 ,1. ae. (var .
Vo tre conj ec ture , a. b , , es t i nadm i ss i bl e . Ce verbe n es ign ifie pas : se j eter en sau tant sur l
’
ennemi , comme vousl e s upposez . I l s ign ifie : fa ire un soubresau t , e t i l s ’emplo i e , n on pas en parlan t d ’ un ê tre h uma i n , ma i s seulem en t e n parlan t d ’un ch eva l , et j e vous défie de me montrer chez les ch ron ique urs u n seu l pa ssage où i l es t emp loyé e n parlan t d e solda ts . La vér i tab l e lecon n ’es t pasd iffic i l e à tro uver . est cel l e des me i lleurs man . e taussi d e Boul . , e t dan s les man. magrib ins , où le à s’éc r i t avec le poi n t au—dessous , r i e n n ’es t p l u s fréquen t quela c onfusi on de ce tte l e ttre avec le I l fau t donc l ire,âÆt ..1. lt « i l s t i n ren t ferme e t D i eu l eu rdon na la v i c to i re . » La correct i o n es t certa i ne , car cet tephrase se trouve fréquemmen t chez l es h i stor i e n s .P. 5 52 , l . 15 . .>Ll .l l L i sez avec l e man . 0
c’es t-à-d i re , .>Î . Â i l t (part i c ipe d e la VII, forme deép i thète ord i na i re de la lance . Voyez mes remarques
dan s mes L oci de A bbad . , t . Il l , p . 16 1 .
P. 5 5 5 , l . 15 . MM
J.,—9 . Vo treW £> n ’ex i ste pas .
Il fau t l i r e avec O . et Boul . :dan s le sen s de lnstrnm (leon i s) . C
’es t—exactemen t
comme on d i t :Ûsfil t C ompa rez dan s m es L oci de
Abbad . , t . 1 , p . 421 , 1. 11291
Ibid . , l . 22 . Votre conj ecturea c on tre el l e t ou s le s m an . e t Boul . Je la croi s i n u t i l e .Le sub stan t i f s
’empl oi e en parlan t d ’un e troup e d ’hom
46
m es ,comme chez Ibn-Khaldoun , [l ist . des B erbères , t . I
J o .p . 495 , l . 10 : L9' 5° L
’
auteur aen vue les ba ta i l l on s e t l es escadron s qu i arr iva i en t s uccessivemen t au camp .
P. 334 ,l . 15 et n . c . Vous avez oub l1e de rest i tuer i c i
la lecon des man . (et de B oul .) .5Lm l31, et de renvoyer àvotre note , dan s les Add . et C orr . , sur t . I I , p . 7 5 4 l . 15 .
P . 5 46 , l . 6 . L i se z Le verbe
UL. qu i su i t , do i t se pron oncer ;;Ç. C
’es t u n p rov i n c ial isme ; la IIe forme de que la langue class ique n ’ava i tpas , s ign ifia i t en Espagne p ayer , comme P . de Alcala l’a ttes te sous p echar .
Ibid ., 9 . B oul . con fi rme vo tre correct i on .
P . 5 47 ,l . 14. B ou l .
ëLs,11 .. àiä> œ"
P . 548 , l . 7 . Bifi ez _ àœ.; B oul . n e l ’a pas.
P . 5 5 1 , l . 1 7 . Boul . a comme vous avez corr igé .
P . 5 5 2 , l . 19 . Ni l ’éd i teur n i vous n e semble avo i r rem arqué que les paroles
à… formen t un vers . L ’
édi
teur de Boul . n e s ’y est pas t rompé .P . 5 6 4 , l . 1 . Boul . n o us met en é ta t de comb ler cet te
lacun e . I l faut l i re :8 ” O
..
8 ,… L.
l..oOA .)LÈJ l LÂ Ÿ, ( CO—3 LA 8L& S \l l
P . 365 , l . 3 .
Üt
Ü.t,î .3,
L.i L,îzz…Ï_ â . .Lsus s ta t. ..e
L,.x. 11
ä. 3L…‘
t « Ibn-Bach cowâ l rapporte qu ’a l—Haeam al
Mostancir fi t détru i re l e réservo i r qu i,etc . e t pour le
48
sée,ma i s don t la r ime es t i n exacte , e t un pompeux ga l i
ma t ia s , ma i s don t la r im e es t pure . Heureusemen t n ou sne n ous t rouvon s pas dan s cet emb arras. La r im e n ’est pasdoub l e , ma i s s impl e ; i l n ’y a que les syl labes sa de L3
,
(avec le hamza dan s Boul . ) e t de LÂ Î (L…Î dan s Boul .) quir imen t en semb le , de même que , dan s la phrase su ivante
et >Ο) , l es syl labes la son t le s seules qu i r imen t .Ibid . ,
l . 2 1 et n . h . La be l le c onj ec ture de M . Wr i ghtest confirmée par Boul .Ibid . ,
22 . Aj ou tez65 (Boul .) avan t d
eU.,
P . 5 70 , l . 7 . I l faut l ire xÏ.b ..filt s,ts s ül; voyez mon
Glossaire des mots asp . dérivés de l’
ara be , p . 3 1 1 .
P . 5 72 , n . e . B oul . comme La . O . , excepté qu ’il a611: , 9
>et L’éd i teu r a aj outé cette n ote :
e .1,e,11
, s>
P . 5 76 , l . 8 e t n . d . Boul . san s lacune : UË.è, : L.Lxl l.
P . 5 7 7 , 1. 9 . S i M . Wr igh t ava i t rémarqué que ce morceau es t emprunté au Ma tmah , i l aura i t san s dou te lu i c i , avec les deux man. de ce t o uvrage(L . et au l i e u de L
’
adjectif
n e peut pas s’
employer en parlan t d ’habits ou d ’autre s obj e ts , m a i s seulemen t en parlan t de person nes .Ibid . , 14 . Au l i e u de l e Ma tmah L . a XSL>£J l ,ce qu i me semb l e m ieux con ven i r ; c f. t . I , p .
p . 504 . 1. 17 . .,1s es C e tex te est
cert a i n emen t al téré , car es t u n con tre-sen s .
49
Boul . a M,î $ ül ce qu i , du moi ns , s ign ifie quelque
chose ; m a i s ce sera i t un e répé t i t io n ,car l ’au teur a va i t
déj à d i t : s .ëLm l l Al-Fa th a écr i t
Üs üt. ( ,
s car tel le est la lec on desdeux m an . d u Ma lmok .
P . 5 7 8 , l . 22 . Votre correc t i on , J……L. au l i eu deW C , es t con firmée par Boul .P. 585 , l . 24. LS1 Le verbe
,.x: san s
( ,
i
ls se
trouve auss i t . I , p . 7 09 , dem . l . , où Boul . aj oute( ,l.
o o 0 5 o o10 1 I l a :
( ,l
P . 5 84 , n . d . La conj ectu re d e M . Wr i gh t,que vous
approuvez avec ra i son , es t confirmée par Boul .P . 586 , l . 20 . I l va san s d i re que j ’approuve votre
correct i on( Si: pour Le Ma tmah L . a c e
qui rev i en t au même .P . 5 89 , l . 8 . Votre excel len te correc t ion n e t rouvera
pas de con trad icteurs . J’
observerai seul emen t queest a uss i dan s Boul . , qu i , du reste , a mal à proposau l i e u deIbid . , 1. 2 1 .
,la .
,s t L.{ De
même dan s Boul . ; m a i s l editeur dit dan s une n o te qu ’ i la trouvé ces leçon s dan s un m an . , qu ’un autre por te
.SLn e t que le tex te es t a l téré,;s xâ i,
I l l ’est très—certa i n emen t , et , à ce q u’ i l para î t ,d ’une mam e re grave ; ma i s j ’ i gn ore comment i l fau t l ec orr i ger .P . 5 90 , l . 15 ; c f. 11. m et les Add . e t Corr . La bon ne
t)0 0
leç on , es t auss i dan s les fragments du Ma tmah qu ise trouven t à la fi n du man . d
’
Ibn-Bassâ m que possèdeM . Moh l .P . 400 , 1. 2 1 (cf. Add. et Corn ) . Boul . et
P . 4 10 ,n . g. La même rédact ion dan s Ihn-Bassâ m
(t . I , m an . de M . Mohl , fol . 7 5 excep té que le man .
a au l i e u deIbid . ,
8 .
Ü… 5 \.ll , .l. L i sez
ÜM S Ül J .L Voyez Ibn
Bassâ m ,t . I , fol . 2 12 v
°
,2 15 V0 .
P . 41 1 , 1—8 . Leçon s d u man . d’
Ibn -Bass â m (t . I ,fol . 6 7 1 .s ; 2 Lei—3l-ê 1. 3
6Lä. lt Ua ,,
nëll; l . 4 n ’y est pas ; l . 8 cu l,, e t _h s‘
1f
P . 420 , l . 20 et 11 . j . Ibn-Bassâ m (t . I , fol . 87 r°
) a
auss i e5,a l.
P. 425, 1. 17 .
(Tru ) Ihn-D ihya (fol . 146 ra)
P . 425 , l . 7 (cf. Add . et Corn ) . Vo tre conj ec tu re estconfirmée par Boul . e t par l ’édition d e Par i s d u Ca lâ i‘d .
P . 426 ,l . 6 . La conjec ture dans les Add. e t C orr
pour ne m e semble pas n écessa i re . L’
édit . dePa r i s du Ca lâ i‘d a auss i —5.P . 7 :
â\ . æ l l, ,.
la :
Vous a vez vu vous-meme que (dan s B oul .est a l téré , e t dan s les Add . e t Corr . d u t ome II (p . 46 9 ,
dem . vous avez proposé de l i re îâ É u»,lecon que vous
expl iquez à présent en d isan t qu ’e l le sign ifie : sich bauclzz‘gem ei ternd , ausdehncnd , e t que c ’est une express i on poe
5 1
t i que pour i nd iquer que la n u i t é tend de tous côté s sesté nèbres sur la terre . Le terme a rabe s ign ifie (voyez Lan e)s’
élargir , s’
en/ler , se gonfler ; m a i s permettez—moi de fa i reun appel à vo tre goû t et de vous demander s i l’exmession
que vous prê tez au poète : la n uit se gonfle , au l i eu d ’ê trepoé tique , n ’es t pas au con tra i re la i de , commune , basse ,impropre e t i n i n tel l ig ib le . I l y a pl us : la l eçon que vousproposez n e conv ien dra i t pas à la s i tuat i on . Dan s les quat re prem iers vers le poète a parlé de la n u i t e t de sesp la i s i rs ; ma i s à part i r du c i n qu i ème , i l parle de la fi n dela n u i t e t du l ever de l ’aurore . Joui s de to us ces pla is i rs , dit-i l , ( g,
. « j usqu ’à ce que tu voies les br i llau tes é toi le s autour de la voi e lacté e , ressembler à un
t roupeau d ’antilopes près d ’une m are où el l es s’abreuvent , »c ’est-à—d i re : j usq u ’à ce que les éto i l e s commencen t à descendre et à se cach er sous l ’hori zon , de même que desa n t i l ope s descenden t d ’un e hau teur vers une m are où el lesv on t s
’
abreuver . Le s ix ième vers , cel u i que n ous a von sà corr iger , doi t con teni r la s u i te de cette descr ip t i on dela nu i t qu i s’en va
, qu i fa i t place à l ’aurore . P artan t decette suppos i t ion , j ’ava i s déjà soupçonné qu ’ i l fau t l ire‘5 . o ’ mot qu i est a i sémen t reconna i ssabl e dan s le
,à$ u .
du tex te e t sur tou t dan s le,äs x:œ de La . , l orsque j ’ai vu
que là où Maccari cite ces vers pour la seco nde fo i s (t .II
,p . l ’éd i t i on de Boulac a réel lemen t cet te l ec on .
Le verbe à la 1re forme , s ign ifie pr im i t i vemen t , comm eM . Lan e l e d i t dan s son L exi que , presser quelq u ’ un ,
leh â ter , en le pou ssan t en avan t . Quan t à la VIIe forme ,qu i n ’es t pas dan s les d ic t ion na i re s , j ’ai déj à eu l ’occas io nde signal er son ex i sten ce
, et j’
ai dit qu ’el l e sign ifie : se
5 2
p resser , se h â ler , se dépêcher voyez mon éd i t i on d’Abda l-wâ hid ,
p . 2 5 2 , 2 5 5 , n . a , e t mes L oci de Abbad . , t .
I I,p . 106 , n . 1 16 , p . 256 . En voic i encore quelques au
t res exemples . Ou l i t chez Ibn-Haiyâ n (man. d’
Oxford ,fo l .
100 .£JL…o Ô._u b, ,
a, o t
, ( « à cause dela rap id i té de son Dan s le Voyage d ’Abdari (man .
fol . 80 Damiette é ta i t t rop é lo ignée de la route…Î x. ,n E t a i l leurs (fol .
0
105 V0 ) : L5,—L£zs ü3 Chez Ibn
al-Khatib (man . de Ber l in , a rt i cl e sur Kh â l i d ibn-Isâ al
Balawi) : ïJ LS \= U. i}<tt—às x:« Chez un chron iqueur anonyme
(man . de Copenhague , n°76 , p .
UÏ.L&J l ,às üLä
.}è, (lis.
( uxë s i)
ccô, æ;u 3y :,æ Plus l o in (p .
( 55,à$ \3l
$ l, ô 3 l m Q â.
5.X3. E t en core LM l
,m J J L9
)LÊ S \Â l
( ,Ls . Dans un autre e ndro i t (p. LA,
(y)—t, ? ( ,
à …L:J t. Pl us lo i n (p . x.f,
.s l
. Lc , ( ,i l. E t enfin (p .
-i,S ül Un gäüL5
u it J .u, é cc,—Là s xsä ï. Ma i s ce verb e (don t l e nom d ’act ion
a chez Maccari , t . I I , p . 7 5 6 , avan t-dem . l . , l e sen s dét ourné d ’inquiétude) n
’
exprime pas seulemen t l ’ i dée de se
h â tcr , m a i s aussi cel le de se h â ter de partir . Ce tte signifi cat i on est déj à sensib l e dan s l e passage d’a l-Fath que j ’aipub l ié dan s mes L oci de Abbad t . I , p . 5 9 , l . 5 (où ilfau t l i re ,Läs üïib ) , m a i s e l le l ’es t su r tou t dan s un autre
1) Le m an . port e par e rreu r
,j£$ üm e t
5 5
d’
lhn-a l—Kha t ib , que M . Mülle r a publ ié dans l e B ul le tindes Séances de l ’Académ ie de Mun ich (année 186 3 , t . I I ,p . 5 , l . C et auteu r dit en parlan t de la pes te , que ,pou r s ’en préserver , i l fau t év i ter les l oca l i té s oùe l le règne , e tc . ; pu i s 11aj ou te e .< lô Un a. -ll b …a .>
( ,xA
,U..Ê.x d l.…1
, ,1m : 1
( ,L: s
,!o LS U S
t outefoi s on est forcé de s ’exposer au péri l , i l n e faut lefa i re qu ’à la cond i t i on de s ’é lo igner au pl us tô t , de prend re des précau t i on s , de reten i r l ’haleine ,
» etc . Cette s ignifica tion est auss i cel l e q u i conv i en t au vers qu i n ousoccupe e t que j e t radui s de cet te man ière : (Jou i s de tou sces pla i s i rs , j usqu ’à c e que les é to i le s c ommencen t à descendre) a et que la n ui t , chassée par l ’aurore , se presse depar t i r , en la i ssan t s ’en vole r son corbeau , c on tre l eque lson adversa i re l â che un faucouP . 452 , n . l . L
’éd i ti on de Par i s d u Ca lâ ïd a la bon nele ç on W $ LAS.
P. 45 5 , 1. a. Chez Ibn—Dihya (fol. 129 r°
)
1) Ce t te n o te é tait écrite depu is longtemps , lorsque j e reçu s la 3 °
livra ison de v o s n o uvelle s remarqu e s. J e v o is qu ’e n parlan t du passage
où Maccari cite ces v ers pou r la seconde fo is (t . I I , p . vou s
adapte z la v éritab le leçon , qu e vou s ave z t rou vée dan s Bou l . , e t qu e ,
pou r prou ver la sign ifi ca t ion de vou s cite z u ne de mes n o tes
an térieu re s . Nou s somme s donc à présen t d ’accord pou r le fond de la
qu est ion . Cependan t j e n’a i pas cru devo ir b ifi
‘
er m a n o te , d’ab ord parce
qu ’e l le con tie n t de s expl ica tion s qu i peu t—ê tre n e seron t pas tou t à fait
inu tiles , en su ite parce que vou s n’ave z pas ré trac té l ’in te rpré ta tion que
v ous avie z donnée dans v o tre premier fascicu le e t qu e m ême vous n’
y
faites pas la moindre al lusion . L ’au riez-vou s oub liée ?
Votre excel len te conj ec ture , an s ., se t rouve don cconfi rmée
,l e mot
,K£4 é tan t l equivalen t de
Ibid . , 5 . (Lil ) l i se z 153 , comme on trouve chez IbnD ihya ,
qui a : Li lo au l i eu de Lx=.
P . 442 , l . 10 . Après L Q ,i l faut aj outer l e mot
Lg.$ Ub—m, ,qu i se t rouve dan s l ’éd i t io n de Par i s d u Ca lâ i‘d
e t qu i est ab so l umen t n écessa i re pour la r ime .Ibid . ,
n . 9 . La leç on se t rouve auss i dan s desman . d u Ca lâ ïd e t dan s l ’édi t io n de Par i s de cet ouvrage.P . 46 1 l . 8 . Dan s Boul . c ’est : ëLÎ Lm ( 5,
{o Ln Ôl ul,25.
SECONDE PART IE ,PUB LIÉE PAR M . KREHL .
J’
observerai d ’abord que , dan s cette part i e , i l y a un
assez grand nombre de fautes qu i n e son t pas dan s lesm anuscr i ts . Ce son t , j e cro i s“ , des lapsus ca lami de l’éditeu r , qui , en mettan t son t rava i l au net , semble avoi ré té suj e t à des d istract i on s . En outre , i l n e me para î tpas avoi r c ol la t i on n é les man. avec assez de so i n . J
’
ai du
moin s t rouvé dan s cel u i de Leyde l e seu l que j ’a i eencore à m a d ispos i t i on , u n t rès-grand n omb re de leçon sexcellen tes que l ’éd i teu r a passées sous s i len ce .P . 466 , 1. 14 . Ls
,x.. œL.3, li L i se z
avec L . e t Boul . Dan s sa Seconde Par t i e (t . IIIp . 6 5 9 , l . 19 éd . de Boulac) , Maccar i d i t en pa rlan t d’unersop nuage qu 1 ava1t seru pl us ieurs pr1nces .
( ,a
5 6
Ibid . ,9 et n .
—c. La copula t i ve est dan s le Ma tm . L .
Ibid 15 . J ’ava i s corr igé comme vou s La
bonne leçon se trouve dans Boul . e t dan s le Ma tm . L .
Au l ieu de l isez comme dan s Boul . et dansle Ma lmok .
Ibid . ,16 et 1 7 . Aj ou tez u n après
â..l i et un
ce après â g,M'
.
Ibid . ,20 . Au l i e u de B oul . et l e Ma tmah ont
I l fau t l i re Ce verbe s ign ifie im iter ; voyezmes L oci de A bbadidis , t . I , p . 265 , n . 2 2
,et t . I II ,
p . 1 14. La ph rase ÂÂEDÏXÂ .}Î su se trouve une i nfi n i té defoi s dan s l ’Hist . des B erbères , m a i s partou t M . de S lanefa i t impr im er mal à propos Jim .
Ibid . ,l . 22 e t 25 . I l n ’est peut-ê tre pas i n ut i l e d ’ob
server que la ph rase,i À l t n ’est pas dan s le Ma t
mah . C’es t u ne expl i cat i on de Maccari.
P . 47 3 , l . 8 . I l fau t certa i n emen t l ire commevou s le proposez . Boul .P . 474 ,
l . 1 5 . Votre correc t ion , es t confirméepar Boul .P. 47 5 , l . 8 et n . b. La vér i table leçon est
(auss i dan s L . et Boul . ) dans sa ville na ta le.
Ibid. , 25 . Votre correct i on, &Æùæ äe, es t confirmée
par B oul .P. 47 7 , l . 9 et n . d , l . 12 et n . e . Boul . a les leç onsdu texte .
5 7
P . 478 , l . 2 1 . Au l i e u de il fau t nécessa iremen t l i re a,i a ( ,
il,comme dan s L . e t Bou l .
P . 480 , l . 5 . Bou l . o$ lÇ>( ,l a .
P . 481 l . 10 . La bonn e leçon , Ch i. , est auss i dan s
B oul .P . 482 , l . 9 . o.» 3 1, au l i eu de même observa
t i on .
P . 485 , l . 4 . De même que M . Kreh l , j e n ’aura i s pasaccepté le changemen t que vous proposez . Tous les man .
du Ma tm ah e t de Maccar i on t la leco n du tex te , qu i estauss i dans B o ul . Vous corr igez , n on pas le s c op is tes ,ma i s l ’auteu r , qu i cependan t s ’es t exp r im é assez cla i remen t , et vo tre changemen t me semble don n er un sen s peunaturel . Les Arab es son t m oin s sévères e t m oi n s préc i sque n ous dan s l ’emplo i d es p ron om s .
16 . La b on ne lec on es t dan s B oul . , excep téqu ’ i l a pou rP . 485 , l . 5 . Au l i eu de l i sez
U..Ïtx.
Ibid . , 9 , 10 et n . 6 . C e n ’es t pas l e des m an .
qu i es t a l téré , ma i s l eur K&M . l l fau t l ire avec Bou]LË
, i s u L.
Ibid . ,l . 15 . L es bonnes leçon s
Z,i l., e t son t
dans B oul .Ibid. , 19 . Ce double J L.i ä es t é trange . L . e t B oul .
ont J tä5 (L. 1
, 1Lä5 , ce qu i es t bon .
P . 489 ,l . 9 . Ce n
’est sans dou te r i en autrechose qu’une faute d ’ impress i on; L . e t Boul . ont aussi
5 8
Ibid . ,l . 1 1 . Je c roi s q u ’ i l faut d i re à pe u près la
même chose de ce J L3 ce sera u n lap sus ca lami del ’édi teur ; L . e t Boul . on t a uss i t
_,1L
‘
5 15m .
141a. , 1. 12 . Boul . a ts>ts.
P . 49 1 ,l . 2 et n ote a . Le
,L. Èz .3l des m an . , que vous
res t i tuez avec ra i son , semb l e a uss i avoi r embarrassé l ’ed iteur de Bou lac , car i l l ’a remplacé par J L:‘a t.P . 492 , n . e . Aussi dans Boul .P . 493 ,
l . 22 . Aprè s L . e t Boul . aj outen t lemot qu i est n écessa i re à cause d u pronom dans
M . Kreh l l ’a ura om i s par méga rde .P . 497 , l . 1 5 e t n . c. I l fau t l i re de to ute nécess i té
al l ) comparez la ligne s u i van te .P . 498 , l . 1 . Boul . aj oute aprèsP . 499 , n . a . Comparez pl us l oi n mes r emarques su r
t . II , p . 457 , l . 5 .
P . 501 , 1. 4 . Subst i tuez aÊ s, (B oul . ) à 155.
P . 507, 18 '
e t n ote 0 . Je cro i s que vous avez eu parfaitement ra i son d e défendre la le çon (auss i dansBoul .) contre l e soupçon de M . Kreh l et de l ’expl iquercomme vous le fa i tes ; ma i s comme vous n e semblez avo irrencon tré n ul le part a i l le urs l e verbe en ce sen s , j ecroi s u t i l e d ’en c i te r quelques exemples . J
’
observera i d’
a
b ord , parce que la Ve forme manque en ti è remen t dans l e sd i c t i on na i res
, qu’
on la t rouve a vec sa s ign ifica t i on propre(s
’
orner de vêtements de soie de difiéren tes cou leurs) dans
ce passage d ’al-Fa th , pub l i é par Hoogvl ie t (L oci de Aph idsidis
, p. sa , 1.(,ma is w-ê l-eù-ab
5 9
44Lm .31 c 5 \i 3,e t dans ce t autre (man . 5 06 , t . p . 88)
o
…S UM ,‘ L.J
‘
Ls xi 3 o_ Avec l e sens
figuré qu ’ i l a dan s notre tex te , ou l e ren c on tre dan s laSeconde Par t i e de Maccar i (t . III , p . 2 6 4 , l . 12 éd . deB oulac) , où on l i t : (}5 W l î
lLu l i … . h Süi i l :
o …, Œ.wLx . l l
A i l l e urs on lit dans l ’éd i t i o n (p . 185 ,l . 7 )
au . a .31 ma i s ce t te leconest fau ti ve ; i l fau t y sub sti tuer Ê . Â ol comme porte leman de Leyde . Plu s 10111 (p . 5 25 , 1. 5 a
LS UO—ï, ëL. S \3 s,. J älà î Ll: Chez Ihn
Abdalmelic Marfécoch î (m an . de Par i s , n ° 6 82 supp l . ar . ,
fol . 15 r°) on tro uve : —J L. a l a
ÊZOJ 3 J—Â l . Pl us l o i n (fol . 16 a i r:
—31 Dans un au tre endro i t (fol . 43v o) : É
£a s, ,s Plus bas (fOI. 45
&.mä l ( ,a A i l leur s
(fol 87 vo) :—Za.
,x.
â ..xs,
a.m A :>i, Pl us l o i n (fol . 12 1653 3. ,, i b fl E t encore (fol . 184 W)t5ü"“ 0
9J"
L5 9l0
°LSD)
‘
P . 509 ,1. 9— 1 1 . Ces tro i s vers se t rouven t auss i dans
n otre man uscr i t 506 , qu i c on t ien t u n ouvrage d ’Abou-’lWa l i d al-Bâ dj î (voyez le Catal ogue de n os man .
- or i en tt . IV, p . 6 5 fol . 122 r
°. Dans l e premier , ce man .
60
porte ( ” à:—li vie? , e t c ’es t a i n s i qu ’ i l fau t l i re . Dans l esecond
,i l a
( ;Η;Π(avec t ou tes les voyel les) au l ieu de 6 5 5
c ’est une n ouvel le correct i o n à fa i re ; m a i s i l n e c on firmeaucune de vos tro i s conj ectures s u r le mot… l , e t
comme i l est anc i en e t correc t , j e m e pers uade de p l usen plus que ce term e n e doi t pas ê tre changé . Evidem
men t le poète a en tendu sous &.Lî : supporter lesfat igues , l es déboi res , qui sont i névi tab les quan d on veu tarr i ver au —S u .
P . 5 10 , l . 1 . Ap rè s l e m ot a l a é té om is mal àpropos . I l se t rouve dans L . , dans B oul . e t dan s le Cdidid .
Ibid . , 5—11 . Ce poème est auss i dan s notre man .
506 , fol . 5 7 7 v°. D an s le 2° vers , i l a pour L..Ï,è
dans le peut-ê tre( ça. pour e t LwL.
, (qu i es tbon auss i) , au l i eu de enfi n , dan s l e dern ier ,Œ…$ t ( 5 12 , au l i eu de i l va de soi que c ’estune excel len te correct ion .
Ibid . , 15—20 . Ces vers‘
à l ’except ion du se trouven t égalemen t dans notre man . 506 , fol . 569 r
° Vs . 1
i l a «A:—sw) . Vs . 4 l e dern i er mot doi t ê tre,£s u » (les
voyel les dan s le Vs . 5 le p rem i er mot est tô t,
dans le man . Vs . 6 i l a au l ie u de Xà3, . Au l i eude
( fi n : , dans le dern ier vers ,i l porte
( ”S i, ce qui me
semb l e b i en préférab l e .Ibid . , 2 1 e t 22 . I l faut un après Um,…W l e t un
44 après Uæ,3= l. Boul . aj oute a l aprèsP . 5 12
, l . 14 et n . a . B oul . comme dans l e texte .
6 1
P . 5 13 ,l . 22 . J ’ava i s c orr igé comme vous ce r i d i cule
g bÀ l l. L . e t Boul . on t la b onn e leçon .
P . 5 15 , l . 1 . pou r( ,
a est p robablemen t unefaute d ’ impress ion ou un lap sus ca lami. L . et B oul . ont
la bon ne lec on .
P . 2
c< t;( SL: L? Lï
e t dan s la n ote a la rédac t i on qu i se trouve chez Abd-alWâ hid :
ÇL 3 6
,L-ï,
Vous d ites : « D ’
après les Add. et Corr . du t . I I , 1"part i e ‘ , devra i t ê tre changé en comme on
t rouve dans l ’Abd—al-wâ hid de M . Dozy ; m a i s ce mo t l u im ême do i t ê tre changé en X àÏ n , don t a.,
h, comme n om
d ’abondance de semble ê tre une eXplication . » E nprem ier l i eu , j e vou s pr i e i n stammen t de n e pas touche rà l ’excel len te l eçon d ’Abd-al—wâ h id , e t s ur tou t d e n e pasl u i e n subst i t ue r un e qu i sera i t r id i cu le . Votre s ignifie locus eminem (terrae) , et votre (qu i , malb enreusement , n ’ex i ste pas) s ign ifiera i t , sel on vous , u n lieu
dans lequ el il y a beaucoup de sa ble , ou une hau teur ,pu i s
que ce doi t ê tre l e syn onyme de Eh b i en,que
1) Pe rmette z—mo i de v ou s faire ob server qu e ce l les de ces n o tes qu i
n’on t pa s é té reprodu ites dan s l es Addition s e t Correc tion s du prem ier
v o lum e , doiven t ê tre considérée s comme n on avenu es.
6 2
sera i t-ce a l ors que : « un h omme supér ieur est comme l ’or,qu
’
on j ette tantôt sous u ne h au teur , e t qu ’ on voi t . tan tô tcomme couron ne sur la tê te d ’un ro i ?» Qu i don c s ’estjama i s av isé de j eter l ’or sous u ne hauteur ? A quo i celaserv ira i t-il ? Commen t cela se fera i t-il ” La l econ d ’Abdal-wâ h id s ign ifie au con t ra i re : « un h omme supé r i e ur estcomme l ’or
,qu i tan tô t est sous l e m arteau , e t q u i tantô t
br i l le comme couronne sur la t ête d ’un ro i . » C’es t un e
ph rase s imple e t ra i son nable ; tan tô t , quand on le t rava i ll e
,on frappe l ’or avec le marteau , on le ma l tra i te , o n
l’
avilit tan tô t on l u i ren d l es plu s grands h onneurs , quandon l e voi t b r i l l er comme couron n e sur la t ê te d ’un monarque . La leçon
'
chez Macca r i expr im e ab solumen t la mêmei dée . est l ’or th ographe vulga i re pour X.
,m 1
, et c edern i er mot s ign ifie en core auj ourd ’hu i e n Afr i que : ma illet , marteau (propremen t instrument p our frapper) , commevous pouvez l e vo i r dan s l e d i ct i on na i r e d ’Hé lot (p .
C’est donc l e synonyme de ” Si…. San s dout e l e poète a
1) Rien n
’e st plus commu n dan s la langu e vu lgaire qu e la confu sion
du Un avec le qu an d ce t te l e t tre fe rm e u n e syllab e . J e pou rrais
e n donn e r qu an tité d ’exempl es , m ais u n seu l suffi ra parce qu ’il e st tou t
à fa it an al ogu e au de n o tre texte . Un m a te las s’appe lle dan s l e
a
dia lecte m agrib in (Ib n-Ba tou ta , t . I I I , p . 8 80 , t . IV, p . 2 3 3 ;
P . de Al cala sou s co loh on de cam a e t sou s p lum a de colchon) , par cor
ru p t ion (B omb ay , p . X -n (Boc th or so u s m a t e la s ; ch e z0
Hœs t , N a ch rz—ch t en v on M a r okos , p . 2 6 6 , o u aùm ,a;mais ch e z
Humb e r t (Gu ide de la conv ersa t i on , p . ce t te dern i e re form e e st
6 4
popula i re c i té par Ihn—Khaldoun (Prole'
gomènes , t . III ,p . 4 15 , l . 12 e t on lit
. lb Läl l —S X. rJ , , Àw> ( 5À3i lô,
«Voyez celle don t la beau té m ’
a charmé , et que malheureusement j e n e pu i s charmer à mon t ou r par de b el lesparoles . » Un pi f (Maccari , t . 11, p . 585 , 1. 5 a f.)es t un langage enchan teur , e t l ’on d i t d ’un homme quicharme par ses paroles , q u’ i l e st (Ibn-al
Khat i b , man . de M . de Gayangos , fol . 5 2 De même
(ÿhflt ( le charme de ses paroles) chez Ibn-Haiyâ n
(apud l bn-Bassâ m , t . I , man . de M . Mohl , fol . 143et i l fau t rest i t uer ce mot dan s un autre passage , où l eman. (fol. 142 V0) porte : m&5 \l l Jf>, (
O
,»
P . 5 18 , l . 12 e t n . d . La faute est de M . Wustenfeld ,e t non pas d
’
Ibn-Khallicâ n. L’édi t i on de M . de S lane
(p . 6 7 1) a la bon n e leçon ,[bid 22 . Vous d i tes : «Le sen s ex i ge
( ,Ë> ou
De mon côté , j ’ava i s( si l , comme
on trouve dans L . , dan s Boul . et chez Ibn-Khallicâ n . Fauted ’ impress ion ou lap sus ca lami.
P . 5 20 , l . 2 . dan s Boul . , comme vous l e propoSCZ.
P . 5 2 1 , l . 10 . B on] . au l i e u de M ,.
Ibid . , 14 e t n . f. La bonn e leço n es t dan s L . etBoul . M . Kreh l s ’est don c trompé e n d isan t que tous lesman . porten t a…$l.Ibid . , 15 . Boul . correctemen t u
,h .
6 5
P . 5 22 ,l . 10 . m L.<1t cg,
. Je m ’é tonne que vous n ’ayez
pas ré trac té votre conjec tu re , sel on laquel le i l faudra i t l i re.Ë;. au l i e u de L,, car dan s mes L oci de Abbad t . III,
p . 23 7 , j ’espè re av o i r p rouvé que au… (le co n qu i estconfi rmée par Boul .) est l ’équ i va len t de ,
C>
e t comme j ’ava i s c r i t i qué vo tre conj ec ture en d isan t qu ’el l en e m e présen ta i t aucu n sens ra i son nab l e , vous auriez dûl ’exp l iquer , ce me semble , e t la j us t ifier , s i vous n e voul i ez pas vous en déd ire . A p résen t j e p u i s auss i vou sren voyer , pour c e qu i con cern e cet emplo i d e e t dex.,
au Lexique de M . Lan e ;j ’aj outera i auss i d ’au tres exemples à cel u i que j ’ai déj à don né . Che z Maccar i (t . I , p . 709 ,
20) on lit ,l a « u n homme de pl ume . » Un bemist i ch e qu ’ i l c i te a i l leurs (t . I , p . 9 12 , l . 12) es t c on c u ences termes
&.s5
(,lb u
,Là
Nous avon s don c i c i l ’express i on u_a, ,
celui qui croit
une chose. Pl us lo i n (t . II , p . son,1. 1) o n 111 : L..
( ,M t, paroles que vous avez for t b ie n expl iquées
vous-même . Un vers c i té par Ibn-a l-Kha t ib , se trouve decet te m an ie re dan s le man . t rès-faut i f que possède M . deGayangos (fol . 125
rläl l ah ä La
I l fau t corr iger , en adop tan t l es lecons d u man . de Berl i n :
6 6
Ai l leurs (man . de M . de Gayangos , fol . 106 v°
,corr igé
d ’après le m an . de Berl i n) i l don ne ces vers :—1 …u11
J, .3L.s
Dan s un autre endro i t (fol . 125 r°
) i l dit : ,Le s
l bn-Abdalmel ic Marrécoch î (man . de Par i s , n ° 682 s upp l .r fol . 15 9 V 0) on t rouve : Um ..i &Æ,=
u >, 8,M { ä2.g. n UM lO—3Αl fi l
.ê, Lç Lœ
‘
5 Dan s Maccar i les Soufis porten tnon—seulemen t l e n om de ç , läl t (t . I , p .
m a i s a uss i cel u i de …L.,l (Séconde Par t i e , t . III ,
p . 6 7 5 ,l . 24 éd . de Bonlao) , ceux qui on t des ex ta ses .
Vous voyez don c que es t b i en certa i n emen t l ’équivalen t de …>bo ou deP . 5 23 ,
l . 6 e t 11 . b . Boul .Ibid . , 16 . Le …$ 1.l es t dan s L . et Bou l .P . 5 26 , l . 2 et n . a . Boul .Ibid . , 10 . La l eçon d u tex te , ô '5 ’ est a uss i dan s
B oul .P . 5 27 , l . 1 1 . Vo tre correc t i on ,
' es t confi rméepar Boul .P . 5 5 1
, l . 18 . 5L.5 0$ V ol .. La . Mauva i se lecon , car
l e s m on tagnes n e meuren t pas . Il fau t y sub stituer(}lä
Ce verbe est b i en ch oi s i dans ces vers su r un
h omme en nuyeux . Il s ign ifie : r endre quelqu ’un inqu iet ,de sor te qu ’ i l n e peu t se ten i r en repos et qu ’ i l change
6 7
de p lace à tou t momen t . I l se d it , par exemp le , en parlan t de l ’effe t que prod ui t la piqûre de ce rta i n s i n sec tesqu ’on n e nomme pas en b on n e soc ié té , comme dan s c epassage t i ré des B iographies des hommes pieux de Ca irawdn(man . de Pari s , n ° 7 5 2 , fol . 48 L.. —.i l .c.bo l,
wi.L3\. I l s ’emplo i e auss i e n parlan t d u sent imen t qu’onéprouve quan d on es t forcé de sub i r la v i s i te prol ongéed ’ un h omme en n uyeux , e t qu i a pou r effe t q u ’on n e sau
ra i t durer en place . Auss i le verbe su iv i designifie
-t i l s’
ennuy er de (Maccari , t . III , p . 830 , l . 1 1éd . de Boulac) , à la V° forme s’imp a tienter (Hélot) , l e s ubs tan t i i u …L
‘
é, impa tience (dan s le s B iographies préc i tées ,
fol . 85 ennu i (Vocabula i re de Barb i er) , d ëla , importune tc . No tre poè te dit don c : l e sen t imen t d ’ennui
i n qu ie t que ce t i mpor tun me don ne , empêchera i t mêm eune mon tagne , s i sol ide qu ’el le so i t , à se ten i r e n repos .P . 5 3 3 ,
l . 1 . Boul . M ,comme vous corr igez .
Ibid . ,18 . L i se z : \Ç\ s>
( SL:
( gt;
P . 5 5 5 ,l . 14 . I l est presque i n ut i l e de d i re que La
,m æ
est dan s L . e t Boul . Probab l emen t l es au tres man . l ’on t a ussi .P . 5 5 6 ,
l . 4 e t 5 . u làÏi\ L., (auss i dan s L .) e t
son t dan s Boul . De même 1. 2 5 s,fÇ>.
P . et n . a . L i sez comme dan s B . (auss i dan se t voyez s u r ce t au teu r mon Ca
t alogue des m an . orien t . de Leyde , t . I , p . 2 7 1 e t suiv.
Ibid . , l . 6 et n . 0 . Au l i eu de l i sez a vec t ousl es man . e t Boul . (p ,
Ce verbe s ’emplo ie souven td ’un e m an iè re el l i pt i que , sans qu ’on n omme la person n e ,ou l es person nes , qu ’on exc i te à fa i re u ne chose .
68
Ibid. , 9 . Boul . a la b on n e l econ , ,L3
, san s a rt icl e .P
. 5 41 ,l . 1 1 . L . e t Boul . correctemen t J LË OL..
P . 5 42 l . 5 et 6 . Ces deux vers son t auss i dan s l eVoyage d Abdar î (man . fol . 89 m a i s san s autre var ian te que t b äl\, Â s ü\ dan s le second .
P. 5 43 , l . 7 . Les bonnes leçon s , et (àla fi n de la l i gn e) son t dan s L . e t B oul .Ibid 10 . Vous avez é té t rès—h eu reux en soupç on
nan t qu ’au l ieu de i l fau t l ire préc i sémen t l e cont ra ire , à savoi r M . Kreh l aura i t p u t ro uver ce tteexcel len te lecon dan s L el le es t auss i dan s Boul .P . 5 46 ,
l . 15 p . 5 47 , l . 4 . Ibn-Bassâ m
de M . Moh l , fol . 16 1 ro) don n e aussi ces vers , à l ’except i on d u 0
° et du Vs . 1 i l a auss i Vs . 2au l i eu de Dan s l e 6 ° vers , l e ŒaÀSÊ.,
de Maccari sera i t u n con tre—sen s , car i l fautj us temen t l e con tra i re . La b on n e leçon , comme j ’ai déj àeu l ’occas i on d ’observer dans les An na l es d e Gœttingue de186 1 (p . se tro uve ch ez Ibn -B assâ m
,à savo i r
Œz .ÊÂ, . Aprés avo i r dit dan s le vers précéden t
,qu ’ i l
se berça i t parfo i s d e la douce espéran ce de revoi r ses amiset qu ’a l ors i l comp ta it pou r peu de chose les fat igues e tl es en n ui s de la rou te
,l e poète con t i n u e dan s celu i-c i
« Ma i s (b i en tô t après) l e l ong voyage que j e su i s forcé d efa i re , m ’
ote de n ouveau l ’espéran ce de v ous revoi r . » Les
copis tes e t l es éd i teu rs con fon den t souven t avecA i n s i l ’éd it i on de Boul . por te deux foi s
l à où la nô tre (t . II , p . 205 ,l . 4 e t 5 ) don ne correcte
69
(nen t Au res te , l bn—Bassâ m a (mauva i seleç on) au l ie u de e t dan s le dern ie r vers au
l i e u deP . 5 47 , l . 14 . Boul . p, l \, comme vous corr i gez .P . 5 48 ,
l . 16 . La bon n e leçon , es t dan sBoul . e t chez Ibn-Kha ll icâ n .
Ibid . , 11 . b . Voyez II , p . 2 58 , 1. 7—9 .
P . 5 5 1 , l . 15 . Boul . comme vous corrigez .P . 5 5 5 , l . 20 . Au l i e u de Boul . Π(deux
fo i s) .P . 5 5 5 ,
l . 10 e t n . c. L a bon ne lecon , .>LÏx i\ est
dan s Boul . e t dan s l ’H istoire des cadis de Cordoue , par Moh ammed ibn-Hâ rith (man . d
’
Oxford , p .
Ibid 1 1 .
( ,s es
,. Boul
au l i e u de c_5,m . Ni l ’ une n i l ’a utre lec on n e conv i en t
i c i , e t san s doute Maccar i a e u sous les ye ux un tex tea l téré , car voi c i c e qu ’on l i t ch ez Mohammed ibn-ll â rith(loco lauda to) : .3\
,.s, … s ©315 0 ,
( ,l$ u —
11 a.Lx.<11.Î £.3
P . 5 56 , 25 . Au l i eu ,Î L3 ., lisez ,äls u , comme dansl e man . de Mohammed ibn-Hâ rith .
P . 5 58 , l . 2 1. Boul .( ,à, comme vous corr igez .
P. 5 60 , l . 1 ‘ B oul .ë ,tà
, comme dan s le texte .Ibid . , 15 e t n . a . Boul .P . 5 6 1 , l . 14 e t 15 . L . e t Boul . comme
vo us corr igez ; pui s Boul . a e t c ’es t a i n s i qu ’ i l fau tl i re
, car pu isque a l e l e mot qui précède doi t
7 6
l ’avoi r auss i . La lacune que vous signal e z après “J ,.
est au ss i dan s Boul .P . 5 7 0 ,
l . 3 e t n . b . Boul .Ibid . ,
25 . Le Soufi Ibn-a l-’Arab i d i sa i t : gj,a l
M l sSL£. i\ Vous vou lez s ubst i tueräf,Lxl l\ à XI
,—M i. Je n e sa i s pas ce que cela s ign ifiera i t ,
et la ph rase qu i se trouve un peu pl us lo i n , p .
3 J,£ d l u zg,
h . (Boul . .cM Æi d,: g a i l
aura i t dû vous fa i re dou ter , ce me semble , de la j us tesse de votre conj ec ture . Dan s ces deuxpassages les m ot s a i
,—Lx. e t semblen t s ig n ifier dilettan
tisme , s ’ i l est perm i s d ’employer ce terme ; ma i s le seconddoi t avoi r un au tre sen s dan s un passage d ’Ibn-al—’Arab ique j ’ai pub l ié dan s m on Cata l ogue , t . II, p . 7 5 ,
l . 14.
P . 5 7 1 , l . 18 . Boul .P . 5 7 2 ,
l . 7 . Boul . au l i e u deIbid . , 15 . Boul . au l i e u de
Œ.Làg>l.
P . 5 75 , l . 25 . L i sezP . 5 7 4 , l . 25 . Au l i e u de l i sez L.Lî 5U ël.ä
avec l es voyel les L .
P . 5 7 5 , l . 2 et 3 . L i s ez a vec L . e t Boul . tés, J LE r
.$
Û ŒtÀ A M ÔL5 k.£ S ÜCN LA Un : g
P . 5 7 7 , l . 7 e t 8 . L’éd i teur de Boul . b i en fa i t i m
primer les mo ts j usqu ’à comme u n vers ;ma i s dans la ph rase sui va n te i l a auss i les fa utes que vousavez c orr igées s i b ien .
P . 5 79 , l . 2 1 et 22 . J ’ava i s fa i t auss i les correct i on s
7 2
(,ts cp1
Bon] . a x. .s x. , comme vous corr igez e t comme M . Krehla fa i t imprimer p l us lo i n , p . 5 86 , l . 19 ; ma i s i l a aussi
e t i l n e fau t pas changer cet impéra t i f en v .}
comme vou s l ’avez fa i t , car vo tre( 5
-5 sera i t de tr0p (lapar t i cu le li es t dan s 1 et J.l> est de r igueu r ,parce que est con stammen t l ’opposé de E n prosece sera i t : (ou ( ç
à) ( , Çxl l
P . 5 85 , l . 7 . Après J L? aj ou tez( 55
Ibid . , l . 14 e t n. c. L a b on ne lecon est n on-seulemen tdan s Boul . et dan s Ibn—al-Kha t ib , man . de Par i s , m a i sauss i dans L . , où M . Kreh l aura i t pu la t rouver .
Ibid . ,l . 18. ΠM J LA 8
,Lâ m l ass…
UKÈ
@ Ê LÈ>, ( 5
5 -c-ê . Je vo l s par
vo tre dern i e r écri t que la n ote su r ce passage , qu i set rouve dan s les Add. e t Corr .‘
e t qu i n ’es t pas s ignée , es tde vous , e t qu ’el le do i t ê tre l ue de ce tte m an iè re : « Après
aj outez Je n ’ose pas vous con tred i re ;m a i s j ’observera i toutefo i s que cet n ’est n i dan s lesm an . (car M . Kreh l n ’en a r ien dit) , n i dan s Boul . , n idan s l bn—al-Kha tib (man . de Par i s) , et peu t—ê tre fau t-i lp rononcer comme on dit (voyezDjauhar i) .
.
1) La le ç o n L p . 5 8 6 , l . 1 9 , au l ie u de n e re n d qu e
fa ib leme n t l ’idée du poè te ; m ais e l le v au d ra it m ie ux cependan t qu e vo trec o nj e c tu re , pa rce qu ’
e lle n’a pa s u n
L53 su pe rflu .
O
P . 585 , l . 7 . L i sez 8,f , comme dan s L . e t Boul .(nœud par nœud) .
Ibid . , 16 . Boul . Ü;ä13 , comme vous corrigez .Ibid . , 18 . Au l ie u de
O" °D ’ l i sez
« qu i l e prépa rera ? » qu i est-ce qu i moudra c eblé e t en fera du pa in ? Voyez s ur ce tt e s ign ifica t i o n duverb e le s Glossa i res s ur Ibn-Badroun ,
l e Bayâ n e tBelâ dzorî ;B iographies des hommes pieux de Ca irawâ n (man .
de Par i s , n ° 7 5 2 , fol . 49 521. t La L.%J .5Lä5
L: : au:: à,,P . 5 86 , l . s t
)äàii q J W U
n a)iù
'
â‘” Lp &â Lgæëb
’
u,.3,
I l es t cla ir qu ’ i l s ’ag i t i c i d’un seul message r , qu i estn ommé tan tô t t antô t e t que par c onséquen t cedern ie r mot n e peut pas ê tre l e pl ur . î . Â3, comme M .
Krehl l ’a pen sé . Dan s l e d ia lec te m agribin est unS i n gul i er. P . de Al ca la l e pron once voyez M . Mül ler ,D ie letz ten Zeiten von Granada , p . 105 , dan s la n o te , e t
e n outre chez Alca la l es arti c les enbaxador , legado del
papa ,mandado a quien se diz e ,
m ensaj ero . Dan s un d iplôme pub l i é par M . Amar i (I dip lom i a ra bi del R . Archi
v ia Fioren tina , n ° XLVI ; c f. p . 448 , n . c ’est -ï .
Dan s les deux d iplômes p ub l ié s par de Sacy dan s le s Notices et eætra its , t . XI , p . 7 e t suiv .
,l e s ing . es t a uss i
0 5con stammen t Le pl ur . es t Aux exempl es qu ’ena donnés M . Mul ler , on peu t aj ou te r ceux-ci zMaccarî , t . I ,p . 25 6 ,
l . 2 ; Seconde Part i e , t . III, p . 62 , l . 8 a f.
7 4
p r
(c ’es t un passage d ’l bn-Dihya) et p . 689 , l 0 a f. éd i t .de Bou lac ; Abou-’l—Ha san Djodzâ m î dan s Mu l ler , B eitrc‘ige ,p
. 129 ,l . 9 ; Ihn-Ba tou ta , t . [V, p . 4 , 105 ; Abou-Ham
mou Il , Wâ sita a s-solouc , p . 15 5 éd . de Tun i s , et a illeurs ; Chron i que an onyme , m an . de Copenhag ue
,n ° . 7 6 ,
p . 4 : —gg .3Lm)l M e
, ; p . 44 2 U‘
ZJ.i:èô l J b ») g..
èyc 5
p . 5 8 ; d ipl ôme pub l i é par M . Reinaud dan sla Collection de documen ts inédits sur l
’
histoire de F rance ,
Mélanges h i stor i ques , t . I I , par t i e 2 , p . 1 17 , l . 5 . Sousenbaæador , P . de A l ca la don n e le m a i s j e cro i sque c ’est u ne faute et qu ’ i l faut l i re A, . Â j , comm e i l aaux art i cles legado e t m ensaj ero , et comme‘ on t rouve chezM . Lane (Modern Egyp tians , t . II, p . 5 62) où les apô tresson t n ommésIbid . , 9 . Boul . b ltä5 , comme vous corr igez .Ibid . , l . 25 et n . f. Après i l faut aj ou terwLæliiJ î ,qu i est auss i dan s Boul .P . 587 , Boul . ét é. Je me t i en s a ss uré qu ’en
subst i tuant à >l . è , vous ne co rr igez pas l es cop istes ,m a i s l’auteur.Ibid . , 10 . .Lu i Je ne l i s pas avec vo us
fifi » , ma i s : .L.xgW ,
comme dan s L . , dans Boul . e tdans la no te c . C
’es t l e m u lta verbe fecit de aliqua re ,chez Frey tag .
P . 5 88 , l . 1 . Boul . a après M i g, comme vouscom gez .
Ibid ., 8 . Boul . a u th : , e t c ’es t a i n si qu ’ i l faut
l i re . Dan s L . ce n ’est pas se ulemen t W qu i manque :ma i s auss i
7 5
Ibid . , 14 . Au l i eu de … 3 l , qu i n ’ex i s te pas ,i l fau t
prononce r .Î ät. C’es t un terme ph i losoph ique qu i manque
dan s n os d ic t i on na i res , m a i s qu i s ign ifie une ch ose dont
on peut dire seu lem en t qu’
e l le est . Chez les Soufis c ’es tDie u , o u p lu tô t , pa rce q u ’ i l s son t pan thé i s tes , tou t c e qu iex i s te . Voyez le Ma im onide de M . Munk , t . I , p . 241
e t l bn-Khaldoun , P rolégomènes ,t . III , p . 7 5 , l . 9 .
P . 5 9 1 , l . l l . .c l).äâ l l
Ü'°
J.,—i‘fll Lç ly q _
ÙL_ {
M UN î,wb l.. l u L$ æ i s}i  J î, . Dan s u ne sa
van te n ote , vou s avez déj à corrigé et exp l i qué ce s)Là Â J î
, ,
qu i do i t ê tre remplacé par Je t â chera i à montou r de corr ige r deux au tres mot s de cette ph ra se , à savo i r
e t Commencons par l e dern i er , su r lequel M . Kreh l a dit dan s la n ote b : « Ce mo t est a l térédan s l es manu sc r i ts , qu i por ten t ou (S .)La prem ière leçon , qu i semb l e ê tre ce l le d e tous les man . ,
à l ’excep t i on d ’un seu l 1 , e t qu ’on t rouve auss i dan s Boul . ,es t la vér i tab l e . es t l e pl ur . de :…LËo ,
mot qu ’oncherchera i t en va i n dan s les d ic t i on na i res , m a i s q u i sembleavoi r dési gné une espèce de man telet que por ta i en t les fak irs errants , l es derv i ches . Je l e t rouve dan s un e curi euseanecdote que Maccar i rappor te dan s la Seconde Pa rt i e deson ouvrage (t . Il l , p . 158 , l . 2 e t su iv. éd . de B oulac)et qu i es t con c ue e n ces t ermes : LBts,
LS” &.L=
Ü'° _ l: Ll2 .—â .ll
âALS \: w i
) £53L: 3
1) Le dan s l e texte para î t ê tre u n e qu a si-co rrec tion de
BI. Kreh l . J e ne pu is pas deviner qu e l sens il y a a t tach é .
7 6
% : l &<JWL5J){LÀ 3 6W S M W
O gg)…M L: M LËÔ &. J L>
LS‘Q9 J J D) X: L. : Ùi X…L
5N lOLÂËÀ S LA
.l
54 03 LQ L.:3i [email protected]È J L3i Le.9}b UA
L55ULÏ
Un
xà
ü.ll u s) U" )
3 lLS
'” Lg :
v$ .Lï LÂ : 3 : LSO—.Ç>èê }àäàlL: L.: LS tm i
Ü'°
L55 834 0 31.fi
'
t34 >3
Ü£:
fJ ’ @ L3
Ü'°
L5 î) L. AL512 LZ0 3 : LÂZQ : Q \ÀW,
XäLË Ül. Je trouve au ss i ce mot sous . la forme …Làb , au
plur. dan s ce ve rs d ’un poème qu ’un pres t i d ig i tateur adressa à u n grand ma î tr e dan s l ’art et que c i te Maccarî (Seconde Part i e , t . III , p . 8)
ULÎ {D 0
°L5)
LX5 É) l UÂLâ J'
OJ i
e t dan s ce t autre passage 2 1 , l . eL5Lb a tdla,
U.$3N l a >f a w$t.æ
't I l es t donc certa i n que la
da/Ïâ sa ou da l/ds é ta i t u n vê temen t gross i er que porta i en tles derv iches
,l es p rest id ig i tate urs e t autres vagabonds , e t
qu i ressemb la i t à l’a bâ ci , avec laquel le i l est nommé conjointemen t e t qu i é ta i t auss i l ’hab i t d i st i n c t i f de ce tte sor tede gen s (cf. Abd-al-wâ h id ,
p . 190 ,l . 7 , Maccar i , t . I I ,
P 246: 1 c ’est—à-d i re , à un e espèce de manteau cour t ,
fa i t de la i ne , ouvert s ur le devan t e t ayan t des t rous parl esquels on passe les b ras (voyez m on D ictionn . des n oms
des vêtements , p . 292 e t Cons idé rons à présen t
78
P . 5 96 ,l . 12 . Au l i e u de l as ü, l i sez , c omme dans la
no te d , .ËÈ
Ibid . ,15 . L . e t Boul . comme vous c orr igez .
P . 5 9 7 , l . 22 . La bon ne leçon , es t auss i dan sBoul .P. 5 98 , l . 2 1 et n . d . Boul . comme les m an . ,
e t j ’hésiterais à changer cet te leç on .P . 5 99 ,
1. 1 1.
xÈ$ \g Vous vous ê te s t rompé e n d isan t qu ’ i lfaut changer en
,a s. La l ec on du t exte est excellen
te,ma i s l e verb e a i c i un sen s que probab lemen t
vous n e l u i con na i s sez pas . I l s ign ifie proprement , commeM . Lan e l ’a d i t dan s son Lex ique : p rép a rer des peaux ,en en étan t la ou surfa ce ; c ’es t don c ra cler ou ra tis
ser des peaux ; a uss i P . de A l ca la l e t radui t-il par ra spar,
verbe qu i a ce sen s . Dans la su i te on a appl iqué ce verbeà une écr i ture que l ’on gra tte pour l ’en lever de dessus l epap ier , efl
’
acer des m ots a vec un gra ttoir; chez P . de Alca la entrera er como en papel et m er del libro . C
’es t aufond la même sign ifica t i on , e t propremen t l es verbes espagnol s m er e t en treraer s ign ifien t auss i racler , ra tisser .
Le synonyme de est qu i , dan s l ’orig i ne , s igu ifi e également racler , ra tisser ( voyez B erggren sous cesmot s et Lane) , et en su i te efi”acer des m ots avec un gra ttoir .
J ’en donnera i t out à l ’heure des exemples ; ma i s j ’observerai encore que , dans pl usi eurs chartes arabes de la Sic i l e , l e sub stan t if qu i n c’ st pas dan s les d i ct i onnaires , désigne une efi
”
açure fa ite a vec un gra ttoir , et qu i’ lfaut rest i tuer ce mot dan s un acte publ i é par de Gregor i o ,
7 9
qu i a fa i t impr imer (D e suppu tandis apud Ara bes S icu los
temporibus , p . 46 ,l . 5 a
Üo ly o -t_ 3
u. :
ä\ ll : t I l fau t n o treexcel len t am i
,M . Amar i , a b i e n voul u m ’
apprendre quecet te l econ se trouve dan s l ’ori g i na l q ue M . Ca sa a col lat ionné . Je va i s vous don ner à pré sen t q uelques exemplesde employé en ce sens . Chez Macca r i (t . I , p . 5 20 ,
l . 12 e t su iv . ) on lit qu ’ un poè te fi t présen ter à u n pri ncedeux vers q u ’ i l ava i t é cr i ts s ur un …}b ; que ces
9vers commencaient a i n s i : -it , et que , dan s sa0
orepon se , l e pr1nce l u : d isa i t : —W :L5
’
Vous voyez que es t ic i l e synonym e de ouverbe qu i s ign ifie auss i ra cler (voyez Bocthor sous ce mote t sous ra ti sser) , e t que , par con sequen t , l e U Ü
.l0
é ta i t un e feu i l l e de pap ie r qu i ava i t déj à serv i , et don ton ava i t effacé l ’écr i tu re avec u n grat toi r , pou r s ’en serv i r en core une fo i s . Dan s u n passage d ’Ibn-Ha iyâ n ,
n’
expr ime pas t ou t à fa i t la même chose que car
on y l i t (ap ud l bn-Bassâ m , t . man . de M . Moh l , fol . 9
…. Ï, Œm :
)J i
U. : U M
L…
a.3t£. Evidemmen t est i c i ra turer , efla cer ce
qui est écrit , en pa ssan t quelques tra its de p lume par-dessus
,
et c e sen s sau te en core pl us aux yeux dan s un réc i t q uej e t rouve dan s l e Voyage d
’
Abdari. En parlan t d’IbnHab îch ‘
, qu i é ta i t u n modè le de modest ie , i l d i t (man .
1) % Ls üî Lfiw. g è
l
80
fol . 1 14 vo) ; unL55 LLÂ:>Lm
xsätd t M L.—W S S Œst) t, _
îttOL{ &.ii
0 9a…M
un ,.s L:Ç>L.o L&M : Œa b s
}m s
î… ss so.…äS
W 55 ÂEÊ $ , d es
}; ‘
s.Ëz$ ta
J LE, L5}: ma c
63 J LS Lg.,d= …m Lg: 5 .>
u h h> L» Œâ b… 1563
.;a b b f> L..,a , «aux , a m
65
ÙL{, u.…
UK
63 j rs, La… a 3L5 w ms
Ê……Ss” :
Ü,s . tË>, ,s SÀ @ -a
6355
8
2
5i Ü.uÛ }Ë g L.: a.Lês tô@ , u
‘ä
äe > :
«Mon compagnon e t ami en D ieu , Ahou—Abdallâ h i bnHoraira , m
’
a mon tré les troi s takhm îs qu ’
Ihn-Habîch ava i tcomposé s sur le poème de Chocrâ t isî . Mon ami l e s ava i técr i ts de sa propre m a i n , e n aj outan t qu’ i l le s ava i t é tudiés sous la d irec t ion d’Ibn-Hab ich , et , en n omman t cedern ier
,i l l u i ava i t don né les ép i th è tes honor ifiques aux
quel les il ava i t d roi t , après quo i i l l es ava i t rem i s aucha ikh , afin que cel u i-c i cert ifi â t par son écr i t ure que sondi sc iple les ten a i t réel lemen t de l u i . « Le cha ikh ,
» me
racon ta Ahou—Abdal lâ h ,« le s p ri t e t en tra dan s sa ma i son
en me d isan t : «At tendez un peu , j e rev i en s à l ’ i n stan t . »I l revi n t e n effet b i en tôt aprè s
,et a l ors j e v i s qu’ i l ava i t
1) Le s mo ts qu i su ive n t ici dan s le m an . , son t de
t mp . Ensuite le m an . W , , au l ieu de
2) Le m an . porte d ‘ un} ; fau te qu i s
’expliqu e a isémen t dan s u n man .
africa in .
8 1
raturé tou tes les épi thè tes que j e l u i ava i s don nées ‘ , etque
,dan s ce t te ra ture , i l ava i t clfacé son nom avec un
gra tto i r. I l ava i t a uss i ra turé tou tes l es ép i thè tes quej ’ava i s don nées a son pè re , en ne la i ssan t s ubs i s ter quel es mot s : l e cha ikh , l e c â l ib ä
» Mon am i Abou-Abdallâ hm
’
a fa i t vo i r ce t te ra tu re e t ce qu’
Ihn-Hahîch ava i t é cr i tau -dessus . C
’est b ie n là l e pl u s hau t degré de la modest i e e t une preuve i rré c usab l e q u ’ i l dé lesta i t tou te os tenta l i on . » Chez l bn-Abda lmelic Marrécoch î (ap ud Renan
,
A verroe‘
s ,p . 444 à la fi n ) on l i t que le cad i Ibn-Hau til
lâ h , qu1 ava1t é tud ié les t rad i t i on s sou s Averroës , ava it lacout ume , l orsque l ’hé résie de ce doc teur e ut é té prouvée
,
de ra t urer l e n om de son m a î t re chaque fo i s q u ’ i l se t rouva i t dan s un isn â d s… t On empl oi e auss i ce verbefigurémen t , comme dan s ce pa ssage d ’Ibn-Haiyâ n (loco lauda to ,
fol . 10Üsj.a Ùl
s,Ls c o s u J ‘.ä5
LnL=O» Li t; M …
;xè
L55, (l o rsque l e m onar
que voul ut rendre la l iberté à Ibn-’
Imrâ n) « quelqu ’un deson “en tourage l u i d i t : « S i Ibn—’Im râ n fa i t d eux pas horsde la pr i son
,i l ra i e tou te une a nné e de votre
P . 60 1 ,1. 5 . L..
,.s «Mé
3 0 .Î L5 L.Ê.S LA 5)LJ: 2 3i 8ÇX@
L5' ô J a ha 4—ii LÀË \A ÂG. AU l ie u de
l) L e se n s fo r t r em a rqu ab le qu e la Il 9 fo rme du v e rb e
_Ia :> a ici
e t dan s la su ite du récit , n’e s t pa s dan s le s dic tio nn a ires .
92) Le s m o ts qu i su iv e n t ic i dan s le t ex te ,sign ifi e n t : «No t re ch aikh ,
dit -il , qu o iqu e dej a â gé , é criva i t e n co re .» J e c ro is qu ’il fau t l e s me t
tre après L.g.A s 253 —\ AgA S &. x ii Lga èô ca r ic i ils se ra ien t de'
p lacé s .
82
_,q t , i l fau t l i re , avec les t ro i s m an . dans la n ote a
0
e t avec Boul . , _, q q 3. Ces paroles se rapporten t a l ’avan t-dem . l igne de la page précéden te . Un d i sc iple deCo tob î ava i t é cri t s ur la m arge de l ’a r t i c l e d e son ma î tre
Œ. : Lx5 , «L’
au teur (Cotob î)n’
a pas du tou t donné à ce person nage les l ouanges qu ’ i lm éri te . » Ma i s ce t é lève de Cotob î eu t à son t our u n d i sciple qu i écr iv i t au bas de sa n o te : « La ch i cane que n otre cha ikh (l ’au teur de la prem iè re n ote) fa i t à l ’aute ur(Co lob i) à cet te occas io n , n ’es t d ’aucune va l eur . » La I l l eforme du verb e éw a la s i gn ifi ca t i on de ch icaner , qu i n ’es tpas dan s l es d i ct i on n a i res , m a i s qu ’on t ro uve auss i dan sce passage d ’Ibn-Khaldoun (P roléqomènes , t . III , p . 76 ,
avan t-dem . J b l.à 53 $ Œ-5 x£ L.äa.o 35 , pa roles que M . deSlane a rendues t rè s-b i en par cel les-ci : « On n e doi t pasch i caner sur les term es . » (Ch ez Ma ccari , t . I , p . 18 ,
ä s x>bäa; es t ex actitude scrupu lwse .) La d iffi cu l té,t oute
fo i s , n ’est pas ici , m a i s dan s l ’en semb l e d u passage , car
i l y es t con s tammen t ques t i on de D zahab î e t j ama i s de Cot ob i. Il fau t don c de deux cho ses l ’un e : o u les parolesc i tées p . 600 ,
l . 22 , n e son t pas de Co l ob i , m a i s de D zah ab i ; ou b i en l e tex te de ce dern i er aura i t dû t ro uver saplace à l ’avan t-dem . l . de la p . 600 ,
après la c i ta t i on deCo lob i et avan t la n o te m a rgi na l e d u d i sc iple .Ibid . , l . 12 . Au l i e u de -A _ 3i L. « iL-c , l i sez LAL:
J’
a i déj à corr igé c e tte fau te dan sl e G lossa ire des m ots esp . dérivés de l
’
a ra be, p . 2 14 (v
°
o
, o oa taurzque) , ou 1 a l a uss1 expl iqué le termeIbid . ,
2 5 . Au l i eu de l i sez
85
P . 602 , l . 2 . L editeur a e u tor t de prononcer)Lm
,
J.gM fi l l i l fau t (la voyel le de l’ao ris le selonLane e t Boc thor) , à la 1re forme . B a ttre , qu ’ i l s ’ag isse demé taux ou d ’au tres choses , est t ouj ours —
o , jama i s .il.
Ibid . ,5 . Non pas m a i s JQ.Ïz (a ccep ter) .
Ibid 6 CL a . La l eç onL5
q…set rou ve dan s t ro i s man . e t dan s Boul . , n ’est n ul lemen t àdéda ign er . Elle s ign ifie , de mêm e que cel l e du t ex te«E t vous payez pour mo i . » Comme Freytag n
’
a peu t-ê trepas i ndiqué assez c la i remen t ce tte s i gn ifica t i on dej ’aj ou te ces exemples : lbn-Djobair , p . 305 , l . 6 : SJ . »
M l) Ù)
—.g_ Œ
gjà io
,« tous les Magribins
san s except i on doi ven t payer , comme n ous l ’avon s dit , un
dinâ r par tê te ;» Mil le et une n u its , t . IV, p . 159 , dem .
éd . Hab i ch t :C,L;3t s i a i l l e u rs , t . I , p . 417 , l .
6 a f. éd . Macnagh ten : Q)J dan s le même sen s15que 6 3 u .}Lsu ,
t t l . , 1 1 . L a ph rase ‘lUl,
E_
5}m i qu i se t rouve dan s u n d iplôm epub l ié par M . Amar i dip lomi a ra bi e tc . , p . 2 16 , l . 9 )n e doi t pas ê tre expl i quée , j e cro i s , comme l ’a fa i t l ed it eur (p . 444 ,
n . d) . y est un e forme i ncorrec te ,vulga i re , pour i: 3j ,j , e t i l faut tradu i re : « e t i ls n e payeron t que ce que payen t l e s m archands vén i t ie n s . »P . 604 ,
l . 20 .
L5wlz l l
09 s if 3L
lM a
,.
Vou s soupçon nez qu ’ i l fau t l i r e)L3 au l i e u de a m , ,
et san s dou te l ’auteur aura i t pu s’eXpr imer a i n s i ; m a i s la6 *
84
vér i tab le lecon n ous est fourn i e par Boul . ; c ’est Com
parez t . I , p . 905 , avan t—dem . l . : u,: lùÜl S
, .
P . 607 , l . 2 et n . a . B oul . a auss i à l ’accusat if, e t c ’es t a i n s i qu’on doi t l i re , car c ’es t u n t erm e c i rconstantiel . On di ra i t de même : l
}.u a s
”L” ,
e t n on pas ?Le » .
P . 609 , LaLä)’
ëL.el. Pl us correc temen tL51Î l , comme
dan s L . e t Boul .P . 6 10 , l . 1 1 et n . e .
Üg l
UJ L>
di s: l…a tÇm
,
I l n e faut pas s ubst i tuer U . : àL5
.L a (auss i dan scomme l e ve u t M . Kreh l , qu i a san s doute pen sé ,
m a i s à tor t , que la part i cul e dépen da it d u verb e . Le sensest : «Ma i s c ec i e s t u n réc i t peu p robab l e , eu égard à la
p ié té d ’Ibn-Mâ lik , e t i l faut en la i sse r la re spon sab i l i té àcel u i qu i l ’a rapporté . » Les pa roles de Cafadî , qm su 1
ven t imméd ia tem en t , s ig n i fien t : « Ce n ’es t pas u n réc i tpeu probab l e , à cause de » e tc . m ,… l , avec l ’accusa tifs i gn ifie , comme on peu t l e vo i r dan s l e Lex i que de M . Laneestimer un e chose peu proba ble ; croire qu
’
el le est
c ’es t-à-d ire , a bsurde ,
‘
impossible , car a très-souvent’ ; O o O ’ce sen s . Dan s n otre texte i l fau t prononcer au
pass i f , comme M . Wrigh t l ’a fa i t avec ra i son dan s ce passage de Maccari , t . I , p . 5 41 , l . 3 a f. :
Ü ,î s
ol
vJ.ŸÀ 9_ x,b ss i l est pe u p robabl e que cela se
fû t t rouvé dan s la grande mosqué e de Cordoue e t que l ecad i ’
Iy â dh n ’en ait pas parlé » (comm e le cad i ’
Iy â dh n’
en
a r ie n dit , i l est peu probab l e , Comparez Ibn-Kha ldoun ,
Prole'
gom . , t . I , p . 15 ,l . 6 : LÂ l,
86
ou tre i l fau t l i re aux l ign es 15 et 18 Je u …» (Boul . ) aul ie u de M U
» (moch tâ ghilin) .
Ibid . ,1. 16 . Au Li eu de
,tu, e t Li sez
,u
‘
ll et
Ibid . ,2 3 . Sub st i t uez (L . et Boul .) à e
j ,g}
P . 6 20 ,l . 2 1 (of. Add . e t Corn ) . Le mot xh ËzÏ> sem
b le avo i r emba rra ssé l ’éd i teur de Boulac de même que M .
Kreh l , car i l a a uss i fa i t impr im er Lä èL> .
P . 6 2 1 l . 2 . Après aj ou tez (L . etL apsus ca lami.
P. 625 ,l . 5 . Votre correct i on
,Les» , est con fi rmée par
l e man . d’
l bn-Hihya (fol . 150 r°) e t par Ibn-Khallicâ n (Faso .
VII,p . 98 , l .
Ibid . , 9 . (M $) l i sez comme on t rouve chezIbn -D ihya . Ce mot , que Freytag n
’
a pas , s ign ifie u lcère;P . de A l cala l e don ne so us u lcera como p ane l . I l fau t auss ile rest i tuer chez Ibn-Khallicâ n , Faso . VII , p . 98 , l . 8 .
P. 6 24 , l . 6 . Ë .Î.Î e xl l l, f., s . Vous
vous ê tes efforcé en va i n de t i re r u n sen s de ces paroles ,qu i n ’en on t pas. Le tex te est a l té ré ; i l fau t l i re avecBoul . : _,eL5 1i —&Ï >it
Ü…LS xUL
,t,
°
Âs ; ph rase ex cel le ntee t qu i ne présen te pas la moindre d iffi c ul té . L . a au ss ila b onne lec ‘on ; seulemen t l es po in ts d u c .? de d .«vLs son tu n peu i nd ist i n c ts .Ibid . , l . 9 . Dan s Boul .
J. , â î l
,s L.…il .
Ibid . , De vos deux conj ec tures j e préfè re lechangemen t de eo
) _s u en Le mot
rLÂÈ se trouve
auss i comme un col lec t i f ma sculin dans u n vers q ue c i te
8 7
no tre a u teu r , t . l l , p . 19 5 ,l . 8 , e t dan s un au tre chez
Abd-al—wâ hid , p . 10 2 , Un s ul ta n de G ren ade estn ommé dan s son épi taphe : «
( 5 .M l l(Lu i: , ,
.L.el (Ibn .
a l-Kha t ib , m an . de M . de Gayangos , fol . 145 Dan sl e Car tâ s (p . 6 1 l . 8 a f. e t 6 a c ’es t un s ingul ie rm asc ul in
, avec le sen s de brouil la rd très-épa is .
Ibid . , l . 14 (cf. Add . e t I l es t presque i n u t i lede d i re que Boul . a x. î tgï .
Ibid . , 15 . Aj outez un apré s e t un ce après
P . 6 26 ,l . 10 . Boul . e$ 5.3 Œ
i l
Ibid . , 25 e t p . 627 , l . 1 . Vo tre ob servat i on sur l egen re du m o t
ôL, io es t j uste . Aux exemples que vous c i
t ez pour p rouve r qu ’ i l es t fém in i n , j ’aj ou te l e passaged’
Ibn-Bassam da n s m es L oci de Abbad . , t . III , p . 40 ,
1 1 . Ma i s au reste votre conj ec t ure sur ce passage (qu i afor t embarra ssé l ’éd i te ur de B onlao , car i l a fa i t imprimer
o Lä3l, e t en su i t e vs ) m e semb l e i nad
m i ssible . Dan s l e man . d’
Ibn—Dinya (fol . 1 50 Vo) i l es técr i t de cette man ie re xi£5 \&i È 5Lä3l,
s  LË S, I l es t don c cer ta i n que ces deux phrases n er imen t pas en semb l e , x=L,_
lo é tan t au nom ina t i f e tà l ’accusat if. La ph rase s u i va n te n e r im e pas non p l u schez Ibn-D ihya , qu i n ’
a pas l e m o t…5 6 , Quan t au motdoute ux (chez Ibn-Kballicâ n M i l) , j e croi s devoi r l e l ireA Î Ê LÏÇJ (imaginer , inven ter) .
P . 2 . Ibn-D ibya : s,: w,
.è l Œxl t
Ü )Æl l
Oe)SP,
.
Ibid . , 8 . L . et Boul . on tœLé , comme vous avez tro uvédan s R . A mon av i s
,cette leçon est la seu le bon ne .
88
Ibid . , l . 20 . La véri tab l e l eçon , Al , est auss i dan sBoul . e t dan s L . , de sor te que la n ote li est i n exac te .P . 6 28 , l . 19
u L.$ -œl _ l9/«w
L5'LS
J£.J l (l . U C” ) Ü '° a a $ \m ki t
UA
Vos deux changemen t s , s b , m,pou r et LÎ g
J.-g pou r
qu i n e son t pas confi rmés par Boul . me semb len ti n ut i les . Vous d i tes vous-même que
,L. s est une l i cen ce
poétique pou r et j e n e voi s pas p ourquoi ‘
à 5;€ pou rLîn
n ’en sera it pas auss i un e . Il me pa ra ît m ême b eauC OUP plus naturel que l e versificateu r , qu i éta it forcé parla mesure de v ioler l es régles de la gramma i re e t de m e tt re l e second mot au n om i na t i f , en a it fa it de m ême pourl e prem ier , afin d ’é vi ter une i n con séq uence , un e b i zarrer ie. Quan t au changemen t de
r.Ê. Îs b en j e doi s
ob server que l ’ab sen ce d u prenom qu i d evra i t s e rappor terà wù$ \il , n ’est aucunemen t ce que vous appelez « e i n eunerträgl ich e Härte .
» Il n ’y ”
a dan s cette ab sence r ie nde dur
,r i en d’ insupportab le ; m a i s j e c ra i n s que vous n ’ayez
pas b i en con n u la s i gn ifica t i o n d u t erme _b . î . æ dan s lasc ien ce des t rad i t i on s . I l s ign ifie , comm e l ’a d i t M . deS lane dan s sa t raduct i on des P rolégom ènes (t . I I p . 481 ,
dem . la bonn e m émoire des trad i t i on na i res , ou b i enl eu r eæactitude . Par con séquen t on dit
ÜM :XS \À l
Jam , etc . , sans r ien aj o u ter . A i n s i on lit dan s lesP rolégomènes (t . I , p . 6 1 ,
l . iläî ii £,Èl
. ic ,œl t, xiîa : U « Or , pour arr iver à cet te croyan
89
ce , i l fàut ê tre parfa i temen t con va i n cu de la c réd ib i l i té e tde la b onn e mémoi re de s person nes qu i ont t ran sm i s ce sren seignemen ts . » A i l l e urs (t . II , p . 396 , l . 5 de la n o te)on t rouve à peu prè s le s m êmes paroles . Dan s u n au treendro i t (t . II, p . 145 ,
l . Uu .x . aŒ: Lu i: lÇ>L5
,L c s s ,—e, i _ io. ,e d is
,i
,i Xiâ i .» ou…s i
wm l l x_%w Œil e£ lô ( 5I,
« S i l ’on découv re qu’ un des h ommes n ommés da n s l ’isnâ d d ’ une t rad it i on a é té taxé de négl ige n ce , ou de ma uva i se m émo ire ,ou d ’inexac titude , ou de fa ib lesse (comme au tor i té) , o u
' dem anque de j ugemen t , cela affec te l ’auth en t i c i té de la tra
d i t i on » (t rad . de M . de S lane) . Chez Macca r i (t . I , p . 8 15 ,
l . W A S …Ibn-al-Kha t ib (man . de Par i s , fol . 1 54. lam l l
,L.\ ÎL> C es exemples , qu ’a u b eso i n i l
ne me sera i t pas d iffic i l e de m ult ip l ier , vous co n va i n c ron t ,j’
eSpère , que la l econ du t ex te est parfa i temen t b on ne .En prose on d i ra i t : w…\ s üt u
_.eL$ æ l fin ,—fo J o
}… Le
,« à
L5
la cond i t i on (qu ’ i l s t ran sme t ten t tou t cela à d ’a ut res) avecl ’exact i t ude qu ’on ex ige des t rad i t i o n na i re s . »P . 6 29 , l . 8 et su iv . Maccar i a ra i son quan d i l d i t (à
la dern ière l i gn e de ce tte page) qu ’
l bn-D ihya don ne un
a utre t ex te de ce poème , e t la d iffé ren ce est s i importan teque j e croi s devo i r don ner en en t i e r le tex te de ce t auteuret son commen ta i re . Voi c i don c c e qu ’ i l dit (fol . 1 13 v°1 15 Le… o l
)l «AS, n
,a_,
L%wwl, L@lfi ül À 99L.-7 L5
’ J LS
) O ;
xix: l,n i
90
o . , (ii
0 o
O
U. é.> )
iM iL5
5 L
g } _ aj_ A &. ÂcX-J
w)
M . .ËZ-JC)
.
&J )—ÈZ—2—A À—ÀL-S lt-M 5 L -c
é lt5
' 5 e5ùëi:
a
s i esse ,e
… . S L î. ä &. ii àô L-o+ s s}
_ c _ ï
iô l —L g, 55 UL. f o.. 3
ÙL_ . n
5_ lî
ÜsL_ s
s . : ( S J—. it esse ê»i,
'
-œ. 5 ŒL: ,3t. .5 a s….
5 0 0 -É
-iZ. fi LS“ > -S L ÀÀ l—Ï
1) Lise z ô}Lm ll , comme ch e z Maccari.
9 1
U S)—.ga Œ L : ŒLÀ J EJ—. A
0 % o o
M . J Ôl M _ J ÔËSS L5 ). W M A
x. i . s -t. o . l l
e.,ss _ te
, Ü oL. Ë»
s _ e_ s,s“
s Œ_ ,i,lo
u l.. g. a Œj
â—î—M “ &. iî fl. ä
eos—g_ s
…La…vs 325
ÜL…l l Œo ,o LM
, x,£h tt
L55 L@â xn Ü
, 1, Lie x,s is .i i e5,5 \m il L,,s
œÂ Xi ä l »s, i s i
,
-
s,
cuits…o l,…l t L,
. l l Les voyel les que j ’ai données set rouven t dan s le m anuscr i t .Ibid .
,18 . ex ,,s i W u Ce
est san s doute a l té ré ; i l faut u n mot comme l .î .£ ( « en
l e comparez l e secon d hém i s t i ch e d u vers qu i su i t .Ibid. ,
2 2 . …5Läè. M . Krehl a—t-il compr i s ce qu i sera i t con tre la mesure , car la prem ieresy l lab e doi t ê tre longue ? Vous même , en avez—vous sa i s il e sen s ? Vous m e répondrez san s dou te q ue n on , car
c’es t u n mot d u dial ec te pop ula i re de l’Andalousie , e t à
9 2
m oi n s d ’avoi r é tud i e P . de Al ca la , i l est i mposs ib le de lecomprendre . On peut b i en dev i n er quel l e doit ê tre à peuprès sa s ign ificat i on . La dame désappo i n té e a t tr i bue , sel on les i dées du temp s , l ’ impu issance de son aman t à un
maléfice . C’est u n sorc ie r , » d i t-el le ,
« qu i a fa it cela ,»
et do i t ê tre un e ép i thè te du sorc i e r . Eh b ien P .
de Al ca la a u n Verb e qu ’ i l t radu i t par bur lar a otro
: O )et par engan ar apartando (t romper) . I l a a uss1 au
Oo op l ur . engan o (t romper ie ) , e t enca l lecido en
a stucias (vi eux rout i er , rusé perso n nage , fin m a to i s) etsiervo ma trero (un servi te ur r usé , ast uc i eux ; i l t radu i t lamême expre ss i on par , la é Ces t ro i s termes son t ,pour a i n s i d ire , les proches paren t s de n ot re qu ’ i lfaut pron once r ou (of. de Sacy , Gramm . ar . ,
t . I , p . 5 22 , n . c e qu i ré tabl i t la mesure . « C’est u n
sorc ier a stuc ieux qui a fa i t cela . » San s d oute i l fau t m ettre ces s ign ifica t i on s de g
,etc . , en rappor t avec l e
verbe voler des cham eaux , dan s la langue class i que;car un voleu r de chameaux est ob l igé de ra ser ,
de t romper , pour at te in dre son b ut .Ibid . , L. 23 . :»i e s.iLs . L
’éd i te urde Bonlao a compri s a ut remen t cet hém i s ti ch e , car i l afa it impr imer e .< di c ’ est—à—d ire , u).ÂÎ (cunnus ma
tris tune) . En adoptan t cet te lecon , i l faudra i t b i en prononcer w
,l, comme dan s le tex te , e t non paswô,l , comme
dan s les Add . et Corr . ( « quand tu voula i s sor t i r d u ventre de ta Po ur expl iquer le second hém is t i ch e ,
94
parfa i temen t ra i son en proposan t de l ire a i n s i , comme l eprouven t l ’éd i t ion de Boulac et n os deux man . du Takfa t
a l-’
a rous . Dan s c e dern ier l i vre o n t rouve tout l e pa ssageà part i r de la p . 6 5 1 , l . 20 , j usqu ’à p . 6 5 2
,l . 7 ;
man . 5 50 ,fol . 156 r
° et v°, m an . 426 , fol . 1 14 v ° .
Ibid . ,l . 19 . Ibn-D ihya (fol . 105 V 0) correc temen t Ü . .e
Abo , .
Ibid . ,2 1 . L i sez L%Aœzz5 l Œi l, s l (Ib n-Dihya) .
P . 6 5 5 , l . 9 . Trompé par la m auva i se l econvous avez changé m al a propos la b on ne leçon
L 5»,e t at
tribué au vers en ques t i o n u n sen s qu ’ i l n ’
a pas . I l fau tl ire
,comme on t rouve chez Ibn -D ihya (fol . 115
1 0 ’ 0 0 0 0 w
Un M > l, cs’) (le s voyel les son t dan s l e Le
sen s est : Voyan t que m es compagn on s n e voula i e n t pas medonner à boire , « j e p ri s mon ou tre sous l e b ra s en dévoran t mes chagri n s . »P . 6 34 ,
l . 9 et u . b . Le x .3,äo des man . (et de Bou l .)
n e doi t pas ê t re changé en comme l ’a fa i t M. Krehl ,0 0
ma i s en d.s . â à .
P . 6 36 ,l . 20 . Vo tre correct i on ,
o,îS t s , est con fi rmée
par BouL
Ibid . 2 1 . Pl utô t c omme dan s Boul .P . 6 5 7
, l . 22 et n . e . La conj ectu re de M . Krehl es tcon firmée par Boul . et par l e m an . d
’
l bn-al-Khat i b .
P . 6 5 8 , l . 17 : L . et Boul . comme vous corr igez .P . 6 59 , l . 12 . L a b on ne leçon
, J À xd ,es t auss i dan s
Boul .P . 6 40 , l . 12 . Même ob servat i on .
9 5
Ibid . , n . e . C e t te n ote est i n exac te ; L . e t l e man .
d’
l bn-al-Kha t i b on t la bon n e leç on (auss i dan sP . 6 4 1 l . 17 . L . e t Boul .
,x…Al .
P . 6 42 , l . 8 . I l n ’y a r i en à change r dan s les m otsBoul . e t l e m an . de Berl i n d ’Ibn
al-Khat ib on t l es m êmes lecons . …su : l est succéder , et lesph ra ses dan s l e gen re de cel l e -c i son t fré quen tes ch ez Ibnal-Khatib . Votre exp l i ca t i on de la VIIIe fo rm e de
,}x‘
cd est
bon n e ; m a i s comme el l e n ’es t pas dan s les d i ct i on na i reset que vou s n e semblez pas avo i r ren cont ré a i l le ursW i
dan s cet te accep t i o n,i l n e sera pe ut-ê tre pas i n u t i l e d ’en
t re r dan s quel ques dé ta i l s su r ce suj e t . A la Ire forme ,l e verbe s ign ifie tirer en haut . Dan s l ’an ci en n e langue onne semb l e l ’avoi r employé qu ’en parlan t de la vi an de q u ’onret i re d u chaudron quan d el le es t c u i te (of. Hariri , p . 39 5
de la 1re éd i t ) ; m a i s p l us ta rd on s ’en est serv i dan s u nsen s géné ra l . A i n s i o n lit dan s les M il le et une nuits (t .
I , p . 85 9 ) que Cama r az-zam â n , aprés avoi r a t tach é un
e un uque , con tre l eque l i l é ta i t fâ ché , à la corde d e pui ts ,l e p lon gea dan s l ’eau ; « ens u i te i l l e t i ra e n hau t
,» s i…
l e replon gea dan s l e p u i ts , e t rép éta plus i eurs fo i s c et teopé ra t i o n
, W ,s LA l
L55r>LË LËl e£iô …Eä u dl,
L’éd i t i o n de Hab i cht ( t . III , p . 200 ,
l . 1) por te en ce t
endro i t au l i eu de ces deux verb es son t don csyn onymes . Dan s un au tr e passage (t . III ,où i l es t q ues ti o n d ’ un n aufragé q u i se déba t dan s l es vagues prè s d u r i vage , l e v i z i r dit au ro i : j
,-3l
O. ;
w, A l Ü .e xt .dast, s.. l ,« S i vous l e permette z , j e descen
dra i vers l u i pou r l ’arracher à la mort ;» l i t té ra l emen tp ou r l e ret i rer de la mort . Dan s la su i te on l i t (p . 225 ,
9 6
l . so. . 5 « Le v i z i r tend i t la ma i n au
naufragé e t l e t i ra en ha u t . » Ic i J. -3 est l e synonymede U LÂ > . En effe t , ces deux verbes s’emplo ient l ’ un pourl ’au tre . A i n s i , au l i e u de d i re «mu m : à la l et tretirer quelqu
’
un par le bra s , en parlan t d ’un e person ne qu iest par terre et qu ’on veu t remett re sur p i ed , pui s , figurément : t ire r quelqu ’ un de l ’ob sc ur i té et l
’
élever à de hautes d ign i té s , on dit auss i m êm e
(L. Un vers de Câ ’id ,
l e poè te favor i d’A1manzor , e n fourn i t la preuve . Dansquelques rédac ti on s , comme chez Macca ri (t . I I , p . 5 7 , I.
6 °ce vers commence par le s m ot s :dan s d ’autres , comme ch e z Homa idî e t chez Abd-a l-wâ hid(p . 25 , l . c ’es t : æz xm a …L… o …. s . L a VIIIe fo rmes ’emplo i e dans la même accept i on . Ch ez Ibn—Haiyâ n (apudIbn—Bassam , t . I , m an . de M . Moh l , fol . 88 r
°
) on l i tque , lorsqu ’
Abou-’
l—VVa l îd ibn-Zaidoun eu t é té j e té en pr ison , eL«L:>
u"
üa ,,l, l l œ3 l Œ
t= À î s, g…à3 Œäl l
sz iL: .e65 ux.xi s is i
—i i, s i
éd.—ss —s us
Œ,t sa it, ,
« i l implora l es b on s offi ces d’Abou-’ l-Wa l id ibn-Djahwar ,
don t l e pè re, Abou-’ l-Hazm , [le prés iden t de la répub li
que] v i va i t en core à ce tte époque . Al o rs Abou—’ l-Wa l idibn—Djahwar i n tercéda pour l u i le t i ra de sa ma lheureuseposit i on , e t l
’
admit dan s son en to urage . » Dan s un e p iècede vers que Çâ ’ id adressa à un n ob le quand i l eu t étécondamné à un e amende , e t que c i te Ibn—al-Abhâ r (dan smes Notices , p . 15 7 , dem . l . ) on t rouve cet hém i s t i che
&îÀ XSi, e .< l a
Ui i
612
J£:
à la l ettre : «Vien s au secours de ton cous in e t t i re-le enh au t ,» c ’est—à-d i re : ret ire-le de l ’embarras oùi l se t rouve .
98
b ien tô t nou s rencon treron s de n ouveau . Or , c e dern iermo t , qu i , selon un e observat i on récen te de M . Blau (dan sle Zeitschrift d . deutschen m orgen l . Gesel lschaft , t . XXIII ,p
. 2 7 5 ,n . do i t son origi n e au grec 7 pa 7réïzou, s ign ifie
ba lustrade , garde-fou , rampe (ba l us trade à hau teur d ’
ap
p ui ) (Boctbor sou s ces m ot s , B erggren sou s l e prem i er e tl e dern i er , Marce l sous le p rem ier) Gelà
‘
nder von gedrech
selten [J ochen (Wetzste i n dan s le Zeitschrift , t . XI , p .
Chez Hélot e t chez Paulm ier c ’est (le tâ rba ç d’Alcala) , ba lustrade , ga lerie de bois , ba lcon . Chan i dj ib se t ro uveauss i e n ce sen s chez l bn-Djobair (p. 29 5 , l . qui
emploi e t rès-souven t l ’adj ec t i f verba l mochardj a b qu i s ignifie ba lustre
'
(p . 9 9 , l . 7 , p . 10 1 , l . 15 , p . 149 , l . 14 ,
p . 15 1 ,1. 7 , p . 1 5 5 ,
1. 5 , p . 267 l . 3 , p . 6 ,
p . 27 7 , l . Le passage de Maccar i que j ’ai c ité , n ousmet en é ta t de pré c i ser en core davan tage l e sen s d u term edon t i l s ’ag i t . I l en résulte que le chardj a b é ta i t une
espèce de . ba l con , une sa i l l i e s ur la facade d ’un b â t im en te t en tou rée d ’un e haute ba l ust rade , dan s laquelle il y avaitdes fenêtres ‘. C
’es t san s dou te à ces ba l con s que le su
perbe pala i s de S i lves , l e Caçr as—charâ dj îb (o u as—charâdj ib) , deva i t s o n n om . Mo
’
tam id l’
a chan té et al-Fa th en
a fa i t l ’é loge dan s les termes les p l us pompeux ; voyez mesL oci de A bbach
‘
dis , t . I , p . 5 9 , l . 8 avec ma note , p . 85 ,
n . 5 7 , p . 1 70 ,l . 6 e t su iv . ; Ibn-al—Abhar dan s mes No
tices , p . 200 , l . 13 e t 14 . San s dou te i l s d onna i e n t s url es deux r i vi eres qu i , sel on la descri pt i on d ’a l—Fath , entoura ien t ce pa la i s
,de même que l e chardj a b don t parl e
1) Bo c th o r t radu it le m o t ba lcon (saillie d ’un e fen ê tre ave c b alu s trade)
par &: Ll9ë )L>
Ûgj gi) à .
9 9
Maccari , ava i t vue su r le Guada lq u iv i r , et i l es t p ré sumab le qu ’ i l s serva i en t sur tout aux dames , qu i , abri tées parla hau te ba l ustrade , pouva i e n t y j ou i r , presqu e san s ê trevues , du spec tacl e de la n a ture . C
’es t de ces ba l c on s queparl e Ibn-Sa ’ i d dan s l e vers qu i m ’
a fourn i l ’occas i on defa i re ces remarques . Dan s cel u i qu i précède , i l ava i tn ommé c ’es t—à -d ire , San t iponce , v i llage b â t i s u rl e s r u i nes d e l ’an ci en ne e t cé lèbre I ta l i ca , non l o i n d e lar i ve droi te d u Guada l qu i v i r , e t aprè s a vo i r d i t : « Combi ende pla i s irs avon s-n ous goû té à San t ipon ce , san s que person ne y trouv â t à red i re , » i l c on t i n u e : « l à où son t cesba l con s , où se t i en nen t tan t de bel le s j e une s fi l les . »A pré sen t n ous devon s en core n ou s occ uper d u dern i er
m o t d u vers . Dan s Boul . c ’est m a i s c omme lar im e do i t ê tre e n bo , i l n ou s faut d e t oute n écess i té l ’aor i st e d ’ un verb e . Par con séquen t , j e l i s Ç u ä , l
’
aoriste
au pass i f de la I“8 forme de -c , verb e qu i s ig n ifi e en
tourer la t ê te d ’une statu e , c ’est-à—d i re , d ’ un fichu de soi en o i r avec un b ord rouge et jaun e e t souven t orné d e perl e s e t de p i èce s d ’or . C
’é ta i t la co iffure des dames a rabe sen Espagne , auss i b i e n qu ’a u Ma roc e t e n Egypte ; voyezmon D ictionnaire des noms des vê temen ts , p . 300 e t suiv.
San s doute à la Ve forme , conv i end ra i t m ieuxm Lu : lf Î>.‘o dan s le (Jdmous) ; m a i s n otre poète n e po u
va i t employer ce tte form e à cause de la mesure,e t on
peut compa rer ces paroles d u Cdmoa s au ÇwzÊ. La ËLsLu a l î.
P . 649 , l . 5 . Bou l . comme dan s la n ote h ; m a i s j e l i sque vous semblez préfé rer auss i e t qu i es t le mot
p ropre .
100
P . 650 , l . 5 . Boul . comme dan s l e tex te .
P . 6 55 , l . 15 . Au l i e u de ad l i sez Ç—A u > .x:°
P . 6 56 , l . 17 . I l es t p resque superflu de d i re que L .
e t Boul . on t auss iâ g
é,—4.
P . 658 ,l . 5 . Les cop i stes on t é cr i t i c i œ@W i, parce
qu ’ i l s se son t la i ssé t romper par l e verbe àLæ , qu i su i t ;m a i s u n te l mot n ’
ex i ste pas , e t s ’ i l ex i sta i t , i l don nera i tu n sen s absurde . B oul . a c::wLn lii , e t c ’est préc i sémen tl e terme qu i c on v ien t .Ibid . , 4 e t n . a . M . Kreh l s ’es t t rompé , car L . a
s L…ü,l eç on que Boul . a auss i .
Ibid . , 9 . Votre rem arque es t très-bon ne , e t la vê
ritable l econ , es t dan s B oul .Ibid . ,
20 . a : » 83L$ Ül Le changemen t d esJL5
‘J l en @ )Ls üt , que vou s vou lez fa i re , es t auss i i nad
m iss ible que cel u i que s ’es t permis l ’éd i te ur d e B oulac en
fa i san t impr imer La l eçon d u texte est bonn e .J ’avoue que s i j e l ’a va i s e ue sous les ye ux i l y a quel quesannées , j e l ’aura i s changée en af>L$ d i , comme vous pouvez le vo i r dan s l e t ro i s i ème vol ume de m es L oci de A bbadidis , que j ’ai pub l i é en 1865 ; m a i s à présen t j ’a i acqu i s la cer t i tude que c ’es t siL5 15i qu ’ i l fau t . Le part i c ipe
)L.> ne pouva i t pas me fa i re reven i r de mon erreur , car
ch aque foi s qu ’ i l s e m e présen ta i t,j e l e ch angea i s en
le s copis tes ayan t pu fac i lemen t con fondre ces deux mots ;m a i s h eureusemen t j a 1 rencon tre le sub s tant i f qu 1
n e se la15 5era 1t pas changer en so l…\ ce dern ier mot
102
P . 666 ,l . 22 . Votre excel len te correct i on , sL pou r
aL3, est confi rmée par Boul .P . 6 67 , l . 13 . Boul . comme vous corr i gez .P . 668 ,
l . 9 . Après c_y .àK aj oute z eMô (L . e tP . 6 70 ,
dem . Au l i e u de …» x l l , qui sera i t r idicu
l e , l i sez …,Jà l l , comme dan s Bou l . Freytag n’
a pas
comme pl ur . de on l e trouve chez Maccar i , t . I ,p . 5 04 ,
l . 19 ,dan s l e Cartds , p . 6 , l . 5 a f. , chez Ibn
Khaldoun , H ist. des B erbères , t . I , p . 295 l . 14 (M . deS lane a corr i gé l e texte dan s sa t ra duct i on) , chez P . deAlca la sou s maj u elo et so us p lanta .
P . 67 1 , l . 1 1 . Boul . comme vous corr i gez .Ibid. , l . 22 . Votre
Ü…s u est c on fi rmé par Boul .
P . 6 7 5 ,l . 4 . Boul . confi rme a uss i vo tre
î3L…
Ibid . ,l . 12 . B iffez ._Stä5 , qui se ra i t de trop ; L . et Boul .
ne l ’on t pas.
Ibid . ,l . 14. Boul . n ous m et à même de corriger deux
fautes graves qu i s e t ro uven t dan s c e vers Au l i eu deLà%l l , qu i sera i t v ide de sen s , i l fa ut l i re e t à
L:.lä‘
3l i l fau t subst i tuer L.LÂ .ËÏ3, « I l n ous a pré sen té uneb oi sson don t la co ul eur é ta i t cel le de la po ix (Ü )…q,…l1 1 e t e t i l n ous a donn é des c orn es de chèvre
pour desser t . » F rey tag n’
a pas su i v i de U , donner
à quelqu ’un des des fruits secs qu’
on mange au des
sert en buvan t du vin ; m a i s la m an iè re don t on emplo i ela Ve forme (cf. l e G l ossa i re su r Edr i s i , p . 584) met cetteaccep t i on h ors de doute .P . 67 4 , l . 8 et 9 .
Z”s’
expliquerait difficile
10 5
men t . La bon ne lecon est dan s Boul . ; c ’es t ,s uäl l. Dan svotre n o te s ur l e tome p . 5 1 , 5 a f. (B erich te ,
p . vous avez c i té deux passages de Maccar i où les0 0p i s tes on t écr i t
J $\ä:—l l au l ie u de le n om de la
côte de l ’Arab ie mér id iona l e d ’où v ien t l ’ambre ; on pe uty aj ou te r cel u i-c i . Le mo t
C’)s i gn i fie i c i bonne odeur ,
parfum ,comme ch ez l bn—Djoba ir , p . 19 7 , l . 12 ; le parfum
d’
as-Chihr , c ’es t-à-d ire l ’ambre . Il faut l i re de même t .I I
,p . 5 40 , l . 1 , où Maccari c i te u n l ivre i n t i tulé
cc)â À
l l (lis . Je m ’é ton ne que vousn ’ayez pas corr igé à la l ig n e 8 l e s m ots m on s trueuxLï L.u t x. l &» Ÿ. I l va de so i q u ’ i l faut pron once r é .îËcŸ
P . 67 5 , l . 4 et 5—. m
Ü° 3 l
Ù
‘
Α
5.îa .n 5t.s
s,, (1. ,si . ) ,en Ü
L>’”
v .,
L5.1. : Sas se
Je ne pu i s t i rer aucun sen s ra i son nable du second hém i s ti ch e d u prem ier vers . Dan s Boul . (qui a Œ)
L_ n -a,
c .-à—d. pour ce qu i rev i en t au même) l et roi s ième mo t es t
ra l ) , l econ que j ’adopte m a i s
l ) En re cevan t l e t ro isièm e fascicu le de v o s n ou ve l le s ob se rva tio n s ,
j’
y v o is qu e v ou s n e te s pa s t ou t à fait d u m ême av is a u suj e t de ce
t itre . J e laisse m a n o te t e l le qu ’e l le e st ; qu e l e le c te u r ch o isisse l
10 4
en changean t l e dern i er mot en l):Â l l Un ex am
,
un ami qui porte le turban , n ’es t pas en géné ra l , commevous le d i tes dan s vos remarques sur l e vers qu i su i t , unami du sex e mascu lin , m a i s c ’es t un ami qu i est théologien ou h omme de lo i , parce qu ’à Tun i s , comme en Espagne ,
ceux-l à seulemen t porta i en t l e t urba n ; voyez m on
D ictionn . des noms des vêtem en ts , p . 506 e t suiv . C’
é taient
des person nes graves e t d ’ un cer ta i n â ge , qu i , c ommet ou t l e m onde sa i t , improuva i en t , selon la l o i d e Mahom e t , l ’usage du v i n . C
’est pour cet te ra i son que l e poètedit : «Cachez-le (l e v i n ) aux yeux des ami s que vou s avezparm i l es h ommes à t urban , car l es v ie i l lards n e peuven tque fa i re p l eurer les j eunes gen s i n souc ian ts c ’est-à-d irei l s peuven t sermon ner les j eunes gen s , l e s fa i re pleurerl eurs péchés
,
‘ m a i s i l s n e sont poi nt fa i ts pour assi ster àdes fest i n s égayés par l e j u s de la t re i l le . Dan s l e secon dvers
,j e n e pu is pas adopter vo tre changemen t de
0 0 3en car en le proposan t vous avez supposé , d ’ab ordque est u n am i du sex e ma sculin ,
c e qu i ,comme j e v i en s de le d i re , n ’es t pas exac t , en su i te que
s ign ifie un voile de femm e , tand i s qu ’ i l es t trè scerta i n que ce terme n e s ’emploie jama i s dans ce t te ac
cep tion , qu ’ i l n ’est jama i s l e synonyme de La l eçond u t exte est b onne , m a i s Boul . n ous fourn i t une excel
o r
l en te correct i on pou r le dern ie r mot , qu i do i t ê tre l) s s xl l ,rouge , du vin rouge . Pour expr imer clai
0 0 0
1) On Pe u t “ 5 55 pro n once r ly :Ül e t l
y.fll , tou tes ces formes é tàn t
b onn e s e t ayan t la m êm e sign ifi cat ion .
106
P. 683 ,l . 8 . L . a a : t .o Œl$ ta san s U n
, Boul .ètl im
va ; ma i s j e m e range en t i è rem en t à vo tre av i s .
î—eCJ'
comme M . Kreh l l e d i t dans l es Add . e t Corr . ,mai s
Ibid . , n . a . Boul .8L,3 sans b lan c .
Ibid. ,l . 18 . I l n e faut pas s ubst i tuer Ü ,Ks a
9
P . 686 , l . 4 et n . a . L i sezrt comme dan s Boul .
et dan s les deux man . d’
Ibn—Haucal .
P . 687 , l . 3 . Boul . au l i eu deP . 689 , l . 3. Au l i eu de l i sez (L . et
P . 69 1 I. 4. Bou l .ë i>
Ibid . , l . 8 e t n . c . Boul . n’
a pas non pl us l ’a rt i c l e e ti l n e fa ut pas l ’aj o uter ( « u n endro i t où il y ava i t des c u i
c omme vou s corr igez .
P . 692 , l . 9 e t 10 . Je n’
a i pas de rem arque à fa iresur ces vers , m a i s b i e n sur la fi n de vot re n ot e , où vousreprochez à M . de Goeje d ’avoi r fa i t impr imer ,AL)’ dan sson éd i t ion de Belâ dzorî (p . tt
‘
,l . C
’es t san s douteune fau te b ie n lourde ; ma i s commen t a vez—vous p u cro i reun seu l i n stan t qu ’ un savan t te l que M . de Goeje l ’a i tcommise ? Ign orer i ez-vou s que les compos i te urs nous j ouen tparfo i s d e m auva i s tours , e t a uri e z-trous o ubl ié q u ’avan tde cr it iquer u n passage , i l faut s ’a ssu rer s ’ i l n ’
a pas é té
corrigé dan s Ferrata ? S i vou s l ’avi ez fa i t , vous a ur iezt rouvé , dan s les Addenda e t emendanda ,
p . 1 15 , que cees t une fau te d ’ impres s ion pour Déc idez
ma i n ten an t vous-même de quel dro i t vous avez reproché àl ’éd i teur d ’avoi r méconn u
,en con s idé ran t l e «:S sém i t iq ue
7
comme une conj on c t i on ,la na ture c on stan te de cette par
t icu le .
Ibid .,1. ex.. 5 : .n .s , sa ,s x. L. .
Je n e comprends pas pourquo i vo us voulez changer , co ntre l ’autor i té de tous les m an . (e t de s
}
… â 3,e n
M,. La leç on du tex te me sem bl e trés-bon ne .
a i c i l e sen s d ’énume'rer , comme pl us l o i n , p . 7 05 ,l . 11
e t 12 : a)c S \a Le m a il Peu t-ê tre
a uri ez—vou s changé a uss i l e tex te dan s cet endroi t,s i la
r im e n ’y eû t m i s ob s tacle .P . 695 ,
l . 1 . Au l i e u de b lé. : 3,
Ibid . , 24 . Pour vou s voulez l i re , commedan s Macr îz î , La l ec on d u tex te , j ’ en demeur ed ’accord , n e conv i en t pas ; m a i s admet tr i ez-vous q ue lescop i s tes a i en t changé x.5La . l l e n Xà lL$ u l l ? Vou s m e répondrez que n on ; eh b i e n , pou rquo i n e l i r i on s-n ou s don cpas et pourquoi n e pren dr i on s-n ous pas la IlIeforme de
Été dan s l ’acception que vous avez i n d iquée s i
b ien vous-même dan s vo tre i n es t imabl e D isser ta tio de glossis H a bich tianis , p . 9 5 , e t qu i conv i e n t parfa i temen t ?P . 6 94 , l . 2 .
ULÊ.o est a uss i dan s Boul .
Ibid . , L e sen s ex ige que l e dern ie r mo t so i t ,,sé, comme dan s Boul .P . 695 ,
1. 1 . Boul .Un.
P . 6 98 ,l . 1 2 et 1 5 . M . Kreh l aura i t pu trouver éta t, ,
comme vou s corr ige z avec ra i son , dan s L .; Boul . a auss icet te leç on , et i l e s t presque i n u ti le d e d i re que , dan scette éd i t ion , les mots , l, etc . son t é cr i t s c omm e un vers ,avec L;lS3 5 à la fi n .
108
IP . 1 . Vo tre correc t i on , Un a . l . î .Ïo n ’es t
bonne qu ’en par t i e ; en o u tre , vo us avez la i s sé s ub s is te r l emo t qu i précède , Œ&2>Lè , et qu i doi t ê tre corrigé , car l’ impératif doi t ê tre au m ascul i n . La bon ne leçon es t dan s Boul .;c ’est €,Îa xl..Ï 1 «À
Î Â Î è. Evidemmen t l e L.: a é té corrompu en L5 . Quan t au verbe i l se constru i tn on-seulemen t avec l ’accusat if, m a i s auss i avec M .
Lane a noté , sous la I“9 forme , l ’express i on : ag
« i l im i ta son exemple .»
Ibid . ,l . 5 e t 11 . b . L . n
’
a pas Æ;L£ t3 , ma i s rçu L$ü.
I l faut l i r eIbid . , 5 . Votre correc t ion , 8LQLJÜ
'
, est confi rmée parL . (Boul . vLäl ï ) .
Ibid . , 14. Au l i eu de l i se z aid an
P . 7 00 , l . 5 . Je n e pense pas qu ’ i l fa i l le changer la0
0leç on qu i est ausm dans B ou l . , et j e prononce0 0 0 4
«Tâ che , a utan t que t u peux ,de » etc .
Ibid . , l . 22 . Boul . Gi a ,comme vous corr igez .
P. 7 0 1 l . 6 e t 7 . Mettez un après 134 , un ce aprè set b iffez , dan s l es Add . e t Corr . , la so i-d i san t corree
Ibid . , l . 14. Après Œ£5…A l J…,3 1» Boul . a de pl us : M
ÔLË &3l Lg.a fiê«A LS… O l)l,LÈJ ÊEII uXm>
@Ôl-3f L-el 6_,Zw fi lé—LS J—. XD LÔ
Ibid . , l . 16 et 17 . Me ttez un aprè sÜL e t un
aprèsÜl, %l t (comme vous avez c orr igé c e mot) . Votre
correct i on M l, est confirmée par Boul .
1 10
Ibid . ,94 et n . d . M . Kreh l s ’es t trompé : la b onne
lecon,
es t dan s L . (auss i dansP. 7 05 , l . 19 .
UM, Vous d i tes : « L i sez
parce que l e mot est j o i n t à J’
adopte volon t i ersvotre correct i on , b i en que la l eçon du tex te se t ro uveauss i dan s Boul . , ma i s j e n e pu i s approuver la man i è redon t vous la j ust ifiez . Evidemmen t vou s avez cons idé réU$ \3 comme le synonym e de e t a ttach é à l’ un comme
6
à l ’autre l e sen s de se courber ; m a i s u n passage chez Maccar i , t . II , p . 5 10 , dem . læ, mon tre que vous vous ê testrompé . On y l i t : ‘
L5Ïzs wt -3
U.» eSÀa êÀ â
ccŒî î xî l , d ’où i l rés ul te que ŒM J se d i t en parlan t de la
démarche d ’un e person ne , de sa facon de marcher (of.Lane) , ma i s que L5
«$ h se d i t au con tra i re quan d i l es tques t i on de ses regards . Dan s la n o te sur le passage quej e v ien s de c i ter et dan s lequel les man . ont auss i le dj im ,
j’
a i t raduit des regards amoureux ; j e cro is à présen t quedes regards langoureucc vaudra i t en core m ieux , car
615 u
est l équ 1valent de c i .
—s u .
P . 7 06 ,l . 16 . Oui , Â -ŸÎ ; l editeur de Boulac n e s ’y
es t pas trompé , car i l a fa i t impr imerP . 7 0 7 , l . 20 . Boul . aussi é là f.
P . 708 , l . 2 . Cer ta i n emen t auss i dan s Boul .Ibid . , l . 9 . Je commence à soupçon ner que ce W est
un lap sus ca lam i de l ’éd i te ur . L . e t B oul . ont a…5 , commevous avez t rouvé dan s B .
1 1 1
P . 7 09 , l . t . L . e t Bou l . ont u Lî .5 ü ; ma i s(comme on l i t chez Ibn-Ba tou ta , c i té dan s la n o te a ) ne
se ra i t pas con t re la mesure , comme vous semb le z l ec ro i re , pu i sque , dans l e basî t , l e p ied 0 h 51… peu t sechanger en
ÜL: Ëx .
Ibid . , 9 . Boul . M LB, comme vous corr igez .Ibid . ,
19 . En tre x U l e t la)—3 ) i l fau t i n sérer l e motÙL_ f (L . e t que l ’éd i te u r semble avoi r om i s parmégarde . L . e t Boul . con firmen t vo tre correc t ionIbid l . 20 . Au l ieu de B oul . a ce qu iest peut-ê t re préférable .P. 7 1 1 , l . 5 .
L5}. sa s
/
,e t o: 5, . Vous voulez lireW
e t tradui re : « Je su i s e ncore n é de son temps , ma i s l orsqu ’ i l é ta i t déj à t rè s-avancé en â ge . » J
’
adoptera is volont i er s votre Op i n i on m a i s avez—vous d ’au tres exemples del ’emplo i de en ce sen s ? Je n ’en a i pas , e t Freytagn’
a pas eu d ’autre autori té que cel le de Golius pou r soncanosa s et vetusta s evasit . I l e n faudra i t un e m ei l le ure .Boul . aw , e t cette lecon est auss i dan s L . (d ’où i lré sul te qu ’ i l faut corr iger la n ote a de M . Kreh l) ;cela sera i t œm ç
,et san s oser affirmer que cet te leç on es t bon
ne , je croi s cependan t q u ’el le m éri te cons idé ra t i on .
Ibid 7 . La bon ne l eçon , n ’es t pas seulemen t dan s Boul . , ma i s auss i dan s L .
Ibid , 1. 20
J e _s$ Üm $ üi
ÜLŸ,
fis cal ma
1 12
I l faut san s dou te res t i tuer la leçon des man . (auss idans Boul .) M l , que l ’éd i te ur a ch angée mal à propos ,et pron once r Làîu 4Â l ma i s i l faut auss i expl iquer le versd ’un e tout autre man ière que vous n e l ’ave z fa i t . Voust radui sez : « Er war , b evor er e i nen Bart b ekam , von a b
sonder licher Schônheit nachdem dies aber geschehen , i s ter zum Absonder lichen , Zusammengesetz ten geworden . » J en e comprends pas ce que cela s ign ifie , m a i s j e vo i s quevous avez a t tr ib ué au mot gharib un sen s qu ’ i l n ’
a pas ,
à savoi r cel u i de a bsonder lieh , te rm e que m on d ic t i on na i ret radui t par sépara ble ,
détaché. Je vo i s auss i que vou savez t radu i t m oçannaf par composé , ce qu i est un e erreurque vous d i tes en su i te qu ’ i l s ign ifie , en parlan t d ’ un ar
bre , ayan t les feu il les en p ar tie vertes , en partie m ortes ,
et que cette express i on est appl iqué e ici par i ron i e à un
j eune h omme don t la b arbe a pou ssé . Tou t cela est l o i nd ’être cla i r . Aur i ez—vou s vou lu d i re que l e poète comparela barb e du b eau j eun e homme à des feu i l les m or tes , e t
son v isage à des feu i l l es ver tes ? Je n ’o se pas vous prê te rune idée auss i b i za rre , m a is sr vous n e l ’avez pas eue ,
vous aur i ez dû vous expr imer d ’ une m an ière m oi n s ohscure .Pour i n terpré ter c e vers et u n autre qu i se t rouve auss ichez Macca r i , j e sera i ob l i gé d ’en trer dan s des dé ta i l s assez é tendus , m a i s j ’ose cro i re qu ’ i l s n e para îtron t pas inu t i les .Commencons par b i e n fixer la s ign ificat i on d u verbe
d …â .æ l L’
au teur du Cam ous d it à ce suj e t : Ls‘z…lw æàÀm
Um aO= L{-«m e
ÿ»,
A l.z> « çannafa s ign ifie : disposer un e chose par espèces et separer ces espèces l
’
une de
1 14
Ce poin t é tabl i , j e do i s parler d u terme gharîb . Il signifie
propremen t ex traordina ire , singu lier, qu i ne ressemblepoin t ‘
aux
autres'
(voyez Bocthor) . Dan s la sc ience des tradit ions’
, on a
don né ce n om aux trad i t i on s authent iques qu i ne prov i ennen tque d ’un seu l i nd iv i d u d ’en t re les compagn on s ;ma is on l ’a appliqué auss i a ux termes d iffic i l es , ob scurs ou ra res , q u’ont rouve dan s les trad i t i on s o u dan s l e Coran , e t l ’ i n terpré ta t i onde ces termes est deven ue une sc i en ce sui generis , l e ,.l aUt),äil, @ : A S ül % s
fà ‘
. On les a rrangea i t par ordre alphabé tique ou par ordre d e m at i ères , säs
‘
zl l …n LSta , e t
dans ce derni e r cas , on le s appela i t a l-gharib a l-moçannaf.
Beaucoup de savan ts , t e l s qu ’
Abou -’
Obaid a l—Gâ sim ibn Sal
l â m e t Abou-’Am r Chaib î mî 3 , on t publ i é des recue i l s sou sce t i tre , e t i l e n est souven t ques t i on . A i n s i on l i t che zMaccar i (t . I , p . 47 5 , l . 20 e t suiv . ) q ue Mondh ir ibnSa
’
îd é cr i v i t deux vers à Ab ou—’Ali Baghdâ di pou r l u i demander l e prê t d ’un l i vre s u r l e gba rî b , e t qu ’un de cesvers é ta i t con c u en ces t ermes
Œ J°
W-IJ l …;qÀ l‘ ä
j$ \ g
. L5°”
Ai l l eurs (t . II, p . 258 , l . 10) i l e s t quest i on d ’ un l i vrequ i porta i t l e même t i tre . Dan s un au tre end ro i t (t . [I ,p . 3 29 ,
l . 6 e t su iv . ) n ot re au teu r parle d ’un personnagequ i , l orsqu ’on l u i eu t demandé l ’expl i ca t i o n d ’ un t erm ei n sol i te e t qu ’ i l n ’eu t pas é té en é ta t de la don ner , a l ta
ch a à un de ses p i ed s une cha î n e de fer en j u ran t qu ’ i lne l
’
ôterait que quand i l saura i t par cœur le a l Gbarî b a l
1) Voye z H â dj î Kh a l ia , t . IV , p . 3 2 2 e t su iv .
2) Vo ye z M . de Goej e dan s le Z ei ts ch rift , t . XV I II , p . 7 84 .
3) B â t Kh alfa , t . IV, p . 3 3 2 .
1 15
moç anna/. Ma i s cette express i on , qu i é ta i t con n ue danst ou tes les écoles , se prê ta i t à merve i l l e à des j eux dem o ts , parce que les deux termes don t el l e se compose admet ten t auss i d ’au tres sen s . Nous possédon s quelques-un sde ces j eux d ’espr i t , qu i so n t de vé r i tab les é n igmes e t qu in e se la i s sen t pas t radui re , san s comp ter q u ’ i l s son t d ’ungoû t fort con testab l e . Macca r i en c i te deux . L
’
un ( t . II,p . 269) se compose de deux vers . Dan s le p rem ier i l estd it s implemen t : La Beauté con templa a vec adm i ra t i on lev i sage de la j eun e fi l l e ; m a i s dan s le secon d on littal… —a g., 35 a.. l —1% 50 53 w =Ïwâ 5l 0353 65 9
Au prem ier abord cela semble for t é trange et même v id ede sen s ; m a i s c ’es t u n défi que l e poè te por te a u l ec teu r,u ne én igme qu ’ i l l u i don n e à dev ine r , car derri è re le sen sapparent i l y a u n sen s cach é , l e s m o ts pouvan t se prendrea uss i dan s une a u tre a ccept i on . La Beau té dit q u ’elle trouvedan s le v i sage de la j eun e fi l l e des ce q u i s i gn ifi e ,dan s l e lan gage ord i na i re , des ch oses rares , s ingul i è res ,merve i l leuses
,m a i s dan s cel u i des écoles , des mo ts rares
(syn onyme de gharî b) 1 , et l e poè te , qu i pren d le termedan s ce der n ie r sen s , t rouve que la Beau té n ’
a pas dit as
sez e t qu ’el le aura i t dû aj ou ter que , su r l e v i sage de laj eun e fi l l e
,t ou t est b i e n ordonné , b i e n à sa place
,de
m ême que dan s u n Gha r'
z‘
b m oçann a/ l es termes son t rangés l ogi quemen t . L
’
au tre j e u d ’ espr i t , cel u i qu i m ’
a ob l igé
Un
ë J'$ Ÿ Os .Jv L. »
r>lfldl Cdm ous ;
)Q LÀ
Îl
55 lU« LxäU Là Î LË '
mÙLÏ s i,… Lp ,
D ict ion a ry of t h e
t echnzca l t erm s .
1 16
à fa i re ces rema rques , est d ’ un autre gen re , car l e poètej oue sur la doub l e s ign ificat i on des termes ghar‘
z‘
b e t m o0
çannaf. Ce dern ier peu t ê tre forme n on-seulement de …ümou espece , ma1s auss i de q u e
, le bord d ’un manteau , d ’une robe , qu i est d ’une au tre c ouleur que l ’hab i tmême , et a l ors c ’es t bordé , ga lonne'. Par ses parol es e napparen ce é n igmat iques , l e poète don ne à entendre que labarbe d u beau j eune homme ressem bl e à u n ga l on que l ’onmet au bord d ’un vê temen t .P . 7 11 , l . 24 e t n . e . B oul .
;A2 4—l l
P . 7 12 , l . 5 . Boul .Ibid . , 6 Vo tre correct i o n n ’es t b on n e qu a dem i ;l i se z il », L5 0.a (L . e tP . 7 15 , l . 9 e t n . d . Boul . comme dan s le t exte .P . 7 14 , l . 1 1 . Pour l i se z Œê
}x…s ll
(L . e tP . 7 17 , l . 14 et n . e . B ou l . a la b on n e leçon .
P . 7 18 , l . 8. La bon ne lecon , L%A ALM «3 , es t auss i dan sL . e t Boul .P . 7 19 , l . 1 7 . Bou l . a auss i
63 W S.
P . 7 20 ,l . 2 2 e t n . a . Boul . a dan s le t exte .
P . 7 22 , dem . Comme vous av i ez ch angé , dan s l esAdd . et Cor r . , la l eço n e t que vous n ’av i ez pas rét racté votre opin i on dan s vos n ouvel le s remarques , j ’ava i splacé ici une n o te pour dé fendre et expl iquer la l eç on dut exte . La l ecture de la p . 108 de votre 5 8 fasci cule m el’
a fa i t b iffer ; j e vo i s -
à présen t que n ous sommes parfaitemen t d ’accord sur ce suj e t . C
’es t san s dou te par unoub l i i n volon ta i re que vous avez négl igé de désavouer vo
tre anc ien n e conjec ture .
1 18
W . La véri tab le lecon , @ÀÂ 3, , se trouve auss i dan sles deux m an . d
’
Abou-Tamm â m .
P. 7 2 4 ,
l . 5 e t n . c . Dan s L . i l n ’ y a pas de b lanc ,e t i l n e manque r ien ic i ; l ’au teu r se b orne à c i ter l eprem ier hém is t i che .Ibid . ,
l . 7 . L . e t Boul . c orrec temen t Ll % lu
. .j tu xll .
Ibid . ,l . 1 1 . San s dou te i l fau t l i re i c i a vec L .
comme vous le d i tes , e t ce t te lec on es t auss i da ns Boul .Vous avez éga lemen t ra i son en t radu isan t la IVe forme de
pa r enfan ter . L’
au teur d u G lossa ire sur le Mançour'
z‘
(man . d it que Rhazès , dan s son Al—Kitâ b a l—Man
couri , a employé t ro i s fo i s l e mo t en ce sen s oü fi l) ,8
m a i s que c’
es t un néolog i sme ,x£: x.9.:
Dan s n otre t ex te i l res te cependa n t encore un efau te à corriger . dan s le sen s de p rodu ire (voyezmes remarques dan s le J ourn . a sia t . de 186 9 , t . II , p . 208 ,
crc/un ter , engendrer , se cons tru i t avec l ’aowsa tif(comparez auss i l bn—Kha ldoun ,
[l ist . des B erbères , t . I ,p . 5 28 , 7 :
Di sa ,,
r.3 e t n on pas ave c
le u . On ne peu t donc pas d i re : _
,
x>mrgLÏQ ..3 O
taj—l i :l.
Il fau t l i re”Ltd . Vou s savez q u ’on em pl o i e la préposi
t i o n J pour j oindre à un verbe trans i t i f son complémen td irec t , quand ce complémen t se trouve déplacé , afin defor t ifier l ' i n fl uence du verbe sur son complémen t (de Sacy ,Gramm . ar t . 1 , 10 49 . n
°
1 19
P . 7 27 , 2 5 e t 24. Vous avez e u le malheu r , dan s votre t raduct ion dc ces deux vers , de prendre l e n om prop re d ’un gran d se igneur , d ’un beau—frére d u cé léb re Sa lad i n , d ’a bord pou r u n nom d ’ac t i on , ensu i te pour un part icipe . J e m ’expl ique . Le gra nd poè te Ibn—’Ona in , don tMacca r i c i te ic i quelques pièces e t qu i é ta i t n é à Damasen 5 49 de l ’Hégire , se pla i sa i t à composer des sa t i res v irnlentes con tre les person nages l es p l us hau t placé s d e sav i l le na ta l e 1 C
’es t à un d ’en tre eux , à Lâ dj in , le prem ie répoux de la Dame de Damas (S i t t as-Châ m) , la sœur deSalad i n ‘ , que s ’ad resse la p 1ece don t n ous a l lon s nousoccuper . Le prem ie r ve rs en a é té imprimé correc temen tdan s l ’éd i t io n
U.,e 1 t.. un .s e : ..23,s 5
5 us,…
I l ne fau t pas changer l e dern ie r mot en commevou s l ’avez fa i t , n i l i re LM >5L1 L5
L>l , comme l’a fa it l ’éditeu r de Boulac , qu i n ’
a pas compri s non p l us de quo i o ude qu i i l s ’agi t. La l ec o n des m an. es t bon ne ; c ’es t laprépos i t i o n u avec l e n om propre Lâ dj in , qui , s i o n l econ s idère comme é tan t de la seconde décl i na i son , dev ien tn écessa i remen t au gén i t i f e t dan s la r ime L â dj lflâ . Le
prem ier hém is t i che d u sec on d vers , qu i es t a l té ré de lamême m an i è re dan s l ’éd i t i on de Bou lac e t dan s cel l e d eM . Kreh l , se lit t rès—correc tem en t a i n s i dan s l e man. L .
e t peu t-ê tre dan s d ’au tres en coreç ,>a
651 t ……3
( ” as et , L5
11 u.>
1) Voye z Ib n -Kh al lic â n , Fa sc . vn , p . 12 6 , 1. a , p . 1 2 7 , 1. 2 a .
éd Wüs tenfe ld .
Voye z Ibn-Kh a llicâ n , t . 1 , p . 1 4 5 , 1. 1 8 éd . de Slan e .
120
Vous voyez qu ’ i c i n ous a von s de nou veau l e n om propreLady n ,
m a i s nul lemen t u n pl u r . i rrégul ie r d u part ic ipe d uverb e ts t 1, comme vous l ’avez supposé . Je va i s vo us donner à présen t la t raduct i on de la p 1ece dan s son en t i er ,après avo i r observé que le prem ier mot du 5 e vers est
l e par t i c ipe de6 )
« Ces voyageurs que j ’accom
pagna is parfo i s (un b ou t de chem in) dan s u ne caravan epour prendre congé d ’eux , bon té d i vi ne,
quel dési r m ’ i nspira ient
-i ls de me rendre auprès de L â dj în ! Eh b i en ,
n ous sommes ven u à la por te de Lâ dj…pour l u i dem ander quelque chose ; m a i s , hé las ! mieux eût va l u q u ’ un emort prématurée n ous en eû t empêch é e t que no us n e fuss ion s pas ven u , car en l u i ad ressan t n o tre pr i è re , n ou ssecou ion s un cadavre san s mouvemen t , et n ou s ressemb lions aux ch ré t i en s qu i dem anden t d u secours à des images . » Vous voyez que la paron oma se est t rés-forte , pl usforte que vous n e le pen s i ez , car t ous les tro i s vers set erm i nen t en l â dj î n â . Au res te , i l n ’es t pas é ton nan t q ueSalad i n ex i la Ibn—’Onain d e Dama s à cause de sa mauva i selangue I l ava i t t ou te ra i son d ’en agi r a i n s i , pui sque sonpropre beau-frère n ’é ta i t pas à l ’abr i des at taques d u m a
l i n poète .
P . 7 28 , l . 2 . Les vér i tab les l eçon s de ce vers son t encore à t rouver . L
’éd i teu r d e Boulac n’
a pas é té pl us heureux que vou s , car i l a fa i t impr imer (con tre lat s
m esure) e t Dan s L . c ’es tL5
.tï l…i.
1) l b n-Kh al licâ n , Faso . VI I , p . 1 2 6 , l . 3 e t 4 .
122
P. 7 5 2 ,l . 18 . Je voudra i s que vous euss ie z donné l ’ex
pl i cat ion de vo tre conj ec ture sur l e second hém ist iche , ca rj e la comprends a uss i pe u que la l eç on d u tex te . Le cop is te de L . a effacé avec u n gra t to i r c e qu ’ i l ava i t é cr i td ’abord , e t m a i n tenan t c ’es t a vec u n poi n t
,qu i
es t b iffé , a u-dessous de la trois1eme l e tt re . Dan s Boul .c ’es t t9=t:œ, avec le gha in .
P . 7 5 5 , l . 15 . La b onn e l ec on , es t auss i dan sL . e t Bou l .Ibid . , l . 22 . Le léger changemen t que vous proposez ,me semb le t rè s-bon . Quan t à la X” forme de pourlaquel le vou s c i tez seulemen t M . Lan e , j e l ’ava i s n otéel ong temps avan t l u i , dan s m on G los sa i re su r le ’
B ay â n ,
p . 1 2 . On la t rouve auss i chez Macca r i , t . I I , p . 2 59 ,
l . 10 .
P . 7 54 , 1. 6 . Oui , Boul . auss iÙL5 \1Î
,.
P . 7 54 ,l . 16 . ÆA 1 pour (L . et Boul .) es t un
lapsus ca lam i de l ’éd i teu r .P . 7 5 7 , l . 16 . Vos deux conj ec t ures s urdan s
Ü:
L5…s
‘
z3 M a ïté , son t éga l emen t inadmiss ib les . La leçon du tex te (a uss i dan s B oul .) est bonn e .C’es t une exmession de la langue modern e , e t B octhor
(v° in terdit) la ph rase t out à fa i t ana logue : « D emeurer
in terdit , q , ;u1 3) U“
P . 7 92 , l . 25 . Ici et p l us lo i n , t . I I , p . 200 ,l . 14 ,
Boul . auss i tä.æt = ; ma i s l ’éd i te ur a aj ou té cette n ote ausecond passage :
,3 Q À .> Œl,ëi
‘. I l
veu t don c ou biffer leL55 , ce qu i sera i t u n remède trop
v iolen t , ou le prendre dan s l ’accept ion de ti . Vous avez
123
l â ché de résoudre la d iffic ul té d ’un e au tre man 1e re e n l isan t L. â .…t m a is j e ne c omprend s pas d u tou t commen tl e verbe @ …ç pour ra i t s ign i fier se remuer d
’
une m anière
vio len te , sich gewa ltig ru lzren , comme vous trad uisez . C ’es ten va i n que j e consu l te les d ic t i on na i res , ceux des sava n tseuropéen s auss i b i en que ceux des Arabes e ux-m êmes , j en ’y trouve pas ce tte accep t i o n . Pour la pro uver
,vous
c itez u n vers d ’
un an ci en poète qu i se tro uve chez le sgéographes . Rema rquez , t outefo i s , que n o us avon s i c i affa i re à de la p rose t rés-s imple , humilis ac pedestr is ora tio ,
qu ’o n n e doi t pas expl ique r à l ’a i de de l ’anc ien n e poés i edu désert . En outre , l e vers don t i l s ’ag i t est in in telligible , parce que n ous ign oron s c e q u i précède e t ce qu isu i t . Vous avez b eau t radu i re ses t ro i s dern iers mot s@ …xg, Œj s _
s_ , par : « i ndem er m it be iden Händen
zugrifi’ un d s i ch gewa l t i g ruh rte , » ce n ’es t qu ’ un e t raduc
t i on arb i t ra i r e , car n iU go.t g n i t a s n e pe uven t
s i gn ifier cela . Le fa i t es t que l e tex te es t bon ; m a i s i lfaut remarquer que le s verb es q ui expr imen t l ’ i dé e d ’a imer,comme e t ->l , se con str u isen t quelq uefoi s avecG… ,comme le prouve ce passage d ’lbn-al-Kha t ib (man . de
Par i s , fol . 1 12 9 5 3 165 tîs m Î x:aê , et ce t au tre (man .
de l ’Escuria l , art i c le sur Sauwâ r) : L5 .5 t. .s u t:: t;wUh’
g}m ts, De même chez n otre auteur ,t . I I , p . 5 5 4 ,
l . 10 ; p . 804 , l . 2 5 . C’est un e con s true
t i o n log ique ; dan s c es sor tes d e ph rases , l es a uteurs on té videmmen t pensé à … .è
)plu tô t qu ’à ou
1.
Ce tte n o te é ta it écrite lorsqu e j e reçu s v o tre dern iere l ivraison . J ’y
P. 7 97 , l . 20 . Me t tez u n 6 ap rès e t un 44 après
Ibid . ,24 . Non pas ma i s Ç—, w
jn .
P. 7 98 , l . 3 . Au l i eu du second l) )fa è , l i s ez ’) J b fi (L . ,
Boul . , Ca ldi‘d) .Ibid . , l . 5 . 6 3 L.ï3 , comme vous voulez l i re , se t rouveen effet dan s le Ca lâ id (p . 3 33 éd . de Pari s) .Ibid . , 7 . J
’
ai col la t i o n n é ce long passage su r le man.
du prem ier vol ume d’Ibn—B assâ m que possède M . Moh l .Je l’indiquera i par l es l ettres Bass .Ibid 12 . Au l i e u de l i sezIbid . , l . 19 . La bon ne leçon , es t dan s L . e t
Boul . Mettez un 6 après ce mo t , e t un et aprèsP. 7 99 , 1. 1 . Au l i eu de
Ül.x +œl l , i l fau t l i re £,txäàn
Il s ’agi t i c i d ’un de ces p lagipa tidae ou sou/fre
gourmades , de ces paras i tes b ouffon s , qu i receva i en t volohtiers des coups e t des souffl et s , pourvu qu ’on l eu r donn â t en même temps u n bon dîner , e t don t vous avez parl édans l e Zeitschrift , t . XIII , p . 5 95 , n . 1 . Dan s la v i ed’
Ibn-Mardan îch , Ibn-al-Kha tib (m an . de M . de Gayangos ,fol . 186 r
°
) par le d ’un de ces h ommes en ces t ermes1 (l i s . tag. ) taf, xxx… a.,s) U
M > aw twas
vo is qu ’en parlan t du passage qu i se t rouve t . I I , p . 8 04 , I . 2 3 , vo u s
con na i sse z par n o tre au te u r l ’u sage de \. A—>I su ivi de _ 5 , e t j e m eL5
fla t te d e l ’e spo ir qu e v ou s n e n ie re z pa s qu e peu t se c onstru ire
de la m êm e m an ière .
1) Ce tte corre c tion e st j u stifi ée par le m an . de Be r lin e t par la p ie ce
de ve rs qu i su it ch e z Ibn-al-Kha tib .
126
su t., S, i un, t.5 .x>s ses ,î_5, Ü, Ç,a s, …,i
s
P . 800 ,l . 6 . Bass . comme dan s l e texte , e t j e c roi s
devoi r corr ige r ce passage d ’ une aut re m an iè re que vou sl ’avez fa i t . Je l i s : cc xl ‘î‘lç
xx l ;62 3,wifi., ÂËL5
‘
. LL» (c ’es tune hon te pou r l u i de l ’avoi r é cri t ) . Le verb e s igu ifie t rè s-souven t écrire ; voyez , par exemple , outre l e Lex ique de M . Lane , Ibn -Djoba ir , p . 5 5 , l . 14 , p . 8 1 ,
p . 126 ,l . 19 ; P role'goménes , t . I , p . 5 4 , l . 7 e t 1 0 .
Ibid . , 9 . Au l i e u de ce tte l ign e , B ass . a 695
Ibid . , l . 18 . Si vous avi ez b i en voul u rem arquer q uej’
ai pub l ié e t tradu i t , en 1865 tou te la préface d ’IbnB assam ,
don t Maccar i n e c i te qu un e par ti e , dan s l e t ro is ieme vol ume de mes L oci de A bbadidis , où el le m’occupepas moi n s de d i x-hu i t pages (p . 5 9 e t vous aur i ezpeut-ê tre corrigé p l us i eurs passages du tex te en vous se rvan t de mon t rava i l . J ’ose cro i re aussi q ue , dans ce cas ,vous n ’auriez pas d i t dan s vo tre dern i e r écr i t qu ’ i l fa utb iffer i c i l e s igne après u 5 5 1, car vous aur iez v u parm a n ote a de la page 5 9 , que ce s i gn e do i t ê tre conservé
,
m a i s q u ’au l ie u de m,ll , qu i n ’es t q u’un e fa ute d ’impres
s i on ,il fau t l i re (auss i dan s
Ibid . ,19 . Boul . correctemen t
(t e sts,
.
Ibid . ,2 1 . I l n e faut pas i n sérer 0 en tre e t
t.j t*b , comme on l i t dan s les Add . et Cor r . Boul . a aussila l econ du tex te .P . 80 1 , l . 5 . J
’
a i déj a d i t qu ’au l ieu de m O,l l , ll faut
l i re s36,ll.
127
Ibzd 14 . J’
a i d i t auss i q u ’au l ie u de,@A l l
i l fau t l i re , comme dan s la n o te Ii , Boul . ala bon n e l eçon .
Ibid 15 . J’
a i d it en core q ue pour tl » i l fau tD‘"
comme dan s le man . d’
Ibn-Bassâ m .
P . 802 , l . 16 . l i sez (L . e tP. 805 , l . 8 . B iffez ce t s
,,- a qu i n ’est pas dan s Boul .
e t qu i don nera i t un con tre-sen s .P . 80 7 , l . 10 . l i sez s x s l,,
g
P . 809 , l . 1 e t n . a . a x is—,a, o
, gl,£ ll o.sw.»pl—A l. I l
se peut for t b i en que cette lec on (dan s Boul . U ,,ÊÇî l l) so i tcorrecte , car l es Arabes d ’Espagne , comme j ’ai déj à e ul’occas i on de remarquer a i l l eurs (G lossaire des mots esp .
dérivés de l’
ara be , p . ava i en t adop té l e mo t espagnolcuba
°
(c uve , t on n eau) e t e n ava i en t form é le n om de mét ie r tonn elier . Un savan t don t l bn-Abdalmelic Mar
récoch î fa i t so uven t men ti on (man . de Pa ri s , n °1 v°, 1 1 1 r
°
,144 r
°
, 166 porta i t c e surn om . L’
ex
press i onU
, gÇî il A S …» pourra i t don c signifier : la mosquéed u quar ti er des tonn el i ers (cf. l e G lossa i re préc i té , p . 5 5 7 ,
P . 8 11 , l . 1 . s,k>( g,—,täs 5
r@,x {l o…x. = Au l i e u
de qu i es t déc idémen t mauva i s , quo ique Boul . l’aitaussi , i l fau t l i re , comme le sen s l ’ex ige et comme le montre le p ronom dan s s
,b , (l ’a î n é de la famil le) .
Ibid . , l . 5 . Bou l . a deux fo i s c omme dan s l esnotes a et b e t c omme vou s v oul i ez l ire aut refo i s ; ma i s j ecro i s , comme vou s le c royez à présent , que la l eçon aqes t bonn e .
128
Ibid . ,20 . Boul . a auss i .
,La .
P . 8 12 , 1. 20 . l i sez i_,s, (L Boul . a
P . 8 14 ,l . 1 e t 11 . b . Le dan s les Add. e t Corr .
ne vau t r i en ; ma i s la conj ec t ure de M . Kreh l dan s la n o teb , ,
e n , est excel len te ; el l e es t c onfirmée par Boul .e t L . a auss iP . a. (:s
de Pa r i s du Ca lâ id) .Ibid . ,
8 . Oui , comme dans Boul . e t dansl e dit . de Par i s d u Ca ldi‘d .
P . 8 17 , 1. 16 . Après aj outez :,n (Ca lâ id) .
la lL. 1 ) l i se z Œi…1t . (Boul . et I edition
Ibid . ,l . 17 . Certa i nemen t aussi dan s L . , dan s
B oul . e t dans l e Ca ld ‘
id .
P . 8 18 ,l . 6 . Remplacez l ’ insipide U
L», p
ar
idid ) ; c’est j ustemen t l e mot qu i conv i en t .Ibid . ,
2 2 . L i sezÜlà l l s .
_1 (Ca lâ ïd) .
Ibid . , l . 2 5 . (,un) l i sez ) Lg3 (Ca l â 1d) .P . 8 19 , l . 15 . Vot re nouvel le n o te m e fa it soupçon ner
que l e changement de … l ia l l en ‘
aùlh l i es t de vous; m a i si l faut conserver la l econ du tex te , qu i es t auss i dan sB oul . , car Ç lÊ l i est un c ol lec t if q u i s ign ifie auss i les étudian ts , e t qu i con v i en t m ieux au style é levé e t recherch éque l e prosa1que al lËzl l.
Ibid . l . 19 (of. Add . e t J ’ava i s espéré qu ’a u l i e ude rel ever , dan s vot re n ouvel é cr i t , un e pet i te fau te d ’impress i on qu i n ’en va la i t pas la pei n e , vous a ur i ez donn édes exemples de la s ign ifica t i on que vous avez a tt ribuée ,dan s les Add . e t Corr . au verbe -t à savoi r cel le de
150
Ibid . , 1. 15 . A . g,g9 0 5
Ibid . ,l . 15 . A . comme vous avez corr i gé .
Ibid . ,16 . A . correctemen t g l5îl i, ;lisez aussi , commeO p 0 0i l por te ,
L51: 3 s,,1 : 3 Œo.l i
&“
ñ
Ibid . , 18 . A. comme vous corrigez .
P . 822 ,l . 1 1 . L
’ idée qu e vou s avez eue d ’ i n sérer 51avan t et de t radu i re comme vou s le fa i tes , es t auss im a lh eureuse qu ’
indécente . L’
opu scule d’
Ibn-al-Kha t ib, au
quel Maccari a emprun té ce passage , a é té pub l i é , i l y a
t ro i s ans , par votre compat r i ot e M . Mul ler (de Mun ich ) ,dans ses B eitrage z ur Geschich te der westlichen Ara ber
(voyez p . 25 , l . 4 a Si vous avi ez b i e n voul u prendrecon na i ssance de ce l i vre vous au r i e z fac i lemen t remarquéque l ’au teu r , l o i n d ’accuser l e cad i de pédéras t i e , dit s implemen t et h onnê temen t qu ’ i l v i n t avec t ous ses conc itoyens à la renc on tre d u p ri nc e e t de son escor te .Ibid . , l . 12 . M) Œ$
l lÜ Ü
, n Votre
ÇçË \—< Ül àt.< üt) est i nadmi ss ibl e pour pl us i e urs ra i son s .En prem ier l i e u , j e n e comprends pas commen t vous a vezvoul u fa i re d i re à Ibn-a l-Khat ib que le cad i a l la à la rencon tre d u pri nce « dan s l e cos tume gross i e r d ’un pèler i n . »
Croyez-vous don c qu ’en Andal ous i e u n person n age respec
t ab l e aura i t osé se présen ter à un pri nce dan s un cos tumequ i n ’en est presque pas un , e t qui d ’a i l l eurs ne se port eque sur l e terr i toi re sacré de la Mecque ? C
’
eùt é té de ladern i ère i ndécen ce . La s u i te du passage (voyez le tex tech ez M . Mül ler) mon tre en ou tre que l e cad i , l o i n de sefa i re vo i r dan s un é ta t voi si n de la n at ure
,s ’é ta i t paré
15 1
de ses p l u s beaux hab i ts e t qu ’ i l por ta i t , à la m an ie re desArabes d ’
Or ien t , u n ta ilesâ n b lan c e t u n tu rban arrangéa vec art . Ensu i te i l fau t ten i r compte de la pa ron om ase (la prem ie re ca rina se term in e par qui
sera i t dé tru i te s i l ’on adop ta i t la l ec on que vous proposezde la voyel le dan s L . qu i porte
L 5:Ë\fl
ll ; de la va
r ian te L5 \5 111 qu i se t rouve dan s l e m an . G . de Macca r i,
dan s Boul . , dan s l ’éd i t i on de M . Müller e t dan s le m an .
de l ’Ih â la que possède M . de Gayangos . Une au tre rema rque à fa i r e , c ’es t que la l ec on est mal appuyée .E lle est dan s Boul . et M . Kreh l l ’a t ro uvé e dan s u n man .
de Macca r i ; m a i s u n au tre porte e t on l i t de mêmedan s l e texte p ubl ié par M . Mül ler , dan s u n man . de l ’Escur ia l qu i es t mei l leur que cel u i don t ce sa van t a fa i tu sage et dan s le m an . de Berl i n d u Ma rcaz a l-Ihd ta
I l dev ien t don c de pl us en p lu s p robab l e q u ’ i l fau t l i rev
ue . o u t5 1 .s xl t et le L ex ique de M . Lan enous met en é ta t d ’expl iquer ce tte express i on . On y lit
1) Il semb le diffi cile de con n a î tre le s m an . de l ’Escu rial . M . Mül le r
(p . 4 5 ) a repro ch é à M . Sim o n e t d ’a vo ir pu b lié u n o pu scu le d ’Ib n-a l-Kh a
t îb d ’après u n se u l m an . e t d ’av o ir ign o ré qu ’il y e n a va it d eu x a u t re s
dan s ce t te b ib l io th èqu e . Il lu i e s t a rriv é à pe u près la m êm e ch o se ,
car il a fa it im prim e r u n au t re Opu scu le d u m êm e au te u r d ’après u n
seu l m an . qu i la isse b e a u cou p à dé sire r ta n d is qu e l ’Escu ria l e n po s
sède u n àu tre b ie n p lu s co rre c t e t p lu s com p le t . C ’e s t le n
°4 7 0
(n° 4 6 7 dan s l e C a tal ogu e de Casiri). M . L afue n te y A lc â n ta ra , don t
n ou s regre tto n s la m o r t prém a tu rée , b ien v ou lu l e co l la tio n n e r pou r
m o i .
2) D an s le m an . de 1’1hdta qu e po ssède M . de Gayango s , le m o t e n
qu e st ion a é té om is .
1 5 2
que L-É\-Ë>, Œ. ë t . £ e t s ign ifien t : « Anyth i ng bywh ich one i s ve i led , concea led , or protected . » C
’est j u stemen t l e sen s q u i c onv i en t à n o tre passage , e t vo us voyezq u ’on peu t l i re a uss i b i e n que L5 t s dl ; m a i s afi nque la paronomase ex i s te pour l es yeux auss i b i e n quepou r l ’ore i l l e , est p réfé rab l e . L i son s par consé
quen t : a g)t
_>m ll
Ü. Â . Ë> ce qu i s ign ifie qu ’ i l
ava i t revê tu ses plus beaux h ab i t s . J ’ose c ro i re que cesl eço n s e t c e tte i n terpré tat i on ne seron t pas cont es tées .L e sen s e st bon , c ’es t c el u i qu ’exige l ’en sembl e d u pa ssage ,e t j ’ai ten u comp te des t ro i s cons idé ra ti on s don t j ’ai parlépl us hau t .P . 824 , l . 2 . Ce
{, le a choqué avec ra i son l’édi
teur de Boulac. I l soupconne qu ’ i l fau t l i re a .Ëzà :>l Œ. x .>
0 11 a làä>3 .
Ibid . , l . 14 e t n . a . Le mot M id i, qu i se t rouve auss i
dan s Boul . , n e doi t pas ê tre changé . I l n ’es t pas c lass iq ue , m a i s i l ex i s te dan s la langue pl us moderne , et on l erencon tre , par exempl e , dan s un passage d’Ibn-al-’Auwâ m( t . I , p . 45 4 , l . 1 et n . que l ’éd i teur , B anqueri , a
rej e té au bas de la page , comme tan t d ’au tres q u ’ i l necomprena i t pas . Il fau t y l i re : t.» Û
5,g
au t :
tgl a :ülô l, ägpl l c ial l _ lo l
âÀ+g: L
’
avan t-dern i er m otest che z Banqueri a . X. s tô t
, , e t dan s l e man. de Leyde(n
°5 46) m id i, , avec un poi n t au-dessus et un autre au
1) A in si dan s l e m an . de Leyde , e t n on pa s À -fl,—’l ’ c omm e ch e z
Ba nqu e ri.
154
Ç .s u dans le prem ier vers) es t bon ; ma i s l ’autre motest en core à trouve r.P . 85 4 , l . 4 . Boul . comme vous cor ri gez .P . 858 , l . 5 . Boul. confi rm e votre correct i on Lil.Ibid . ,
18. l i sez z .a.s.i (L. et L ap sus
ca lam i de l ’éd i teur .P . 859 , l . 14. Veui l le z ré tracter vos deux conj ec t ures .
Vous vous é tes la i ssé t romper par une i nadver tanc e del’éd i teu r . Le mot a é té om i s , ca
,. m M (L . et
Ibid . ,19 .
r.S ts
‘
zl l Ki m . C omme on n e tein t pas lecharbon , mais qu ’on l e fa it , i l fau t avec lesdeux man . c i té s dan s la n o te h . B oul . a la bonn e leçon .P . 840 ,
l . 6 . En subst1tuan tU
..xs a vou s avezoubb e que la r ime est e n si. L i sez , c omme dans lan ote b , i, g… Œ.Ë: L S; c ’es t auss i la lecon de Boul .Ibid . ,
15 . (ŒM lexst) l i sez …io si (L . et Fauted ’ impress i on o u lapsus ca lami.
Ibid . , l . 18 . Dan s Bou l . c ’es t &M > o
P . 841 , n . Quoique l e mot J Lu Ë désign e aussi unebouteille , p ui sque P . de Al ca la l e t radui t par amp olla para
bever , j ’aura i s fa i t m ieux , en compa ran t Maccar i , t . II ,p . 165 , l . 17 , 2 5 e t 2 4 , de l e tradu i re i c i par ca se de
terre . Al ca la l e don n e pou r la cinqu1eme foi s sou s j arrode vino , et il sembl e d ’or ig in e b erb ère , car dan s l e D ictionnair e berbère , pot (de terre) est J L.u .Â Ë I. C omme enEgypte il n
’
a jama i s é té en usage , i l a for t embarrassé
15 5
l editeur de Boulac , qu i a fa i t imprime r dan s lesdeux passages de Macca r i , e t qu i a aj outé une n ote a u
second,où i l dit que , pui sque la s ign ifica t i on de
dan s l e Cdmous n e conv i en t pas , i l faut con s idé rer le motd u tex te comme le syn onyme de ou coupe .
Méfion s-n ous des Orien taux quand i l s expl iquen t des te rmes qui n ’appar t i en n en t pas à la langue c lass ique o u àleu r propre d ial e c te !P . 842 , l . 16 . In sé rez
61 en tre dla, e t (L . e t
P . 845 , l . 2 . l i se z commep l us hau t , p . 829 , l . 2 .
P . 844,l . 20 . L a l econ Œ, -gi , qu i est con fi rmée par
B ou l . , ne doi t pas ê tre changée . L’
auteu r ve ut d i re queles de ux savan ts q u ’ i l n omme s
’
appela ien t l ’un e t l ’au treAbou- ’A li . De m ême p . 884 , l . 5 . Chez Ibn-Abda lmelicMarrécoch î (man . de Par i s , n ° 6 82 s uppl . ar. fol . 1 v°)on lit : w àl i
U. : t .$ t. l l Pl us lo i n
(fol . 2 099
s.-l l i Œ, : tU
°
A i l l eurs (fo l . 4 r°) &xîŸ}i ll, Un
Pl us bas (fol . 4 —Â .
,
sütg ,:,x, Ü
e
Dan s un autre endro i t (fol . 9 0 91
LSD)
es,;5 ü
.
Ü…s d t 35 111:
fac i le de c i ter en core u n m i l l i er d ’autres exemples t i résde l ’ouvrage de ce t a uteur.P. 846 , l . 2 1 . Boul . M o z comme vous corr igez .
1 5 6
P. 847 , l . 13 e t n . a . Le m ot qu i est auss i dans
Boul . , est nécessa i re .Ibid . ,
24 . L i sez ( S a t, : san s hamz a .
P . 1 5 et 19 . l i sez dan s Boul .La seconde foi s le mot est auss i é cr i t correctemen t dan s L .
P . 849 , l i sez Auss i dan sL . par correct i on .
P . 85 1 l . 15 . Boul . comme vou s corr igez .P . 852 l . 8 . Certa i n emen t comme vou s le d i tes .Boul . a ce qui semble un e faute d ’ imp ress i on .
Ibid . , 2 1 . a j a x est n on -seulemen t dan s Boul . , ma isauss i dans L .
P . 855 , l . 15 . Boul . comme vous corri gez .P . 854 , l . 5 . I l es t presque superfl u de d i re que L . e t
B oul . on t correc temen t a x i a l .
P . 85 5 , l . 10 et 1 1 . Dan s Boul . c ’es t La 8 tx-î 1, . s65
Ibid l . 1 4 et 16 . Dan s Boul . cet etc. est auss i exp r im é par E’
P . 858 , l . 14. PourÊ’9 ’qu i sera i t t rès-m auva i s , Boul .
nous fourn i t l ’excel len te lecon è…Â .P. 85 9 ,
l . 4 . Correctemen t dan s Boul .Ibid . , 2 2 . Avan t il
'
fau t nécessa i remen taj o u ter la n égat io n qu i man que a uss i dan s Boul . (sansregarder en a rrière) .
P . 860 , l . 15 . Boul . a auss i la bonne leçonL5,1,1 15
Ibid . ,20 . Je n e comprends pas pourquo i o n l i t dan s
les Add . et C orr . que le avan t doi t ê tre b iffé , e t
158
cordes ? Ces cordes don nera ien t un con tre-sen s r i d ic ule.La l eçon du tex te est b on ne . Le poète parl e de Gibra ltar , vis-à-v i s de Ceuta (xù w ) ; dan s l e vers s u ivan t ilnomme Tâ ric , à qu i G ibral tar doit son n om : « Le djebal
al-fa th ,là où E l i e apparu t à Mousâ (ibn-Noç a ir) e t à Tà
r i c ;» et tou t l e m onde sa i t que , sous les A lmohades , l edj eba l de Tâ rie ou G i bra l ta r a reçu le nom de dj eba l a lfa th . Le poè te a éc r i t dj ibâ ’ l au pl ur ie l , au l i e u de dj eba lau s i ng ul ie r , parce que la mesure du vers l ’y força it .Ibid . ,
17 . Ce vers , qu ’ i l n ’é ta i t pas d iffi c i l e d e cerr iger , es t é cr i t correc temen t dan s Boul .P . 86 5 , l . 5 . &.KJ auss i dan s Boul .; L . e t Boul .
ma i s votre s,,a : est b i en préférab le .
Ibid . , 5 . Correct emen t dan s Boul .Ibid l . 19
g y .î > Lu $ t l l g j ÇXä: wà :,1 lC>i
th at: Π:,-tx_ 11 s L
_Z…
En publ iant ce vers de cet te man ie re e t en n’
ajoutant au
c une var ian te , M . Kreh l m i s vo tre sagac i té à un e rudeépreuve. Vous vous en ê tes ‘
t iré avec h on neu r , pu i sq uevous avez devi n é l e sen s
,m a i s vou s n ’avez pas p u rest i
t uer les paroles du poète ; i l é tail imposs ib l e de l e fa i resan s avo ir u n m ei l le ur t exte sous les yeux . Le man . L .
donne le secon d hém i st i che de ce tte m an i ère
et s i vo tre col lègue ava i t n o té ces leçon s,vo us aur i ez vu
san s doute que l e mot n ’es t pas à sa place , e t vousaur i ez co rr i gé , comme la mesure e t le sen s l ’exigent
15 9
o_
0 o ) 0
Lhu: t…ctloŒ
? v\ dl,5 \g,
En l i san t a i n s i , n ous obtenon s à peu près le sen s que vousa vez i nd iqué , excep té que rtb est e n parenthèse . Dan s Boul . c ’es t
Lfo .â 3 w,LÀx 9…
(o l—lo —c>.l l
C’es t b on auss i ; m a i s a l ors i l fau t pen ser à u ne à
une b arque d ’où on lanc e le n aph te su r le s va i sseaux e nnem is (cf. Q ua tremère , H ist . des suit . m am l . , t . 1, pa r t .1 , p .
Ibid . , l . 22 . Boul . comme vous corrigez .P . 866 ,
l . 26 . Boul . c orrec temen tP . 86 7 , l . 5 . B oul . e t L . co rrec temen t Œi l i, ,
ma i s cedern ier
Gi ll, au pass if.
Ibid .,l . 25 . Bou l . correc temen t
P . 868 ,l . 9 . Boul . a : , comme vous corr igez .
Ibid . , l . 14 . Boul . c orrec temen t 1,L5.
P . 869 ,l . 10 . Bou l .
L551.11 et J ’a ime m ieux
d ire que la vér itab l e le con es t en core à trouver , que deproposer un e conj ec ture e t une i n te rp ré ta t i o n dans l e gen rede cel les que vous avez don nées . J ’en d i ra i au tan t deIbid . ,
l . 15 , où Boul . ab sol umen t l e même texte queM . Kreh l .P . 870 ,
l . 2 5 . L i sez Œuî txäs l1.P . 873 l . 4. Votre ne conv iendra i t pas du tou t .
I l faut conserver la lec on des man . (Boul . Le
poète , qu i s ’appela i t Ahmed , adresse la parole à soi-même :e t , aprè s s ’ê tre fa i t l es reproches l es p l u s amers su r sa
140
we passée , il con t i n ue : « 0 perfide Ahmed , la j eunesse t ’aqui tté , e t à présen t , » e tc . I l se n omme p erfide , parcequ ’ i l n ’ava i t pas j ust ifié la confiance que D ieu ava i t p lacéeen lu i
,ou parce qu ’ i l a va i t rompu l ’engagemen t qu ’ i l ava i t
pr i s envers D ieu .
Ibid . , 10 . (WJ—z : Mieux dan s Boul .P . 1 1 . Après (Boul .
L5.itlt. l1) i l fau t il l
serer JL}: (L . e t
Ibid . ,2 5 .
,Ïâ.b 1 est dan s L . e t Bou l . L apsus ca lami
en faute d ’ impress i on .
P . 881 l . 9 . I l faut d ire la même ch o se de ceDan s L . e t dans Boul . c ’es tIbid . ,
l . 1 1 . Vous avez b i en expl iqué ce que vou s‘
en
t endez sous,:c t3 m a i s vou s n ’a vez pas dit com
m en t vous t radu isez l e second hém ist i che , don t j e n e pu i st irer aucun sen s quand j ’adopte votre opi n i on su r ces deuxmots . Je cro i s que la leço n qui es t auss i dan s Boul . ,doi t ê tre con servé e , m a i s qu ’ i l fau t corr iger t ro i s a utresm ots dan s ce vers , san s compter l e 5>L> , qu i a déj à
.
é téchangé en 53.. 1 (L . e t Boul .) dan s les Add. e t Corr.D ’
ab ord L2xËÊ13 n e peu t pas se d i re . On ditm a i s ,, 5 . Ê sera i t un barbar i sme . Boul .
donn e la b onn e lecon , c ’est Lgï lä13 . De même que vousl ’avez ob servé au suj e t de Œo
,.3 et de le verbe
811: peut se cons trui re avec l e (voyez-en des exemp les
1) B erich t e , t . XIX , p . 1 80 .
142
« afin que l es yeux n e s ’en dé tournen t pas . » Dan s un aut re endro i t (t . I , p . 158 , l . 7 ) on l it qu ’ i l y a en Anda lousie des pauvres qu i , l orsqu ’ i l s n ’on t que l ’argen tnécessa i re pour l e pa i n de la j ournée , a imen t m ieux sep river de nourr i ture e t a cheter du savon pour laver leurshab i ts , L%Àa Ü
: £ l l —3 a JL:>Gl a «&c -È3 4 « e t
l eurs habi ts n e son t pas u n seul i n s tan t dan s une cond it i on don t les yeux se dé tournera1en t . » C
’es t don c uneexpress i on con sacrée par l ’ usage , e t s i , dan s notre tex te ,nous sub st i t uon s à
U…>S, l e verbe…ÂÏ: aura u n su
je t e t l e sen s sera cla i r . Res te le dern ie r mo t d u vers .Le U:oj
.x l l d u t ex te n e m e présen te aucun sens ra i son nable .Dan s Boul . c ’es t U:o )
. - à . l l e t j e croi s devoi r adop t er ce ttel eçon . La dj obba verte é ta i t l ’hab i t de dessous , l e prem ie rqa ’
l bu-Gh â nia a va i t revê tu , e t pour ce t te ra i son i l éta i tUm)
.â î l de rigueur , car , comme le dit l ’au teur d u M al
ta ed a l-a bhor (man . 108 1 , fol . 2 1 1 v°
) au commencemen tde son chapi tre
U…,Ut 6
5 : L. :
Le vers doi t don c se l i r e de cet te m an i èreUa}zl l U A L5 ld
,3‘
ëLo
? l eî £: ngib t3 —
. l z i5
et i l s ign ifie : «Vous avez revê tu d ’abord (et c ’éta it de r igueur) une dj oblm verte , ’qu i fa i t que les yeux de ceux qu ivous voyent se dé tournen t de vous ple i n s de respect . aIbid 20 . …fll : est b i en dans L .
, m a i s Boul . a la
b onne l eçonIbid . , 2 1 . V otre L est u ne b elle correct i on .Boul . la confirme .
Ibid . , 22 . Pourquo i voulez-vous
145
l i re i c i Frey tag a déj tl n o té l ’express i one t r ien n ’es t pl us fréquen t q ue ces sor te s de
ph rases .P . 882 , l . 10 . San s doute i l fa ut , comme vous le d i
l es , mettre dan s le tex te le s mo ts qu i se trouven t dan sla n ote b . Boul . l es a auss i e t i l don n e correctemen tM l.
Vous l i se z en s u i teJ
. : o,à la 1re form e . Boul . a à la
e t c ’es t bon aussi . M . Lan e a déj à n o té que la Il eforme de s ’emplo i e dan s l e même sen s que la I ” , e t
j e t rouve chez Ibn—Haiyâ n (man . d’
Oxford , fol . 5 7 r°
)
fil “ : Vous voyez que
l e verbe es t é cr i t ici , n on pas avec l e dz dl , ma i s avec l eddl
,c omme dan s l e tex te de M . Kreh l . C
’es t une i ncorrec t i on qu ’on trouve auss i p resque con stammen t dan s l ’éd i ti on q ue M . de S lane a don née de l ’H istoire des B erbères ,par exemple t . I
,p . 2
,p . l . 4 a f.
p . 5 14 , l . 10 , p . a f. , p . 5 ,p . 445 ,
p . 505 , dem . I. , p . 5 12 ,
1. 14 , p . 5 5 5 , 1. 5 a f. , 5 5 4 , l . 9 ; t . I I , p . 6 ,
p . 407 , l . 8 (où n otre man . 13 50 a l e dz â l) . Correctem en t avec l e dz â l t . II, p . 244 , l . 7 .
Ibid . ,1 1 . Boul . b on : L: S tlt.
Ibid . , e t n ote 0 . Je su i s ent 1e rement de votreavi s quand vou s d i tes que ce est ici i nd i spen sabl e . Boul .l’
a auss i .Ibid . , 1. 2 1 . (6 1) Boul .P . 883 , l . 7 . l i sezP . 884 , l . 24. l i se z et: (L. e t
P . 885, l . 1 1 . Bou l . correctemen t
144
P. 887 , l . 5 . La b on ne leçon , est n on—seu lemen t dan s Boul . , m a i s auss i dan s L .
Ibid . , u . b. Votre conj ec ture sur ce ver s es t inadmiss ib le . Les bon nes leçon s se t rouven t dan s Boul . , à savoir :Q ,)Læ j : f 0
10 23555 La
L5'Ë5 ,
.Ê : AQ—ë>CJ"° 5LS \.ll
P . 888 , l . 5 . dan s L . e t Boul . Le noun dan sl e tex te es t un lapsus ca lami o u une faute d ’ impress i on .
Ibid . , 2 1 . B oul . comme vous corrigez .P . 889 , l . 16 . Boul . a la leçon que vous p roposez .P . 89 5 , l . 8 . l i se z (L . et Fauted ’ impress i on .
Ibid . , 1 5 . Comme le dern i er p i ed es t dans les deu xau tres vers i l faut res t i tuer la l eç on à , ,m t
, qu ise trouve dan s t ro i s man . e t dan s Boul . C
’est u ne l ic en cepoé t ique pour voyez mon H istoire des m usulmans
d’
E spagne , t . I , p . 2 10 ,n . 1 , où j ’en a i don né pl us i eurs
exemples .P . 900 , l . 20 . B ilÏez qu i n ’es t n i dan s L . n i dans
Boul . En outre,i l s on t correc tem en t e t es t
a uss i dan s Boul .P . 901 , l . 3 e t 4 . J
’
adopt‘
e b ien vot re t,…l t s t
”…(dan s
Boul . m a i s j e cro i s que la phrase su ivan teé ta i t t rop a l té ré e pou r qu’on eû t p u la corr iger par conjecture . Boul . n o us fourn i t la vér i table leçon ;c ’est :ce lîîül J.;—t U ’° sLs xîl t, « vous qui a imez les gramma i ri en sà cause d ’al-Farra » (l e célèbre gramma i r ien ) . En sui te i lfau t écr ire : t_ s,,g us 5
1:
Ibid . , 5 (cf. Add . e t C orn ) . J %Io (auss i dan s Boul . )
146
P . 9 12 ,l . 15 . L . e t Bou l .
P . 0 15 ,l . 24 e t n . b . M . Kreh l s ’est trompé dan s la
no te b ; d u moi n s L . por te correc temen t (auss i dan se t i l est peu probab l e que le s cop is tes des aut re s
m an . a i e n t a l té ré un te rm e qu ’ i l s d eva i en t conna î t re . .
P. 9 14 ,
l . 24 e t n o te b . Même ob servat i on .
P . 9 15 ,l . 15 . Le dan s l es Add . e t Corr . est
auss i m auva i s q ue l e …J o\ d u tex te e t d u man . L .
Dan s Boul . c ’es t La ve r i tab l e l eçon , don t l e s traces son t encore for t reconn a i s sables dans le s deux leç onsa l téré es , es t san s aucun dou te le syn on yme deu
}
.îx : qu i précède . Auss i l ’auteur d u Câ mous expl i que-t—il
par
Ibid . ,18 . l i sez ù: g: ll : S (L . e t
P . 9 16 ,l . 18 . Comme le n om de ce t h omme de let
tres , tel qu ’
il'
est écr i t ici , sem b l e vou s a voi r embarrassé ,je n o tera i que les m ots 0 9
son t écr i ts e n encre rouge dan s l e man . L . Maccar i donn e d ’abord le n omsous lequel i l es t con n u gén éra l emen t , à savoi r Abou’
Abda llâ h ibn—Dj â bir , e t en su i te son n om propre . Le tex ted u m an. S . , dan s la n o te a , es t pl us comple t , m a i s i lfau t y sub s t i tu er L5 ,
t: %
lt (Boul . ) à e t
;: J: n iî
;:Lç ( J
‘
(Boul . ) à Œ;œl l.
P . 9 17 ,l . 22 . M . Kreh l s ’es t t rompé dan s la n ote a .
L . a correc temen t (auss i dan sP . 9 18 , l . 5 . Est-i l beso i n de d i re que L . e t Boul .
on t auss io
“° L: 7
P . 9 19 , l . 1 1 . Bon] . a auss i e t en ou tre
147
Ibid . ,12 . l i sez comme p . 9 25 ,
l . 2 .
Ibid . ,14 . L . Bou l .
P . 9 2 1 , 20 , e t
Ibid . , 22 . Boul . conn u e vous corr igez .
P . 9 22 ,l . 6 . I l n e fau t pas l i re comme vous
le proposez,m a i s L, : o (Boul . ) en deux mo ts .
Ibid . , 2 4 . Boul . correc tem en t :Làäi , ilU“ "
P . 9 25 ,l . 22 . l i se z
P . 9 24 ,l . 2 1 . La vé r i tab le leç on est L: el le e st
dan s BouLP . 9 26 ,
l . a . L . e t Boul . correc temen tL5â m '.
P. 92 7 , l . 1 . M . Kreh l aura i t pu t rouver la véri tab l el eçon , Eÿ ,
n on-seulement dans S ., m a i s auss i dan s L .
Boul . l ’a éga lemen t .
P . .928 ,l . 19 . Bou l . comme i l faut .
P . 9 29 ,l . 2 5 . Ic i e t p . 9 50 , l . 4 , Boul .
comme vous corrigez ; m a i s en ou tre i l fa u t sub s t i tuer(L . e t Boul . ) àP . 9 5 1 , l . 1 1. (L Je m e t i en s persuadé que
comme vou s avez trouvé dan s B . , es t la vér i tab l e l ec on .
Elle es t auss i dan s L . , e t Boul . en a con servé latrace .Ibid . , 15 . Vous n ’avez devi né la vé r i table lecon dece t hém i st i che n i dan s les Add . e t Corr . , n i dan s vo tredern ie r éc r i t . El le est :
Œ).fll
vla :Œ: Q : :
e t el le se trouve , n on -seulemen t dan s Boul . , m a i s auss idan s L . Le copi s te de ce man . ava i t écri t d ’ab ord , comme
10 *
148
dans l e tex te de M . Kreh l :ob : J J pu i s
i l a aj ou té au c ommencemen t de la l ign e e t ra tu ré lesmo ts e tIbid . ,
2 1 . Vous avez corrigé très-he ureusemen t cesmots . L
’éd i teu r de Bou lac les a fa i t impr imer de la mêmeman iè re que M . Kreh l , m a i s en aj ou tan t cet te note :
UJ L: 3 —k… :.f
â“ ” t. : 5 1
û UÀAL@
OA Q i
P . 95 2 , l . 5 . La b on ne lecon , que vous avez rest i tuée ,est dan s Boul . L . l
’
a auss i , m a i s par correc t i on , et l em o t y es t à p résen t peu l is ible .
P. 9 5 5 , l . 20 . l isez 3, (L . e t
P . 9 54 , l . 2 1 . Boul . correc temen t sot-i, ; dan s L . l e
mo t m anque .P . 9 35 ,
l . 8 e t n . a . Dan s Boul . comme dan s S .
P. 9 5 9 , l . 18 . Vous vou s ê tesI
trompé en subs t i tuan t5)LÀ3 à :
)Lzat , qu i est auss i dan s Boul . Votre zs
/L: ‘L ne con
v i end ra i t pas d u tout , comme vous vous en c on va i n c reza i sémen t en c on sul tan t l e Câ mou s . Quan t à c ’es tle syn onyme de s :>i= que l ’auteur emplo i e dan s l e m êmesen s 1. 15 ,
19 et 2 1 ; a uss i Boc thor t radu i t-il l es motsdésigna tion , enseigne , marque , présage , p ronostic , signe e t
symp tôme par X:>La et par Dan s n otre passage i l ss ign ifien t l ’un e t l ’au tre criterium , et Boothe r donne en
effe t s>L:‘
ç t dan s cet te ac cep t i on . Vou s voyez don c que vousferez b i en de ré trac ter vo tre conj ec ture . Elle m e rappel leune autre de M . Wrigh t , qu i n ’est pas pl us heureuse . Enparlan t d ’un préd i ca teu r
,l bn-Djoba ir (p . 182 , l . 1 6 e t 1 7 ) dit
qu ’ i l é ta i t 44 5)L.&3 l
â\ : iA
‘
ÔLÀ ,Il Ü . .w e t M . Wrigh t
15 0
e t peu sa t i sfa i san te . Vous la modi fiez à présen t , ma i ssan s respec t pou r la r ime e t sans la rendre pl us accep
tab l e . Pour ma par t j e d i ra i , comme j e l e d i sa i s i l y a
pl us de d ix ans , que j e n e comprends pas l es m ots don ti l s ’ag i t . L
’éd i teu r de Boulac a é té dan s le même emba rra s qu e moi . I l a fa i t impr imer : L: (sic) L_5
…3L…l
3 8 ma i s en me ttan t sur la ma rge l es ign e t‘ pour i nd iquer que le passage l u i s embla i t a l té ré .P . 12 , l . 14. Je pers i st e à c ro i re q ue la lec on L.K.… l
est b on n e , e t Bou l . la con fi rm e .P . 5 6 , l . 6 . L i sez L,: il comme je l ’ai
dit dan s mes L oci de ‘
A bbad t . III , p . 5 6 ,l . 7 . Vous
n ’avez noté qu ’ une de mes correct i on s en oub l ian t l ’au tre .P . 5 7 , l . 4 . —li ÙL: : szii. Ma co rrec t i on , U
L: x£z.li
au l i e u de comme porten t l es man . , es t con fi rméepar l ’éd i t i on de Bonlao ; m a i s ce t te dern i è re por te éga l em en t e t c ’es t u ne secon de fau te que j ’aura i sdû c orr iger . Un mot n ’ex i s te pas du tou t. Onsa i t b i en ce que c ’es t qu ’ un …u -5 1-2, m a i s ces gens n es ’appel len t pas au pl ur . et e n ou tre i l n e peu tê tre ques t i on d ’eux dan s ce passage . Evidemmen t Maccaria voul u parler des e un uques s laves de la cou r ; ce qu iprécède e t ce qu i s u i t n e la i sse a uc un dou te à ce s uj et ;m a i s a l ors i l fau t l i re , en changean t l es po i n ts :
C’est l e n om que le s eun uques slaves por ten t
con s tammen t , comme ch ez Ibn-Djobair ,p . 3 28 , I. 19
UL: Xài l e t dan s un e fo ule de pa ssages
d’
h istor iens a rabes-espagnols . Voyez a ussi mes L oci deA bbad .
,t . III , p . 9 , e t Ibn-Ha iyâ n (ap ud Ibn -Bassâ m ,
t .
15 1
III,man. de Go tha ,
fol . 29 ‘
:LÎ L:L«
:N o —l
…iä: a l l Lil rau lC quej’
ai corrigée se trouve auss i dan s u n passage d ’Abou—’ lFaradj . Ce t auteu r d it (Abul-Pharaj ii Il ist. D y na st . , p . 19 4 ,
l . 9 e t …: 3L3 t. l t…À S : :À äè . Pococke a t ra
d u i t : « B egerente a u tem i n eum [Andream] Serg i o conv il ia qualibus excipi solen t C inaedi , » e t M . \Ve ijers , dan sune n o te sur l e Sp ecimen de M . Va le ton (p . 8 7 , n . a
0con s idéré c e c omme le pl ur . de qu l , àl ’en c ro i re , sera i t l e synonyme de ma is qu i e nréa l i té n
’ex i s te pas . I l fau t l i re car ce t André ,
l ’amba ssadeu r de Cons tan t i n , é ta i t effec t i vemen t un euuu
que comm e l ’au te u r l ’a d i t p . 19 5 , a van t-dem .
L5'
l i gn e .P . 60 , l . 6 . Ώ) l i sez avec l e s man . e t Bou l .
Le m o t x a ici une a ccep t i on qu i a é tén oté e par Bocthor , à savoi r cel le d e politique , conduite
adroite dan s les a;7”
a ires . Chez ”
Roland de B ussy x…L… l t:
est doucemen t ; c ’es t au fon d la même s ign ifica t i on .
14 et n . d . Le sen s est b i en cel u i que j ’a ii n d i qué dan s la n o te d ; m a i s j e n e cro i s pas q u ’ i l so i tnécessa i re d ’aj o u ter quelq ue ch ose .
P . 6 1 e t n . a . Je pen se à p résen t que ledes m an . (a uss i dan s Boul . ) es t un e a l té ra t i on deLa I I° forme du verbe j ;ê s i gn i fie : fa ire p artir des t roupespour une expéd it i on . o t,s ii n o tre tex te ,est , pour a i n s i d i re , l ’express ion c omplè te ma i s o n suppr ime auss i l e s ubs tan t i f qu i dés ign e l ’armée , les troupes ,comme dan s ce passage d ’
Ibn-Haiyâ n (man . d’
Oxford , fol .
15 2
2 1 qu i a é té c0pié par l bn—a l—Abbâ r (dan s mes No
iccs , p .
L,: …l3 6
19 ) L$i= …b s :
ÙL{
L5)—Là : U
,L_Ël, et dan s cet autre ,
que l ’on trouve dan s l ’Ak/zbâ r madjmou’
a (p . 85 ,l . 4 éd .
Lafuen te) : it : : a : 09 J .: a Èi,
P . 6 4 , l . 1 7 et n . a . Le L. : que j ’ai aj outé est dansBouL
P . 6 7 , l . 12 . Vous avez don n é une excel len te exp l i cat i on de ce vers ; seu lemen t j ’a imera i s m ieux l ire 9 3 : 3L) ;
l e sen s est l e même , ma i s me semble pl u s é légan tque ° e t les copi s tes confonden t s ouven t ces deux mot s(voyez m es L oci de Abbad . , t . III , p .
P . 2 2 . Notre au teu r se t rompe i c i : i l n ’aura i tpas dû renvoyer au VIIIe, ma i s an VII9 l i vre de la secondepar t i e de son ouvrage ; voyez l ’éd it i o n de Bon lee , t . III,
p . 7 49 e t suiv .
P . 69 , l . 2 et 5 et n . a (of. Add . e t L’éd i te u r
de Boulac a é té embarrassé comme m oi par ce passage ,car sur la m arge i l l ’a accompagné d u s i gn e t‘ , pour i ndiquer qu ’à son av i s i l est corrompu . Cependan t le textequ ’ i l a don né est parfa i temen t correc t . Au l i eu du
L5i: £zl l,
O ode mon éd1tmn , que vou s avez change en I l ace qu i s ’accorde avec le u it
, (sic) d u man . La . ,L5
e t cet te leçon m e sem b le la vér i tab l e . Voi c i mes ra i son svotre n e s ign ifi e pas en généra l les m orts ,
comme vous t radu i sez , m a i s s eulemen t ceux qui on t été
tués , ce qu i n e conv i endra i t pas . L’ i dé e que l ’ i n te r
cess i on des sa i n ts profi te aux mor ts (supposé pour un instan t que si gn ifie cela) est pl utô t ca th ol ique que
15 4
P. 85 ,
i . 1 . 55 11 Vous voulez s ub st i tuerL53
il , e t ce verbe se const ru i t san s dou te a vec la prepo .“e5
sition J , comme ch ez Boothe r sous butte (ê tre en bu t te a ,
exposé à , Go.,xm : se met tre en butte à ,
ch ez Har i r i , p . 5 6 ,l . 1 de la éd i t . , da ns mes L oci de
Abbad . , t . II , p . 1 6 , l . 1 7 (où i l fau t s ubst i t uerà et changer la n o te 16 , comme j e l ’a i dit t . III ,p . e t p . 16 5 ,
l . 10 (cf. t . III , p . ma i s i l secon s tru i t a ussi avec A i n s i on l it chez Ibn-a l—Kha tib(apud Maccari , Seco nde Pa r t i e , t . III , p . 20 1 , l .
Σl A i l l e urs (dan s m onCa ta l ogue , t . I , p . 2 28 , l . d
ti Q a gJ : : l,
…, c,
s L%äàl i Dan s u n au tre endroi t (ibid .,
p . 250 , l . &Lgä5 Œil Q ùçml: O
LÜ-) l J L. 3
id:: m , Ces exemples , vous en conv iendrez , prouven t que , dan s n otre t ex te , la l ec on desm an . , qu i est auss i cel le de Bon] n e do i t pas ê tre changée .Ibid .
,l . 15 . Vous a vez ra i son de d i re qu’ i l
fau t l i reC}: L,lii et que ce mo t se rappor te à Haeam ;ma i s
j e croi s que vous vous ê tes gravemen t trompé en aj ou tan tque sig n ifie : « qu i v i va i t séparé de ses paren ts (qu i se tro uva i en t en car
L5. 3:: n e s igui
fi e pas paren t , m a i s pa tron e t auss i clien t . Or , i l va sansd i re que l e sul ta n d ’Espagne n ’ava i t pas de pa trons , e t
quan t à ses cl i en ts i l s se t rouva i en t en Espagne . Le fa i test que le pronom dan s se rappor te , n on pas àHaeam , m a i s à Ziryâ b , e t qu ’ i l fau t tradu i re : « I l (Ziry â b)se rend i t vers l ’émir d ’Espagne ,
qu i v i va i t en i n im i t i é
15 5
avec ses pa tron s , » c ’es t-à-d i re , avec le s Abbûsides , le spa tron s de Ziry â b . Voyez sur la s ign ifica t i on d e leL ex ique de M . Lane .
P . 86 ,l . 25 . Bou l . comme vous corr igez .
P . 8 7 , 5 e t n . a . Bou l . con fi rme m a correc t i on .
Ibid . , l . 15 e t 11 . c . Boul . d onn e la le con don t l es man .
ont con servé la trace . C’es t Ma i s s i on l’ad0pte ,
i l fau t l i re en su i te e t : : La .
Ibid . ,l . 17 . Boul . con fi rme ma c orrec tion .
Ibid . , 2 2 . Boul . L,:j , comme vous corr igez .
Ibid . , 25 e t n . B oul . a comme les man . ,
e t j e m e t i en s persuadé à pré sen t q ue ce t te lecon es t b on ne .Par con séquen t , i l fau t b i lier la n oteP . 88 , l . Boul . m a i s la leç on que
j’
ai don née est la vé ri tab l e ; i l fau t l i re de même p . 22 1
l . 2 e t 4 , où Boul . a la b on n e l econ , e t chez Ibn-Dihya(fol . 1 12 où le m an . por te :
L5. :
O‘ “
U" ° J ît
L_,Lä
î
il, Q :
, t Ibn-al-Hachoha d it dan s sonGlossaire sur le Man ç ouri (man . 5 5 1 à l ’ar t i c le
L,ÊL.È, num,
î ,,h l t
L,i : l: ï E t on lit chez Checou rî (Tra ité de la dy s_sen terie ca ta rrha le , m a n . 5 5 1 fol . 196
ZL: À ,â : ä l
s iÜ
: c_,3 Œ“ L' °
L5s( ic) L,;Làî 5L) L: M 9
0‘
€. i :p )
—s,
: L:, J .,L3, ,
s i
x…t: L: æ,,l t 65, Ü :
. X. ï t: tà:d t -£it.
Je doi s observer que les man . auxquel s j ’emprunle ces c ita tions , son t très—correc ts .
15 6
Ibid . ,8 . Boul . correc temen t
Ibid . ,l . 15 . Les deux fau tes dan s cette l ign e , don t
l ’une a é té corrigé e par vous , l ’au tre par moi , son t auss idan s Bo ul .P . 89 , l . 17 . Ce … î
, :il semb l e avo i r embarrassé l’édi
teur de Boulac , car i l l ’a om i s . J e cro i s à p ré sen t avecvous qu ’ i l fau t l e changer en
P . 90 , l . 24 . Boul . é,m it , comme vous c orr i gez .P . 9 1 , l . 16 . Boul . a auss i Q
)C>l.
P . 9 2 , l . 6 . J .æ, . ii ,àÜ
.Ü , O
t_ :
J ’ava i s réfuté t rès-bri è vemen t votre i dée de change r ene t san s me don ner la pei n e de chercher a i l le u rs l e
n om de ce t ém i r Cha’b â n , parce que j e pen sa i s que vousn e tarderiez pas à abandonn er u n e op i n i on qu i , pardonnezm o i m a franch i se , n e me sembla i t pas méri te r une réfutation approfond ie . Auss i m e flattais-je de l ’espo i r de vousavoi r con va i n cu , car dan s votre répon se vous n e reven i ezpas sur cette quest i on . A mon gran d é ton nemen t j ’a i vuque , dan s votre n ouvel écr i t , _où vou s avez fa i t imprimerma pet i te n ote , vous pers i s tez à voulo i r l i re et quem ême vous y défendez longuemen t votre Op in i on . Je s ui sdon c ob l igé de vous réfute r complè temen t , e t j ama i s j en’
ai eu une t â che pl us fac i le à rempl i r . En prem ier l i e u ,j e pers i s te à n ier que , dan s la s imple prose (e t la ph raseque n ous avon s i c i est auss i p rosaïque q u ’ un e ph rase peutl ’ê tre) , l e m ot ;. Â . l l s i gn ifie jam a i s les h ommes illu stres .
Les deux exemples q ue vous c i tez pour pro uver l e cont ra ire , n e p rouven t absol umen t r i e n , car l ’un es t emprun té
1 5 8
l e mot Ghoz z d u tex te . Eh b ien , dé trompez—vous ! Ayezla b on té d ’ouvr i r mon éd i t i on d ’Abd—ai-wâ hid : vous y trou æ
verez , à la page 2 10 , que ce t h i s tor i en ra con te que , dan sl ’année 5 82 ou 5 85 de l ’Hégire , au commencemen t d urègn e de l ’Almohade Almanzor , l es Ghoz z a rr i vèren t dan sl es E tats de ce p r i n ce . I l n omme leu rs chefs ; c ’é ta i entCarâ coch « et un person nage n ommé Cha ’b â n qui , dit
-on ,
e ta i t u n des em 1rs des Ghozz ,» l
, ot: u
‘
o Œ—O-M J
Ei5t : l_,A l
U‘° Un peu pl us lo i n i l aj out e : « Le pr i nce
donna en fief à ce Cha ’b â n un gran d n ombre de v i l lagesen Anda l ous i e , qu i rappor ta i e n t env iron n euf m i l le p i ècesd’or par an . » L
’
aute ur a b eaucoup con n u ce C ha ’b â n ; i ll oue sa sagac i té , sa c on versa t i o n , ses con na i s san ces lit téraires ,
ses tal e n ts poé ti ques . Est—il b eso i n d ’aj oute r quece C ha’hâ n est i n con tes tab lement l e même que cel u i don tparl e Maccari , et que , par con séquen t , tou t l ’échafaudageque vous avez dressé pour prouver vot re conj ec ture , s ’ éc roule devan t les fa i ts ? N
’
en parlon s pl us , ce sera l em ieux .
P. 92 , l . 17 . g o t, r
.t= j f L55 Nous som
mes tous i n excusab l e s , moi en p rem ier l i eu , p ui s vou s ,e t en fi n l ’éd i teu r de Boulac , de n ’avoi r pas corr igé i c i lescopi s tes . L eu r n e sign i fi era i t ab sol umen t r i en . I ln e faut pas l e changer en comme l ’a fa i t l ’éd i te u rde Boulac ,
m a i s e n e t au l i e u de on doi tl i re , comme dan s la n ot e a e t dan s Bou l . , L
’
ex
press i onF.%À.g …et, {
.La 55 L55 L
_Î)o
Otî s ign ifie : « i l p os
séda it une b onn e par t de chaque sc ience e t de chaquegenre d e l i ttéra t ure . » Elle es t l o i n d ’ê tre rare . On lit ,
1 5 9
par exemple , che z l bn-al-Kha t îb (man . de M . de Gayanges , fol . 90 Vo) : W i
L55 L:
,o W i
L5.5
C hez Ab ou—’ l-Hasan Djodz â m î (dan s Mülle r B eitra‘
ge , p . I 19
2 a .fa.s u[.ne t
0:05 J.: 5
5
C hez Soyouti (Ta bacâ l a l-mo/a ssirî n , p . 5 5 , l . 8 éd . Meurs i nge) .
,L
, rg…) 55 6
5 On d i t a uss i,comme
chez Abd-al-wâ hid ,p . 7 1 , 1. 15 e t 16 : 315
.. vLg: .o LM S,
\:Sl d L55 Q .È U
Q “r%
M
55:L3
P . 95 1 18 . B oul .P . 96 ,
l . 5 . Boul . a auss i aprè se s l,: l l
Vous avez san s d ou t e ra i son de dé clarer fausse l ’explicat i o n de vu, : que vous av i ez donné e dan s u ne de vos n otess ur Abou-’ l-mahas i n . C el l e que vous y subst i t uez à présen t es t m e i l le ur e ; m a i s el le n ’es t pas e ncore to u t à fa i tbonne . Vous pen sez que l e verbe en ques t1on—sign ifie , e nparlan t d ’un d isc i ple : réc i te r ou l i re l e C ora n (vous a urie zdû d ire : réc i te r un écr i t quelcon que) à un professe ur, afinde profi te r de ses ob serva t i on s e t correc t i on s . C
’es t auss il ’expl i cat i on que M . de S lane ava i t don née de ce t erm e
,
qua tre ans avan t v ous , dan s u n e n ote sur sa traduct i ondes Prolégomènes , qu i sembl e avoi r é chappé à votre at
t en t ion (voyez t . II , p . 182 , n . e t dans beaucoup depassages Un} : a réel lem en t cet te accept i on . P . de Al ca lal’
a noté e . Chez l u i dar licion e l maeslro est î,à la 118
160
forme 1 e t da r licion cl dicipu lo C’est a uss i le sen s
qu ’ i l fau t a t tribuer à ce verb e ch ez Maccar i , t . I , p . 5 5 2 ,
1. 5 ,p . 5 98 , l . 8 ; chez Nawawî , p . 5 40 , dern . I. ; dan s
la B ibl . Ara bo-S icu la , p . 66 5 , l . 1 , p . 6 70 , l . 9 ; dan sl es P rolégomènes , t . I I , p . 158 , l . 8 ; chez D zah ah î , apudRenan , Averroès , p . 456 , l . 2 a f. Dan s son Au tobiographie , Ibn-Khaldoun dit en parlan t d ’ un de ses professeurs(man . 15 50 , t . v , fol . 19 7
â‘” .}i è . Dan s 1. seconde Part i e de Maccari (t . III , p . 1 15 ,
1. 19 éd . de Boulac) on l i t : : LäÏ
Â,Lΰo,:
Ü. : Ma i s ce verbe
n ’ impl ique pas nécessa i rem en t l ’ idé e d ’ un d isc iple qu i réc i te sa l econ à son professeu r , afin que cel u i-c i l e corr igeau besoi n ; i l s ign ifie en généra l : réciter , p rononcer ce que
l’
on sa it par cœur . Tel le es t l ’expl i ca t i on qu ’en don n eBocthor (voyez auss i Humbert , Guide de la conversa tion ,
p . e t j e t â ch era i d e prouver par quelques exemplesq u’el le est la vér i tab le . On l i t chez un chron iqueur ano
nymc (man . de C openhague , n ° 7 6 , p . , et
. .w.,a. Œt:
'
…Ls 1J t Œà (lis .
U…L:d l xÇ,Ï: , ,m s t: g Œ.L…tt
—Z.. s,,2r . Ibn—Gab i b aç—çalâ t (man . d
’
Oxford , fol .7 5 V°) parle d ’un personnage qu i fu t p rom u ‘à une d ign i téXÀA$ Ûi M L5
' è 23 \=J LA{ &.È Â S Ü. I l
1) Vo u s save z qu e , dan s la la ngu e v u lgaire , o n sub stitue so u ven t la
Il & fo rm e à la IVe .
16 2
a u tre chose que réciter . On lit , par exemple , ch ez notreau teur (t . I , p . 87 4 , I. 1 5 « Un tel racon te : j ’aisu i vi l es cou rs d e ce professeu r pendan t s i x moi s , et jam a i s je n
’
a i v u person n e qui sû t au tan t de l i vres par cœur .Dan s ses lecons sur l e Mowa tta e t sur Bokh â rî , i l réc i ta i tchaque j our env i ron d i x feu i l les d e ces deux l ivre s e t i ll e fa i sa i t textu el lemen t , » U
“ °UL£5
terminan t qu ’ i l n e fau t pas pense r , comme vou s l ’avezfa i t , que l e verbe en ques t i on s ’emplo i e auss i en pa rlan td ’un m an usc ri t qu ’on l it à hau te vo ix , e t qu ’ i l n e fau tpas se la i sser t romper par l e verbe 333 , car ce dern i e r
,
comme les recherches récen tes su r la v i e de Mah omet l ’on tsuffi sammen t mon tré ,
_
sign ifie auss i trés-so uven t réciter .
On en trouve un exemple frappan t chez n o tre a u teu r,t .
II, p . 258 , l . 1 1 e t 12 , où i l est imposs ib le de donnerl e sen s de lire à ce verbe , car i l s ’agi t d ’
un aveugle .P . 100 , l . 8 . Boul . confirme ma correcti on
10 1 , l . 18 . Même observat i on .
10 2 ,l . 2 e t 2 1 . Même observa t ion .
10 4 , l . 9 e t n . a . La c opulat i ve es t auss i dan s Boul .105 , l . 17 . Boul . comme les man uscr i ts .106 , l . 16 . l i s ez (Boul . ) e t comparez
c e que j e d i ra i pl us l o i n , dan s ma n o te sur p . 166 ,l .
10 , rela t i vemen t à la s i gn ifica t i on e t la cons truc t i o n d u
wwwçc
g-a
verbe La leçon (auss i dan s Boul .) est déc idémen t m auva i se , e t i l fau t la changer en car le sb el les dames qu i voyagen t pendan t qu ’ i l fa i t n u i t noi re ,ne tr ah i ssen t pas le u r présence par l eur sourire , que l
’
ob
16 5
seurité n e perme t tra i t pas d ’apercevo ir , ma i s par les parfum s qu ’el les répanden t
, et la compa ra i son d u prem ier versdu poème qu i s u i t , m e t m a correc t i o n à l’abri de tou t dou te .P . 10 7 , l . 2 1 e t 2 2 . Boul . auss i La
,. e t
P . 109 , l . 4 . Boul . äs t 2., comme vou s corr i gez .Ibid .
, 6 . Fo 1cé par l e m anque d ’espace d ’ê tre extrémem ent b ref dan s les Add . e t Corr . , j e n ’
a i pu y expli
quer pourquoi j e préfère le du man . d’
l bn-Bassamdes man . de Maccar i , e t j e l e regre tte parc e que
j e vo i s que vous n ’avez pas devi n é m a pen sée . Je u’
io o u 0 4 0 5
9
gno1a 1s pas qu on d i t -…J t a uss 1 b 1en que
,L> ; m a i s i l m e sembla i t q u ’ i c i ,, s x: l é ta i t
plus é légan t que parce que ce mot rime avec,—,à ,
dan s la ph ra se su i van te . Je voi s à pré sen t que Boul . cone
fi rme ma m an 1ere de vo i r ; i l a aussi Dan s laph rase
_.t vous avez e u t0 1 t de subst i
t uer à I l s ’ag i t réel lemen t d ’un e coupe ,de
cel le qu ’
Ibn-Mochil a décr i te dan s des ve rs trés-é légan ts ;voyez les extra i ts que feu M . de Hammer a don né s d ’unouvrage de Tha ’ â lib i dan s l e Zeitschrift , 1. VI , p . 50 e t
5 1 , n ° 265 . Comme ce t ra va i l a pa ru trés—pe u de tempsaprè s la pub l i ca t i on de Maccar i e t que vous l ’avez com
m en té , j ’ava i s espéré que vou s aur ie z fa i t vous-même ce tteremarque dan s vo tre n ouvel é cr i t .
Ibid . ,l . 12 . C
’es t en va i n que vou s t â chez de défendrel e
O'” des man . Le leçon d u man . P . e t d u m an .
d’
Ibn—Bassâ m (voyez les Add . et Corn ) , mon treque l e U " ° n ’est q u ’un e faut e des cop i s tes pou r Ils
L5
con fonden t san s ce sse ces deux mots .
16 4
P . 1 10 , l . 9 . La singul1e re faute , que j ’aicorrigée dan s les Add. et Corn , est auss i dan s B oul .P . 1 1 1 , l . 25 . B oul . L
’un e de vos
deux conj ectures , à savoi r œ£ä: , es t con firmée par Boul .L5
Ibid. , l . 24. (J ,l) Boul . comm e vous c orr i gez .P . 1 15 , l . 5 . Mettez u n aprè s comme vous
avez corr i gé s i b ie n (Boul . a auss i la e t unaprés : la …
P. 1 18 ,l . 6 à la fin . Aprés i l faut aj ou ter
comme j e l ’ai d i t dan s mes L oci de Abbad . , t . I , p . 199 ,
l . 2 .
P . 120 , l . 4. (M ) . De vos deux conjectures je préfère c ’es t auss i la l ec on de ’ Boul .P . 12 1 , l . Certa i n emen t auss i dan s Bou l .P . 125 ,
l . 1 . L i se z pl utô t , comme dan s Boul . :
Ibid. , l . 17 . Ma correct ion , estc on fi rmée par Boul .P . 125 ,
l . 22 . Votre changemen t ,est trop v iolen t . On peu t l i re : la—L: : c ommedan s Boul . , ou b i en , ce qu i sera i t plus s imple ,( « nous n e pouvon s La faute p . 120 , l . 4pou r est de la même n a ture .P . 127 , l . 9 . Boul . comme vous corrigez .P . 129 ,
24 . B oul . a auss iPl ..
P . 15 1 , l . 22 . Boul . auss i dan s le prem ierhémi st i che .
166
s ign ifica ti on pr im i t i ve d e ce t adj ec t if relat i f , et ch ez Bocthor c ’es t v ineux , qu i sent le vin , qu i en a la cou leur ;
ma i s dan s l e passage que vou s c i tez e t où Maccar i parled ’un Œ; -f> i l ne fau t pas t radui re : « Un
beau j eun e h omme aux yeux couleur de v i n ,» ma i s : Un
beau j eun e h omme aux yeux br un s , » car l e term e don t i ls ’agi t s ign ifie , du moin s dan s l e d ia lect e m agrib in : brun ,
brun foncé , brun qui tire sur le n oir . Chez P . de Alca la ,
il répon d aux mots espagnols baço color , baça negra
hosco baço en color ,loro en tre b lanco ,
m orena cosa baça ,
n egro un poco . C’est la couleu r des m ul â tre s , qu i au
jourd’
hu i s ’appel len t a i n s i au Maroc , car on lit chez Hœst(Nachrich ten von Ma rokos , p . 142) 0
9 d ie M ula tten oder d ie , welehe von schwa rzen und we i ssen Ael terngeboren s i nd .
» C hez Hé lot ce terme es t auss i ex pl iq uépar mu lâ lre , d ’où i l ré sul te qu ’en Algé ri e i l a éga lemen tce tte accep t i on . Chez Pa ulm ier c ’es t noir de peau . Les
auteurs arabes parlen t quelquefo i s d ’un e espèce de m arbrequ ’ i l s n ommen t voyez , par exempl e , Maccari , t .
I , p . 125 ,l . 16 , p . 5 7 1 ,
l . 2 ; Edri s i c i té par Ibn-al
Ba l tar (v° °
â‘"
DL: 1.
C’es t peut-ê tre ce qu ’on appel l e , e n termes techn i ques , labrèche africa ine an tique ,
qu i se compose de fragmen ts gr i s ,rouges e t v i ol et s réun i s par une pâ te ca l ca i re n oi re . La
couleur de la p ierre a fus i l es t éga lemen t dés ignée par cemot , car on lit chez Edr is i (apud l bn-al-Ba itâ r, v°, t.t l tL: L. U L: ,
e,
Ü ,£g , et j e n
’
ai pas besoi n de vou s rappe le r que lebrun fon cé est la couleur la pl us ord i na i re de la p ierre à
16 7
fusi l . C’es t seulemen t quand on con na i t ce t te s ign i fica t i on
d u terme don t i l s ’agi t , qu ’on peu t sa i s i r la poi n te de c evers d ’un poè te qu i a ima i t à fréquen te r l e cabare t (apudMacca r i , t . II , p . 5 50 , l . 18)
,täl, â£i&3 ,u:è
Le terme si gn ifian t ord1na 1remen t brun e n Espagne ,i l semble for t i n nocen t de d i re : « J
’
a i tei n t mes hab i ts enbrun ;» m a i s comme i l ava i t pr im i t i vemen t l e sens de couleur de vin , l e poè te donn e a u tre chose à en tendre
,e t i l
n e sera i t pas dan s la décence d ’expl iquer ce qu ’
il veut d i re .
0 , a ; 0 oP. 140 , l . 5 . prononcez …a…, comme on trouve
chez l bn-D ihya (fol . 143 C omparez dan s le Glossa iresur le Mançour
‘
i (man .
Ui,9>…: la l l d x.il‘
,
â\ î t,,
tto
‘° t..—sa s
,
3115 Ç\ ll . Dan s un passage de Râ z î c i té par C hec ouri (Tra ité de la dy ssen terie ca tarrha le , man .
fol . 194 ce t auteu r d i t , après avoi r parlé d ’un bre uvage qu ’ i l prépara : Voyez auss i Maccari , t . I , p . 627 , l . 18 .
P . 144 , l . l . B oul .,Uàl t
, , comme dan s tro i sde mes man . Ne faudra i t-i l pas l i re e t y reconna î tre le mo t espagnol guitarra (gui ta re) , qu ’on écr i t aujourd
’
h ui en Or ien t (Boc thor , Berggren , Ma rcel ,Humb ert , p .Ibid . , l . 18 . Moi n s i ngé n i eux q ue vou s
, l editeur de
Boul . n’
a pas trouvé la vér i tabl e leçon , et i l a changé arb 1tra1rement l e tex te en fa l sant 11n pr1mer : ,
£s xltÜt
.L.t: is t: l
168
P. 146 , l . 25 . (6 5, Bou l . L5 ,s: îl dan s l e tex te , e t
sur la m arge : Œ,,äll
U
;.
P . 147 , l . 15 . La vé r i tabl e l eçon , que j etrouve dan s le man . de Berl i n du Marcoz a l-ihdta , est
Li t,t, . Il es t faci le de voir que l e Lit
,t, des man . de Mac
car i (auss i dan s B ou l .) en est une a l té ra t i on .
Ibid l . 18 . Dan s l’Ihäta et dan s le Marcaza l-ih â ta
P . 148 , l . 18 . Je c roi s à présen t que la vér i tab l e leçonest e t j e voi s avec pla i s i r que , dan s vo tre n ote su rt . I I , p . 449 , l . 19 , vous ê tes d e la m ême opi n i on .
P . . 150 , l . 20 . Boul . comme j ’ai corri gé .P . 15 1 , l . 5 . L
’éd i teur de Boulac a é té choqué commevous par ce qu i se t rouve pour la secônde fo i sdan s la r ime , car i l a no té su r la m arge : : L: : L:
à»
v“653 “ 3 L:
P . 5 . Je n e conna i s pas de poètede ce n om . Boul . a aussi dan s l e tex te , ma i s s urla m arge comme var iante . I l es t d onc à peu préscerta i n q u’on doi t l i re voyez l ’Index des n omspropres .P . 1 5 9 , n . c. Dan s Boul . c omme dan s G . P. et La .
P . 160 , l . 1 5 . Boul . qu i est m auva i s , ma i scorrec temen tP . 16 1 , l . 14 et n . o. Je vo i s par Boul . que , s i je n ’
ai
pu ri en fa i re des m ots que j ’a i placés dan s la n o te 0 ,c ’est
parce que le mo t est a l té ré . I l faut l e changer en… 3LÏ , et l i re dans le texte : UÀ L: =
U€’…Â L£. ll
Ü: J Läâ
17 0
: la.Ȇ
’° M,Ï , —: il f
u t,; L: f Suiv ide la prépos i t i on qu i sert à rendre u n verbe t ran s it if, ce verbe do i t se t radu i re par mon trer furtivemen t , “
tra
b ir , comme dan s ce passage de Becrî , p . 187 , l . 15
L: : m w : Œ. 5 « une rob e qu i trah i ssa i t ses charmes , » qu i les dé roba i t for t m al aux yeux .
On d i t dan s le même sen s voyez Bocthor soustrahir , et Macca r i , t . II , p . 106 , l . 16 , où i l faut l ire ,comme j e l ’a i di t , au l i e u de Lg: L= , e t au
l i e u d eIbid . , 12 . C e qui est d i ffic i le i c i , ce n ’es t pas desa i s i r l ’ idé e d u poè te (car vous vo udrez b i en c roi re quej’
ai touj ours compri s ce vers de la man 1ere dont vous letradu i sez) , ma i s de ré ta bl i r ses propres paro les , e t votre
sera i t i n tolé rab l e . La lecon de Boulac
est beaucoup mei l leure , et c ’es t auss i cel le d u très-bonman . d
’
Oxford d’
Ibn-Bassam (dan s ma n o te f) , ex cep té quele y a é té om i s . Le n
’
a é té aj ou té par l es c op i stesqu’après que le s ’é ta i t perdu , et afin de red resser lamesure .P . 170 ,
l . 9 . Comme vous a ttachez tan t d ’ impor tanceà des fautes d ’ impress ion , même à celles que chaque lecteu r corr igera de so i-même , j e vous répondra i , comme j evous réponda i s i l y a d ix ans , que ce y est , ma i s qu ’ i lest un peu usé .P . 1 7 1 , l . 9 . Boul . correctemen t d ia s.
17 1
P . 174 , l . 12 . Boul .of. L editeur aura i t- i l t rouvé
cela dan s ses m an . , ou b i en aura i t-i l changé , . l enÙt
parce q u ’ i l ava i t l e même scr up ule que vous ?P . 17 6 , l . 5 . Boul . a a uss i la b on n e lecon
P . 179 , l . 6 e t n . a . Ma correc tionä xtä est con fi rméepar Boul . e t par l e man . d
’
Ibn-B assâ m que possède M .
Moh l,où l ’on t ro uve a uss i ce tte pièce (fol . 189 m a i s
l e secon d hém i s t i ch e de ce ve rs m e para î t a l té ré, e t j e
croi s que les deux mo ts }: L3 ;b L3 do i ve n t ê tre b i en é tonnés de se trouver en semb l e . Au l i e u de
Œ: s 3, (qu i est
un e conjec tu re) , Boul . e t Ibn—Bassâ m ont Œ: 5 ü, ; j e prononce (la IV" fo rme avec deux accusa t i fs , fa irecueil lir , comme vou s l ’avez démon t ré s i bi en dan s votren o te su r t . I , p . 700 , l . 1 7 ) e t j e l i s
‘,wLa ‘:ÏÔU Lç
f
« tand i s que vou s fa i tes cue i l l i r aux yeux , qu i rega rden tat tent i vemen t , t ou t ce qu ’ i l s dé s i ren t » (cf. t . II , p . 188 ,
l . 6 , où vous p rononcez avec ra i so nIbid . , 1 1 . Au l i e u d u p rem ier Boul . et Ibn
Bassâ m on tI bid . , 12 . Je n e comprend s pas commen t le j oueu r
de gobe lets pourra i t fa i re ses t ours avec des chan teu ses ,
e t cet te lec on m e para î t su spec te . Au l i e u deà : :e , lbn-Bassâ m a j e l i s avec Boul .Ibid . , l . 15 . L i sez (Add . e t
1 7 2
Boul . a de n ouveau;h xzs ; Ibn-Bassam Je lis
ÿa gxs .
Le sen s est le même ( « nous ma i s la répét i t iond u m o t qu i se t ro uve déj à dan s lé vers qu i précède
,se
ra i t peu é légan te .
Ibid .,l . 15 . prononcez &î täa .
Ibid . ,16 . Au l i e u de ce
8538 qu i n e convien
dra i t n ul lemen t i c i , Ibn-Bassâ m n ous offre l ’excel len te lecon
zljlt Les cop i s tes ont s ubst i tué un au t re m ot à
ce —3 , parce qu ’ i l s” ne le con na i ssa i en t pas . I l n ’est pas
dan s les d i c t i on na i re s , m a i s c ’est pl ur . de a …, qu i
s ign ifie une bouteille . Dan s l e Glossaire sur le Mançourî
(man . on t rouve :U
’° a…)6 %
m as …u n,
gel .at? )
Lÿ,s ü ,
t x.æb< Un con tempora in de no tre poè te ,Ibn-Haiyâ n , emplo i e auss i c e mot quand i l dit (man . d
’
Ox
ford,fol . 5 8 vd—À: w l.f _ln â 3 -3
612 M ac .
Vous voyez que , dan s ce passage , I l est ques t ion de bontei l les rempl ies de naph te .Ibid . ,
l . 17 . Boul . a l e tex te que j ’ai don né .Ibid . ,
22 . Boul . a aussiP . 18 1 , l . 15 (wM 3 l) . Vous me semblez avoi r expl ique d ’une m an 1ere tout à fa i t sat i sfa i san te la l ec on duB ad . œ$ t@t , e t j e m e t i en s conva i n c u qu ’el le est la vé
ritable . Bou l . l’a aussi ; j e suppose que l ’éd i teur l ’a t rouvee dan s ses m an . du B ad . , qu ’ i l a con sul tés e t s u iv i s .Ibid . ,
16 . Boul . c orrec temen t œLà : .Ibid . ,
11 . g. Boul . : Li u :L5l‘a Lg: @ L5
$ Jfj Lj) 3 UL
5
17 4
men t aucun lec teur de Maccar i n e dev i nera , car sanscomp ter que j e n ’en a i pas l e dro i t , j e la c ro i s tout à fa iti nd igne de vous . En ou t re , j ’ose me fla tter de l ’espoi rque le léger changemen t que j e va i s proposer , aura votreapproba t ion . La leçon d u man . P . ,…à : (au l i e u de…à3) ,est auss i dans Bou l . e t el le m e semb le la vé ri tab l e ; ma i sc ’es t so.ä5 qui es t a l té ré . J ’y subs t i tue s
;i 5 (ËÂÂ Â ) , mot
poét ique que les copi s tes n e semb le n t pas avoi r conn u .
Quand on lit de cette man ière , ce vers don ne u n sen sexcel len t e t se l i e é tro i temen t à ce l u i q ui su i t , car i l s s ignifient : « E t n ’oub l i ez pas que , s i l ’on “ n e trouve pas(dan s ce t te sa i son) les fleurs fra î che écloses d u prin temps ,n ous avon s , pou r les remplacer , l es n ob l es qua l i tés d ’Abou’
Ami r , qu i n ous fon t mépri se r l es roses et l es narc i sses . »P . 186 ,
l . 5 . (ŒJ xÀ S) Boul . m ieux LS,
Ibid . , 9 . l i sez _ lc}-Ë m a i s gardez-vous
de pen ser que ce a; est un lap sus ca lam i don t j e m e sera i sren du coupab l e .Ibid . ,
25 . ( té l) B oul . correc temen t .31.
P . 189 ,l . 6 . (Lg aussi dan s Boul .
P . 190 , l . 1 1 . Le secondL5 }w est auss i dan s B oul . ,
et cette lecon es t la seu le b on ne .P . 19 1 l . 7 .
_;ê Boul .
L5;L.f Si c ’est u n e l i
c ence poé ti que pour Œ. gL. J j e su i s devenu pour vou scomme un h omme don t on n e ve ut l e vers aura i td u moi n s un sen s , tand i s que le tex te des man . de Maccari n ’en donne pas ; m a i s le ex e res tera i t é trange .Ibid . , 9 . Vous voulez adop ter la leç on
L5 }a l (qu iest aussi dans et sel on vous , ce m ot sera i t le sy
17 5
nonyme de ma i s c ’es t peu t-ê tre plus fac i le à d ireq u ’à prouver . Je c onna i s dan s le sen s de se désha
bil ler , ma i s non pas dan s celu i de r en oncer a u m onde , e t
j e n e m e rappel le pas d ’avo i r ren con tré l ’express i on
Un dan s l’accept ion de LA .xl l
Un Je pré
sume que vous serez ob l igé d ’e n d i re a u tan t , ca r s ’ i l e né ta i t a u tremen t , vou s n ’aurie z pas m anqué de c i te r desexemples à l ’appu i de v o tre Op in i on . Quan t à vo tre ob
jec tion con tre mon Œ;L l l l , j’
a voue que j e n’
a i pas p u lal i re san s su rpr i se . Vous d i te s : « Dan s l’acception chercher
à se consoler , l e m o t vé r i table a ura i t é té , n on pas L5}d A l ,m a i s ŒÏ… .3L» Ma i s aur iez-vous d on c oub l i é que ces deuxmo ts son t syn onymes ? Dan s ce cas , j e vous pri e d ’ouv rir l e d ic t i on na i re de Hélot ; vous y t rouverez : « consoler ,
e t cel u i de Marcel : « se consoler , Œ}*—3 e t
ŒL..J » (voyez auss i sous consola tion e t sou s conso ler) ; celui de B erggren : « se consoler , e t
L5 jx a ; consolc
'
,
Œt…x» e t (voyez tou t l ’a r t i c l e , où la 11° forme deŒ;
‘
-2 se t rouve t ro is fo is comme le synonyme de la l l eforme de Bocthor : « se consoler , e t
consola ble , Œj —à e t Œt…:ù; inconsola ble , a… 3 e t
L5}… C omparez a uss i ces paroles d ’un vers que c i teIbn-Kha llic â n (Faso . XI , p . 5 5 , l . 1 1 éd . VVu stenfeld)
.M La ).u , car vous n e d i scon v iend rez pas qu ’ i l
faut l i re a i n s i au l ie u de“ fi s .
1 76
Ibid . ,l . 10 . wst est auss i dan s Boul .
Ibid . ,—;l ) l i se z u$ g:ÿ}f
P. 192 ,l . 19 . (fi n it) Boul .
P . 195 ,l . 18 . Le m o t
L5) %l l se trouve deux fo i s dan s
ce vers e t i l va san s d i re qu ’ un poè te auss i é légan t qa ’l buZaidoun n e commet pas une t el l e n égl igen ce . Auss i l eprem ier hémi st i che est-i l ch ez Ibn—Bassâ m (t . I , man . de
M . Mohl , fol . 96 L5&m ll q y .3l . Le
motŒ.E-o se prend figurément , de même que fin…, dan s
l e sen s de m isère , comparez , par exemple ,p l u s lo i n p . 195 , l . 2 , e t les P role'gome‘nes , t . Il l , p. 419 ,
l . 9 .
Ibid . ,l . 20 . Voic i les var ian tes de ce vers , qu i est
san s dou te a l téré : Ibn-Bassâ m d …,ALg ;
B oul . a£zl£5; Ibn-Bassâ m
P . 19 4 , l . 15 Ü: g est auss i la lecon de L . et de Boul .
Vous l ’avez expl iquée à m erve i l l e e t el le do i t remplacer leU
’ 3 de mon t exte .P.195
'
l . 17 . Boul . n’
a pas l e On peu t en cifet s ’en passer ; ma i s le s Arab es a imen t cette espèce detautolog ie ; comparez , par exemple , Ibn-al-’Auwâ m , t . I ,p . l . 19 :
)lJA
P . 196 , l . 8 . Au l i e u de ce t é trange ç , . à Boul . a
qu i don nera i t u n for t bon sen s ; m a i s la vér i tablel econ , se trouve chez Ibn-Abdalmelic Marrécoch î
(man . de Par i s , n ° 6 89 suppl . ar . ,fol . 7 5 qu i c i te
auss i ces vers .P . 19 7 , l . 18 . 55 @$ 3U
/ 0°,la , n e peu t pas ê tre
bon . I l faut remplacerU
' ° par L5" (Boul .) ou par
178
que ;voyez de Sacy ,
Gramm . nr . , t . II , p . 504 , n ° 9 24.
P . 20 4 ,l . 6 e t n . a . La vér i tab l e l ec on est
dans Boul . ; c ’est Ux
,cx et j e vo i s à présen t que le
man . L . por teL55 (sic) . est le m ot espa
gno l fidcos , du vermicel le , que les Arabes d ’Espagne ava i en tadop té . Dan s l ’excel len t man . de Checo uri (Traité de lady ssen lerie ca tarrha le ,
m an . 5 5 1 101. 195 r°) i l es t é cr i tŒ,Çxê , et i l fau t prononcer de la m ême m an 1e re dan s n otre t ex te . Auj ourd ’hu i en core les Ara bes se serven t de cem o t . Chez B ombay (Gramm . ling . Mau ro-Ara b , p . 60)on t rouve : “ŒD lLÀ—è , lurunda e .
» Dan s le d i ct i onna i re d eHélo t : m acaron i , » e t «Œ. verm icel le .
»
Ch ez M . Daum as (L a vie a ra be et la société m usu lm ane ,
p .«F eda ouch , espèce de verm icel le . » Dan s le d i c
t ionna ire de Pau lm ier : «Verm icel le , Dan s cel u ide Bocthor : «p â ton , morceau de pâ te pou r engra i sser l esvola i l les , Le m ot qu i su i t dan s n otre texte etque j e n
’
a i pas encore ren con t ré a i l le urs,est dan s Boul .
Ibid . ,18 e t n . c .
v. i 35 est auss i dan s Boul .
et ce t te lecon doi t ê tre adoptée ( J l l l) .
Ibid . ,19 . ((puis) l i sez
P . eos , 2 . (â m e. ) Boul .Ibid . , 2 e t 5 . Le vers
U" ° es t certa i nemen t
al téré . Il l ’est auss i dan s Boul . qu i porteŒW l
r* 3
cç" èäà ll Œzx
°
tc
v °
En comparan t ces lecons avec cel les d es m anuscri ts , ] 8me t i en s persuadé qu ’ i l fau t l i re
17 9
LSI—W i
, ,ë
Ü ,.Q
_Àl Œ
wto”
Ibid . , 1 5 . (_ è5œl) l i sez t _ èlJ.£a l
P . 20 7 , l . l l . l i sez … iäleIbid . , 2 1 e t su iv . C
’es t u n a r t i c le d e l ’Ih â la o n l et rouve dan s le m an . de M . de Gayangos , fol . 43 vo e t
su iv . , e t dan s cel u i d e Berl i n , m a i s l e passage qu ’on litche z Macca r i , p . 208 ,
dem . l . , j usq u ’à p . 209 , l . 4 ,n ’y
est pas . J’
indiquera i ce t ouvrage par les le t tres Kb .
P . 208 ,l . 2 . x. .—ñl l , c ’es t-à-d i re “ lait ou …Läl l (Boul .
e t
Ibid . ,l . 6 . (J , io l) Kh .
Ibid . ,l . 8 . que vous avez t rouvé dan s
B . , est san s dou te pl us é légan t ; c ’es t auss i la l eco n d eKb .
Ibid . ,14 . l i se z >L e qu ’ i l faut pron oncer
(tendre ,a vec l ’acon s . ; c f. Ibn-Badroun , n otes add i ti on
n el les , p . 1 15 ,
Ibid . ,l . 15 e t 16 . Vous avez don né à p ré sen t tro i s n o
tes s ur cet te pe t i te p1ece , deux dan s les Add . e t Corr . e tune dan s votre n o uvel éc r i t . Je regre t te de n e pouvoi ren accepter aucun e , e t d ’ê tre ob l igé de repousser les de uxchangemen ts que vous avez proposés . Quan t au m o t
que vous voulez subs t i tuer à j e n e l ’a i j ama i s re nc on tré che z les poè tes anda lou s dan s l e sen s de va l lon , e t
la l econ du tex te est confirmée par Boul . e t Kb . La le
con 3..t est bon n e auss i , comm e j e l e m on t rera i tou t àl ’heure , e t pour c e qui con cern e la traduct ion que vousavez donnée d u second vers , i l e s t i n ut i le de la réfute r ,car el l e s ’é lo ign e tel lem en t d u na t urel , qu ’el le se réfute
12 *
180
so i-méme , san s comp te r que vou s a v ez a t tr ib ué au verbeun e accep t i on qu ’ i l n ’
a pas . L’ i dée d u poè te est b i en
d i ffé ren te de cel le que vous lui avez prê tée . Dan s l e prem iervers i l parl e d e c ’es t—à-d i re , de m ag ie b lan ch eou n a turel l e (of. Bocthor , v
° magie ) , e t dan s le sec ond i lemploie l es mots et C e dern ier terme désign e
,en tre au tres ch oses , comme M . Lane l ’a dit dans
son Lex iq ue : l ’im age d’
un obj et qui se réfléchit dans un m i
roir ou da ns l’
eau . A i n s i o n lit dan s l es Mil le et une nu its
(t . II, p . 80 , l . 7 éd . Macnagh ten) : « Comme la mule deMahmoud ava it soi f , el le voul u t s
’
abreuver à la mare ;m a i s e n voyan t dan s l ’eau l ’ image d’Aladin , qu i dorm a i t ,el l e se dé tourna efi rayée ,
»
vs .…sus: cul}
En généra l ce m ot s ign ifie ombre , comme dans cette ph raseque c i te M . l e généra l Dauma s (L a vie ara be e t la société
m usu lmane , p . tekhafm enn kh i‘
a l-ha ,« el l e s’effraye
même de son ombre . » De là v ien t l ’express i on Ç).ial tqu i répond l i ttéra l emen t à ce qu ’on appel le dan s votrelangue Scha ttenbild . Qua tremère , qu i a écr i t une n ote àc e suj et (H ist . des sa lt . m am i t . part . 1
,p . 1 5 2 ,
la tradu i t par les om bres chinoises l ; et l es pa ssages devoyageurs européen s q u ’ i l c i te e t auxquel s on peu t aj outerM . Lane , Modem Egyp tie ns , 1. Il , p . 1 25
,126 , mon tren t
qu ’ i l fau t en tendre sou s ce t erme : de pet i tes figures plates , ou b i en des mar i onnet tes , qu ’on fa i t rem uer derr ièreu n morceau de t o i le b lanche , à l ’omb re de la c larté de
C ’e st au ssi , comme Qu a trem ère l ’a d it , la la n t ern e m agiqu e (voye z
B o c th or so u s l a n tern e) , e t c’e s t e n ce se n s q ue j e c ro is de vo ir e n te n
d re le pa ssage de Prospe r-A lp in , qu e l ’illus tre a cadém icien a c ité .
182
dan s la dépendance duquel i l devra i t ê tre , é tan t sous »en tend u ; of. de Sacy , Gramm . ar . ,
t . II , p . 8 1 e t 82
5 15 9 ; Mül ler , B eiträge , p . 1 18 , l . 15 . Je trad ui s parconséquen t : « Ce sera it un e fol i e p our u n homme tel quetoi , de p leure r les a rrê ts d u des t i n , e t de d i re , en man i èrede c onsolat i o n : « Plû t au c i e l qu ’ i l (l e père du poète) _ eû tété enterré (c omme les au tresIbid . , 5 . Boul . comme dan s mon t ex te .P . 2 1 1 , l . 2 . Boul . correctemen tIbid . ,
4 . (c ‘—ç ) Boul . ce qui est préfé rable àcause de la mesure (Zl ioIbid . , 10 . Après Boul . aj oute ma i s i lfau t a :… (r…—a l l U n) l i sez L5
’
P . 2 14 ,l . 19 . Boul .
,un
,comme vou s corr igez .
P . 2 15 ,l . 19 e t n . 9 . Vous avez e u une s inguh e re
i dée en t radu isan t le t ex te d u B ad . comme vous l ’a ve zfa i t , e t s i vous voulez b i e n cons ul ter l e Lex ique de M .
L ane , vous verrez que la IVe fo rm e de (p l)n e s ign ifie
n ul lem en t su bmerger .
Ibid. , 2 1 . Vos deux conj ec tures me semb len t éga lemen t i nadm i ss ibles . A mon av i s i l faut pron once r
C’es t ce qu’on appel le en prose3L> Œ)
.A , l lfl6 ma ladie
inflamma toire ; voyez l e G lossa ire sur le Manceuri , man .
5 5 1 v°
Uo}.æ , e t Boo the r , v
° inflamma toir e .
P. 2 20 , l . 2 5 . Boul . 1,comme vous corr igez .
P . 2 2 1 , l . 2 e t 4 . l i sez L;Lâ xl l ; voyez plus hau t ,p . 15 5 .
P . 222 , l . 7 . La leç on ou pl us correc temen t
183
JSLLÂ J l , es t confi rmée par l bn-Bassâ m ( t . ma n . de M .
Moh l,fol . 2 5 1 vo :
oL .-ä. l l) e t on la recon na i t fac i lemen t
dans l e Œa‘
LAäil de Boul .P . 2 2 7 , 8 . En répé tan t da n s vo tre n ouvel écr i t vo tre
note d ’ i l y a d i x a ns su r l e mo tU
. g)—. A e t e n y aj ou ta n tma répon se
,vous avez oubl i é q ue n ous avon s rencon tré
un peu plus tard ceU
. g-A -Â dan s cet te ph rase d ’Ibn-a l
Kha t ib (Mi’y â r d l—ikh tibâ r ,p . 20 , l . 1 éd . S imone t) : :, d :
u :…o. J LS xiL..îàè e t q u ’a lors vous avezapprouvé m a remarq ue s ur ce t erme , q u i a é té impr iméeda n s le Zeitschrift , t . XVI , p . 5 9 5 . I l es t for t heureuxque le passage d ’l bn-a l—Kha t ib , qu i se trouve a i n s i dan s tousles m an . ; ca r M . Mülle r
,dan s ses B eiträge , n
’
a pas no téde var ian te , m et la l eç on des man . de Macca r i à l ’ab r ide t ou t dou te , car Boul . a réel lemen t commevous voul i ez l i re , m a i s i l es t é viden t que l ’éd i te ur , ou l ec op i ste du man . qu ’ i l s u i va i t , s ’es t perm is un changemen t , parce qu ’ i l ne con na i ssa i t pas l e ten u e don t i l s ’agi t .Au res te , Humber t (Guide de la conversa tion , p . 147) donn ea ussi : « h omme rel ig i eux , p ieux , O .aM ;» ma i s i l l e pro
un "n onceU go“ .
P . 256 ,l . 19 . …s ne doi t pas ê tre changé en
Ü…
’
comme vous l ’avez fa i t , m a i s enP . 2 5 7 , l . 1 e t n . a .
-fl À l ti)ttxl t Ce verb e ,
qu i se t rouve auss i dan s Boul . , n ’es t pas a l té ré,ma i s i l
a une accept i on qui n ’es t pas dan s le s d i ct i on na i res .à la I I" et à la IVe forme , s ign ifie couvrir . On l ’emploi espéc ia lem en t en parlan t d ’ un e ma i son qu ’on couvre det ui le , d’ardoise , e tc . , conn u e dan s n otre passage “ e t chez
184
P . de Alca la , qu i tradui t tra stej ar la ca sa (cou vr i r unem a i son) par e t tra stej adura ( l ’ac t i on de c ou
O
vr i r une m a ison ) par s _$ t3 ; ma i s on s ’en ser t
auss i en parlan t d ’au tres choses , comme dan s les M il le et
une nuits , où on l i t (t . V , p . 100 éd . Hab i ch t) : àggùaLg,
: La ,Gag e
, ,>l ,
L53t,t. Peut—ê tre y a—t-ii du
rappor t en tre ce tte s ign ifica t i o n d u verbe e t le s ub stant i fque l e d i c t i on na ire de Hélot don n e dan s l ’accept ion
de draperie de canapé en brocard . Dan s u n passage desM il le et une nuits (t . X , p . 45 5 de vo tre éd i t i on) , où l ’ont rouve : Œ
i l J .ä:… :>L5 UxL ce terme sem
ble ê tre à peu près l equiva lent de (fil….
P . 258 , l . 16 . Je n e comprends pas commen t vous avezp u d i re que e t r imen t ensemb le .P . 240 ,
l . 25 . Boul . comme vous corrigez .P . 2 42 ,
l . 6 . Vo tre n ouvel l e n ote su r ce vers m ’
a fa i tgrand pla i s i r . Ell e m on tre deux choses , d ’abord que j ’avaisra i son en donnan t à en tendre que ce vers est v ide de sen s ,en s u i te que la t raduct i on q ue v ous en avez don née dansl es Add. e t C orr . est i nadm iss ib l e . Je c ro i s qu ’
à présen tnous arr i verons à n ou s en tendre . No tre poi n t de départsera l e m ême . Vous d i tes que l e m o t qu i es t éc r i tdan s le m an . P . d u Ma tmah e t dan s les m an . de Maccar i ,doi t s ign ifier : les bonn es de l ’en fan t
,l es femmes cha rgées
de l e soigner ; j e su i s de la m ême opi n i on , et vo tre m an .
B . , qu i n ou s ’
a suggéré ce tte idée,méri te n otre recon
na i s sance . Ma i s le mo t vé ri tab le es t en core à t ro uver .Sera i t-cc “ La la , comme dan s le m an . B Je ne l e c ro i spas , e t voi c i mes ra i son s : Le de a é té aj ou
186
ne‘
nne e t nene , avec le pl ur i el n en it ou nennit . Auj ourd ’hu iencore on se ser t de ce mo t e n Orien t . Humbert (Guidede la conversa tion , p . 29 ) don n e : «Grand
’
mère , a ïeule,
aÏLË
,» e t chez Berggre n (sous grand ) on trouve : « Grand ’
mère , a i l.3 , pl . c 3L3. » C’est ce t erme qu ’ i l fau t ré tabl i r
dan s n o tre t exte , où au l doi t ê tre ch angé en x3L3L3 , tan
d is que la l eçon d u M a tmah L . est a 3…, ear wLî$ représen te exac temen t l e pl ur . qu ’
Alcala écr i t e t pron once à lam an iere gren ad in e n ennit .
Je pourra i s term iner i c i cet te n o te , qu i , j ’ ose m ’e n fla tter , aura votre approba t i on , s ’ i l n e me resta i t encore àprouver ce que j ’a i d it pl us haut , à savo i r q ue d ’autreslangues ont a uss i ce terme . J
’
ajoutera i don c que , dan sl ’an cien espagnol , on employa it nana dan s le sen s de mère ,
m aman ; voyez Gon za l o de Berceo , D uelo de la Virgen Mar ia , st . 1 7 4 (dan s la Coleccion de Sanchez , t . 11, p . 429) ,
e t l’
Alexandre ,st . 10 17 (ibid . , 1. III , p . Le mala i
a \ .Ë—ÀA 3, qu ’on pronon ce neneh et qu i s ign ifie prop remen t
grand—père et grand
’
mère ; m ais on n omme a i n s i chaquefemme â gée à qu i l ’on parl e .
P . 2 45 , l . 14 . Boul . LÀg,LÂ e t à la fi n du versLa, Ce tte lecon , qu i sera it bon ne pou r l e sen s , ma i sque la r im e n e tolè re pas , con firme votre excel le n te c onjecture Li g,L3. Le verbe g ,
U s ign ifie en effet , comme vou sl ’avez dit , d ispu ter avec quelqu ’ un ; ma i s comme vousn ’avez pas donné d ’exemple de ce tte accep t i on ,
j ’en c i te ra iun que j e t rouve dan s l ’H ist . des B erbères ,
où on lit (t .1 , p . 5 7 4 , l . U
. î t}.5t3 Ü,
Œ .,a t,,Lx» ÜL. f
187
dans la traduc t i on d e M . de S lane : « i l ava i t touj ours é téen r i va l i té avec .
»
P . 245 , l . 15 . Boul . a auss i Lts u k. L’orig i ne de ce l le
si ngul iè re corrup t i o n res te in expl iquée ; ma i s l i s on s LgÀs ,
j e n e m ’y oppose pas .
P. 2 47 , l . 7 . Vous avez m i l le fo i s ra i son de d i re queO )
8 1 on l i t613 , c omme vous voulez le fa ire ,
l e poè te aemployé une i mage monstrueuse , e t ce t te c ons idé ra t ionaura i t dû vous empêcher , ce m e sem b l e , de proposer vo
tre conj ec ture . LeL51, 5,de G . P . est après tou t pl us près
de la vé r i tab le l econ que l e de L . Bou l . ad ès) , ce
qu i est presque bon . I l fau t l i re :L55) Lg
Le ,« par
l e charme m agique de vo tre i n te rcess i on .» Je m e t i en s
a ssuré que vous approuvere z ce t te correc t i on , car n ou sob tenon s de cette m an iè re u n sen s ra t i onn el , e t j e n
’
a i
pas b eso i n de vous rappeler que , pour fa c i l i ter l ’acco uchemen t , l e s Or i en taux fon t usage de toutes sor tes de charm es . C omparez auss i p . 2 54 , l . 4 .
Ibid . , I l . Boul . comme avez s i b i en c o rr igé .
Ibid . , 15 . Boul . comme j ’a i fa i t impr imer .Ibid . , 25 . Ce
LE5 Lis .l est a uss i a l té ré dans Boul . ,
qu i por te ŒAL5 ‘
LA .
P . 250 , l . 7 . S i vous av iez b i e n voul u vous en tenir
à ma n ote a , où j ’a i dit que ce t hém is t i che est a l té rév ous vous ser iez épa rgné la pei n e i n u t i le d ’ i n ven te r desformes et des s ign ificat i on s qu i n ’ex i s ten t pas . Boul . n ousm et à même de corri ger la fa u te . Au l i e u deq u ’ i l don n e comme une variante s ur la m arge , i l a Œh d l .
188
C’es t i n con tes tab lemen t la véri ta ble lecon , ca r ré .pond à
c5“ L dan s l e second hém is t i che , e t tous l es au
t res mots donn en t un sen s excel len t quand on lit a i n s i .6 . o 5 5
im ) est le causa t if de ŒM e t S igni fie , par conséquen t ,rouil ler .
« Sur la terre de l ’ex i l , des rogn ures d ’a rgen t lon t roui l lé mes do ig ts , de même que mes pied s y o nt
perd u l ’hab i tude de p resser l es flancs d ’un cou rs i e r qu is ’é lanc e au ga l op . » A présen t ce t te p ièce acquier t unecer ta i n e impor tan ce h i s torique , car s i el le a é té composéeréel l emen t pa r l e fi l s d u ro i d ’Almérie , el le pro uve quec e p r in ce a va i t embrassé , après la chu te de sa m a i son ,la profess i o n d ’orfèvre , de même que l ’ava i t fa i t son cou
tempora in Fakh r ad—daula , l e fils du ro i dé trô né de SéV il le (voyez mes L oci de A bbad . , t . I , p . 5 2 1 ; Abd a l
Wâ h id , p . Ma i s la p i èce est- el le b i en de l ui ? Ne
sera i t-el le pas plu tô t de Fakh r ad-da ula ? J ’avoue que j esu i s por té à le c roi re
,car l es dé tai l s qu ’o n trou ve chez
l es h i s tori en s su r le sor t du pr i n ce d ’A lmérie (voyez m esRecherches , 1. I , p . ne n ous au tor i sen t pas à supposer qu ’ i l so i t descen du s i bas dan s la h i é ra rch i e soc ia le ,e t Macca r i semb l e s u i vre ic i u n a u te ur ma l i n formé e t qu is ’es t m ême trompé sur le n om de ce p ri nce (voyez mesRech erches , t . I , Append ice , p . L IV , LV) . Quo i qu ’ i l e nso i t , i l n ’es t pas san s impor tan ce de compare r avec l evers de n otre tex te cel u i qu i se t ro uve dan s l e poèmed’
Ibn-a l—labbana su r Fakh r ad-daula et qu i est conç u e nces t ermes@ LA süt
, Œ .xxl t s s xl . 31 xlÎ Œsw,.o
1) Vo ye z le Lexiqu e de M . La n e .
190
15 ) e t ce mo t s ign ifi e en ou tre ca che t sou terra in , prison ;
voyez le G lossa ire des m ots esp . dérivés de l’
ara be , p . 125 ,
v°
a lgibe . La l eçon que donn e Maccar i , n ’es t qu ’ une g lose .4 0 0
Ibid . ,l . 5 . (s, ta è) Ibn -Bassâ m 2£ËZ: LÀM
Ibid 1 1 (of. Add . e t Lorsque vou s a t trihu iez , i l y a d ix ans ,
la s ign ificat i on deDES au verb e
j e vous répondi s que vous aur ie z b i en d e la pei n eà la démon trer , e t vous m ’
avez écri t a l ors : «F au te d’
une
p reuve conva incan te pour m on Opin ion , j e cro i s à présen tque l e pl us sûr es t de s ’en ten i r à votre man i è re de l i ree t d ’expl i quer le vers » A présen t vous fa i tes imprimervo tre anc i en ne n ote , san s y aj oute r aucune preuve . Ai—jet ou t à fa i t t or t s i j e trouve ce t te façon d ’agi r un peué trange , e t pouvez-vou s m ’en voulo i r s i j e n
’
adopte pas
une op i n ion que vous av i e z rép ud ié e vous—même ? Au
reste , Boul . a61Ù;s>, au l i e u de
P . 265 ,l . 1 . l i sez
Ibid . , l . 4 . La b on ne leçon que j ’ai resti tuéedan s les Add . e t C orr . , es t auss i dan s Boul .Ibid 7 et n . b . Je n e nie pas l ’ex istence de la Il 6forme de ma i s ce que j e pers i s te à croi re
,c ’es t que
l ’express ion : a-3l dan s l e sen s de : i l a racon téque , » sera i t monst rueuse . Vous n ’avez n ul lemen t prouvéle contra i re , e t l ’éd i t i on de Bou lac confirme le changemen tque j ’a i proposé dan s la note b , car e l le a réel lemen tœ‘>r
1) « In Erm anglu ng e in e s üb e rzeu ge nde n B ewe ise s für das Le tztere ,
h al te ich e s j e tz t se lb st für sich e re r , b e i Ih re r Le su ng u nd D eu tn ng zu
b le ib en .»
Ibid . , 15 . ( fi n . B ou l . ŒÀW .
P . 266, l . 16 (c f. Add . e t Boul . correctemen t
Œs‘
zx i s üt.
Ibid 25 . L i sez C,w}Ïi don t W}; est une
corrup t i on .
P . 268 , l . 18 . Ma correc t i on -l e st con firmée parBoul .P . 269 ,
l . 5 . Boul . v ien t à l ’appu i de votre conj ecture
P . 2 70 ,l . 6 . Vo tre Œj = l e s t con fi rm é par Boul . e t j e
par tage à présen t vo tre opi n i on sur l e sen s de c e vers .P . 27 5 ,
l . 4 e t n . a . Boul .Ibid . ,
l . 7 . Votre obj ec t i on est fondée : l e poè te a ura i tch oi s i u n a u tre mo t que …L5 \… n s i ma m an ière de vo i ré ta i t la vér i tab l e ; ma i s c e m ot est fac i l e à t rouver , c ’es t
P . 2 7 6 ,l . 8 . ist) Boul . 6
9 .
Ibid 20 . Boul . aA=L5 , comme vou s corrigez .Ibid. ,
2 1 . Boul . aÊO"" comme vous corrigez , ma is
i l a auss i ce que vou s me semb l ez condamner avecra i son .
Ibid . ,22 . Boul . confirme m a correc t i on
P . 2 7 9 , l . 16 . La compara i son d u passagequ i se trouve pl us lo i n , p . 45 9 , mon tre que ces vers n ’on tpas é té composé s su r des arroso i rs , ma i s s ur des ga l è re s.Par con séquen t , il fau t l i re e t biffe r le n ° 8dan s l e glossa i re su r Edrîsî , p . 5 25 .
P . 280 , l . 22 . (w i ) Ibn-Bassâ m (t . I , man . de M .
Mohl , fol . 1 7 9 V°) mieux wt .
192
P. 28 1 ,l . 1 7 . J
’
a va i s déj à res t i tué la leçon des man . ,
3Lîil t , dan s mes L oci de A bbad . , t . Il l , p . 16 1 . Boul .
P . 282 ,l . 12 . Boul . con fi rme ma correc t ion e t
P . 285 ,l . 2 , ma c orrec t i on …u n .
P . 287 , l . 1 . Boul .635,comme vous corr igez .
Ibid . , 17 . Pas plus que par l e passé , j e n e pu i sadop ter l e changemen t que vous voul ez appor ter à ce verset l ’ i n terpré ta t i on s i pe u n a turel l e q ue vous en donnez .Je cro i s à présen t que l e tex te des m an . ,
qu i es t auss ice lu i de Boul . , est b on ; j e prononce
,CXL
,a>LS L
O
ŒJl S.Ï‘LÏZA sh}. l (S} : ….S
'
La
e t j e trad ui s : « Ce qu i est b i e n s i ngul i er , c ’es t que mesL5
en nem i s d isen t (en parlan t de moi ) : « C’est un impor tun ,
»
car un homme qu i se t rouve dans m a pos i t i on es t tou
j ours excusab l e s ’ i l i n s is te sur sa pr ie re . » Les verbes àl te t von t t rès-b i en en sembl e ; je m e tonne que vous n el ’ayez pas sen t i . est , comme Freytag l’a d i t avecra i son : institit et importuna s fuit (petendo et rogando) , e tcel u i qu i l e fa i t est un un imp ortun un homme
ennuy eux , car 3.. fi.3 s i gn ifie importuner , ennuy er ; voyezBoothe r sous les mots déranger , gêner , importuner , in
comm oder , peser ; Maccar i , t . I I , p . 47 2 ,l . 14 ,
p . 5 50 ,
l . 15 e t 18 , p . 5 5 6 , l . 7 ; Hoogvl i e t , L oci de Aph ta sidis ,p . 5 5 , l . 5 a f. ; Abd a l—wâ hid
,p . 15 4 ,
l . 8 . Dan s unpassage d ’ l bn-Abdalmel ic Marrécoch î , l e verbe£l se trouveéga l emen t à côté d ’un m o t déri vé du verbe E n parlan t d u médec i n Mohammed ibn—’Abdoun
, cet auteur dit
19 4
un l ong usage , est deven ue molle et l i sse . C’es t donc
,
comme vous voyez , l ’équ i va le n t d u mot bord dan s le man .
d’
Ibn-Bassam . Quan t à l ’autre m ot , i l d o i t ê trequelque lecon qu’on adopt e , car et… n e conv i en t en au
cune man i ère . Le poè te compare don c les cosses tendresdes fèves à des bordas qui , par un long usage , son t devenues auss i m i n ces que ce qu ’on appell e ma i scomme l e pron om dan s n e se la i s se pas expli
quer,j e pense qu ’ i l faut l i re en rapportan t le
pronom à e ël ë L. l l.
Ibid . ,10 e t 1 1 . Après avo i r donné votre t raduct ion
de ces deux vers,vous aj o u tez qu ’ i l sera i t superflu de
l ’expl i quer . Vos lecte urs seron t peu t-ê t re d ’un autre av i s ,car toutes l es person nes à qui j ’a i m on tré vot re traduct i on ,
m ’on t d i t qu ’el le s n ’y comprena i e n t ab sol umen t r ien .
Pour ma par t , j e sa i s par la note que vous m ’
avez communiquée i l y a d i x ans ce que vous avez voul u d ire , e tj e soupçon n e auss i que vou s avez suppr imé vo tre expl i cat i on par respect pour la b i en séance . Je croi s b i en fa i reen la cons i déran t comme non aven u e , e t j e tâ ch era i d ’ i nt erpré ter à mon t ou r l es vers don t i l s ’agi t . Ce son t ,comme j e vous l ’ai é cr i t dan s l e t emps , le s deux dern iersd ’un poèm e qui
,dan s l e m an . d
’
Oxford d’
Ibn-Bassâ m , ena h ui t . Ma lheureusemen t j e n ’ava i s pas l e s au tres , etcomme i l n ’y ava i t là—has person ne qui p ti t me t ran scri reune dem i-page d ’a rab e , j ’a i dû a ttendre ,
pour en obten i rla cep ie , j usqu ’à ce que M . de Goeje a l l â t explorer lesm an . de la Bodléienne . Sa copi e n ous déb a rrasse d ’abordde ce ou Le m an . por te 3. 3} .n (avec les
9 5
voyel les) , c ’est-à-d i re le par t i c ipe de la V…" forme du verbefil
, e t l e vers qu i précède m on tre que ce tte lec on est la
véri tab le . Les vo ic i tous les de ux :3 . Ê}èi. Œ. l s
,l,i â î L. .a
L,iSf.l lt; œ"’
l Ç t.. 15 1
Comme les c i nq prem iers ve rs son t é ro t iques , i l fau t tradu ire ceux—c i de ce t te ma n i è re : « 0 mes deux amis
,pres
sez—moi qua nd i l s ’agi t de l ’amour , m a i s n e me pressezpas de b oi re le v i n excel lent de Co trobbo l. Quand je vo i sl es coupes de l ’amour , j e n e su i s pas len t à les bo i re .
»
San s dou te la l ia i son en tre ces deux vers la i sse à dés i rer ;m a i s c ’est la fa u te du poè te e t l ’on vo i t a i sémen t qu ’ i lveu t d i re cec i : I l fa u t savourer à son a i se l ’excel len t v i nde Cotrobbol , m a i s quand on peut t ri ompher d ’ un e b el le ,i l faut a l le r v i te e n b esogne e t sa i s i r l ’occas ion au vol .Quan t au dern i e r ve rs
2 0 5 o
Ôxxs af. is, Ü ,,eusa
i l n e doi t pas ê tre c on si déré comme u ni é troi temen t àceux qu i précéden t et i l exige deux expl i cat ion s . La
prem ie re a pour obj e t le verb e( ,
d e s . A la I"9 forme i ls ign ifie
,en parlan t d u v i n ,
ê tre ex cel len t, et au ss i être
vieux dan s l e Câ m ou s) , parc e qu ’
ordi
nairement l es v i n s v ieux son t le s mei l leu rs ;ma i s n ous devon s la i sser ici de cô té cet te dern iè re i dée . La Il 9 forme ,qu i est l e causat if de la prem ière , s ign ifie , par consé
quen t , rendre ex cel lent , au pass i f devenir ex cellent . Le
( J O E1) Le s leço n s e t Ü
,Ôl (Bou l .) n e so n t pas m au vaises , m ais
ce l le qu e do nn e Ib n—Bassâ m me semb le m e il leu re .
196
poè te d it donc , en parlan t de l ’amour : « c ’es t un v in qu idevien t excel len t par le s ye ux , » c ’est—à-d i re , on gagne lecœur d ’ une b el l e en a ttachan t sur el le des regards tendrese t amoureux . Quan t au second hém i s t i che
,j ’avoue qu ’ i l
ava i t é té pour m oi un e én igme j usqu ’à ce que j ’en ca sse
t rouvé l ’expl ica t i on dans un e chan son bacch ique d’AbouNowâ s . Pa rlan t au cabare t ie r , ce poè te d i t (n ° 5 1 v
i
s . 6
éd . Ahlwardt)
3.=Ï—Î $ t o… :c,. ».U .Sls., L,.5.l i 8
.3.â
On vo i t fac i lemen t que l ’express i on : « l e na bidz que vosm a i n s on t expr imé , » désign e i c i l e na bidz propremen t dit ,à savo i r la l iqueur qu i « se prépa re en fa i san t i n fuser desra i s i n s secs ou des da ttes dan s de l ’eau , de man iè re à enfa i re une boi sson sucrée e t l égè remen t tan
d i s que l ’au tre express ion , qu i nous para î t s i b i zarre : « l ena bîdz des pi ed s , » désign e le v i n , pa rce qu ’o n le préparede ra i si n s qu ’on foule avec l es p ieds e t la su i t e du poèmemon tre que c ’est b i en l à l ’ i dée d u poète 3 . Nous sommesà présen t à même de com prendre l ’hémistiche chez Mac
1) D e Sacy , C hres t . a r . , t . I , p . 4 04 .
2) Il e s t pre squ e inu t ile de dire qu e Frey tag s
’e st gravemen t t rompé
e n disa n t qu e n a bidz n e se dit pa s e n pa rlan t du v in . Su iv an t le Gl os
s a i re s u r l e M a nceu r i (m an . 8 3 1 v° M ) , c
’e st e n Irâ c qu ’
o n a
dé sign é par c e t e rm e , n on—seulem en t le v in,m a is en co re de s b o isso n s
e n ivran te s d e to u te so r te . Le p lu r . 8.À x 33 l se t rou ve e n ce se n s ch e z
Ib n -a i-’Anwâ m , t . I , p . 3 2 6 , l . 1 2 .
O o
3) D an s l e 7 e ve rs , il fau t pron o n ce r l.;e
j
e t au lieu de
Lu } e t L e poè te dit qu e le v in do it ê tre très—fo r t e t p iqu an t
comm e d u po ivre .
198
P . 505 ,l . 2 1. L i sez x.>i
)351 (Boul .) e t b ifi'
ez
ma no te dan s les Add . e t Corr .P . 5 1 1 ,
l . 15 . Vous voulez l i re Lg»Lm £à -iet Boul . a n L«n£5l ; ma i s quan d on at taque un pla t avecles doigts ,
ou ne l e coup e pas . A mon av i s , l e m ot vé
r itable es t encore à t rouver . Si l ’au teur ava i t écri ti l n ’y aura i t pas de d iffi cul té .P . 5 15 , l . 15 . Boul . ŒÀàg, ,
comme vous corrigez .P . 5 22 ,
l . 7 et n . a . Je n e croi s pl us qu ’ i l manquei c i une da te . I l fau t l i re (Boul .P . 5 25 ,
l . 1 1 . Dan s l e Ganz a l-yawâ kî t
(man . 468 ,fol . 17 9 V 0) , où l ’on t rouve auss i ces vers
,
on l it Œ%xs‘
an ,1, ce qu i vau t m ieux .
P . 5 5 1 ,l . 12 . Le sen s de ce vers est… cla i r ; i l s’agi t
seulemen t de corriger l e mot a l téré . Lorsque dan s let emps vous propos iez et que vous a ttr ibuiez à ceverb e un sen s qu ’ i l n ’
a nu l lemen t , j e vous dem anda i s despreuves ; m a i s dan s votre répon se à mes obj ect i on s , vousgard i ez prudemmen t le si len ce sur cel le-c i . Ma i n tenan tvous fa i tes imprimer votre an c ien n e n ote t el le qu ’el le é ta it ,c’est-à-di re san s preuves . I l para î t don c que , pendan t d i xans ,
v ou s n ’e n avez pas t rouvé , c e don t j e n e m ’étonnepas . Boul . n ous fourn i t enfi n la lecon véri tab l e , c ’est
Ce verb e une s ign ifica t i on qu i con v ien t parfa i tem en t à n otre passage , m a i s qu i n ’est pas dan s Frey tag ,à savoi r cel le de par tir vite , s
’
en a l ler vite , sortir rapide
m en t , s’
esqu iver (Bocthor sous ce m ot) , pa sser (le même) .A i n s i Ihn—al-Kha t ib (man . de M . de Gayangos
,fol
. 15 1
ro) dit en parlan t d ’un l ion qu i é ta i t dans une cage e t
19 9
qu ’on voula i t fa ire comba t tre con tre un ta ureau :o
n
ul)f Un
"?ÜA wï ül Ou .)
UA a g
ÙLÏ
L}.—A > my U
L…ÏL} a s,
Da n sl es Mille et une nuits ( t . III , p . 284 , 6 a f. éd . Mac
nagh ten) on lit UJ J m: l‘.î l J Lñ5
îj î
L5 i) )L…, aùiä, A i l l eurs ( t . III , p . 5 16 ,
lÀ QLS“ Q ic a i &. l J LS, 0
)L4 3 L: : OÔ
OLE)? e
,L. l i ëL
_>La
Ù,t>. gfi La
,last
,.
Pl us lo i n (t . III, p . 5 22 , l . l)-»j-_ a
)Là£l i
}.Èw…i L. ts
Œl a ,.g. àæa U
n _3J. a Dan s un a u tre
endro i t (1. IV,p . 6 12 , l . au : w3LÏ
,
OLA:l ;
4 3L5”
Ü'° &
äL
_S ÜLJ . I l y a
encore dan s ce l i vre un passage qu i m e t la l eç on de Boul .a u-dessus de tou t dou te , car on y l it (t . I , p. 8 7 5 , dem .
,n ,i l €s 5
î tb î tO f
*è’ de même que dan s n otre
texte :Ju J L1
Zu J.iLf @ .3
p» m
}.Ü S
ign .» &
)e Lg.
P . 5 5 2 ,l . 10 e t 1 1 . Boul . comme dan s mon texte , ex
cepté qu ’ i l au l i e u de08.
P . 5 5 5 ,l . 1 5 . Le prem ier hém isti ch e doi t ê tre c omme
dans Boul savoi r :
w o )
U.
‘
s g ŒÀU | ;Ls x
'
Comparez t . I , p . 120 ,dem . l i gn e .
Ibid . ,22 . La leçon de La . , … l Î> es t auss i dan s
Boul . et j e c ro i s à présen t qu ’e l l e est la vér i table .—Boul .
1) Il y ava it dan s ce passage p lu sie urs fau te s qu e j ai co rrigées à
l ’aide du man . de Be rlin .
200
km ).—ii , comme j ’a i fa i t impr imer . Quan t au m ot qu i
su it , j e ne songe pl us à défendre le i ta…“ ‘1 des m an . et
j’
adop te volon t i ers votre c orrec t ion xtÊ2. it , qu i est confir
mée par Boul . ; ma i s c omme vous n e l ’avez pas j ust i fiée ,
j e cro i s devoi r l e fa i re à votre place . Le termesu iv i d e la prépos i ti on s ’em plo i e dan s l ’aoception dechargé de , couvert de , pro/
”
usém ent orné de . A i n s i on l i tdan s un passage d’ l hn-Khaldoun que c i te n otre auteu r (t .I , p . 249 , l . Ü
..tæt»@
«w—e m,t5 eta .
A i l l eurs (Histoire des B erbères , t . I , p . 435 , l . 6 a i ldit ne n: m b}….>L.s d i
fi s .” Voye z auss i , dan s le m ême ouvrage , t .II
,p . 5 4 , l . 2 a f. On t rouve auss i seu l dan s l e
sen s de profusément orné d’
or . A i n s i on l i t chez Nowairi(H ist . d
’
Afrique , m an . de Pa ri s n ° 7 0 2 , fol . 29… i säLs u it. Chez Macrîz î (dan s Kosegar ten , Chrestom .
,
p . 1 17 dem . l . , e t p . 120 , l . W ëtè go . L
’
adject if
J…«su s emploie dans la même accep t i on . On l i t ch ez IhnHaiy â n (apud Ibn-Bassâ m ,
t . III , m an . de Gotha ,fol . 4
“ M ? @5,wel»,
‘J.sä
‘
3 dja—
UA ç;»î J b l.4 .ê . Dan s
un passage d’Ibn—B assâ m que c i te n otre auteur (t . I I ,p . 413 , l . 4) on t rouve : M Lç
LS ..i
g r“ ? a.:ie . En cc
p ian t a i l l eurs (t . I , p . 23 1 l . 4) u n passage d ’Ibn—Kha ldoun , Maccar i a om is les mo ts J Lñ‘
3 qu i se trouven tdan s l e man . quas i-autograph e après x. 53.5 Ch ezl bn-al-Khat ib (man . de M . de Gayangos , fol . 15 7 r
°
) onl it : &l a 55.
‘
3 ääl2 im , 8)l.5
Ü. A LSM—35 &A Jl J —m . ï l M .
202
P . 5 5 5 ,l . 9 . Boul .
015
, comme vous corrigez .Ibid . ,
1 7 . Le mo t dou teux estULg dan s Boul .
P . 5 5 6 l . 9 . Vous avez i n terpré té ce vers d ’une man 1e reb i en é trange . Commen t avez—vous pu t rad ui re par
« en s ign e de refus ?» Commen t avez-vous p u penser quefi le,» M .L3 s ign i fie : « el l e m ’
a t ourné l e dos ? » Vous sa
vez auss i b ien que moi que dés ign e préc isémen t l econ tra i re et qu ’ i l est i mposs ib le de l e j o i ndre à
}glâu . Efi
ñu la con t i n uat i on d u vers dan s la l i gn e 1 1 ne s ’a ccordepas du tou t avec l e se n s que vous a vez a ttribué à cel u idon t i l s ’agi t . J ’accept e cependan t une seule chose de vot re i n terpré tat i on , à savo i r que l e fém i n i n dan s
l
e
e tc . ,se rapporte à la même person ne que le m ascul i n dan s
ma i s au reste j e croi s devoi r en tend rel e vers d ’ une t out aut re facon . I l est b i en m o i ns i nn ocen t que vous n e l ’avez pen sé , et j e n
’
osera is pas l’
expli
quer en fran ça i s ; m a i s j e m e serv i ra i de l ’arabe ; c ’es t unelangue qu i , comme le lat i n , b rave l ’hon nê te té . Oommencon s par corr i ger le de rn ier mot ! 11 doi t ê treCette correcti on se j us tifie
,en p rem ier l i eu par l ewl $ \xm l
qu i précède , car vous savez que les mots dérivés de larac i ne
Ù> son t j o in ts con stammen t à ceux qu i dé ri ven t
de la raci n e S. e t en secon d l i e u par la paron omase(hirmahä dans ce vers , et dj i ï
‘fltühâ dan s l ’au tre) . Vousosavez ce que c ’est quan d on di t d ’une femme : wts u:…1
o O c ’es t tres-mauvai s ; cependan t el le peut fa i re encore
05
p i s , e t c ’es t ce que le j uif voula i t , m a i s e l le n e le voula i tpas; de là l ’express ion ÀIË: S Liz» (car c ’es t a i n s i q u’ i l fautl i re) ;;Àl Ü
.o, ou i , el le le perme t ta i t ; m a i s
n on pas ;3 par conséquen t &1.L5 . A bon en tendeurpe u de paroles , e t j e c roi s m ’
ê tre expr imé assez cla i rem en t . Ma i n tenan t la con t i n ua t i o n d u vers n e présen tepl us r i en d ’obscur , et i l se ra i t i n u t i le d ’expl iquer ce qu ’ i lfau t en tendre sous l e pe t i t l um i na i re qu i fa i t d u tor t augrand .
P . 17 e t n . a . Boul . a l es q ua tre prem iers motsde ce vers comme j e les a i fa i t imprimer , et ensu i te
L5.31.
Ibid . , 22 . (ii Boul . auss i la bonn e leçonque vous avez tro uvée dan s B .
P . 5 60 , l . 10 . L’éd i teur égyp t i e n a é té choqué
, avecra i son j e c ro i s , de ce
r.g,,è 5
3252 L5 )
Ô. s L.è. I l d i td ’ab ord q u ’un au tre m an . por te
55 Œ) ô. a pu i s
i l propose de l i re :äd i Œ) t}. a , s
>Lg5 , ou quelque chose desemblab le -3 Peu t-ê tre
L5)-À s Lg5 sera i t l e
p l u s s imple .P . 366 ,
l . 1 1 . Je n e songe pl us à con tes ter que—æ es t la vér i tab le leç on ; j ’ohservera i seulemen t que
vous avez n égl igé de don ner la meil le ure preuve à l ’app u i d e votre op i n ion ; e l le se trouve chez no tre auteur ,
t . I , p . 3 70 , l . 9 , où on l i t : ä…3.w Ü.o
e t d ’ un autre côté , j e pers i ste à croire que , s i on l i tu 0
euh… , l e verb e n e conv1en t pas . Vous avezO o
hé5 1té a l e changer en W ; ma i s I l est t res-perm i s d e
204
l e fa i re , car cet te lecon se t rouve n on-seulemen t dansBoul . , ma i s aussi , avec t outes le s voyel les , dan s l e t rèsb on man . de Homa idî '
que possède la Bib l ioth èque d’Oxford(fol . 28P . 37 9 , l . 16 e t u . b . On peu t b ien conserve r le 3
des man . , ma i s a l ors i l fau t b ifler avan tOK.; le mot
qu i n ’es t pas dan s Boul .Ibid. , 19 . Boul . confi rme ma correct ionP . 589 , l . 18 e t n . a . Boul . L.5Lu , comme j ’a i corrigé .P 5 90 , I. 18—20 . Ce passage peu t ê tre corr igé d ’ uneman 1ere b ien pl us s imple que vous n e l ’avez proposé . A
la l igne 19 i l fau t l i re avec O .
)L. JÇ 31 e t à la l igne
20 , avec Bou] LL», au l ieu de ce L. . dépend de
)Â Ë Kg l.4.5 , don t
)L£31
U” n e dépend pas .
Ibid 24 . l i sez_,i
P . 595 , l . 6 . Boul . QQ ) , comme j ’ai corr igé .
SECONDE PARTIE ,PUBLIÉE PAR M . DUGAT .
P . 5 95 , l . 9 . a.:a.3 L.» au t:>Lä es t san s dou te une faute;ma i s l e m an . L. me met à même de la c orriger d ’ un eautre man 1ere que vous l ’avez fa i t e n su ivan t l’éd it . deBoulac . I l n ’
a pas ægL:3-Lâ et ce mot es t en effet de trop .Quand on le suppr ime , l e xÎ=3 dépend de dans lal igne 6 .
206
ma i res , m a i s qu i s ign ifie prépara teur , vendeur de sflngesvoyez à ce suj e t mes remarques dan s le J ourn . a sia t . de186 9 , t . II , p . 16 1—16 5 . Si le dern ier m o t de ce versé ta i t réel lemen t comme vous voul ez l i re avec Boul . ,i l faudra i t écr i re , à cause de la mesure , M it
, au l i eude ce que vous avez oub l ié de remarquer ; m a i sl’
eXpl ica tion de cette p ièc e que j ’a i don née dan s le recue i lque j e v ien s de c i ter , p . 199 , mon t re que la leconest i nadm i ss ib l e et qu ’ i l n e peu t ê tre quest i on ic i d ’une«m a i n dro i te . » La r ime n ’ex i ge pas non pl us ce mot ,comme vous l ’avez cru , car cel le en nih i suffi t .P . 405 ,
l . 1 1 . l i se z leur ia
lousie . Pl us lo i n , p . 5 40 , l . 13 et 14 ,on t rouve la Ve
forme , sui v i e de la prépos i t i on dan s le sen s de ê trej a loux de.
P . 40 7 , l . 5 . (lOJ J ) l i sezP . 412 , l . 2 1 . (,lau ) l i se z 1,lazs au duel , car
i l s ’agi t de deux person nes .P . 415 , l . 5 . l i sez avec Boul . et le man .
d’
Ibn-Bassâ m (t . I , m an . de M . M oh l , fol . 7 8 oùl ’cn
t rouve tout ce passage avec p l us i eurs varian tes .Ibid . , 7 . I l fau t prononcer s
ix} , et sub st i t uer à
l e mot (cf. n . e) , comme on t rouve dans Boul . e tchez Ihn-Bassâ m .
Ibid . , l . 1 7 . (M M O l i sez &%J LÂ . è—H (Boul . e t Ibn—Bas
sam) . Au l i e u de i l faut certa i nemen t l i re s,L£>
avec Boul . Ce tte lec on e st encore très—reconna i ssable dansl egus . d u m an . d
’
Ibn-Bassâ m .
Ibid . , 18 . Au l i eu de Œ. A… , Boul . a La… ; m a i s j e
20 7
c ro i s devoi r l i re L… avec Ibn-Bassam , ou , ce qu i revien tau même , comme dans les deux man . c i té s dan s lan ote j .
Ibid ., 19 . Ecr ivez
Ibid . , 20 . (s Llà t ll) l i sez (L . , Boul . , Ibn—Bass â m ) .
P . 4 15 , l . 19 . La sub st i tu t i o n de àL5
.11: est auss iau tori sée par l e man . d
’
Ibn—Bassâ m (t . I , m an . de M .
Moh l , fol . 2 25P . 417 , l . 9 . La leç on des man . de Maccar i
,dan s la
no te d , est la seule vér i tab le , c omme le prouve l e versqu i su i t . C el le d u B ad . est proven ue du vers qu ’on lità la l ign e 13 .
Ibid n . e . L’éd i teu r s ’es t t rompé ici , car l e B aydn a
Ù)5LA .
P . 4 19 , l . 2 et 10 . L . a auss i correc temen t e t
P . 42 1 l . 15 . L i sez ŒÂ »o.Ë}Ë (L . et
Ibid . ,2 5 .
rtœ@$ i C omme les
serpen ts n ’on t pas la c ou tume de fa i re de l ongs voyagespar mon ts e t par vaux , t and i s q u ’ on emplo ie les chameauxà cet usage , j e cro i s devo i r l i re avec Boul . : —a g i;M b
”
.
Pour la VIIIe forme de dan s le sen s de peragravit ,compa rez Ihn—Djoha ir ,
p . 5 9 ,l . 15 p . 225 , p . 5 20 ,
l . 20 ; Ibn—Khaldoun ,Hist . des B erbères , t . I , p . 6 46 ,
l . 4 a f. ; l e m ême dans la t raduc t i o n fran ça i se des Proie
'
gomènes , t . I , p . X L , 3" vers . On l ’emploi e en parlan t
d ’endroi ts dangereux et où i l est fac i le de s ’égarer .P . 422 , l . 6 . ne se dit pas , tand i s que
208
@ , àxal t , comme on lit dan s P . e t Boul . , est l ’épithê te cons tan te du musc ; voyez , par exemp le , de Sacy , ChreÏst .
nr . ,t . I I , p . F1, 1. 1 1 et comparez ce vers que c i te al
Fa th (Ca lâ y id , man . 306 , t . I I , p . 5 5)
aùLh
_.güt L@Î Â .»
v,,n1 55 L
Ïl;à=) U
a 9..u
P . 423 , l . 2 2. L . comme Boul .P . 425 ,
l . 10 . (…A ñi l L9. 5) l i sez 6 5
P . 428 , l . 20 e t 2 1 . Le prem ier hém ist i che es t che zIbn—Bassâ m (t . I , man . de M . Moh l , fol . 23 1
s 1.> en sui te i l aUK3 , au l i e u de e t en
fin ». za , à la place deP . 45 1 ,
l . 8 . Le changemen t de -1 (auss i dan sB oul .) en ê… u ,
qu i est san s dou te d e vou s , n e doit pasê tre accepté , car chez les Magrib ins ce verb e est 8
53, e t
n on pas Ce qu i le prouve , c ’es t un pa ssage d’a lFath (Ca ldy id , p . 58 , l . 4 a f. éd . de Paris) , qu i se t rouveaussi chez Maccar i (t . I , p . 442 , l . 15) e t où on l i t.câ
_ Â _ Ï-l63L.»3 1 et»,
‘
C…x .æfs
ztjii Vous voyez que la
r im e s ’oppose i c i au ch angemen t que vous voulez fa i re .Dans les man . d
’
Edrisî j’
a i auss i t rouvé con stammen tt
.t5 s.
Ai n s i o n l i t ch ez cet auteur (Cl im . III , Sect . ;. î .g a.. i
m ts A i l le urs (C l im . V, Sec t . sf}: M LS
Un peu pl us l o i n M .» M LB Lee,.
Et encore (C l im . V , Sect . ».s s s o_,w .
P. 457 , l . 14 . sera i t ici un cont re-sen s ; i l fautL1a ,
comme dan s l e Ma tmah P .
Ibid 2 1 . l i sezrœ.3 avec les deux man . du
Ma tmah .
2 10
qu a la por te de la Ca ’b a , a t trapa la jambe d ’ une femmequ ’on t i ra i t en haut , a u &. Â Î x ï, sëLn l
°
ê,n W
J .î t> Un . 0n l ’emplo ie auss i dan s le sen s de toucher;
i'oyez Becrî , p . 121 dem . Ibn—Djobair , p . 9 1
p . 25 5 , l . '
7 ; H ist . des B erbères , t . I I , p . 425 ,l . 9 a i. ;
l ho -a l-’
Auwâ m ,t . II , p . 6 , l . 15 , p . 7 , l . 8 .
Ibid . ,20 . l i sez Q
JËÂ
, comme dan s l e Ma tmah
P . (ce passage m anque dan s le Ma im . 5,5 …33i Q } A
est j us temen t l’eXpression qu i conv ien t pour un mulet , tand i s que la l eçon d u texte sera i t v ide de sen s . Quan t auxmots qu i su i ven t , j ’avoue comme vous que j e ne les comprends pas ; i l s m e semb len t a l té ré s .P . 442 , l . 5 .
Z}u n e don n e pas de sen s . Je l i s
Ibid . ,l . 4 . La vér i tab le leçon , 9
}läg , est auss i dan s
l e Ma tmah L.
Ibid . , 9 . Vo tre conj ec ture m e sembl e malheureuse
,car vous a t tr ibuez à ce verbe une s i gn ifica t i on qu ’ i l
n’
a pas e t qu i , s’ i l l ’ava it , n e con vi end ra i t pas . La véritable l econ est cel l e d u Ma tmah dan s la n ote e , à savoir
« La Mor t ouvri t sa gueule pour l e dévore r; m a i sle dest i n ne la seconda pas ;» c ’es t-à-d i re , c omme le montre la compara i son de ce qu i su i t : pou s ’en fa l l ut qu ’ i lne fût condamné à mort , m a i s le des t i n en aya nt décidéau tremen t , i l en [u t qu i t te pour la pri son .
Ibid 19 . Les conj ec ture s qu e vous proposez su r cever s m e semb l en t i nadmi ss ib les . -s
, comme vous voulezl i re
,n e s ign i fie jam a i s sa … sL…o , et vous ne me semb le z
2 1 1
pas avoi r compris ce tte dern ie re exmessiou , car el le s ignifie un gra nd n om bre d
’
ea ux ,comme on dit
e t $C)—c ç l)g l
, bea ucoup de vil les , de portes (Edri s i , p . 7 6 ,
2 a f. , p . 19 7 , l . 4 a f. éd . de Leyde) . Quan t à lal ie forme de i l fa ud ra i t d ’a bord prouver q u ’e lle ex i s te .Pour ma pa r t , j e cro i s devo i r l i re
. 5 0 B
0 6 0
«f … o"
r‘ W +
Le mot a‘
.L5 es t expl iqué par B e i sh e (ap ud F rey tag) de ce t tem an i è re : « fovea i n mon te , u b i aqua pl uv ia l i s res tagna t ,»e t ce tte i n terpré ta t i on est b onne , pourvu qu ’on re tran ch eles mots in m onte e t p lu via lis , comme le prouve ce passage de Becri (p . 1 7 2 , l . O
Arég i
/, la
L55 L,3t,
forme de65 9 , dan s le sens d e sup erstes fa it (voyez Lane) ,
se trouve , par exemple , dans un vers que c i te Maccar i( t . II , p . 285 , l . 9 ) e t dans u n d i plôme pub l ié par deSacy dan s le s Mémoires de l ’Académ ie des inscrip tions , t .
IX,p . 47 1 l . 6 , où on lit 6 . 9 . .M 5l J LA t , propremen t
« la somme qu i reste , » c ’est—à -d i re : « la somme don t i lreste déb iteu r . » Ce est en ha rmon ie avec l e xt.md u vers qu i p récède . Enfin , l e dern ie r mo t d u vers es t
Œ î . £-m -4 , non -seulemen t dan s Boul . , ma i s auss i dan s leMa tmah .
P . 445 , l . 14 . Ls‘
z29 pour L.É.m > n ’es t qu ’un lapsus calami de l ’éd i teur ; L . e t l e Ma tmah on t la b on ne lecon .
P . 448 , l . 17 . I l ne faut pas sub st i tuer l e LSl°
14 *
de Boul . à la l eç on d u tex te653 qu i es t confi rmée
,
n on -seulemen t par l es man . de Maccar i , m a i s auss i part ro is man . du Ma tmah (P L . e t l es fragmen ts de cet o uvrage à la fi n du Ier vol ume d ’ l bn—Bassâ m) , e t qu i seul edonne un sen s ra i so n nab l e . « Quand j e m e su i s la issécondui re par l es c i rc on stan ces vers un homme tel queYahyâ , a l o rs , j e l e j ure , j e n e d i ss im ule pas l e ressen t imen t que j e garde d ’ un e offen se , » c ’es t-à-d ire : quand ledest i n m
’
a condu i t vers u n homme auss i n obl e et a ussip u i ssan t que Yahyâ , j e n e con t i en s pas mon ressen t imen t ,m a i s j e l e la i sse éclater e t j e pu n is cel u i qui m ’
a offen sé ,parc e que j e su i s assuré de l ’appu i e t de la pro tect i on dem on b i en fa iteu r . Ce tte t raduct i o n m e semble s imple e t
cla i re , t and i s que selon la vô tre , s i t ou tefo i s el le p résen teu n sen s , ce don t j e n e su i s pas sûr , l e poè te , au l i e u defa i re l ’éloge de son patron , l u i rep roch era i t d ’ un e facongross iè re son m anque de force mora le .P . 449 , l . 5 . au l i e u de 6 5 semble de n ouveau un
lapsus ca lami de l ’éd i teur ; L . e t l e Ma tmah ont la bonn eleçon .
Ibid. , 19 . La vér i tab l e leçon , se trouve auss idan s L dan s le Ma tmah P . e t dan s les deux m an . quej’
ai c i té s t . II , p . 148 ,n . c .
P . 45 2 ,l . 14 . t , à-L m l Œ-it a î…sl Je m ’é ton n e
que , dan s vos n ouvel les observa t i on s , vous n e soyez pasreven u sur l es deux conj ectu res que vous avez présen téessu r ces mo ts , e t que ce t te fo i s en core vous n e vous soyezpas aperç u que XA n ’es t pas :u l
, comme vous prononcez ,- J a £5m ai s “
&a l , de qu1 expr ime l ’adm ira t ion . …,à-t. … ä. g l ,
2 14
langue arab e le mot hadj ar , propremen t p ierre , s ’emplo ie ,comme S tein en a l lemand et p ierre en frança i s , pou r dés igner un ch â teau (p . e . la forteresse a l sac ien ne Lü tze ls te i n en a l lemand , la Pet i te-Pierre en frança i s) . A i n s i onlit dan s l e Cartâ s , p . 5 9 , l . 8 : M i
ie tl a—A l
« son ch â teau qui porta i t l e nom de Geyerstein ,» comme
on t radui ra i t en a l lemand . Vous voyez don c qu’ i l n ’y a
r i en à changer dan s l e texte et qu ’en sub st i tuan t &Êi ll tà W i , vous avez é té mal i n spiré , car de cet te man iè renous ob t i en dr i on s cet te ph rase r id i cule : « A ses ancê tresappar t i e n t l e n igaud con n u sous le nom de la pierre d’Ab ou-Khâ lid ,
» san s comp ter que , selon l ’usage , un homm e
n e peu t pas ê tre l e suj et de 5 521…
P . Dan s les Add . e t Corr . , vous voulezmett re u n mot turc dan s la bouche d ’un poè te espagnold u XI"’ s iècl e c ’est une idée b i en s ingul i ère e t i l m e semble qu ’ i l vaut m ie ux n e pas fa i re d e conj ec tures que d ’enfa i re de tel les . Dan s vos nouvel les obser va t i on s , vous d ites que l e
êx>fde Boul . ne donn e pas de sens . Je cr ois
au con tra ire que cette leçon , don t j e recon na i s la t racedan s L es t excel len te .
61 5 1
{.e t
/JB s ign ifie les p ennes an
térieures des a iles , les p ennes prima ires; vous pourrez vousen conva i ncre en con sul tan t de Sacy , Chrest . nr . , t . II ,p . 5 7 1 , e t l e s scol i es sur le 12 9 vers d ’An tara , p . 86 éd .
Men il . Au res te , j e v ous recommande encore le m o t sols»,
dan s c e vers . Vous l ’avez passé so us s i l ence,ma i s i l
n ’ex i st e pas .
P . 462 , l . L’éd i te ur a
°
négligé de rem arquer que le
2 15
poè te fa i t ici a l l us i on à ces paroles d u Coran (sour . 7 ,
vs . . b LÜ5 Ül f.…
ÛL‘
P . 466 ,l . 1 1 . Il n e fa u t pas changer ü
' ° e n6
-5,
comme vous le voulez , ma i s a u l i e u de e t de i lfau t l i re e t voyez pl us hau t m a n o te sur t . II ,p . 166 ,
l . 10 . Ic i l e cop is te du man . L . ava i t d ’abordéc ri t W ; ma i s s
’
apercevan t auss i tô t de son erreu r,i l a
b itfé u n poi n t , e t en su i te i l a écri t correc temen tf"
Ibid 1 6 . Ce vers é tan t u n peu abrupte , quand onl e lit tel qu ’ i l s e t rouve dan s l ’éd i t i on , j ’a ime m ieux su ivre Boul . , qu i n ’
a pas 0 1 5 , e t qu i don ne au l i e u dePJ . Au reste , est pou r comme on litdan s Boul .P. 469 ,
l . 8 . L . e t Boul . ce q u i es tbon , car la Il (! forme s ’emplo ie réel lemen t dans l ’acceptionque l e vers exige ; voyez mes L oci de Abbad . ,
t . III , p . 87 ,
7 . Au l i e u de LÏL= ,j e cro i s devoi r l i re til l avec Boul .
et les qua tre man . c i té s dan s la n o te b Œ) _5 1.3 dan sl e prem i er hém i s t i ch e) .Ibid 15 . L . a auss iP . 487 , l . 1 e t 2 . Vous avez supposé avec ra i son que
j e préférera i s vot re i n terpré ta t i on de ces deux vers à cel leque j ’a i don née dan s mes Abbad ides .P . 49 5 ,
l . 20 . Les mo ts)â x> La l 515 14w
,L£z. 3 sera i en t
ab sol umen t v ides de sen s . I l faut l i re avec L . e t Boulj
‘
a ? bl >î kä o,Ls
‘
z3 , « l ’orig i ne pa tern el le d ’Abou-Dja’ faret son orig i n e m a tern el le son t d iffé ren tes : l ’une est noble
,
l ’autre b asse . » Quan t au dern ier mo t du vers,j ’ava i s
2 16
auss i no té qu ’ i l fau t con server la l ec on du tex te . J’
ohser
vera i tou tefoi s que vo tre anc ien ne op ini on peut se défendre . Les d ic t i onna i res n ’on t u i la VIIe n i la VIIIe formede d—fwä m a i s j e t rouve la dern iè re chez Ibn-a l-’Anwâ m ,
I , p . 7 a f. : M l, U:o)
ël lÜ
‘° 31: L» .
P . 49 9 , l . 12 . ( fi l» ) l i sez Œs l'
; derri ere m oi.
P . 5 06 , l . 10 . Permet tez-moi de vous fa i re remarquerque vou s vous ê tes s i ngul i è remen t trompé dan s l’ in terpréta t i on de ces pa roles . Vous fa i tes d i re à Ibn-Sa ’ îd : « Ce
poè te qu i demande à me voi r , est peut-ê t re l e v i z i r Ibn’
Amm â r;» après quo i l ’auteu r aj outera i t en paren thèse« car i l (Ibn—’Amm â r) é ta i t con n u de tou t le m onde . » Les
mot s LA «M l 0 1 5,n e peuven t pas s ign ifier cela ;
m a i s ce qu i es t plus grave , c ’es t l ’anachronisme que vousfa i tes commettre par [bn—Sa ’ i d , car cel u i-c i n e pouva its ’a t tendre à une v is i te d’Ibn-’Ammâ r , ce t h omme célèbreé tan t mor t depu i s pl us de quaran te ans . Vous semb lezl ’avoi r i gnoré , m a i s peu t-ê tre voudrez-vou s b ie n croi requ’ l ho—Sa ’ i d n e l ’ignorait pas . I l d i t tou t au tre chose quece que vous l u i fa i tes d i re . C omme le poè te qu i se présent e chez l u i é ta i t de S i l ves , endro i t qu i ava i t au ss i vunaî tre Ibn-’Amm â r , e t qu ’ i l sava i t composer de b on s vers ,de même que ce dern ie r
,i l s ’écrie en pla isan tan t : « C
’estpeu t-être le v i z i r Ibn-’Amm â r qui est revenu au monde(qu i a é té ressusc i té) ; i n t rodu isez-le b i en v ite auprès demoi ! » Vous voyez don c que l e t ext e es t correc t e t qu ’ i lne fau t n ul lemen t subst i tuer à 0P . 509 , l . 5 . De mon cô té , j ’ava i s n oté auss i que la
I‘fe forme de s ’empl oi e , au l i e u de la IVe
,dans le sen s
d ’a llumer , e t que vous avez eu tor t de la changer dan s
2 18‘
P. de Alca la le tradui t par aqueæar a otro , e t _b Ï……Ê est
chez l u i : enoj oso a otro e t inquietador . Vous voyez quece tte s ign ifica t i on conv i ent parfa itemen t au passage don ti l s ’agi t . Dan s un autre , qu i se trouve dan s l ’A/chbâ ‘rmadj mou
’
a (p . 12 1 , l . 5 éd . L afuen te) , e t où on l i t enparlan t d ’
un s ul tan :Un .h t…A l Lu ÂS …L15l &1‘ol U n
ÙL{
ml s , j e croi s qu ’ i l fau t p rononcer auss i . b ÏÀ Â J
et t radui re : l e s gouverneurs qu i t ourmen ta i en t , oppr ima i en tles suj ets .P . 5 10 , Vous avez la i ssé s ubsi ster i c i un con
tre-sen s a ssez r id i cule . I l est quest i o n d’ un excel lent ar
ch itecte e t qu i conna i ssa i t son art mieux qu ’
aucun autre ,et cependan t cet homme , s i l ’on adepte la l eçon du t exte ,aura i t é té en même t emps un J.. à -i . a ,
u n n igaud . En
déplaçan t u n seu l poin t , on ob t i en t un sen s b ie n d ifféren tet parfa i temen t ra i son nab le . C
’es t à -a.… (fi n : o uqu ’ i l faut l i re , in tel ligent , et a fin de prouver que ce term es ’emploie réel lemen t dans cet te accep t io n
,j e c i tera i les
deux passages d ’l bn—Ha iy â n que j ’ai pub l ié s dans mes L ocide A bbadidis , t . I , p . 225 , l . e t dan s mon Cata l ogue ,t . I , p . 9 .
P . 5 12 , l . 18 . Je n e pu i s n i expl iquer , u i corr iger ceJe m e b orn era i don c à ob server que votre conj ee
t ure , 55 19 , me semb le 1nadmrsmble ,d ’abord parce que
l es cop i stes n ’aura i en t pas a l téré un met auss i con n u ,
en su i te parce qu ’ i l n e peut ê tre quest i on i c i d ’ une m er .
Le sen s ex ige un m o t qu i dés igne u n corps cé leste,l e
solei l, la nouvel le lun e , ou une étoi le .
2 19
P . 5 15 ,l . 1 . On dit sa ns dou te aw x . ÂI, comme
vous voulez l ire avec Bou ] A i n s i on lit W x:,l> dan s
l e même sen s,1. II, p . 5 5 2 , l . 20 . Ma i s la lecon du
t ex te es t b onne auss i , ca r on tro uve chez lbn- ll a iyâ u(apud l bn- Bassdm , t . III , m an . de Go tha , fol . 4 r
°
)
Œj n lx ll ë )â A L4 9 3
_, 03 À À%A L5 1À -A . £ L4 %5;
Ç l VOUS) , Evoyez don c qu ’on peu t di re “
xx l , de même qu ’on ditXÀgA &LÀ
P . 5 16 ,l . 4 . Me ttez un aprè s e t un après
Ibid . ,15 . La b onn e leç on , a igd£ï , es t a uss i dan s L .
P . 5 20 ,l . 1 .
85 151 5 55… L.»
fil, , avec les va r ian
tes e.< e t (Boul . ) On n e peu t pas l i re uS d…,
comme vous l e proposez , car êds59Ê…J t n e se dit
pas . Le verb e «£ a … s ’emplo i e d ’une au tre m an 1e re . Ond i t dan s l e se ns de a n
)—J, e t
OL£J t l&\æ Ç
dan s cel u i de “
i (Zamakhcharî , Asa‘
s a l-ba lâ gha ) . On
dit auss i : au 5Ï= O.:u (Ihn-al-Kha t ib , m an .
de M . de Gayangos , fol . 22 v°
) et : x; al fa… o.. s
(ibid . , fol . 7 2 L a vér i tabl e l eçon est ci . Le verbeai m , avec l e edd, s ’ emplo ie e n parlan t d ’ un b ru i t , d’unson , qu i frappe l es ore i l l es . A i n si on l i t chez Ibn-Haiyâ n(ap ud Ibn—Bassâ m , t III , man . de Gotha ,
fo l . 48 v°
)
255 3 31)t , àt…ï t L,, d
a ns dj.h
UsŒi l.
A i l l eurs (ibid . , fol . 141 en parlan t d ’un man ifeste d ucal i fe qu i fu t l u dan s la grande mosquée : èL…>l t &.Âa .ä
220
JM S—l lU” …lwb . Plus lo i n (ibid . , fol . 25 2 W) : (
. lâ
Œ.sU ,
.1…ns . es” . w155 . s i&t……
e£ lü> Voyez auss i Ibn-Djob air , p . 146 ,
l . 1 1 , p . 15 7 , l . 7 , e t mes L oci de Abbad . , t . II , p . 196 ,
l . 9 2wlm J lJ.m l au a..æl l f L4 .) &;u w &Zo L4.XÊ . Mai s
au l i eu de e.î m ,on pron once et o n écri t auss i avec
l e sî n , comme Frey tag l ’a n oté d ’aprè s u n passage desMille et une nuits , ou pl utô t , car il n ’ava i t pas lu cerecue i l , d ’après le Glossa i re de Hab i cht , e t chez Ihn-Djobairon t rouve deux foi s l ’express i on én l…. ll QL… ,
p . 5 6 , l . 8e t p . 2 58 ,
dem . Il es t vra i que dan s l edition on litma i s comme ce sera i t un con tre-sen s , i l est cer ta i n
qu ’ i l fau t corriger de la m an i è re que j ’ai i nd iquée .Ibid . ,
4 . . . î o l, (d i st i nc temen t dan s L .) n ’es t pas
a 0 5 oma i s L edite ur égyptien ne s ’yest pas t rompé ,
car i l a aj ou té le techdî d . L e verbe qu iprécède doi t se prononcer , par conséquen t : ) .Âgé .P . 5 22 , l . 18 . Vous aurie z pu vous épargner la pei ne
de n oter la l eçon de Boul .â\ à L4—ii 0 91, car c ’es t une fau te
e t l e person nage don t i l s ’agi t i c i , est b i en c on nu ; voyez ,par exemple , l e s Orien ta lia , t . I , p . 42 2 ,
n° 5 5 .
P . 5 56 , l . 25 . De vos deux anc ien nes conj ectures , vouspréférez à présen t la seconde , were e t j e su i s du mêmeav i s . J
’
observerai seulemen t que v ous vous ê tes t rompéen d isan t , dan s vos nouvel les observat i o n s que l ’ex is tencede la Il 9 forme de ne peu t pas ê tre prouvée . P . de
: i l ,
Al ca la donne sous a torçonado , et six . dan s l e
2 22
que s l>À l l (voyez Lane) , car l ’élifes t dan s tou s les man .
du Ca ldgid à l ’except i o n d ’un seul,et dan s ceux de
Maccari.P . 5 7 2 , l . 17 . s SL:> J Ln .… l Vous vou l e z
l i re avec Boul . a lba , d ’où j e concl us que vous n ’avez pasencore remarqué que J L a pa rfoi s l e même sen s queJ L» . Peut-ê tre l ’éd i teur égypt i e n l ’ignorait-il auss i . I l n esera don c pas superflu d ’en c i ter quelques exemples . 0nl i t chez n otre auteu r (t . I , p . 906 , l . J L5
‘ J l8
J u il, . Dan s Ibn-Djobair (p . 1 7 1 , l .L5:
J. 5 1,il —f) ,
s J l,>t, w, s .su e,. sr y et? .
A i l leurs (p . 1 7 7 , dem . s a…L5
.L=
W L.£A l155
Mh z,
. Chez Ibn-C â hibic-ca l â t (man . d
’
Oxford , fol . 5 0 xllä3
5) O ADPlus lo i n (fol . 5 1 Ü ,
u 5 1J 1 J b>l w a l l,
….g1‘
31L5
. t,Q t,>t 11131
J.; r
.%xäxro Xm îüLs.
Chez Ibn-al—Kha t ib (man . de M . de Gayangos , fol . 147Ce monarque ava i t t ro i s fi l les
Un
U). l l
C}SP)—fi l
W J: L,,30, X:f
}Lq Chez Djaubarî (dan s l e
Zeitschrift , t . XX ,p . 5 09 , l . Un gj
+J l ÙL_ { Ut,
L,,3N t J b>l U n Vous voyez que la note de M . deGoeje s ur ce dern i er passage (i l pen se que .j l,> t es t une
fau te de copi s te pour L35 e ) , es t e rronée , e t que , dan sn o tre tex te , i l n ’y a r i en à changer . J
’
ajouterai encorequ
’
Abd-ai—vvâ h id ,qu i san s doute ava i t l e même passage
sous les yeux,écr i t (p. 10 1 l : ‘
xl l, A d u lte J…>j,Q u e—JP ) JM .—« l «À : ;
225
P . 5 8 1 l . 6 . Voyez mon Glossa ire des mots esp . deri
ve'
s de l’
ara be , p . 25 6 .
Ibid . , l . 10 . Les voyel les de ce m ot dan s letex te e t dan s les Add . e t Corr . son t éga lemen t fau t i ves.Chez lbn—D ihya (fol . 15 5 v
°
) c ’es t e t i l fau t pron oncere n effet
j* -‘
æ l ’ impéra t i f de la Ve forme deP . 585 , l . 1 . Vous vou s é tes t rompé , j e cro i s , en
d isan t qu ’ i l fau t l i re avec Boul . a î à Às, , au l i e u de s i x….
Le verbe ne conv i end ra i t po i n t , tand i s quedan s les m an . d u Ma tmah et de Maccar i , est j us temen t l everbe qu ’ i l faut , comme l e m ont re la compara i son duvers qu i se t ro uve à la page su ivan te (1. 5 L>
_
e£ îœw :
P . 5 84 ,l . 15 . est auss i dan s l ’éd i t i on de Pari s
d u Ca ldgid .
P . 5 89 , l . 3 . l i sez Έ xxg , comme dan s la n oted , e t b itfe z 5.. l
, qu i n ’es t pas dan s le Ma tmah .
Ibid l . 20 . Ce)Lx
‘
>o ï l l n ’es t qu ’un lapsus ca lami ouune fau te d ’ impress i on ; l es m an . d u Ma tmah et d e Maccari on t correc temen tP . 5 90 l . 15 . I l est à pe i n e b esoi n de d i re que j ’ava i s
co rr igé ce passage comme vous le fa i tes d ’après Boulm a i s j e sera i s p resque t en té de cro i re que les fau tes son tde l ’éd i teu r , car L . e t l e Ma tmah ont l es b on nes lecons .
P . 5 93 , l . 8 . L… .î est auss i dans L l ’emiss ion de cem ot n ’est donc qu ’un lapsus ca lam i ou une fa u te d ’ i mpress i on .
P . 5 9 5 , l . 14. Cet te foi s l e lapsus ca lami est de vous .0 vc
Ce n ’es t pas qu ’ i l faut prononcer , m a is , commej e l ’ava i s d i t , 15 1
224
Ibid . ,22 . Ma lgré m oi , j e su i s forcé d’avouer que
j e n’
a i pu m ’empêcher de sou r i re à la vue de votre lapi nqu i v i en t se désa l té rer avec ses pet i ts au b ord de la r iv ière . En prem ier l i eu , l e lap i n s’appela i t en Espagnea,Ï_Ë1Ê (voyez Maccari, t . I , p . 122 , l . 7 e t mes remarquessur ce passage , pl us hau t , p . ce qu i , à coup sû r ,n e ressemb l e pas du tou t a u 1. ä . ls du texte » En secondl ie u , on s ’aperçoi t que vous vous ê tes occupé d ’arabe b i enplus que d ’h i stoi re natu rel le , car
-”
au tremen t vou s aur iezs u que le lapi n a pour l ’ea u une avers i on t rès-prononcéeet qu
’
ordinairemen t i l n e b oi t pas . S i vous a vi e z bi envoul u consu l ter mes L oci de Abbad . , t . II , p . 229 , que
M . Dugat c i te à la page su i va n te , n . e , yous y aur ieztrouvé l e veri tab le sen s d u vers , qui est b i en d iffé ren t .J’
a i cependan t encore u ne ou deux observat i on s à fa i re .En prem ier l ie u , j e remarquera i q ue le t erme vulga i reL5 5
5, faire , cours de ven tre , est encore us i té en A lg ér i e ;
voyez Humber t , Guide de la conversa tion , p . 5 4 , et Pau lm ier sous faire. P de A l ca la l ’écr i t j urî et j ’ava 1s cruque cet i éta i t l a prononcé à la m an iè re grenadine ; ma i sc omme on pron once dj erî en Al gér ie , j e pen se à présen tqu ’en Espagne en éc riva i t k5 fi
;° Quan t la mesuren ’ ex ige pas absol umen t qu ’on donn e un techdid au yä , car
dan s l e mè tre a l-câ mil , l e pi ed U -l . a t_ à-x . s peut deven i r
Ül= ta . J e con t i n ue donc à consi dérer c e term e commel ’équ i va l en t de e t l ’on peut ob server que
,dan s la
langue vulga i re cet te rac in e a donné n a i ssance à beaucoupde mots que la langue class ique n ’
a pas . Ai n s i on t rouve
226
tous les ouvrages et dan s tou s les m an . où l ’on trouvece t te p i èce , on litP . 6 24 ,
I. 19 . Comme vou s renvoyez pou r l ’orig i n e et
la s ign ifica t i on d u t erme d’orfévrerie J L» ,niel le , â mes
L oci de A bbad . , t . III , p . 1 6 , j e profi tera i de cette occas ion pour rem arquer qu ’on a formé de ce sub stan t i f l epart i c ipe -n ,
n ielle'
. On le t rouve dans u n passaged’
Ibn-Batoa ta (t . IV, p . où i l est quest io n de w
ati… xœèÜ
»,
« s i x chan del ie rs d ’argen t n i el lé . » Le t ra
ducteur qu i a rend u cet te ph ra se par : « s i x chandel i ersd ’a rgen t ém a i l lé s d e b l eu ,
» a san s dou te déri vé ce par t ic ipe de
,}p , indigo , ma i s c ’es t u ne erreur . I l se t rouveauss i chez M . Daumas , L a vie ara be , p . 195 : « m eniy el ,
n iel lé .P . 6 50 ,
1. 5—6 . Ces vers se t rouven t avec des var ian tes dan s Mül le r , B eitrage , p . 17 .
P . 6 55 ,1. 1 25— 18 . On ren con tre a uss i ces vers ch ez
Ihn- al—Kh atib , m an . de Par i s , fol . 1 12 v° Va r ian tes :
15 (J ‘ 16 sin é té J …; 1. 17
ÜèJ. l l ; I. 18 ,
1 ‘” hém i s ti cheÙL_ {
U‘:
LÂ L$ tj“ ! (c ’es t la correct i on de l ’homme de lett res don t
i l est quest i on à la l i gn e 2 ° b émist .L).
P . 6 5 4 ,I. 1 7 . Vo tre conj ec ture m e para î t arb i tra i re
e t la compara i son de la l i gn e 19 mon tre queL 5
' 5
est bon . Il s ign ifie à l’
instan t , à l’
heure m êm e
chez Marcel et chez Hélot) comme Ü…s xl l L5 5 , a a L…
J L5 \3l LçE; voyez P . de Alcala sous lu ego . Le ç o. l .Ë\S
2 27
a l e sen s de Ou ; 0 1591; et i l est ques t i on d ’un né
cessiteux qu i presse un au tre qu i es t dan s la même cond i t ion que l u i , de lu i d on ner à l ’ i n s tan t même ce que ce tau t re n
’
a pas en core .P . 6 7 1 , l . 18 . Ce tex te est a l té ré e t l e changemen t
que vous proposez n e l e ren d pas mei l l eur.Ibid . , I. 20 . l i se z XÂ
;L
_—l g
P . 6 7 5 , l . 1 (LÆL£
ü) l i sez Là@Läo, le roi au j e udes échec s ; voyez mes Ooster lingen , p . 7 9 , 80 , e t m on
Glossa ire des m ots esp . dérivés de l’
a ra be , p . 5 5 2 , 5 5 5 .
P . 688 ,l . 1 1 e t 12 . La l eçon
)À ss lt provi en t d ’un e
au tre rédact ion de cet hém ist i ch e , à savo i r;L… ss353 œe
Ell e se trouve chez lbn-D ihya (fol . 1 1 qu i , au l i e ude
r93$ \5 , don n e c e qu i vau t m ieux ; l e pron om se
rappor te a l ors à u t…tx3l . Dan s l e secon d vers , cet auteu ra ÏÎ 5 , à la place de &M 3 .
Ibid . ,I. 20 . Ihn—D ihya (fol . 14 r
°
)
P . 689 ,l . 5 . Au l ie u de Q .ä= , qu i sera i t v ide
de sen s , i l fau t l i re &g_,s comme dan s mes L oci de
Abbad . , t . I , p . 298 ,1. 1 .
P . 7 0 1 , l . 15 . (j _5 u s ) l i se z
P . 705 , l . 22 .
Un) b ifi
'
ez l eUn , qu i n ’es t ni
dan s le s qua tre m an . c i té s dan s la n o te n i dan s Boul . ,et pronon cez t x l l .
P . 704 , l . 10 . Voulo i r changer le L531 de tou s l e s man .
et de Boul c ’est pou sser l e pur i sm e t rop loi n . L’
aute ura san s do ute écr i t d o i , en pen san t à un mo t comme
1 5 *
)tu s ül plu tô t qu a ses deux suje ts fém in i n s , qu i , du reste ,n
’
exprimen t qu ’une seule idée . C’es t , s i vou s voulez , une
négl igence ; ma i s n e soyon s pas des ma î tres d ’école qu icorr igen t des thèmes .P . 707 , l . 15 . l i sez
,comme dan s la note
i,
Ibid . ,22 . l i sez
P . 7 08 ,I. 8 . (m àj ) l i sez a vec G . e t Boul . parce
q ue l e verb eC’)se t rouve déj à dan s la ph ra se précéde nte
,
e t que m é} n e peu t pas se j oi ndre à LSb L5 \… U» .
P . 7 10 , l . 9 . Le m o t qu i n ’est pas dan s Bou lest de t rop.
Ibid . ,l . 12 . (œU…s ül) l i sez
P . 7 1 1 , l. 6 . varian te dan s Boul .Vous d i te s qu ’en tou t cas ce mo t es t l e t u rcdu coton ; m a i s c royez-vous donc sé ri eusemen t
qu ’on a it employé des mot s turcs à la cou r de s Mérinides ,
e t que même o n s ’y soi t servi d ’un t erme t urc pour dés igner le coton , é toffe pour laquelle les Arabes ont le ur
qui a passé dan s t ou tes l es langues de l ’Europe ?Ce qu i me para î t cer ta i n , c ’es t qu ’ i l fau t en t rer dan s unet out autre vo i e et chercher l ’or ig i ne d u m ot en questiondan s une des deux langu es auxquel les l e d ia l ec te magrib ina fa i t réel lemen t beaucoup d ’emprun t s , c ’es t—à—d i re dan sl e b erb ère ou dan s l ’espagnol . A mon av i s , la var iantede Boul . est presque b on n e ; i l faut l ire Le mot
espagnol mon ta a passé dan s l e d ia lecte magrib in sous laforme au pl ur . On lit chez un chron i queu ranonyme (man. de Copenhague , n ° 7 6 , p . au .“
30
dans l ’anc i en n e t raduc t i on la t i n e (ibid . , p . voyezauss i une note de M . Amar i , p . 449 , n . q.
P . 7 18 , l 6 L’endro i t s
,,que vous d i tes n e pas
conna î tre , n e ta i t cependa n t pas d iffic i l e à trouver ; c ’estUtrera ,
sur la gran de route de Sév i l le à Cadix . Quan t àl ’événemen t auquel Ihn-al-Khat i b fa it a l l us i on ,
vou s aur iezpu l e t rouver dans l e prem ier l i vre sur l ’h i sto i re de cet t eépoque qu i vous tomb â t en tre les m a i n s . Utre ra ayan tembrassé l e par t i de don Henr i , l e frè re de Pierre-le—Crue l ,l e roi .de Grenade , qu i é ta i t l ’a llié de ce dern i er , la pr i td e v i ve force en 15 68 e t emmena e n esclavage on z e m i l leperson nes de t ou t â ge e t de tout sexe .P . 7 20 , l . 1 . M ,
. Boul . m ieuxP . 7 2 1 , l . 2 1 . J e n e sach e pas que le m ot s
,. â .s a it
jama i s la s ign ifica t i on q ue vous l u i a ttrib uez ; dan s t ousles exemples que j ’ai n otés , i l e n a d ’au tres . La l ec ond u t exte , s
ans, , est b on ne . C
’est un m ot pour lequelIbn—al—Khat ib e t son con tempora i n Ibn—Khaldoun on t une
grande préd i lect i on e t qu ’ i l s semb len t employer dan s l esen s mé taphor ique d ’afi’
ection ,z èle , dévouem en t p our (fi l s ) .
C’est donc l e synonyme de dan s la ph ra se qu i précède . Dan s un d iplôme pub l ié par de Sacy (dan s les Me
'
moires de l’
Académ ie des inscrip tions , t . IX , p . 49 3 à lafin) 0 1] l it : L4 .1
Ü_A S zs
fæÀ.li &.J
,: Àî
C)‘ LM L: :
ï…LnUn xi , paroles que l ’éd i te u r a t rad ui tes un peu
l ib remen t par cell es-c i : « Nous nous sommes crus ob l i gé sà emb rasser sa défen se d ’ une m an ière qu i répondit à sonrang élevé .
» Dan s les Prole'gom e‘
nes (t . I , p . 25 4 , 5—5 )
a… t x;,m ,x… 3
L5t= ss
rgn i>
)lL5 ) “
3ŒLÇ v
,: ÀÂ l
,Xäñ.äà l l
Ü'° a») a
L55
2 5 1
65 Voyez auss i ibid . , l . 10 , p. 25 5 ,
e t 14 , p . 2 5 6 ,1. a , 4
7 ,p . 2 78 , l . 6 ,
p . 109 , l . 1 1 e tc . ;
H istoire des B erbères , t . II , p . 12 5 ,l . 12 , p . 5 5 7 , 4
a f. Dan s ce dern ie r pa ssage i l fau t s ub s t i tue r u n’
a in
au gha in ce t te fa u te est presque c on s tan te dan s no trem an . 13 50 ,
qu i don ne quelquefo i s les v oyel lesP . 7 29 , l . 2 . Vous pers i s tez à cro i re que le mo t
es t v ide de sen s . C ela prouve que vou s n e l ’ avez pasencore reconn u . C
’est un e au tre forme de W ’ ga lère ;
voyez le Glossa i re s ur Edri s i , p . 3 3 1 , e t aj ou tez aux
exemples qu i s ’y t ro uven t c i té s : Beh â -ed-dîn Vie de Sa
ladin , p . 4 1 , l . 8 . I l est quest i o n d ’un e ga l e re don t l ’êquipage se com posa i t de m éc réan t s (de ch ré t i en s) qu ié ta i e n t des « servi teu rs de l ’eau , c ’est-à-d i re des m a telo ts ,et qu i lanca ient l e n aph te sur l e s va i sseaux en nem i s .P . 7 41 l . 4 . Quoique la lec on Li nz} ; se t rouve auss i
dan s Boul . , i l est cer ta i n q u ’ell e es t m auva i se e t q u ’ i l fau ty sub s t i tue r LLa;, s s i n ou s n e cra i gn i on sP . 7 45 ,
l . 10 . Vos ob servat i on s su r Un is … s on t parfa itemen t fondées , comme l e prouve ce passage t i ré del’
Asâ s a l-ba idya de Zamakhch ari : Üxflb ÙL a,—. Ji
O. :
.
 bAUl W S “ , ,la .t l i ts …“
œLa lJ>tÜ,
A. l l aJ après quo i i lc i te le vers que vous avez trouvé dan s Y â cou t . Ma i s lafaute est fréquen te e t i l faut s ub st i tuerW àdan s l ’H istoire des B erbères ,
t . II , p . 89 , l . 2 , p . 2 5 5 ,
p . 5 a f .
25 2
P. 7 46 ,l . 1 . I l n ’y a r ien à changer dans c e passage
e t vous a vouerez que la note que vou s y avez aj ou tée estmalheureuse , quand j e d i s q u ’ i l fau t prononcer 8 ) x3
,
bb; LL.h> de, St
a
Sii, et tradu i re : « n ou s c ra i gn on s ,à moin s que D ieu n e n ou s protège , de graves ma lheurs . »P . 7 48 , l . 24. La l eçon de Boul . , Ü xh tt
)nt Ü:
me para î t bea ucoup mei l le ure .P . 7 49 l . 13 . L i sez x. 3n fi ; voyez p l us hau t, p .P. 7 5 1 ,
l . 20 . Vous avez b ien fa i t de ré trac ter vo treanc ien n e conjecture . a.. i se t rouve auss i dan s l es deuxman . d
’
l hn-Bassâ m .
P . 5 . Vous avez ra i son de condamner cela véri tab l e l eçon est sj ôu, el le se t rouve dan s les deuxman . d
’
l bn Bassâ m .
Ibid . ,l . 12 . Les deux man . d
’
Ibn-Bassâ m on t correc
temen t le J e.
P . 7 5 5 , l . 2 . S i vou s av i ez b ien voul u consulterla l ongue d i sser tat i on que j ’ai fa i t imprimer dan s mesRech erches et que M . Dugat a c i tée dan s la note c , vousauri ez vu qu ’ i l n e s ’agi t n ullemen t i c i d ’Ahou—Dja ’far ibnal—Bi n ni , m a i s d ’un tou t autre homme de let tres , à savoi rd’
Ahou-Dja ’far a l-Bat t i . Ce dern ie r a é té b rû lé par l e Ciden 488 , tand i s que l ’aut re composa encore des sa t i resaprès l ’année 500 . Je n e regre tt e pas , cependan t , quevou s soyez t omb é dans ce tte grave erreur don t M . Duga tava i t t â ché en va i n de vou s préserver , parce que decette m an i ère vous m ’
avez fourn i l ’occa s i on de reven i r surun e quest i on d ’h i sto i re l i tté ra i re assez c urie use . Dan s mesRecherches (t . I I , p . 49—5 1 de la 2° éd i t .) j ’a i soupçon né
25 4
se peu t que les dern iere s feu i l les a i en t manqué à I’exem«
pla i re don t i l se serva i t .P . 7 5 6 , l . 15 . l i se z Q Ë
Î M > , à l ’accusa tif,comme on t rouve dan s le m an . d
’
Ibn—Abdalmelic Ma rrecochî (voyez fol . 89 v
° et Le suj e t de es tdan s l e vers qu i précède .Ibid .
,19 . La b on ne lecon ,
zsLÀæla> cec i :
,se t rouve
auss i chez Ihn-Abda lmelic Marrécoch î .P . 7 5 7 , l . 7 . Le même a uteur don ne fa ite,
avecâ\æ , e t
Ibid . , 9 , …s‘
zif, comme dan s Boul . , e t
P . 7 5 8 , l . 1 , avec le s voyelles , e t
Ibid . , 6 , Œ…t , ce qu i c on fi rme vo tre J M , , et
9 5
Ibid . , 12 , 283G£ l .a Uu
)ä i HJ}
e t
Ibid 15 ,…
‘
Çs , e t
Ibid . , 14 , g}.ä3
Üt Ce son t d ’excel len tes le
cons , car axi xæ s ’accorde parfa i temen t avec le verb e €L:oqu i précède . Le texte est dé c idémen t mauva i s ; i l n esera i t pas a rab e .
0P. 7 5 9, l . 5 . Chez le m ême Œx s xs.
P. 7 6 5 , l . 12 e t 15 . Il faut l i re)
.gXÂ à J i, 3;Â/
L
O
À A JLJPÂ>JM i
u Lä.<5b Lœ.: t m i , comme t . II , p . 258 , l . 22 ,
où Maccar i c i te le même passage . Ensui te il faut bifi’erla copulat i ve dan s —Lsm
ca, ; Boul . ne l ’a pas .
P . 7 64,1. 10 . l i se z
r.i
‘
… à l ’ac t i f.P . 7 66
, l . 15 e t 14. Boul . &A 3jS \il äàÙs ül.
P. 7 6 7 , l . 12 . l i sez
25 5
P . 7 82 , l . 7 . Il fa u t san s dou te sous—en tend re un mot0
0 0 A 0comme uno—g) , m a i s I l n e me para i t pas nécessa i re de
l ’aj ou ter .P . 7 86 , l . 7 . Vous voulez pron once r et
vous c i tez Yâ cou t à l ’appu i de vo tre op in i on ; ma i s j e cro i sque vous ferez b i e n de n e pas tr0 p vou s fier à ce géograph e a s ia t i que , l orsqu ’ i l s ’ag i t de la prononc ia t i o n denom s espagnol s . Ce l u i d e ce tte r iv 1e re es t con s tammen tJ. âüa dan s les bons man . ; da n s u n endro i t que vo us aveznégl igé de c ite r , Yâ cou t (t . II , p . 7 6 ) don ne la mêmevoyel le , e t en outre la form e la t i n e (S ucron ) e t la form eespagnole (Xucar ) démontren t qu ’e n arabe cet te voye l le do i tê tre un dhamma .
P . 7 99 ,l . 9 . Dan s cet te l ign e i l y a u n m ot à expli
O0 5quer e t u n aut re a c orr iger . J
’
observera 1 don c que)t3, t
es t pour) t (l eçon d u m an . pl ur . de
»4, chande lier .
Cet te t ran spos i t i o n n ’es t pas rare dan s la langue modern e ;0 5
a i n s i on trouve chez P . de Al ca la : pl . -L.g,t
(pour e t passada tendida , pl .ôLg,5 (pou r
Quan t à la s ign ificat i on de ce voyez Qua tremère , H ist .dessu it . m am l . , t . Il , part . 1 , p . 2 7 2 ; M . de Slan e , dan ssa t rad uct i on angla i se d’Ibn—Khallicâ n , t . I , p . 2 7 1 6 7 5 ;
M . W’ r igh t , Glossa i re su r l bn—Djoba ir , p . 18 ; M . Defré
m ery , Mémoires d’
h ist . orien t . , p . 264 ; J ourn . a sia t . de186 1 , t . I , p . 46 5 , e t de 186 2 , t . I I , p . 586 . Les c op i stes con fonden t so uven t le pl ur .
)l,ï t avec A i n s i
o n l it chez Nowair î (H istoire d’
Egyp te , man . 2 k
fol . üLfl m, dl .bM , ) L.,Si J i a œ3 $ l Chez
25 6
l bn-ai-Kha t i b (man . de M . d e Gayangos , fol . 145
a…l : L. ALS
‘L SâæL$ \l l O.S \xq l
)t,
. 3t -t, g…11 …t3 e
, M .,—m, .x,ç mll, o
,à ls
Ü. A
ê
(lisez [email protected] S‘
) L@if3 am i” . Dan s ces deux tex tes i lfau t corr iger
)t)st. La même ob servat i on s ’appl ique à ce
passage de vot re éd i t i on des Mil le et une nu its (t . X ,
p . 98 ,l . Lg, è wam, s @ t
,l, su u
,» t,
où l ’éd i ti on de Macnagh ten por te mm… ,qu i
est l e s ynonyme de)t,3t. Après la men t i on des chan
deliers de cu i vre , » on lit da n s l e texte de MaccarixÂ,,Ïg p la n, ; ma i s des « cha i res de cr i s ta l » sera i en t des
obj et s assez é tranges . I l faut y subs t ituer « des candélabres de cr i s ta l . »
P. 80 1 , l . 20 . J’
ajou terai à vot re n o te que , dan s l ed ial ec te magribin , comme n om appel la t i f , s ’écri téga lemen t voyez l e Cartâ s , p . 14 , 18 e t a i l l eurs .Quatremère s ’est t rompé , lorsqu ’
en rendan t c ompte del ’éd i t i o n de M . Tornberg dan s le Journa l des Savan ts , i la d i t que dan s ces passages i l fa l la i t sub st i tuer à
P . 805 , l . 2 2 . n e conv i end ra i t pas , car ce verbese const ru i t , non pas avec l’accusatif ma i s avec
dit. I l
fau t l i re o..œ,
P . 804 , l . 17 . Plus hau t , dan s ma rema rque su r t . I ,p . 2 5 0 ,
l . 2 5 , j’
a i déj à démon t ré que vous vous ê te strompé en d isan t qu ’ i l faut subst i tuer L.fa .L…l i à
65.
2 5 8
chaque l igne i l s seron t ob l igé s de chercher dan s les Add it ions e t Correc ti on s , dan s vos n ouvel les remarques , quevou s avez d i ssém inées en deux endro i ts d ifféren ts , e t enfindan s cet te l ett re , s i quel que mot y a é té changé ou expliqué . Pour ob v ier à cet i n convé n i en t , j ’aj outera i à mont ravail un i n dex qu i m ettra l es arabi san ts à même de voi rd ’un seu l coup d ’œ i l où i l s t rouveron t l es remarques supplémentaires . J ’y i nd iquera i l es Addi t i on s e t Correct i on spar la l et tre A , vos remarques dan s les B erich te par lal et tre B , et ce l i vre par la l ettre L .
I N D E X .
T OME 1 .
wË"
m“
—1œ©œœœ
ou:
»
N
r-a
o—tNr—ùH»
co c
L“
,5 A .
15 A , B 1 5 5 , L.
n ot e 8 A .
1 2 10 A , B 1 5 5 .
1 5 B 1 5 5 .
1 7 A .
n ot e 5 A .
1 3,1 8 B 1 5 5 .
1 4, 1 A .
10 B 1 7 2 .
24 A .
1 5 , 2 1 B 1 72 .
1 7 , 2 1 A .
22 A .
1 8, 4 A .
5 A , L.
1 9 , 2 2 A .
2 5 ,
1 1 A .
1 2 A .
1 7 A .
1 1 A .
1 9 A .
n o t e a A .
3 A , B 1 7 2 .
1 6 A .
2 1 A , B 1 73 .
6 B 1 5 5 .
2 4 B 1 5 5 .
22 A , B 1 5 5 .
n ot e b A .
2 B 1 7 3 .
1 6 A .
1 4 A .
1 7 B 15 6 .
not e a A .
n ot e 6 A .
2 4 A .
1 7 et 1 8 A .
1 9 A .
2 5 A .
1 et 2 A .
22 A .
n ot e a A .
1 2 A .
n ot e b A .
5 1 ,
5 2 ,
1 1 A .
n ot e a A .
2 A .
3 A , B 1 5 6 , L .
28 B 1 5 6,L.
2 5 A, B 1 5 6 L
6 A .
1 6 B 1 5 6 , L.
n ot e a A .
1 0 A, B 1 7 3 .
2 A .
9 A .
1 5 et 16 B 1 73 .
1 7 A .
2 1 A .
6 A.
11 A,B L .
2 5 A .
3 A .
n ot e a A .
a A .
1 6 A , a 1 5 7, 1 74, L .
1 9 B 1 5 7 .
2 4 B . 1 5 7 .
n ot e a A .
5 A, B 15 7 .
5 4,
2 40
1 9 A .
5 A C111, 1 , 1 .
n ot e d A .
e A .
4 A .
1 1 A , B 1 74.
1 4 A .
1 7 A .
n ot e a A .
6 B 1 7 4.
22 B 15 8.
n o te a A , B 1 5 7 .
b A .
7 A .
1 0 A.
22 A , B 1 5 8,L.
1 A , B 1 5 8.
1 1 A .
2 3 A.
6 B 1 75 , L.
n ot e e A .
8 A CII],2, 1 9 .
12 A .
m ,
D5
D
1 08,D
109 ,
n ot e a A .
3 A , B 1 5 8, L .
6 A .
9 B 1 5 8, L.
1 1 B 1 7 5 .
2 2 e t n ot e f L .
2 & L .
1 6 4
,2 1 A .
no te 0 A .
, 4 4
2 4 A .
2 0 B
no t e d A .
, 4 4
21 A.
, 1 5 4
1 9 A.
2 3 e t 24 A .
not e 0 A.
, 12 1
1 5 e t 1 6 A .
2 2 e t 23 A .
2 4 A .
6 A .
1 2 e t 1 3 A .
3 A .
1 2 A.1 6 A .
mmmm
mm
1 1 9,120,
1%
1 %
mama
ma
ma
mm
mn
wama
ma
we
h A .
OO
N>
O
13 A .
1 5 B 1 7 6,L .
2 2 A , L.
5 e t not e a L .
10 A , L.
1 2 A .
9 A .
10 A .
1 5 A CIV, 1 , 8.
20 A .
not e i A .
2 A .
8 A…
2 1 A .
6 A .
2 5 A .
1 A.
2 3 9 ,
2 41,
2 42,
2 43 ,
2 44 ,2 46 ,
2 47 ,
13 A CXVI I.1 5 B 1 80 .
1 7 A .
19 A CXVI I .5
g A CXV I I .m A CX V I I .A .
A CXVI I .A CXVI I .A CXV I I .A CXVI I .A CXV I I.A .
?
H
H
H
ŒCJ‘
CÛ
ŒU‘
Dü
. b,c
l., 1, p A cxvu .
A
A cxvu .
d , e ,
1 A cxvm .
1 5 A ,L .
1 6 A
n . A cxvm .
6 B 190 , L .
9 A cxvm .
1 5 A e t CXVIII, L .
1 6 A . L .
1 7 e t 1 8 ACXV I I I .
1 9 A e t CXVIII,L .
2 1 L.
2 3 A CXV I I I .3 A .
6 e t n . f8 A CXVI I I .1 1 A CX VI I I .1 2 A CXV I I I .
d, e et CXVI.
ad, ga h j a
g ,h A
CXV I I , CXV I I I .
e t
2 47,
2 5 0,
2 5 1 ,25 2 ,
2 5 5,
2 5 6,
25 9,
2 5 9,
2 60 ,
2 62,
2 64,
268,
2 69 ,
2 7 0,
2 7 1,
2 72,
2 7 3 ,
2 7 4,
2 42
20 A, I
2 1 e t 11. k L .
CXV I I I .5 et n ot e
2 3 »
2 4 »
20 A,L.
22 e t n . f A , L.
2 1 A .
a L
c L
d L .
b L
H
H
H
H
OO
U‘
cc
.—coca
B 280 .
n o t e g L .
1 9 A cxvm .
1 A, B 1 8 1 .
n ot e ]6 A CXVI I I .8 A .
1 0 A .
1 2 B 1 8 1 .
1 0 A .
1 7 A .
n ot e 0 L.
1 8 A .
22 A .
1 2 A .
2 B 1 81 .
2 0 A .
1 0 B 1 81 .
1 5 A CX VI I I .1 7 A CXVI I I .1 8 A CXVI I I .1 9 A CXVI I I .2 1 A e t CX VI I I .n . d, e A CX VI I I.f A et cxv1u .
2 A .
6 A CXVI I I .8 A CX VI I I .1 0 A .
1 1 A .
to 4
285 ,
2 86,
2 9 6 ,29 9
,
3 09,
309 ,
3 10
3 1 1,
3 12,
1 2 A CX VI I I.1 5 A CX VI I I .2 1 A CXVI I I.n . i , l , m ,
n ACX VI I I .
1 A CX VI I I .3 A .
8 A CX VI I I.1 3 A CX VI I I .1 6 A CX VI I I .1 8 A CX VI I I .2 1 A CX VI I I .n . a , d A CXV I I I .1 7 A .
3 12,
3 13,
3 14,2 1 5
,
3 3 7 ,
3 39,
3 39
6 A .
no t e a B 1 82 .
1 B 182 .
7 e t n . d B 182 . L.
8 B 1 82 .
n o t e j A .
1 4 A .
1 L .
n o t e a B 1 83 .
6 L .
1 4 9 1 9 3,L .
2 6 9 1 9 3,L .
1 6 A .
3 A .
7 A .
1 1 A .
8 A .
1 5 A ,L .
22 A ,L .
1 0 A .
1 3 A,B 1 83 .
1 5 e t no t e 0 L.
1 8 A .
2 3 A .
6 B 1 83 .
22 A .
9 A,B 1 93 .
20 A .
n o t e a A .
6 14.
1 7 B 1 83 .
n o t e f A .
2 A , 9 1 94.
4 A .
40,
3 4 1,
3 43,
3 44,
3 45,
346,
3 47 ,3 49
,
3 49,
3 5 9,
3 6 0,
3 61 ,3 63 ,
3 6 4,
3 65,
QD
'"
l°
O
“
N
N
Q
IO
N
Œq—s—Lg
[O
O
oa
ÎÏ
z
e
c
e
e
3 69,
3WL3 7 1
,
3 7 2 ,
3 7 3 ,
3 7 7 ,
3 7 9 ,
3 79,
3 81,
3 92,
3 93 ,
3 94,
3 90,
3 89,
2 A .
7 A .
1 1 B 1 84.
1 4 B 1 84,L .
1 5 B 1 84.
2 1 e t no t e h L22 L .
1 3 B 1 84 .
1 5 A .
2 5 A .
7 L .
1 7 A,11 1 9 5 .
n o t e 8 A .
no t e A .
e L .
1 4 A .
8 e t n ot e d L.
1 A .
9 L .
1
1
6 A .
2
2
1
9 A .
1 9 A .
1 0 A .
1 1 B 1 85 .
2 4 L .
6 A .
n ot e d B 1 85,L .
1 1 A .
22 A .
00
%
mmo
r
to
,a.
399,
3 99 ,
405 ,
412 ,
41 3 ,
414,
41 5 ,
41 6 ,
41 7 ,
41 9 ,
41 9 ,
420,
42 1 ,
422 ,
423 ,
424,
425 ,
426 ,
427 ,
429 ,
429 ,
—ùÇDQ
N
H
ŒQ-
H
—I m»
Ë‘
42 9 ,
432 ,
433 ,
43 4,
435 ,
439 ,
440 ,442 ,
444,
445 ,
446 ,
447,
449 ,
45 2 ,
45 4,
45 5 ,
45 6 ,
45 7 ,
45 9,
460,
46 1 ,
462 ,
463 ,
465 ,
466,
46 7 ,
46 8
1 4 et 1 5 B 1 88 .
3 A ,3 1 99 .
8 B 1 89 , L .
mw—mpa»
œv—*œœ
œ—n>œmœ
P
P
?“
2 4 A .
n o t e b B 1 89 .
4 A , B 1 89 .
5 A,B ,1 89 L .
46 9 ,
47 3 ,
47 5 ,
47 7 ,
47 9 ,. 47 9 ,
1 0 et 1 1
6 A, B 1 89 .
1 3 A .
1 7 A , B 15 9 , L .
19 L .
n o t e 6 L .
,3 9 1 5 8, L .
9 e t n ot e 0 L .
1 3 B 189 , L.
1 6 e t 1 7 L .
2 0 L .
2 2 e t 2 3 L.
n o t e d B 1 89 .
1 A .
8 B 190, L .
1 6 B 1 90 .
1 5 A , L.8 et n o t e 6 L .
1 4 A .
2 3 A , L .
9 et n ot e d L .
1 2 » e L .
1 4 A .
2 1 L.
1 A .
2 A .
n o t e a B 190.
3 L .
9 A .
1 7 A , 9 1 90 .
1 90, L .
1 9 9 1 5 9 .
9 A,9 1 90, L .
4 9 1 90 , L .
1 1 A .
1 2 A .
1 6 A ,9 1 90 , L .
1 4 A .
1 6 A .
20 A .
A ,R
246
5 43, 7 A , B 19 8, L .
9 B 19 8.
1 0 B 1 9 8, L .
24 A .
n ot e B 1 98 .
5 44, 3 A .
1 8 A .
5 45 , 20 B 1 9 8 .
2 4 B 1 9 8 .
5 46 , 7 A .
1 5—5 47,4 L .
1 7 A .
5 47 , 14 A , L .
n ot e f B 198
5 48, 5 A .
6 A,B 198.
1 3 A .
1 6 A,L .
1 8 A .
n ot e 6 L .
5 49, 1 0 A .
1 8 A,B 199 .
2 1 A .
n o t e 13 B 1 99 .
5 5 0, 3 A .
5 5 1 , 1 3 A , L .
2 1 A .
5 5 2,20 A .
2 3 B 19 9 .
5 5 3 20 L.
5 5 4 1 3 A .
5 5 5 , 9 A .
10 A,L .
11 L .
5 5 6 , 5 B 1 99 .
2 5 L .
5 5 8, 21 A , L.
5 5 9 , 9 A .
1 0 A .
5 60,1 1 A
,L .
1 5 A,L ,
5 6 1, 6 A .
8 A .
1 4 e t 15 B 1 9 9,
5 62,8 A .
5 63,9 A .
5 64, 1 2 A .
2 1 A .
5 6 5,22 B 1 99 .
5 6 7
5 6 8
5 7 0,
5 7 1 ,
5 7 2,
5 7 3 ,
5 7 4
5 7 5 ,
5 7 7 ,
5 7 9 ,
5 79 ,
5 90,
5 3 1,
1 3 e t 14 B 200 .
1 6 B . 2 00 .
_2 3 L .
n o t e a B 200.
2 3 I2 e t 3 L .
“
7 A .
7 et 9 9 200, L
2 3 A,B 2 00 .
1 A,3 1 5 9 .
1 A .
3 9 2 0 1 .
14 9 20 1 .
1 6 A .
2 1 et 22 9 20 1 , L
9 11.
1 0 L.
1 B 2 01 .
5 9 2 0 1,L
9 e t B 201,L .
1 1 3 2 0 1.
12 A, L .
2 3 A .
9 9 20 1 .
1 6 A .
1 9 A .
7 L .
1 4 et n ot e 6 L.
1 8 A,B 201
,L .
2 3 9 201 .
2 5 A,3 201 .
,4 A .
1 6 A .
,7 L .
’
1 1 A .
1 5 A .
1 6 A,L .
1 3 L .
5 89 ,
5 9 5,
5 9 6,
5 9 7,
5 99,
602,
lo
to
S
OO
N
tO
QD
t—\S
C°
cp
10
3 e
co
q
—kw
wo
w
m>v
?
o
o
'°
wo
g
g
13
8
N°
F“
;
F‘
q
œ
…mH
H
—OOHIO
H
CD
@
57
Ê"
O
Ë"
œw<
mwo
g
œœ
F"
mœwto
—1—al—a—x:1
2 1 e t n ot e d L.
2 5 A .
1 1 A,L .
1 8 B 204.
3 L .
1 2 9 204,L .
1 7 A,B 1 5 9 .
1 9 A, 9 1 5 9 .
2 3 L.
2 L.
5 L.
247
602, 6 L .
603 , 2 B 204.
no te (1 A .
604, 1 2 A .
1 7 A .
20 B 204,l
606 , 1 0 A .
6 0 7 , 2 e t n o t e a L .
18 A .
6 08, 1 A .
24 A,B 1 5 9 .
6 09, 4 L .
6 A , B 204.
6 10,1 1 e t n o t e 6 L .
6 1 1 , 8 A , B 204.
1 1 A , B 205 , L1 4 B 1 5 9 .
1 5 B 20 5 .
0 1 8 A , L .
6 12 , 3 L .
1 0 L .
1 5 A , B 205 .
22 A .
2 5 L .
6 13,5 e t 7 e t n . a e t
u>N
u—tOUÏ
2 3 L .
19 A .
6 1 6 , not e 6 A,B 206 .
6 1 8,1 5 A .
2 0 A .
2 1 B 206 .
6 19 , 6 A .
620 , 1 7 B 206 .
21 A , B 206,L .
6 2 1 , 2 L .
2 0 B 206 .
622,23 B 206 .
q
œ.æ.
œw»
r—ñœœ
O
Œ<I
U‘
ñ—CÆN
oo
œl—9—oomwws-æ—H—s—s—sœ
"‘
OO
2 3 et 6 2 7 , 1 A
9 2 09,L .
8 e t su iv. L .
9 A .
1 0 B 2 09 .
1 3 B 1 60 .
1 4 A .
1 5 A .
1 7 A .
CD
N
L"
—œ10CD59
O
ŒOO
ù
—v
c—_rw0
…:
ä
:
ç
œwn
n
u
œmp
œww
'1 2 B 2 10 .
n o t e a B 2 10 .
2 B 2 10 .
4 A .
10 A,B 2 10 .
1 2 A,B 2 1 0 .
2 0 A , L .
2 1 L.
2 5 A,B 2 10.
5 A .
8 A , B 2 11 .
2 2 L .
2 3 A .
7 A .
8 A,B 1 5 9 .
1 1 A .
1 2 A .
1 4 A .
1 7 A,L.
05
2 48
19 A .
4 A .
1 2 B 2 11, L .
14 A .
1 8 A .
2 2 A .
n o t e e B 2 11 .
7 A,B 206
8 A .
1 2 A , B 2 11 , L.
n o te 6 L .
1 1 A .
1 7 B 2 11 , L .
5 A .
7 B 2 11 .
8 A , E »2 1 1 , L .
10 e t n ot e f L .
ro
u
v
—*œ—lNa
t
t
o
—u=
wo
—zœm
wœwn
wwH
—a—Hœoo
p—œ
to -ù
3
3
3
w
1 1 A , 9 2 12 .
3 A , 9 2 14, L .
1 3 A .
1 7 A .
1 9 9 2 14.
n ot e 0 B 2 15 .
3 A .
4 A .
1 6 A .
1 4 A .
1 5 A .
2 2 A .
2 3 A .
1 3 L .
1 5 A .
1 9 A .
2 1 A .
4 A .
1 7 A , B 16 0,L
22 B 2 15 .
2 3 B 2 15 .
n ot e d B 2 15 .
1 3 2 1 5 .
2 9 1 60,2 15 .
6 5 9,
6 60,
6 6 1,
6 62,
6 6 3,
115
0
l\?
p—L S“
n o t e a L.UU M C)
2 16,L .
l\?
C)
E"
mœ©û
w>œb
5
5
3
5
rc
tU
1 c;
Nä
\I
G)
56N 0
3
t n o t e 6 L .N
p—b 65
9 2 16.
3
5
3
10 q
œq
œœœo
N-L
q E‘"
7
M—1fi
.
UU
.q
w
mwo
mo
CJ
Œ1&
N
N
IO
D-‘H
æ
l—'JNM
»
H
HHHHH
—5ÇDŒ1—L
WN
H
ÇD
Œ
“à
1 9 e t su iv . B 2 18.
2 1 B 21 8.
no t e d A .
f B 2 18.
7 12 ,
7 13 ,
25 0
1 8 A .
19 A , L .
2 4 e t n . d A , L .
1 9 B 2 41, L.
6 B 2 41.
1 1 B 242 .
1 6 3 2 42,L .
2 1 B 242 .
2 2 A .
1 5 A .
2 0 B 1 6 1, L.
22 A , B 1 6 1.
2 B 1 6 1, L .
pè C
U
w? 5
3Uni
05
:.L
Ë"
N
H
H
CD
H
IO
QD
OO
o
co
œ
2 4 et n ot e 6 L .
L .
A , L.
A .
—Huœoo
l—tqœœ
œœmæ-n
o
N
O A .
A .
2 2 A .
14 e t not e e L .
722,
7 24,
726,
7 2 7,
B
co
.—1œH
H
H
H
ŒH
H
œN
H
w—h—tä
ü
ù—ŒN
H
N
-H—t©
H
ua
€.q-ñ
u>w;>
i cr.
»
b
l0
ς0
OO
°°
N
q
CO
\I
Ù°
lO
HH
HH
730,
7 3 3 ,
7 34,8
5
6
8
8
6
N
H
H
Q
q0
u
*,
A,B 2 44 L
,.
°
*l
Œ>
—D
N
U
E>m &
N
°’
sn
to
.—sun
%
ŒŒÙ
3 A , B 2 45 .
4 A .
1 5 4 .
1 6 A .
1 9 A, B 245
,L .
Ë"
2 46 L .
Wl0
H
ÇD
OO
û-œ>>
H
H
H
ŒJ
ΝN
N
N
M
—\HH—‘mw
(D
ub—00
to
IE95
7 43 ,
1
W
51
)ü:
q
2 2
1 0
1 2
2 2
2 3 B 309 .
n ot e a B 247 .
2 4 A .
1 B 2 47 .
1 3 A , B 2 48.
1 9 A .
20 A , B 2 48.
2 3 B 248 .
2 0 A .
2 1 A .
22 A .
2 A .
9 A .
12 A , B 2 48.
UU
E>>UU
2 48.
O
CD
?
Œ
B 2 48 .
p.
C
WN
lo
wH
H
H
—m—mmm—Aamo‘
w—s
10 fi
n
5°
û-
O
ÇD
O©
UÏ
KO
l\D“în—W(D
‘
Nun CD
l°
H
H
:
È
OÔ
«J
Ê
15
00
03
o0
t°
\a
m
9
5 I°
,à.
CD
pb
l€
H
H
\
03
10
0
DO
I-t
4 O
1 1 A .
1 5 A , B 1 62 .
n o t e a B 2 5 1 .
3 B 2 5 1 .
9 A,B 2 5 1 .
1 0 A .
1 6 A,B 2 5 1
,L.
1 7 A .
not e d A,B 2 5 1 .
5 A .
7 A B 2 5 1 .
1 A .
l A .IO
H
ù
CR
C?
"‘
ÇO
w.
[O C
‘
U:
www.—œ
ca
c.:
w—ooœ—a»wuo
—mœœœwu
r—hw
cu
>
O
P
°
>Uä
0
1 5 A .
4 B 2 52 .
1 5 et 1 6 B
24 A .
8 A .
1 4 A ,B 2 5 2
,3OS .
1 6 A .
7 A .
H
H
!ü-
H
N
lO
’
‘
CJO
Ô
OO
25 2
00
3
90
5
0
0
5
3
5
5
00
0
0
9
5
oo
2
0d
5
0
5
3
3
3
0.
2
3
3
3
2
A.
.
2
5
5
B
5
B
5
5
5
B
B
5
4
2
2
2
B
B
2
2
2
B
2
%
B
B
B
A
.
A
A
B
A
»
A
A
A
B
A
B
B
.
A
A
A
A
A
A
a
.
A
A
A
A
A
A
A
A
A
AAA
A
A
A
A
B
A
A
7
8
1
7
8
0
1
9
3
0
8
1
5
2
5
0
3
4
3
4
1
3
3
1
2
5
6
7
2
6
1
9
1
1
2
8
1
1
2
2
6
1
2
3
7
1
1
1
1
2
2
7
1
1
1
2
1
2
2
1
4
6
2
5
8
1
8
1
1
1
1
1
2
9
1
5
1
1
1
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7 90 ,
1 3 A; L .
1 5 B 2 5 5,L .
1 6 B 2 5 5 .
2 3 A .
n o te 6 A, B 2 5 5 .
6 A,L .
9 L .
1 8 B 2 5 5,L .
1 9 A,L .
21 A,L .
4 A,B 2 5 6 .
L .
A .
4 L .H
\Î
U‘
80 9,
3 10 ,
8 11,
D
8 12,
81 4
oo
—\Hl©
ifl
—h
1 e t n ote a L .
2 4 A,B 2 5 6 .
2 4 B 2 5 6 .
n o t e g B 25 6 .
1 L.
3 A,B 2 5 6
,L .
1 0 A .
1 8 A .
2 0 A , B 1 6 3 , L.
muæ
t—*H1
x1
œ‘
O
H
H
Œ
86 5,
2 3 A . 866 ,
1 0 e t 1 1 A ,8 260 ,L . 86 7,
1 3 A .
1 4 e t 16 A,B 26 1
,L.
D—i
w
w
w
w
3
wË"
E"
wF‘
w
t'“
F"
01
01
N’
03p.»
T‘
M
IO
I©
®
œc>
10
1o
v
H
H
H
H
H
H
M
H
K‘
H
co
oo
q
œ»
o
www“
3 A,B 262
,L .
1—ç
55
l\?
C')
“l\?
t
0:
:o w
l°
l©
P*
h-‘t
©®
lä
0°
l0
w>w5
5
3
I°O5
ÇO
.a—œw
Ë"
wen
noww
H
H
H
h—>DH
H
»
œH
H
—>œq
œ
wwv
wæ
l“
wq
w»
g
wu>œ
NJ
un
10
en
889 ,
890,
89 3,
89 4,
89 5 ,
89 8,
899 ,
9 00 ,
9 01 ,
9 0 4,
905 ,90 7 ,
, 1 0
2 5 B 2 64, L.
2 1 A .
9 A , B 26 4,L .
1 1 A , B 2 64, L .
1 5 A, B 2 64.
2 0 A
2 1 B 2 5 , L .
2 2 A
1 3 6 1: n . c B 26 5 , L.
2 1 L.
2 3 A .
n o t e a A .
12 A .
2 7 A,L .
1 6 A .
6
1 1 A , B 26 5 , L.
5 A , L .
6 A .
n o te 6 B 2 65 , L .
2 A .
5 A , B 2 65 , L.
1 6 A .
2 1 A,L.
1 6 A , L.
1 3 A .
20 B 26 5 .
8 L.
1 5 L.
n o te 0 A .
4 A .
1 0 B 266 .
4 A, B 266 .
1 5 A .
1 4 A .
n . ô et d A , B 2 66 .
4 A .
1 5 A .
20 A,L .
3 e t 4 A ,B 2 66 , L .
5 A,L .
18 B 2 66 .
16 L .
2 7 L.
9 L .
7 A .
8 L.
9 1 5 ,
9 16,
9 17,
9 18,
9 19,
8,
1 0 ,
20 A .
N
H
H
H
H
OO
N
H
ÇWIO
|—Dœœ
ù
l°
N
u
es
-no
2 4 e t n o te 6 L.
6 A .
8 A .
1 0 A .
1 6 A , B 2 6 7 .
24 e t n o te L .
1 5 A , L.
1 8 L.
9 B 2 6 7 .
1 8 B 1 64,L .
1 4 A .
2 2 e t n o t e a A , L5 A
,B 1 6 4
,L .
1 0 A .
2 5 A .
8 A .
9 A .
1 1 B 2 6 7,L .
1 2 L.1 4 A
,L .
1 6 A .
T ODΠI .
8 A , B 2 69,L . 12 , 7 A .
2 A . 14 B 269 , L .
1 1 20 B 269 . 1 4, 16 A,B 2 7 0 .
1 4,1 8 A .
2 2 A .
1 6 , 7 A , B 2 70 .
9 30 ,
oo
ps
—soa—a.jro
—Auo
—A—A
—O10 —1
l°
lO
N
M
Q
Û
œH
—MŒÔ-r—IÇ
u=-m:
UÈN
OO
O
p
l€
H
1—>OO<
Œ
—mwœw
NC?
Œ.
5
NC)
OO
û-
I©*
mœmo
w
ç>>
3 26 7 .
9 30 ,
9 3 1,
12 A .
1 6 A .
7 A , 0 2 6 7 .
1 1 A ,0
12 A .
1 5 A , B
2 1
2 1 0 2 6 8.
3 A, L .
4 A .
p.L
O
H
N
B 2 68 .
note a L .CD
>n
qo©
œl©ÇD
æ-10
w
Œo
*‘—Dm
5
5
5
5
5
.
t“
10 03
ξ
\Î
IO
N
H
—ï—k
O:
I° 0
0b
www»
.
1 6 ,
1 9 ,
2 0,
2 3
2 7,
2 8,0 9 ,
30,
62 .
1 8 A .
3 A .
1 2 A .
note a A .
1 6 A , B 2 70 .
1 A , B 2 70 .
r—.r*
1 2 A .
1 9 A, B 2 7 3 .
8 A ,B 2 7 3 .
1 2 A .
1 1 A,B
1 6 L .
2 1 A , B 2 74,L .
1 A .
9 B 2 74.
1 3 A , B 1 65 .
1 7 A ,B 1 6 5 .
2 3 A .
1 2 A ,
‘
8 2 7 4.
2 2 B 1 65,L .
1 9 A , L .
2 3 A , L .
3 et note a L .
5 A,B 2 7 4.
1 5 e t n o t e 0 A , L1 7 L.
1 9 A .
2 2 A,L.
2 3 e t n o t e f L .
1 L .
8 B 2 7 5,L .
1 5 A,L .
1 9 A .
n ote B 2 7 5 .
89 , 1 7 B 2 7 5,L
20 B 2 7 5 .
2 2 A .
2 5 A .
9 0 , 2 4 A, L .
9 1,7 A .
1 6 A,B 2 7 5 , L
2 4 A .
9 2, 6 B 2 7 5 , L .
1 6 A .
1 7 L .
9 3, 1 8 B 2 7 6 , L.
9 4, 2 1 A .
9 6, 5 B 2 76 , L .
1 5 A .
9 8,2 B 1 65 .
1 0 A .
9 9, 1 0 A , B 2 7 6 , L.A .
8 L.
1 4 A .
2 1 A . B 2 7 7
101 , 9 A .
1 8 L .
1 9 A , B 1 6 5 .
2 1 A , B 1 65 .
1 02,2 L .
2 1 L.
1 0 3,1 3 A.
1 0 4, 9 e t n ot e a L105
, 1 A .
1 7 A , L.
106, 1 A.
1 6 L.
2 3 B 2 7 7 .
107, 3 A .
9 A .
2 1 A,L .
22 L.1 08
, 1 8 B 2 7 7 .
1 09 , 4 A , L.
6 A,B 2 7 7
,L.
9 A .
1 0 A .
1 1 A .
1 2 A,B 2 7 8 , L .
1 6 A .
2 2 A.2 3 A .
1 10,9 A
,1
1 89 ,
19 0,
l )
19 1,
D
1 9 2,
6 B 2 83 , L .
2 3 A .
1 1 B 283 , L .
1 2 A .
note a A .
7 L .
9 B 1 6 6 , L .
1 66 , L .B
L .
A .
A,B 283 .
L .
A .
g
œŒ—1CDIO
O
M
IO
H
S
IO
H
O
U‘
N
>ñ
NJ
O
OO
H
l
HH
w
wC‘
l\?
\l
00R
\]
ŒlQ
H
H
Œ
1 7 L .
n ote a A , B 1 67 .
7 A .
8 L.
1 6 B 2 84.
note a A .
2 A .
8 B 1 6 7 .
1 8 L .
12 A .
6 A .
n o t e a A , B 284 .
c A , B 2 84 .
8 A , B 2 84.
1 4 B 2 85 , L .
1 9 A , B 2 85 .
2 4 B 2 85 , L.
1 A .
4 et 5 L .
1 2 L.
6 e t n ot e a L .
1 3 A .
1 8 e t n o t e c L .
1 9 L .
2 0 A .
2 L .
205,
206,
2 07,
1 4 L .
1 5 e t 16 A,B 285 ,L
20 A .
24 L .
4 L .
1 1 L .
19 IJ .
2 e t n ot e 6 L .
5 L.
1 1 A .
2 2 A , B}286 .
2 A , L .
4 L .
1 0 L .
1 9 A .
1 9 A , L .
1 0 A .
1 9 e t n .g B 2 86, L
2 1 A,B 2 86
,L
1 A , B 2 86 .
1 A , B 1 67 .
1 5 A .
H
Œpù—H
l—ii—ïùæ
ÿ-ï
QD
\Ï
H
w>>
P,
.
2 32 ,
2 33 ,
2 34,2 3 5 ,
2 36
2 3 7
2 39 ,
2 40,
2 42 ,
243,
244,
2 45,
2 46,
2 47,
20 A .
7 A,B 288.
10 e t 1 1 B 288.
2 4 A .
2 A .
1 9 A,L .
1 e t not e a L .
1 A .
2 B 1 6 5 .
8 B 2 88.
1 6 B 1 6 7,L .
n o t e a A .
1 3 A,B 2 88.
1 7 A .
2 3 A,L .
24 A .
3 B 1 6 7 .
5 B 2 88.
6 e t n ot e d A , B1 6 7 , L .
8 B 1 6 7 .
1 1 A .
1 6 A , B 1 6 8.
n ote la A .
a A .
3 B 2 89 .
6 A .
7 A,B 289 .
1 4 A,L .
n ote A .
1 2 A .
1 3 B 290, L .
n o t e (1 A .
1 7 B 290 .
20 A,B 2 90 .
4 A .
d
2 6 3 ,
% z
2 87,
Dw:
16
—wma
U:
ww1
0CD
g—L
w00
—L[o
u
œr
œ
F!
_t"
©
mù
—wM—ù—awq
—b—sto
—su—æq
u
p
a
t
1 9 , 20 0 t n . c L
1 7 A .
,.2 4 A
10 e t 1 1 A , L.
ç>>
r
—œqmp
wwH
—Hnu
œ—lœw
www wwN
M
(D
CD
g>g>r
t"
n . b B 293 , L.n
293 , L .
[0
N
H
œN
H
H
—lcäuü—1—b
H
WŒ
0°
\I
U‘
>rÿ
?
?
b
wË
E"
2 88,
2 1 A .
2 2 A ,
1 3 A .
2 0 A .
2 80,1 1 A .
29 8,L.
2 6 8,
I
O
10
1°
I°
C‘
v
\Î
v
3
U
“
U
U
5
_U
e
t:
5
U
8
o
u
8
1 8 n 2 9 3,6 4
,74.
2 3 6 2 0 3,6 4
,7 4.
6 B 29 4,L.
n ote a B 2 9 3 .
2 B 2 9 4,XX1,2 1 0 .
3 A .
4 A .
2 1 A .
4 e t no te a L .
7 B 2 94,L .
1 5 A .
1 6 A .
8 B 29 5 .
no te b A .
8 B 2 9 5 , L.
\0
00
:b
ŒNa
v—L
1 7 e t n o t ef A, L.
1 9 A .
2 A .
1 2 L .
2 L .
2 5 A .
1 B 29 7 .
4 A , B 29 7 .
6 A .
2 3 A .
1 A,L .
1 7 B 29 8,L .
29 9 ,300
,
3 01,
3 02,
3 03 ,30 4,
305
306,
3 0 7,
308,
3 10,
M
H
H
wH
H
OO
N
H
œH
lO
l
©\l
®
8 e t n . B10 c 1 1 1 A , B 2 9 8 ,L.
16 A .
c
53
1
-q
>
L.A,L .
e t no te L .O
C‘
2 9 9 .
2 9 9 .
L .
L .
69
ww
01
00
1 2 e t 1 3 A, B
3 00,L .
2 A .
1 B 300 .
n o t e 6 A .
d A .
1 6 A,B 300 .
1 8 L .
2 1 A,L .
1 3 A .
n ote a A .
note a B 300 .
1 8 A .
2 0 A .
22 B 300 .
1 7 A .
3 10 ,
3 1 1 ,
3 12 ,
3 13 ,8 14,
81 6 ,
3 18,
3 19 ,
82 1 ,
3 2 3 ,O3
U‘
9
3 2 7 ,
3 88,
3 39 ,
3 40,
3 41,
3 42 ,
3 43 ,
345 ,
3 47,
348,
2 4 A .
A ,B 1 6 8.
B 3 00,L .
A B 300 .
w
wç
03OO
000
1 0
7 e t n ote a L .
2 1 A,B 3 0 1
1 2 A .
1 2 B 30 1, L.
1 0 et 1 1 B 301 , L
1 9 B 30 1 .
,1 1 A .
1 5 A,B 3 02
,L
2 2 A , B 3 02,L
""
OÏ
M
ŒF‘
OO
Q
ŒH
60
n o te a A .
2 0 A , B 3 02 .
n ote 5 A .
1 6 14.
æ a
% 23 2w2
waM L
wawawa
% m
æ ææ L
H
QD
l°
lO
H
IÈ*
lÔ
V—h
Ch
r—00\”l
7 A , B 305 .
1 5 A , B 306 .
n ote 6 A .
11 A .
note d A .
1 ÆB 3Œ.
2 A .
1 9 A B 306 .
2 2 A
e t 1 2 B 3 06 .
1 7 A .A,B 3 06 .
e t 1 1 B 30 7 .
et note b L .
19 L .
1 8 A .
A,B 1 6 8.
1 6 A .
9 A .
% L
% 5% 3
æm
æ 2
æ 3
æ L
æ 3
æ 3
mL
1 2 A .
2 1 B 1 68.
9 A .
1 1 A .
1 4 A .
18 e t no te a L .
1 3 A .
1 8—20 A , B 30 7 , L .
00
9°
8 308.
®
H
uP—lo
t'*
1>w
oo
q
œr—H
CD
UU
ù
N
M
H
H
H
H
CD
QO
H
l—AHH
ÇD
10
0
4
N
o
œ
fico œCU
lù
lù
r
r
r
[Ô
ŒŒQ
ÜÎ
Ù
D
N
H
ÇD
q
lR‘
w>wç»
p
ww
l.à
ww
_
3
2
“"
CÛ
M
M
H
H
ÇD
N
>ŒO
H
O
w°
?
ÿ
>w
ih—ŒF
ül°
440 ,
2 0 A ,B 49 .
8 A, L .
2 2 A, B 49 .
6 A ,B 5 0 .
1 4 B 5 0 .
2 1 A , B 5 0 .
8 A , B 5 0 .
12 A ,
CJ”!—æ—bp—>HHH O
'
w,°
w_
«l
a
w—Nr—O
www”0—p
U‘
U‘
û
N
N
H
CD
CÜ
ŒCD
U‘
P‘
5
mm 0
1
H
H
ÇD
\l
N
l°
l°
b
m:
H
©ûfl
mo
“>r
ÿ
œ
N>
w
mm
U‘
N
w—owo
1 4 A , B 5 8.
1 9 A ,B 5 3 , L .
2 1 A ,B 5 3 .
1 1 B 5 3 .
14 B 5 4.
B 5 0 .
1 8 A , B 5 1 .
B 5 1 .
1 9 A, B 5 1 .
w
a
en
1°
en
3°
0
à
?
, B 5 3 .
, B 5 3 .
,B 5 3 .
440 ,44 1
,
442 ,
ph
|D
e
œd
u
e
c
e
u
444,
t$
445 ,
446 ,
1 3 A , B 1 69 , 5 4
15 A , B 5 4.
1 A,8 5 4.
3 L .
4 B 1 69 , 5 4, L .
‘
9 A , B 5 4, L .
0—p CD 6
…w
07
01
C‘)
05
0"9°w
w
—su—u—tu—xœæ
cn
wÿœ®
œm
3
47
3
1b
œœ»
û-
O
co
w
ww0
1
3
51
Ê
wen
0 A , ' B 5 7 0
—110
wCR q
H
mH
—AHH
—lmñä—œ
Q
ŒŒH
(O
r—slo
t
o
°
œo
©®
w
% L
% 2
5 2
wm
1 1 4
w8 5 8
1 7 m 8 5&
1 Æ8 5 &
wwwP
.°
w.°
w
05
65
5
5
1 3 e t su iv . B 60 .
1 4 A,B 60.
1 6 B 61 .
1 7 B 6 1.
1 8 B 6 1 .
1 9 B 6 1 .
n ote a A .
g A .
www—xmm
>>h>
15
œ5
5
5
5
U‘
N
H
H
H
H
OO
N
M
wwww
$”
wwww
wa
470 ,
b
lo
wtO
IO
u—sœ
mM
—Hœb
wmu—s—œq Ê
w
www
C‘>
O)
c5
5
5
5
www
ww>Ÿ w
1—s—uæ
t
—ku—ht-ùÇD
vP
CD
mp
w>wa
w
w
ww»:
wou
91
w5“
r
»
q
mp
n
o
>
>>w
w=
w
05
3
5
5
www www,»
_www5
5
5
5 A ,B B .
CD
19 B 66 .
n mu n
6
8
4K)
15
pü
e
e
e
:
ä
e
ë
e
e
c
z
N
H
H
OO
N
N
H
IO
H
% 3
2 3 B (16 .
1 A,B (36 .
2 A .
1 0 A .
12 B 6 6 .
1 7 A , B (36 .
2 1 A,B 1 6 9
,
2 3 A , B 6 7 .
note B 6 6 .
1 B 6 7 .
1 8 A , B 6 7 .
6 A , B 6 7 .
9 A , B 6 7 .
1 0 A .—5 m
wwG>
s
5
5
00
ww9°
m
m
28
%
q
><D
U‘
û—æ
>w>>
\9
c
v
C‘)
a
u
oo
“
w
UU
_oo
ww
c:
®
cv
oo
wc:
SD
P°
ww
co
co
1 0 B 69 .
” 8 69
1 8 4 8 69
, 2 8 æ .
5 4 8 6 9
485,
486,
487,
488,
489,
49 0,
49 1 ,
ù
ÇJ
Cî
Q
wn
u
—s—mçç
wl
o
N
C:
Œe—t©
n'
5
5
°
lO
®
ñ—\Iœm]oc::
n'
“
—tcc
.—qu»
œg>ç>>
H
K]
P
æ
ŒÈD
N
N
N
H
H
H
N
H
N
—‘H
r—ù—‘ÇD
(0
01
cc
m
8 e t su iv. B 7 1 .
1 7 B 7 1 .
no te g A .
1 e t 2 B 7 2,L.
03
œœ>
?>g>œ
Wifi-
N
9°
q
5
5
5
www—camo
u
co
—1w00
q
wc”
qqg:
.a
oo —1 E
‘"
a: —x
Ë
æ
ë
œq
wmœw
œCU
CU
«19 1 ,492 ,
49 3 ,
49 4,495
,
498,
49 7,
49 8,
499 ,
5 00,
501,
_,
o
v
mu
u
e
u
e
wo
m
*Î
ŒIO
N
IQ
—ïl—b—sqlo
wtfl
w
to
wn—«tmc
-b
l\D
22
N
H
M
N
H
H
œq
œl
—œœ—>NO
m—mw—H—oo—n
c
oo
n—ww»
>5
5
5
5
?
226 4
B 1 70 .
B 7 4 .
q
q
°°
s
5 02 ,5 03
,
l\?
œœoo
—1 _«1
ÏÏ
Œ
w
\l
00
q
u
\1
I0
—ul—3mm
CD
H
©
9°
œ5ä
w
l0
>>œ
xl
q
ŒN
H
NJ
—lräs—n—H—b—b—ëœ
œ€”
œ
CU
ŒŒ
qO0
10 A , B 78 , L .
n ote a A,B 7 8.
\1
q
—1 9°“I
9°
—1 9°
5 15,8 A, B 81 .
5 1 7,
5 1 8,
5 20,
5 2 1
2 1 B 82 .
n ot e d B 82 .
1 0 B 82 .
n ot e 0 B 83 .
00
03
60
:
H
H
H
ÇD
N
H
lO
H
H
H
Q
Œ%
œH
H
H
H
H
QO
OO
ŒÈ
N‘
H
ua
—Hmœœl°
o
www.—sq
H>N
O
M
5 6 3 ,
5 64,
5 65 ,
5 66 ,
am
N
N
IO
IÔ
H
H
q
>»
œa>
CD
Σ
5
°°
QD
ww
QD
CD
QD
ÇD
M
N
H
—CDG?w(D
CD
wo
œm
C
O
01
w
co
CD
CD
GD
ŒŒŒQD
fl>l°
CD
9 7 .
CD
N
H
U
IQ
H
N
Q
M
H
CD
wa
00
rh—NU‘
>œw>flwœ
9 8.O
1 3 A .
n ote 6 B 9 87 A .
8 A .
9 A . B 9 8.
1 1 A , B 9 8.
1 2 A , B 9 8.
1 6 A , B 9 9 .
n ot e g A .
2 B 99 .
3 A , B 99 .
5 67 ,
5 68,
5 7 4,
5 7 5,
1 0 A .
B 101 .
1 7 A
1 8 A, B
n ot e 8 B 101 .
4 A , B 1 01 .
5 e t 6 A .
1 0 B 10 1.
OO
O©
N
5 7 7 ,
5 7 8,
_
5 7 9,
5 80,
N
M
H
H
—HŒŒŒlO
H
M
H
H
q
œœ—H
2 8 B 104.
7 A , B 104.
œœ>°
ϩ
Ü‘
w>p
m>>
l©O
CD
Q
ŒQ
?>www—5
o
9—5
w
o
wœ
H
50
H
“
O
OO55
0 ç-pCD
ÇD
ΝH
N
H
—ïl—A—b
H
ÇD
OO
N
U
»
ma>œ
1 7 A , B 1 14.
5 92,1 4 A , B 1 14.
1 1 A, B 1 1 1 .
L.
5
4
1
1
1
0
1
5
B
1
B
1
AAA
A
A
A
00
1
1
2
1
2
5
6
8
9
1
1
»
% e
»
5
5
1 5 A .
1 6 4
h
L e
0
o0
D
D .
"
I o
fi
l o
”
l o—I o
8
0
o
u
] .
L
1
6
6
6
1
mm
7
1
1
1
1
7
7
4
&6
1
u
n
n
6
1
6
1
.
z
n
1
1
1
1
8
.
M
M
1
1
A
5
1
1
1
1
B
1
B
1
7
1
B
B
B
B
B
1
A
B
l
d11 1
l
1
1
1
B
B
B
1
..
1
B
u
l
B
.
k
1
n
B
B
B
B
B
.
.
A
.
A
A
.
ŒB
B
ABAA
A
A
A
B
A
B
B
A
A
A
A
A
A
A
ŒA
A
B
ŒA
A
A
A
3
0
1
2
7
5
0
1
2
2
3
9
1
0
3
2
0
3
4
2
n
5
1
1
1
2
1
1
1
5
6
7
9
1
1
1
5
9
2
8
2
2
2
2
1
1
1
2
n
6
1
2
n
5
8
1
1
5
5
5
5
5
5
6
6
6
L .
L
L
L
.
1…
2 .
2
2 .
L .
A…
1
1
1
1
1
1
2
1
1
2
2
1
3
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
.
1
1
1
1
7
8
8
1
1
L
n
1
.
2
2
8
4
1
2
1
2
œ
ww1
1
8
u
2
1
1
o
1
o
7
1
o
.
A
B.
ABA
B
A
A
B
A
B
B
-.
ABAA
.
A
A
A
A
A
B
A
L
A
B
mA
B
A
B
AA
A
A
1
5
9
6
4
7
4
6
8
9
0
0
2
5
0
3
4
1
4
1
5
1
1
1
1
2
3
4
5
1
2
1
1
3
5
6
1
1
1
1
2
D
2
4
7
9
1
1
2
2
2
6
8
1
1
2
2
19.
5
5
5
5
5
5
mmwæ
Ζ
lê
wu
u
œœrù—HH
H
H
H
wN
I—9Mb—ùœœoü-
m
wp-à c
e
e
s
u
e
u
e
z
e
â
u
v
u
c
z
î
z
e
:
e
z
O 903
ma
ma
mm
m
wmv—OO
B 149 .
H
H
‘
01
mwH
.50
”
*l
œ
œ}>ç>tä
_h>H
ù
N
O ”
a
:
U‘
5
9
3
5
O‘
O
1 5 1 .
w
—;cu m€fl
1-sen
wo
u
o
©œ
A
, B ŒL—HHH
N
N
H
H
H
H
ÇQ
M
H
H
H
M
S
mœw
15
5
5
6 17 ,
6 18,
6 19 ,
620,
621 ,
268
CD
C)
N
N
Q
ŒN
lÔ
H
Q
l©
lÔ
(Ô
N
H
>
|è
H
O
ÇD
lO
mm.
Q
N
N
H
H
H
H
Q
1 7 A .
n ot e A,B 1 5 6 .
62 5,
6 88,
684,
n ot e g B 1 5 6 .
5 A , B 1 5 6 .
8 B 1 5 6 .
;t>
m}:
l©
wfi
H
wœmH
—ñr—èr—‘HŒJ
M
lO
IO
N
H
H
*‘
UÏ
ŒQO
H
Œ
O
lO
H
Q
OÙ
U‘
2 5 A,B 1 5 7 .
1 5 A ,B 1 7 1
, 1 5 8 .
l 7 e t 1 8 A,B 1 5 8 .
1 9 B 1 5 7 .
note 0 A.
e A .
1 B 1 5 8 .
4 A .
1 5 A , B 1 5 8.
not e 8 B 1 5 8.
5 A , B 1 5 8.
9 B 1 5 8.
1 5—18 L .
2 2 A , B 1 5 8.
2 B 15 8 .
2 2 A , B 1 5 9 .
14 A .
1 6 A .
1 7 B 1 5 9 .
2 4 A .
8 A , B 1 5 9 .
1 1 A , B 1 5 9 .
22 B 1 5 9 .
HC)
O
7 02 ,
6 A ,8 1 7 0 .
1 9 8 1 70 .
2 1 A , B 1 70 .
8 A .
1 1 B 1 7 0 .
1 4 8 1 70 .
1 2 B 1 7 0.
1 8 B 1 7 0 .
3 A ,8 17 0.
6 B 1 7 0 .
1 5 A , 8 1 7 0 .
8 A.
1 8 A .
22 B 1 70 .
14 A , B 1 70 .
1 6 A , B 1 70 .
tü-
ŒN
O
ŒU‘
O
70
704,
706 ,
7 07 ,
7 08,
7 09 ,7 10,
7 1 1 ,
7 12 ,
7 1 8,
7 13,
5 8 1 7 2 .
9 8 1 72 .
1 0
1 7 8 1 7 2 .
22 8 1 7 2 .
2 8 A,8 1 72 .
1 B 1 72 .
1 2 B 1 72 .
1 3 A .1 4 A ,
B 1 7 2 .
1 2 A , 8 1 72 .
15 A, 8 1 7 2 .
1 6 A .
1 B 1 7 2 .
2 B 1 72 .
O
ÇD
lO
1 B 1 7 3 .
4 B 1 7 3 .
1 8 8 178 .
2 4 8 1 7 8 .
1 8 1 78 .
3 8 1 7 3 .
7 A,:8 1 7 8 .
10 8
1 8 A,8 1 7 4.
1 7 A .
1 A, 8 1 7 4.
7 14,
7 15 ,
7 16,
9
1 6 A, B 1 74.A .
1 8 A , B 1 7 4.
1 3 A, B 1 74.
—mm.
u
»
œ<
uæ-
N
mn
u
n
q
æ
œu
n
œ—œœ—tœœ
o
œœm»
æ
H
H
H
[Q
H
H
M
N
H
m.
q"
t°
1
°
I°œ
u
\1
[O
5
1 6 B 17 6 .
1 9 A .
2 0 A , B 1 7 6 .
2 1 B 1 7 6,I»
6 A .
7 A , B 1 7 7 .
1 5 B 1 7 7 .
2 0 A , B 1 7 7 .
5 A , B 1 7 7 .
24 A , B 1 7 7 .
2 A,B 1 7 7 .
7 B 1 7 7 .
10 A , B 1 7 7 .
1 4 B 1 7 7 .
1 5 A , 8 1 7 7 .
1 8 A .
1 9 B 1 7 7 .
2 4 A .
2 A,B 1 7 7 .
4 A, B 1 7 7 .
7 B 1 7 7 .
1 0 A,R I 7 7 .
2 1 A .
2 3 A , B 1 7 7 .
2 5 A,B 1 7 7 .
9 A , B 1 7 7 .
1 3 B 1 7 7 .
1 7 A , B 1 7 7 .
1 9 B 1 7 7 .
2 3 A .
1 A , B 1 7 7 .
3 B 1 7 7 .
6 A .
7 e t 8 A .
1 1 A .
1 3 B 1 7 7 .
1 4 A , 8 1 7 8 .
1 5 A, 8 1 7 7 , 1 7 8.
1 7 A , 8 1 7 7 .
24 A .
5 A .
8 17 8.
8 1 7 8 .
8 1 7 8.
B 1 78.
0 A , 8 1 7 8.
2
2
3
5
6
7
8
9
1
1 1 A , B 1 78.
7 2 8, 18 8 1 7 8.
59
a
u
0
8
8
::
ËÊ
15
c
c
a
7 3 1 ,
1 4 A , li l 7 8 .
1 8 A, 8 1 7 8 .
2 1 A,13 1 7 8.
2 0 A ,8 1 80 .
25 72 8 1 80 .
5 A .
1 0 A…7 B 1 80 .
9 ct 10 A ,8 180 .
1 3 A .
14 A ,!3 1 80 .
2 1 .A .
22 A…24 e t 25 A , 8 1 80 .
1 A , 8 1 80 .
2 B 1 80 .
786,
D
7 3 7,
7 42,
748,
9 8 180 .
10 A , 8 180 .
1 4 A .
1 5 A .
4 A ,B 1 80 .
5 A , 8 180 .
14 8 181 .
1 6 8 181 .
1 7 A,8 180.
19 A,11 181.
2 1 8 181 .
2 2 8 1 81.
1—booCO
wœ.
N)
œœÿÿ
œp
wwHHœœl\9
'lÛ
7 48,
7 49 , 1
7 5 0,
7 5 1 ,
7 5 2,
7 5 8,
7 5 4,
6 A , 8 1 82 .
1 6 A, 8 1 82 .
1 7 8 1 82 .
20 A , 8 182 .
2 1 A , 8 188.
28 A , 8 1 88.
1 A ,L .
4 A .
1 8 A .
8 A ,8 1 88 .
7 8 1 88 .
8 A .
9 8 1 88 .
10 A ,8 1 88 .
1 1 B 1 88 .
1 4 A ,8 1 88 .
1 6 A , 8 1 88 .
no te 0 A , B 183 .
1 8 A ,8 1 88.
8 1 84, L .
>œœœm5
8 1 85 .
B 185 .
ü
H
ñ-
ŒOÔ
Q
O‘J
N
H
Œ>P
ŒŒP
OO
! 00 5
y-L S“
185 .
0 B 1 85 ."
Q
ŒN
H
N
M
IO
M
H
H
—Hq‘
H
H
H
H
H
OO
KÎ
û
—blo
ŒCÜ
ÜÎ
l°
F‘
“
48
4
5?
O0
US
..
00(D
i
19 A .
2 1 A ,8 1 87 .
2 2 A , 8 1 87 .
2 A .
7 6 3, 2 2 A , B 1 87 .
n ot e 8 A , B 1 87 .
7 6 4, 3 A .
9 A .
1 0 L.
1 6 A,B 187 .
1 7 A, B 1 87 .
2 3 B 187.
7 6 5,1 5 A
,B 1 88.
18 A, B 1 88.
2 1 A .
7 6 6,2 A .
2 e t 3 B 1 88.
6 B 188 .
10 B 1 88.
1 1 B 188 .
1 3 et 1 4 L.
1 5 B 1 88.
1 8 B 1 88.
1 9 A .
7 67 , 7 A .
9 A .
1 2 L .
1 3 B 1 88 .
1 8 A .
1 9 A .
2 0 A,B 188.
2 3 B 1 88 .
7 68, 8 A , B 1 89 .
1 3 A .
1 6 A, B 1 89 .
1 8 A, B 1 89 .
1 9 A .
2 1 A,B 1 89 .
7 69 , 5 B 1 89 .
1 5 A, B 189 .
1 6 B 190 .
2 2 A, B 190.
n ot e 0 A, B 189 .
7 7 0 , 6 A .
7 A, B 190.
8 A, B 19 0.
1 0 B 1 90 .
1 3 A,B 1 9 0.
14 A,B 1 90.
1 6 A .
1 7 A .
1 8 A .
7 7 1,2 B 190 .
6 A .
79 5 ,
7 9 6 ,
7 9 7 ,
7 98,
23
8
“o
8
8
8
8
8
806 ,
807 ,808,
809 ,
81 0,81 1 ,
19 8 200 .
2 1 A , 8 200 .
2 8 200 .
5 A, 8 200 .
18 A , 8 2 00 .
2 5 A , 8 20 1 .
n o t e d 8 2 0 1.
1 8 20 1.
7 B 2 0 1.
1 4 A , B 20 1.
10 A .
2 0 A .
2 2 L .
1 A .
1 7 A. 8 20 1 ,
2 3 B 20 1 .
ŒH
N
N
N
H
y-byà—NH
Œ
H
ÇD
H
lO
N
U‘
G)
2 74
8 12 ,
8 18,
814,
815,
816,
819,
6 B 202 .
1 2 e t 1 3 B 2 02 .
wQD
N
O
H
H
œœl—D—s—‘
œmlè
whä
œ
H
Q
824,
1 4 B 2 05 .
o
æ
œN:
oau
c
oo
w
w>>
10
15
l°
m
œmww»
1o
—HœG
O
O
>g>3>www
0
ND
e
www
no
o
c:
ca
c»
O
.
.
CD
01
lü°
5
5
8
5
“
w
ww
IO—1
C
O
M
fil
.—IO
mœq—MIQ
H
H
ÇD
H
H
H—h—hœq
65
15
10
»
ŒQD
OO
«1
œwwn
»
>—sœ
HH—œ
15
.—t°
2 7 5
e t 1 8 B 208.
1 9 e t 2 0 B 208.
829 , 16 8 208.
1 7
9 .
9
0
9
m
2
A
B
B
A
A
AA
1
2
1
2
2
2
2
3
4
8
1
1
4
7
831,10 8 209 .
DD
1 6 A B 209 .
1 7 A
882, 2 8 209 .
DD
3 A .
4 A .
1 5 A .
833, 4 A , 8 209 .
1 3 A .
20 A .
2 1 A , 8 209 .
2 5 A .
884,1 A .
884, 2 8 2 09 .
ceä
c
e
u
u
u
a
u
u
u
7
6 A ,8 209 .
8 A .
1 0 8 209 .
11 A .
1 5 A.
1 6 A .
1 7 A, 8 209 .
1 9 A , 8 209 .
2 2 A .
5 A,8 210 .
6 A,8 2 10 .
L I S TE D ES M OT S
E X P L IQ UÉS D A N S C E VO LUM E .
71413 1 1 32 .
7 5 .
a u Lîa ;j
.; (B arb itania) 14 , 1 5 .
II 1 5 1 . 1 5 2 .
I 78—81 . III 209 , 2 10 .
I 2 23 .
X 84 .
M ; 84 .
V 2 1 1 .
au l ieu deLaLs
‘
ù‘
1 5 5 .
pl .
23 6 .
-W: 3 IV 3 1 .
J .ä3 II 1 92 , 200 .
M 200 , 2 01 .
a} 1 93 .
L5 ;'Ë> II e t IV 183 , 184 .
2243.
184 .
IV , avec deux accusatifs ,L5
171 .
IV , suu m de
2 14 .
LÉ\Ï>, 1 3 2 .
ŒÔ‘> V III , suivi de 1 08 .
)
"
L> —5L> D : a1 82 .
1 00 1 01 .
2 7 8
V 1 1 7 .
I 2 19 .
J” " ‘
J ’ÏW
II 3 5, 36 .
45,46 .
° 1205 , 206 .
au…
J J… V III 2 16 .
U_ä… V III 47 .
Q:… 1 2 20 .
J a k… II 2 1 7 , 2 18 .
;:s 23 5 .
8)L:äi 148 , 149 .
10 .
IV 188.
U… 1 24 , 12 5 .
I 2 19 , 2 20 .
II 1 12 , 1 13 , 1 1 6 .
M , wLâ îu n 1 13 .
16 .
CLA: I , suivi de 2 05 .
_Ia î£o 88, 89 .
,.I.
65 I…
1 58 , 1 59 .
62 , 6 3 .
176 .
&L;b (fém .) 87 .
II 1 95 .
VII 122 .
I 1 5 9—162 .
V 1 75 .
W V 6 . V III 2 07 .
\ .i ‘
a—a I , smwdeL55 ’ 12 3 .
V 7 .
Ua : VI 18 .
2 18 .
â“ l ° ’ Pl ‘ @ :
1M '
L5‘Ï>J LÈ 40 .
AL.: 2 7 .
II 22 9 .
0° 3 7 , 3 8 .
w . fi 1 14 .
pl . U”) Ë ' 102 .
…Lè 1 . 61$ \œ18
,.Llé 86 , 87 .
II.
;àâ ü 1 45 .
V 206 .
w u 51 «J … .J î
W I 1 67 .
Œ.g, îùä 1 78 .
ÙO.5 (plan ) 1 1 .
)O.S I , sa ns 1 49 .
L: I 1 62 .
J
v“ , V 7 2 .
V 7 , 8 .
À Ï â 2 1 1 .
æ1îI:i 10 .
œ15 I , suivi d e 6 7 .
04€
IV 6 6 , 6 7 . V 6 7 , 2 25 .
2 14 .
6 7 , 22 5 .
_ä iä. 2 2 5 .
J LW 134 .
,j L3 (fut . 75) V 5 6 .
12 7 .
rLo ÂÜS À AÀ 4—6 .
Ü-j II 46 .
8 5 V, ave c et a vec l’
a ccus . ,
140 , 14 1.
280
653 II , avec deux accusat ifs ,1 73 .
Uu $ b o V 23 1 .
sing ., pl .U,.îf
a , 22 , 23 .
I 1 98,199 .
31» I . Î L.a 1 05 .
II 1 79 .
pl . 228, 229 .
XÀ.Ê.æ
2 19 .
C>…s. C>… s 1 96 .
I , suivi deC
a ’ 141 , 142 .
…5 1; IV 118 .
,oL3 1 15 .
41 .
ïJ ° LAA 70 .
8 3II 2 20
, 221 .
.5, 70 .
O ) )I 83 .
ç a…, X 40 .
I et V III 9 5
uJ.x$ 230 .
3115 86 .
I, 88 , 34 .
II, suiv i de 1 02.
Rs ouL5£s IV 23—25 .
VŒII 23 7 .
I 1 69 , 1 70 .
3313 185 , 1 86 .
223 185 , 1 86 .
U Ls III 186 .
,jL,s 226 .
JQ}I 2 26 .
a u : , pl . 1 72 .
X, suivi de
511, 1 54 .
II 221 .
W 2 21 .
155 226 .
I 216 , 2 17 .
41 , 42 .
â àS)-î a P]. Ü L£ A S
J .J , 42 ,
































































































































































































































































































![TEXTE ESPAGNOL] TRATADO DE LIMITES ENTRE ESPANA ...](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/63143441b1e0e0053b0eaae0/texte-espagnol-tratado-de-limites-entre-espana-.jpg)