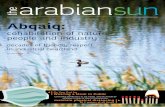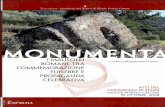LES FRESQUES DE KAFTOUN AU LIBAN : LA COHABITATION DES DEUX TRADITIONS BYZANTINE ET ORIENTALE
Transcript of LES FRESQUES DE KAFTOUN AU LIBAN : LA COHABITATION DES DEUX TRADITIONS BYZANTINE ET ORIENTALE
Chronos no 20 - 2009
Des peintures murales de qualité exceptionnelles ont été découvertesrécemment (entre 2003 et 2007) dans l’église Saint-Serges-et-Bacchusde Kaftoun dans le Liban Nord.L’église, dédiée aux saints Serge et Bacchus, est de structure basilicale(Fig.1). Six piliers massifs divisent l’espace intérieur, trois de chaquecôté. Mais les quatre piliers des extrémités est et ouest sont engagésdans les murs de telle sorte que les deux piliers centraux sont libres. Dece fait, l’intérieur est divisé en deux travées seulement. Le vaisseaucentral, dépourvu de l’étage de fenêtres (le clerestorium) dans sa partiesupérieure, est couvert d’une voûte en berceau légèrement brisée et setermine par une abside semi-circulaire saillante à l’extérieur. La neflatérale nord, ayant été détruite et emmurée à une époque antérieure, aété dernièrement reconstruite selon le modèle de la nef sud2 (Fig. 2).Celle-ci, plus basse que la nef centrale est couverte de deux voûtesd’arêtes et se termine du côté est par un mur droit percé d’une niche.Un porche voûté en berceau et probablement plus tardif que l’égliseprécède la partie centrale de l’entrée (Nordiguian et Voisin 1999 : 166).Le nombre d’ouvertures est très réduit : la baie en meurtrière percéedans l’abside, les deux petites ouvertures dans la partie inférieure de lavoûte et l’oculus flanqué de deux fenestrons sur le mur ouest et quirappelle le modèle des églises croisées (Nordiguian et Voisin 1999 :217). Une semi-obscurité baigne l’intérieur.
CHRONOSRevue d’Histoire de l’Université de BalamandNuméro 20, 2009, ISSN 1608 7526
LES FRESQUES DE KAFTOUN AU LIBAN : LA COHABITATION DES DEUX TRADITIONS
BYZANTINE ET ORIENTALENADA HELOU1
1 Université Libanaise.2 La reconstruction de la nef nord a été effectuée sous la responsabilité de la Directiongénérale des Antiquités.
Chronos no 20 - 2009
LES FRESQUES DE KAFTOUN AU LIBAN 9
Cette structure est typique des constructions romanes. Toutefois,et contrairement à la nef centrale, les bas-côtés se terminent à l’est parun mur rectiligne, non pas semi-circulaire. Le peu d’ouvertures rendl’espace central sombre. Une mouluration à forme très simple cintre lepérimètre de la nef au niveau du commencement de la voûte. Toutes lescaractéristiques de cette architecture et de ses détails témoignent del’origine croisée de l’église, qui possède des ressemblances avecbeaucoup d’autres monuments du Liban datant de la même période,comme l’église Saint-Saba à Eddé de Batroun et celle de Rashkida, ouSaint-Charbel de Maad (Nordiguian et Voisin 1999 : 116, 160-162, 164,169). La particularité de ces églises qui remontent toutes à l’époque desCroisés (XIIe-XIIIe siècle) réside dans leur plan basilical et leurcouverture en voûtes d’arêtes ou en berceaux brisés, ainsi que dans leuraspect rustique qui participe de leur caractère rural.
Les églises qui répondaient à des commandes strictement croisées,telles les églises urbaines Saint-Jean de Jbeil et de Beyrouth ou Notre-Dame de Tartous appartiennent à l’architecture dite localement «croisée ». Elles se distinguent par leur grande dimension, leur formerégulière et équilibrée et la taille très régulière de la pierre (Folda 1995: 69-74). Par contre, les églises de type rural où les proportions ne sontpas rigoureuses, l’appareil des murs extérieurs et parfois intérieursgrossier et les dimensions plutôt réduites, sont des constructionslocales, quoique naturellement influencées par l’art des Croisés. L’égliseSaints-Serge-et-Bacchus de Kaftoun avec l’irrégularité de certains de sestracés, les dimensions réduites et la lourdeur de ses masses sembleappartenir à ce dernier type, où coexistent des éléments del’architecture occidentale levantine et de l’architecture locale. Dans lesdeux cas, des fresques couvraient le plus souvent les parois intérieures. Il y a encore quelques années l’église Saints-Serge-et-Bacchus deKaftoun était à l’abandon. La découverte des fresques a cependantredonné au site toute sa splendeur et son importance. Elle a surtoutdéclenché une nouvelle problématique sur l’origine des peintres qui yont travaillé3 (Chmielewski, Waliszewski 2005 : 447-452 ; Hélou,Immerzeel 2005 : 453-458 et 2007 : 315-317 ; Hélou 2008 : 28-37). Les peintures recouvraient probablement les deux niveaux des parois de
3 Les fresques ont été dégagées de dessous l’enduit de chaux qui les recouvrait et furentrestaurées par Tomasz Waliszewski et Krzysztof Chmielewski de l’Université deVarsovie. Les travaux de restauration sont terminés en 2008.
NADA HELOU10
l’église. Elles n’ont été retrouvées que dans l’abside et dans certainesparties de la nef centrale. De ces deux niveaux, seuls des fragmentssurvivent (Barsky 1896 : 66-67)4. Se déploient dans l’abside une grandedéisis (Fig. 3) avec le Christ trônant intercédé par les deux Suppliants,la Vierge et le Précurseur et, à droite du trône, un séraphin tenant unlaborium avec le trisagion (saint, saint, saint) écrit en grec. Un autreséraphin ou chérubin devait faire pendant à son homologue de l’autrecôté du Christ, mais sa figure est effacée. L’image de la déisis avec lespuissances célestes symbolise le thème du Christ triomphateur dans saSeconde venue. C’est l’un des sujets les plus répandus dans les régionspériphériques de l’Empire byzantin, et surtout au Liban où il occupe laconque de l’abside qui constitue la place la plus privilégiée de l’église(Nordiguian et Voisin 1999 : 217-281; Cruikshank Dodd 2004 : 34-36;Hélou 2006 : 32-47). Une Annonciation (Fig. 4) a été découverte sur la partie supérieure del’arc triomphal. Jusqu’à une date très récente, cette composition étaitinvisible au visiteur, car elle se trouvait au-delà de l’extrados de la voûtede la nef5. Celle-ci a été apparemment reconstruite à l’emplacementd’une voûte plus ancienne qui était plus haute et sous laquelle setrouvait la scène. De part et d’autre de l’abside, une Communion desapôtres défile sous la mouluration qui cintre la nef, sur les murs nord etsud. La scène est traditionnellement divisée en deux parties, où chaquegroupe de six disciples s’avance (Fig.5), les mains tendues vers leSeigneur pour recevoir l’Eucharistie. Le Christ, représenté deux fois,debout derrière une sorte de balustrade, offre l’eucharistie sous les deuxespèces. À gauche, sur le mur nord, le cortège est précédé par Pierre qui,le dos courbé, les mains tendues en signe de soumission, reçoit le pain.En face, sur le mur opposé, dans une pose analogue, Paul s’apprête àrecevoir le calice (Fig. 6). On aperçoit ici, derrière la figure du Seigneur,le ciborium dont le pendant sur le mur opposé n’existe plus. Constituéd’un baldaquin en forme de coupole soutenue par quatre colonnes, le
4 Le voyageur russe Vassili Grigorovitch-Barsky qui a visité Kaftoun entre 1728-1744raconte avoir retrouvé un monastère en état d’abandon mais dont les murs montraientdes traces de peinture ; parmi elles le moine mentionne des figures d’évêques sur laparoi absidale. Actuellement, aucune trace d’une telle composition n’a été conservée.5 La dernière travée de la voûte de la nef a été enlevée en juillet 2009 de telle sorte quela peinture se trouvant sur l’arc de l’abside est devenue visible de l’intérieur de l’église.Cette opération eut lieu sous la supervision de la Direction générale des antiquités et derestaurateurs polonais.
Chronos no 20 - 2009
LES FRESQUES DE KAFTOUN AU LIBAN 11
ciborium fait allusion à l’autel de sacrifice et au Saint Sépulcre. Lesnoms des apôtres sont désignés en syriaque au-dessus de leurs têtes etles abréviations du nom du Christ sont en grec.
Fragment de la fresque de l’Annonciation sur l’arc de l’abside
Dans l’abside, la déisis
NADA HELOU12
La Communion des Apôtres avec six disciples. Mur nord.
Paul s’apprêtant à recevoir le calice. Fragment de la Communion des Apôtres.Mur sud.
Chronos no 20 - 2009
LES FRESQUES DE KAFTOUN AU LIBAN 13
Sur le prolongement de cette scène, sur le mur nord, la peinturecontinue, mais il ne reste visible que le visage d’un ange dans unmédaillon (Fig. 7), d’ailleurs très bien conservé, et les traces d’unefigure debout de laquelle il ne reste qu’une partie du nimbe, et les restesde l’inscription en grec qui la désigne. On peut déchiffrer ici les lettresDO [-]E… qui pourraient désigner Dométios, soit Doumit qui est unsaint fort vénéré par les différentes communautés chrétiennes du Liban(grecques orthodoxes, maronites et syriaques) (Nordiguian 2003-2004 :187-192 ; Hélou et Immerzeel 2005 : 453 ; Hélou 2007 : 47 et 2008 :33)6. Dans l’écoinçon de l’arc situé en dessous de l’image du Christ de laCommunion, toujours sur le mur nord, apparaît la figure à moitiéconservée (le côté droit étant détruit) du diacre saint Laurent, identifiépar l’inscription grecque qui le désigne, avec, à sa gauche, un ange lebénissant. Cet emplacement à l’entrée de l’abside est réservé, dans lesprogrammes iconographiques byzantins, à Étienne (Stéphane) commec’est le cas à Bahdidat au Liban (Hélou 2006 : 34) et à Mar Moussa enSyrie (Cruikshank Dodd 2001 : 31). Laurent, archidiacre de Rome auxtemps de Sixte II, est assimilé ici au protodiacre7 (Duchet-Suchaux etPastoureau 1994 : 214).
Une inscription écrite en arabe, en noir sur fond blanc (Fig. 8),court sur la corniche qui fait le périmètre de la nef au niveau de la basede la voûte. L’écriture, très détériorée, n’est pas encore déchiffrée, maison peut lire : , ce qui se traduitcomme « [Anta]kia et tout l’Orient et ceci eut lieu le jour … ». Cette phrasequi est l’attribut du patriarche d’An[tioche et de tout l’Orient] nousmène à déduire qu’il s’agit soit d’une commande patriarcale soit que ledécor de l’église ait été effectué au temps de ce patriarche dont l’identitéreste à découvrir. L’inscription étant de toute apparence dédicatoire,c’est la deuxième hypothèse qui est plus plausible. Quatre figures, réparties en deux, occupent l’intrados des arcs quireposent sur les deux piliers encastrés de l’est, face aux fidèles.Représentées en pied, elles portent des phylactères déroulés dépourvusd’inscription. On voit apparaître sous leurs manteaux, un rectangle bleumarine, qui n’est rien d’autre que le schema des moines, ce qui les
6 On retrouve l’inscription identifiant le saint dans la fresque, très détériorée de l’églisede Saydet el-Kharaeb à Kar Hilda, village qui se situe dans les hauteurs du pays deBatroun, à une quinzaine de kilomètres à vol d’oiseau de Kaftoun.7 En Orient, Laurent est souvent associé à Étienne et Vincent de Saragosse.
... c«¬ hS°ÉFô Gdªû°ô¥... hcÉ¿ Pd∂ jƒΩ...
NADA HELOU14
identifie tous à des moines8. Une inscription très effacée accompagne lafigure de droite du pilier nord (Fig. 9). On y discerne les lettres a-e-iox,qui désigneraient Arsenios9. Ayant vécu dans la seconde moitié du IVesiècle, Arsénios aurait mené une vie d’ascète dans le désert d’Égypte.Plus tard, sa vie sera relatée par saint Théodore le Stoudite (759-826),fondateur du monastère de Stoudite à Constantinople et défenseuracharné du culte de l’image. Le personnage à côté d’Arsénios pourraits’identifier à Théodore le Stoudite. Les deux figures du pilier opposé,quoique fort mutilées, laissent deviner la silhouette de saint Saba à latête ronde et chauve, aux cheveux blancs, à la barbe courte et fourchue(Fig. 10). Connu pour être le fondateur du monachisme oriental, sa viefut décrite par Cyril de Scythopolis (514-557). Le personnage qui setient à côté de Saba pourrait s’identifier à ce dernier car lui-même,originaire de Palestine, avait vécu en moine dans la laure de saint Saba.La tiare tronconique qu’on aperçoit sur sa tête et qui est généralementporté par les sages d’Orient serait l’attribut de cet éminent hagiographe.
8 Cette remarque m’a été révélée par Mahmoud Zibawi. 9 Le déchiffrage de cette inscription a été réalisé par Michele Bacce.
Le visage de l’ange dans le médaillon. Mur nord.
Chronos no 20 - 2009
LES FRESQUES DE KAFTOUN AU LIBAN 15
La dédicace. Fragment visible sur lemur nord
Saint Saba : la figure de droite dupilier sud
Saint Arsénios : la figure de droite dupilier nord
La figure plus ou moins conservée deBacchus sur le pilier à gauche de
l’entrée
NADA HELOU16
Quatre saints soldats se tiennent debout en pied dans les intrados desarcs sur les quatre piliers de la travée suivante : Théodore et Georgesface à l’abside se tiennent vis-à-vis respectivement des saints patrons del’église, Serges et Bacchus (Fig.11). Dans les fresques du Liban et de larégion, les saints soldats sont souvent représentés à cheval sur leurmonture, et non debout comme il est le cas ici avec leurs boucliers tenusverticalement et posés au sol10. Cette dernière façon de représenter lessaints guerriers (debout en pied) provient indubitablement de latradition byzantine.Le programme iconographique, quoique en grande partie détruit, estbien clair : toutes les scènes et figures convergent, symboliquement,vers le centre, la conque qui constitue le point focal de l’église11.Témoins de l’Incarnation, leur rôle consiste à exalter le Christ trônantdans les cieux et intercédé par les deux témoins privilégiés del’Incarnation la Vierge et le Précurseur qui supplient le souverain duMonde pour le salut de l’humanité. La paroi absidale était probablementoccupée par un cycle de prélats, plus particulièrement d’évêques pourleur fonction de défenseurs de l’orthodoxie et comme auteurs desliturgies eucharistiques (Barsky 1896 : 66). Ils sont généralementassistés par deux diacres qui se tiennent sur les piedroits de l’arc àl’entrée de l’abside : c’est la figure de Laurent qui reste visible à Kaftoun; vraisemblablement Étienne devait lui faire pendant sur l’autrepiedroit. L’Annonciation, premier acte qui inaugure l’Incarnation,occupe une place importante au sommet de l’arc triomphal,emplacement qui constitue la séparation symbolique dans l’église entrele monde des fidèles qui se trouvent dans la nef et le monde céleste quiréside dans l’endroit le plus sacré, l’abside. La Communion qui devrait,selon la tradition, occuper la paroi absidale, se répartit ici sur les murslatéraux qui convergent vers l’abside. Cette déviation serait due aumanque d’espace dans l’abside ; néanmoins la place qu’elle occupe ici,aux alentours du sanctuaire, répond toujours à la fonction qui lui estassignée et qui consiste à servir de modèle aux fidèles qui prendrontl’eucharistie des mains du prêtre officiant. L’inspiration monastique duprogramme est attestée par les figures des quatre moines sur les piliers
10 Pour l’iconographie des saints Cavaliers en Orient, voir Immerzeel 2003 : 265-286 et2004 : 29-60.11 On retrouve les meilleures interprétations des programmes iconographiques dans lesouvrages de Catherine Jolivet-Lévy (1999 et 1991).
Chronos no 20 - 2009
LES FRESQUES DE KAFTOUN AU LIBAN 17
orientaux, place de distinction en face des fidèles, ce qui souligne etconfirme l’appartenance de l’église à un monastère. On reconnaît parmieux les deux illustres pères du monachisme oriental, Saba de Palestineet Arsène d’Égypte, l’identification des deux autres étant trèshypothétique. Les quatre figures de soldats sur les piliers ouest, plusproches de l’entrée, témoignent de leur rôle de protecteurs de l’église etdes fidèles, comme de la grande popularité de leur culte en Orient.
D’après leur style, les compositions sont différentes selon qu’ellesappartiennent au niveau supérieur ou inférieur des parois surlesquelles elles sont peintes. Elles appartiennent soit à deux phasesd’exécution soit à des peintres différents, deux au moins. Lescompostions des deux niveaux furent néanmoins peintes à desintervalles très réduits durant le XIIIe siècle, se distinguant par leurmanière très classicisante et manifestant par une parenté marquée avecla tradition byzantine (Hélou & Immerzeel 2005 : 453-457).
Au premier niveau appartient la scène de la Communion desApôtres (Figs. 5 et 6) où les figures se distinguent par leur grandeexpressivité et leur lien étroit avec la tradition byzantine. Les visages secréent par un modelé complexe et délicat qui est formé d’ombres bruneset verdâtres rehaussées de fines lignes blanchâtres. Ces ombres situentles parties saillantes de la face et des mains et constituent les carnationsqui non seulement soulignent le volume mais donnent l’impression delumière émanant de l’intérieur. C’est un style dynamique et puissant,où la fermeté de la lumière confère aux figures non seulement laspiritualité mais une véritable monumentalité. Tout ceci rappelle biensûr les modèles byzantins de la deuxième moitié du XIIe siècle (Popova2005 : 175-204 republié dans : Popova 2006 : 149-210) ; Mouriki D.1980-1981 :77-124).
Cependant une grande différence sépare les modèles byzantins dela deuxième moitié du XIIe siècle, en l’occurrence le style comnènetardif, de la composition de Kaftoun : ici le langage pictural estbeaucoup plus classicisant, les figures traitées avec plus de plasticité, lesvisages qui, tels des portraits, sont non seulement différenciés etindividualisés avec leurs regards aigus, mais se caractérisent par cet airsoucieux, presque angoissé. Les figures sont corpulentes et massives etles formes — visages et vêtements — sont modelées énergiquement àl’aide de denses rehauts conférant ainsi aux images une spiritualitéintense. Tout ceci nous renvoie aux idéaux du XIIIe siècle et déclinetoute appartenance au siècle précédant (Chadzidakis 1967 : 59-73).
NADA HELOU18
Les figures des apôtres, volumineuses et denses, sont représentéesdans des positions très naturelles, gesticulant de différents côtés, bienque la plupart d’entre eux ont le regard centré vers le Seigneur, alorsque certains, surtout ceux à l’arrière, donnent l’impression de discutertranquillement en attendant leur tour. Les figures aux proportionsparfaites, aux mouvements pleins de grâce, aux gestes variés, aux corpsmassifs, aux draperies amples tombant en des plis fluides et libres,ressemblent à des statues grecques ; c’est précisément ce qui rapprochedavantage cette composition de la tradition hellénistique etéventuellement des modèles du XIIIe siècle. L’ensemble possède uncaractère très animé grâce au rythme particulier créé par le mouvementdes corps penchés. On est loin de toute rigidité ou statisme si typique del’art de l’Orient.
L’accent principal est mis sur les visages qui sont peints avec unegrande maîtrise et beaucoup de finesse ; les touches de pinceau ensoulignent délicatement la forme (par exemple sous les yeux, autour desnarines ou sur le nez). Les couleurs sont appliquées avec fermeté etsûreté particulières. Dans ces visages, la profonde spiritualité est enéquilibre parfait avec la beauté physique des corps ; ceci nous renvoieaux fameux modèles classiques des fresques du XIIIe siècle qu’onrencontre particulièrement sur le territoire des Balkans (Djuri 1967 :145-167 ; 1975 et 1976 : 46-98 ; L’art byzantin 1967).
Le modelage des visages, tant chez les apôtres que chez l’archangedu médaillon, prend, non pas à travers la ligne mais le grisé, uncaractère pictural puissant. Les formes sont modelées énergiquement àl’aide de très fins rehauts conférant une force émotive à l’expression. Lecoloris de ces fresques est d’une beauté et d’une harmonieextraordinaires. Des teintes bleues, lis de vin, gris azur, alternent avecdes teintes lilas, marron rougeâtre, jaune verdâtre mais surtout ocre.Ces peintures qui dénotent la touche d’un artiste de grand talent, sontincontestablement l’œuvre d’un maître grec (Popova 2002, : 66-71;Lazarev 1986 : 123-155).
Après la prise de Constantinople par les Croisés en 1204, le rôlede la capitale de l’Empire chrétien en tant que centre promoteur des artsdepuis sa fondation en 330 s’anéantit. La perte de cette référenceprincipale favorisera l’apparition et le développement des écoles «nationales », que ce soit au sein de l’Empire ou dans sa périphérie(Hélou 1999 : 13-36 et 2003a : 397-434). Mais paradoxalement, un stylebyzantin très classique qui retourne aux valeurs hellénistiques et à la
Chronos no 20 - 2009
LES FRESQUES DE KAFTOUN AU LIBAN 19
gloire du passé apparaît dans les pays orthodoxes qui ont échappé àl’occupation étrangère comme la Serbie, la Macédoine ou le Kosovo. Lesartistes byzantins originaires de Constantinople, Thessalonique ou toutautre centre tombé sous l’occupation franque, émigrent dans descontrées orthodoxes plus paisibles où ils perpétueront la traditionclassique. Ils laisseront, avec leurs collègues locaux, des œuvres degrande qualité artistique comme celles de Milečevo ou Peć. La fresque de la Communion à Kaftoun possède par son classicismeévident beaucoup de traits qui la rattachent au style des peintures desBalkans. Les figures aux allures monumentales, larges et volumineuseset le raffinement du modelé des visages se relient incontestablementaux fresques des Balkans (Djurić 1967 : 145-167 ; Lazarev 1986 : 133-136)12. En effet, la composition de Kaftoun ressemble, par sonclassicisme impressionnant, à ces différents cycles de peinture ; lesexemples les plus caractéristiques se retrouvent à l’église de l’Ascensionau monastère de Milečevo (1228) ou plus particulièrement, à l’égliseSaint-Nicolas (1240) du monastère de Studenitsa (Fig. 12) (Djurić 1967: 149-150).
L’idéal classique se manifeste de la même façon qu’à Kaftoun. Lesvisages bouillonnant de vie intérieure intense, les corps puissants etmajestueux dans leurs amples draperies expriment calme et dignité. Les
12 Les miniatures grecques du XIIIe siècle sont aussi typiques de l’évolution de ce styleclassique (cf. Weitzmann 1944 : 193-214 ; Lazarev 1986 : 125-129).
Saint Jean le Précurseur (église Saint-Nicolas,monastère de Studenitsa Serbie), vers 1240
NADA HELOU20
peintures de ce premier niveau de fresques à Kaftoun sont ainsiempreintes de cette même liberté qu’on ne retrouve que dans lesmodèles du XIIIe siècle qui proviennent d’une forte inspirationbyzantine (Lazarev 1986 : 134-135 ; Chatzidakis 1967 : 61-62).
Ce style de fresques de la communion de Kaftoun, où l’influencesyrienne, celle qui caractérise les peintures du Liban et de la Syrie, estpratiquement inexistante, suggère que l’artiste qui les a accompli vientd’un grand centre byzantin, tel Constantinople ou Thessalonique ; lapremière ville restée sous domination franque jusqu’en 1261 et ladeuxième jusqu’en 1224. Ces fresques auraient été exécutées, à l’instardes fresques de Serbie, vers le deuxième tiers du XIIIe siècle ou peuaprès, vu la grande distance géographique qui les sépare. S’agirait-ild’un artiste grec qui a fui l’occupation franque pour venir se réfugierquelque part à Kaftoun dans le Comté de Tripoli ?
Au deuxième niveau, et à un autre artiste, appartiennent toutesles autres compositions : la déisis dans l’abside, l’Annonciation, lesfigures sur les piliers et la figure de Laurent. Certes, cet art qui estdifférent du style de la Communion, possède lui aussi, des liens étroitsavec la tradition byzantine. Le Christ trônant en majesté dans l’abside(Fig. 3) présente l’une des plus belles figures du Sauveur dans l’art denotre Orient. Son modèle est rempli d’une force brusque et invinciblequi crée l’impression d’un véritable tout puissant. De dimensionsvisiblement plus grandes que les personnages de la Communion, lesfigures dans la déisis sont massives, calmes, sereines et dénuées de toutetension psychologique ou expressive. Elles sont impassibles et graves.Le dessin des visages et des mains dénote un style plus schématisé, plussimple, les traits des visages sont marqués, la libre plasticité de lacouleur a laissé la place à une interprétation plus prudente de la forme.Dans les carnations, le peintre préconise les couleurs uniformes. Lesrehauts sont moins affirmés, les volumes moins prononcés, mais laforme est malgré tout modelée délicatement grâce au dégradé desombres vertes qui les rend plus volumineuses. Les contours sont peut-être moins sûrs, mais les visages gardent leur élégance et leur finesse,leurs traits sont devenus plus simples, les cernes sont réduits, lessourcils symétriquement arqués, les figures deviennent quelque peuplus hiératiques, plus rigides. Bref, toutes ces caractéristiques et cesdétails nous poussent à attribuer ces images à un artiste local ayantobtenu une bonne formation byzantine.
La composition de la déisis a perdu la couche supérieure de
Chronos no 20 - 2009
LES FRESQUES DE KAFTOUN AU LIBAN 21
peinture, de telle sorte qu’on ne discerne plus ce qui devait être lemodelé. Par contre, c’est le graphisme du dessin qui est mis enévidence. Ces lignes sont tracées par la main experte d’un dessinateurtrès sûr de lui, qui ébauche la structure de son dessin d’une manièrelaconique et très sommaire. C’est ce qui confère à ces figures leurmonumentalité. On est loin du raffinement graphique rencontré chezl’artiste de la communion qui accorde à la ligne un intérêt particulierqui apparaît dans le traitement des détails des figures, dans le contourdes silhouettes, dans l’exécution des visages et surtout des vêtements.
Le traitement de la surface apparaît d’une façon plus claire sur lafigure plus ou moins mieux conservée de Bacchus (Fig. 11) qui se tientdebout sur le pilier à gauche de l’entrée : sur la couche inférieure d’unbrun sombre qui est rehaussée d’une légère touche de rouge, ondiscerne des ombres épaisses vert foncé. Cette gradation successive destons créant le volume, les ombres verdâtres modelant les formes et lalumière spiritualisée confèrent au visage une expression puissanteemplie d’une impulsion exaltée. Cette figure ainsi que les autres figuresde saints sur les piliers, bien moins conservées, se distinguent, toutcomme les images de la déisis par leurs formes monumentales, leursstatures opulentes et denses, leurs visages aux traits individuels.Toutefois le langage plastique est beaucoup plus simple que celui de lacommunion. Ce qui impressionne c’est la simplicité et la pureté. Il n’y apas le moindre détail ou le moindre pli qui aurait exprimé une émotionquelconque, comme il n’y a non plus aucun détachement des figures,aucun accent ascétique ou méditatif souligné. Partout règne netteté etaccessibilité. Toutes ces caractéristiques distinguent le style de l’art duXIIIe siècle (Djurić 1967 : 145-167).
Ces représentations de soldats et de moines (Fig. 9) sur les piliersnous étonnent par leur monumentalité impressionnante et leurpuissance. Les figures lourdes, les épaules larges aux silhouettes solides,aux formes carrées et sommaires, aux lignes rares, aux couleursintensives même au niveau du modelé des visages avec leurs jouesempourprées et leur lèvres rouges dénotent une ambiance de bonnesanté. Cet art, préconisant le monumentalisme et l’approche sommairequi a radicalement renoncé au raffinement de la peinture comnènetardive se rapproche des formes de l’art existant dans les milieuxbyzantins du XIIIe siècle.
La tradition locale a largement représenté des saints soldats, maisceux-ci étaient plutôt figurés à cheval. Prenons en guise d’exemple
NADA HELOU22
l’église de Bahdidat (milieu-deuxième moitié du XIIIe siècle) où lesfigures des saints Georges et Théodore, désincarnées et dépourvues devolume, se distinguent par leur hiératisme prononcé. Le modelé estpratiquement ignoré, tout comme les effets de pesanteur et de tangibilitésont inexistants (Hélou 2007 : 17-19). Les silhouettes sont plates, leurscontours simplifiés. Bien sûr, cette comparaison avec des images issuesde la tradition strictement locale où prédomine le style qualifié demaniera syriaca est exagérée ici car, comme on l’a vu, ces peintures deKaftoun sont beaucoup plus complexes. Le rapprochement avecBahdidat se limite à certains détails très caractéristiques que l’on ne peutretrouver dans des modèles strictement byzantins. Les figures sedécoupent sur un fond bleu uni, où l’on ne rencontre aucun détailarchitectural ou spatial qui aurait pu les situer ; le sol sur lequel elles setiennent est même absent. De ce fait, les personnages semblent flotterdans un espace abstrait. Encore les silhouettes massives à la présencedominante qui occupent pratiquement toute la hauteur du pilier arrivantpresque jusqu’à la clé de l’arc, semblent paradoxalement se tenir sur lapointe des pieds dans un équilibre précaire. Cette sensation del’irrationnel remonte à l’idéalité qui réside dans la conception orientalede l’espace et de l’image. De ce fait, ces peintures se rallient à la traditionlocale. Cependant ce style plutôt abstrait, qui caractérise le traitementdes corps et où se conjuguent le décoratif et l’irréel, est corrigé parl’exécution délicate des visages au modelé puissant qui les dote de traitscaractéristiques. Malgré tout, le dessin incisant les traits du visage estsimplifié, les yeux sont grands ouverts à la manière orientale.
Dans toutes ces variations, on rencontre la création d’une maintalentueuse très imprégnée d’une influence byzantine. Néanmoins, cetart présente un aspect différent de la tradition classique telle qu’on a vudans les figures de la Communion : le modelé en volume, fort délicat desvisages des protagonistes de la communion, est remplacé ici par unepeinture plus large qui préconise des surfaces plus plates, tout comme lavigueur et le dynamisme de la touche sont supplantés par cetteexpression de grandeur et de sobriété monumentale. Le style de la déisis(Fig. 3) aux contours précis et austères des figures et au traitementplutôt sommaire, est inhérent à l’art byzantin. La figure de la Viergelongue et sèche, la silhouette intègre et pure, l’économie du traitementen volume, tous les détails rattachent cette image à celle de l’icône bifacedu Monastère de Sainte Catherine au Sinaï avec la Vierge Hodigitria surun côté et les saints Serges et Bacchus à cheval sur l’autre (Fig. 13 et14).
Chronos no 20 - 2009
LES FRESQUES DE KAFTOUN AU LIBAN 23
Le saint équestre Serge (monastère Sainte-Catherine, Sinaï)
La Vierge Hodigitria (monastèreSainte-Catherine, Sinaï)
Les deux saints équestres Serges etBacchus (monastère Sainte-Catherine,
Sinaï)
NADA HELOU24
L’origine de ce panneau, ainsi qu’une dizaine d’autres, toutesattribuées à la deuxième moitié du XIIIe siècle, a constitué, depuis lemilieu du siècle dernier, un point de discorde des chercheurs entre eux.K. Weitzmann les avait rattachés à un maître Templier vénitien ouoriginaire de l’Italie du sud et qui aurait travaillé en Terre sainte selonla manière byzantine (Weitzmann 1966 : 49-83, esp. 70-71; Idem. 1982: 345-346; Idem. 1984 : 143-170). ; D. Mouriki, elle, les avait reliés à unpeintre syrien travaillant à Chypre (Mouriki 1995 : 341-443, esp. 400-403), alors que J. Folda, dans ses dernières études, les attribuait à unartiste provenant de l’école vénéto-byzantine ayant travaillé dans cequ’il a nommé « l’atelier des saints soldat à Acre », en Palestine (Folda2004 : 229, 230, 232; Idem 2004 : No. 17-20). Dans sa récentepublication sur l’art de la Chypre à l’époque des premiers Lusignan,Anne-Marie Weyl Carr insiste sur l’origine chypriote de ces icônes(Weyl Carr 2005 : 83-110). Lucy Ann Hunt, était la première à avoirvu en l’icône de la Vierge Hodigitria et des Saints Serge et Bacchus uneorigine syrienne (Hunt 1991 : 96-145). Mat Immerzeel et moi-même,nous basant sur les fresques et l’icône de Kaftoun, avons démontré,dans plus d’une publication, l’appartenance syro-libanaise de cesœuvres (Hélou 2003 : 101-131 ; 2006 : 53-72 et 2007 : 25-29 ; Immerzeel2007 : 67-83).
Les deux saints équestres Serges et Bacchus sur le revers de cetteicône (Fig. 14), ainsi qu’une autre icône du saint équestre Serge (Fig.15) provenant elle aussi du monastère de Sainte Catherine, possèdentune grande ressemblance avec les représentations de saints Cavaliersdans les fresques de la Syrie (Qara) (Immerzeel 2004 : 47, 56 ;Westphalen 2005 : 117-118, 121-122) et du Liban (Bahdidat,Hamatoura et surtout Rashkida), où le culte de ces saints est trèsrépandu (Cruikshank Dodd 2004 : 70-72 ; Nordiguian et Voisin 1999 :268-281). À part le sujet, et dans l’icône et dans les fresques, onretrouve les mêmes caractéristiques : les lignes simples et nettes, lecontour épuré et bien incisé, les figures abstraites, légères, dépourvuesde volume et de poids planant au-dessus d’un sol conventionnel. Leschevaux représentés strictement de profil et traités en surface possèdentle même dessin, les mêmes oreilles piriformes et les mêmes yeux enamande, au regard humain. Ceci témoigne davantage de l’origine syro-libanaise de ces icônes. Comme l’église de Kaftoun est patronnée par lesSaints Serges et Bacchus, Mat Immerzeel propose l’appartenanceoriginale de l’icône du monastère de Sainte Catherine à cette église du
Chronos no 20 - 2009
LES FRESQUES DE KAFTOUN AU LIBAN 25
Mont Liban. La figure de la Vierge sur l’avers de l’icône du Sinaï avec sa pose
hiératique, sa grandeur sobre et son traité plutôt en aplat se rattachetant à la fresque de Kaftoun qu’à l’icône de ce même monastère. Celle-ci, elle-même biface, représentant la Vierge Hodigitria d’un côté(Fig.16) et le Baptême du Christ de l’autre (Fig. 17), a été redécouvertedans les années 1990. Elle appartient au milieu-troisième quart du XIIIesiècle (Hélou 2003 : 101-131 ; Lammens 1996 : 21-27). L’image de laMère de Dieu, calme et détachée se rapproche de la tradition orientaleet se relie à la fresque de la déisis de Kaftoun (Fig. 3). On retrouve dansles trois images (les deux icônes et la fresque) des traits communs,comme l’ovale du visage, les yeux en amande, le tracé des sourcils sereliant au-dessus du nez par un trait arqué surmontant la paupièresupérieure. Tout cela témoigne d’une même origine.
La Vierge Hodigitria (monastère de laVierge, Kaftoun)
Le Baptème du Christ (monastère de laVierge, Kaftoun)
NADA HELOU26
Le Baptême du Christ (Fig. 17) sur le revers de l’icône de Kaftounprésente une série d’éléments qui affirment davantage l’appartenanceorientale de l’icône. La figure du Christ qui semble rassemblée de piècesdétachables avec la tête disproportionnellement grande, les bords desrochers dessinant un zigzag, les ondulations stylisées de l’eau duJourdain, le ton foncé presque noir du fond : autant de détails quiéloignent la composition de la tradition byzantine et confirment sonorigine provinciale. L’image statique et linéaire du Christ retrouve sonécho dans la fresque représentant le même sujet à l’église de Saydet ed-Derr (Notre Dame au lait abondant) près de Bcharré (dans le MontLiban) (Cruikshank Dodd 2004 : 90, 139 ; Nordiguian 1999 : 286-287 ;Hélou 2003 : 124). Encore, les figures des anges à la touche vigoureuseet participant à la scène de baptême possèdent des visages ronds auregard vif et sont rehaussés de fine lignes blanches soulignant en destraits souples le front, la lèvre supérieure, le menton, les coins des yeux.On décèle ces mêmes détails dans le visage encore conservé de l’ange dela fresque de la Nativité à l’église de Saydet el-Kharaeb à Kfar Helda(non loin de Kaftoun) (Nordiguian, 2003-2004 : 187-192). Cespeintures présentent, certes, des différences, mais correspondent à uneseule atmosphère artistique, où l’inspiration de la tradition byzantine
la Vierge Platytera (monastère Sainte-Catherine, Sinaï)
Chronos no 20 - 2009
LES FRESQUES DE KAFTOUN AU LIBAN 27
trouvait une interprétation locale (Hélou 2006b : 53-72). Les deux figures de prophètes dans les angles supérieurs de lacomposition suscitent l’attention car elles sont étrangères àl’iconographie habituelle du Baptême. Toutefois deux figures deprophètes apparaissent au même emplacement dans une icônereprésentant la Vierge Platytera (Fig. 18) du monastère de SainteCatherine (Sotiriou 1956 – 1958 : I, Figs. 171-172, II, 157-158). Cetteicône à l’allure très orientale, à la figure hiératique et désincarnée,dévoile une manière étrangère au style byzantin. Ces mêmescaractéristiques se retrouvent dans différentes fresques du Liban oùl’image de la Vierge trônant a joui d’une grande popularité au XIIIesiècle. Tout ceci fait remonter l’icône de la Platytera à des origines syro-libanaise (Hélou 2006 : 63-64 ; Hunt 2007: 53)13
. Les figures des prophètes ici comme dans l’icône de Kaftouncomplétant ou préfigurant la scène néotestamentaire proviendraientd’une tradition orientale dont les prototypes n’existent plus. Il est à noter aussi que dans le Baptême de Kaftoun se côtoient les troislangues connues ou parlées en terre syro-libanaise. Ainsi, les prophètesdéroulent des phylactères où sont écrites des inscriptions en arabe et ensyriaque, alors que les abréviations sont notées en grec. Une tellecohabitation de langues, surtout de la langue arabe, n’est pas courantedans l’art médiéval du Liban. Cependant, on retrouve ces trois languesdans la fresque de l’église de Kaftoun où l’inscription en arabe courttout au long de l’imposte qui cintre la nef (Fig. 8). Il est évident que cecine peut être l’effet d’une simple coïncidence : l’icône et la fresque avectout ce qu’elles représentent de traits communs, sont le produit, si cen’est d’une même main, sinon d’un même atelier. De plus, l’apparitionde la langue arabe devrait aider à trouver des réponses aux problèmesconcernant les langues parlées et liturgiques des différentescommunautés vivant dans le comté de Tripoli, mais nous préféronsgarder ces questions aux historiens et aux linguistes14.
13 Lucy-Anne Hunt (2007) attribue l’icône à une origine égyptienne et plus précisémentà une provenance du Caire. 14 La question traitant des langues parlées par les différentes communautés chrétiennesau Liban reste un sujet peu étudié. Les maronites considèrent le syriaque la seule languede leurs ancêtres, et les orthodoxes, le grec et plus tard l’arabe. Il s’avère que la réalitéhistorique était beaucoup plus complexe : le syriaque et l’arabe étaient bien connus parles deux communautés, alors que l’usage du grec se limitait à la pratique liturgique ; legrec était de même parlé par les orthodoxes des villes côtières.
NADA HELOU28
Les icônes citées ci-dessus se relient elles aussi à un petit groupe depanneaux du monastère Sainte-Catherine et qui ont été autrefoisattribuées par Weitmann au maître des Templiers (Weitzmann 1966 :70-71; Id. 1982 : 345-346; Id. 1984 : 143-170 ; Hélou 2006 : 65-66)15,mais qui devraient provenir du même milieu que les fresques deKaftoun. Ces oeuvres appartiennent à une seule école de peinture qui secaractérise par son admiration pour l’art byzantin et aussi par sonappartenance à la tradition locale. Dans des études précédentes, M.Immerzeel et moi-même avons essayé de regrouper ces icônes et desituer leur origine. C’est bien sûr la découverte des fresques de l’égliseSaint-Serges-et-Bacchus de Kaftoun qui a levé tous les doutesconcernant l’origine de ce groupe d’icônes. Grâce à elles, on a pudéfinitivement affirmer en l’origine syro-libanaise, comme on a putrancher sur la question de l’existence d’un atelier de peinture qui sesituerait dans la moitié nord du comté de Tripoli et qui aurait prospéréentre le milieu du XIIIe siècle et 1287, date de la chute du comté, plusprécisément dans le troisième quart du siècle. Par leur style, cespeintures, tant la composition de la Communion que les autres,s’inscrivent dans le cadre de cette période.
Mais si les fresques de Kaftoun ont pu être exécutées par cetatelier, il faudrait rappeler que le premier groupe de fresques, celui dela Communion, est l’œuvre d’un maître grec. Celui-ci peut avoirtravaillé côte à côte avec un artiste local qui jouissait d’un grand talentet d’une grande maîtrise de l’art byzantin et qui serait lui-même le chefde l’équipe qui a accompli le décor de l’église. Cette déduction est due aufait que la fresque la plus importante, la déisis, a été faite par lui. D’autrepart, le programme iconographique qui est sans conteste d’inspirationorientale, avec la déisis dans la conque, nous laisse trancher sur l’originelocale du concepteur du décor ou de celui qui l’a effectué. Lesinscriptions en syriaque et surtout en arabe le prouvent.
Juillet 2009
15 Ces icônes ont été publiées pour la première fois par Sotiriou 1958, II, Figs. 183, 184,185.
Chronos no 20 - 2009
LES FRESQUES DE KAFTOUN AU LIBAN 29
BIBLIOGRAPHIE
CHATZIDAKIS M., 1967, « Aspects de la peinture murale du XIIIe siècle en Grèce», in L’art byzantin au XIIIe siècle, Symposium, Sopocani 1965, Belgrade,pp. 59-73.
CHMIELEWSKI K., WALISZEWSKI T., 2005, « Conservation and Restoration of theMar Sarkis Church Murals. Interim Report », Polish Archaeology in theMediterranean, Warsaw XVI, pp. 447-452.
CRUIKSHANK Dodd E., 2001, The Frescoes of Mar Musa al-Habashi. A Study ofMedieval Painting in Syria, Toronto,
CRUIKSHANK DODD E., 2004, Medieval Painting in the Lebanon, Wiesbaden,Sprachen und Kulturen des christlichen Orients, 8.
DJURIC V., 1967, « La peinture murale serbe au XIIIe siècle », in L’art byzantinau XIIIe siècle, Symposium, Sopocani 1965, Belgrade, pp. 145-167.
DJURIC V., 1975, Vizantijke freske u Jugoslave (Les fresques byzantines deYougoslavie), Belgrade, Jugoslavia.
DJURIC V., 1976, « La peinture murale byzantine: XIIe et XIIIe siècles » in XVeCongrès des Études Byzantines (CEB), Athènes, pp. 46-98.
DUCHET-SUCHAUX G. et PASTOUREAU M., 1994, La Bible et les saints, Paris,Flammarion.
FOLDA J. 2004, in Byzantium. Faith and Power (1261-1557), Ed. by H. Evans,New York.
FOLDA J., 1995, The Art of the Crusaders in the Holy Land, 1098-1187,Cambridge.
FOLDA J., 2004, Trésors du monastère de Sainte Catherine, Mont Sinaï Égypte,Martigny.
BARSKY V.G.,1886, Stranstvovania Vassilia Grigorovitcha Barskovo, EditionI.P.P.O., St-Petersbourg, pp. 66-67 (en russe: Les voyages de VassiliGrigorovitch Barsky) ; Réédité : Grigorovitch Barsky V.G., Les voyagesen Terres Saintes d’Orient, Vol. 2, 1728-1744.
HÉLOU N., 1999, « Wall Paintings in Lebanese Churches », Essays on ChristianArt and Culture in the Middle East, Leiden, Leiden University, 2, pp. 13-36.
HÉLOU N., 2003a, « L’église de Saint Saba à Eddé-Batroun », Paroles d’Orient,Université du Saint Esprit, Kaslik, pp. 397-434.
HÉLOU N., 2003b, « L’icône bilatérale de la Vierge de Kaftoun au Liban : uneœuvre d’art syro-byzantin à l’époque des Croisés », Chronos 7, pp. 101-131.
HÉLOU N. 2006a, « Le décor des absides dans les églises du Liban »,
NADA HELOU30
Iconographica V, pp. 32-47.HÉLOU N. (avec la collaboration de M. Immerzeel), 2006b, « À propos d’une
école syro-libanaise d’icônes au XIIIe siècle », Eastern Christian Art(ECA), 3, pp. 53-72.
HÉLOU N., 2007, La fresque dans les anciennes églises du Liban (I). Régions deJbeil et Batroun, Beyrouth, Aleph.
HÉLOU N., 2007a, L’icône dans le Patriarcat d’Antioche (VIe – XIXe siècles),Beyrouth, Aleph.
HÉLOU N. & IMMERZEEL M., 2005, « Kaftoun 2004. The Wall Paintings », PolishArchaeology in the Mediterranean, Warsaw, XVI, pp. 453-458.
HÉLOU N. & IMMERZEEL M., 2007, « Les peintures murales de Kaftûn », Bulletind’Archéologie et d’Architecture Libanaise (BAAL), 11, pp. 315-317.
HUNT L.A., 1991, « A woman’s prayer to St Sergios in Latin Syria: interpretinga thirteenth-century icon at Mount Sinai », in Byzantine and ModernGreek Studies 15 pp. 96-145 (repr. : Hunt L.A., 2000, Byzantium, EasternChristendom and Islam. Art at the Cross Roads of the MedievalMediterranean, London, vol. II, pp. 78-126.
HUNT L.A., 2007, « Artistic Interchange in Old Cairo in the Thirteenth to EarlyFourteenth Century: The Role of Painted and Carved Icons », inInteractions. Artistic interchange between the Eastern and Western Worldsin the Medieval Period, Colum Hurihane ed., pp. 48-66.
IMMERZEEL M., 2003, « Divine Cavalry. Mounted Saints in Middle EasternChristian Art », in K. Ciggaar, H. Teule, East and West in the CrusaderStates. Context - Contacts - Confrontations III, Acta of the congress held atHernen Castle in September 2000, Leuven/Dudley, M.A. (OrientaliaLovaniensa Analecta 125), pp. 265-286.
IMMERZEEL M. 2004, « Holy Horsemen and Crusader Banners. EquestrianSaints in Wall Paintings in Lebanon and Syria », Eastern Christian Art(ECA) 1, pp. 29-60.
IMMERZEEL M. (with the collaboration of Hélou N.), 2007, « Icon Painting inthe County of Tripoli of the Thirteenth Century », in Interractions.Artistic interchange between the Eastern nd Western Worlds in theMedieval Period, Colum Hurihane ed., pp. 67-83.
JOLIVET-LÉVY C., 1991, Les églises byzantines de Cappadoce. Le programmeiconographique de l’abside et de ses abords, Paris.
JOLIVET-LÉVY C., 1999, La Cappadoce médiévale. Images et spiritualité, Paris. LAMMENS A., 1996, Icônes du Liban, Paris. L’ART BYZANTIN AU XIIIE SIÈCLE, 1967, Symposium, Sopocani 1965, Belgrade. LAZAREV V.N., 1986, Istoria vizantiiskoi zhivopisi (Histoire de la peinture
Chronos no 20 - 2009
LES FRESQUES DE KAFTOUN AU LIBAN 31
byzantine), Moscou, Iskusstvo, pp. 123-155.MOURIKI D., 1995, « Thirteen Century Icon Painting in Cyprus », in Mouriki,
Studies in Late Byzantine Painting, London, pp. 341-443. (repr. from:The Griffon, 1-2, 1985-1986, pp. 9-112).
MOURIKI D., 1980-1981, « Stylistic Trends in Monumental Paintings of GreeceDuring the Eleventh and Twelfth Centuries », Dumbarton Oaks Papers,34-35, pp. 77-124.
NORDIGUIAN N. et VOISIN J.C., 1999, Châteaux et églises du Moyen Âge au Liban,Beyrouth, Terre du Liban.
NORDIGUIAN L., 2003-2004, « Note sur deux fragments de peinture à SaydetKharaeb de Kfar Helda (Caza de Batroun) », Tempora 14-15, pp. 187-192.
POPOVA O.S., 2002, « Vizantiiskie ikoni VI-XV vekov (Les icônes byzantinesVI-XVe siècle », in Istoria ikonopisi, Moscou, ART-BMB. pp. 41-94..
POPOVA O.S., 2005, « Asketitcheskoe napravlenie v vizantiiskom iskusstsvevtoroi polovine XI veka i ego dalneishaya sudba (Les tendancesascétiques dans l’art byzantin de la seconde moitié du XIe siècle et sadestinée ultérieure) », in Vizantiiskii mir : iskusstsvo Konstantinopola Inationalnie raditsii. K 2000-letiu hristianstva, Moscou, pp. 175-204.
POPOVA O.S. 2006, Problemi vizantiiskogo iskustva. Mozaiki, freski, ikoni (Lesproblèmes de l’art byzantin. Mosaïques, fresques, icônes), Moscou.
RADOJCIC S., 1967, « Sopocani et l’art européen du XIIIe siècle » in L’artbyzantin du XIIIe siècle, Symposium de Sopocani, 1965, Belgrade.
SOTIRIOU G. et M., 1956-1958, Eikones tes mones Sinai (Icônes du Mont Sinaï),vols. I, II.
WEITZMANN K., 1944, « Constantinopolitan Book Illumination in the Period ofthe Latin Conquest », Gazette des Beaux Arts XXV, pp. 193-214.
WEITZMANN K., 1966, « Icon Painting in the Crusader Kingdom », DumbartonOaks Papers (DOP), 20, pp. 49-83.
WEITZMANN K., 1982, Studies in the Art of Sinai, Essays by K.Weitzmann,Princeton.
WEITZMANN K., 1984, « Crusader Icons and Maniera Graeca », in Byzanz undder Westen. Studien zur Kunst des europäischen Mittelalters, I. Hutter ed.,Wien,. Österreichische Akademie der Wissenschaften. Phil.-Hist.Klasse. Sitzungsberichte, Bd. 432, pp. 143-170.
WESTPHALEN S., 2005, « Das Kloster Mar Yakub und seine Wandmalereien »,inMar Yakub, Christliche Wandmalereien in Syrien: Qara und das KlosterMar Yakub, A. Schmidt, S. Westphalen eds., Wiesbaden, ReichertVerlag, Sprachen und Kulturen des Christlichen Orients 14).