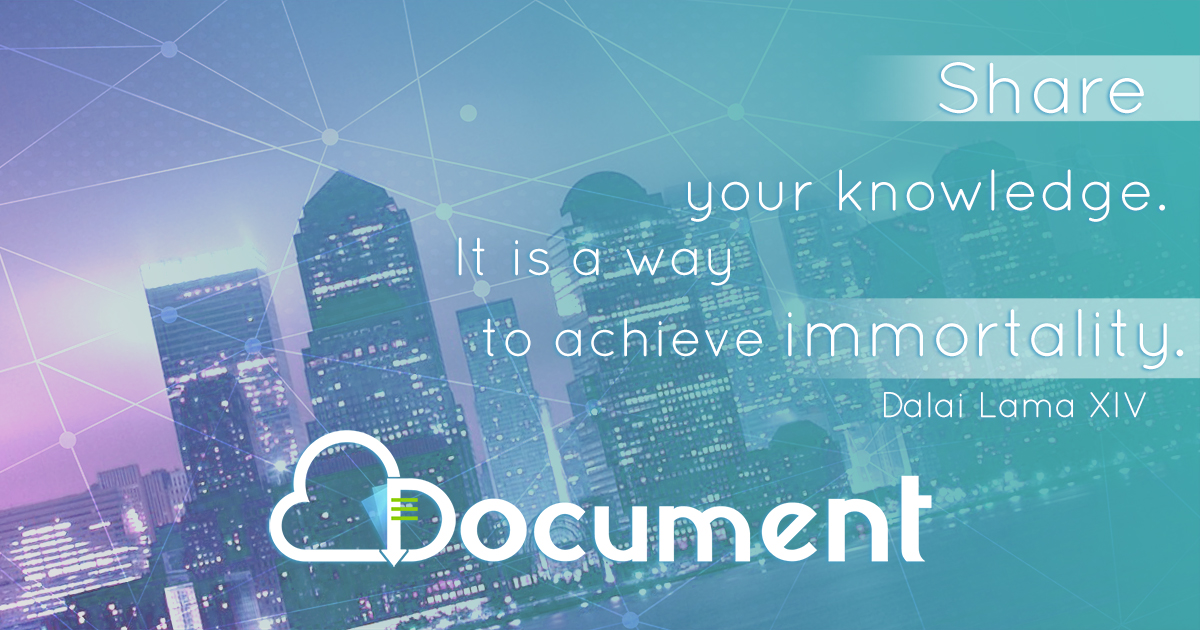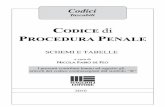LE TRIBUNAL SPECIAL POUR LE LIBAN: DE L'HYPOTHESE D'UN POSSIBLE EFFET DESTABILISATEUR SUR LE SYSTEME...
Transcript of LE TRIBUNAL SPECIAL POUR LE LIBAN: DE L'HYPOTHESE D'UN POSSIBLE EFFET DESTABILISATEUR SUR LE SYSTEME...
LE TRIBUNAL SPECIAL POUR LE LIBAN: DE L’HYPOTHESE D’UN POSSIBLE EFFET
DESTABILISATEUR SUR LE SYSTEME DE LA JUSTICE PENALE INTERNATIONALE
MARIA STEFANIA CATALETA
1. Introduction.- Dans le panorama international, l’institution du
Tribunal Spécial pour le Liban (TSL), en 20071, a certainement bouleversé l’équilibre qui avait été établi par la création de la Cour pénale internationale (CPI). En effet, cette dernière aurait dû mettre fin à la justice pénale internationale “exceptionnelle” mise en place par les Tribunaux ad hoc et par les tribunaux internationalisés. Le bouleversement a fait qu’actuellement le système de la justice pénale internationale qui s’est formé après l’institution du TSL n’a plus les caractéristiques d’uniformité juridique internationale que la présence d’une juridiction permanente devait garantir. D’ailleurs, une instance à caractère international successive à la Cour ne peut se soustraire à des comparaisons et à la tentation d’une critique pour le fait d’avoir osé défier la suprématie juridique et institutionnelle de la Cour.
En réalité, dès les Tribunaux de Nuremberg et de Tokyo, stigma-tisés pour le fait de représenter la “justice des vainqueurs”, toutes les juridictions pénales internationales, ont fait, mutatis mutandis, l’objet de critiques. Dans la même perspective, le fait que les procédures actuellement en cours devant la CPI concernent des Etats africains a fait parler de “justice des blancs”2.
1 Malgré sa création en 2007, les travaux du TSL n’ont commencé officiellement que le
1er mars 2009 sous la présidence du juge Antonio Cassese, ancien Président du TPIY, après quatre années d’enquête conduite par une Commission nommée par le Conseil de Sécurité de l’ONU, voy. ASCENSIO, MAISON, L’activité des juridictions pénales internationales (2006-2007), in AFDI, 2007, 432-435; voy. également MOHR, Hariri indictement: now arrests? [en ligne], juillet, International Justice Tribune, No. 132, July 6, 2011, by-weekly magazine on international criminal justice, http://www.internationaljustice.nl (page consultée le 7 juillet 2011). Pour suivre l’actualité de l’activité du TSL voy. le site Internet: www.stl-tsl.org.
2 Quant aux TSL, le fait que le résultat des investigations ait été la mise en accusation des membres du Hezbollah a provoqué d’âpres réactions politiques au niveau national. La Comunità Internazionale Fasc. 1/2012 pp. 55-76 EDITORIALE SCIENTIFICA SRL
LA COMUNITÀ INTERNAZIONALE
56
Dans cette perspective, les vicissitudes politiques qui ont accompagnés le processus de création du TSL3, les modalités et la ratio à la base de sa création confèrent à ce Tribunal une spécificité absolue par rapport aux autres juridictions internationalisées4. C’est une spécificité liée à son degré inférieur d’internationalisation5 et à la particularité du système juridique mixte choisi pour son fonctionne-ment6. En outre, le fait que le TSL, dans l’application du droit aussi bien matériel que procédural, se soit éloigné du système codifié propre à la Cour pourrait faire penser à une déstabilisation dans le sens réductif des garanties judiciaires du procès pénal international7. On fait référence, d’une part à sa compétence exclusive en matière de terrorisme, ce qui est une nouveauté dans le panorama de la justice pénale internationale, et, d’autre part, à un très fort caractère romano-germanique de la procédure adoptée par le TSL, typique de la justice libanaise. En ce qui concerne le dernier aspect, la procédure du Tribunal se caractérise par l’admission du procès in absentia interdit devant la CPI.
3 Pour une reconstruction historique voir, AURESCU, Etats, statuts territoriaux, maintien
de la paix, maîtrise des armements. Le conflit libanais de 2006. Une analyse juridique à la lumière de tendances contemporaines en matière de recours à la force, in AFDI, 2006, 136-159; AZAR, Le Tribunal Spécial pour le Liban, in RGDIP, 2007, 643-658; BOSLY, VANDERMEERSH, Génocide, crimes contre l’humanité et crimes de guerre face à la justice . Les juridictions internationales et les tribunaux nationaux, Bruylant, 2010, 147-154; LELARGE, Le Tribunal Spécial pour le Liban, in AFDI, 2007, 397-428; NOOTENS, L’affaire Hariri et le tribunal spécial – Quel espoir pour le Liban?, in Les nouvelles du droit humanitaire, avril 2008, n° 27, 2-10.
4 PAZARTZIS, Tribunaux pénaux internationalisés, in AFDI, 2003, 643; voy. également ASCENSIO, LAMBERT-ABDELGAWARD, SOREL (dirs.), Les juridictions pénales interna-tionalisées, Paris, 2006.
5 Parmi les juridiction internationalisées le TSL, à côté des Chambres Extraordinaires auprès des Tribunaux Cambodgiens, présente un caractère moins international par rapport au Tribunal Spécial pour la Sierra Leone. Voy. LINTON, New approches to international justice in Cambodia and East Timor, in RICR, 2002, 101; ONG, Les chambres extraordinaires du Cambodge, un tribunal mixte comme dernier espoir d’établir la responsabilité pénale des dirigeants Khmers rouges, in DIGNEFFE, MOEAU (dirs.), La responsabilité et la responsabilisation dans la justice pénale, Bruxelles, 2006, 459; POISONNIER, Les chambres extraordinaires cambodgiennes. Une nouvelle forme de justice internationale, in JDI, 2007, 87 et 93; ROMANO, BOUTRUCHE, Tribunaux pénaux internationalisés, in RGDIP, 2003, p. 115; MCDONALD, Sierra Leone’ shoestring Spécial Court, in RICR, 2002, 131.
6 ASCENSIO, MAISON, L’activité des juridictions pénales internationales (2008-2009), in AFDI, 2009, 331-392.
7 PHILIP, DE CARA, Nature et évolution de la juridiction internationale, in La juridiction internationale permanente, Paris, 1987, 11.
LE TRIBUNAL SPECIAL POUR LE LIBAN
57
En réalité, malgré la tentation de soulever des critiques, une analyse plus attentive ne peut que faire relever le caractère très innovateur et progressiste du TSL, fruit de l’effort de faire face à des exigences particulières qui ont déterminé le choix d’une juridiction successive à la Cour et bien différente de celle-là.
2. L’anomalie dans le processus de création du TSL: entre
négociations et Chapitre VII. – Le TSL a été institué le 30 mai 2007, par la résolution 1757 du 30 mai 2007 du Conseil de sécurité des Nations Unies, afin de poursuivre les responsables de l’acte terroriste perpétré à Beyrouth le 14 février 2005, qui a entraîné la mort de l’ancien Premier Ministre libanais Rafic Hariri et de 22 autres personnes8. Pour la première fois, la justice pénale internationale s’occupe du crime de terrorisme9.
La création du TSL s’inscrit dans la complexité du contexte historique, politique et géographique du Liban, particulièrement dans la moitié des années 2000. Il s’agit d’une complexité demeurant dans une situation de grave instabilité de l’ordre démocratique dans laquelle le Liban était tombé après l’attentat terroriste du 14 février et par conséquent, dans la difficulté de la justice libanaise de poursuivre les responsables de l’attentat. Les difficultés internes sont donc à l’origine de la création du TSL et ont conditionnés fortement les modalités de création de celui-ci. En effet, il s’est agi de modalités qui ont été marquées par une alternance conflictuelle entre opposition et consentement national à l’égard de la création d’une juridiction à caractère international10.
Pour répondre à la faction contraire, on peut rappeler que l’inter-vention internationale dans une affaire interne a fait suite à la demande du chef du gouvernement libanais de l’époque, qui avait pris
8 L’attentat s’inscrit dans le cadre de l’opposition de Hariri à l’influence pressante de la
Syrie – accusée de viser, avec l’Iran, au développement du pouvoir chiite dans le Moyen-Orient – dans la politique intérieure du Liban.
9 AZAR, op. cit., 646; ASCENSIO, MAISON, op. cit., 2007, 429-473. 10 En effet, la création d’un tribunal international pour juger des affaires internes au Liban
a soulevé les protestations de la faction parlementaire libanaise liée au Hezbollah. Plus précisément, le Tribunal a été accusé d’être une création exclusive des Etats-Unis et d’Israël. Les difficultés dans l’iter de ratification provenaient en premier lieu de la faction politique liée au Président Lahoud, qui refusait la ratification d’un accord entraînant une perte de souveraineté. D’ailleurs, le blocage demeurait également au niveau parlementaire, car l’inscription de la question à l’ordre du jour était continuellement procrastinée par le Président de la Chambre, Berri. Il y avait donc une fracture institutionnelle entre le bloc pro-syrien des loyaliste, et celui anti-syrien des opposants.
LA COMUNITÀ INTERNAZIONALE
58
acte de l’impossibilité d’établir la vérité par la justice nationale11. A côté des forts doutes sur l’indépendance des autorités judiciaires nationales, il faut ajouter la découverte de graves irrégularités dans le recueil des éléments de preuve. Tout cela menait à la conclusion qu’il manquait une volonté unanime d’aboutir à la vérité et de combattre l’impunité. La situation compromettait l’état de droit et, par consé-quent, l’ordre démocratique du Liban était menacé12.
Le 30 mai 2007, l’alternance susmentionnée et donc les dif-ficultés dans les négociations liées au processus de ratification de l’Accord entre le Liban et les Nations Unies concernant la création du TSL, conduisirent donc le Conseil de Sécurité à agir en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies et à entériner unilaté-ralement l’Accord, conjointement au Statut du TSL, qui en faisait partie intégrante13.
Il faut toutefois remarquer que, bien que la création ait fait suite à une résolution adoptée sur la base du Chapitre VII, le TSL n’est pas un organe subsidiaire du Conseil de sécurité, comme l’étaient les Tribunaux pénaux internationaux ad hoc (TPI)14.
L’intervention internationale pour le rétablissement de la paix et de l’ordre démocratique libanais s’inscrit donc dans une situation de faiblesse et de stagnation interne susceptible de déstabiliser ulté-rieurement le Liban et tout le Moyen-Orient. En effet, la stabilité moyen-orientale a toujours représenté un problème non limité à la
11 Par la résolution 1644/2005, le Conseil de sécurité avait pris acte de la demande du
Premier Ministre libanais, Fouad Siniora, du 13 décembre 2005. Voy. le Rapport du Secrétaire général des Nations Unies du 15 novembre 2006, Doc. NU S/2006/893.
12 Voy. le Rapport de la commission du 24 mars 2005 (S/2005/203) et le texte de la résolution 1595/2005, où les rédacteurs soulignent l’absence de crédibilité des résultats de l’enquête interne et la perte de confiance de la part de la population libanaise.
13 Le TSL est également compétent pour tous les attentats terroristes qui présentent un lien de connexité avec l’attentat du 14 février 2005 et survenus au Liban entre le 1er octobre 2004 et le 12 décembre 2005. Pour toute autre attentat avec les mêmes caractéristiques, mais survenus après le 12 décembre 2005, il sera nécessaire d’obtenir du Conseil de sécurité. Le lien de connexité prévu par l’art. premier du Statut peut être caractérisé par l’intention criminelle, le but recherché, la qualité des personnes visées, le mode opératoire et les auteurs. Par rapport à ce crime, l’art. 4 du Statut établit la primauté du TSL sur les tribunaux libanais, «dans les limites de sa compétence» concurrente à celle des juridictions nationales. Pour les modalités de l’exercice de la compétence en cas de connexité, voy. les artt. 11 et 12 du Règlement de procédure et de preuve (RPP) du TSL; Voy. ASCENSIO, MAISON, op. cit., in AFDI, 2007, 430-431.
14 BROWN, Primacy or complementary: reconciling the jurisdiction of national courts and international criminal tribunals, in Yale JIL, 1998, 383 et s.; Pour un excursus en matière de juridictions internationalisées, voy.: CAHIN, L’impacte des TPI sur la (re)construction de l’Etat, in ASCENSIO, LAMBERT-ABDELGAWARD, SOREL, (dirs.), op. cit.
LE TRIBUNAL SPECIAL POUR LE LIBAN
59
région, mais affectant la communauté internationale tout entière15. L’institution du TSL est lié à la nécessité de protéger une région caractérisée par une instabilité jugée comme une menace contre la paix et la sécurité internationale, surtout à la suite de l’attentat. De plus, loin de représenter une menace pour la souveraineté du Liban, la résolution 1757 visait à préserver la paix dans la région moyen-orientale et à protéger le Liban contre toute menace ou ingérence de l’extérieure16. En effet, l’acte terroriste du 14 février 2005 a été considéré par le Conseil de sécurité comme une menace contre la paix et la sécurité internationale17, de sorte qu’«aucune remise en cause de la stabilité au Liban ne sera tolérée»18.
Selon une certaine doctrine, le TSL serait l’expression d’une immixtion dans les affaires internes nationales, car il est appelé à juger sur une infraction pénale de droit interne, à savoir à l’égard d’une matière considérée de domaine réservé19. En réalité, il serait excessif d’envisager une vraie imposition dans la création du TSL, si l’on considère qu’elle faisait suite à une demande formellement adressée par le Gouvernement libanais au Conseil de sécurité. La demande exprimait donc l’admission gouvernementale des limites des autorités nationales à assurer une justice fiable, indépendante et impartiale20. D’ailleurs, la permanence d’une situation de risque de perpétration
15 Dans cette perspective, les résolutions adoptées par le Conseil de sécurité depuis
l’attentat contre Hariri s’inscrivent dans le cadre de “la situation au Moyen-Orient”; voy. AZAR, op. cit.
16 Rapport du Secrétaire général (S/2006/893/Add.1): «Le Liban a besoin de l’aide de la communauté internationale pour créer les conditions d’une paix durable dans le pays et pour devenir un facteur de paix dans la région».
17 Sur le but de la justice pénale internationale de rétablir l’ordre pénal international, voy. SAFFERLING, Towards an international criminal procedure, Oxford, 2007, 44-48.
18 Voy. résolution 1636/2005; voy. FICHET-BOYLE, MOSSE, L’obligation de prendre des mesures internes nécessaires à la prévention et à la répression des infractions, in ASCENSIO, DECAUX, PELLET, Droit international pénal, Paris, 2000, 871-885.
19 Pour un regard critique concernant la création du TSL en tant que juridiction “d’exception”, voy. KOLB, Droit international pénal, Bruxelles, 2008, 241-242; pour une lecture en termes de “mesure disproportionnée” et de justice “imposée” par l’ONU, voy. LELARGE, op. cit., 424-428.
20 De plus, il faut mettre en exergue l’absence de crédibilité et de fiabilité de l’enquête menée par les autorités nationales, ce qui avait déjà conduit à établir une Commission d’enquête internationale, sur la base de la résolution 1595/2005 du Conseil de sécurité, qui aurait donc appliqué des méthodes d’investigation selon les standards internationaux. Il s’agissait d’un organe qui devait d’abord se limiter à aider les autorités libanaises dans l’enquête interne, mais qui a vu accroître ensuite ses prérogatives au fur et à mesure que la nécessité de créer un Tribunal Spécial prenait corps, que d’autres assassinats politiques envers des éléments anti-syriens se succédaient au Liban et qu’une intense activité de dépistage émergeait au cours des investigations.
LA COMUNITÀ INTERNAZIONALE
60
d’autres faits criminels de la même gravité ont créé les conditions pour agir sur la base du Chapitre VII de la Charte.
Aux critiques d’ordre juridique, il faut ajouter celles d’ordre poli-tique, concernant les modalités de création du TSL ainsi que sa composition21. En réalité, quant aux juges, on peut répondre que l’in-dépendance du Tribunal est assurée grâce au mode de leur élection. L’impartialité est une condicio sine qua non pour l’éligibilité des juges internationaux22. Pour être éligibles, ils doivent posséder des qualités de compétence, d’intégrité morale et d’autonomie par rapport aux autorités politiques et à tout autre groupe de pouvoir lié à un Etat. Ils ne doivent pas se trouver dans la condition de subir ni d’ingérences ni de menaces.
La façon d’élire les juges internationaux de cette instance doit donc remplir ces critères et c’est dans cette logique qu’il faut considérer la composition du TSL23: en effet, le Statut fixe la composition des Chambres selon un critère de répartition qui fait prévaloir en nombre les juges internationaux sur les juges libanais, sur un total de neuf juges entre le Juge de la mise en état, la Chambre de première instance et la Chambre d’appel, dans un rapport de six juges internationaux contre trois juges libanais24; sans oublier que le Procureur est lui aussi un organe international25.
En outre, le fait que le TSL ne soit pas un organe subsidiaire du Conseil de sécurité empêche toute possible doute liée à l’appartenance à une structure hiérarchique dérivant de sa création sur la base du Chapitre VII26. L’indépendance du TSL de l’ONU est également de type financier, dans la mesure où seulement quarante-neuf pour cent des dépenses sont pris en charge par le Gouvernement du Liban et
21 Plus précisément, les modalités de création du TSL et même sa composition n’ont pas
évité les accusations du Hezbollah quant à la légitimité et à l’impartialité de cette instance. 22 Pour l’élection des juges de la CPI, voy. l’art. 36 du Statut. 23 Voy. European Court of Human Rights, DeCubber v. Belgium, Judgment 26 Octobre
1984, Series A No. 86, par. 26 , about the «confidence which the court in a democratic society must inspire in the public and, above all, as far as criminal proceedings are concerned, in the accused»; European Court of Human Rights, Campbell and Fell v. UK, Judgment 28 June 1984, Series A No. 80, par. 81, «justice not only be done: it must be seen to be done».
24 TSL, art. 8, par. 1 du Statut. 25 Art. 8, par. 1 de l’Accord annexé à la résolution 1757/2007: «Le Tribunal spécial siège
hors du Liban. Le choix du siège tiendra dûment compte des considérations de justice, d’équité et d’efficacité en matière sécuritaire et administrative, notamment des droits des victimes et de l’accès aux témoins, et sera subordonné à la conclusion d’un accord de siège entre l’Organisation des Nations Unies, le Gouvernement et l’Etat d’accueil du tribunal».
26 Les mêmes critiques ont concerné le TPIY, voy. ICTY Trial Chamber Decision 10 August 1995 Case No. IT-94-I-T, par. 7.
LE TRIBUNAL SPECIAL POUR LE LIBAN
61
cinquante et un pour cent provient d’États tiers27, qui participent avec des contributions volontaires.
Il faut ajouter que l’indépendance du Tribunal est garantie également par sa délocalisation du contexte national, son siège ayant été fixé à La Haye, loin de toute pression ou conditionnement au niveau local et de tout risque de menace ou rétorsion aux victimes, aux témoins et aux juges. Par ailleurs, les autorités libanaises elles-mêmes ont consenti à la délocalisation au moment de la signature de l’Accord, qui prévoyait la seule présence dans le pays d’un bureau chargé des enquêtes. Le choix d’une juridiction internationalisée s’inscrit donc dans le nécessité de garantir au Liban une justice de substitution vraiment indépendante mais proche du Liban.
3. L’originalité du TSL dans la compétence ratione materiae: le
crime de terrorisme selon la loi libanaise.- A part les modalités concernant sa création, la spécificité du TSL demeure dans le droit applicable, surtout le droit matériel. En effet, sa compétence ratione materiae inclut le crime de terrorisme, auparavant jamais poursuivi par les autres instances à caractère international28. Toutefois, malgré la dimension internationale de ce crime, la notion de terrorisme à laquelle le TSL fait référence est celle indiquée par la loi libanaise29, puisque l’art. 2 du Statut fixe dans le droit pénal libanais le droit
27 Parmi les Etats tiers figurent: le Koweït, l’Arabie Saoudite, les Emirats Arabes Unis, la
France et les Etats-Unis. 28 En effet, l’aspect d’originalité concerne plutôt la compétence en matière de terrorisme
que l’applicabilité de la loi pénale libanaise, étant donné que d’autres juridictions internationalisées, telles que les Chambres Extraordinaires auprès des Tribunaux Cambo-dgiens, ont appliqué le droit national, même si de façon non exclusive. L’art. 2 du Statut du TSL indique comme droit applicable: les dispositions du Code pénal libanais sur le crime de terrorisme, sur les crimes et délits contre la vie et l’intégrité physique des personnes, sur les associations illicites et sur la non-révélation de crimes et délits; les artt. 6 et 7 de la loi libanaise du 11 janvier 1958 en matière de sédition, guerre civile et lutte confessionnelle. Voy. à cet égard, le Rapport du Secrétaire général, (S/2006/893), parr. 23-24: «les 14 attentats commis au Liban pouvaient correspondre à la définition prima facie du crime contre l’humanité»; addendum (S/2006/893/Add.1), par. 2.
29 L’art. 2 du Statut du TSL indique comme droit applicable: les dispositions du Code pé-nal libanais sur le crime de terrorisme, sur les crimes et délits contre la vie et l’intégrité phy-sique des personnes, sur les associations illicites et sur la non-révélation de crimes et délits; les artt. 6 et 7 de la loi libanaise du 11 janvier 1958 en matière de sédition, guerre civile et lutte confessionnelle. Voy. à cet égard, le Rapport du Secrétaire général, (S/2006/893), parr. 23-24: “les 14 attentats commis au Liban pouvaient correspondre à la définition prima facie du crime contre l’humanité”; addendum, (S/2006/893/Add.1), par. 2. La solution adoptée – visant à inscrire les infractions dans une dimension nationale – a introduit une nouvelle tendance de l’ONU en matière de création de juridictions sur la base du Chapitre VII.
LA COMUNITÀ INTERNAZIONALE
62
matériel applicable30. Plus précisément, le droit libanais est applicable en termes de renvoi par le Statut31, comme il est indiqué dans le premier acte d’accusation du TSL, rendu public en août 201132.
Il ne s’agit toutefois pas d’une applicabilité sic et simpliciter, dans la mesure où ce qui est demandé est une interprétation de la loi libanaise conforme aux principes généraux du droit international et aux droits de l’homme. Il s’agit d’une formule fruit de l’ordonnance du 16 février 2011 de la Chambre d’appel, où les juges ont répondu à la question liminaire posée par le Juge de la mise en état sur ce point: à savoir si, même à l’égard du droit matériel applicable, le tribunal devait également tenir compte de la normative internationale en matière de terrorisme. Le problème concernait donc l’interprétation du droit matériel applicable33, surtout en ce qui concerne le crime de terrorisme34. La conclusion de la Chambre d’appel a été la suivante: le droit international, coutumier ou conventionnel découlant des traités ratifiés par le Liban, peut exclusivement fournir des indications interprétatives au Tribunal, qui devra toutefois se limiter à appliquer la notion de crime de terrorisme tel que définie par le droit pénal libanais, à savoir l’art. 314 du Code pénal libanais, et appliquée par les juridictions libanaises35.
Pour comprendre la décision de la Chambre d’appel il faut consi-dérer l’importance du crime de terrorisme dans le milieu international, car la définition de ce crime et la façon de le réprimer ont intéressé la communauté internationale et les experts du droit international pen-dant des décennies.
Le choix d’une juridiction internationalisée, mais compétente pour des crimes définis par le droit interne, a alimenté les critiques
30 Pour le respect des principes de légalité et de non-rétroactivité, reconnus par la loi
libanaise, voy. GALLANT, The principle of legality in international and comparative criminal law, Cambridge, 2009, 324-325.
31 Le Statut renvoit au Code pénal du 1943 et aux dispositions de la loi du 11 janvier 1958.
32 Les neuf chefs d’imputation contenus dans l’acte d’accusation indiquent également les premiers quatre suspects officiels: Mustafa Amine Badreddine, Salim Jamil Ayyash, Hussein Hassan Oneissi et Assad Hassan Sabra. Voy. l’acte d’accusation du 10 juin 2011, STL-11-01/I/PTJ.
33 STL-11-01/I, Chambre d’appel, Décision préjudicielle sur le droit applicable: terro-risme, complot, homicide, commission, concours de qualification, 16 février 2011.
34 Une faculté dont le Juge dispose en vertu de l’art. 68, alinéa G) du RPP aux fins de permettre au Tribunal d’éviter tout retard non justifié dans sa procédure et donc, de garantir un procès rapide et équitable. Pour les autres questions posées par le Juge de la mise en état, voy. Chambre d’appel, Décision citée, par. 42.
35 Voy, parr. 62, 145 et 147 de la Décision de la Chambre d’appel citée.
LE TRIBUNAL SPECIAL POUR LE LIBAN
63
relatives à une immixtion internationale dans les affaires domestiques libanaises36, au lieu d’être perçu comme la manifestation de respect de la tradition juridique libanaise37, du principe de légalité38 et celui du juge naturel établi antérieurement par la loi39. La décision d’interpréter la loi libanaise selon les principes de droit pénal les plus élevés ne peut qu’être lue dans le but d’harmoniser la loi libanaise avec le droit international, pour garantir le respect des normes internationales les plus élevées en matière de justice pénale.
Plus précisément, en ce qui concerne le crime de terrorisme, la vérification concerne naturellement la compatibilité des normes du droit pénal libanais avec le droit international. Au-delà du problème de l’absence présumée d’une définition partagée de la notion de terrorisme40, ce que les juges du TSL se sont donc demandés était si le droit pénal libanais devait être interprété à la lumière de l’évolution du droit international en la matière ou non41.
A cet égard, la Chambre d’appel a déclaré que plusieurs traités, résolutions des Nations Unies et également qu’une certaine pratique judiciaire au niveau national avaient démontré l’existence d’une règle coutumière de droit international en matière de terrorisme en temps de paix, l’existence de la même règle étant in statu nascendi42 en période de conflit armé43. L’existence de cette règle coutumière est confirmée
36 Sur le conflit entre justice pénale internationale et souveraineté nationale, voy.
SAFFERLING, op. cit., 48-53. 37 Rapport du Secrétaire général (S/2006/176), par. 8. 38 BASSIOUNI, Introduction au droit pénal international, Bruxelles, 2002, 178 ss.;
GRANDE, Droit pénal et principe de légalité: la perspective du comparatiste, in FRONZA, MANACORDA (dirs.), La justice pénale internationale dans les décisions des tribunaux ad hoc, Paris, 2003, 69 ss.; CASSESE, International criminal law, Oxford, 2003, op. cit., p. 135.
39 Sur l’importance de la justice pénale internationale en tant que justice de substitution, voy. CASSESE, Lineamenti di diritto internazionale penale, II. Diritto processuale, Bologna, 2006, 159-160.
40 En faveur de l’existence d’une définition de terrorisme universellement acceptée et sur l’absence d’un accord sur l’exception à la définition en ce qui concerne les freedom fighters, voy. CASSESE, Lineamenti di diritto internazionale penale, I. Diritto sostanziale, Bologna, 2005, 162-175.
41 Sur le sujet, voy. BASSIOUNI, in Criminal LR, 2001, July, 527-542; SAUL, Defining Terrorism in International Law, Oxford, 2008, 270; BARNIDGE, Terrorism: Arriving at an Understanding of a Term, in Terrorisme et droit international, Leiden, 2008, 157-193; O.-Y.-E., International Law Documents Relating to Terrorism, London, 1995.
42 Voy. TPIY, Arrêt relatif à l’appel de la défense concernant l’exception préjudicielle d’incompétence, 2 octobre 1995, par. 94; GREEN, The contemporary law of armed conflict, Manchester, 2000, 16; DINSTEIN, War, aggression and self-defence, Cambridge, 2001, III éd., 181, 214, 261.
43 Le Bureau de la Défense du TSL – un organe interne au Tribunal – a opposé une série d’observations – dans certains cas partagées par le Procureur lui-même – aux questions
LA COMUNITÀ INTERNAZIONALE
64
par l’opinio juris44 ac nécessitatis45 au sein de la communauté internationale, et par la diuturnitas46. En effet, l’opinion partagée par la communauté internationale est qu’il faut combattre le terrorisme «sous toutes les formes et quels qu’en soient les motivations, les auteurs et les victimes, sur la base du droit international»47. D’ailleurs, la règle coutumière de droit international impose la répression de ce crime tant aux sujets de droit international qu’aux individus et donc aux Etats obligés de faire respecter et de punir ce crime au niveau national48. De plus, l’analyse de la règle coutumière a fait émerger la présence de trois éléments nécessaires à la configuration d’un acte comme acte terroriste: la perpétration ou la menace d’un acte criminel; l’intention de répandre la peur parmi la population ou de contraindre directement ou indirectement une autorité nationale ou internationale à accomplir un certain acte ou à s’abstenir de l’accomplir; la présence, au sein de cet acte, d’un élément d’extranéité49.
préjudicielles soumises à la Chambre d’appel, parmi lesquelles: in primis, le fait qu’il n’existe actuellement aucune définition établie du crime de terrorisme en droit international coutumier et qu’une définition cristallisée dans une phase qui précède le procès ne pouvait qu’être irrespectueuse des droits de l’accusé du fait qu’elle serait prématurément imposée par les juges; en deuxième lieu, il a soutenu qu’une interprétation stricte du droit pénal applicable aurait dû rester respectueuse de la souveraineté étatique et donc du principe in dubio mitius; que, dans l’application du droit matériel, le droit international ne devait pas être pris en considération, “le droit libanais étant suffisamment clair et plus à même de protéger efficacement les droits des défendeurs potentiels”, thèse ayant été d’ailleurs accueillie par la Chambre d’appel
44 Voy. Affaires du Plateau Continental de la mer du Nord (République fédérale d’Allemagne c Danemark; République Fédérale d’Allemagne c Pays-Bas), Arrêt, C.I.J. Recueil (1969) 4, 43 et 44, parr. 76 et 77.
45 Voy. l’Affaire Nicaragua, Activités militaire et paramilitaires au Nicaragua et à l’encontre de celui-ci (Nicaragua c. Etats-Unis d’Amérique), Arrêt, C.I.J. Recueil (1986) 14, 98, par. 186. MERON, The Humanization of International Law, Leiden-Boston, 2006, 126 et 256 s.
46 MERON, op. cit. 47 Voy. le Rapport présenté au Comité contre le terrorisme (Iran), 27 décembre 2001,
S/2001/1332, par. 2. 48 Voy. le Manuel sur le rôle de la justice pénale dans la lutte contre le terrorisme,
UNODOC, Série de manuels sur la réforme de la justice pénale, 2009, 5-31; SIMMA, “International Crimes: Injury and Countermeasures, Comments on Part 2 of the ILC Work on State Responsibility”, in WEILER, CASSESE, SPINEDI (eds.), International Crimes of State: a Critical Analysis of the ILC’s Draft Article 19 on State Responsibility, 1989.
49 Voy. la notion de coutume internationale donnée par la Cour internationale de Justice dans l’affaire du Plateau continental, Affaires du Plateau Continental de la mer du Nord (République fédérale d’Allemagne c Danemark; République Fédérale d’Allemagne c Pays-Bas), Arrêt, C.I.J. Recueil (1969) 4, 43 et 44, par. 76 et 77; cfr. STL-11-01/I, Chambre d’appel, Décision préjudicielle sur le droit applicable: terrorisme, complot, homicide, commission, concours de qualifications, 16 février 2011, parr. de 85 à 148; voy. également les Observations du Procureur, par. 25.
LE TRIBUNAL SPECIAL POUR LE LIBAN
65
Or, les organes du Tribunal ont focalisé leur attention sur le droit applicable par le Tribunal à cet égard50, au-delà du simple renvoi à la disposition de la législation libanaise et restant de toute façon le droit libanais le droit matériel appliqué par le Tribunal51. Il faut observer d’ailleurs que la définition du crime de terrorisme dans le Code pénal libanais est la suivante: «acts of terrorism are acts which are intended to cause a state of alarm and are committed by means such as explosive devices, liable to pose a public threat»52. Il faut ajouter que le Liban a ratifié la Convention arabe pour la lutte contre le terrorisme du 22 avril 199853. Selon l’opinion du Procureur, ladite notion doit être interprétée comme une sorte de “working tool”, à savoir un instru-ment de travail capable de contribuer, par son interprétation et appli-cation de la part du TSL, à l’évolution du droit pénal international54.
Ladite conclusion ne fait que garantir le respect du principe général de légalité et de non rétroactivité de la loi pénale, tel qu’il est énoncé aussi dans la Constitution et dans le Code pénal libanais55, mais elle souligne également des différences importantes en matière de preuve, comme le fait que le droit international demande la preuve de l’élément subjectif spécifique de «créer un état d’alarme», ce qui n’est pas demandé par le droit libanais. Au contraire, «en droit liba-nais et non en droit international, les moyens utilisés pour commettre l’acte de terrorisme doivent être de nature à exposer le public à un danger»56.
Ainsi, la Chambre d’appel a établi que, à la lumière du droit international, l’interprétation de l’art. 314 du Code pénal libanais doit tenir compte de trois éléments ultérieurs: la commission volontaire de
50 COUGHLAN, Wanted – A definition on terrorism, by International Justice Tribune, Radio
Netherlands Worldwide, 21 February 2011, www.rrnw.nl, (consulté le 24 février 2011). 51 Voy. ASCENSIO, MAISON, op. cit., 2007, 432-435. 52 Il s’agit de l’art. 314 du Code pénal libanais, dans la version française: «Sont compris
dans l’expression actes de terrorisme tous faits dont le but est de créer un état d’alarme, qui auront été commis par des moyens susceptibles de produire un danger commun, tels qu’engins explosifs, matières inflammables, produits toxiques ou corrosifs, agents infectieux ou microbiens».
53 La Convention est entrée en vigueur le 7 mais 1999. Disponible sur le site suivant: www.unodc.org.
54 Celui-ci a proposé une définition qui ne soit pas nécessairement liée aux motivations et aux finalités politiques de l’acte de terrorisme, dont la preuve peut être négligée, le crime étant un acte à travers lequel «a substantial section reasonably and significantly fears more than momentarily from the present onward, incriminate personal harm».
55 Art. 1er du Code pénal libanais. 56 Voy. Chambre d’appel, Décision préjudicielle citée, lettre C), par. 145.
LA COMUNITÀ INTERNAZIONALE
66
l’acte, l’utilisation de moyens susceptibles de créer un danger commun et l’intention de l’auteur de créer un état de terreur57.
4. La procédure adoptée par le Tribunal: les influences romano-
germaniques du système libanais.- La procédure du TSL s’inspire en même temps du code de procédure pénale nationale et des normes de procédure pénale «les plus élevées, afin de garantir un procès rapide et efficace»58. En effet, à part sa nature et sa composition, on peut noter que le caractère international du Tribunal demeure surtout dans sa procédure59.
L’idée d’une procédure pénale internationale unifiée a commencé à prendre corps après la CPI. En effet, malgré les différences existant au sein des autres instances à caractère international, une certaine uniformité de procédure de base est certainement envisageable en termes de mixité découlant des modèles appartenant aux deux systèmes juridiques de common law et de civil law. La procédure adoptée par la CPI est l’expression la plus élevée de ce mélange, dans la mesure où un modèle mixte rassemble en soi l’optimum des systèmes juridiques existants60, afin de garantir le respect des règles du procès équitable et des garanties réservées à l’accusé61.
En ce qui concerne le TSL, s’il est vrai que sa procédure mixte exprime le caractère international de cette instance, en vertu de la double référence explicite aux sources nationales libanaises et internationales – il s’agit d’ailleurs de l’hybridité propre aux juridictions internationalisées –, il est également vrai que la procédure du TSL suit beaucoup la tradition de droit civil du système juridique libanais62, où le juge joue un rôle central aussi bien avant qu’au cours du prétoire. De plus, la procédure pénale libanaise, conformément au
57 Ibid., par. 147. 58 Statut du TSL, art. 28, par. 2. 59 FERNANDES DE GURMEDIA, FRIMAN, The roules of procedure and evidenceof the
International Criminal Court, in IYHL, 2000, 325. 60 CASSESE, International criminal law, op. cit., 386-387. 61 A cet égard, voy. BASSIOUNI, Introduction au droit pénal international, op. cit.,
Bruxelles, 2002, 215-216; CASSESE, Procès équitable et juridictions pénales internationales, in Variations autour d’un droit commun, Paris, 2002, 246; DOSWALD-BECK, KOLB, Garanties judiciaires et droits de l’homme Kehl/Strasbourg/Arlington, 2004, 95 ss. Pour un commentaire critique, TULKENS, The Paradoxical Relationship between Criminal Law and Human Rights, in Journal of International Criminal Justice, 2011, 577-595.
62 Dans une certaine mesure, il se rapproche des C.E.T.C. Sur ce point, voy. DELMAS-MARTY, L’influence du droit comparé sur l’activité des Tribunaux pénaux internationaux, in CASSESE, DELMAS-MARTY (éds.), Crimes internationaux et juridictions internationales, Paris, 2002, 116.
LE TRIBUNAL SPECIAL POUR LE LIBAN
67
modèle romano-germanique, privilégie la preuve écrite et prévoit la participation des victimes à la procédure.
Ce dernier élément – même s’il s’agit d’un aspect typique des systèmes de civil law, les victimes étant exclues dans le modèle accusatoire – rapproche le TSL de la CPI, mais également des Chambres extraordinaires auprès des Tribunaux Cambodgiens (CETC). Toutefois, une telle possibilité est admise dans le procès devant le TSL dans certaines limites et avec des différences très importantes par rapport à la participation des victimes dans le procès devant la CPI63. Comme pour les CETC, les victimes du TSL sont autorisées à intervenir pour faire part au Tribunal de leurs vues et préoccupations, lorsque leurs intérêts personnels sont affectés, mais contrairement à la procédure devant la CPI où les victimes jouissent du droit à la réparation64, elles ne peuvent demander aucune réparation du préjudice subi à cause des crimes poursuivis. Les victimes présentes au TSL peuvent certainement se prévaloir d’un jugement de condamnation émis par le Tribunal afin de demander et obtenir réparation devant les autorités nationales65. Enfin, l’action des victimes au cours de la procédure doit toujours s’accomplir «d’une manière qui n’est ni préjudiciable ni contraire aux droits de la défense et aux exigences d’un procès équitable et impartial»66.
5. Le dépassement des griefs à l’égard de l’exception à
l’interdiction du procès in absentia.- Une particularité typique des systèmes de civil law qui caractérise cette nouvelle juridiction, en l’éloignant drastiquement du modèle procédural offert par la CPI, est l’admission du procès in absentia.
En général, si, sur le plan des systèmes nationaux, le principe de l’interdiction du procès par contumace ne reflète pas un principe général absolu67, sur le plan international la Cour, les TPI et les autres
63 Pour une brève illustration des modalités de participation des victimes à la procédure
devant la CPI, voy. CATALETA, La tutela delle vittime e la Corte penale internazionale: da una giustizia repressiva ad una giustizia riparatrice, in I diritti dell’uomo, cronache e battaglie, 2011, n. 1.
64 CPI, artt. 75 et 79 du Statut. 65 TSL, art. 25, par. 3 du Statut. 66 TSL, art. 17 du Statut. 67 Il est présent dans plusieurs pays de civil law, mais la règle selon laquelle le modèle
accusatoire ne permet pas de procès in absentia et que le modèle inquisitoire l’admet, n’est pas dépourvue d’exceptions, là où certains pays ayant un modèle accusatoire admettent le procès par contumace, voir l’Italie, et par contre, d’autres qui ont adopté un modèle inquisitoire ne l’admettent pas, voir l’Allemagne et l’Espagne.
LA COMUNITÀ INTERNAZIONALE
68
juridictions internationalisées ont introduit dans leurs Statuts ce principe, en tant que condition pour la célébration régulière du procès. En effet, le procès pénal international, notamment celui devant la CPI68, requiert la présence de l’accusé pendant le déroulement du procès69, son absence étant admise uniquement soit quand l’accusé, par son comportement, gêne le déroulement régulier du procès, soit quand, après l’ouverture du procès, il décide volontairement de se soustraire à la justice70.
Pour comprendre l’importance de ce principe dans le système de la justice pénale internationale, il faut considérer la complexité intrinsèque du procès pénal international et la spécificité des affaires dont il s’occupe. La médiatisation excessive de ce genre de procès génère souvent des monstres pour l’opinion publique. La présence de l’accusé au procès et l’exercice du droit de se défendre, conjointement à la publicité du procès, en tant que principe incontournable pour une société démocratique71, peut résulter la façon la plus directe de protéger d’autres principes fondamentaux de l’accusé, comme celui de la présomption d’innocence72.
D’ailleurs, en ce qui concerne la procédure, la ratio de l’inter-diction du procès par contumace demeure en premier lieu dans la nécessité de garantir la dialectique entre Accusation et Défense, et donc l’égalité des armes, dans le respect des standards internationaux sur les droits de l’homme, auxquels la justice pénale internationale se conforme73. En effet, la Cour européenne des droits de l’homme et la Cour interaméricaine des droits de l’homme ont affirmé à plusieurs reprises que la présence de l’accusé au procès est nécessaire pour lui permettre de participer au moment où les preuves à sa charge seront présentées74.
Dans la prévision du procès in absentia, le TSL, en se rappro-
68 CPI, art. 63, par. 1 du Statut. 69 CASSESE, International criminal law, op. cit., 2000, 371-372; CASSESE, Lineamenti di
diritto internazionale penale. II, op. cit., 101-109; SAFFERLING, op. cit., 241-250; SCHABAS, An Introduction to the International Criminal Court, Cambridge, 2004, 143 ss.
70 CPI, art. 63, par. 2 du Statut. 71 Sur le principe de la publicité du procès, voy. SAFFERLING, op. cit., 226-239. 72 CASSESE, International criminal law, cit., 2000, 400-405; BASSIOUNI, op. cit., 519. 73 CASSESE, L’influence de la CEDH sur l’activité des Tribunaux Pénaux Internationaux,
in CASSESE, DELMAS-MARTY, (dir.), op. cit., 143 s. 74 Cour européenne des droits de l’homme, Poitrimol c. France, arrêt 23 novembre 1993,
par. 35; Krombach c. France, arrêt 13 février 2001, par. 86; Brozicek v. Italie, arrêt 19 décembre 1989, par. 45.
LE TRIBUNAL SPECIAL POUR LE LIBAN
69
chant du système juridique libanais75, introduit donc une nouveauté importante par rapport au Statut de Rome76. En effet, sur cet aspect, des éléments propres au modèle inquisitoire caractérisent la procédure du TSL77.
L’exception à un principe consolidé sur le plan international se prête à d’inévitables objections visant à voir dans la procédure adoptée par le TSL une régression de la procédure internationale vers un modèle de matrice inquisitoire moins respectueux de l’égalité des armes. Les critiques concernent essentiellement la violation du principe du contradictoire lié à l’absence de l’accusé au moment de la formation de la preuve à charge.
De telles critiques peuvent être aisément rejetées par la circonstance que l’admissibilité du procès in absentia dans la procédure du TSL est limitée au respect d’un certain nombre de règles. De plus, l’exception s’inscrit dans le cadre de deux exigences: en premier lieu et plus spécifiquement, à celle de maintenir le TSL le plus que possible près du système libanais de droit civil; en deuxième lieu et plus en général, à la nécessité de tenir compte de la spécificité de la justice pénale internationale, qui demande des réponses le plus que possible immédiates – ce qui est déjà très difficile quand on s’occupe de certains crimes – et des solutions spécifiques pour des situations spécifiques.
La complexité de la justice pénale internationale, avec toutes les conséquences en termes de poursuite, de rassemblement des éléments de preuve et plus en général de mise en marche de la machine judiciaire, implique que l’ouverture du procès a lieu plusieurs années après la perpétration des crimes. Dans ce laps de temps, il s’avère souvent que la capture de l’accusé résulte de plus en plus difficile, parfois à cause de la faible coopération de la part des gouvernements. Autrement dit, il faut considérer l’intérêt que la société porte à la lutte à l’impunité dans tous les cas de violations des droits de l’homme
75 TSL, art. 22 du Statut. Pour la réglementation de la procédure in absentia, voy. le Règlement de procédure et de preuve, Chapitre 5, Section 6.
76 En réalité, l’art. 22 par. 1 du Statut de la CPI affirme génériquement «l’accusé est présent à son procès» au lieu de «l’accusé jouit du droit d’être présent à son procès», ou de l’expression plus forte «l’accusé doit être présent à son procès», ce qui aurait affirmé de manière moins sibylline et moins souple le principe de l’interdiction du procès par contumace.
77 Voy. l’art. 28, par. 2 du Statut du TSL «les juges se guideront, selon ce qui conviendra, sur le Code de procédure pénal libanais et d’autres textes de référence consacrant les normes internationales de procédure pénale les plus élevées, afin de garantir un procès rapide et équitable»; voy. également la référence aux normes internationales relatives au rassemblement des éléments de preuve, art. 19 du Statut.
LA COMUNITÀ INTERNAZIONALE
70
d’une certaine gravité; dans ces cas, la demande de justice de la société peut justifier l’absence de l’accusé au procès, surtout dans le cas où l’accusé prend la fuite78.
Il va de soi qu’une telle argumentation est à la base de l’exception à un principe et à une pratique consolidée, dont la violation peut être justifiée uniquement en présence de certaines conditions et dans l’observance de garanties. En effet, la réglementation très stricte de la seule exception à l’interdiction du procès par contumace démontre que, dans le cadre de la justice pénale internationale, la présence de l’accusé semble être devenue l’une des conditions fondamentales pour un procès équitable et que seuls le caractère et les exigences spécifiques du TSL en justifient une dérogation.
Dans cette perspective, il faut considérer que l’attentat terroriste contre Hariri a été perpétré en 2005 et que l’acte d’accusation a été rendu public en 2011. Par conséquent, le décalage temporel entre commission du crime et déroulement du procès n’était pas dépourvu de conséquences en termes de conservation des preuves à rechercher. A cela, il faut ajouter la difficulté dans la capture des accusés, ce qui rend le risque d’impunité très élevé. De plus, l’écoulement temporel fait perdre actualité à l’action judiciaire, et une justice tardive ne peut que provoquer le découragement, le désintérêt et le manque de confiance dans la justice de la part de la communauté civile. Dans cette perspective, il apparaît donc clairement le rationale en faveur du procès par contumace, dont l’esprit est de lutter efficacement contre l’impunité.
Or, la procédure par défaut du TSL ne fait que suivre la jurisprudence sur les droits de l’homme. En effet, la Cour européenne des droits de l’homme, dans l’affaire Colozza v. Italy79, a précisé que l’impossibilité de célébrer un procès à cause de l’absence de l’accusé peut provoquer la dispersion des moyens de preuve, même celles à décharge, ou de prescription de certains droits de l’accusé, actions qui doivent être accomplies sans dérogations dans un certain délai et dans une certaine phase de la procédure80. Dans ce sens, le procès par contumace serait donc admis surtout dans l’intérêt de l’accusé.
Pour pallier les conséquences dérivant de l’absence de con-tradictoire et atténuer ainsi toute possible menace à l’équité de la
78 CASSESE, International criminal law, op. cit., 371-372. 79 Cour européenne des droits de l’homme, Colozza v. Italie, arrêt 12 février 1985, par.
29. 80 CASSESE, L’influence de la CEDH, op. cit., 143 ss.
LE TRIBUNAL SPECIAL POUR LE LIBAN
71
procédure, le procès in absentia du TSL impose un certain nombre de garanties. Premièrement, la procédure par défaut ne peut être appliquée que sur décision de la Chambre de première instance et limitativement à trois cas: renonciation écrite de la part de l’accusé à son droit à être présent; manque de rémission au Tribunal de celui-ci de la part de l’Etat concerné81; fuite de celui-ci ou impossibilité de le trouver, malgré la mise en œuvre de toutes les mesures raisonna-blement possibles pour en assurer la présence et pour lui garantir la connaissance des charges à son encontre82. Quand, après des tentatives raisonnables, il s’avère impossible de déterminer où l’accusé se trouve, et que donc l’acte d’accusation ne peut lui être notifié en personne, le Président du Tribunal, en consultation avec le Juge de la mise en état, peut ordonner de rendre public l’acte d’accusation, partiellement ou intégralement.
Par cette publication, l’accusé est informé du fait qu’il doit comparaître devant les juges83; de plus, les personnes détenant toute information sur le lieu où l’accusé se trouve sont invitées à la communiquer au TSL. A cette fin, le Greffier transmet aux autorités nationales une annonce avisant l’opinion publique de l’existence d’un acte d’accusation84. Ce n’est qu’après trente jours à partir de cette annonce que le Tribunal peut engager la procédure en l’absence de l’accusé. Le Juge de la mise en état demandera alors au Chef du Bureau de la Défense de commettre d’office un conseil à l’accusé85. En effet, le procès in absentia devant le TSL est possible surtout grâce à la présence du Bureau de la Défense, un organe qui n’est pas présent au sein des autres juridictions pénales internationales.
Deuxièmement, puisque l’impossibilité de comparaître devant le Tribunal ou de prendre connaissance du procès contre lui n’est pas toujours causée par l’accusé, le Tribunal lui donne la possibilité – s’il prouve cette impossibilité comme non imputable – d’être jugé ex novo, une fois comparu après la fin du procès par contumace et à moins qu’il n’ait désigné un conseil de son choix et qu’il n’ait eu des contacts avec son conseil pendant le procès86. Une fois jugé par contumace et une fois retrouvé ou comparu, l’accusé jouit donc du
81 TSL, art. 106, alinéa B) du RPP. 82 TSL, art. 22, par. 1 du Statut et art. 106, alinéa A) du RPP. 83 TSL, art. 76, alinéa E) du RPP. 84 TSL, art. 76bis du RPP. 85 TSL, art.105bis, alinéa B) du RPP. 86 TSL, art. 108, alinéa A) du RPP.
LA COMUNITÀ INTERNAZIONALE
72
droit à être rejugé87. En outre, il pourra choisir entre plusieurs possibilités: accepter par écrit le jugement et/ou la peine, accepter par écrit le jugement et demander la tenue d’une nouvelle audience concernant la peine ou faire appel de la condamnation ou/et de la peine, une fois qu’il a renoncé par écrit à son droit d’être de nouveau jugé88. De plus, devant la Chambre d’appel, l’accusé jouit du droit d’accepter l’acquittement prononcé par la Chambre de première instance et de demander la tenue d’une nouvelle audience en appel89. Il s’agit de droits qui ne s’appliquent pas à un accusé qui a nommé un conseil de la défense et qui était représenté par celui-ci pendant la procédure par défaut90. Toutefois, le Règlement limite à une seule fois la possibilité pour l’accusé de se faire rejuger91.
En revanche, la simple absence physique de l’accusé aux audiences ne rentre pas dans la procédure par défaut, n’impliquant aucune négation du droit au contradictoire. En effet, pour des raisons logistiques ou de santé, la Chambre ou le Juge de la mise en état peuvent autoriser l’accusé à participer aux audiences par vidéo-conférence, en facilitant sa comparution formelle92. Il est évident que dans ces cas, il ne s’agit pas de procès in absentia, mais d’une procé-dure ordinaire que l’accusé peut suivre à l’aide des technologies modernes, souvent nécessaires au cours de procès concernant des accusés de plusieurs nationalités, qui ne sont pas détenus dans le quartier pénitentiaire du tribunal, mais qui se trouvent libres ailleurs. Toutefois, pour empêcher à l’accusé d’abuser de cette pratique, il est prévu une limite à son absence physique: une fois comparu et une fois désigné ou accepté la désignation d’un conseil, il sera toujours considéré présent même s’il ne se présente plus aux audiences de jugement93.
Comme cela a déjà été mentionné, la protection de l’accusé absent est renforcée par la présence, au sein du TSL, du premier Bureau de la Défense, en tant qu’organe institutionnellement reconnu,
87 TSL, art. 109 du RPP et art. 22, par. 3 du Statut: «En cas de condamnation par défaut,
l’accusé qui n’avait pas désigné un conseil de son choix a droit à ce que sa cause soit rejugée en sa présence devant le Tribunal, à moins qu’il n’accepte le verdit».
88 STL, art. 109, alinéa C) et E) du RPP. 89 STL, art. 9, alinéa E), iv). 90 STL, art. 109, alinéa F) du RPP. 91 STL, Art. 108, alinéa D) du RPP. 92 STL, Art. 104 du RPP. 93 ASCENSIO, MAISON, op. cit., 2009, 346, où des critiques ont été soulevées quant à la
cohérence des dispositions du RPP du TSL, 350.
LE TRIBUNAL SPECIAL POUR LE LIBAN
73
placé au même niveau que le Procureur et faisant officiellement partie de la structure interne du Tribunal. Il s’agit d’un organe exclusif qui permet le procès par contumace sans aucun risque pour le droit au contradictoire et à l’égalité des armes. En l’absence d’un organe pareil, il est évident que les mêmes garanties ne seraient par respectées pleinement. L’ensemble des normes établies dans le Règlement de procédure, permet donc au procès devant le TSL de garantir le respect des droits de l’accusé et de l’équité de la procédure, conjuguant donc les éléments inquisitoires de la procédure nationale libanaise avec les standards internationaux propres au schéma fortement accusatoire du procès pénal international94.
6. Conclusion.- Le TSL a remis en discussion des règles et des
principes qui semblaient s’être consolidés dans le système général de la justice pénale internationale, tels que: la participation des victimes à la procédure en tant que partie civile; le modèle mixte de la procédure avec une très forte impulsion accusatoire; l’interdiction du procès in absentia; la limitation de la compétence à un certain nombre de crimes, parmi lesquels le terrorisme n’était pas inclus. Enfin, il a remis en discussion le fondement conventionnel que la création de la CPI avait conféré à la justice pénale internationale actuelle, dans la mesure où encore une fois un tribunal a été le fruit d’une résolution du Conseil de sécurité de l’ONU.
Quant à la participation des victimes à la procédure, malgré les différences par rapport à la Cour, la normative en vigueur auprès du TSL, méconnue dans le procès devant les TPI, est l’expression de l’avancement d’une pratique admise dans le procès pénal international grâce à la CPI et que le TSL ne fait que confirmer. En ce qui concerne la procédure, la prééminence inquisitoire du modèle en vigueur devant le TSL, où le juge n’est pas un observateur mais un arbiter qui intervient, souligne le besoin de corriger et de balancer tout déséquilibre entre Accusation et Défense95. En effet, l’expérience précédente au TSL, notamment celle des Tribunaux ad hoc, avait démontré que la priorité du modèle accusatoire et l’application
94 Il faut rappeler l’ordonnance du Juge de la mise en état, où il reconduit aux juridictions à caractère international la présence d’un «dénominateur commun aux systèmes juridiques, autant de droit civil que de common law», voy. TSL, Juge de la mise en état, ordonnance portant fixation du délai de dépôt de la requête du Procureur en application de l’art. 17, paragraphe B) du règlement de procédure et de preuve, n° CH/PTJ/2009/03, 15 avril 2009.
95 AMBOS, International criminal procedure: “adversarial”, “inquisitorial” or mixed?, in ICLR, 2003, 1-37.
LA COMUNITÀ INTERNAZIONALE
74
paroxystique de ses règles a souvent produit des dysfonctionnements dans le déroulement du procès pénal international à cause d’une exacerbation des aspects de procédure liés à l’égalité des armes: en d’autres termes, cela nui aux droits de l’accusé96.
En outre, malgré une référence explicite à un modèle inquisitoire propre au système de civil law libanaise, la procédure du TSL ne peut pas être considérée en termes de déstabilisation par rapport à la procédure en vigueur dans le milieu de la justice pénale internationale. En effet, la réglementation minutieuse de la procédure par défaut, admise seulement à certaines conditions, fait que cette dernière juridiction internationalisée protège les droits de l’accusé même en son absence. Toute possible critique concernant l’admission du procès in absentia, susceptible d’engendrer une réduction des garanties sur l’équité de la procédure et sur l’égalité des armes est donc dépourvue de tout fondement grâce à la prédisposition d’un système rigoureux de protection des standards internationaux sur les droits de l’accusé, fruit de la mixité du droit applicable, notamment le droit procédural. De plus, la protection de l’accusé se matérialise, in primis, dans la présence d’un organe officiel unique dans l’histoire de la justice pénale internationale et peut-être de la justice pénale tout court: le Bureau de la Défense. A côté des Chambres, du Procureur et du Greffe, seul le TSL a institué un organe chargé de préserver et d’assurer les droits de l’accusé et du suspect.
En ce qui concerne l’aspect lié aux crimes poursuivis, notamment la compétence en matière de terrorisme, et aux modalités de sa création, il faut considérer le fondement national et international du Tribunal comme intimement liés entre eux. En pratique, l’incapacité de faire justice au niveau national a déterminé la création d’une juridiction à caractère international autonome et impartiale. La conta-mination de la juridiction internationale par des éléments juridiques provenant du système national libanais a poursuivi l’objectif de ne pas éloigner cette juridiction du Liban et par conséquent de ne pas permettre une internationalisation complète de l’affaire, contrairement à ce qui s’était passé pour les Tribunaux ad hoc. En effet, il faut reconnaître une tendance générale du système de la répression internationale vers une non exclusion de la souveraineté nationale; le
96 Il suffit de considérer la longueur du premier procès de la CPI contre Lubanga, com-
mencé en 2009 et pas encore terminé en 2011 à cause de la lourdeur d’une procédure ac-cusatoire tellement favorable aux droits à la preuve de se transformer dans un véritable goulet d’étranglement pour le droit à un procès rapide.
LE TRIBUNAL SPECIAL POUR LE LIBAN
75
rapport de complémentarité entre la CPI et les juridictions nationales en donne un exemple. Grâce à la procédure adoptée et à la décision du 16 février 2011 de la Chambre d’appel du TSL, surtout dans la partie concernant le crime de terrorisme, la non exclusion du Liban se réalise à travers le droit applicable: une combinaison réussie entre droit national et droit international.
Malgré toutes les limites de temps, d’espace et de matière, cette instance a certainement le mérite d’avoir produit des innovations intéressantes dans l’histoire de la justice pénale internationale. Tout cela nie évidemment l’hypothèse d’une possible déstabilisation du système général de la justice pénale internationale que la création d’une nouvelle instance si particulière aurait bien pu entraîner. ABSTRACT
The Special Tribunal for Lebanon: An Analysis of a Possible
Destabilizing Effect on the International Criminal Justice System
Inaugurated on 1 March 2009, the Special Tribunal for Lebanon is the latest creation of the system of international criminal justice. Like other international courts of the same “hybrid family”, it is a prototype for a variety of reasons.
In the first place, it exercises its jurisdiction over the terrorists responsible for the attack of 14 February 2005 in Beirut, resulting in the death of 23 persons, including former Prime Minister Hariri. Never before has a case for terrorism been brought before an interna-tional court.
Secondly, in spite of the adversarial model predominant in the international criminal courts, the Special Tribunal for Lebanon allows for proceedings in absentia, in accordance with the Lebanese civil law tradition. In the other international courts, trial in absentia is not allowed.
Thirdly, the Tribunal has established the first Defence Office, beside the Presidency, the Chambers, the Prosecutor and the Registrar. This official organ is a unicum in international criminal justice and is an undeniable achievement in order to respect the principle of equality of arms.
Lastly, its creation is based on a resolution (1757/2007) adopted by the Security Council of the United Nations under Chapter VII, recognising the existence of a threat to the peace and security in the
LA COMUNITÀ INTERNAZIONALE
76
region. The intervention of the Security Council came after the failure of ratification of an agreement with the UN initially proposed by the Lebanese Government. The resolution stressed however «the strict respect of the sovereignty, territorial integrity, unity and political independence of Lebanon under the sole and exclusive authority of the Government of Lebanon».
The present contribution aims at emphasising the singularity of the STL, which is not an international tribunal stricto sensu although international in character, and at underlining that it was the most suitable tailor-made solution to a defined situation in a defined country. Consequently, the international criminal system is not destabilized by this institution.