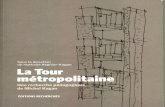Fils et pesons : éléments pour une approche des techniques de tissage en Gaule romaine du Nord
L'émigration italique dans la Lusitanie côtière : une approche onomastique
-
Upload
u-bordeaux3 -
Category
Documents
-
view
4 -
download
0
Transcript of L'émigration italique dans la Lusitanie côtière : une approche onomastique
L'
ÉMIGRATION
ITALIQUE
DANS
LA
L
USITANIE
CÔTIÈRE
:U
NE
APPROCHE
ONOMASTIQUE
1
Milagros N
AVARRO
C
ABALLERO
*
Toute réflexion sur les déplacements de populations, comme c’est le but de cetteétude, obligerait à emprunter des méthodes démographiques dont la base est le recensementdes personnes
2
. Néanmoins, le projet d'appliquer ces pratiques démographiques auxpériodes les plus anciennes de l'histoire, en particulier à la civilisation romaine, se heurte àune difficulté insurmontable : malgré leur importance politique, malgré leurs techniquesdétaillées d'enregistrement de la population et des biens, surtout à partir de l'époqueaugustéenne, nous avons perdu presque toutes les données des recensements romains
3
.Notre approche des migrations à l'époque romaine, surtout celles qui concernent la péninsuleibérique, doit utiliser d'autres éléments historiques qui, sans pouvoir se fonder sur la totalitédes individus concernés, pourront donner des tendances géographiques, chronologiques ouencore sociologiques. Mais, mis à part certaines indications des textes littéraires, ces indicesse trouvent généralement dans les inscriptions, seule approche nominale directe de lapopulation romaine et donc notre source essentielle.
Par conséquent, l’onomastique apparaît, malgré ses imperfections, comme unetechnique incontournable pour l’obtention de données démographiques. L'idée de départétait la suivante : se nommer est se définir socialement, juridiquement et, parfois,géographiquement. Dans une dénomination personnelle, outre l'
origo
qui est rarementexprimée, cet aspect spatial peut se déduire de l'origine rare, ancienne et lointaine d'un nom(comme, par exemple, le gentilice Staius) ou encore de sa signification topographique(comme, par exemple, le
cognomen
Tuscus). Le cadre de mon enquête onomastique a été déterminé par des recherches
précédentes que j'ai entreprises, axées, autour du “Grupo Mérida”, sur la publication d'un
Atlas Antroponímico de la Lusitania romana
. Ce travail a mis en évidence que cette provinceest une zone particulièrement propice à l’étude des relations liant fond indigène et apportsromains. En règle générale, plus tardivement conquise que les autres régions hispaniques, la
1
Cet article doit beaucoup à mes conversations avec F. Mayet qui m'a guidé par les complexes itinéraireslusitaniens. Qu'elle soit remerciée pour son aide précieuse, de même que P. Aupert pour sa relecture du manuscrit.
2
La seule méthode d'étude fiable semble être, selon les géographes et sociologues, la comparaison entredeux recensements, qui met en valeur l'absence de certaines personnes dans un endroit et sa présence dans autre, cequi permet de recréer les flux migratoires. On peut donc parler de déplacement ou migration, même si le caractèrede celui-ci reste à déterminer au fur et à mesure que se déroule l'existence de la personne concernée.
3
Il reste les chiffres des citoyens transmis notamment par Tite Live. Sur ces questions, voir, entre autres,Pieri 1968, 173-182.
* Ausonius - Université Bordeaux 3.
70
MIGRARE
partie de l'
Ulterior
qui deviendra ensuite la Lusitanie, moins urbanisée que les autresprovinces, notamment dans le Nord, a mieux préservé ses particularités jusqu'à la fin de laRépublique, c'est-à-dire, au moment où notre source, l'épigraphie, devient petit à petitessentielle. Les textes épigraphiques, surtout ceux de cette époque et du début de l'Empire,montrent un contraste important entre individus d'origine locale et allogènes, et de mêmeentre
peregrini
et
ciues Romani
. Et cette situation sociale permet d'envisager avec succès larecherche onomastique de personnes venues d'ailleurs.
Ensuite, et encore grâce aux données de l'atlas anthroponymique, mon attention a étéattirée par les Italiens émigrés en Lusitanie à travers plusieurs réminiscences onomastiques,notamment certains surnoms géographiques mais, surtout, un type de gentilices. En effet,l'étude des
nomina
recensés dans cette province montre l'existence de trois groupesprincipaux : les gentilices très répandus, associés aux relations de clientèle envers lesgénéraux ou associés au prestige du nom de l'empereur (Iulius, Caecilius, Cornelius,Norbanus ou Claudius)
4
; les gentilices patronymiques, créés à partir des noms uniquespérégrins au moment de la naturalisation (latins, comme Frontonius ou Modestius,indigènes, comme Louesius ou Talatius) ; et enfin, une série de gentilices, qualifiés derésiduels ou fossilisés par certains auteurs par leur rareté numérique, tant dans la provincequ'ailleurs. Ce sont précisément ces deux attributs qui rendaient intéressants ces noms car ilsdeviennent ainsi les résidus et la preuve onomastique fossile d'un passé à déchiffrer. Ces“fossiles onomastiques”, comme nous les avons appelés, ont en commun une origine latineassurée, avec une présence très réduite dans d'autres régions en dehors de la Lusitanie
5
, cequi ramènerait leurs porteurs ou leurs ascendants directement à la péninsule italienne. Ilsdeviennent une porte d'accès à la population d'origine italienne en Lusitanie qui, autrementserait réduite aux simples indications des origines, donc à quinze individus environ
6
. J'ai présenté ainsi la liste de ces
nomina
dans un travail précédent
7
, avec quelquesclefs méthodologiques et quelques résultats
8
. Néanmoins, dans le cadre de cettemonographie sur les déplacements des populations autour de la péninsule ibérique, il m'asemblé utile d'analyser la documentation onomastique typiquement italienne concernant lesvilles côtières lusitaniennes, notamment Olisipo, et ceci pour deux raisons : d'une part, parcequ'il est évident qu'une simple liste de noms n'apporte rien en soit et que l'analyseonomastique doit être parallèle à une étude sociale générale qui prenne en compte desconditions historiques et géographiques spécifiques, justifiant et expliquant les déplacementsde certains individus. Dans ce contexte, les caractéristiques socio-économiques de ces cités,intimement liées à la mer, pouvaient attirer un certain type d’immigration et lescommerçants italiens y avaient une place considérable ; d'autre part, parce que la venue
4
Il s'agit de la méthode utilisée par Dyson 1980-1981.
5
Pour obtenir ces donnés, j'ai utilisé fondamentalement, Schulze 1904 et Solin & Salomies 1988 pourl'Italie, Mócsy 1983, complété par les nouveaux Lörincz & Redõ 1994, Lörincz 1999, 2000, 2002 pour lesprovinces occidentales, Abascal 1994 pour la péninsule ibérique, ainsi que les
indices
du
CIL
et de l'
AE
.
6
Haley 1986, 137-145.
7
Navarro 2000. Voir aussi Navarro
et al.
2003.
8
L'étude globale de la totalité des
nomina
et de leurs porteurs dans la province de Lusitanie fera l'objetd'un livre ultérieur.
L’ÉMIGRATION ITALIQUE DANS LA LUSITANIE COTIERE
71
italienne dans ces ports pouvait être comparée et mise en relation avec celle d'autres
portsromains
9
. Mon intérêt pour les cités côtières de la Lusitanie part de l'individualisation
géographique, économique et sociologique que faisait V. Gil Mantas quelques années plustôt dans un article intitulé : “As cidades marítimas da Lusitânia”
10
qu’il compléta par untravail paru en 1995 et intitulée “Comércio marítimo e sociedade nos portos romanos doTejo e do Sado”
11
. Comme lui, je prendrai en compte notamment le cas d'Olisipo, de Salaciaavec ses avant-ports de Caetobriga et Troia dont le nom à l'époque romaine reste inconnu etBalsa. On laissera de côté Ossonoba, faute de données onomastiques nécessairessignificatives pour le propos méthodologique qui est le mien.
Les bases chronologiques de ma recherche dépendent en grande partie desconclusions publiées par P. Le Roux dans un article sur l’émigration italique en Citérieure eten Lusitanie
12
, qu'il est possible d’adapter à la côte orientale de la péninsule ibérique. Dès lafin des guerres lusitaniennes, c'est une émigration fondamentalement économique, peuabondante, souvent associée à quelques installations de soldats à l’intérieur des cités sansstatut colonial, peut-être Olisipo et Salacia ; ensuite, entre la période des guerres civiles etl’époque augustéenne, à côte de la création des cinq colonies des vétérans (Metellinum,Norba Caesarina, Scallabis Praesidium Iulium, Pax Iulia et Emerita Augusta), on soupçonnel'existence d’une émigration économique généralement spontanée (sauf dans le cas de
publicani
), quantitativement difficile à évaluer mais sans doute plus abondante que lors de lapériode antérieure, à côté d’une possible émigration politique qui fuit les troubles dans lapéninsule italienne. Il ne faut jamais oublier qu’à cette époque, l'espace lusitanien fait encorepartie de la province d'Hispanie Ulterior et donc que l'émigration officielle lui est rattachée ;à partir de la fin du
I
er
siècle a.C., une fois la Lusitanie créée, et jusqu’au
III
e
siècle p.C.,l’émigration italienne fut comme partout, fondamentalement spontanée, économique et plusou moins inchiffrable.
L
E
DOSSIER
ONOMASTIQUE
Olisipo
Mon propos n’est pas de réécrire l'histoire d'Olisipo, dont beaucoup d'élémentsrestent encore dans l'ombre. Néanmoins, un bref rappel concernant l'époque républicaine etle Haut Empire sera utile pour analyser la documentation onomastique. Comme l'actuelle
9
La récente publication d'un colloque sur les Italiens dans le monde grec donne de nombreux élémentsde réflexion, Müller & Hasenohr 2002. La recherche des Italiens en Orient a une tradition ancienne. A l'époquerépublicaine, leur nomenclature personnelle était facilement identifiable. Sur le sujet, citons les classiques Hatzfeld1912 et 1919, Cassolà 1970-71, Van Berchem 1962 et 1963, Helly 1983, Bresson, 2002, Follet 2002, Rizakis 2002,Hasenohr & Müller 2002. En Occident, la question est plus complexe, étant donné la date plus tardive et un plusgrand nombre de similitudes onomastiques.
10
Mantas 1990.
11
Mantas 1995.
12
Le Roux 1995.
72
MIGRARE
Lisbonne, son héritière dans le temps, Olisipo occupait un excellent port naturel surl'estuaire du Tage, déjà exploité par les Phéniciens et les habitants indigènes
13
avant l’arrivéedes Romains. La cité entre dans l'histoire en 138 a.C. quand, selon Strabon, D. Junius Brutusla fortifie
14
après ses campagnes victorieuses sur les Lusitaniens et Galiciens. Cela montreque dans la deuxième moitié du
II
e
s. a.C., Olisipo était donc déjà une ville de taille etd'importance considérables. Ses vestiges pré- et protohistoriques ont été mis au jour dans lepromontoire du Castelo de S. Jorge qui domine la plaine environnante et le port
15
. On doit à Pline la deuxième référence littéraire qui daterait de l'époque augustéenne :
le nom complet de la ville était
Felicitas Iulia Olisipo
16
et possédait le statut de
municipiumciuium Romanorum
17
, deux éléments suggérant un passé pro-césarien. Faute d'autresdonnées écrites, il faut s’appuyer sur les données archéologiques pour ébaucher unereconstruction du passé d'Olisipo à l'époque républicaine. La population de la ville indigènea dû croître avec l'arrivée des nouveaux habitants italiens et romains dès la fin du
II
e
sièclemais surtout tout au long
I
er
siècle a.C. : anciens soldats installés dans cette nouvelle terre,commerçants,
publicani
… En effet, l’extension de l’urbanisme, mise en évidence parl’archéologie, corrobore ces faits. Dès la conquête romaine et surtout à partir de la secondemoitié du
I
er
siècle, Olisipo sort de son noyau primitif pour s'étendre sur toute la colline et laplaine environnante. Comme on l'a dit auparavant, la population soutint la cause de César. Saposition politique, accompagnée par une romanisation importante, appuyée par unpourcentage relativement important d’Italiens, lui valurent un statut juridique privilégié,c'est-à-dire la citoyenneté romaine pour tous les habitants et, très probablement, le statutpolitique de municipe dès le début de l'époque augustéenne
18
. A ce moment, et pendant lestrois premiers quarts du
I
er
siècle, la ville va connaître un renouveau urbanistique : lesbâtiments publics sont érigés selon les modèles romains (forum
19
, théâtre
20
) et beaucoupd’éléments d'infrastructure nécessaires au confort des habitants sont construits
21
.Olisipo avait une position géographique privilégiée, base de sa richesse et de son
développement. Son excellent port, bien emménagé, permettait d'une part, de recevoir et deréexpédier des marchandises vers le Nord de l'Atlantique, dans les ports d'Hispanie et deGaule, et même de Bretagne, mais surtout vers le Sud, comme les Phéniciens le faisaientdéjà, en arrivant en Bétique, et une fois passé les colonnes d'Hercule, commerçant avecd'autres ports de l’Océan Atlantique et vers l’intérieur des terres par voie fluviale
22
.L'expédition des produits importés pouvait se faire aussi par les nombreuses voies qui
13
Amaro & Matos 1996, 215-244.
14
Str. 3.3.1.
15
Mantas 1990, 160.
16
Plin.,
Nat.,
4.117. Son nom officiel est également présent dans deux textes épigraphiques :
CIL,
II,186 ; 4992.
17
Silva 1944, 44 et 88.
18
La ville est ainsi citée par Pline et ses habitants sont inscrits dans la tribu Galeria.
19
Mantas 1990, 163.
20
Hauschild 1990 ; Diogo 1993.
21
Almeida 1968, 179-189 ; Quintela, Cardoso & Mascarenhas 1986, 121-125 ; Matos 1994.
22
Str. 3.3.1.
L’ÉMIGRATION ITALIQUE DANS LA LUSITANIE COTIERE
73
partaient d'Olisipo : trois vers Emerita, vers le Nord, le Sud et encore des routes secondairesaux différents endroits de la province. A la fonction de comptoir d'échanges desmarchandises, il faut ajouter celle d'un centre producteur de
garum
dès la fin du
I
er
siècle a.C.
23
, mais aussi celle d'une ville agricole car, en effet, Olisipo possédait unterritoire vaste et fertile, exploité déjà au
I
er
siècle a.C.
24
Le dossier onomastique retenu pour Olisipo comporte deux volets. Le premier
concerne les gentilices italiques fossilisés connus, mis en relation avec leur présence dans lereste de la Lusitanie et de la péninsule ibérique en général. La deuxième abordera les
cognomina
géographiques issus des peuples et toponymes italiques dont la présence àOlisipo est importante.
Les fossiles onomastiques
Alfius
: [A]lfia L. f. Amoena est décédée dans le territoire d'Olisipo
25
.
Ce gentilice originaire du centre de l'Italie, répandu par le Sud
26
, mais avec desexemples remarquables dans le Nord
27
, est attesté plusieurs fois à Emerita, notamment dansun de ses plus anciens documents épigraphiques, l'épitaphe de P. Alfius T. f. Pap.
28
, due àson frère T. Alfius T. f. et à son affranchie, probablement sa compagne, Alfia Iucunda
29
.Toujours en Lusitanie, plus exactement à Ebora, on trouve Q. Alfius Modestus
30
décédédans la première moitié du
I
er
siècle p.C.
Clatius
: ce nom d'origine étrusque
31
semble avoir fait souche en Apulie. En effet,une lecture des indices des
corpora
italiens montre qu'il est absent partout, sauf à Rome
32
, etsurtout à Canusium où l'on trouve plusieurs exemples
33
. Dans les provinces, on peut citer les exemples de Catina en Sicile
34
et celui de ClatiaM. f. Marcella
35
mentionnée par un manuscrit dans une épitaphe disparue, qui la localise àOlisipo.
Coranius
: il s’agit d’un gentilice peu fréquent dont l'origine semble être dans larégion de Norcia
36
. On en trouve plusieurs exemples dans la péninsule ibérique, très
23
Edmondson 1990, 130.
24
Sur la transformation des campagnes, Edmondson 1994.
25
Alverca (Vila Franca de Xira, LI), Camacho
et al.
1996, 185.
26
Schulze 1904, 424 ; Alföldy 1969, 90 ; Lejeune 1976, 141 ; une nouvelle inscriptions dans
AE, 1997,316.
27 Un sénateur à Vérone, CIL, V, 3590 ; Alföldy 1982, 343.28 CIL, II, 528. 29 Les autres exemples sont les suivants : L. Alfius [---] (Roso de Luna 1905, 61) ; Alfia Maura (AE, 1983,
492) et Alfius Veto (CIL, II, 529, document perdu).30 IRCP, 407 (= AE, 1980, 545). Il avait une relation familiale difficile à comprendre avec les Tullii.
Deuxième mari de leur mère?31 Il est attesté dans deux textes étrusques de Clusium, CIE, 2945 et 2947 ; Schulze 1904, 149.32 CIL, VI, 14853-14854.33 Chelotti et al. 1990, 35 (aedilicius au IIe siècle) ; 111 ; 141.34 CIL, X, 7059.35 CIL, II, 5014. Le texte a été trouvé à Colares (Sintra, LI).36 AE, 1983, 293 ; 296.
74 MIGRARE
anciens pour la plupart 37. En Lusitanie, l’exemple d’Olisipo date de la première moitié du Ier
siècle p.C. : L. Coranius L. f. Gal. Bubbus 38. On en note un autre à Pax Iulia : Corania 39. Cossutius : ce nom, que Schulze considère d'origine étrusque, est attesté de façon très
limitée en Italie du Centre et du Sud, notamment en Campanie 40. Deux magistratsmonétaires romains portent ce nom au Ier siècle a.C. 41
En province, le plus connu est le chevalier sicilien M. Cossutius 42, cité par Cicéron àcôté de Q. Rubrius et M. Castricius en raison des décorations reçues de Verrès. Cossutiusconnaît en Cisalpine et en Narbonnaise un taux de présence un peu plus important que dansd’autres provinces, les autres exemples se répartissent de façon égale, un seul, dans plusieursprovinces occidentales 43 et parmi ceux-ci se trouve notre exemple lusitanien 44 : M.Cossutius Macrinus dédia un autel à Aesculapius Augusti 45.
Curiatius : ce gentilice, vraisemblablement d'origine étrusque 46, porté par cinqsénateurs républicains 47, est peu fréquent, même en Italie 48, sauf en Dalmatie, où il estreprésenté à Iader et Salone 49 et dans la cité macédonienne d’Edessa 50.
Le seul exemple hispanique est lusitanien. Au Ier siècle p.C., un Italien ou descendantd'émigrés italiens, car son surnom pourrait avoir une connotation locale, T. CuriatiusRufinus 51 érigea un autel à une divinité indigène, Triborunnis, dans le territoire d'Olisipo. Jepartage l'avis de J. d'Encarnação qui pense qu'il s'agirait d'un essai de la part de Rufinus des'attirer les bienfaits d'un dieu protecteur local 52 : le nouveau venu se place ainsi sous saprotection 53.
37 Deux de cinq attestations n’ont pas de cognomina. Signalons le cas de L. Coranius Tuscus à Arva,porteur d’un surnom très repandu à Olisipo (voir infra). Les exemples dans Abascal 1994, 116.
38 CIL, II, 5000 = ILER, 5195 = Silva 1944, n° 122 = D'Encarnação 1994, n° 8.39 IRCP, 306.40 Données des indices des CIL et AE. Voir aussi les commentaires de Cl. Nicolet sur cette gens (Nicolet
1974, 857-858). Signalons la présence d'un aedilis à Carsioli. 41 L. Cossutius C. f. Sabula, ca. 72, MRR, p. 438 ; L. Cossutius Maridianus, triumuir monetalis en 44,
MRR, p. 437.42 Sanctissimum uirum atque honestissimum, Cic., Ver., 3.185.43 Dans les régions hellénophones, ce gentilice est attesté, entre autres, à Athènes sous la République. Il
s’agit de marbriers (Follet 2002, 85). On les retrouve plus tard à Thespies (AE, 1971, 447). Il existe égalementquelques exemples en Afrique.
44 Lörincz 1999, 80, plus sept en Afrique.45 CIL, II, 174.46 Schulze 1904, 355.47 MRR, II, 1968, 558. Pour l'époque impériale, PIR2, C, 1603 ; 1604.48 Un peu plus au Sammium, Conway 1897, 204.49 Trois exemples dans la regio II, à Luceria et Allifae. Le centre de l'Italie : deux en Cisalpine et 4
exemples de plus répandus pour quatre provinces différentes ; Lörincz 1999, 88. Quelques exemples isolées enAfrique.
50 Tataki 1996, 109.51 Freiria, S. Domingos de Rana (Cascais, LI), AE, 1985, 514, d'Encarnação 1994, n° 2.52 D’Encarnação 2003.53 On trouve des parallèles à ce fait religieux dans le texte épigraphique IRCP, 287, de Pax Iulia.
L’ÉMIGRATION ITALIQUE DANS LA LUSITANIE COTIERE 75
Curius : en rapport étymologique avec l'exemple précédent, Curius serait un nométrusque 54 peu répandu en Italie, à l'exception de la Cisalpine 55.
Il n'est pas rare en Occident, notamment en Lusitanie 56. En effet, tous les exempleshispaniques appartient à cette province. Le dossier commence avec les exemples d'Olisipo :Curia Sex. f. Fundana, épouse de Trebonius Tuscus, décédée au Ier siècle p.C. 57 Elleappartiendrait à la même famille que [S]ex. Curius Siluanus et Sex. Curius S. f. [---] 58, peut-être son père et son frère respectivement. Pour des raisons non élucidées, dont les similitudesavec l'onomastique indigène sont à retenir, ce gentilice s’implante en Lusitanie 59,notamment dans la cité d'Igaedis 60.
Gellius : il s'agit d'un nomen, peut-être sammite, assez fréquent en Italie et dans lesprovinces occidentales 61. Il est présent à Corinthe et Eleia 62. Dans la péninsule ibérique, ontrouve trois exemples dans trois cités côtières de l'Hispanie Citerieure 63 et en Lusitanie 64,notamment à Olisipo où vécut Gellia Grata 65. Mais le personnage le plus important fut M.Gellius Rutilianus, IIuir sous Hadrien 66 dont le surnom suggère une appartenance à lafamille des Rutilii par la mère. Son épouse occupa le sacerdoce de flaminique 67. Le coupleappartenait donc à l’élite de la cité.
Les Gellii et les Rutilii, leurs parents 68, devaient avoir des intérêts commerciaux quiconcernaient le trafic maritime du port. A la fin du Ier siècle p.C., une branche 69 des deuxfamilles s'installa dans la cité portuaire de Balsa pour élargir ses opérations économiques.
Heius : ce nom, que Schulze considère comme originaire du Latium 70, est attesté àCumes dès le IIIe siècle a.C. avec une riche famille commerçante dont fait partie plus tard lesénateur Cn. Heius 71 et le préfet du prétoire M. Heius 72. Sauf en Campanie, les attestationsitaliennes conservées sont peu nombreuses 73.
54 Schulze 1904, 355.55 Lörincz 1999, 88, plus quelques attestations en Afrique.56 Ibid. ; Abascal 1994, 57 CIL, II, 212 = Silva 1944, n° 30.58 HAE, 1213.59 C. Curius Auitus (AE, 1919, 87) ; Curius Priuatus (AE, 1996, 845).60 Curia Primula (AE, 1967, 165) ; Curia Vitalis (CIL, II, 442 ; Almeida 1956, 76) ; Curia Chr[e]sum[i] f.
Vitalis (AE, 1967, 159) ; C. Curius C. f. Igeditanus (CIL, II, 61* ; Almeida 1956, 74) ; C. Curius C. f. Q(uir.)Clementinus (ILER, 5125 ; Almeida 1956, 69) ; C. Curius Pulli f. Quir. Firmanus (CIL, II, 442 ; Almeida 1956, 76) ;M. Curius Quintio (AE, 1967, 165).
61 Indices du CIL et AE, Lörincz 1999, 162. Il est très abondant en Afrique.62 Zoumbaki 1996, 205.63 Abascal 1994, 146 : exactement à Tarraco, Dertosa et Saguntum. 64 On connaît l'épitaphe de Gellia Patricia Emerit(ensis), décédée au IIe siècle CIL, II, 5270 = 5458.65 AE, 1962, 327, Granja dos Serrões, Montelavar (Sintra, LI).66 Il érigea avec son collègue, L. Iulius Auitus, une statue honorifique à l’empereur Hadrien (CIL, II, 186
= Silva 1944, n° 91) et à son épouse Sabine (CIL, II, 4992 = 5221 = Silva 1944, n° 72).67 CIL, II, 197 = 5218 ; Silva 1944, n° 83.68 Voir infra.69 Navarro 2000, 287-290.70 Schulze 1904, 251. En effet, on conserve une attestation à Fanum Fortunae, CIL, XI, 6233.71 Camodeca 1982, 105 et 121. 72 Camodeca 1982, 121. 73 2 à Rome, 3 en Cisalpine, 3 en Italie Centrale, 2 en Italie centro-méridionale. Signalons un document
ancien trouvé à Venusia en Apulie.
76 MIGRARE
En dehors de l'Italie, il faut citer tout d'abord les C. Heii de Messine,vraisemblablement des Mamertins originaires de Campanie, privés de leurs biens par larapacité de Verrès 74. Ajoutons pour l'Occident un exemple en Narbonnaise et un second enPannonie qui peuvent être mis en relation avec les nombreux cas hispaniques 75. Enrevanche, les parallèles existants dans les cités hellénophones sont assez nombreux ethautement significatifs. Le dossier commence avec les Heii déliens 76 que, commed’habitude, on retrouvera dans la seconde moitié du Ier siècle a.C et sous l’Empire sur lecontinent, notamment à Corinthe où des affranchis qui font souche dans la cité, et enBéotie 77.
Mais revenons à la péninsule ibérique. Mis à part un IIuir du municipe inconnud'Archena (Murcie), les Heii hispaniques sont lusitaniens. D'ailleurs, tous les exemplesappartiennent à la même familia : il s'agit d'une branche affranchie qui réalisa la dédicace àson patronus. Celui-ci, C. Heius C. l. Primus, un riche libertus, fêta son poste d'Augustalisavec l'érection du podium du théâtre sous Néron 78. Ses affranchis et les enfants de ceux-cilui ont dédicacé une statue sur piédestal, loco publico 79 : C. Heius Primi lib. Nothus et HeiaPrimi l[ib.] Elpis, sa co-affranchie et probablement son épouse. On lit ensuite les noms deleurs enfants, C. Heius Nothi f. Gal. Primus Cato, Heia Nothi f. Chelido et [C. H]eiu[s]Nothi f. Gal. Glaphyrus. L'identité de Heia Notha Sec[u]nda est moins sûre, peut-être lasœur de Nothus.
Hirrius : on a affaire à un gentilice d'origine osque dont le berceau semble être laLucanie 80, avec plusieurs attestations significatives à Bénévent et à Saepinum (dans cescités, les Hirrii font partie de l'élite 81). Très rare donc en Italie, il n'est attesté qu’en Afriqueet dans deux provinces hispaniques 82, notamment en Bétique 83 et en Lusitanie : Q. HirriusM. f. Gal. Mat[e]rnus 84 mourut à Olisipo au plus tard dans la première moitié du Ier sièclep.C.
Loreius : ce gentilice semble être d'origine campanienne 85, avec des déplacementsdans la vallée du Pô et en Gaule Narbonnaise 86.
On trouve deux attestations dans le territoire d'Olisipo : M. Loreius M. f. Gal.Maternus 87, décédé à la fin du Ier siècle p.C. et L. Loreius L. f. Gal. Maximus 88, enterré au
74 Cic., Ver., 4.1-3. Ajoutons le sénateur Cn. Heius, Cic., Cluent., 107.75 Lörincz 1999, 175.76 Müller & Hasenohr 2002.77 Spawforth 1996, 178-179 avec tous les exemples de la partie orientale de l'Empire. 78 Hauschild 1990.79 CIL, II, 196 = Silva 1944, n° 71.80 Campanile 1992.81 Pour cette dernière cité, pensons au sénateur Hirrius Fronto Neratius Pansa, PIR2, N, 56.82 Lörincz 1999, 183.83 Il s'agit d'une femme ingénue, morte à Cordoue au Ier siècle.84 CIL, II, 217 = Silva 1944, n° 4.85 CIL, X, 937-8, IIuiri de Pompei à l'époque républicaine.86 Móscy 1983, 166 ; Lörincz 2000, 32.87 CIL, II, 5022 ; ILER, 4348 ; d'Encarnação 1994, n° 17.88 CIL, II, 309.
L’ÉMIGRATION ITALIQUE DANS LA LUSITANIE COTIERE 77
début du IIe siècle p.C. 89. Le deuxième est le fils de Caesia Auita, membre de la famille de Q.Caesius Q. f. Gal. Fundanus, porteur d'un cognomen toponymique italien 90.
Mis à part un exemple à Emporiae qui semble être d'origine italienne 91, il fautsignaler dans la péninsule ibérique le cas de Loreia M. f. Laeta 92, morte à Metellinum entrela fin du Ier a.C. et la première moitié du Ier siècle p.C., qui semble être la fille de l'un despremiers colons.
Lucceius : il s'agit d'un gentilice du centre de l'Italie 93, moyennement attesté en Italie,avec une certaine fréquence dans la partie centro-méridionale 94.
Il fait partie de la liste de noms italiens attestés à Délos entre la fin du IIe et le début duIer siècle a.C. 95 En Occident, les exemples de ce nomen sont rares, à l'exception de laNarbonnaise, de l’Afrique et, surtout, de la péninsule ibérique 96, où il est fréquent surtout entrois cités de Lusitanie : Olisipo, Emerita 97 et Conimbriga 98.
A Olisipo, on connaît des documents anciens (fin Ier siècle a.C., début Ier siècle p.C.)les concernant. Ils sont esclaves ou affranchis : Graptus, l’esclave de Lucceia Cinnamis 99
décéda très jeune à Olisipo. G. Lucceius Philogenes, quant à lui, arriva à l'âge de 40 ans dansla même ville à la même époque 100. Le dossier comprend une attestation plus tardive et trèsprestigieuse car il s'agit de Lucceia Q. f. Albina Terentiani (uxor) 101 qui semblerait être lafille du flamen provincial Q. Lucceius Albinus et de son épouse, la flaminique Seruilia L. f.Albini (uxor) 102. Si cette intéressante interprétation de S. Lefebvre est exacte 103, la familledu flamen aurait une origine indigène car le grand-père d'Albina était Albuius, un pérégrin.Le choix de leur nom aurait pu dépendre de leur relation avec les Lucceii établis depuislongtemps dans cette cité portuaire.
Maius : de ce nom d'origine osque 104, modérément cité dans l’ensemble de lapéninsule Italique, les exemples ne sont pas non plus très nombreux dans les provinces
89 Le premier à Caparide, S. Domingos de Rana (Cascais, LI) et le deuxième à Faião, Terrugem(Sintra, LI).
90 Voir infra, les commentaires aux cognomina géographiques.91 IRC, III, 70.92 ILER, 2202.93 Schulze 1904, 359 ; 532.94 Données issues des indices des CIL et de l'AE. 95 Ferrary et al. 2002, 200.96 Lôrincz 2000, 34. 97 Lucceia Herennia ; Lucceia Laudice, AE, 1983, 493 ; Lucceius Dorion, EE, VIII, 50 ; ILER, 4607 ; L.
Lucceius Restitutus. Voir l’article Lucceius dans Grupo Mérida 2003, 217, carte 174.98 Lu[cceius?] Max[imus?], Étienne et al. 1976, 17 (= AE, 1975, 479) ; Q. Lucceius Rufinus, CIL, II,
383 ; Étienne et al. 1976, 57 ; Lucceius Seueri(nus), CIL, II, 383; Étienne et al. 1976, 57.99 CIL, II, 216 = Silva 1944, n° 37.100 CIL, II, 232 = Silva 1944, n° 47.101 CIL, II, 195b = Silva 1944, n° 36b.102 CIL, II, 195a = Silva 1944, n° 36a.103 Lefebvre 2000, 219.104 Schulze 1904, 469-470 ; Lejeune 1976, 122.
78 MIGRARE
occidentales 105. Dans la péninsule ibérique, les attestations sont au nombre de trois : deux enBétique et une en Lusitanie 106, Maia Fel[i]cula 107, décédée à Olisipo au IIe siècle p.C.
Mascellius / Masxellius : il s'agit d'un gentilice presque inconnu 108, issu deMascellio, surnom celtique 109 attesté faisant fonction de nomen en Cisalpine 110. Lesexemples lusitaniens, parfois douteux, appartiennent à Emerita 111, Masxellius (H)ermes, et àOlisipo, Mascellius Macer 112 et [M]ascelli[a Ma]trona 113.
Mundicius : c'est un gentilice latin rare. En effet, il n’est répertorié que dans la villede Rome 114 et dans le port d'Ostie. Cependant, des individus ainsi nommés, provenant doncde la capitale, sont recensés à Délos à la fin du Ier siècle a.C. 115 Ils quittent l'île pours'installer en Macédoine puis en Asie 116. L'exemple lusitanien d'Olisipo, [. M]undici[us M.f.] Gal. Se[uerus?] 117, est le deuxième trouvé en Occident 118, après un premier exemple enBétique 119.
Orbius : ce nom, qui semblerait être d'origine étrusque 120, est peu répandu sauf enItalie : sa répartition y est relativement éparse 121. Signalons la présence à Délos au début duIer siècle a.C. de cinq Orbii 122, famille que l’on retrouve plus tard sur le continent,notamment à Athènes 123 et en Béotie 124.
Dans la péninsule ibérique, tous les exemples sont lusitaniens : une femme de ce noma vécu à Olisipo au Ier siècle, Orbia C. f. Anus 125, et deux autres à Emerita au milieu dumême siècle, P. Orbius Rusticus, et de sa sœur, Orbia Restituta 126. Rusticus fut enterré sousune stèle en granit avec un sommet arrondi typique des premiers colons. Un peson découvertà Conimbriga avec la marque Orbi 127 pourrait être mis en relation avec cette famille.
105 Lörincz 2000, 48.106 Abascal 1994, 178.107 CIL, II, 235 = Silva 1944, n° 64.108 Lörincz 2000, 62, en Cisalpine et au Norique, un exemple en Afrique. 109 Voir commentaires de sa distribution dans ILA Pétrucores, 89.110 Schulze 1904, 307111 Voir l’article Mascellius / Masxellius de Grupo Mérida 2003, 232.112 AE, 1982, 469.113 Areias, S. João das Lampas (Sintra, LI), Capeans 1935, 271-274.114 CIL, VI, 22685-22692.115 Ferrary et al. 2002, 203.116 Salomies 1996, 125.117 Trouvé à Bucelas (Loures, LI) et publié par Ferreira & Almeida, 1958, 132-140, nº I.118 Lörincz 2000, 90.119 CIL, II, 1620.120 Schulze 1904, 364, cinq exemples en Italie centrale. Il semble être un nomen d'origine sabellique
répandu notamment dans le Sud par les bergers qui pratiquaient la transhumance, Letta & D'Amato 1975, 159.121 Lörincz 2000, 116, avec quelques exemples africains.122 Ferrary et al. 2002, 206-207. 123 Follet 2002, 82 et 84.124 Hasenohr & Müller 2002, 16.125 Janas, S. Martinho (Sintra, LI), CIL, II, 311 = HEp, 2, 1990, 820 + Grupo Mérida 2003, 254.126 Ramírez 1994-1995, n° 9.127 Étienne et al. 1976, 408.
L’ÉMIGRATION ITALIQUE DANS LA LUSITANIE COTIERE 79
Passerius : on a affaire avec un nomen rarissime, dont l'origine semble être la ville deRome 128. En province, seul le cas de la Narbonnaise est digne d'intérêt avec 5 exemples 129.L'épitaphe de Passeria L. f. Romula, l'unique exemple hispanique 130, est inscrit sur uneplaque de marbre sans consécration aux Dieux Mânes mais avec des lettres actuaires auxtraits cursifs, ce qui a suggéré aux éditeurs une datation tardive 131.
A déjà été signalée la similitude onomastique de cette femme avec le sénateur L.Passerius Romulus 132, légat propréteur du proconsul d'Asie en entre 100 et 102 p.C. dontSyme faisait un Narbonnais 133, sans qu'aucune explication plausible ne soit émise jusqu'àprésent. Il est vrai que les premiers éditeurs du texte épigraphique d'Olisipo lui attribuentune datation tardive mais si l'on regarde de près la plaque, on peut s'apercevoir que cettechronologie est fondée sur des critères esthétiques, car le texte n'a pas de consécration auxDieux Mânes, ce qui ferait supposer une date relativement ancienne. En plus, le type delettre utilisé, avec des traits actuaires, n'est pas forcément tardif : il est utilisé en Lusitaniedès le début du IIe siècle. Si l'on considère les dates de 85 ou 129 pour le poste de légatoccupé par Passerius Romulus, il n'est pas impossible qu'il soit le père d'une fillette décédéedans la première moitié du IIe siècle p.C. Si, avec R. Syme, on maintient que Passerius L. f.Romulus était originaire de Narbonne, on pourrait lui supposer un séjour en Lusitanie où il aperdu son enfant 134.
Peticius : il semblerait que ce gentilice soit originaire de la région des Péligniens où ilest relativement fréquent, surtout entre Sulmone et Corfinium, avec des déplacements auSud, vers Canusium. On trouve en nombre limité des exemples dans le reste de l'Italie 135
sauf en Cisalpine, où il arrive à 18 cas 136. Il est pratiquement absent de l'épigraphie provinciale occidentale en dehors de la
Lusitanie 137. Peticia P. f. Tusca, mariée avec un édile, fut une femme importante àOlisipo 138. Ce nomen est également attesté à Pax Iulia, au Ier siècle p.C., pour Q. PeticiusRufus 139, ainsi qu’à Emerita au IIe siècle p.C. : l'épitaphe de L. Peticius Felix était inscritedans une frise d'un monument funéraire collectif avec Iulia Apana, probablement au IIe
siècle 140. Les exemples des Peticii sont suffisamment rares pour que l'on ne passe pas sous
silence la possible relation des Lusitaniens avec les habitants de la cité de Sulmone,
128 On y trouve les seuls exemples italiens, CIL, VI, 23843-23845.129 Lörincz 2000, 126. 130 Abascal 1994, 165.131 Almeida & Ferreira 1965, 107-109 (AE, 1965, 269). 132 PIR2, P, 56.133 Syme 1986, 15 (= RP, VI, 216).134 Déjà R. Syme considérait cette solution plausible : “The notion is not idle that her father governed
Lusitania”, Syme 1986, 15 (= RP, VI, 216).135 Données issues des indices du CIL, V, VI, IX, X, XIV.136 Lörincz 2000, 134. 137 Móscy 220 ; Abascal 1994, 196-197.138 CIL, II, 192 = Silva 1944, n° 33 + CIL, II, 240 = Silva 1944, n° 53.139 CIL, II, 66 = IRCP, 271.140 Ramírez & Gijón, 1994, nº 22 (AE, 1994, 559d).
80 MIGRARE
commerçants dans tout le bassin méditerranéen à la fin de la République et au début del'Empire. En effet, nous devons aux recherches de P. A. Gianfrotta l'identification d'unnotable de la cité de Sulmone avec un négociant en blé de l'époque césarienne 141. A partir delà, A. Tchernia arrive à identifier d'autres membres de cette famille, éparpillés en Afrique, enÉgypte et en Orient pour des raisons commerciales 142.
Rubrius : nomen vraisemblablement d'origine étrusque 143, bien attesté dans leLatium à l'époque républicaine, notamment à Casinum, avec des chevaliers 144 etsénateurs 145. Il n'est pas rare dans les provinces occidentales 146, notamment en Sicile, où ilest connu dès l'époque républicaine parmi les membres de l'élite 147 et les gens ducommerce 148.
Il est attesté à Salacia au début du Ier siècle p.C. 149 et apparaît dans un cas à Olisipodans un document disparu : Rubria Q. f. Sabina 150.
Rutilius : les données sur les Rutillii, dont on a parlé dans un travail précédent 151,sont plus abondantes que celles des autres gentilices. Ce nomen, vraisemblablementoriginaire du Latium, est porté par de nombreux sénateurs et chevaliers 152. Il est assezrépandu dans la partie côtière sud méridionale de l'Italie et dans la vallée du Pô, mais peudans le reste de l’Occident, à l’exception de l’Afrique et l’Hispanie 153. En revanche, ontrouve des Rutilii dès l’époque républicaine, notamment à Délos 154 et ensuite dans d’autrescités orientales 155.
Cette famille, dont l’opulence est parfois attestée 156, est répertoriée en Bétique, etl’on peut penser qu’elle en a migré pour s’installer à Olisipo. En effet, L. Rutilius L. f. Gal.Seuerus 157 mourut dans le territoire de cette cité au milieu du Ier siècle p.C. ; sa mère Rutiliafit graver son épitaphe.
Les Rutilii ont établi des liens familiaux avec une autre famille vraisemblablementd’origine italienne, les Gellii, et ont occupé des postes de responsabilité dans legouvernement de la cité : M. Gellius Rutilianus, un Rutilius par sa mère, fut IIuir sousTrajan 158.
141 Gianfrotta 1989, 177-183. César, Ciu., 3.96 ; Plut., Pomp., 73.3.6.142 Tchernia 1992, 293-301.143 Schulze 1904, 221.144 Nicolet 1974, n° 304. 145 Licordari 1982, 25 et 34.146 Lörincz 2000, 32, plus quelques exemples africains.147 Q. Rubrius, chevalier cité par Cic., Ver., 3.185 ; cf. Nicolet 1974, n° 303.148 L. Rubrius, Cic., Ver., 2.132 ; cf. Nicolet 1974, 1006.149 Voir infra.150 CIL, II, 249 = Silva 1944, n° 77. Il est possible qu'elle soit la même personne attestée à Scallabis, CIL,
II, 325 = Silva 1944, n° 119. Un parallèle aussi à Emerita avec C. Rubrius Proculus Pap. (AE, 1982, 483).151 Navarro 2000, 287-290 : j’ai poursuivi l'enquête commencée par Alves Dias 1988-1989, 241-262.152 PIR2, R, 238-261.153 Abascal 1994, 212.v g.154 Ferrary et al. 2002, 212.155 Styberra en Macedoine, Tataki 1996, 106-107 et à Athènes, Follet 2002, 81.156 Un chevalier dénommé Q. R(utilius?) Fl. Cornelian(us) posséda un atelier de Dressel 20 (Chic 2001,
331 et 413). Mais il est difficile de supposer une quelconque relation avec les Rutilii Lusitaniens.157 CIL, II, 3105 = 5005 = Silva 1944, n° 124 = d'Encarnação 1994, n° 19. 158 Voir supra l’article Gellii.
L’ÉMIGRATION ITALIQUE DANS LA LUSITANIE COTIERE 81
Staius : P. Staius G. f. Gal. Exoratus, un citoyen d'Olisipo, membre de l'élite, car iloccupa le sacerdoce de flamen diui Vespasiani, mourut sous le règne de Domitien 159. Maisson nom invite à penser qu’il n’est en aucun cas un personnage banal : Staius est un gentilicelatin rare. En effet, il s'agit d'un nom osque 160, dont Capoue conserva de nombreuxexemples, qui s’est répandu sur la façade adriatique, dans le Samnium, notamment dans lescités de Sulmone (pensons à L. Staius L. f. Murcus 161) et Bovianum, ainsi qu’en Apulie 162.On ne le retrouve pas ailleurs, sauf à Délos au début du Ier siècle a.C. 163 et ensuite àNarbonne 164 et d’Olisipo. Il est donc possible de suggérer qu'il s'agit d'une puissante famillecommerçante, avec des ramifications dans des ports importants. Il semble séduisant deproposer que leurs représentants à Délos ont quitté l'île après l'invasion de Mithridate en88 a.C., pour s'installer dans d'autres ports plus sûrs vers l'Occident, comme ceux d'Olisipoou de Narbo.
En Lusitanie, la famille a poursuivi ses activités commerçantes et y a pris racine endevenant membre du corps civique du nouveau municipe de citoyens romains. Le temps etl'honorabilité ont diversifié ses intérêts économiques : on trouve un affranchi de P. Staiusdans la première moitié du Ier siècle p.C. à Ebora, cité dont le territoire était spécialementpropice à l'agriculture. Nous pensons qu'il s'occupait des intérêts agricoles de la famille. Sonsurnom, Meridianus, ne révèlerait pas une origine africaine comme d'autres chercheurs l’ontpensé 165, mais une vocation méridionale par rapport au noyau central de la famille.
Tarquius : M. Tarquius M. f. Gal. Maxumus 166 mourut à Olisipo dans la premièremoitié du Ier siècle p.C. environ. Du gentilice, vraisemblablement d'origine étrusque 167, lesexemples sont très rares. On trouve quelques cas isolés à Rome 168, avec notre seul exemplehispanique 169.
Tenatius : C. Tenatius C. f. Gal. Iustus 170 fut honoré d'une dédicace lacunaire etdisparue. Son gentilice, rare en Italie, sauf peut-être à Rome, semble avoir pour berceau laCisalpine, notamment Vérone 171. En effet, c’est dans cette zone que les attestations de ce
159 S. Romão, Lourel, Sta. Maria e S. Miguel (Sintra, LI), AE, 1987, 478d = HEp, 2, 1990, 816.160 Lejeune 1976, 143 ; AE, 1981, 240.161 CIL, IX, 3080.162 Une analyse des indices des volumes des CIL italiens montre une prédominance des attestations
apuliennes, 15 environ, avec des ramifications vers le Nord, comme celle du lieutenant de César, L. Staius Sex. f.Murcus, originaire de Sulmone (CIL, IX, 3080 ; MRR, 622) contre un seul cas dans l'Italie centrale et 7 dans leNord. A mon sens, les parallèles italiens ne permettent pas de justifier la correction proposée par Hatzfeld 1912, 80qui fait des Teii de Cumes, des Staii donc, de Cumes.
163 Ferrary et al. 2002, 215-216.164 Lörincz 2002, 92 ; CIL, XII, 5145, un affranchi et sa femme? Aux alentours : AE, 1945, 72 et
1959, 140. 165 IRCP, 485.166 CIL, II, 252 = Silva 1944, n° 20.167 Schulze 1904, 95.168 CIL, VI, 27115.169 Schulze 1904, 95 le relie à Tarcius. Abascal 1994, 227 ; Lörincz 2002, 108.170 CIL, II, 199 = Silva 1944, n° 60.171 Schulze 1904, 373.
82 MIGRARE
nom à consonance celtique 172 sont les plus nombreuses 173. On ignore tout de ce personnage,entre autres les raisons de sa présence à Olisipo 174.
Trebonius : il s'agit d'un nomen peut-être d'origine étrusque 175, avec unereprésentation éparse en Italie sauf en Cisalpine, où il est assez abondant. Il est par ailleursrecensé dans d’autres régions, comme en Narbonnaise, en Panonie et au Norique 176 ainsiqu’en Macédoine. Sa présence, relativement importante, fait de lui un gentilice moinsreprésentatif pour mon propos, bien que, dans l'exemple d'Olisipo, il soit accompagné dusurnom Tuscus, dont on parlera plus tard. Dans la péninsule ibérique, la plupart desattestations ont été trouvées en Bétique 177. Trebonius Tuscus 178 était l'époux de Curia Sex. f.Fundana, décédée à Olisipo dans la première moitié du Ier siècle p.C.
Valcius : il s’agirait d’une variante du nomen Valgius, gentilice latin rare, attesté àRome, dans la région II et en Cisalpine, avec quatre exemples supplémentaires dans lesprovinces occidentales 179. Cependant, le nom Valcius trouve un représentant de marque dansla personne de C. Valgius Rufus, orateur et consul en 12 a.C. 180
Les exemples hispaniques, dans ces deux versions, sont lusitaniens. Au Ier siècle, lescendres de Valcia L. [f.] Sabina ont été déposées dans une cupa, monument fréquent dans leterritoire d’Olisipo 181. Le deuxième cas se trouve à Igaedis, à la fin du Ier siècle p.C., où leConimbrigensis M. Allacarius Celer Paullianus, dédia l’épitaphe de Valgia C. f. Flaccilla 182.
Vrsius : de ce gentilice d'origine étrusque d’après Schulze 183, les exemples ne sontpas très abondants. On en trouve quelques-uns en Italie centrale, plusieurs à Rome et six enCisalpine 184, dont l’un, Boetus de son surnom, spécifie sa condition de natus in Asia 185. Dureste, Vrsius semble être un nomen typiquement hispanique, voire lusitanien 186. Lesexemples les plus anciens appartiennent à Olisipo. En effet, c’est là, sous une stèle en marbreà sommet arrondi, que fut enterré C. Vrsius P. f. Gal. Clemens 187. Dans la même nécropole,située sous la Praça da Figueira, a été inhumée Vrsia Fundana, épouse de P. Vrsius Niceros,
172 CIL, III, 10907.173 Lörincz 2002, 112.174 Un exemple récent a été trouvé en Norique. P. Tenatius Essimo, domicilié dans la cité de Trente et dont
la famille ne semble pas être d'origine locale, définit son métier : negotians uinarius, AE, 1984, 707.175 Schulze 1904, 375.176 Lörincz 2002, 129.177 Abascal 1994, 230-231.178 CIL, II, 212 = Silva 1994, n° 30.179 Lörincz 2002, 146 présente un exemple en Narbonnaise et en autre en Dalmatie, auquel on peut ajouter
quelques exemples africains.180 PIR, V, 169. Dans la variation Valgius, on trouve deux attestations parmi les chevaliers en Afrique,
Lefebvre 1999, 561.181 D'Encarnação 1994, n° 20. Trouvée à Caparide, S. Domingos de Rana (Cascais, LI).182 ILER, 5304 = Almeida 1956, 143 = Étienne et al. n° 29. Signalons le cas de Valgius Marci f. un
pérégrin, attesté à Sta. Eulália (Elvas, PT), Maciel, Maciel, Encarnação, FE, 46, 1994, nº 207.183 Schulze 1904, 261.184 Schulze 1904, 261 ; Lörincz 2002, 187.185 CIL, V, 7451 à Vardagate.186 Abascal 1994, 251.187 AE, 1965, 267.
L’ÉMIGRATION ITALIQUE DANS LA LUSITANIE COTIERE 83
qui l’a par la suite rejointe comme leur fils Vrsius Arrenus 188 (dont le surnom est d'origineindigène 189). Il est cependant difficile de savoir où a été trouvé le texte citant P. Vrsius P. f.Gal. Priscus et son père P. Vrsius Demetrius 190. De nouveaux documents montrent laprésence de porteurs de ce gentilice à Emerita au IIe siècle, ce qui élève le nombre d'Vrsiilusitaniens à un total de onze individus 191.
Les cognomina géographiquesA côté des fossiles onomastiques, le dossier anthroponymique des Italiens et de leurs
descendants à Olisipo doit tenir compte d'un autre type de matériel : les cognominagéographiques qui font allusion à la péninsule italienne. Sans vouloir affirmer avec fermetéque ce type de surnoms comporte très souvent une indication d'origine individuelle, commel'a fait I. Kajanto 192, il nous a semblé nécessaire de les examiner sous l’angle des conditionssociales de leurs porteurs, surtout après la remarque suivante : deux cognominagéographiques italiens, Fundanus/-a et, surtout, Tuscus/-a, semblent être typiquementOlisiponenses 193. En Lusitanie, des vingt attestations lusitaniennes du premier et des trentedu second, la moitié appartiendrait à Olisipo et à son territoire 194. Rappelons que le premierfait allusion à la cité de Fundi et le deuxième signifie “étrusque”.
Il est encore plus curieux de constater que ces deux cognomina latins aient un usagetypiquement hispanique car, si l'on regarde les indices onomastiques provinciaux, ons'aperçoit qu'ils ne sont fréquents que dans la péninsule ibérique. En effet, pour Fundanus,-a, on ne trouve qu'une attestation en Narbonnaise et une autre en Dalmatie, à côté de dix-sept exemples hispaniques 195. Les différences sont encore plus importantes dans le cas deTuscus et de ses dérivés : B. Lörincz 196 présente trente-cinq attestations en Hispanie, deuxen Cisalpine, une en Dalmatie et une en Pannonie 197. Une analyse détaillée des exempleshispaniques permet d'affiner l'analyse, car Fundanus/-a semble être typiquement lusitanien.Plus exactement, il n'est présent que dans la partie méridionale de cette province et c'est àOlisipo qu’il est le plus communément rencontré 198. Pour Tuscus, certains auteurs ont déjàremarqué qu'il est représenté dans une grande partie sud-ouest de la péninsule ibérique,correspondant à la province Vlterior républicaine 199.
188 AE, 1969-1970, 244.189 Voir article Ar(r)enus, -a / Ar(r)einus (carte 38, avec Arenierus ; Ar(r)e(i)nius) dans Grupo Mérida
2003, 99.190 CIL, II, 256 = Silva 1994, n° 62.191 Vrsia Ar[e]thusa (MNAR, nº reg. 12134, inédite) ; Vrsia [S]erena (ou [V]erana) (HAE, 1480) ; Vrsia
Verana et Q. Vrsius Paederos, Saquete & Márquez 1993, nº 3 (AE, 1993, 905 = HEp, 5, 1995, 90).192 Kajanto 1965, 43.193 J'ai laissé de côté Sabinus car son usage semble montrer une pratique particulière : il a été spécialement
apprécié dans les milieux pérégrins, voir article et carte Sabinus dans Grupo Mérida 2003, 291.194 Voir articles Fundanus et Tuscus dans Grupo Mérida 2003, 179-180 et 329.195 Lörincz 1999, 155.196 Lörincz 2002, 135.197 Il faut ajouter ces dérivés qui présentent le même constat (Lörincz 2002, 135) : un seul exemple de
Tuscillianus en Hispanie ; de Tuscillus on trouve un cas en Cisalpine et sept en Hispanie ; seul deux exemples deTuscinus se trouvent en Hispanie.
198 Abascal 1994, 374 ; Article Fundanus, /-a de Grupo Mérida 2003, 179-180.199 Untermann 1965, mapa n° 79 ; Marcos Pous 1976 ; Kajanto 1965, 51.
84 MIGRARE
Certaines raisons socio-culturelles ont fait que ces noms aux consonancesgéographiques italiennes sont plus particulièrement attribués dans ces zones de la péninsuleibérique. L'usage s'est créé dans des régions où l'émigration italienne, tant individuelle quecollective, a été importante dès l'époque républicaine. Il semble donc légitime de penser que,dans la plupart des cas, les personnes concernées par ces noms avaient des ancêtres italiens.Ces raisons culturelles locales, qui font que l’on dénomme volontiers les gens en fonction deleur origine géographique, se sont conjuguées dans l'usage onomastique, avec unemétonymie : des adjectifs qui qualifient une partie de l'Italie sont devenus ceux quidéfinissaient une origine italienne en général. Tuscus ou Fundanus seraient donc dessubstituts d'Italicus 200 (ce dernier est d’ailleurs utilisé de façon prestigieuse à Emerita lorsde la troisième génération). On constate un phénomène analogue en Argentine, de nos jours,avec la dénomination de Gallegos, utilisée pour désigner des Espagnols. Mais, à ladifférence de cet exemple moderne, Fundanus et Tuscus semblent avoir une connotationprestigieuse, car ils sont portés souvent par les membres de l'élite locale.
L'analyse des données d'Olisipo, la cité qui est l'épicentre d'un tel phénomèneonomastique, apporte, d'une part, des éléments supplémentaires sur l'attribution de ces deuxcognomina, et d'autre part, des données sur les Italiens et leurs descendants à Olisipo.
Fundanus, -a :
200 Navarro 2000, 290-292.
Personnage Lieu de découverte Référence
Q. Atilius M. f. Fundanus Colares (Sintra, LI), CIL, II, 274 = ILER, 2392
Q. Caesius Q. f. Gal. Fundanus
S. Domingos de Rana (Cascais, LI)
CIL, II, 4997 = Silva 1944, n° 109
C. Cassius Fundanus Lisbonne (Lisboa, LI), CIL, II, 5099 = Silva 1944, n° 127
[. C]om[inius] M. f. Gal. Funda[nus]
Casais de Cabrela, Terrugem (Sintra, LI)
CIL, II, 285 = HAE, 1225
Curia Sex. f. Fundana Lisbonne (Lisboa, LI) CIL, II, 212 = Silva 1944, n° 30
Iulia G. f. Fun[da]na Alcabideche (Cascais, LI) AE, 1985, 513
[I]ulia Q. f. Fu[ndana?] Lisbonne (Lisboa, LI) CIL, II, 290 = Silva 1944, n° 88
[Iu]nia [. f. Fu]ndana Caparide, S. Domingos de Rana (Cascais, LI)
AE, 1981, 492
Vrsia Fundana Lisbonne (Lisboa, LI) AE, 1969-70, 244
L’ÉMIGRATION ITALIQUE DANS LA LUSITANIE COTIERE 85
Tuscus, -a
Personnage Lieu de découverte Référence
[A]lbanius C. f. Gal. [T]u[sc]us
Almorquim, Terrugem (Sintra, LI)
HAE, 1224
G. Fabius Tuscus Montelavar (Sintra, LI) CIL, II, 5008
M. Fuluius Tuscus Lisbonne (Lisboa, LI) CIL, II, 187 = Silva 1944, n° 23
Iulia Tusca Lisbonne (Lisboa, LI) CIL, II, 222a = Silva 1944, n° 133
Iulia C. f. Tusca Postumia Lisbonne (Lisboa, LI) CIL, II, 222b = Silva 1944, n° 134
[Iu]nia L. f. Tusca Lisbonne (Lisboa, LI) AE, 1953, 257 = Silva 1944, n° 115
L. Lauius L. f. Aemilia tri. Tuscus Felici<ta>tis Iul(iae)
Vila Nova de Gaia (Vila Nova de Gaia, PT)
HAE, 465 = AE, 1953, 268
Licinia L. f. Tusca Almorquim, Terrugem (Sintra, LI)
HAE, 1224
Peticia P. f. Tusca Lisbonne (Lisboa, LI) CIL, II, 192 = Silva 1944, n° 33 et CIL, II, 240 = Silva
1944, n° 53
Terentia M. f. Tusca Alenquer (Alenquer, LI) CIL, II, 275 = ILER, 3693
M. Terentius Tuscus Alenquer (Alenquer, LI) CIL, II, 275 = ILER, 3693.
Trebonius Tuscus Lisbonne (Lisboa, LI), CIL, II, 212 = Silva 1944, n° 30
Voluscia G. f. Tusca Lisbonne (Lisboa, LI) Silva 1944, n° 14
[---]licia M. f. Tusca Lisbonne (Lisboa, LI) Silva 1944, n° 115 = AE, 1953, 257
Tusca Tusci f. Matacães (Torres Vedras, LI) AE, 1982, 468
Tuscus Matacães (Torres Vedras, LI) AE, 1982, 468
86 MIGRARE
Tuscilla
Tuscillianus
Il faut d'abord signaler la chronologie ancienne de la plupart des documents. Saufexception, ils datent de la première moitié du Ier siècle. La comparaison de ces donnéesonomastiques avec celles du reste de la Lusitanie, notamment dans le cas de Fundanus, meten évidence une pratique qui commence à Olisipo pour s’étendre ensuite au reste de laprovince. En effet, les attestations de Pax Iulia 201, Mirobriga 202 et encore d'Evora 203 sontplus récentes.
Le fait que ces cognomina soient souvent unis aux gentilices fossilisés confirmel'hypothèse italienne de leur origine : Curia Sex. f. Fundana, épouse de Trebonius Tuscus,Peticia P. f. Tusca 204, [. C]om[inius] M. f. Gal. Funda[nus] 205, Vrsia Fundana 206. Rappelonsaussi le cas de T. Rutilius Gal. Tuscilianus 207 Olisiponensis, installé à Balsa ou de Q.Caesius Q. f. Gal. Fundanus, qui appartenait au cercle familial des Loreii 208.
Il faut signaler également que ces surnoms, qui entretiendraient le souvenir del’origine familiale, sont souvent portés par les femmes. Enfin, un phénomène particulier esttout à fait remarquable : l'adoption de ce nom par des pérégrins voisins des uillaeappartenant à la population d'origine italienne. On parle de Tusca Tusci f., citée auparavant,qui ne constitue d’ailleurs pas le seul exemple dans la province 209.
Personnage Lieu de découverte Référence
[Iu?]lia Tuscilla Lisbonne (Lisboa, LI) CIL, II, 236 = Silva 1944, n° 50
Personnage Lieu de découverte Référence
T. Rutilius Gal. Tuscillianus Luz (Tavira, FA). Sa tribu et les parallèles onomastiques
font de lui un citoyen d'Olisipo
CIL, II, 4989 = 5161 = IRCP, 80
201 IRCP, 387.202 IRCP, 156.203 IRCP, 385.204 CIL, II, 192 = Silva 1944, n° 33 + CIL, II, 240 = Silva 1944, n° 53.205 CIL, II, 285 = HAE, 1225.206 AE, 1969-70, 244.207 CIL, II, 4989 =5161 = IRCP, 80.208 Voir supra, p. 76-77. 209 Voir l’article Tuscus, -a dans Grupo Mérida 2003, 329.
L’ÉMIGRATION ITALIQUE DANS LA LUSITANIE COTIERE 87
SalaciaSalacia s’érigea sur un promontoire dominant le début de l’estuaire du Sado
(Callipus), occupé aujourd’hui par la ville portugaise d’Alcácer do Sal. Elle avait uneposition stratégique : située à l’intérieur des terres, elle possédait un important port fluvialqui la reliait directement avec l’océan et qui était la base de son économie. En plus, les portsmaritimes du uicus de Tróia et de la cité de Caetobriga surveillaient l’entrée des bateaux surl’estuaire et lui servaient d’avant-poste.
A la différence d’autres cités de la région, elle a fait l’objet d’opérationsarchéologiques qui ont permis de déceler, d’une part, l’ancienneté de son occupation et,d’autre part, l’endroit exact de l’emplacement de l’oppidum 210. En effet, les vestiges mis aujour remontent à la fin de l’Age du Bronze. Ensuite, de nombreux éléments permettent desuggérer la présence d’un entrepôt indigène a fait du commerce avec les Phéniciens établis àAbul 211 et a subi leur influence. On connaît également l’existence d’un important siteindigène pré-romain, très actif comme port d’entrée des marchandises provenant d’Italie àl’époque républicaine 212. Cet établissement indigène et la ville romaine qui lui succéda sontsitués tous deux sur l’actuelle colline du château et se sont étendus secondairement vers lefleuve avec son port fluvial, centre économique de la cité.
A l’époque républicaine, Salacia a frappé monnaie avec des légendes en caractèresibériques, sans que les spécialistes soient d’accord sur son toponyme exact : Evion,Ketovion, Ketivion ou Keition. Plus tard, elle émit un numéraire avec la légendeImp(eratoria) Sal(acia) o Salac(ia), peut-être pendant le conflit qui opposa César auxenfants de Pompée. Il est possible, comme nos collègues portugais le pensent 213, que Salaciase soit ralliée au parti pompéien car elle ne posséda pas l’épithète de Iulia. En effet, lesmonnaies et le témoignage de Pline suggèrent que le nom complet de la cité romaine était :Salacia Urbs Imperatoria 214. Quoi qu’il en soit, elle possédait le droit latin ancien àl’époque d’Auguste : le nombre de citoyens romains résidant dans son oppidum et dans sonterritoire était suffisamment important pour qu’y soit nécessaire le ius Latii qui gérait leurcohabitation avec les indigènes pérégrins. Probablement sous Auguste, la cité a reçu le statutmunicipal. L’urbanisme de la ville romaine est encore inconnu : seuls quelques vestiges duforum ont été mis au jour autour de l’église de Santa Maria do Castelo 215. On connaît mieuxson territoire où plusieurs uillae et une partie de l'aqueduc ont été trouvées 216. Ce portflorissant dès le IIe siècle a.C., trouve dans le sel, les minerais ainsi que dans les salaisonsd’origine locale ses principaux produits d’exportation tout au long de l’Empire. En effet, lesminerais extraits des mines de Vipasca étaient exportés par la mer à partir de Salacia, demême que le sel obtenu aux alentours. Ensuite, nombreuses sont les usines à garum et
210 Silva et al. 1980-1981, 129-168.211 Mayet & Tavares da Silva 2000.212 Mantas 1990, 179.213 Mantas 1990, 174.214 Plin., Nat., 4.116.215 Silva et al. 1980-1981, 164-168 ; Faria 1998.216 Ferreira 1959, 168-195.
88 MIGRARE
dérivés situées entre l’embouchure du fleuve et l’oppidum de la cité, étant les plus connuescelle de son uicus de Tróià 217.
Malgré son importance à l'époque républicaine et sous le Haut Empire, Salacian'offre qu'un dossier onomastique à consonances italiques quantitativement peu importanteet peu instructif :
Duronius : il s'agit d'un gentilice rarissime, issu de la ville samnite de Duronia, etpresque absent de l'épigraphie italienne 218. On connaît cependant l'existence de deuxsénateurs républicains porteurs de ce nom 219. Il est recensé en petit nombre dans certainesprovinces celtiques, peut-être par assonance linguistique 220. L'attestation lusitanienne est leseul exemple hispanique : Duroniu[s .] f. Gal. Modestus 221 érigea une statue sur piédestal àun notable de la cité de Salacia qui, étant donné le nom de la tribu, devait être aussi la ciuitasdu défunt.
Rubrius : de ce nomen, déjà mentionné à Olisipo, on connaît une attestation du débutdu Ier siècle à Salacia. Il s'agit de L. Rubrius Priscinus, décédé à l'âge de 26 ans 222.
BalsaLe site de ce chef-lieu de cité s'est érigé dans un espace, aujourd'hui inhabité, qui
correspond à la Quinta da Torre de Ares, appartenant à la ville moderne de Luz de Tavira. Laville occupait un petit plateau, qui dominait la plaine agricole et le bassin intérieur, protégéde l'Atlantique par l'île de Tavira. Ce port était situé sur le promontorium Cuneus 223, près duDelta du Guadalquivir, au voisinage de la frontière de Lusitanie et de Bétique, face auxterres africaines.
Faute de données archéologiques suffisantes, la reconstruction de son histoire doitêtre établie à partir de données numismatiques : son atelier frappa asses, semisses etquadrantes probablement vers 47-44 a.C., ce qui la fait figurer comme une ville indigène àl'importance relative. Selon Pline, il s'agissait d'un des oppida du promontorium Cuneus,dont le statut était celui d'une cité stipendiaire 224. Balsa était donc dépourvue des privilègespolitiques au début du règne d'Auguste, peut-être à cause d’un mauvais choix au moment dela guerre civile. Son évolution politique est parallèle à celle du reste de la péninsuleibérique : elle reçoit entre 73 et 74 le droit latin et, très probablement, la conditionmunicipale un peu plus tard. En effet, à partir de cette date, ses citoyens romains serontinscrits dans la tribu Quirina 225, qui est celle des cités privilégiées sous les Flaviens.
Rappelons que Balsa n'a jamais fait l'objet de fouilles archéologiques systématiques.
217 Étienne et al. 1994.218 Schulze 1904 355, pense à un usage étrusque. Un exemple à Puteoli, CIL, X, 2863, deux attestations à
Aquilée : CIL, V, 1885 et 8377. 219 L. Duronius (MRR, I, 388) et M. Duronius (MRR, II, 7).220 Lörincz 1999, 111.221 IRCP, 186.222 CIL, II, 37 = IRCP, 196.223 Pomp. Mela 3.1.7. ; Ptol. 2.5.2.224 Plin., Nat., 4.117-118.225 CIL, II, 4990.
L’ÉMIGRATION ITALIQUE DANS LA LUSITANIE COTIERE 89
Cependant, de l'épigraphie et des vestiges archéologiques récupérés en surface, 226 on peutdéduire qu'elle connut une situation riche au IIe siècle. Elle posséda même un cirque, érigé engrande partie grâce à la générosité des notables 227. Cette situation, fondée sur une économieflorissante, ne semble pas changer au IIIe siècle et même au début du IVe, période deproduction des amphores Almagro 50 et 51, qui transportaient le garum produit dans larégion. L'essor de la cité à l'époque tardive est confirmé par les trouvailles des monnaies etpar les restes de la nécropole de Pedras d'El Rei, en service au IVe siècle. Les donnéesarchéologiques semblent disparaître au milieu du Ve, peut-être aux alentours de la grandeinvasion des Suèves.
Le dossier onomastique que nous avons retenu est bref mais assez significatif. Eneffet, il met en valeur les liens sociaux établis entre Balsa et Olisipo.
Gellius : à la fin du Ier siècle, plusieurs membres de cette famille originaired’Olisipo 228, peut-être des affranchis, se sont installés dans cette cité méridionale,vraisemblablement pour élargir et diversifier leurs intérêts commerciaux. Dans cetteaventure, ils étaient accompagnés par des Rutilii, leurs associés et parents 229 : L. Gell(ius)Tutus 230 fait partie des dédicants qui au milieu du IIe siècle financent la réalisation d’unestatue à T. Rutilius Gal. Tuscilianus 231.
Meclonius : T. Meclon(ius) Cassius 232 participa avec L. Gell(ius) Tutus à l'hommagerendu à T. Rutilius Gal. Tuscilianus 233. Son gentilice, d'origine étrusque 234, est très rare :Cicéron mentionne à T. Mec(u)lonius comme propriétaire à Rome, mais les seuls parallèlesépigraphiques se trouvent dans le centre et centre-sud de l'Italie (surtout en Ombrie etCampanie), trois en Cisalpine et deux en Narbonnaise 235. Il s'agissait très probablement d'uncommerçant associé aux autres dédicants. Son surnom témoigne d’un souci d’archaïsme dela part de ses géniteurs.
Rutilius : T. Rutilius Gal. Tuscilianus, citoyen d’Olisipo par sa tribu, porteur d’unsurnom typique dans sa cité qui rappellerait son passé italien 236, vécut à Balsa au IIe siècle.Vers 150 p.C. Tuscilianus reçut une dédicace honorifique qui est une mine derenseignements. D'abord, de sa nomenclature, il faut remarquer sa tribu, la Galeria quimanifestait sa condition d'Olisiponensis et sa filiation qui remontait à son grand-pèrematernel. Celui-ci, T. Manlius Quir. Martialis, avait été IIuir de Balsa 237 : il s'agissait demontrer ses liens locaux.
226 Carta Arqueológica de Portugal. Concelhos de : Faro, Olhão, Tavira, Vila Real de Sto. António, CastroMarim e Alcoutim, Lisbonne 1995, 109-161. Voir aussi les pages des synthèses dans Smit Nolen 1994.
227 IRCP, 76-77.228 Voir supra.229 Voir infra, sur les Rutilii.230 CIL, II, 4989 = 5161 = IRCP, 80.231 Sur les Gellii et les Rutilii à Olisipo et Balsa voir Navarro 2000, 287-290.232 CIL, II, 4989 = 5161 = IRCP, 80.233 Voir infra.234 Schulze 1904, 152.235 Lörincz 2000, 72.236 Voir supra.237 On conserve la base de la statue que lui a érigé sa sœur, Manlia Faustina. Son titre de IIuir y est bien
spécifié : CIL, II, 499 et 5162 = IRCP, 79.
90 MIGRARE
Par conséquent, les branches des Rutilii et des Gellii déplacées à Balsa ont faitsouche et ont assuré leur position avec des mariages dans des familles nobles, comme lesManlii. Le nombre ainsi que l’onomastique des dédicants dans l’hommage à Tuscilianuspermettent d’affirmer qu’il s’agissait de commerçants, voire un collège des commerçants. Ilssont huit, leurs surnoms orientaux exprimeraient leur condition d’affranchis ; leurs gentilicessont également très significatifs car on y trouve un membre de la famille Gellia, un affranchides Rutilii, P. Rutilius Antigonus, deux affranchis des Manlii, mais aussi T. Meclon(ius)Cassius, cité auparavant.
RÉFLEXIONS SUR UN DOSSIER ONOMASTIQUE
Les limites de la documentationLa lecture du dossier épigraphique invite à la prudence : on a tenté d'évaluer la
population d'origine italienne de façon indirecte et parfois hypothétique, à partir de critèresonomastiques dont la validité doit être sans cesse remise en cause en fonction des progrès del’épigraphie. De plus, cette approche est partielle, car elle est fondée sur certains indicesanthroponymiques, comme sont les gentilices fossilisés ou les surnoms géographiques ; il ya donc certainement un groupe beaucoup plus nombreux d’individus d'origine italienne quiéchappe à cette analyse. Ajoutons à cela la fragmentation du dossier : les référencesépigraphiques sont souvent isolées, ce qui empêche de suivre l'évolution des groupes deparentés.
Les données chronologiques s'étendent sur deux siècles et demi. Cette amplitudechronologique est en rapport, d'une part, avec l'évolution sociale des familles et, d'autre part,avec le contexte des migrations : leurs phases, leurs causes et les types d’immigrés ont variédans le temps, rendant ainsi difficile la reconstruction historique. Il faut cependant signalerque les textes les plus nombreux mettent en valeur des situations datant de la premièremoitié du Ier siècle p.C., ce qui fait penser à une immigration plus importante à la fin de laRépublique et au début de l'Empire. C'est le cas de Q. Hirrius M. f. Gal. Mat[e]rnus 238,Lucceia Cinnamis 239, G. Lucceius Philogenes 240, L. Rutilius L. f. Gal Seuerus 241, Orbia C.f. Anus 242, Valcia L. [f.] Sabina et de la plupart des attestations des cognominagéographiques.
Signalons enfin les différences géographiques : parmi les cités côtières de laLusitanie, seule Olisipo présente un dossier onomastique étoffé et nos conclusionsconcerneront donc en majorité cette ville. Pour comprendre ces différences, il faut savoir queson corpus épigraphique est plus abondant que celui des autres ciuitates, mais le hasard nepeut pas tout expliquer. En effet, les gentilices fossiles et les surnoms Tuscus, -a et Fundanus
238 CIL, II, 217 = Silva 1944, n° 4.239 CIL, II, 216 = Silva 1944, n° 37.240 CIL, II, 232 = Silva 1944, n° 47.241 CIL, II, 3105 = 5005 = Silva 1944, n° 124 = d'Encarnação 1994, n° 19. 242 Janas, S. Martinho (Sintra, LI), CIL, II, 311 = HEp, 2, 1990, 820 + Grupo Mérida 2003, 254.
L’ÉMIGRATION ITALIQUE DANS LA LUSITANIE COTIERE 91
semblent indiquer que la composante allogène de la population d'Olisipo, notammentitalienne, était plus importante que celle des autres ports de l'Atlantique lusitanien : lesréminiscences onomastiques d'origine italienne sont très abondantes à Olisipo et très raresdans les autres villes côtières, à l'exception de Balsa où, d'ailleurs, les élémentsanthroponymiques recensés ont un passé “Olisiponensis”. La composante sociale des cités adû provoquer des répercussions dans leur vie économique et même dans leur conditionjuridique.
La vie des Italiens et de leurs descendants en LusitanieNéanmoins, le dossier sur les noms à réminiscences italiennes, éparpillé en
apparence, permet en fait de répondre à un certain nombre d’autres questions. Les plusévidentes sont celles qui concernent l'intégration des Italiens et de leurs descendants. Apartir du Ier siècle p.C., période à laquelle nos sources commencent à apparaître à Olisipo,tous les témoignages convergent : les individus dont l'onomastique manifeste une origineitalienne ne sont pas de passage. Ils font partie du corps civique, participent activement à lavie publique et occupent souvent des postes de responsabilité. Citoyens d'Olisipo, ils sontinscrits dans la tribu de la cité, la Galeria, comme Q. Hirrius M. f. Gal. Mat[e]rnus 243 et M.Tarquius M. f. Gal. Maxumus 244, décédés au plus tard dans la première moitié du Ier sièclep.C., ou L. Rutilius L. f. Gal. Seuerus 245, enterré au milieu du Ier siècle p.C., ou encore [.M]undici[us M. f.] Gal. Se[uerus?] 246 et C. Tenatius C. f. Gal. Iustus 247 dont la chronologieest plus tardive. Parmi les notables de la cité, on trouve P. Staius G. f. Gal. Exoratus, flamendiui Vespasiani 248, ou Peticia P. f. Tusca, épouse d'un édile 249, ainsi que C. Heius C. l.Primus, riche Augustalis et généreux évergète sous Néron 250. Du côté de Balsa, on arrive aumême constat avec quelques différences : d'une part, les individus recensés sont originairesd'Olisipo, dont ils conservent la citoyenneté, comme T. Rutilius Tuscillianus ; et, d'autre part,leur intégration à la vie publique est plus tardive et contemporaine de l'accession à lacondition municipale de Balsa.
Si l'on revient à la cité la plus significative dans notre recherche, Olisipo, onremarque que les témoignages retenus ont été souvent trouvés dans la campagne, où cesfamilles possédaient donc une uilla et exploitaient des terres. Dans ces contextes ruraux,l'épigraphie montre l'existence d'une certaine mixité avec la population d'origine locale etmême la tentation de s'attirer la bienveillance des divinités indigènes. Rappelons la dédicacede T. Curiatius Rufinus à Triburonnis 251. Au-delà du fait religieux, ce don est une
243 CIL, II, 217 = Silva 1944, n° 4.244 Lisboa (Lisboa, LI), CIL, II, 252 = Silva 1944, n° 20. 245 CIL, II, 31005 = 5005 = Silva 1944, n° 124 = d'Encarnação 1994, n° 19.246 Ferreira & Almeida 1958, 132-140, nº I.247 CIL, II, 199 = Silva 1944, n° 60.248 S. Romão, Lourel, Sta. Maria e S. Miguel (Sintra, LI), AE, 1987, 478d = HEp, 2, 1990, 816.249 CIL, II, 192 = Silva 1994, n° 33 + CIL, II, 240 = Silva 1944, n° 53.250 CIL, II, 196 = Silva 1944, n° 71.251 Freiria, S. Domingos de Rana (Cascais, LI), AE, 1985, 514, cf. d'Encarnação 1994, n° 2.
92 MIGRARE
manifestation profonde de l'installation permanente des Italici en Lusitanie et une preuve dela symbiose opérée entre romanité et coutumes indigènes.
Par conséquent, la partie de la population d’origine italienne que les “fossilesonomastiques” permettent de connaître ne semble pas se comporter comme une minoritérepliée sur elle-même, bien que la nomenclature personnelle de ses membres, notamment lesurnom Tuscus, montre qu’elle a conscience de la différence de son origine.
Il n'est pas vain de rappeler qu'Olisipo était un municipe de citoyens romains dèsl’époque d’Auguste. A cette époque, la plupart des habitants libres de la cité au passé pro-césarien, ce qui lui vaudra les épithètes de Felicitas Iulia, étaient des citoyens romains, entreautres de nombreux descendants de colons installés sur son territoire, comme le suggèrentcertains auteurs 252. En effet, à partir des données onomastiques, les textes épigraphiques,bien que relativement tardifs par rapport à ce phénomène et trop laconiques, montrent laprésence de gens venus d’Italie au moins dès la fin du premier siècle a.C. Peut-être issus del'armée, ils habitent à la campagne et travaillent la terre selon des modes d'exploitation dontles études sur l'occupation du sol permettent de déceler l’origine romaine. Il est possible quel’usage des cognomina Tuscus, -a et de leurs dérivés et de Fundanus, -a, révèle de façononomastique l’existence d’un substrat italien ancien, dont le point de départ était le centre dela péninsule italienne. Du souvenir des premiers colons reste le prestige des deuxcognomina. Cependant, l'analyse des gentilices fossilisés montre la présence d'un autre typed'émigrés Italiens, les commerçants, dont nous parlerons en détail ci-dessous.
Selon Pline, Salacia, l'autre grand port lusitanien, n'avait que le droit latin ancien, etTurobriga et Balsa n'étaient que des ciuitates stipendiaires. Le comportement des cités aucours des Guerres Civiles a en effet été déterminant pour l’obtention de ces situationsjuridiques. Il en va de même de leur composante sociale, telle que la suggère ladocumentation onomastique retenue : il semblerait que l'émigration des Italiens fut plusimportante à Olisipo, ville de droit romain, que dans les autres cités.
Un autre aspect de la vie des Italiens et de leurs descendants en Lusitanie est celui desdéplacements intra-provinciaux. Le cas des Rutilii et des Gellii Olisiponenses, établis plustard à Balsa pour développer leurs affaires, est un exemple révélateur. De même, unebranche affranchie des Staii de la même Olisipo gérait les intérêts de la famille dans lacampagne d’Evora. Les Valgii hispaniques ne sont présents qu’à Olisipo et, ensuite, àIgaedis. Le même constat peut être établi pour les Vrsii, habitants d’Olisipo dès le début duIer siècle p.C. et que l’on trouve au IIe siècle p.C. à Emerita. Les déplacements de cesindividus dépendaient d’un réseau économique à échelle de la province, car, dans lapéninsule ibérique, ces gentilices sont absents en dehors de la Lusitanie.
L’interprétation des données se heurte à une difficulté. En effet, il est peu aisé deconnaître avec certitude les directions des flux migratoires entre la côte, surtout Olisipo, etles cinq colonies lusitaniennes, notamment la capitale, Emerita Augusta. Certains individusporteurs des fossiles onomastiques peuvent n’être en fait que des colons ou leursdescendants, déplacés pour des raisons socio-économiques vers la mer. En effet,
252 Le Roux 1995, 91 ; d’Encarnação 1994, 71-72.
L’ÉMIGRATION ITALIQUE DANS LA LUSITANIE COTIERE 93
l’inscription de Q. Tallius Sex. f., originaire d'Emerita Augusta, trouvée à Igaedis et datée de16 a.C. 253, montre que, très tôt, les coloni d’Emerita Augusta, grâce à leur situation aisée,avaient acquis des intérêts dans d’autres cités. La question se pose aussi pour les Alfii(colons d’Emerita, avec des parallèles onomastiques à Olisipo), comme pour les Coranii(une femme appelée Corania serait l'un des premiers habitants recensés épigraphiquement àPax Iulia) et pour les Loreii, (une femme avec ce gentilice était la fille d’un des premierscolons à Metellinum). Si l’ancienneté chronologique privilégie les colonies comme originedans ces exemples, elle semble parfois favoriser la piste inverse : Olisipo est le point dedépart des Peticii et des Vrsii, qui sont présents plus tardivement à Emerita. Leurs épitaphesétaient exposées sur des structures architecturales collectives, qui appartenaientprobablement à des associations d'étrangers à la cité 254.
Tous les éléments du dossier semblent donc s’accorder pour permettre de dire que lesItaliens installés à Olisipo, membres à part entière de son corps civique, se tournent ensuitevers l’intérieur de la province, même si une part de leurs revenus est issue de la mer 255.
Origines et motifs de l'émigration italienneVenons-en à l’épineux problème de l’origine, en général, des Italiens installés sur les
côtes lusitaniennes. Nous employons cet adjectif au terme d’une enquête onomastique serréeen Italie et dans le reste de l’Empire qui confirme que, étant donné les déplacements despopulations, notamment vers le Nord et la côte de la péninsule italienne, l’étymologie serévèle totalement insuffisante comme méthode de recherche et toute affirmation basée sur unpourcentage d’attestations doit être traitée avec une extrême prudence.
Compte tenu de ces limites, l’analyse des origines des Italiens déplacés vers les citéscôtières de la Lusitanie ne montre pas beaucoup d’éléments convergents : les endroits d’oùprobablement pourraient provenir les individus recensés sont très divers, surtout l'Apulie,mais aussi la Campanie, le Samnium et même la Cisalpine, si l’on tient compte desdéplacements au sein de l’Italie. Le manque d’homogénéité, malgré une certaineprédominance de l’Italie méridionale, semble refléter la réalité d’un municipe de citoyensromains, comme Olisipo, qui n’a pas été l’objet d’une colonisation officielle et organisée.Les intérêts économiques et sociaux ont lancé sur les routes de l’émigration des individusd’horizons géographiques italiens divers, à des moments différents, sans que la Lusitaniesoit pour autant, leur première terre d’accueil. En effet, les caractéristiques de nos sourcesprivilégient par sa rareté l'origine italienne – là réside notre objectif, mais presque tous lesanthroponymes retenus ont quelques minces attestations ailleurs, notamment en Orient et enAfrique. En effet, plusieurs chercheurs ont signalé avant nous les relations fluides quisemblait exister entre la Lusitanie et l'Afrique, reflet que l’on retrouve dansl’onomastique 256.
253 Étienne 1992.254 Voir références supra.255 Sur le rayonnement d’Olisipo dans son conuentus et dans la province, voir Martineau & Tranoy 2000.256 d'Encarnaçao & Ribeiro. Il est vrai que, parmi les étrangers recensés en Lusitanie, les Africains sont les
plus nombreux. Voir, à cet égard, Grupo Mérida 2003 et l'article de S. Lefebvre, dans ce volume.
94 MIGRARE
Mais les motifs des déplacements sont en étroite liaison avec l’origine et lesconditions des flux migratoires. Malgré la prudence qui doit entourer la méthodeonomastique, on peut considérer comme très probable que les Staii aient débarqué dans leport d’Olisipo pour des raisons commerciales. En effet, tous les témoignages sur cettefamille dans l’Empire semblent mettre en valeur leur sens des affaires. Il s'agit d'une gensoriginaire de Capoue, où l'on a conservé les noms de ses affranchis dans des collègesprofessionnels de la fin du IIe siècle a.C. Au Ier siècle a.C., plusieurs de ses membres se sontdéplacés vers l’est de la péninsule italienne, car on les retrouve à Sulmone, mais surtout enApulie, autour de Canusium et Bénévent, régions voisines de la mer et favorables aucommerce maritime à l’époque républicaine. Une branche faisait partie des Italiens installésà Délos déjà à la fin du IIe siècle, bien que les données sur leurs transactions commercialesou financières soient malheureusement inexistantes. Comme d’autres familles italiennes del’île, on les retrouve après les événements de 88 a.C. en Grèce continentale et en Asie. Leurdiaspora, depuis l’Italie et très probablement depuis la Grèce, les ont amené à s’établir danscertains ports, afin d’y installer leurs affaires et le dossier onomastique montre que Narbo etOlisipo ont été ces ports en Occident.
Le dossier des Peticii, plus complexe par sa densité, irait dans le même sens. Onconnaît des individus avec ce gentilice à Délos et en Orient. On connaît des grandsnégociants de cette famille, dont le noyau le plus important se rencontre dans la cité deSulmone où, précisément, on trouve également des attestations des Staii, ce qui n’est peut-être pas le fruit du hasard. Il semble donc possible que les Peticii, peut-être avec les Staii,aient pu s’installer à Olisipo vers la deuxième moitié du Ier siècle a.C. On pourrait appliquerdes arguments similaires aux Heii, dont un représentant affranchi fut un grand évergète de lacité, et aux Orbii, dont la fonction commerciale en Lusitanie est confirmée par le peson avecla marque Orbi trouvé à Conimbriga.
D’ailleurs, on est troublé de constater que les fossiles onomastiques sont présentségalement à Délos pour plus de la moitié au IIe et au début du Ier siècle a.C. et, plus tard, surle continent, que ce soit en Grèce ou en Asie, où les personnes ainsi nommées exerçaient desfonctions commerciales : à côté des Staii, Peticii, Orbii, Heii, il faut citer également lesRutilii, Luccei, Mundicii… A l’exception de Rutilius, ces noms sont assez rares pour que cesrapprochements et convergences ne laissent pas indifférent. Il semble possible de suggérerl’arrivée à Olisipo au Ier siècle a.C., peut-être après le désastre de 88 a.C., des membres deces familles à la recherche de comptoirs de substitution à Délos, devenu un endroit peu sûr,ou, tout simplement, à la recherche de nouveaux ports où établir un bureau commercial oubancaire 257.
Il n’est évidemment pas dans notre intention d’affirmer que tous les Italiens d’Olisipoétaient des commerçants venus d’Orient. Comme on pouvait l’imaginer dès le départ, notresource d’information principale, les gentilices latins fossilisés, ne présente qu’une partieparticulière de la population d’origine italienne. A Olisipo, cette partie semble montrer unecertaine spécialisation dans les milieux d’affaires. En effet, il faut se réjouir que les
257 Sur le commerce des produits hispaniques en Méditerranée orientale : Bernal Casasola 2000.
L’ÉMIGRATION ITALIQUE DANS LA LUSITANIE COTIERE 95
caractéristiques des fossiles onomastiques permettent d’isoler un phénomène social, qui estcelui de l'installation à Olisipo des familles italiennes commerçantes recensées auparavant àDélos et sur le continent grec et asiatique. Leurs transactions ont favorisé l’importation demarchandises, mais elles ont également promu le développement des productions locales,notamment celle des salaisons, qui ont très bien pu être acheminées par leurs propresréseaux commerciaux vers les points de consommation dans toute la Méditerranée. On peutpenser que les bureaux d'Olisipo ont souvent été sous la responsabilité d'affranchis, dont laplupart ont fait souche en Lusitanie.
C'est ainsi qu'un dossier onomastique apporte des éléments de réflexion sur l’histoireéconomique. La venue à Olisipo de ces grandes familles commerçantes oblige à effectuer unretour sur la fonction économique de cette cité portuaire : port de frontière dans l'Atlantiquedu Ier siècle a.C. 258 et, ensuite, sans être un grand port d’échanges (rappelons qu’Olisipo estabsent de la liste d’emporia recensés par Strabon), port d'exportation des produitslusitaniens, notamment des salaisons mais, surtout, port d’importation de produitsredistribués dans toute la province par le Tage, trafics où l'influence de commerçantsétrangers a pu être déterminante. Les confins du monde occidental étaient ainsi reliés àd'autres comptoirs, grâce aux différents bureaux des mêmes familles. En revanche, le port deSalacia semble avoir des spécificités commerciales plus locales, fondées plus surl'exportation du sel et des salaisons de son littoral ainsi que du minerai de l'intérieur.
Étant donné la documentation actuelle, il est cependant impossible de connaître lerôle de ces familles dans les échanges : propriétaires, négociants, banquiers 259? De surcroît,leurs transactions étaient basées sur des produits dont on ignore la nature. Rappelons que ladocumentation épigraphique lusitanienne concernant l’instrumentum domesticum n’est pastrès prolixe. La production d’huile et de vin de la province semble avoir toujours trouvé undébouché local 260, ce qui ne rendait pas nécessaire la fabrication d’amphores pour unecommercialisation par voie maritime. En revanche, les salaisons de poissons produites surtout le littoral méridional, notamment dans les cités que nous étudions, ont été consomméesdans toute la Méditerranée occidentale, notamment à Rome. Cependant, leurs conteneursamphoriques de fabrique locale, les Dressel 14b identifiés par F. Mayet 261, sont très pauvresen renseignements onomastiques et ils ne sont donc d'aucun secours pour nos propos. Onretiendra simplement la très probable fonction commerciale des Staii, Heii, Peticii, Orbii etc.dans un milieu des affaires maritimes que les sources littéraires ont ignoré.
Pour conclure, notre principal constat est d’ordre méthodologique : à l’époqueromaine, se nommer pouvait comporter une attestation géographique soit directe, parl’origo, soit indirecte, par l’onomastique. Les résultats obtenus montrent la validité de laméthode anthroponymique, lorsque l’origo fait défaut. En effet, elle permet de détecter unefraction de l'émigration italienne qui, autrement, serait restée dans l'anonymat. Mais, étant
258 Mavrojannis 2002, 179 pense également à Délos comme un port frontière au IIe siècle a.C.259 Sur ces questions voir Étienne & Mayet 1993-1994 et 1998.260 Brun 1997.261 Mayet 1990 ; Mayet et al. 1996 ; Mayet & Tavares da Silva 1998 et 2002.
96 MIGRARE
donné le caractère partiel de cette approche méthodologique, la documentation n'est pas enmesure d'expliquer tous les aspects de l'émigration italique en Lusitanie. Elle a des limites etforce est de le reconnaître. Mais ce sont précisément ces caractéristiques spécifiques qui larendent nécessaire, puisqu'elles isolent des phénomènes de société. Notre étude a mis enrelief deux aspects : tout d'abord, l'intégration des Italiens et de leurs descendants dans la viepublique et économique des cités portuaires de Lusitanie ; ensuite, l'arrivée à Olisipo desfamilles commerçantes qui ont eu préalablement des intérêts dans le bassin méditerranéen,peut-être en Sicile et en Afrique mais, surtout, en Orient avec tout ce que cela représented'intérêt pour la place du commerce maritime lusitanien dans le monde romain.
A côté de ces résultats, d'autres aspects de la problématique retenue restent ensuspens : l'origine des flux migratoires, leur densité, le rôle concret de l'armée, le possibleretour en Italie, les conditions sociales des premiers immigrés sur ces nouvelles terres quifurent à une époque la fin du monde connu…, questions auxquelles d'autres sources devrontrépondre.
Le deuxième thème de réflexion concerne le cadre géographique de l'étude. Nousavons retenu les cités côtières de la Lusitanie, car la mer leur donne une unité spatiale et unepossible similitude socio-économique. L'état actuel de notre documentation onomastiquesuggère des variations dans leurs composantes sociales, qui auraient des incidences dansleur spécificité économique et juridique. Olisipo apparaît comme une destination privilégiéede l'immigration italienne, dès la fin de la République et jusqu'au milieu du Ier siècle, avecl'établissement de colons, rappelés par les surnoms Fundanus, -a et Tuscus, -a, mais aussiune émigration commerciale, manifestée dans certains gentilices fossilisés. Les donnéesonomastiques pour les autres cités portuaires sont, ou inexistantes, ou plus tardives, commec'est le cas à Balsa.
Toutes ces remarques doivent s'inscrire dans le cadre global de la mutation socio-culturelle des territoires hispaniques les plus occidentaux vers la nouvelle identitélusitanienne romaine, qui s'est produite vers la première moitié du Ier siècle p.C. Lesimmigrants italiens ont y joué un rôle important comme porteurs de modèles culturels, maisaussi comme stimulateurs de la demande économique de nouveaux produits. On retrouveleurs traces diluées dans la population mélangée d'une cité romaine portuaire d'époqueimpériale telle qu'Olisipo.
L’ÉMIGRATION ITALIQUE DANS LA LUSITANIE COTIERE 97
BIBLIOGRAPHIE
Abascal Palazón, J. M. (1994) : Los nombres personales en las inscripciones latinas de Hispania,Anejos de Antigüedad y Cristianismo, II, Murcie.
Alarcão, J. de (1988) : O domínio romano em Portugal, Sintra.Alarcão, J. de et F. Mayet, éd. (1990) : Les amphores lusitaniennes. Typologie, Production, Commerce
(Conimbriga, 1988), Paris.Alföldy, G. (1969) : Die Personennamen in der römischen Provinz Dalmatia, Heidelberg.——— (1982) : “Senatoren aus Norditalien regiones IX, X und XI”, EOS, 2, 309-368.Almeida, F. de (1956) : Egitânia. História e arqueologia, Lisbonne. ——— (1968) : “Sobre a barragem romana de Olisipo”, AP, 3 série, III, 179-189.Almeida, J. Mendes et F. Bandeira Ferreira (1965) : “Varia epigraphica (Nova série)”, RGuimarães,
75, 82-109. Alves Dias, M. M. (1988-1989) : “A propósito de duas inscrições romanas de Torres d’Ares (Luz,
Tavira)”, AP, IV, 6-7, 241-262.Amaro, C. et T. L. de Matos (1996) : “Trabalhos arqueológicos no claustro da Sé de Lisboa. Notícia
preliminar”, Ocupação romana dos estuários do Tejo e do Sado, Lisbonne, 215-224.Beltrán Lloris, F., éd. (1995) : Roma y el nacimiento de la cultura epigráfica en Occidente (Zaragoza,
1992), Saragosse.Bernal Casasola, D. (2000) : “Las ánforas béticas en los confines del Imperio. Primera aproximación a
las exportaciones a la pars orientalis”, Congreso Internacional ex Baetica amphorae.Conserva, aceite y vino de la Bética en el Imperio Romano (Sevilla-Écija, 1998), Écija, 935-988.
Balsdon, J. P. V. D. (1979) : Romans and Aliens, Londres. Bresson, A. (2002) : “Italiens et Romains à Rhodes et à Caunos”, in : Müller & Hasenohr 2002, 147-
162.Boak, A. E. R. (1916) : “The magistri of Campania and Delos”, Class. Phil., 11, 25-30.Brun, J.-P. (1997) : “Production de l'huile et du vin en Lusitanie Romaine”, Conimbriga, 36, 45-72.Bugalhão, J. (2001) : A indústria romana de transformação e conserva de peixe em Olisipo. Núcleo
Arqueológico da Rua dos Correeiros, Lisbonne.Caballos Rufino, A. (1999) : “Los caballeros romanos originarios de las provincias de Hispania. Un
avance”, in : Demougin et al. 1999, 463-512.Camacho, C., C. Calais et G. Nunes (1996) : “A presença romana no concelho de Vila Franca de Xira :
investigar, divulgar e animar”, Ocupação Romana dos Estuários do Tejo e do Sado, Lisbonne,179-188.
Camodecca, G. (1982) : “Ascesa al senato e rapporti con i territori d’origine Italia : regio I (Campania,esclusa la zona di Capua e Cales), II (Apulia e Calabria), III (Lucania e Brutia)”, Epigrafia eordine senatorio, II, Tituli, 5, 101-163.
Campanile, E. (1992) : AION (filol), 14, 207-221.Capeans, R. (1935) : “Uma novidade no onomástico greco-latino”, Etnos, 1, 271-274.Cassolà, F. (1970-1971) : “Romani e Italici in Oriente”, Dialoghi di Archeologia, IV-V, 306-307.Cébeillac Gervasoni, M., éd. (1983) : Les “bourgeoisies” municipales italiennes aux IIe et IIIe siècles
(Naples, 1981), Paris-Naples.Chelotti, M., V. Morizio et M. Silvestrini (1990) : Le epigrafi romane di Canosa, I-II, Bari.
98 MIGRARE
Chic García, G. (2001) : Datos para un estudio socioeconómico de la Bética. Marcas de alfar sobreánforas olearias, Écija.
Coarelli, F., D. Musti et H. Solin, éd. (1982) : Delo e l'Italia. Opuscula Instituti Romani Finlandiae, 2,Rome.
Conway, R. S. (1897) : The Italic dialects Hildesheim (édition de 1967).Demougin, S., H. Devijver et M.-Th. Rapsaet-Charlier, éd. (1999) : L'ordre équestre : Histoire d'une
aristocratie (IIe s. av. J.-C.-IIIe s. ap. J.-C), Coll. EFR 257, Rome.Diogo, A. M. Dias (1993) : “O teatro romano de Lisboa. Noticia sobre as actuais escavações”, in :
Ramallo & Santiuste 1993, 217-224.Dyson, S. L. (1980-1981) : “The distribution of Roman republican family names in the Iberian
peninsula”, Anc. Soc., 11-12, 257-299.Edmondson, J. (1990) : “Le garum en Lusitanie urbaine et rurale”, Les villes de Lusitanie romaine.
Table ronde internationale du CNRS (Talence, 1988), Paris, 123-147.——— (1994) : “Creating a Provincial Landscape : Roman Imperialisme and Rural Change in
Lusitania”, in : Gorges & Salinas 1990, 13-30.Encarnação, J. d' (1994) : Roteiro epigrafico romano de Cascais, Cascais.——— (2003) : “Onomástica y religión” in : Grupo Mérida 2003, 425-427.Étienne, R. (1992) : “L'horloge de la ciuitas Igaeditanorum et la création de la province de Lusitanie”,
REA, 94, 3, 355-362. Étienne, R. et F. Mayet (1988) : “Les mercatores de saumure hispanique”, MEFRA, 110, 1998, 147-
165.——— (1993/1994) : “La Lusitanie et le commerce méditerranéen”, Conimbriga, 32-33, 201-218.——— (2000) : Le vin hispanique, Paris.——— (2002) : Salaisons et sauces de poisson hispaniques, Paris.Étienne, R., Y. Makaroun et F. Mayet (1994) : Un grand complexe industriel à Tróia (Portugal), Paris.Étienne, R., G. Fabre, P. Levêque et M. Levêque (1976) : Fouilles de Conimbriga, II, Epigraphie et
sculpture, Paris.Fabião, C. (1993-1994) : “O azeite da Baetica na Lusitania”, Conimbriga, 32-33, 219-245.Faria, J. C. (1998) : “Algumas notas acerca do provável forum de Salacia Imperatoria (Alcácer do
Sal)”, Conimbriga, 37, 185-199.Ferrary, J.-L., Cl. Hasenohr et M.-Th. Le Dinahet (2002) : “Liste des Italiens de Délos”, in : Müller &
Hasenohr 2002, 183-239.Ferreira, F. Bandeira et J. Mendes de Almeida (1958) : “Varia Epigraphica”, Rev.Fac.Let.Lisboa, 2,
132-171.Follet, S. (2002) : “Les Italiens à Athènes (IIe siècle av. J.-C. – Ier siècle ap. J.-C.)”, in : Müller &
Hasenohr 2002, 79-88.Gianfrotta, P. A. (1989) : “Eracle, Peticio e il commmercio marittimo”, Dalla villa di Ovidio al
santuario di Ercole, Sulmone, 177-183.Gorges, J.-G. et T. Nogales Basarrate, éd. (2000) : Sociedad y cultura en Lusitania romana. IV Mesa
Redonda Internacional, (Mérida, 2000), Serie Estudios Portugueses, 13, Mérida.Gorges, J.-G et M. Salinas de Frías, éd. (1994) : Les campagnes de Lusitanie romaine. Occupation du
sol et habitats. Table Ronde Internationale (Salamanque, 1993), Madrid-Salamanque.Grupo Mérida (2003) : Atlas antroponímico de Lusitania romana, Mérida-Bordeaux.Haley, E. W. (1986) : Foreigners in Roman Spain. Investigation of Geographical Mobility in the
Spanish Provinces of the Roman Empire, 30 B.C.-A.D. 284, Columbia Univesity.
L’ÉMIGRATION ITALIQUE DANS LA LUSITANIE COTIERE 99
Hatzfeld, J. (1912) : “Les Italiens résidants à Délos mentionnés dans les inscriptions de l'île”, BCH, 36,10-101.
——— (1919) : Les trafiquants italiens dans l'Orient grec, Paris.Hasenohr C. et Ch. Müller (2002) : “Gentilices et circulation des Italiens”, in : Müller & Hasenohr
2002, 11-20.Hauschild, Th. (1990) : “Das römische Theater von Lissabon”, MDAI(M), 31, 348-392.Helly, B. (1983) : “Les Italiens en Thessalie au IIe et au Ier siècles av. J.-C.”, in : Cébeillac-Gervasoni
1983, 355-380.Jongelling, K. (1994) : North African Names from Latin Sources, Leyde.Kajanto, I. (1965) : The Latin Cognomina, Helsinki.Lefebvre, S. (1999) : “Donner et recevoir : Les chevaliers dans les hommages publics d'Afrique”, in :
Demougin et al. 1999, 513-578. Lejeune, M. (1976) : L'Anthroponymie osque, Paris.Le Roux, P. (1995) : “L’émigration Italique en Citérieure et Lusitanie jusqu’à la mort de Néron”, in :
Beltrán 1995, 85-95.Letta, C. et S. d'Amato (1975) : Epigrafia della regione dei Marsi, Milan. Licordari, A. (1982) : “Italia : Regio I (Latium)”, EOS, 2, 9-57.Lörincz, B. et F. Redõ (1994) : Onomasticon provinciarum Europae latinarum. Vol. I : ABA -
BYSANVS, Budapest.Lörincz, B. (1999) : Onomasticon provinciarum Europae latinarum. II : CABALICIVS - IXVS, Vienne.——— (2000) : Onomasticon provinciarum Europae latinarum. III : LABAREVS - PYTHEA, Vienne.——— (2002) : Onomasticon provinciarum Europae latinarum. IV : QVADRATIA - ZVRES, Vienne.Mantas, V. Gil (1990) : “As cidades marítimas da Lusitânia”, Les villes de Lusitanie romaine. Table
ronde internationale du CNRS (Talence, 1988), Paris, 149-205.——— (1995) : “Comércio marítimo e sociedade nos potos romanos do Tejo e do Sado”, Ocupação
romana dos estuários do Tejo e do Sado, Lisbonne, 343-369.Marcos Pous, A. (1976) : “La estela de M. Perpernas Tuscinus, sus antropónimos y la relación con la
colonización itálica de la Ulterior”, Corduba, 1, 49-141.Matos, J. L. de (1994) : “Romanização de Lisboa : trabalhos arqueológicos na Sé de Lisboa”, V
Jornadas Arqueológicas de l'Associação dos arqueólos portugueses (Lisboa, 1993), Lisbonne.Martineau B. et A. Tranoy (2000) : “Migrations et courants migratoires dans le conventus
Scallabitanus”, in : Gorges & Nogales 2000, 229-239.Mayet, F. (1990) : “Typologie et chronologie des amphores lusitaniennes”, in : Alarcão & Mayet 1990,
29-34.Mayet, F., A. Schmitt et C. Tavares da Silva (1996) : Les amphores du Sado, Portugal. Prospection des
fours et analyse du matériel, Paris.Mayet, F. et C. Tavares da Silva (1998) : L'atelier d'amphores de Pinheiro, Portugal, Paris.——— (2002) : L'atelier d'amphores d'Abul. Portugal, Paris.Mavrojannis, Th. (2002) : “Italiens et Orientaux à Délos : considérations sur ‘l'absence’ des
negotiatores romains dans la Méditerranée orientale”, in : Müller & Hasenohr 2002, 163-180.Mócsy, A. et al. (1983) : Nomenclator provinciarum Europae Latinarum et Galliae Cisalpinae,
Budapest. Navarro Caballero, M. (2000) : “Notas sobre algunos gentilicios romanos de Lusitania : una propuesta
metodológica acerca de la emigración itálica”, in : Gorges & Nogales 2000, 281-297. Navarro Caballero, M., M. Oria Segura et J. L. Ramírez Sádaba (2003) : “La onomástica greco-latina”,
in : Grupo Mérida 2003, 407-412.
100 MIGRARE
Navarro Caballero, M. et J.-P. Bost (2003) : “Estatuto social y onomástica”, in : Grupo Mérida 2003,413-424.
Nicolet, Cl. (1974) : L'ordre équestre à l'époque republicaine (312-43 av. J.-C.), II, Prosopographiedes chevaliers romains, BEFAR, 207, Paris.
Pieri, G. (1968) : L'Histoire du cens jusqu'à la fin de la République romaine, Paris.Quintela, A., J. Cardoso et J. Mascarenhas (1986) : Aproveitamentos hidráulicos romanos a sul do
Tejo, Lisbonne.Ramallo Asensio, S. F. et F. Santiueste de Pablos, éd. (1992) : Teatros romanos de Hispania,
Cuadernos de Arquitectura romana, 2, Murcie.Ramírez Sádaba, J. L. et E. Gijón Gabriel (1994) : “Las inscripciones de la Necrópolis del Albarregas
(Mérida) y su contexto arqueológico”, Veleia, 11, 117-168.Ramírez Sádaba, J. L. (1994-1995) : “Estelas de granito inéditas en el M.N.A.R. de Mérida”, Anas, 7-
8, 257-268.Rizakis A. D., éd. (1996) : Roman Onomastics in the Greek East Social and Political Aspects.
Proceedings of the International Colloquium ou Roman Onomastics (Athens, 1993),MEAETHMATA, 21, Athènes.
——— (2002) : “L'émigration romaine en Macédoine et la communauté marchande deThessalonique : perspectives économiques et sociales”, in : Müller & Hasenohr 2002, 109-132.
Roso de Luna, M. (1905) : “Nuevas inscripciones romanas de la región norbense”, BRAH, 47, 60-71.Salomies, O. (1996) : “Contacts between Italy, Macedonia and Asia Minor during the Principate”, in :
Rizakis 1996, 111-127.Saquete Chamizo, J. C. et J. Márquez Pérez (1993) : “Nuevas inscripciones romanas de Augusta
Emerita : la necrópolis del Disco”, Anas, 6, 51-74.Silva, V. da A. (1944) : Epigrafia de Olisipo, Lisbonne.Silva, C. Tavares de, J. Soares, C. Mello Beirão et al. (1980-1981) : “Escavações arqueológicas no
Castelo de Alcácer de Sal”, Setúbal Arqueológica, 6-7, 129-168.Smit Nolen, J. U. (1994) : Cerâmicas e Vidros de Torre de Ares. Balsa, Lisbonne.Solin, H. et O. Salomies (1988) : Repertorium nominum gentilicium et cognominum Latinorum,
Hildesheim-Zurich-New York (édition de 1994).Spawforth, A. J. S. (1996) : “Roman Corinth : the formation of a colonial elite”, in : Rizakis 1996, 170-
182.Schulze, W. (1904) : Geschichte Lateinischer Eigennamen, Leipzig.Syme, R. (1986) : “More Narbonensian Senators”, ZPE, 65, 1-24 (= RP, VI, 209-231).Tataki, A. B. (1996) : “The nomina of Macedonia” in : Rizakis 1996, 105-109.Tchernia, A. (1992) : “Le dromadaire des Peticii et le commerce oriental”, MEFRA, 104, 293-301.Untermann, J. (1965) : Elementos de un atlas antroponímico de la Hispania Antigua, Bibliotheca
Praehistorica Hispana, 7, Madrid.Van Berchem, D. (1962) : “Les Italiens d'Argos et le declin de Délos”, BCH, 86, 305-313.——— (1963) : “Les Italiens d'Argos. Un post-scriptum”, BCH, 87, 322-324.Wilson, A. J. N. (1966) : Emigration from Italy in the Republican Age of Rome, Manchester-New York.Zoumbaki, S. (1996) : “Römische namen in Eleia”, in : Rizakis 1996, 191-206.









































![Les images parlantes des catholiques, du Moyen Age aux Temps modernes, et la polémique protestante (XVIe – XVIIe siècles). Une première approche [2016]](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/63139acd85333559270c5064/les-images-parlantes-des-catholiques-du-moyen-age-aux-temps-modernes-et-la-polemique.jpg)