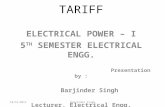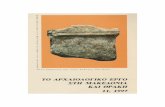Le débat immobile, Kimé, 1997
-
Upload
univ-paris5 -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of Le débat immobile, Kimé, 1997
Version numérique en libre accès,
avec l’autorisation des éditions Kimé
Pour citer cet ouvrage : Doury, M. 1997. Le Débat Immobile. L‟argumentation dans le débat médiatique sur les parasciences. Paris : Kimé.
Contact : [email protected]
« Les controverses continuelles que l‟on connaît dans ce milieu ne servent à rien, parce que l‟on ne pourrait jamais forcer
quelqu‟un à croire ce qu‟il ne veut pas croire. » (Rémy Chauvin, parapsychologue)
« Raisonner avec les astrologues, c‟est boxer avec un oreiller de plumes : on l‟enfonce en un point, il se regonfle ailleurs. »
(Michel Rouzé, rationaliste)
Avant-propos1
Il est parfois difficile de repérer un événement qui pourrait constituer le point de départ de l‟intérêt d‟un chercheur pour un sujet particulier. Dans mon cas, déterminer la date où le débat sur les parasciences m‟a intriguée au point de devenir un possible sujet de recherche est relativement aisé. En 1986, parallèlement à mes études, je faisais des “piges” pour un quotidien régional. Ses autres journalistes étant occupés ailleurs, ce quotidien m‟avait chargée de rendre compte d‟une conférence de presse donnée par un morphopsychologue2 dans une MJC de la ville. L‟assistance semblait relativement sereine ; pour ma part, j‟étais, de façon quasi épidermique, très réticente face à la morphopsychologie : carrée au fond de mon fauteuil, sourire narquois aux lèvres, je laissais le morphopsychologue présenter sa discipline tout en préparant quelques questions acérées. L‟ensemble de mon comportement devait communi-quer mon scepticisme de façon assez éloquente – surtout pour un morphopsychologue, entraîné à prêter attention au langage du visage et du corps. Cela explique sans doute que, l‟orateur
1 Cet ouvrage présente les résultats d‟une thèse menée au sein du Groupe de
Recherches sur les Interactions Communicatives (GRIC) à l‟université Lumière-Lyon 2 entre 1990 et 1994. Mille mercis à sa directrice, Catherine Kerbrat-Orecchioni, qui m‟a permis de bénéficier d‟un environnement matériel et scientifique idéal pour mener à bien ce travail. Parmi les membres de l‟équipe, je tiens à remercier plus spécialement Christian Plantin, François Lupu et Véronique Traverso pour leurs conseils et leurs relectures. Enfin, merci à Michel Marcoccia pour sa relecture rigoureuse, et pour bien d‟autres choses encore.
2 Rappelons que la morphopsychologie est une discipline qui prétend pouvoir déterminer la personnalité d‟un individu à partir de la morphologie de son visage.
8 Le débat immobile
ayant posé que le journaliste par excellence présentait un physique “mercurien” (Mercure étant, dans la mythologie, le messager des Olympiens), parmi l‟assistance rassemblée devant lui, c‟est moi (sans doute la moins journaliste de tous !) qu‟il a choisie pour illustrer ce type, vantant à l‟envi mes récepteurs sensoriels (yeux, bouche, nez, oreilles) de bonne taille (signe d‟ouverture sur l‟extérieur), mais affinés en leurs extrémités (manifestant une capacité à analyser les informations ainsi engrangées), etc... La ficelle était sans doute un peu grosse ; pourtant, l‟ensemble de la conférence de presse du morphopsy-chologue m‟avait durablement intriguée, et – même s‟il faut, évidemment, se méfier des reconstructions a posteriori –, son discours m‟avait fait toucher du doigt la puissance de la rhéto-rique qu‟il développait. Quelques années plus tard, après maintes pérégrinations, lorsque j‟ai eu à décider d‟un sujet de thèse, c‟est aux parasciences que je suis revenue. Depuis la conférence de presse du morphopsy-chologue, j‟ai beaucoup travaillé à construire un objet, à élaborer une position de recherche. Ce n‟est pas une pigiste “allergique” aux parasciences qui a fait ce livre, mais une linguiste, qui travaille en argumentation et propose un modèle d‟analyse de débats médiatiques. Il n‟en reste pas moins que cette conférence de presse peut être considérée, pour moi, comme l‟acte de naissance d‟une réflexion de plusieurs années sur la polémique sur les parasciences. Plus largement, rares sont ceux qui n‟ont jamais été confrontés à une manifestation de la polémique sur les parasciences (astrologie, parapsychologie, instinctothérapie, ovnis...). En effet, celle-ci constitue un sujet traité régulièrement par les grands médias lorsque l‟actualité se fait pauvre (un “marronnier”, selon le jargon consacré). Les débats qui sont organisés sur des thèmes “parascientifiques”, en particulier à la télévision, suscitent bien souvent des réactions négatives chez les téléspectateurs, quelle que soit d‟ailleurs leur position person-nelle sur le sujet. Ces réactions sont de divers types : – “ils ne savent que s‟insulter !” Ce qui ressort à la première vision de ces débats, c‟est la violence de l‟affrontement des personnes. On a souvent le sentiment que l‟argumentation se limite à l‟insulte. Même lorsque les locuteurs font l‟effort de ne pas recourir aux attaques personnelles, l‟argumentation ne dépasse pas la phase d‟affirmation du désaccord. “Je ne suis pas d‟accord avec vous” serait le seul mode possible d‟expression des débatteurs, toute velléité d‟argumenter se heurtant à des
Avant-propos 9
mises en cause personnelles ou aux contraintes du média : temps limité, contraintes d‟intelligibilité, irréductibilité d‟un plateau de télévision à un laboratoire scientifique... – “c‟est un dialogue de sourds !” De ces affrontements émerge le sentiment très fort que chaque débatteur mène son propre discours indépendamment de son adversaire, qu‟aucun véritable dialogue n‟est possible. Chacun se contente d‟affirmer et de réaffirmer sa position, sans véritable volonté de discussion critique, et avec la ferme intention de ne rien entendre de ce que pourra dire l‟adversaire. En bref, et pour paraphraser Traverso (1996 : 191)1, la polémique sur les parasciences, telle qu‟elle apparaît à la télévision, produit le plus souvent un effet de “débat immobile”. Elle donne le sentiment que rien ne s‟y dit réellement, que les mêmes arguments se répètent de débat en débat, et semble n‟introduire aucun mouvement dans les convictions ou les représentations des téléspectateurs et des débatteurs eux-mêmes. Par ailleurs, le peu de crédit accordé au sujet même du débat (les parasciences en général, ou une parascience particulière) par les “gens sérieux” est sans doute grandement responsable du peu d‟intérêt porté à ce débat comme objet d‟étude. En effet, une position relativement répandue est de considérer que l‟astrologie, la parapsychologie, l‟instinctothérapie, etc... correspondent à des phénomènes de société, qui peuvent donc constituer des objets pour des sociologues ou des ethnologues, mais que les discours qui s‟y rapportent sont probablement creux et sans grand intérêt. Il se pourrait bien pourtant que l‟intérêt intrinsèque d‟un thème ne laisse en rien préjuger de l‟intérêt de l‟analyse d‟un débat contradictoire sur ce thème. Le travail présenté ici a l‟ambition d‟intéresser même (et peut-être surtout) ceux dont la chirologie ou la parapsychologie ne sont pas la préoccupation essentielle. Ce que cet ouvrage voudrait montrer, c‟est que le débat sur les parasciences est loin d‟être un affrontement creux, vide (même s‟il reste peut-être, malgré tout, stérile, dans la mesure où il est bel et bien “immobile”). L‟essentiel de son intérêt tient au fait qu‟il traite d‟un objet frontière d‟un point de vue épistémologique. La controverse sur les parasciences soulève en fait des
1 Les références des ouvrages théoriques sont données dans la bibliographie. Les
références des articles ou ouvrages utilisés comme corpus sont données dans le corps du texte, en entier lors de leur première occurrence, en abrégé par la suite.
10 Le débat immobile
interrogations très générales et fondamentales sur les moyens de preuve, sur leur évaluation par des “locuteurs ordinaires”, sur le rapport à la réalité, sur la notion de fait, etc., interrogations qui renouvellent le débat en le déplaçant, des discussions classiques sur la validité de l‟astrologie ou de l‟homéopathie, vers de nouvelles problématiques. En dehors de ce que le travail présenté ici peut apprendre sur le débat sur les parasciences, il constitue, je l‟espère, un exemple d‟analyse de polémique médiatique qui peut servir de modèle à l‟étude d‟autres débats. Le premier chapitre de cet ouvrage s‟interroge sur la façon de traiter un débat médiatique. Il présente le cadre théorique de l‟analyse et, plus particulièrement, la conception de l‟argumen-tation adoptée ici. Il décrit également le corpus traité, ainsi que les conséquences méthodologiques de son caractère médiatique. Le deuxième chapitre définit l‟objet analysé : le débat sur les parasciences, et expose les problèmes soulevés par cette définition. Il propose une réflexion sur les termes qui lui sont associés (“parasciences”, “pseudo-sciences”, “sciences parallèles”), ainsi qu‟une typologie permettant de structurer l‟ensemble des disciplines ainsi désignées. Il présente enfin les principaux acteurs du débat, ainsi que les supports par lesquels ils s‟expriment. Les cinq chapitres suivants sont consacrés à une description de la construction du cadre de la polémique par les partisans et les adversaires des parasciences. Le troisième chapitre montre en quoi la position de l‟opposant, dans la polémique sur les parasciences, souffre d‟une faiblesse constitutive : le thème même du débat favorise les partisans des parasciences, qui légitiment leur droit à la parole en revendi-quant une compétence sur le sujet qu‟ils refusent à leurs adversaires. Autre manière de manifester une compétence : se poser en vulgarisateur. Le chapitre 4 décrit les séquences de vulgarisation produites par les débatteurs, et en analyse la fonction argumen-tative. Les chapitres 5, 6 et 7 complètent cette description de la construction du cadre par une analyse des identités discursives élaborées par les locuteurs. Ils présentent les images que les débatteurs proposent d‟eux-mêmes, du camp adverse, et plus généralement, de la polémique dans laquelle ils entrent. La description de ces images est suivie de l‟analyse de leur fonction dans la mise en place d‟une interprétation globale de la polémique. La description du cadre du débat constitue un préalable qui permet de mettre à jour certains enjeux qui
Avant-propos 11
traversent la polémique, et de lui restituer une cohérence qui risquerait de passer inaperçue avec une analyse immédiate de la discussion sur la validité des parasciences. Le chapitre 5 met ainsi en évidence la rhétorique de dénonciation mise en oeuvre par les adversaires des parasciences ; basée principalement sur des procédés métaphoriques, elle construit une vision manichéenne du débat, opposant la communauté scientifique unanime au bloc solidaire des charlatans. Le chapitre 6 montre comment les partisans des parasciences répondent à cette schématisation en lui opposant des procédés de dissociation visant à mettre en doute le consensus scientifique contre les parasciences, et à se démarquer de certaines pratiques “parascientifiques” fortement critiquées. Le chapitre 7 clôt cette analyse des schématisations en présentant l‟interprétation globale du débat élaborée par les partisans des parasciences. Cette interprétation repose sur la figure argu-mentative de l‟“appel à Galilée”, qui fait des partisans des parasciences des martyrs des sciences, et de leurs adversaires, de dignes héritiers de l‟Inquisition. Le cadre du débat étant mis en place, le chapitre 8 décrit les argumentations qui visent à établir l‟existence ou la non existence de phénomènes paranormaux, et l‟efficacité ou la non efficacité de “mancies” ou de médecines parallèles. Ces argumentations passent souvent par des négociations “méta-argumentatives” cherchant à définir ce qu‟il faut admettre comme preuve. Ces négociations débouchent généralement sur des tentatives pour construire des définitions négociées de la science (chapitre 9). Leur analyse suggère que, dans le cadre du débat médiatique sur les parasciences du moins, il est possible d‟assigner une conception de la science différente aux partisans et aux adversaires des parasciences.
Chapitre 1 : Comment analyser
l’argumentation dans un débat
médiatique ?
1. ARGUMENTATION, ANALYSE DE DISCOURS, PRAGMATIQUE
Le choix d‟un cadre théorique a été subordonné à l‟objectif principal de l‟analyse : accéder aux logiques épistémiques qui se manifestent dans le débat sur les parasciences, et comprendre comment les locuteurs élaborent leurs discours de façon à les rendre convaincants – en tout cas, plus convaincants que ceux de l‟adversaire. Pour mener à bien ce travail, différents secteurs des sciences du langage ont été sollicités : les théories de l‟argumentation (et, plus largement, la rhétorique), l‟analyse de discours et la pragmatique des interactions conversationnelles. La dimension privilégiée reste cependant l‟argumentation, et ce, pour deux raisons principales : – seule une approche argumentative permet de comprendre ce qui constitue le coeur du débat sur les parasciences, c‟est-à-dire les discussions sur la réalité des phénomènes “para”, ou l‟efficacité des pratiques “para”. – même certains mécanismes moins centraux de la polémique sur les parasciences, comme la construction du cadre du débat (prétention des locuteurs à une certaine légitimité, revendication d‟une compétence, schématisations proposées par les débatteurs...) mettent en jeu des procédés argumentatifs. S‟« il n‟existe pas, à l‟heure actuelle, de cadre de référence universellement admis fixant un concept d‟argumentation » (Plantin 1990 : 9), on peut du moins reprendre les grandes questions qui structurent et orientent les études en argumen-tation, afin de préciser ses propres choix1. L‟approche développée ici relève d‟une conception de l‟argumentation comme un phénomène linguistique (et non avant tout une opération de pensée) propre à certains discours (et non à tous les discours, comme le supposerait une vision manipulatoire du langage). Elle prend pour objet la situation dialogique (ici,
1 L‟établissement des grands axes permettant de caractériser les principales
conceptions de l‟argumentation est dû à Plantin 1996 : 18-19.
14 Le débat immobile
principalement des débats télévisés), et utilise les instruments mis au point pour l‟analyse des interactions verbales. Dans ce cadre, son objectif est avant tout descriptif, et non normatif (ce qui ne signifie pas que la question des normes soit abandonnée, comme il apparaîtra plus loin). Enfin, le choix entre une vision de l‟argumentation comme moyen d‟atteindre un consensus, ou comme manifestation d‟un dissensus irréductible s‟impose par l‟objet même de ce travail : il est clair qu‟une conception du dialogue argumenté comme moyen de réduire le désaccord serait tout simplement, dans ce cadre, non pertinente. En bref, il s‟agit d‟une conception rhétorique (et non logiciste) de l‟argumentation, privilégiant la description de stratégies argumentatives menées par des locuteurs au sein d‟interactions. On entre dès lors dans une problématique de la persuasion qui, depuis l‟ancienne rhétorique, reconnaît l‟importance du contexte (et en particulier, prône l‟adaptation du discours rhétorique à l‟auditoire visé). Cette importance de la situation est clairement affirmée par Plantin (1993), qui définit une situation rhétorique par les caractéristiques suivantes : 1. Une situation rhétorique est caractérisée par une question (dite “question rhétorique”1), qui surgit de l‟affrontement de deux thèses antagonistes, l‟une étant généralement admise et appartenant à la doxa, et l‟autre venant mettre en cause cette doxa :
Proposition nouve lle anta goniste de (P )
P roposition reç ue (P ),doxa
Que stion
La résolution de cette question nécessite le déploiement d‟un discours et d‟un contre-discours argumentatifs, dont chacun apporte sa propre réponse à la question. Il n‟y a pas symétrie entre les deux argumentations développées : seule la proposition nouvelle, antagoniste de (P), supporte la charge de la preuve. 2. Une situation rhétorique repose sur un conflit d‟intérêts, chacun soutenant une argumentation conforme à son intérêt propre. Une situation rhétorique comporte donc un enjeu, et la parole rhétorique est une parole intéressée, une parole d‟action, et non une parole gratuite, un “jeu”. 3. Enfin, dans une situation rhétorique, les destinataires (l‟auditoire) jouent un rôle déterminant, dans la mesure où ils sont censés participer à l‟action : ce sont eux les intéressés – ou
1 Afin d‟éviter toute confusion, on réservera ici l‟expression “interrogation
rhétorique” pour désigner les “fausses questions”.
Comment analyser… 15
ceux qu‟il s‟agit de constituer comme intéressés. C‟est en cela que la parole rhétorique est avant tout une parole publique. Cette conception de la situation rhétorique (et de l‟argumen-tation qui s‟y déploie) permet de poser clairement les bases du débat sur les parasciences. Dans ce débat, il est pratiquement impossible de définir a priori qui, s‟attaquant à la doxa, a la charge de la preuve. Quelle est la doxa attachée aux para-sciences ? Si l‟on se réfère aux différents sondages visant à déterminer la croyance des Français aux parasciences, il apparaît que les opinions changent considérablement d‟une discipline à l‟autre. De plus, l‟attribution de la charge de la preuve, loin d‟être donnée au départ, constitue un enjeu crucial du débat. Aussi ne peut-on pas déterminer hors polémique quel sera le discours et quel sera le contre-discours : l‟attribution de la charge de la preuve est négociée au cours de chaque interaction, en fonction notamment de la position argumentative de l‟audi-toire (devant un public d‟astronomes, la charge de la preuve incombera a priori à l‟astrologue, alors que devant un public d‟astrologues, c‟est le sceptique qui devra justifier ses doutes). La question rhétorique qui surgit – et qu‟on peut formuler grossièrement par « pour ou contre les parasciences ? » – comporte des enjeux divers, dont l‟importance justifie l‟achar-nement dont font preuve les acteurs du débat : enjeux écono-miques, liés au poids des activités parascientifiques (applications au recrutement, phénomène éditorial, salons, etc.) ; enjeux symboliques et idéologiques, comme en témoignent les motiva-tions des adversaires des parasciences ; enjeux institutionnels enfin, puisqu‟on observe une pression sans cesse croissante (même si elle n‟est pas générale) sur les pouvoirs publics afin d‟institutionnaliser les parasciences par divers moyens (intégration à des cursus universitaires, remboursement de certaines thérapeutiques par la sécurité sociale, financement des recherches sur certains phénomènes paranormaux, etc.). Enfin, l‟importance de la “publicité” donnée au débat n‟est pas à démontrer ; il suffit de constater l‟importance des émissions télévisées ou des articles de presse qui y sont consacrés pour s‟en convaincre. Si l‟on admet la description précédente d‟une situation rhétorique, il devient nécessaire de reconnaître le dispositif triangulaire qui sous-tend l‟argumentation. Le discours argu-mentatif met en jeu non pas deux, mais trois instances énoncia-tives : le proposant et l‟opposant d‟une part (responsables de deux discours antagonistes), et l‟auditoire d‟autre part. Le tenant du contre-discours peut fort bien se fondre avec l‟auditoire dans certaines situations ; il n‟en faut pas moins
16 Le débat immobile
établir une distinction de principe, dans la mesure où un locuteur construit son discours différemment selon qu‟il s‟adresse prioritairement à son adversaire ou à son auditoire. La parole rhétorique, en tant qu‟elle est adressée à un auditoire, constitue une recherche d‟alliés, qui oeuvre par le biais de la persuasion. Dans le même temps, comme lieu de l‟affrontement entre un discours et un contre-discours, elle est une forme de guerre verbale, où chacun cherche à prendre l‟adversaire en défaut, et peut-être, finalement, à le réduire au silence. La relation entre les locuteurs-argumentateurs est a priori symétrique, dans la mesure où ils sont censés alternativement exposer leurs arguments et recevoir ceux de l'interlocuteur ; en revanche, la relation entre locuteur et auditoire, qui passe par un discours persuasif, n‟est, elle, pas réciproque. Cette description tripolaire du dispositif énonciatif du discours argumenté vaut également pour des situations de communica-tion dans lesquelles on ne peut distinguer trois individus en chair et en os. Dans les situations dilogales, où il s‟agit de convaincre l‟interlocuteur, de l‟amener à changer de position, le schéma se transforme en :
Tenant de la thèse proposée Tenant de la thèse refusée
Interlocuteur en tant
qu 'il est visé par l'argumentation
°
(Boissinot 1992 : 12) De façon similaire, lorsque l‟interlocuteur est constitué par un ou plusieurs individus indécis et muets (c‟est la situation le plus souvent envisagée par l‟ancienne rhétorique, où un orateur adresse un monologue à un auditoire afin de le gagner à sa cause), le dispositif reste encore triangulaire : cette fois, c‟est l‟orateur lui-même qui se dédouble, mettant en scène deux énonciateurs, l‟un (auquel il s‟identifie) tenant du discours, et l‟autre (qu‟il cherche à discréditer) tenant du contre-discours. Cette structure triangulaire du dispositif rhétorique laisse prévoir une des difficultés majeures du discours argumenté, difficulté liée au fait que l‟orateur court deux lièvres à la fois, puisqu‟il cherche à discréditer la thèse d'un adversaire tout en se constituant comme complice d‟un auditoire. Cette définition de la communication argumentative permet de rendre compte de la spécificité de différents types de situations où un discours argumenté peut se développer, sans renoncer ni à la dimension persuasive, ni à la dimension polémique de
Comment analyser… 17
l‟argumentation. Elle fait apparaître en quoi le débat est un type d‟interaction où l‟argumentation peut se déployer de façon privilégiée, puisqu‟il présente, lui aussi, ce dispositif triangulaire (Vion 1992 : 138-139) – en bref, elle institue le débat comme le prototype de l‟interaction argumentée. Enfin, l‟argumentation ainsi conçue entretient des liens avec divers courants linguistiques. En particulier, le fait de définir la parole rhétorique en tenant compte de la situation d‟énoncia-tion ramène à des problématiques connues. Ainsi, Vignaux, après avoir proposé de caractériser une argumentation à partir des arguments qu‟elle contient, ajoute qu‟ « on ne peut imagi-ner [...] d‟argumentation sans discours qui l‟exprime et la soutient ni non plus sans considération du sujet qui l‟énonce » (1988 : 21). Aussi est-il nécessaire de prendre en compte celui qui produit l‟argumentation, ainsi que les circonstances histo-riques et conjoncturelles qui ont vu naître cette argumentation. On est alors amené à appliquer à l‟étude de l‟argumentation la grille de la linguistique de l‟énonciation, qui impose de prendre en compte
les relations qui se tissent entre l‟énoncé et les différents éléments constitutifs du cadre énonciatif, à savoir : – les protagonistes du discours (émetteur et destinataire(s)) ; – la situation de communication : . conditions spatio-temporelles ; . conditions générales de la production / réception du message : nature du canal, contexte socio-historique, contraintes de l‟univers de discours, etc. (Kerbrat-Orecchioni 1980 : 30-31).
C‟est le programme que respectent de nombreux auteurs qui travaillent sur l‟argumentation (ou, plus généralement, sur le discours polémique), dont Boissinot (1992), qui considère que l‟étude du système énonciatif est un outil privilégié d‟analyse du texte argumentatif ou, en analyse de discours, Ebel & Fiala (1981), qui proposent d‟analyser l‟argumentation comme un cas particulier d‟interaction sociale, mettant en jeu des représentations et des rapports de forces lisibles à travers les marques d‟énonciation présentes dans le discours argumenté. La prise en considération de la situation de communication, dans sa définition matérielle et sociologique, fait que l‟analyse de l‟argumentation rencontre inévitablement des probléma-tiques qui relèvent classiquement de l‟analyse de discours, et en particulier, la question de la légitimité, donnée ou construite, des locuteurs. Tout travail en argumentation entretient nécessaire-ment des rapports étroits avec l‟analyse de discours, dès lors qu‟il se propose de décrire des polémiques débordant de la sphère privée.
18 Le débat immobile
Enfin, on a souvent souligné que l‟objet de l‟ancienne rhétorique correspond, au moins partiellement, à l‟objet que se donnent aujourd‟hui les approches pragmatiques des discours. Ainsi, Maingueneau, présentant la pragmatique comme l‟avatar moderne de la rhétorique, affirme que « la rhétorique, l‟étude de la force persuasive par le discours, s‟inscrivait pour une bonne part dans le domaine que balise à présent la pragma-tique » (1991 : 170). Cette convergence entre rhétorique et pragmatique ne doit bien entendu pas conduire à abandonner l‟une pour l‟autre – considérant que “tout est dans la rhétorique” et qu‟au-delà de Cicéron, point de salut, ou, à l‟inverse, que la rhétorique n‟est que le vestige poussiéreux d‟une proto-histoire des sciences du langage, tout juste digne d‟une étude paléontologique. Les outils développés au sein de l‟analyse du discours ou de l‟analyse des interactions conversa-tionnelles permettent d‟interroger de façon serrée des discours argumentatifs, d‟en révéler certains fonctionnements que l‟analyse rhétorique laissait dans l‟ombre, et, surtout, d‟en restituer la dynamique. La tradition rhétorique, et, plus particu-lièrement, la théorie de l‟argumentation, permettent, elles, de repérer et d‟identifier un nombre important de stratégies de persuasion grâce aux réflexions sur les tropes et aux typologies d‟arguments qu‟elles ont constituées tout au long de leur histoire. Finalement, une analyse rhétorico-argumentative (qui s‟intéresse aux « techniques discursives permettant de provoquer ou d‟accroître l‟adhésion des esprits aux thèses qu‟on présente à leur assentiment » ; Perelman & Olbrechts-Tyteca 1988 : 5) est absolument compatible avec (et peut-être même, appelle naturellement) une perspective interactionniste, c‟est-à-dire une approche « qui ne prend pas l‟action indi-viduelle comme unité de base de l‟analyse sociale », et qui « raisonne au contraire en termes d‟actions réciproques » ; les individus ne sont alors « sujets que pour autant que leur identité subjective émerge de leurs interactions avec d‟autres individus et avec leur environnement physique et social » (Quéré 1989 : 49). Le fait que, dans ce travail, la description de toute stratégie argumentative intègre systématiquement la description de ses possibles réfutations, peut être considéré comme une illustration de cette approche interactionniste de l‟argumentation. En effet, on peut chercher à caractériser un type d‟argument par les réfutations qu‟il admet, et celles qu‟il exclut. Celui qui l‟énonce cherche à restreindre les possibilités d‟enchaînement de l‟adversaire, en le contraignant soit à mener une des réfutations prévues, soit à admettre la conclusion visée par l‟argument.
Comment analyser… 19
Aussi la description des réfutations doit-elle être associée systématiquement à celle des arguments.
2. ÉTUDES SUR LES PARASCIENCES
En dehors de ce cadre théorique emprunté au domaine des sciences du langage, l‟analyse du débat sur les parasciences présentée ici doit beaucoup à quelques uns des très nombreux travaux portant sur les parasciences elles-mêmes. Les lignes qui suivent ne prétendent en aucun cas à l‟exhaustivité, ni même à la représentativité des auteurs cités ; elles visent simplement à présenter les deux principaux types d‟ouvrages qui ont servi à ce travail.
2.1. Études de certaines pratiques parascientifiques
Quelques études, assez rares mais fort intéressantes, proposent une analyse “micro” de certaines pratiques parascientifiques. Ainsi, Aphek & Tobin (1989) ont décrit les interactions qui se déroulent entre astrologues et clients, dans une optique qu‟ils qualifient de “relativisme dynamique”. Ils militent pour l‟adoption d‟une perspective sémiotique afin de décrire ce type de situation, s‟appuyant d‟une part sur l‟existence de systèmes de signes utilisés comme supports de voyance (astrologie, chirologie, etc.), et, d‟autre part, sur l‟importance, dans de telles interactions, de ce qu‟ils appellent la communication persuasive. Ils mettent ainsi en évidence le rôle du langage (et des éléments paraverbaux) dans la dyade astrologue / client, mais aussi des systèmes de signes spécifiques à la pratique divinatoire utilisée, et d'éléments extralinguistiques liés au rituel de la cérémonie et à la communication non verbale. Par ailleurs, certains travaux portent sur les récits faits par des témoins de phénomènes paranormaux. En particulier, il faut mentionner la remarquable étude de Wooffitt (1992) sur les témoignages relatant des phénomènes paranormaux. Wooffitt a travaillé sur des discours de locuteurs relatant leurs expériences paranormales (apparitions d‟ovnis, télépathie, précognition, expériences de décorporation, etc.). Appliquant à des textes monologaux les outils mis au point pour l‟analyse des interactions conversationnelles, il a mis en évidence les différentes stratégies mises en place par les locuteurs pour garantir la factualité de leur récit, et pour asseoir leur propre crédibilité comme témoins. Il a finalement montré que les témoins de phénomènes paranormaux sont conscients du fait qu‟il existe un scepticisme culturel puissant à l‟endroit des
20 Le débat immobile
individus qui affirment avoir rencontré de tels phénomènes, et que, dans leur discours, ils s‟efforcent de relater leur expérience sans pour autant mettre en danger leur image aux yeux du destinataire. L‟ouvrage de Wooffitt, qui restitue la dimension polémique des témoignages sur les phénomènes paranormaux, ouvre la voie au deuxième type de travaux : l‟analyse des controverses parascientifiques.
2.2. Analyse de la construction des controverses sur les parasciences
Ces travaux s‟inscrivent dans un courant d‟anthropologie des sciences qui prend pour objet non pas les théories scientifiques considérées comme des produits finis, et étudiées indépendam-ment du processus de leur élaboration (les sciences sanction-nées), mais plutôt la science en action (Latour 1989), la science en train de se faire, en pleine controverse. L‟objectif est, à travers l‟étude de la science au moment où elle n‟est pas encore consacrée comme telle, de saisir les processus qui font entrer une théorie dans l‟enclos scientifique, ou qui en marquent, au contraire, l‟exclusion. Cette position est gouvernée par une éthique basée sur la notion de symétrie, revendiquée par Latour & Woolgar :
Ou bien il est possible de faire une anthropologie du vrai comme du faux, du scientifique comme du préscientifique, du central comme du périphérique, du présent comme du passé, ou bien il est absolument inutile de s‟adonner à l‟anthropologie qui ne sera toujours qu‟un moyen pervers de mépriser les vaincus tout en donnant l‟illusion de les respecter. (1988 : 21)1
Les pionniers de l‟application de ce type de démarche aux controverses parascientifiques sont sans doute Collins & Pinch (1991). Ils ont notamment étudié les tactiques mises en oeuvre par les parapsychologues pour obtenir la reconnaissance scientifique de leur discipline et des résultats de leurs expériences, ainsi que les tactiques déployées par leurs adversaires pour leur refuser cette reconnaissance. Pour ce faire, ils prennent en compte aussi bien les discussions qui se déroulent sur le “forum constituant” (celui de la théorisation scientifique, de l‟expérimentation, ou des controverses menées au sein de publications spécialisées) que celles qui prennent 1 Il ne s‟agit pas pour autant d‟adopter une position relativiste, qui nierait
l‟existence de différences entre la science et les autres formes de savoir, mais plutôt de définir une approche “relationniste”, qui cherche à expliquer pourquoi certaines théories résistent mieux que d‟autres aux épreuves qu‟elles subissent (cf. Latour 1989 : 323).
Comment analyser… 21
place sur le “forum officieux” (revues populaires ou semi-populaires, “ragots”, manifestations diverses, créations d‟organisations professionnelles, etc.), qui ne sont habituelle-ment pas intégrées à l‟étude du processus d‟élaboration des théories, mais dont Collins & Pinch montrent qu‟elles jouent un rôle fondamental. Ils mettent ainsi en évidence le caractère négocié de la science, et révèlent la façon dont les médias, plus ou moins directement, peuvent affecter l‟issue d‟un débat scientifique (voir aussi Collins & Pinch 1994). Dans un esprit très similaire, Kaufmann (1993) a étudié la controverse autour de l‟“affaire Benveniste” – du nom du chercheur français qui, en 1988, a proposé une théorie dite de la “mémoire de l‟eau”, susceptible de fournir une justification scientifique à l‟homéopathie. Kaufmann a mis en évidence « le rôle joué par la “publicité” faite aux découvertes scientifiques sur la scène médiatique dans le cadre des controverses portant sur des résultats de recherche contestés et / ou hérétiques » (id. : 69). La plupart des travaux cités ci-dessus n‟empruntent guère ou pas du tout aux sciences du langage ; ils ont cependant grandement inspiré l‟approche du débat sur les parasciences adoptée ici. En particulier, prendre comme objet non pas les parasciences, mais le débat médiatique dans lequel elles sont prises, permet de voir comment, au coeur même des discussions, les locuteurs négocient sans cesse la frontière entre ce qui est scientifique et ce qui ne l‟est pas, et cherchent à imposer leur propre définition de la science, des faits, et, finalement, leur rapport à la réalité.
3. LE CORPUS
Diverses manifestations de la polémique sur les parasciences constituent le corpus qui est à la base de ce travail. Ce corpus regroupe principalement des émissions télévisées de plateau consacrées à une ou plusieurs discipline(s) parascientifique(s) : – principalement, débat : « Ciel mon mardi » (TF1), « Duel sur la Cinq » (la 5), « Durand la nuit » (TF1), « Français si vous parliez » (France 3), « Star à la barre » (France 2), « Mardi soir » (France 2), mais aussi : – talk show : « Nulle part ailleurs » (Canal +), « Bas les masques » (France 2) ; – émission scientifique : « Savoir plus » (France 2); « Santé à la une » (TF1) ; – émission littéraire : « Ex Libris » (TF1)
22 Le débat immobile
Il s‟agit au total d‟une trentaine d‟émissions 1, qui ont été enregistrées puis transcrites. Le fait de constituer un corpus à partir d‟émissions télévisées, même s‟il n‟implique pas une révolution méthodologique, n‟est pas non plus encore une démarche routinière tant en analyse de discours qu‟en argumentation ou en pragmatique des interactions conversa-tionnelles. Le caractère médiatique du corpus (et, plus particu-lièrement, ici, son appartenance au genre “débat télévisé”) implique que l‟on prenne certaines précautions descriptives afin de rendre compte de la spécificité de ce type d‟interactions. Lorsqu‟on considère une interaction télévisée (et, en particulier, un débat télévisé), on a coutume de distinguer : – La situation dialogale immédiate, comprenant un premier cercle de participants (ceux qui sont présents sur le plateau, et qui sont susceptibles d‟interagir : les débatteurs, et éventuelle-ment l‟animateur). Cette situation est gérée par un contrat de débat ; elle constitue ce que Nel (1990) appelle l‟espace télévisable. – La situation de communication médiatique, qui instaure un dispositif triangulaire prévoyant d‟une part une interaction symétrique entre les débatteurs, et une communication asymétrique entre ces débatteurs et un deuxième cercle de participants : les récepteurs témoins de l‟échange, c‟est-à-dire l‟ensemble des téléspectateurs. Cette situation de communica-tion médiatique est gérée par un contrat médiatique, et constitue le niveau de l‟espace télévisé. La rupture entre ces deux niveaux est liée à l‟intervention, dans le contrat médiatique, d‟une autre instance, un sujet montrant : le réalisateur, qui met en scène l‟espace du studio et les participants d‟une façon relativement autonome par rapport aux échanges verbaux. Cette mise en scène joue sur des opérations de sélection (choix de tel ou tel participant), de cadrage, de choix des angles, des plans, de synchronisation ou d‟a-synchronisation des images avec la chaîne verbale, etc. Ce cadre global d‟analyse des interactions télévisées étant posé, les éléments dont doit tenir compte l‟analyste dépendent de l‟objectif qu‟il se fixe. S‟il veut étudier l‟effet produit par l‟argumentation développée au cours d‟un débat sur le téléspectateur (c‟est-à-dire s‟il adopte le point de vue du deuxième cercle des participants), il doit nécessairement prendre en compte le “to-texte”, c‟est-à-dire :
1 Voir en annexe la liste des émissions analysées.
Comment analyser… 23
– l‟interaction produite par les interactants du premier cercle, le débat, télévisable mais non télévisé, qui a lieu entre des participants co-présents dans un même espace ; – cette même interaction retravaillée par le réalisateur, qui devient énonciateur à son tour pour produire, à partir d‟un premier “texte” (le débat télévisable), un deuxième texte, le débat télévisé, dont l‟effet sur le téléspectateur est au moins autant le fait de l‟instance énonciative “réalisateur” qui retravaille les argumentations menées par les participants du premier cercle que le fait des argumentations elles-mêmes. Mais l‟analyste peut aussi considérer que le traitement proprement médiatique du débat n‟est pas l‟objet principal du travail qu‟il veut mener. Il peut décider de n‟analyser que les argumentations qui dépendent du premier cercle de participants, en s‟interrogeant sur la façon dont des individus s‟y prennent pour défendre leur position dans le cadre d‟un débat télévisé. C‟est cette seconde position qui a été adoptée ici. Le jeu spécifique de monstration opéré par le réalisateur, qui choisit de souligner tel ou tel aspect du débat qui a lieu sur le plateau à l‟intention des téléspectateurs, et d‟orienter ces derniers vers une lecture partiale de la polémique, n‟a pas été analysé en tant que tel. La priorité a été donnée à la composante verbale du débat, qui elle, est le fait des participants du premier cercle (invités ou animateur). Cette limitation de l‟objet est légitime, à condition que certaines précautions soient respectées : 1. La limitation de l‟objet au débat télévisable interdit à l‟analyste de s‟interroger sur les effets réels produits par le débat sur la conviction des téléspectateurs. Dans les faits, il est parfois difficile de s‟interdire des jugements du type : “l‟argumentation menée par tel locuteur est plus puissante que celle menée par son adversaire”, mais l‟effet de conviction réellement produit sur le téléspectateur dépend, entre autres facteurs, du travail opéré par le réalisateur (Charaudeau 1991) – entre autres seulement, car bien d‟autres facteurs entrent en jeu ; en particulier, il a été maintes fois souligné que l‟opinion préalable du téléspectateur est déterminante. 2. Le paradoxe est que si l‟on veut travailler sur le débat télévisable, le seul matériau dont on dispose est le débat télévisé. L‟analyste, n‟étant pas présent sur le plateau, n‟a pas pu, en plus du dispositif prévu par le réalisateur, placer ses propres caméras et micros afin de rendre compte de l‟interaction de façon aussi neutre et exhaustive que possible. Il est important d‟être conscient de cela, et du fait que le débat télévisable n‟est pas un matériau donné comme tel à l‟analyste, mais qu‟il est le
24 Le débat immobile
résultat d‟une reconstruction, nécessairement incomplète et parfois hasardeuse, à partir du débat télévisé. 3. Cette reconstruction, on l‟a dit, est risquée ; limiter presque exclusivement son objet au verbal réduit d‟autant les risques d‟extrapolation. Mais même avec cette limitation, il faut prendre garde à n‟étudier que des débats transmis en direct ou enregis-trés dans les conditions du direct, c‟est-à-dire sans montage ; sans quoi le débat télévisé ne permet aucunement de se faire une idée de ce qui s‟est réellement passé sur le plateau. 4. Enfin, il faut tenir compte du contrat de communication qui régit les comportements attendus des débatteurs, et qui peut être soit :
– explicité avant l‟émission par des professionnels des médias, qui “briefent” les invités avant le débat en explicitant ce qu‟on attend d‟eux : ne soyez pas trop techniques, n‟abordez pas tel point, n‟oubliez pas que vous êtes invité en tant que témoin, expert...
– implicite mais bien connu des débatteurs : les téléspecta-teurs “ordinaires” ont un savoir souvent assez précis, de par leur expérience de téléspectateur, justement, de ce qui est attendu d‟un invité dans le cadre d‟un type d‟émission donné.
Finalement, l‟analyste doit constamment garder à l‟esprit le fait que, même si l‟interlocuteur direct d‟un débatteur est l‟autre débatteur présent sur le plateau, le véritable destinataire du débat est toujours, et de façon décisive, l‟ensemble des téléspectateurs. En effet, les invités à un débat savent bien entendu qu‟ils vont être filmés et que le débat va faire l‟objet d‟une diffusion télévisée. C‟est bien souvent pour cette seule raison qu‟ils acceptent de débattre : pour défendre leur opinion afin de gagner des téléspectateurs à leur cause (et non, bien sûr, leur adversaire), ou même, parfois, simplement, “pour passer à la télévision” (par une forme de narcissisme médiatique, ou pour des raisons plus pragmatiques : promotion d‟un livre, d‟un film, d‟un festival...). Le fait de considérer que le véritable destinataire du débat télévisable est l‟ensemble des téléspectateurs a des conséquences sur le modèle de description que l‟on adopte. En effet, cela conduit à décrire le dispositif énonciatif du débat télévisé comme un trope communicationnel1, « puisqu‟il comporte deux niveaux de destinataires (la parole est bi-adressée),
1 La généralisation de la notion de trope communicationnel à toute interaction
médiatique peut être dangereuse. Elle peut en effet mener à négliger l‟existence d‟enjeux internes au télévisable dans les débats télévisés : par exemple, une promesse que des manifestants présents sur un plateau cherchent à arracher à
Comment analyser… 25
. l‟un “direct” en apparence – les débatteurs font comme s‟ils ne parlaient qu‟entre eux,
. et l‟autre, celui des auditeurs, en apparence “indirect”, mais qui est en fait le principal » (Kerbrat-Orecchioni 1990 : 95)
Soulignons une dernière fois que le fait de ne s‟intéresser qu‟au débat télévisable ne signifie en aucune façon qu‟on oublie le fait qu‟on a affaire à un débat médiatique, et non à une conversation privée, à destination interne. La conscience, chez les débatteurs, de l‟existence d‟un public auquel ce débat est destiné façonne le discours qu‟ils produisent ; ils essayent de se faire une image de ce public, argumentent en fonction de cette image. En particulier, le caractère structurant de l‟existence d‟un public absent comme destinataire indirect mais principal de l‟argumentation, dans les débats télévisés, apparaît clairement dans les changements de cadre participatif qu‟on peut y observer (Doury 1995). Pour en finir avec la description de l'angle sous lequel va être traité le corpus, le fait que l‟analyse privilégie la composante verbale des débats télévisés, et non leur traitement spécifique par le média “télévision”, autorise à élargir le corpus à des discours d‟autres natures (en particulier, des articles issus de la presse généraliste ou de la presse militante, ou des extraits d‟ouvrages consacrés aux parasciences), ces discours étant considérés comme d‟autres manifestations de la même polémique sur les parasciences. L‟analyse des interactions télévisées (débats) reste prioritaire ; la situation de face-à-face permet de mettre en évidence la dynamique du débat, la fonction argumentative des interventions étant mise en relief par leur contestation immé-diate par l‟adversaire. Dans ce cadre, le recours à des textes écrits sert surtout à étoffer la description de certaines stratégies argumentatives, identifiées d‟abord dans des interactions télévisées, puis éventuellement développées dans des textes polémiques monologaux. Le corpus analysé ici définit donc un objet limité : c‟est bien le débat médiatique sur les parasciences qui sera traité ici, et non le débat sur les parasciences dans toutes ses manifestations : conversations privées, discussions entre instances scientifiques ou administratives pour décider de l‟institutionnalisation de telle ou telle discipline, etc. Cette précision est nécessaire, dans la
une personnalité politique invitée à participer à la discussion. Le fait que le débat soit à destination d‟un public absent est utilisé pour donner du poids à l‟engagement pris par le politique, mais les téléspectateurs ne sont pas les destinataires principaux, pour les manifestants en tout cas.
26 Le débat immobile
mesure où le caractère publique et l‟importance de l‟auditoire visé font sans doute peser sur les débatteurs des contraintes spécifiques dans un cadre médiatique. Il n‟en reste pas moins probable que, pour partie au moins, les arguments mis à jour dans les débats télévisés se retrouvent également dans d‟autres occurrences de la polémique sur les parasciences.
Chapitre 2 : les termes de la
polémique et les acteurs du débat
Dans le cadre d'une étude du débat sur les parasciences, la définition de l‟objet est d‟autant plus cruciale qu‟il ne s‟agit pas simplement d‟établir le concept de parasciences, mais également de peser sa valeur polémique. Il existe un certain nombre de disciplines, théories, doctrines, parfois qualifiées de “parasciences”, “pseudo-sciences” ou “sciences parallèles”. Il ne va pas de soi qu‟elles aient suffisamment de points communs pour qu‟une dénomination commune soit légitime, et que les discussions critiques sur ces disciplines constituent – au moins à un premier niveau – un débat unique. Depuis une dizaine d‟années, toute une série d‟émissions télévisées de type “débat” ont été consacrées à des polémiques sur des disciplines aussi diverses que l‟astrologie, la para-psychologie, la télékinèse, la morphopsychologie, l‟ufologie, l‟instinctothérapie, la numérologie, mais aussi l‟homéopathie, la graphologie, etc. Trois observations permettent de supposer qu‟il s‟agit de manifestations ponctuelles d‟une polémique plus globale : – les termes de “parascience” ou “pseudo-science” (ou les adjectifs qui en dérivent) sont utilisés au moins une fois par les acteurs du débat pour désigner ces disciplines dans leur ensemble, ou une de ces disciplines en particulier ; – il est fréquent, au cours de différentes émissions, de rencontrer plusieurs fois le même débatteur, invité à chaque fois pour défendre, mais plus souvent pour contester, des disciplines différentes. Ceci suggère que, au moins pour le débatteur concerné et pour les professionnels des médias qui l‟ont invité à s‟exprimer, ces débats ponctuels sont des manifestations d‟une même polémique. – enfin, préalablement à l‟analyse systématique de la polémique, une approche même superficielle de ces émissions fait apparaître certaines formes argumentatives récurrentes d‟un débat à l‟autre, même lorsque le thème de discussion (la discipline en question) varie. Avant de chercher une définition globale des parasciences, il est nécessaire de mettre un peu d‟ordre dans la nébuleuse des parasciences, en organisant les disciplines qui la composent.
28 Le débat immobile
1. LES DISCIPLINES PARASCIENTIFIQUES : “MANCIES”, PARANORMAL, MÉDECINES PARALLÈLES
Si l‟on cherche à comprendre comment s‟organise l‟ensemble des disciplines, pratiques ou théories discutées dans le débat sur les parasciences, force est de constater que le dictionnaire n‟est pas d‟un grand secours (Doury 1994 : 18 sqq.), pour deux raisons principales. D‟une part, de nombreux termes, comme “instinctothérapie” ou “dianétique”, n‟y apparaissent pas ; d‟autre part, les définitions qu‟on y trouve ne s‟organisent pas en un champ lexical cohérent, qui permettrait de mieux comprendre ce que ces termes peuvent avoir en commun, ou, au contraire, en quoi ils sont fondamentalement différents. On proposera donc une structuration du champ parascientifique originale, principalement notionnelle, mais qui cherche à rendre compte de fonctionnements argumentatifs spécifiques. Cette structuration du champ des parasciences redistribue les disciplines traitées comme parascientifiques dans le débat selon trois grandes catégories : les “mancies”, le paranormal et les médecines parallèles. – les “mancies”1 Le terme de “mancies” désigne les systèmes d‟interprétation qui, à partir de données observables (visage, main, nombres...), proposent une grille de lecture qui permettrait de tirer des inférences portant soit sur des événements précis, soit sur la personnalité d‟un individu. La composante événementielle des mancies peut porter sur des faits révolus (la mancie est dite rétroactive), ou sur des événe-ments à venir (elle est alors prédictive, et conduit à un pronostic). Les applications rétroactives d‟une mancie sont vérifiables sans délai : elles peuvent donc servir, dans un face à face entre praticien et client, à tester la validité du système d‟interprétation ou à évaluer celui qui la pratique. En revanche, l‟évaluation des applications prédictives est, par définition, toujours différée.
1Le choix d‟utiliser le terme de “mancie”, ordinairement suffixal, et de ne pas se
servir de mots existants (comme “mantiques” ou “arts divinatoires”) cherche à bloquer les connotations qui y sont attachées (particulièrement, le caractère archaïque des disciplines ainsi désignées), et à permettre de définir précisément ce terme, qui ne correspond pas exactement à la définition d‟une mantique ou d‟un art divinatoire.
Les termes de la polémique… 29
La composante caractérologique, visant à établir un diagnostic (révélant des éléments de la personnalité) est largement exploitée par les cabinets de recrutement, qui utilisent diverses mancies pour analyser les “profils” des différents candidats et ainsi guider le choix de l‟employeur. Dans la définition des mancies, l‟existence d‟une technique, d‟un système d‟interprétation qui guide les prédictions ou le diagnostic caractérologique, est fondamentale. Cela n‟empêche pas les praticiens des mancies de revendiquer parfois un don ou une intuition particulièrement développée ; mais on considérera que la technique est première. Du point de vue de l‟implanta-tion socio-économique des mancies, l‟existence d‟une technique suppose la possibilité d‟un apprentissage : d‟où une profusion de séminaires et de manuels mettant la mancie à la portée de chacun. Quant aux argumentations auxquelles elles peuvent donner lieu, les techniques qui sous-tendent les mancies sont avant tout légitimées par un critère d‟efficacité. Les défenseurs des mancies affirment : “aussi étonnant que ça puisse paraître, ça marche” (et même, “ça devine”). La controverse sur le versant événementiel des mancies va donc se centrer sur l‟étude des prédictions et sur l‟évaluation des échecs et réussites. Les acteurs du débat semblent rencontrer plus de difficultés pour évaluer le versant caractérologique (et le passent d‟ailleurs souvent sous silence), les critères d‟appréciation de l‟exactitude d‟un “portrait psychologique” étant plus difficiles à établir. Les discussions portent alors essentiellement sur la légitimité ou non de l‟application des mancies au domaine du recrutement. – Le paranormal Alors que les mancies sont caractérisées par l‟existence d‟une technique, le paranormal, lui, se définit avant tout par des phénomènes. Ces phénomènes peuvent être de natures très variées, mais présenteraient tous un caractère commun : celui, justement, d‟être “para-normaux” ou “extra-ordinaires” – c‟est-à-dire de n‟être pas explicables par les théories scienti-fiques (et, particulièrement, physiques ou chimiques) existantes. Le champ du paranormal est donc vaste, et mérite qu‟on y établisse de nouvelles partitions. Les partisans du paranormal distinguent deux cas : – Les phénomènes se produiraient de façon autonome, sans que leur apparition soit maîtrisable par un individu : apparitions d‟ovnis, manifestations d‟“esprits” dans les “maisons hantées”, objets qui se déplacent eux-mêmes, production de bruits sans source identifiable, etc. Ces phénomènes font l‟objet
30 Le débat immobile
de récits par des témoins. Les témoignages comportent quantité de procédés de crédibilisation, d‟autant plus cruciaux que le récit est le seul moyen d‟attester des faits, puisque ceux-ci ne sont pas reproductibles à volonté. – Les phénomènes pourraient aussi dépendre d‟un individu ; dans ce cas, ils seraient produits volontairement ou non. Ainsi, la psychokinésie (ou télékinésie) est définie comme le fait de déplacer volontairement un objet par la force de sa pensée ; mais certains voyants affirment que des images s‟imposent à eux, sans qu‟ils n‟aient cherché à “voir” quoi que ce soit. Lorsqu‟un individu est à l‟origine de la production de phénomènes paranormaux, les parapsychologues considèrent qu‟il est détenteur d‟un don, d‟une faculté particulière : il est “sujet psi” ou “médium”. Un tel don, par définition, ne pourrait s‟apprendre : il serait propre à l‟individu, ou transmis de façon héréditaire. Le domaine du paranormal se caractérise par le rôle fondamen-tal qu‟y jouent les récits (témoignages ou comptes-rendus d‟expérimentations pour les phénomènes susceptibles d‟être reproduits), qui cherchent à fonder l‟existence des faits para-normaux. C‟est essentiellement sur ce point (établissement ou non du phénomène) que se focalise la controverse sur le para-normal. Alors que pour les mancies, le débat tourne autour de l‟affirmation “ça marche”, dans le domaine du paranormal, l‟assertion discutée est “ça existe” (et, dans certains cas, “ça m‟est arrivé”). – Les médecines parallèles Enfin, la troisième composante de la nébuleuse des parasciences est l‟ensemble des médecines parallèles.1 Cette composante n‟est elle-même pas homogène (même si elle se caractérise, semble-t-il, par un rejet plus ou moins fort de la médecine dite “officielle”), mais, contrairement au domaine du paranormal ou des mancies, elle a fait l‟objet de nombreuses tentatives de classifications. En particulier, les pratiques médicales parallèles sont souvent opposées selon qu‟elles sont exercées ou non par un médecin. On trouve cette distinction notamment chez Legrand & Prayez – qui parlent, eux, de “médecines différentes” ou “autres médecines” : 1 Au vu des réactions hostiles que suscite souvent l‟intégration des médecines
parallèles (et, particulièrement, de l‟homéopathie) à une étude du débat sur les parasciences, anticipons sur les lignes à venir et précisons qu‟il ne s‟agit en aucun cas d‟un jugement de non-scientificité des thérapeutiques en question : sont traitées, dans cet ouvrage, toutes les disciplines dont le statut est régulièrement discuté dans le cadre du débat sur les parasciences.
Les termes de la polémique… 31
À notre sens, les médecines différentes relèvent d‟une opposition dialectique entre deux types de praticiens : le soignant exerçant dans le cadre de la médecine légale d‟une part, le thérapeute-guérisseur (illégal) d‟autre part. Le premier fonde sa légitimité sur la loi et se réfère à cette dernière dans son exercice. Le second bénéficie d‟une position charismatique qui repose sur la reconnaissance par des patients, disciples ou adeptes, de la qualité extra-ordinaire (hors de l‟ordinaire, hors du commun) d‟une personne et de sa valeur exemplaire. (1986 : 16-17)
Ainsi, les médecines parallèles chevauchent le domaine des mancies (puisqu‟elles reposent sur une technique, un corps de savoir) et celui du paranormal (puisqu‟elles supposent parfois l‟existence d‟un don). Dos Santos propose, lui, d‟opposer les médecines populaires ou traditionnelles (pratiquées en milieu rural, prodiguant des soins de façon ponctuelle, à tradition orale et à évolution lente) aux médecines parallèles ou savantes (pratiquées en milieu urbain, modernes, à caractère savant et professionnalisé, reposant sur un système qui revendique une certaine cohérence) (1986 : 26-28). Le débat sur les médecines parallèles se concentre principale-ment sur la question de leur efficacité, comme pour les mancies : l‟assertion en discussion est donc, encore une fois, “ça marche”, ou, plus précisément, “ça guérit”. Mais la discussion passe principalement, comme pour le paranormal, par le recours à des témoignages attestant de guérisons (ou, plus rarement, d‟échecs) à la suite de traitements par des thérapeu-tiques parallèles, ou à diverses expériences établissant, selon un protocole scientifique, leur efficacité ou leur inefficacité. La structuration du champ des parasciences en mancies, paranormal et “médecines parallèles” est résumée dans le tableau page suivante. Parmi les disciplines parascientifiques, certaines sont plus prototypiques que d‟autres. Ainsi, l‟astrologie semble être la mancie par excellence : elle en réunit toutes les caractéristiques, et c‟est certainement celle qui est la mieux représentée dans le débat. En revanche, la psychanalyse, qui apparaît parfois dans le débat sur les parasciences, est un élément relativement périphé-rique des médecines parallèles, et n‟est mise en cause que très rarement dans le débat : si elle apparaît dans Les Dossiers du Canard (juin 1990, « Le Grand bazar du bizarre ») aux côtés de la graphologie, des gourous d'entreprise ou de la voyance, en revanche, lors de l‟émission « Savoir plus » du 01/03/1993, le psychanalyste Gérard Miller est invité comme adversaire des parasciences, et non comme représentant d‟une discipline parascientifique.
Mancies Paranormal Médecines parallèles
Un système d‟interprétation. Théories basées sur la constitution d‟un observable considéré comme un système de signes à interpréter selon une grille de lecture donnée, pour en tirer des déductions de type prédictif (portant sur des événements à venir) ou caractérologique (permettant de révéler la personnalité de l‟individu). Le plus souvent, se situent dans une tradition.
Exemples : astrologie, morphopsycho-logie, chirologie, numérologie...
Coeur de la controverse :
ça marche ? Discussion de l‟efficacité généralement orientée sur les prédictions, par l‟énumération de réussites ou d‟échecs.
Des phénomènes dont la science, en son état actuel, ne peut pas rendre compte de façon satisfaisante. Ils peuvent dépendre d‟un sujet, qui les produit volontairement ou non, ou se produire de façon spontanée ; parfois, des disciplines se sont constituées pour en rendre compte.
Exemples de phénomènes : tables qui tournent, objets qui se déplacent sans contact physique, transmission de pensée, apparitions d‟ovnis...
Exemples de disciplines traitant de ces phénomènes : spiritisme, parapsychologie, ufologie, radiesthésie...
Coeur de la controverse : ça existe ? Discussion sur la valeur des témoigna-ges qui attestent de l‟existence des phénomènes spontanés, des expériences qui testent le pouvoir d‟un sujet.
Des thérapeutiques non orthodoxes, non reconnues comme des spécialités par l‟institution médicale universitaire, et qui se séparent en médecines “savantes”, pratiquées par des médecins, et médecines populaires ou traditionnelles, qui supposent le plus souvent l‟existence d‟un don.
Exemples : homéopathie, acupuncture, auriculothérapie, aromathérapie, instinctothérapie, dianétique...
Coeur de la controverse : ça guérit ? Justification curative ; argumentation basée sur des témoignages attestant de thérapies réussies ou ratées (importance du pathos) ou sur des comptes-rendus d‟expériences en laboratoire, selon des protocoles plus ou moins proches de ceux habituellement utilisés pour tester les médecines “classiques”.
Les termes de la polémique… 33
Cette réorganisation des disciplines parascientifiques permet d‟y voir un peu plus clair dans ce qui apparaît au départ comme une nébuleuse hétéroclite, et donne quelques indications sur les fonctionnements argumentatifs spécifiques de chacune des trois catégories de parasciences dans un contexte polémique. Mais elle présente, bien sûr, des difficultés. En particulier, la voyance, une des disciplines parascientifiques le plus souvent discutées à la télévision, est à cheval sur les mancies et le paranormal. Elle s‟apparente aux mancies par le fait qu‟elle permettrait d‟établir des prédictions ; aussi se trouve-t-elle, dans le dictionnaire, dans le même champ lexical que l‟astrologie. Elle peut donc, comme les mancies, faire l‟objet d‟argumentations basées sur l‟invoca-tion de prédictions exactes ou erronées. Mais elle repose avant tout et sans équivoque sur l‟affirmation de l‟existence d‟un don chez le voyant, d‟une faculté extrasensorielle qui lui permettrait d‟avoir connaissance d‟informations par des moyens extraordi-naires ; c‟est pourquoi elle apparaît ici dans le champ du paranormal. De même, certaines mancies (notamment l‟astrologie) entrent dans le champ des médecines parallèles, dans la mesure où elles sont parfois utilisées pour diagnostiquer des maladies.
Quoi qu‟il en soit, la distinction entre ces trois paradigmes parascientifiques rend plus intelligible le champ des parasciences, et constitue une première étape, d‟une définition par extension, vers une définition en compréhension
2. “PARASCIENCES”, “PSEUDO-SCIENCES”, “SCIENCES PARALLÈLES”
Dans la polémique médiatique sur les parasciences, les trois termes de parasciences, pseudo-sciences ou sciences parallèles sont utilisés pour désigner les mêmes disciplines. Lorsqu‟on cherche à les définir autrement que par énumération, la première constatation qui s‟impose est qu‟aucun des trois n‟apparaît dans le dictionnaire.1 Il s‟agit donc encore de créations non lexicalisées (ou partiellement lexicalisées), qui sont toutes forgées sur le morphème de base “science”. De telles constructions lexicales suggèrent d‟emblée que les domaines du savoir ou de l‟expérience ainsi désignés entretien-nent un rapport privilégié à la science, se définissent par rapport à elle. L‟étude lexicale des éléments “para”, “pseudo-” et “parallèles” peut permettre de préciser la nature de ce lien.
1 A l‟exception du terme “pseudoscience”, admis par la dernière édition du Petit
Larousse illustré, et défini comme un “savoir organisé qui n‟a pas la rigueur d‟une science”.
34 Le débat immobile
2.1. “para”, “pseudo”, “parallèle”
Le Petit Robert définit para- de la façon suivante : Para- : 1) Élément, du grec para, « à côté de ». 2) Élément, tiré de mots empruntés (parasol, paravent) qui exprime l‟idée de « protection contre ».
On peut exclure que le sens 2) soit manifesté dans le terme parasciences. Même si certains acteurs de la polémique considèrent les parasciences comme une protestation contre une certaine forme de science, jugée dangereuse (intellectuellement, philosophiquement ou matériellement), définir les parasciences comme une protection contre la science ne peut être que métaphorique. Quant au sens 1), s‟il suggère que les parasciences, étant « à côté de » la science, ne sont pas dedans – et pose donc une certaine altérité entre la science et les parasciences –, il ne permet pas de préciser la nature de cette relation1. Si l‟on considère les différents termes formés à partir du préfixe para-, on peut préciser certaines de ses acceptions : – para- peut introduire l‟idée de fausseté. On trouve ainsi :
PARACHRONISME : Erreur de chronologie qui consiste à placer un événement plus tard qu‟il ne faudrait.
PARALOGISME : Faux raisonnement fait de bonne foi (opposé à sophisme). V. Erreur, non-sens.
Si le caractère intentionnel ou non de la “faute” n‟est pas spécifié pour parachronisme, en revanche, le paralogisme est une faute non intentionnelle, une erreur, et non une tromperie. – para- peut introduire aussi l‟idée d‟incompatibilité. Ainsi, un
paradoxe est défini comme : PARADOXE : 1) Opinion qui va à l‟encontre de l‟opinion communément admise. 2) Être, chose, fait qui heurte le bon sens
1 Dans le même ordre d‟idée, Edgar Morin, cherchant à caractériser la revue
Planète, propose le préfixe péri- (du grec peri, « autour ») comme alternative à para- :
Planète n‟est évidemment pas une revue scientifique (c‟est-à-dire de recherches) ni une revue de vulgarisation scientifique (bien qu‟elle vulgarise partiellement) : c‟est une revue péri-scientifique, para-scientifique. (Cité par Jean-Claude Pecker, Problèmes politiques et sociaux 450-451 (“Le débat sur les phénomènes paranormaux ou : quelles voies vers la connaissance ?”), 1982 : 30).
Les termes de la polémique… 35
– l‟altérité dénotée par para- peut découler d‟un jugement social :
PARALITTERATURE : Ensemble des productions textuelles sans finalité utilitaire et que la société ne considère pas comme de la « littérature » (roman, presse populaires ; chanson, scénario et texte des romans-photos, bandes dessinées, etc.).
On notera que l‟adjonction de para- à littérature, en dehors d‟un jugement d‟altérité, comporte parfois un jugement négatif (on parle aussi de “sous-littérature”). – Enfin, para- peut impliquer l‟idée de non appartenance à une
institution : PARAMEDICAL : Qui se consacre aux soins, au traitement des malades, sans appartenir au corps médical.
Chacune de ces acceptions peut être activée dans le terme parasciences ; c‟est ce que montrera plus loin l‟analyse des définitions (non linguistiques) qui en sont parfois proposées. Pour désigner les parasciences, le préfixe para- peut apparaître seul : ainsi Robert Joly1 emploie systématiquement l‟expression « la para ». Enfin, à côté du substantif parasciences apparaît aussi l‟adjectif parascientifique. On l‟a dit, le préfixe para- peut alterner avec le préfixe pseudo-, dont Le Petit Robert donne la définition suivante :
PSEUD(O)- : Élément du gr. pseudês « menteur » (V. Faux) → FAUX, 1, I, 3° : Qui évoque mais qui n‟est pas ce qu‟on le nomme (Faux s‟emploie devant un grand nombre de noms de choses pour marquer une désignation impropre ou approximative). V. Pseudo-. Faux acacia, fausse oronge (...)
Le renvoi à faux rend compte d‟acceptions comme :
PSEUDARTHROSE : Méd. Fausse articulation formée au niveau d‟une fracture mal consolidée
ou PSEUDONYME : Qui écrit sous un faux nom,
mais l‟étymologie (« menteur ») suggère que pseudo- s‟oppose au para- de paralogisme par l‟intention qu‟il suppose. De plus, la distance à la science qu‟instaurent ces préfixes est plus grande pour pseudo- que pour para- ; c‟est en tout cas l‟avis du physicien Henri Broch, adversaire des parasciences, qui, au
1 Robert Joly, « La Parapsychologie, imposture ou illusion », in Hervé Hasquin
(éd.), Magie, sorcellerie, parapyschologie, Bruxelles : Editions de l‟Université de Bruxelles, 1984, p.201-213.
36 Le débat immobile
cours de l‟émission « Savoir plus », justifie sa préférence pour le terme pseudo-sciences : HB : je pense que manifestement toutes ces pseudo-sciences plutôt que
parasciences je pense qu‟il vaut mieux utiliser le terme pseudo-sciences pour bien montrer que ça n‟en est pas
(« Savoir plus » du 01/03/1993, France 2)1
Ainsi, pour Henri Broch, les préfixes para- et pseudo- s‟organi-sent sur une échelle argumentative qui va du plus proche d‟une éventuelle scientificité au plus incompatible avec l‟idée de science. On trouve la même gradation de para- et pseudo- dans la bouche de Florence Mavic, auteur d‟un reportage sur les parasciences. Répondant aux questions du présentateur (P) de l‟émission, elle assimile les parasciences à des “presque sciences” : P : j'imagine que ça n‟a pas été toujours évident d‟amener tous ces
gens à témoigner devant la caméra FM : mmm (.) effectivement alors ça dépendait des sujets (.) euh
l‟astrologie le magnétisme les techniques de recrutement comme la morphopsychologie (.) ça les gens acceptent d‟en parler sans trop de réticences (.) parce que ces domaines ont acquis un statut quasi-scientifique (.) on les range dans la rubrique euh des parasciences (.) par contre quand il s‟est agi de d‟aborder la voyance (.) là on a senti un un malaise un blocage
(« Envoyé spécial » du 14/10/1993, France 2)
Pseudo- entre aussi bien dans la composition du substantif pseudo-science que de l‟adjectif pseudo-scientifique. Enfin, l‟adjectif parallèle (qui entre dans l‟expression “sciences parallèles”) admet, entre autres, les acceptions suivantes :
PARALLELE : I. 1) Se dit de lignes, de surfaces qui, en géométrie euclidienne, ne se rencontrent pas. II. Fig. 1) Qui suit la même direction, se développe dans la même direction. (...) Qui a lieu en même temps, porte sur le même objet. Marché, cours parallèle. (...) Police parallèle.
En toute logique, on retrouve ici des sens similaires à para- ; mais le fait que ce soit l‟adjectif parallèle qui soit accolé au mot science plutôt que l‟élément préfixal introduit des implications
1 Le type de transcription adopté cherche à faciliter la lecture des corpus, sans
pour autant trahir le caractère oral des discours analysés. Les pauses, généralement très brèves (elles se limitent souvent à une reprise de souffle) sont notées par (.). Le point d'interrogation signale une phrase énoncée avec une intonation interrogative. Une succession de XXXX note un passage incompréhensible. Le signe [...] informe qu'un passage n'a pas été transcrit. Les chevauchements sont introduits par le signe [ précédant les deux fragments de discours simultanés. Les caractères gras, sauf indication contraire, sont de mon fait, et isolent les passages sur lesquels porte l‟analyse.
Les termes de la polémique… 37
sémantiques qu‟il ne faut pas négliger. Alors que parasciences et pseudo-sciences suggèrent que le référent est “autre chose” que de la science, l‟expression “sciences parallèles” implique qu‟il s‟agit bien, justement, de sciences ; mais parallèles à quoi ? Comme le “marché parallèle” ou la “police parallèle”, les sciences ainsi qualifiées sont parallèles à ce qui est officiel – donc à “LA Science”, unique et avec une majuscule, vue comme une institution. Au terme de cette analyse, une observation s‟impose : alors que le syntagme nominal singulier “la science” permet de désigner l‟ensemble des sciences particulières (physique, géologie, biologie...), le singulier “la parascience” n‟apparaît presque jamais pour désigner l‟ensemble des disciplines dites parascien-tifiques. Cette opposition entre une science singulière et des parasciences plurielles peut servir des argumentations visant à disqualifier les parasciences, présentées comme un ensemble de pratiques hétéroclites face à “LA Science” unitaire et universelle. Mais elle peut aussi témoigner du fait que le terme “parasciences” relève d‟une stratégie argumentative élaborée par l‟un des camps en présence, stratégie qui permet d‟englober sous un même terme des réalités très hétérogènes, et dont on peut dire, pour aller vite, qu‟elles pourraient bien n‟avoir en commun que leurs détracteurs (voir chapitre 5).
2.2. La (non) scientificité des parasciences
En dehors des dictionnaires, alors que les termes de parasciences et pseudo-sciences apparaissent relativement fréquemment dans le débat, il est rare qu‟ils y fassent l‟objet d‟une définition précise ; leur sens semble “aller de soi”. Mais lorsque de telles définitions existent, elles permettent d‟explici-ter des contenus jusque là implicites, puisqu‟ils apparaissaient comme des présupposés inhérents au choix des termes. Ainsi, la non scientificité des para- ou pseudo-sciences, implicite dans le choix des termes eux-mêmes, est posée par de très nombreuses définitions “hors dictionnaire”. C‟est le cas, on peut s‟y attendre, pour des locuteurs fortement impliqués dans le débat du côté des adversaires des parasciences. Pour Isaac Asimov par exemple,
Une spéculation infantile ou inutilisable, basée sur l‟ignorance, est un exemple de “pseudo-science”. “Pseudo” vient du grec et signifie “faux” ou “décevant”. La pseudo-science est une fausse science ; c‟est un tissu d‟absurdité qui peut fourvoyer le profane parce qu‟il a l‟apparence de la science, qu‟il utilise la langue scientifique, qu‟il traite de sujets scientifiques, et surtout parce
38 Le débat immobile
qu‟il se proclame lui-même scientifique (Les Moissons de l‟intelligence, Bordeaux : L‟Horizon chimérique, 1990 : 184-185).
Le caractère polémique de cette définition n‟a rien d‟étonnant si l‟on sait qu‟Isaac Asimov est un rationaliste convaincu qui, aux États-Unis, a fait partie du CSICOP (comité américain pour l‟investigation scientifique des allégations de phénomènes para-normaux, qui s‟attache à “démolir” les faits présentés comme paranormaux), et qu‟il a collaboré régulièrement à la revue de ce comité, le Skeptical Inquirer. Ainsi, cette définition, par son contenu, mais aussi par l‟identité de son auteur, constitue elle-même un élément du débat. De même, Alain Cuniot, farouche adversaire des parasciences, très présent dans les débats télévisés sur le sujet, les accuse d‟« éloigner les esprits de l‟attitude scientifique », et affirme :
Il s‟agit en fait d‟anti-sciences qui se camouflent en adoptant certains mots utilisés par la science ou en évoquant certains faits mis en évidence par elle. (Incroyable mais… faux !, Bordeaux : L‟Horizon chimérique, 1989 : 17)
La définition suivante assied définitivement le caractère stéréo-typé des définitions polémiques des parasciences ; on la doit à Cornelis de Jager :
Pseudoscience defends or promotes proven uncorrect or unsubstantiated statements by dishonesty, be it sometimes in good faith, advancing them (latin : pro-statuere) by means of quasi scientific terminology, suggesting that the results are scientifically sound. That is our reason for claiming that pseudoscience prostitutes science. (« The Prostitution of science : pseudoscience », in Colloque pour la science - Actes du colloque des 3 et 4 décembre 1991, Paris : Fondation EDF : 120-126)
On ne sera pas indifférent à l‟argumentation par l‟étymologie menée ici, qui soutient la thèse explicitée dès le titre de l‟article et reprise dans le corps du texte : « pseudoscience prostitutes science ». Le point commun de ces définitions est que, posant assez violemment la non scientificité des parasciences, loin de constituer des définitions préalables à l‟analyse du débat sur les parasciences, elles y entrent au contraire de plain-pied. Si ce fait n‟a rien de bien surprenant venant de rationalistes militants, il est en revanche plus surprenant de retrouver ce même postulat de non scientificité chez des auteurs qui se proposent non plus d‟évaluer les parasciences, mais de décrire le phénomène social qu‟elles représentent et de mesurer l‟adhésion qu‟elles suscitent. Ainsi, Françoise Askevis-Leherpeux affirme que la propriété commune aux parasciences se réduit « à leur absence de fondement scientifique et à leur irrationalité (...) de sorte qu‟elles correspondent à un mode de
Les termes de la polémique… 39
pensée incompatible avec le raisonnement scientifique » (« Croyance au surnaturel et instruction. Examen critique de l‟hypothèse intellectualiste », Communications 52, 1990 : 161-162). Même chez des auteurs comme Daniel Boy & Guy Michelat, qui sont à l‟origine des principales données statistiques sur la croyance des Français aux parasciences, on retrouve ce postulat d‟altérité, selon lequel les systèmes parascientifiques se situeraient non plus en opposition avec la science et la technique, mais « quelque part ailleurs, en marge, dans une autre dimension » (« Qui y croit ? », Autrement 85, 1986 : 97). La fréquence de ce postulat de non scientificité dans la définition des termes de parasciences et pseudo-sciences soulève inévitablement deux questions, que l‟analyste, lui même aux prises avec la redoutable tâche de définition des parasciences, ne peut esquiver : est-il exact que les disciplines désignées comme parascientifiques ne sont pas scientifiques ? Est-il pertinent, dans le cadre de l‟analyse argumentative d‟une polémique, de chercher à définir les parasciences en termes de scientificité ou de non scientificité ? Chercher à se prononcer sur la scientificité des parasciences est à coup sûr une tâche difficile, et sans doute hors de nos compétences. Par ailleurs, on est bien obligé de constater que les discussions sur ce sujet n‟ont en aucun cas pour effet de faire taire les controverses, ni de plonger dans le néant les théories ainsi passées au crible de la science. Les adversaires des parasciences en rejettent généralement la faute sur les médias, accusés de faire la part belle à ces disciplines, et de ne jamais faire écho de leur invalidation. Il se pourrait en fait que le problème soit lié avant tout à l‟incapacité des acteurs du débat à se mettre d‟accord sur ce qu‟il faut entendre par “science”. Dans cette hypothèse, poser d‟emblée la non scientificité des parasciences risquerait d‟empêcher l‟analyste de voir les incessantes négociations auxquelles se livrent les débatteurs afin de déterminer ce qu‟il convient d‟admettre comme critère de scientificité. De plus, dans les débats qui sont analysés ici, on trouve, par exemple, autant d‟astrologues défendant le caractère scientifique de l‟astrologie que d‟astrologues affirmant pratiquer un art, une technique, mais pas une science. Faudrait-il alors considérer l‟astrologie des premiers comme une parascience, mais pas celle des seconds ? Il est sans doute plus prudent (et plus pertinent) de ne pas se prononcer sur la (non)scientificité des parasciences, et de considérer, au contraire, qu‟il s‟agit d‟un des principaux enjeux du débat.
40 Le débat immobile
2.3. Autres définitions des parasciences
Il existe d‟autres définitions des parasciences qui, elles, ne reposent pas sur ce postulat de non scientificité – ou du moins, pas fondamentalement. Certains auteurs ont essayé d‟unifier le champ hétérogène des parasciences en recourant à la notion d‟occultisme (Morin 1981, Chevalier 1986). De telles défini-tions suggèrent d‟emblée le caractère archaïque du référent : dès qu‟on parle de magie ou d‟occultisme, on pense à des formes de pensée primitive, à coup sûr non scientifique – et on en revient à poser d‟entrée la non scientificité des parasciences. De plus, il est bien difficile de discerner quelque parenté que ce soit entre l‟occultisme et certaines disciplines, comme l‟instinc-tothérapie ou la dianétique, qui sont pourtant désignées par leurs adversaires comme des parasciences. Faut-il considérer qu‟il ne s‟agit pas de parasciences ? Comment expliquer alors qu‟elles rencontrent les mêmes adversaires que, par exemple, l‟astrologie et la parapsychologie, et que leurs opposants aussi bien que leurs partisans adoptent les mêmes stratégies argumen-tatives que les acteurs du débat sur les parasciences ? S‟il est légitime d‟utiliser la clé de l‟occultisme pour comprendre le fonctionnement de certaines disciplines parascientifiques, une définition des parasciences basée sur cette notion ne permet pas de rendre compte de l‟ensemble des théories qui sont en discussion dans ce qui semble pourtant former un débat unique. En relation avec ce postulat de parenté entre parasciences et occultisme, on a parfois tenté de définir les parasciences comme des versions archaïques des sciences, comme des “protosciences”. Un représentant de cette position est Lévy-Leblond, qui estime que
[La science] a relégué les autres formes de connaissance, rationnelles ou non, dans le passé historique ou dans la marge institutionnelle : l‟alchimie ou l‟astrologie ne peuvent plus être considérées que, hier comme préscientifiques, ancêtres de la chimie et de l‟astronomie, aujourd‟hui comme parascientifiques, cousines occultes des sciences reconnues. (1984b : 87)
Mais pour d‟autres, il n‟y a pas de continuité entre la science et les parasciences, mais bel et bien une rupture profonde. Ainsi, Peter, à l‟idée de parasciences comme “protosciences”, répond :
Mais l‟alchimie n‟était en rien une chimie adolescente. Si quelque chose se tient entre l‟une et l‟autre, cela ressemble bien plutôt à un fossé profond : celui qui sépare une science sacrée de l‟expérimentation profane. Et la chimie comme science exacte n‟est née que de la ruine de l‟idéologie alchimiste. De même pour
Les termes de la polémique… 41
les thérapies non médicales. Il y a entre elles et la médecine une distance incommensurable, que ne réduit en rien la facilité de certains malades (nombreux d‟ailleurs) de passer de l‟une à l‟autre. (1992 : 227)
Même si l‟on admet une relation de filiation entre certaines parasciences et certaines sciences, une telle définition ne nous dit rien sur leurs relations actuelles. Enfin, son application à des théories parascientifiques apparues récemment pose problème : de quelle ancienne discipline l‟instinctothérapie serait-elle l‟avatar moderne ? Enfin, certaines définitions mettent en avant la situation institu-tionnelle des parasciences. Chevalier illustre cette position, en affirmant :
La notion de parascience recouvre un ensemble composite de pratiques et de doctrines rejetées par les confessions dominantes et la science officielle. Intimement apparentées à l‟occultisme par leurs fonctionnements logiques et leur vision du monde, elles ne s‟en distinguent que par la revendication d‟un statut de science et la recherche d‟une légitimité par la science. (1986 : 205)
Si on laisse de côté la référence à l‟occultisme, déjà évoquée, le choix de l‟absence de reconnaissance institutionnelle des parasciences comme critère définitoire présente l‟avantage d‟être (généralement) admis aussi bien par leurs partisans que par leurs opposants. Mais il présente, une fois de plus, de nombreux inconvénients. Il existe en effet de nombreuses parasciences qui sont en voie d‟institutionnalisation. Il s‟agit, pour la plupart, de disciplines appartenant aux médecines dites “douces”. Ainsi, l‟homéopathie et l‟acupuncture, dès le début des années quatre-vingt, ont été intégrées à des cursus universi-taires sous forme d‟attestations ou de certificats dans certaines facultés de médecine comme à Marseille, Bordeaux, Lille, Besançon, Bobigny ou Lyon1. En 1983, la conférence des Doyens a débouché sur un rapport interne dit “rapport Mornex”, selon lequel il conviendrait de donner aux médecines parallèles une formation universitaire susceptible de déboucher sur un diplôme universellement reconnu (cf. Groupe de réflexion “médecines différentes”, 1986 : 25).
1 Mais l‟institutionnalisation de ces thérapeutiques n‟est en tout cas pas achevée.
Pour résumer la situation, il existe soit des diplômes officiels (universitaires) mais non nationaux (délivrés par une faculté de médecine donnée, mais pas reconnus à l‟échelle nationale), soit des diplômes nationaux, mais délivrés par des organismes non officiels (non universitaires). Ainsi, il n‟est toujours pas possible pour un médecin de se spécialiser en homéopathie au cours de son internat, comme il pourrait se spécialiser en rééducation fonctionnelle ou en pédiatrie (Elzière 1986 : 54-55).
42 Le débat immobile
Outre les exemples de semi-institutionnalisation empruntés aux médecines douces, on peut relever, entre autres, l‟existence d‟un “laboratoire de parapsychologie” à l‟université de Toulouse- Le Mirail, dirigé par Yves Lignon (laboratoire dont le caractère officiel fait l‟objet de controverses répétées, qui témoignent de l‟importance de l‟enjeu). Le degré d‟institutionnalisation ne varie pas seulement d‟une discipline à l‟autre, mais, au sein d‟une même discipline, d‟un pays à l‟autre. Ainsi, la graphologie a acquis en France un statut quasi-officiel. Si aucun diplôme universitaire n‟est délivré, il existe un diplôme de niveau II (bac + 3) qui est délivré par le Ministère du Travail. Pourtant, aux États-Unis, au Japon et dans la plupart des pays d‟Europe, la graphologie n‟est ni reconnue, ni utilisée. Finalement, une définition des parasciences basée sur leur reconnaissance institutionnelle ne permet pas de rendre compte du caractère graduel de ce processus. Par ailleurs, il est un peu rapide de poser que toutes les parasciences recherchent une légitimation par la science ; et pour une même discipline, les positions ne sont pas toujours clairement définies. Ainsi, la numérologue Nicole Laury, dans le « Duel sur la Cinq » du 11/08/1988, définit sa discipline comme une science, alors que le numérologue Jean-Daniel Fermier, lors de l‟émission « Savoir Plus » du 01/03/1993, affirme ne pas exercer une science, mais un art. De même, si l‟astrologue Élisabeth Teissier a choisi d‟intituler un de ses ouvrages L‟astrologie, science du XXIe siècle, sa consoeur Joëlle de Gravelaine affirme que « l‟astrologie ne doit avoir aucune prétention au titre de science » (citée dans Les dossiers du Canard, juin 1990 : 9). Une fois encore, que faut-il faire ? Considérer qu‟elles n‟exercent pas la même discipline, ou considérer que la revendication d‟un statut de science n‟est pas un critère définitoire des parasciences ?
2.4. Toute dénomination commune est nécessairement polémique
À l‟issue de cet inventaire critique des définitions possibles des parasciences, aucune ne paraît pleinement satisfaisante. La cause de cet échec est sans doute à chercher dans l‟utilisation même d‟un terme unique pour désigner des réalités si hétérogènes. Si le découpage du champ des parasciences en “paranormal”, “mancies”, “médecines parallèles” peut déjà sembler réducteur, que penser de l‟utilisation de la dénomination
Les termes de la polémique… 43
commune de “parasciences” pour désigner des disciplines, phénomènes ou thérapeutiques dont la structuration que l‟on a proposée cherche à reconnaître les différences ? Outre le caractère polémique du signifiant même (qui, on l‟a vu, pose la non scientificité du référent), le regroupement qu‟il opère est argumentatif. Il n‟est en effet jamais le fait de ceux qui défendent telle ou telle parascience, qui revendiquent au contraire la spécificité de leur discipline, et dénoncent comme un amalgame l‟utilisation d‟un même terme pour désigner toutes les parasciences. En revanche, on le trouve systématiquement chez les adversaires des parasciences, qui y voient un moyen commode de désigner ce qu‟ils considèrent comme l‟ennemi. C‟est ce qui apparaît très clairement dans ce texte de Jean-Claude Pecker (qui introduit le numéro de Problèmes politiques et sociaux consacré au débat sur les phénomènes paranormaux), et qui, finalement, justifie le regroupement de réalités très hétérogènes en soulignant que toutes exploitent (selon lui) un fléau qu‟il faut combattre, la crédulité :
Ce dossier comporte plusieurs parties, qui, à première vue, pourront sembler assez différentes les unes des autres : qu‟on y trouve à la fois les problèmes posés par les OVNI et ceux que soulève la discussion de la Gnose de Princeton, ou du Colloque de Cordoue, peut en effet paraître étrange ; et il apparaîtra même, aux défenseurs de tel ou tel corps de doctrine, comme un amalgame ayant pour but évident d‟assimiler les plus dignes d‟entre ces opposants aux courants officiels de la science à de misérables escrocs et de simples naïfs. Il nous semble pourtant essentiel de mettre en évidence les liens entre ces différents courants de pensée paranormale plus ou moins élaborée. (...) Ce n‟est pas un hasard si les tenants de la parapsychologie remettent en vogue les tables tournantes, et si certains de ceux qui s‟intéressent aux OVNI évoquent à ce sujet des mécanismes paranormaux et des types d‟interactions inconnus en physique classique (...) ; ce n‟est pas un hasard si les médiums doués de pouvoirs psi les exercent dans le domaine de la radiesthésie ou dans celui de la psychokinèse plutôt que dans la recherche scientifique (...). Ce qui fait cette unité, ce n‟est pas (comme l‟allégueront certains) l‟unité des pouvoirs psi, c‟est beaucoup plus clairement, à mon avis, la permanence de la crédulité des hommes en face du bizarre, et c‟est par l‟étude de cette crédulité que nous commencerons donc notre dossier. (Problèmes…: 4)
Ainsi, c‟est le débat lui-même qui justifie la pertinence du terme : “parasciences” n‟a de sens que par rapport au jugement que l‟un des camps porte sur les disciplines ainsi désignées. Hors controverse, le terme de “parasciences” ne signifie rien ; dans le débat, il désigne un ensemble de théories ou champs d‟investigation qui ont des adversaires communs. Sans doute Alain Cuniot illustre-t-il au mieux cette polyvalence de certains adversaires des parasciences. Dans son ouvrage
44 Le débat immobile
Incroyable mais faux, il s‟attaque successivement à l‟astrologie, à la voyance, la numérologie, la morphopsychologie, la para-psychologie et l‟instinctothérapie. Il apparaît dans le « Duel sur la Cinq » consacré à la dianétique (18/05/1988), ainsi que dans celui sur la sorcellerie (mai 1990) ou sur la transcommunication (01/10/1990) ; il apparaît encore dans l‟émission « Ex Libris » du 01/10/1990, où il s‟oppose à la voyante Maud Kristen. De même, Henri Broch, dans ses différents ouvrages, examine le dossier de l‟astrologie, de l‟ “archéologie fantastique”, des médecines “magiques” (acupuncture, homéopathie, guérisseurs philippins), de la parapsychologie (télépathie, psychokinèse, etc.), de la radiesthésie, de l‟ufologie, et même de la thaumaturgie. Polyvalente encore, la revue Science et pseudo-sciences. Cahiers de l‟AFIS, diffusée par l‟Union Rationaliste, dirigée par Michel Rouzé, et qui dénonce un large éventail de théories parascientifiques (des ovnis à l‟homéopathie en passant par l‟astrologie, la psychokinèse, etc.). Il reste encore à justifier l‟utilisation du terme de “parasciences” dans cet ouvrage. On a voulu éviter l‟utilisation systématique de guillemets, afin de ne pas alourdir la lecture. Rappelons pourtant qu‟il ne s‟agit en aucun cas ici de trancher sur le caractère scientifique ou non des disciplines ainsi désignées : le lecteur est donc invité à restituer des guillemets virtuels à chaque occurrence des termes “parasciences” et “parascientifique”, afin de bloquer le présupposé de non scientificité qui y est associé. Le terme de “parasciences” constitue simplement ici un raccourci commode pour désigner “les théories qualifiées de parascientifiques par leurs adversaires dans le débat”.
3. LE DÉBAT SUR LES PARASCIENCES : ACTEURS ET SUPPORTS
Il est temps à présent de s‟intéresser à la polémique sur les parasciences proprement dite, et d‟en donner quelques caractéristiques.
3.1. Les partis en présence
Les partisans des parasciences Parmi les partisans des parasciences, beaucoup sont des parascientifiques professionnels, qui gagnent leur vie en exerçant une parascience. Il s‟agit généralement d‟individus exerçant une mancie, de voyants ou de praticiens d‟une médecine parallèle. Parmi ces parascientifiques professionnels, on peut distinguer quelques figures de proue, qui apparaissent
Les termes de la polémique… 45
de façon récurrente particulièrement dans les débats télévisés. Le plus présent d‟entre eux est la jeune voyante Maud Kristen, co-fondatrice d‟une association visant à réglementer les pratiques des voyants, invitée à 3 émissions-débat du corpus, et sujet de 3 reportages. D‟autres défenseurs des parasciences participent moins souvent à des débats publics, mais disposent d‟une émission télévisée ou radiophonique qui en fait des personnages médiatiques importants et leur assure une notoriété remarquable ; c‟est le cas par exemple du voyant Didier Derlich, qui a longtemps assuré une émission de voyance sur RTL, ainsi qu‟une séquence “voyance” dans l‟émission de variété « Sacrée soirée » (TF1), et qui était responsable d‟une rubrique dans le magazine Télépoche (et qui apparaît comme invité lors d‟une émission du corpus). C‟est le cas encore de Mérédith Duquesne, qui était alors astrologue sur Europe 1 (et qui est invitée à participer à un débat sur l‟application de l‟astrologie au domaine médical), ou de l‟astrologue Élisabeth Teissier, qui assure la rubrique “horoscope” dans l‟hebdomadaire Télé 7 jours (magazine le plus vendu en France), et qui est mentionnée dans la plupart des dossiers consacrés par la presse à l‟astrologie ou à la voyance (jusqu‟à faire la couverture du magazine économique Challenge en janvier 1994). Dans le domaine du paranormal – à l‟exception des voyants – rares sont ceux qui gagnent leur vie grâce aux parasciences, à part quelques sujets psi, qui affirment détenir un don et l‟exercent professionnellement (c‟est le cas notamment de certains radiesthésistes et de quelques spirites). La plupart des partisans du paranormal intervenant dans le débat sont soit de simples témoins qui racontent leur expérience, soit des théoriciens, scientifiques ou non, qui cherchent à étudier et expliquer les phénomènes. Les premiers sont parfois totalement inconnus du grand public : c‟est exclusivement comme témoins d‟un événement paranormal qu‟ils sont invités à parler. Mais il peut aussi s‟agir de personnalités plus connues : ainsi Paul-Loup Sulitzer vient-il témoigner en faveur de la voyance lors d‟un débat télévisé. Enfin, le second type de défenseurs du paranormal peut être illustré par des personnages comme Rémy Chauvin ou Yves Lignon, qui ne gagnent pas leur vie grâce au paranormal (l‟un étant professeur d‟éthologie à la retraite et l‟autre, enseignant en mathématiques à l‟université de Toulouse-Le Mirail), mais qui consacrent une partie de leur temps à l‟étude des phénomènes paranormaux, et apparaissent très régulièrement dans les émissions qui y sont consacrées.
46 Le débat immobile
Les adversaires des parasciences Le camp des adversaires des parasciences est, en revanche beaucoup plus “éclaté”, beaucoup plus difficile à définir, sans doute parce que les motivations qui les poussent à s‟opposer aux parasciences sont plus floues que celles des partisans de ces disciplines. On peut distinguer, dans ce camp également, divers types de “résistants”. Petrossian (1981b) rappelle que l‟Église catholique s‟oppose généralement aux parasciences. L‟Avertissement contre l‟astrologie de Jean Calvin (Avertissement contre l‟astrologie. Traité des reliques, Paris : Armand Colin, <1962>) est une bonne illustration de l‟utilisation d‟arguments religieux contre une parascience. Mais ce courant est relativement peu représenté dans le débat. Une partie non négligeable des adversaires des parasciences se recrute au sein de la communauté scientifique. Ainsi, des débats télévisés voient l‟astronome Dominique Ballereau s‟opposer à l‟astrologie, le gastro-entérologue Jean-Pierre Bader à l‟instinc-tothérapie, ou encore le généticien Albert Jacquard à la morphopsychologie. Dans les exemples précédents, le débatteur scientifique se spécialise dans la dénonciation d‟une parascience particulière, en relation plus ou moins étroite avec sa propre spécialité. Il arrive aussi que des scientifiques opposés aux parasciences dénoncent conjointement diverses parasciences, sans que le lien avec leur propre domaine de compétence soit évident : c‟est le cas par exemple de Henri Broch, professeur de physique à l‟université de Nice, et qui est, on l‟a vu, relativement polyvalent dans le débat, puisqu‟il s‟oppose à un assez large éventail de parasciences. Les autres adversaires des parasciences ne sont donc pas scientifiques. Ils peuvent être, à nouveau, inconnus du grand public : c‟est le cas par exemple de Alain Cuniot, affilié au Parti Communiste1, ancien militant syndicaliste, puis comédien, metteur en scène de théâtre et réalisateur de cinéma, président de l‟association “science et illusions” qu‟il a créée, et qui a pour but de dénoncer les parasciences. C‟est lui qui apparaît le plus
1 Si je signale cette appartenance politique, c‟est qu‟elle n‟est sans doute pas sans
relation avec l‟activité d‟Alain Cuniot dans le débat. Comme le souligne Pétrossian,
Le républicanisme laïque, le socialisme, le communisme marxiste (qui se veut scientifique) sont allergiques à l‟astrologie. (...) Partout où l‟on trouve une doctrine fortement structurée, un noyau idéologique, et surtout où cette doctrine se fonde sur le rationalisme et sur la science, il y a résistance à l‟astrologie. (1981 : 120)
Les termes de la polémique… 47
fréquemment dans les manifestations télévisées du débat sur les parasciences entre 1988 et 1990 (on le rencontre dans neuf des émissions du corpus). Plus récemment, il semble avoir été supplanté par Henri Broch, qui est de plus en plus souvent invité afin de tenir le rôle du sceptique. Les adversaires non scientifiques des parasciences se recrutent aussi parmi des “célébrités” de plus ou moins grande envergure, de Cavanna à Philippe Bouvard, en passant par l‟illusionniste Gérard Majax (qui, comme Broch ou Cuniot, est un adversaire polyvalent des parasciences). Enfin, certaines organisations jouent un rôle dans le débat autour des parasciences. La première est bien entendu l‟Union Rationaliste, qui a été fondée en 1930, et qui compte parmi ses fondateurs un grand nombre d‟intellectuels français ralliés au Parti Communiste. Selon le dépliant distribué (en 1994) par l‟Union Rationaliste elle-même,
Elle lutte avant tout pour la liberté et l‟égalité des droits de tous. Parmi ses objectifs, elle se propose d‟agir : – pour permettre au citoyen d‟acquérir la plénitude de son pouvoir politique, – contre l‟exclusion et l‟isolement de l‟individu dans un monde urbain inhumain, – pour que l‟État demeure laïque, assume véritablement sa fonction de protection des jeunes contre toute forme d‟endoctrinement, et donne à l‟école publique indépendance et prestige, – contre toutes les formes de l‟irrationnel, anciennes ou nouvelles, et leur emprise inquiétante sur les média.
Son président actuel est l‟astrophysicien Evry Schatzman, et son vice-président, Yves Galifret, professeur de neurophysiologie, qui s‟oppose au mage Dessuart dans le « Duel sur la Cinq » sur la voyance. Également engagée dans la lutte contre les parasciences, l‟AFIS (Association Française pour l‟Information Scientifique) a été fondée par Michel Rouzé, longtemps journaliste scientifique dans la presse communiste et à Science & Vie, et rédacteur en chef d‟une petite revue à diffusion très confidentielle (Science et pseudo-science. Cahiers bimestriels de l‟Association Française pour l‟Information Scientifique). Elle s‟attache beaucoup plus à la réfutation des parasciences qu‟à la vulgarisation scientifique au sens classique du terme. Il faut enfin souligner le rôle joué par la revue Science & Vie dans le débat. Cette revue, essentiellement consacrée à la vulgarisation scientifique, publie régulièrement, dans une rubrique “blurgs”, des articles dénonçant diverses parasciences (de l‟astrologie à la graphologie en passant par les apparitions d‟ovnis). Par ailleurs, elle a joué un rôle important dans une
48 Le débat immobile
polémique périphérique par rapport au débat sur les parasciences, mais dont certains aspects seront analysés ici : “l‟affaire Benveniste”. Finalement, le camp des adversaires des parasciences fonctionne en partie comme un réseau, les individus qui le composent étant souvent liés par des relations plus ou moins étroites. Ainsi, le physicien Henri Broch est responsable de la collection “zététique” de la maison d‟édition L‟Horizon chimérique, où est paru le livre d‟Alain Cuniot (Incroyable…). Par ailleurs, il figure parmi les membres du conseil de l‟AFIS, aux côtés de Yves Galifret, secrétaire de l‟Union Rationaliste (association domiciliée à la même adresse que l‟AFIS). Henri Broch, toujours, est responsable d‟un service télématique (36 15 code ZET) qui propose un défi, lancé par Broch et l‟illusionniste Gérard Majax à toute personne qui pourrait faire la preuve de pouvoirs paranormaux. Enfin, Science & vie publie des articles “anti-parascientifiques” de Michel Rouzé, de Henri Broch ou même de Gérald Messadié, rédacteur en chef adjoint de la revue, et qui apparaît aux côtés de Henri Broch dans l‟émission « Nulle part ailleurs » du 30/09/1993. Quelles que soient les différences qui les opposent, les adversaires des parasciences sont tous unis par un militantisme “anti-parascientifique” qui se présente comme une lutte contre la crédulité, et pour la préservation de l‟esprit critique. Ainsi, Hubert Curien, alors ministre de la Recherche et de la Technologie, ouvrant un colloque sur les parasciences en février 1993, insistait sur le rôle des enseignants dans la lutte contre ces disciplines, afin d‟éviter de « former de nouvelles générations de crédules »1. De même, Henri Broch demande qu‟au droit de rêver soit associé « le devoir de vigilance », et affirme que les parasciences contribuent à « amollir l‟esprit critique, le sens du réel, c‟est-à-dire [à] affermir une conception magique du monde »2, et Alain Cuniot voit dans les parasciences un attentat contre « l‟intégrité de l‟intelligence » (Incroyable... : 26). Certains vont jusqu‟à expliciter les implications politiques de la lutte contre les parasciences, qu‟Henri Broch présente comme une condition nécessaire pour qu‟un individu puisse exercer pleinement son rôle de citoyen3. Déjà, Eco, dans un article consacré à la « mystique de Planète », suggérait que le vice caché de cette revue était qu‟à force d‟affirmer que tout est
1Ouverture du colloque de la Villette, 24-25 février 1993, in La Pensée
scientifique et les parasciences, Paris : Albin Michel, 1993, p.19. 2 Le Paranormal - ses documents, ses hommes, ses méthodes, Paris : Seuil, 1989,
p.205. 3 Au coeur de l‟extra-ordinaire, Bordeaux : L‟Horizon chimérique, 1991, p.327.
Les termes de la polémique… 49
possible, elle constituait une « invitation à la contemplation passive », et devenait ainsi une « dangereuse université du poujadisme métaphysique » (1985 : 124). À sa suite, Albert Jacquard suggère que la complaisance des pouvoirs publics envers les parasciences serait un moyen d‟endormir les citoyens :
Transformer les citoyens en moutons soumis est le rêve de bien des pouvoirs. Pour y parvenir les moyens sont nombreux ; les intoxiquer de para-sciences peut être fort efficace. Il n‟est que temps de réagir. (Préface à A. Cuniot, Incroyable…: 21)
Ainsi, aussi diverses que soient les origines des adversaires des parasciences, le camp “anti-parascientifique” trouve son unité dans une démarche proprement militante, reposant sur une conception du rôle de la réflexion critique dans une démocratie ; cette conception est très proche de l‟idée d‟argumentation comme garant de la démocratie qu‟on trouve dans de nombreux travaux anglo-saxons sur l‟argumentation.1
3.2. Les supports du débat
Les supports dont disposent les acteurs de la controverse pour exprimer leurs positions sont divers, puisqu‟il peut s‟agir aussi bien de supports écrits (livres et revues), que de supports audio-visuels (et, principalement, télévisés).
Les supports écrits Considérons dans un premier temps les partisans des parasciences, et particulièrement, les parascientifiques profes-sionnels. Ceux-ci disposent, pour faire connaître leurs théories, de nombreuses maisons d‟édition spécialisées – ou de collections spécialisées dans des maisons d‟édition “généralistes” – qui publient quantité d‟ouvrages parascienti-fiques : Acropole, Éditions du Rocher (collections “L‟Âge du verseau”, “La Pierre philosophale”), Dangles (collections “santé naturelle”, “la science de l‟être”, “médicale et para-médicale”, “horizons spirituels”, “horizons ésotériques”), Éditions Jacques Grancher (collections “ABC”, “horoscope”), Éditions Guy Trédaniel... À côté des maisons d‟édition existe aussi une presse spécialisée aux titres extrêmement nombreux et aux tirages non négligeables. Ainsi, Le Monde Inconnu tirait à
1 Il est intéressant de signaler que de nombreux ouvrages d‟argumentation anglo-
saxons empruntent l‟essentiel de leurs exemples de paralogismes à des argumentations, fictives ou authentiques, visant à établir des parasciences (voir en particulier Blackburn 1992).
50 Le débat immobile
35 000 exemplaires, Astres et Quel avenir madame à 150 000 exemplaires, Mystères et Autre Monde, à 100 000 exemplaires.1 Enfin, bon nombre de périodiques “généralistes” ont leur rubrique “astrologie” : parmi eux, Télé 7 jours, Télépoche, mais aussi Elle ou Marie-Claire. Les adversaires des parasciences, s‟ils peuvent aussi exprimer leur position dans des ouvrages ou des articles, ne disposent pas, eux, d‟un réseau de diffusion aussi spécialisé et développé, et leur poids économique est moindre. À part la collection “zététique” de l‟Horizon chimérique et les Éditions rationalistes, il n‟existe pas, à ma connaissance, de maison d‟édition spécialisée dans la dénonciation des parasciences. Quant aux revues, le moins qu‟on puisse dire est que leur diffusion est limitée : Sciences et parasciences (la revue de l‟AFIS) n‟est disponible que sur abonnement ; quant à Raison présente ou Les cahiers rationalistes, leur diffusion n‟est guère meilleure... Ce n‟est que lorsque les adversaires des parasciences sont invités à s‟exprimer dans une presse plus généraliste qu‟ils ont une chance de toucher un public plus large – d‟où l‟importance du rôle joué par Science & Vie (et, plus ponctuellement, par d‟autres revues de vulgarisation scientifique, comme La Recherche, Nature, Science ou Science & avenir), qui publie régulièrement des articles contre les parasciences, ou par certains hebdomadaires, qui consacrent ponctuellement des articles ou des dossiers entiers au paranormal, aux mancies ou aux parasciences en général.
Le débat à la télévision En dehors des supports écrits, la télévision est largement ouverte aux acteurs du débat sur les parasciences. Dans ce domaine, une fois encore, les partisans des parasciences sont largement privilégiés, dans la mesure où ils disposent parfois de rubriques régulières dans des émissions de grande écoute. En 1989, l‟émission « Matin bonheur » (Antenne 2) proposait une “météo Astrale” (horoscope), ainsi qu‟un “Astro bébé” (thème astral d‟un nourrisson), et consacrait tous les lundi huit minutes de plateau à “l‟étrange” ; dans le même temps, le « Club Dorothée » (TF1) a reçu Madame Soleil entre septembre
1 À titre de comparaison, une revue de vulgarisation scientifique comme Science
et vie diffuse à 400 000 exemplaires, Science et Avenir à 300 000, La Recherche à 115 000. Signalons par ailleurs que les revues parascientifiques ont une durée de vie fort limitée : parmi les magazines mentionnés plus haut, au moins trois ont disparu aujourd'hui (Le Monde Inconnu, Mystères et Autre Monde).
Les termes de la polémique… 51
1988 et avril 1989 (L‟Événement du jeudi, 26 octobre - 1er novembre 1989 : 83). Par ailleurs, il arrive fréquemment que des émissions leur soient consacrées sans que leurs adversaires ne soient invités à s‟exprimer (c‟est le cas en particulier dans les différents numéros de l‟émission « Ex Libris » consacrés au sujet, ou, bien entendu, de l‟émission « Mystères », aujourd‟hui disparue des écrans, consacrée à l‟ “actualité mystérieuse”, qui ne donnait presque jamais la parole aux membres du camp “anti”). Mentionnons enfin l‟importance des programmes parascientifiques à la radio ; en dehors de l‟émission de Didier Derlich sur RTL, de l‟horoscope de Mérédith Duquesne sur Europe 1 ou de Cécile Saurin sur RMC, sur le réseau local de Radio-France, les deux-tiers des stations offrent des prévisions astrologiques1. En revanche, les adversaires des parasciences ne sont jamais invités à s‟exprimer sur le sujet en dehors de la présence d‟un représentant du camp des partisans de ces disciplines (à l‟exception de l‟émission « Nulle part ailleurs » du 30/09/1993) ; de plus, ils sont en général très largement en minorité.
1 Ces chiffres datent de 1989, mais il semble peu probable qu‟ils aient été révisés
à la baisse depuis (L‟Evénement du jeudi, 26 octobre - 1er novembre 1989 : 84).
Chapitre 3 : Faiblesse constitutive de
la position de l’opposant
Dès qu‟un débat sort du domaine privé pour se dérouler dans l‟arène publique, les différents médias (chaînes de télévision, revues, quotidiens, radios...) décident de critères définissant un droit à la parole, et permettant de sélectionner les individus qui seront invités à s‟exprimer sur un sujet donné, éliminant par là même d‟autres invités potentiels, qui sont rejetés au sein de la masse anonyme et muette, mais destinataire des discours média-tisés : l‟ensemble des téléspectateurs, lecteurs ou auditeurs. Dans le cas des débats télévisés, on peut distinguer (au moins) quatre critères ouvrant le droit à la parole, et, partant, quatre types d'invités : – les experts, qui parlent en vertu d'une compétence qu'on leur reconnaît et qu'on leur demande d'exercer ; – les représentants, qui se font l'écho, officiellement ou non, d'un individu ou d'un groupe ; – les témoins, qui relatent un événement auquel ils ont eu un accès privilégié ; – les “stars”, dont la notoriété suffit à légitimer leur participation à tout événement médiatique. Le critère décidant du droit à la parole varie selon les émissions et les sujets discutés. Dans le débat sur les parasciences, témoins et stars interviennent régulièrement ; la légitimité de leur discours ne semble pas faire problème, et ne fait jamais l‟objet de contestation. En revanche, le critère qui y fonde le plus souvent le droit à la parole des locuteurs est celui de la compétence, et les longues négociations auxquelles il donne lieu le désigne comme un des enjeux importants du débat. Les chapitres 3 et 4 décrivent les stratégies discursives dévelop-pées par les acteurs du débat sur les parasciences afin de manifester une compétence légitimant leur parole. Le chapitre 3 montre en quoi le thème des débats télévisés consacrés aux parasciences favorise fondamentalement les partisans de ces disciplines, et les amène à contester le droit à la parole de leurs adversaires. Le chapitre 4 décrit les séquences de vulgarisation qui apparaissent dans le débat, et suggère qu‟elles peuvent avoir une fonction dans la polémique.
54 Le débat immobile
1. TERRITOIRES CONVERSATIONNELS ET CONTRÔLE DU THÈME
Les débats télévisés analysés ici ont tous pour thème une parascience particulière : l‟astrologie, la parapsychologie, la voyance..., ce thème étant problématisé par l‟alternative “pour ou contre”. Les débatteurs invités au titre de défenseurs de la parascience en discussion en ont parfois une connaissance théorique, et sont quelquefois auteurs d‟ouvrages sur le sujet. Ils en ont aussi presque toujours une connaissance pratique, dans la mesure où ils l‟exercent professionnellement : c‟est une numé-rologue qui est invitée à plaider pour la numérologie (« Duel » du 11/08/1988), c‟est le fondateur de l‟instinctothérapie qui est constitué comme défenseur de cette thérapeutique (« Duel » du 15/06/1988), etc. C‟est donc leur compétence dans le domaine en question qui légitime leur droit à la parole. Si le groupe des défenseurs révèle ainsi une forte cohérence, il n‟en est pas de même, une fois de plus, pour celui des débatteurs dont la fonction est de s‟opposer à ces parasciences. Comme chaque fois qu‟une position est définie négativement, l‟ensemble des personnes susceptibles de l‟occuper est flou. On peut distinguer deux catégories d‟opposants aux parasciences dans les débats télévisés. La première est constituée de scientifiques dont le domaine de compétence est en rapport avec la parascience en discussion. Le débatteur bénéficie alors d‟une légitimité que l‟on pourrait qualifier de statutaire (liée au prestige conféré par son appartenance à la communauté scientifique), doublée d‟une légitimité thématique (la discipline dans laquelle il exerce d‟ordinaire son expertise a une certaine proximité avec le thème du débat). Ainsi, c‟est un astronome qui est invité à se prononcer sur l‟astrologie (« Duel » du 10/06/1988), et un gastro-entérologue sur l‟instinctothérapie (« Duel » du 15/06/1988). Quant à la deuxième catégorie d‟invités opposés aux parasciences, représentée par Alain Cuniot, Cavanna, Gérard Majax ou Philippe Bouvard, elle est caractérisée par le fait que les débatteurs qui y appartiennent ne peuvent se prévaloir d‟aucune compétence particulière dans leur lutte contre les parasciences – sinon, on le verra, d‟un certain esprit critique, caractéristique de l‟« honnête homme ». Dans le cas d‟Alain Cuniot, l‟absence de compétence spécifique est à l‟origine de sa polyvalence : il est invité pour parler aussi bien de la vie après la mort et de la transcommunication que de la parapsychologie ou de la diané-tique. D‟une certaine façon, on peut dire que ce n‟est que parce qu‟il est opposé aux parasciences qu‟il est invité à participer au débat – alors que les débatteurs invités pour soutenir les para-
Faiblesse constitutive… 55
sciences le sont comme partisans, mais aussi comme spécialistes de ces disciplines. Cette asymétrie est bien sûr lourde de conséquences pour le déroulement des débats. En effet, tout locuteur dispose « d‟un domaine de compétence qui lui est propre, et sur lequel il peut en principe exercer seul son droit de parole » (Kerbrat-Orecchioni 1984 : 226). Il existe ainsi des ensembles thématiques qui définissent des territoires conversationnels privilégiés, qu‟un locuteur peut considérer comme son domaine réservé. Dans le cadre de la polémique sur les parasciences, il est clair que le thème du débat relève beaucoup plus naturellement du territoire conversationnel – ou, plus spécifiquement, du territoire argumentatif – des partisans des parasciences que de celui de leurs opposants. La maîtrise du thème joue parfois un rôle décisif dans l‟instauration de rapports de place entre interactants :
La nature elle-même du thème joue un certain rôle taxémique en ce sens qu‟un thème donné peut être plutôt favorable à L1 ou à L2, dans la mesure où il le “concerne” plus, où il relève davantage de son “territoire” conversationnel, de ses centres d‟intérêt, de son domaine de compétence : si un thème est introduit sur lequel L1 manifeste une évidente supériorité de savoirs, cela va lui garantir en principe une certaine maîtrise de l‟interaction. (Kerbrat-Orecchioni 1992 : 92)
L‟asymétrie du statut des locuteurs par rapport au thème du débat est clairement favorable aux partisans des parasciences, qui apparaissent comme spécialistes du domaine en question, au détriment de leurs adversaires, dont il est plus difficile de dire à quel titre ils parlent. Ce déséquilibre taxémique lié au thème se double souvent d‟un déséquilibre numérique, qui se reflète dans la composition des plateaux des émissions qui abordent le sujet : les invités “naturels” semblent être presque systématiquement les partisans des parasciences, les adversaires étant absents ou très faiblement représentés. C‟est ce qui ressort par exemple de l‟émission « Santé à la une » consacrée à l‟application de l‟astrologie au domaine de la santé (04/01/1993) : face à un plateau d‟adeptes de l‟astrologie se trouve un seul représentant de la position adverse, un psychiatre opposé tant à l‟astrologie qu‟à son exploitation thérapeutique. Les exemples, en fait, sont innombrables : la supériorité numérique des partisans des parasciences dans les débats télévisés opposant plus de deux invités est la norme. Devant ce double handicap, il ne reste plus aux adversaires des parasciences qu‟à chercher à renverser le rapport de place en jouant sur d‟autres composantes de la relation verticale.
56 Le débat immobile
Les manifestations discursives de l‟asymétrie des deux camps varient au cours des interactions. Lors de la séquence de présen-tation, le présentateur-animateur cherche le plus souvent à équi-librer les statuts des invités, en explicitant le titre auquel chacun des débatteurs prend la parole. Mais cette légitimation de départ est presque toujours renégociée en cours d‟interaction, et n‟empêche aucunement la contestation du droit à la parole de l‟adversaire.
2. SÉQUENCE DE PRÉSENTATION : UNE ASYMÉTRIE DE DÉPART1
Traditionnellement, dans les débats télévisés, le rituel de l‟émis-sion est pris en charge par l‟animateur. Les séquences d‟ouverture de « Duel sur la Cinq » comportent essentiellement l‟annonce du thème du débat, la présentation des invités, et l‟attribution de la parole à l‟un ou l‟autre des invités. Si, dans la conversation quotidienne, les présentations ont pour fonction d‟« accréditer de nouveaux participants, c‟est-à-dire de les faire passer dans la classe des interlocuteurs autorisés » (André-Larouchebouvy 1984 : 77), le dispositif complexe propre au débat télévisé nécessite une redéfinition de leur fonction. En effet, les débatteurs se sont engagés préalablement à interagir en acceptant de participer au débat : ils constituent déjà l‟un pour l‟autre des interlocuteurs autorisés. En fait, les présentations des débatteurs permettent d‟informer le téléspectateur de l‟identité de ceux qui parlent, mais de préciser aussi à quel titre ils parlent : les présentations comportent divers éléments d‟information jugés pertinents par rapport aux locuteurs en présence, au type d‟interaction à venir et au sujet du débat. Dans « Duel sur la Cinq », les débatteurs sont présentés par la mention de leur statut, de leur profession ou de leur position argumentative. La séquence d‟ouverture de l‟émission comprend généralement l‟annonce du thème sous la forme canonique : « aujourd‟hui Duel sur la Cinq sur... », suivie d‟une question qui explicite la controverse :
1 L‟analyse des présentations porte essentiellement sur des « Duels sur la Cinq ».
En effet, cette émission n‟invite à s‟exprimer que deux débatteurs, qui font l‟objet de présentations systématiques et très ritualisées en début d‟émission, alors que les émissions à débatteurs multiples échelonnent les présentations au rythme des prises de parole, et les réduisent souvent à leur plus simple expression.
Faiblesse constitutive… 57
JCB : aujourd'hui Duel sur la Cinq euh à propos de l'astrologie (.) alors faut-il croire (.) à l'astrologie l'astrologie est-elle une vraie ou une fausse science
(« Duel sur la Cinq » du 10/06/1988, la 5)
De la sorte, dès le départ, le thème du débat est situé sur le territoire conversationnel des spécialistes de parasciences (ici, des astrologues), mais sa problématisation (la question rhétorique, selon les termes de Plantin, qui oriente la controverse) légitime la présence des adversaires de ces disciplines comme représentants de la branche “contre” de l‟alternative. Suit la présentation des participants, qui explicite le rôle défini pour chaque invité par ce que Charaudeau appelle le contrat de communication de l‟émission (1991 : 12).
2.1. Présentation des partisans des parasciences
Dans chaque « Duel sur la Cinq », le premier débatteur évoqué est le partisan des parasciences. Cette règle de préséance reflète le fait que les partisans des parasciences sont en quelque sorte les pivots de la polémique, la position des adversaires des parasciences étant difficile à définir autrement que négativement. Le défenseur des parasciences est toujours présenté en relation avec une pratique ou une profession, et éventuellement la parution d‟un ouvrage dont il est l‟auteur : JCB : pour en débattre (.) Élisabeth Teissier (.) qui est astrologue (.)
bien connue (.) auteur de L‟astrologie, science du vingt-et-unième siècle (.) aux éditions numéro un
(« Duel sur la Cinq » du 10/06/1988, la 5)
C‟est donc en tant que professionnel de la parascience en question (et donc par rapport à une compétence pratique) que ces invités vont s‟exprimer : ce titre ne leur est jamais contesté par leurs adversaires. Il arrive que les invités favorables aux parasciences bénéficient d‟une double légitimation, comme spécialistes ou praticiens, et comme scientifiques : JCB : pour en débattre Guy-Claude Burger qui est physicien à ma
droite c‟est le monsieur aux cheveux longs (.) fondateur de l‟instinctothérapie
(« Duel sur la Cinq » du 15/06/1988, la 5)
JCB : pour en débattre Claude (.) Boublil médecin généraliste et dianéticien
(« Duel sur la Cinq » du 18/05/1988, la 5)
Cette double légitimation des partisans des parasciences, qui renforce la légitimation thématique (dont ils bénéficient toujours) d‟une légitimation statutaire, rencontre une opposition
58 Le débat immobile
fréquente chez les adversaires des parasciences : les titres attribués, dans la séquence de présentation, au partisan des parasciences sont régulièrement l‟objet de contestations. À cet égard, le cas du parapsychologue Yves Lignon est exemplaire, puisque son statut scientifique est mis en cause dans plusieurs émissions, et donne lieu, systématiquement, à de longues négociations. C‟est le cas lors du « Duel sur la Cinq » consacré à la parapsychologie, ainsi que lors de l‟émission « Durand la nuit » du 11/05/1993. La même contestation apparaît également loin des plateaux de télévision : lors du colloque sur “La pensée scientifique, les citoyens et les para-sciences” au centre des Congrès de La Villette en février 1993 s‟est élevée la même polémique sur le titre exact de Yves Lignon et le caractère officiel ou non de son laboratoire de parapsychologie à l‟Université Toulouse-Le Mirail. Plus généralement, la discussion sur les titres affichés par les partisans des parasciences est souvent mise en relation avec le souci de crédibilité et de légitimation qu‟on leur prête. De nombreux auteurs opposés aux parasciences présentent cette démarche comme illégitime, et accusent les partisans des parasciences d‟usurpation. Ainsi, Robert Joly, évoquant le Manuel expérimental de parapsychologie de Jean et Christine Dierkens, y dénonce la multiplication des titres :
Les parapsychologues font volontiers l‟article. Dans le Manuel, il n‟est guère de spécialiste nommé sans que son nom ne soit précédé d‟un “Professeur” ou d‟un “Docteur” avec majuscule. On est toujours en toge dans la para. Mais cette incantation rituelle tient plus du milieu des fakirs que de celui des savants. (« La parapsychologie…» : 206)
Il est clair que la mise en avant des titres de “professeur” ou de “docteur” révèle un enjeu du débat sur les parasciences, à savoir la recherche, par certaines disciplines, d‟une reconnaissance institutionnelle. Comme le dit Chevalier,
Le déploiement d‟un écran de légitimité témoigne d‟une inquiétude du statut qui hante les parasciences. (1986 : 212)
Mais il serait faux d‟y voir une caractéristique du discours des parasciences : il est intéressant de noter que, dans le corpus, le titre de “professeur” apparaît de la façon la plus récurrente dans l‟émission « Nulle part ailleurs » du 30/09/1993 (22 occurrences), et qu‟il est associé non pas à un parascientifique, mais à Henri Broch, adversaire des parasciences (qui, pourtant, n‟était pas professeur au sens strict à cette date, mais maître de conférence à l‟université de Nice). En fait, la dénonciation de l‟utilisation, par les partisans des parasciences, de titres de “docteur” ou de “professeur” va de pair avec deux autres critiques :
Faiblesse constitutive… 59
– l‟une, contestant l‟authenticité de ces titres (c‟est le cas pour Yves Lignon) ; – l‟autre, dénonçant l‟objectif visé par ceux qui brandissent de tels titres : une intention de tromper le destinataire, et de bénéficier illégitimement de l‟autorité scientifique. Enfin, il ne faut pas négliger le fait que l‟évocation des titres des différents invités peut aussi témoigner du souci de l‟animateur de crédibiliser son émission à travers la crédibilisation de ses invités. Ce souci amène parfois l‟animateur à prêter à un invité des titres qu‟il ne détient pas, et qu‟il refuse. C‟est ce qui se passe par exemple dans l‟émission « Ex Libris » où la présentation de Christine Hardy par Patrick Poivre d‟Arvor donne lieu à l‟échange suivant : PPDA : alors elle est avec nous (.) là là aussi 1il ne s‟agit pas d‟une
demoiselle farfelue elle est (.) euh (.) on ne peut plus diplômée elle est diplômée de l‟université de Princeton aux États aux États Unis
CH : non pardon [excusez-moi PPDA : [non vous avez étudié là-[bas CH : [j‟ai étudié là-bas [absolument PPDA :[voilà et vous avez obtenu ensuite votre doctorat d‟État de
parapsychologie donc vous êtes passionnée par ces par ces sujets (« Ex Libris » du 08/03/1990, TF1)
L‟auto-rectification à laquelle se livre Patrick Poivre d‟Arvor montre que la présentation qu‟il propose de son invitée ne relève pas d‟une erreur liée à un manque d‟information, mais bien à une approximation volontaire. De même, la répétition du terme « diplômée », ainsi que l‟absence de toute précision sur le statut exact du « doctorat d‟État de parapsychologie », reflètent le souci de légitimation de l‟animateur. Quoi qu‟il en soit, si les titres des partisans des parasciences, habituellement mentionnés lors de la présentation des invités, font souvent l‟objet de discussions dans le débat autour des parasciences, leur qualité de spécialiste de la parascience discutée (qualité que souligne une autre composante des présentations : la mention des ouvrages écrits par l‟invité) n‟est, elle, jamais mise en doute, ce qui leur assure la domination de l‟interaction du point de vue des territoires conversationnels.
1 L‟expression « là aussi » renvoie à la séquence de présentation de l‟invité
précédent, au cours de laquelle Patrick Poivre d‟Arvor précisait :
PPDA : alors il est évident que quand on fait ce genre d‟émission on essaye d‟éviter les farfelus
(« Ex Libris » du 08/03/1990, TF1)
60 Le débat immobile
2.2. Présentation des adversaires des parasciences
La question de la compétence des adversaires des parasciences est plus complexe. La présentation du premier type d‟opposants aux parasciences – scientifiques dont le domaine de compétence est en rapport avec la parascience en discussion – comporte la mention du nom, du titre et de la spécialité de l‟invité. En cela, elle est, au moins formellement, symétrique à la présentation de certains partisans des parasciences : JCB : le professeur Yves Galifret directeur du laboratoire de psycho-
physiologie sensorielle (.) à l‟université de Paris VI (« Duel sur la Cinq » du 22/04/1988, la 5)
Parfois, la mention de la spécialité est doublée d‟une paraphrase explicative, qui souligne la légitimité thématique de la présence de l‟invité sur le plateau. Ainsi, dans le débat sur l‟instinctothérapie, Jean-Claude Bourret présente l‟adversaire de sa discipline comme gastro-entérologue, puis reformule ce terme : JCB : le professeur Jean-Pierre Bader qui est gastro-entérologue à
l‟hôpital Henri Mondor de Créteil et spécialiste donc de l‟appareil digestif
(« Duel sur la Cinq » du 15/06/1988, la 5)
Or, l‟instinctothérapie est une forme de thérapeutique basée sur un régime qui nécessite l‟ingestion de tous les aliments crus, afin de renouer avec ce qui est présenté comme un “instinct alimentaire primordial”. On comprend donc aisément la présence d‟un spécialiste de la digestion, habilité à évaluer les conséquences d‟un tel bouleversement de l‟alimentation sur l‟organisme. Parfois encore, c‟est la légitimité statutaire que souligne le commentaire de la spécialité de l‟invité. Ainsi, dans le débat sur l‟astrologie, Jean-Claude Bourret insiste surtout sur le fait que l‟adversaire de l‟astrologue Élisabeth Teissier est scientifique : JCB : Dominique Ballereau qui est un astronome donc un scientifique
professionnel (.) à l‟observatoire de Meudon (« Duel sur la Cinq » du 01/06/1988, la 5)
Enfin, le programme argumentatif1 que l‟invité est supposé suivre dans le débat reste le plus souvent implicite, tant il va de
1 On entend par programme argumentatif la position argumentative, définie par
rapport à l‟énoncé du thème du débat (par exemple, “faut-il croire à la parapsychologie ou ne pas y croire”, “pour ou contre l‟astrologie”...), qu‟un débatteur devra occuper au cours du débat. Ce programme est défini par un certain nombre de propositions qu‟un débatteur choisit de défendre au cours de l‟interaction : ainsi, un partisan de l‟astrologie pourra choisir de défendre toutes les pratiques astrologiques, ou seulement l‟astrologie dite caractérologique, en rejetant l‟astrologie prévisionnelle. De même, un opposant
Faiblesse constitutive… 61
soi que l‟astrologue est là pour défendre l‟astrologie et le numérologue, la numérologie, l‟autre débatteur devant occuper l‟autre position, c‟est-à-dire jouer le rôle d‟opposant. Il apparaît ainsi parfois sous forme de simple présupposé, comme à la fin de la séquence d‟ouverture du « Duel » sur l‟instincto-thérapie : JCB : alors (.) Guy-Claude Burger je crois qu‟il faut d‟abord expliquer
(.) ce qu‟est l‟instinctothérapie et ensuite le professeur nous dira (.) pour quelles raisons il ne croit pas du tout à cette thérapeutique (« Duel sur la Cinq » du 15/06/1988, la 5)
En revanche, la présentation de la deuxième catégorie d‟oppo-sants aux parasciences – celle des débatteurs qui ne peuvent se prévaloir d‟aucune compétence particulière – mentionne presque systématiquement l‟opinion de l‟invité sur le sujet traité : JCB : Alain Cuniot président de l‟association “Science et Illusion” (.) et
qui organise lundi prochain vingt heures trente une soirée de gala au théâtre Romain Rolland de Villejuif dans le Val de Marne (.) sur le thème vive l‟intelligence (.) l‟intelligence spectacle (.) contre la crédulité les pseudo-sciences et le charlatanisme
(« Duel sur la Cinq » du 15/04/1988, la 5)
Dès que la notoriété de l‟invité est suffisamment importante pour que son identité ne nécessite pas d‟être développée au-delà de la mention de son nom, seule sa position sur le sujet est évoquée : DB : alors Cavanna (.) vous vous êtes radicalement contre vous croyez
à pas à à pas à tout ça (« Mardi soir » du 15/10/1991, France 2)
Dans le cas d‟Alain Cuniot, sa seule caractérisation – donc la seule légitimation de son droit à la parole –, en dehors du programme argumentatif qu‟il est supposé suivre dans le débat lui-même, est son statut de directeur de l‟association “Science et Illusion”. Cette caractérisation unique, et relativement faible (l‟association en question n‟est pas connue du grand public) témoigne de l‟embarras des médias devant des personnalités comme Alain Cuniot. Comme le souligne Jean-Claude Bourret dans la présentation de l‟ouvrage de Cuniot, il est difficile de définir à quel titre parle ce dernier :
Alain Cuniot est un personnage irritant. Il n‟est pas scientifique, mais pratique une démarche scientifique. Il n‟est pas journaliste, mais enquête avec un professionnalisme dont beaucoup d‟entre nous devraient s‟inspirer.
aux parasciences peut choisir de dénoncer consommateurs et praticiens des parasciences, ou d‟épargner les consommateurs.
62 Le débat immobile
Il n‟est pas mandaté par le peuple, mais poursuit avec acharnement une mission de salubrité morale publique dont la Convention lui aurait donné acte deux siècles plus tôt. Non, Alain Cuniot est un artiste inscrit depuis longtemps au Parti Communiste. Je précise cette double étiquette afin que ses détracteurs trouvent une nouvelle matière irrationnelle aux attaques renouvelées que ne manquera pas de susciter cet ouvrage décapant.
(Préface à A. Cuniot, Incroyable…: 13)
Ni expert, ni homme de télévision, ni témoin d‟un événement paranormal ou représentant de “l‟opinion publique”, seule son intime conviction justifie la présence d‟Alain Cuniot sur les plateaux de télévision – conviction en partie motivée par des choix politiques jamais mentionnés par les présentateurs lors des débats télévisés, car il semble bien que leur évocation risque plus d‟handicaper Cuniot que de confirmer son droit à la parole. Ainsi, dans le « Duel sur la Cinq » sur la parapsychologie (15/04/1988), Yves Lignon évoque par deux fois les opinions politiques d‟Alain Cuniot. Il fait ainsi allusion à « un certain journal » qui aurait envoyé Cuniot enquêter sur l‟affaire de Vailhauquès : il s‟agit en fait de L‟Humanité. Un peu plus loin, il critique le terme d‟« aberration mentale » utilisé par Cuniot, affirmant : YL : il ne m‟étonne pas que vous utilisiez le terme d‟aberration
mentale (.) c‟est celui qu‟on utilise quelque part (.) à notre gauche (.) quand on veut envoyer des gens un peu au frais
(« Duel sur la Cinq » du 15/04/1988, la 5)
Chaque fois que les sympathies communistes d‟Alain Cuniot sont évoquées, c‟est sous la forme d‟insinuations. Au total, la présentation faite d‟Alain Cuniot – et, plus généra-lement, des opposants aux parasciences non scientifiques – par les animateurs des émissions télévisées auxquelles il participe met en évidence la faiblesse de la légitimité de sa participation aux débats sur les parasciences.
2.3. Notoriété de l’invité
Enfin, il arrive que la notoriété de l‟invité soit telle qu‟elle est évoquée lors des présentations. C‟est le cas notamment pour Élisabeth Teissier, présentée comme une « astrologue bien connue » : faute d‟une reconnaissance institutionnelle, Élisabeth Teissier bénéficie d‟une forme de reconnaissance “par le bas” qui, ajoutée à sa grande maîtrise des médias, constitue pour elle un atout majeur dans le débat sur les parasciences. C‟est encore le cas pour Albert Jacquard, dont la renommée est telle que le « Duel sur la Cinq » sur la morphopsychologie est le seul cas où
Faiblesse constitutive… 63
l‟animateur adresse ses remerciements de façon asymétrique aux deux invités : JCB : le professeur Albert Jacquard (.) directeur du département de
génétique à l‟Institut National d‟Études Démographiques (.) qui est généticien de réputation mondiale (.) et dont c‟est aujui- aujourd‟hui le premier passage dans un débat sur une chaîne de télévision française donc je vous remercie monsieur le professeur (.) d‟avoir bien voulu accorder à la Cinq ce privilège
(« Duel sur la Cinq » du 01/07/1988, la 5)
C‟est, dans le corpus, la seule fois où l‟adversaire des parasciences se trouve ainsi valorisé dans la séquence d‟ouverture (à travers les remerciements et les appellatifs marquant la déférence), au point d‟éclipser en retour le partisan des parasciences. Il convient sans doute de nuancer l‟idée qu‟il y aurait une asymétrie de départ radicale et définitivement favorable aux partisans des parasciences dans le débat. S‟il est vrai que le thème général des discussions influence de façon déterminante le rapport taxémique entre les débatteurs, il arrive aussi qu‟au cours d‟une interaction, un thème plus ponctuel émerge, qui, lui, relève davantage du territoire conversationnel de l‟adversaire des parasciences. En particulier, lorsque celui-ci est de formation scientifique, il reprend l‟avantage dès que la discussion aborde le problème de la scientificité de la discipline envisagée. Ainsi, le « Duel sur la Cinq » consacré à l‟instinctothérapie, contrairement à la plupart des débats portant sur des médecines parallèles, est centré non pas sur la question de l‟efficacité de cette thérapeutique, mais sur celle de sa scientificité. Alors que la question de l‟efficacité tend à situer le débat sur le terrain du partisan de la parascience (qui peut en appeler à une expérience, à une pratique, pour mettre en avant des résultats), la question de la scientificité de l‟instinctothérapie oriente le débat au bénéfice du gastro-entérologue Jean-Pierre Bader, puisque, en tant que médecin, il est en quelque sorte dépositaire des critères de scientificité. Il souligne cette légitimité dès sa première inter-vention, où il évoque son « passé de médecin » et ses « patients ». Puis au cours du débat, il explicite à diverses reprises son statut, qui l‟autorise à juger de la scientificité de la théorie – et, plus particulièrement, du fait qu‟elle respecte ou non l‟éthique médicale :
64 Le débat immobile
JPB : je sais un peu ce que c'est que l'alimentation en tant que gastro-entérologue je sais un peu ce que c'est la diététique (.) et je sais ce qu'est une expérience portant sur les problèmes de l'alimentation
(« Duel sur la Cinq » du 15/06/1988, la 5)
JPB : vous faites quelque chose que en général en tant qu'homme de science on s'interdit (.) c'est-à-dire que vous passez à l'acte avant que les démonstrations de la validité de vos thèses ne soient (.) ne soient acceptées par le monde scientifique
(« Duel sur la Cinq » du 15/06/1988, la 5)
JPB : et là vraiment mon mon réflexe de médecin (.) devient fantastiquement négatif (.) parce que autant j'accepte toutes les fantaisies on est libre dans la vie on peut s'amuser on peut faire ce qu'on veut (.) mais je n'accepte pas en tant que médecin (.) que soient lancées (.) euh dans le public et avec une application pratique chez des malades en danger chez des malades graves (.) euh des techniques qui vous le reconnaissez vous-même ne sont pas encore validées sur le plan scientifique
(« Duel sur la Cinq » du 15/06/1988, la 5)
Même si, à diverses reprises, Guy-Claude Burger met en avant sa formation de physicien pour revendiquer une certaine maîtrise des critères de scientificité, le martèlement incessant de son rôle de scientifique (ou gastro-entérologue, ou médecin) par Jean-Pierre Bader lui permet de prendre en charge presque tous les énoncés de définition de la science. Ainsi, l‟existence de glissements thématiques au cours des interactions permet de nuancer l‟asymétrie de départ : l‟orientation du thème du débat vers le problème de la scientificité ou, au contraire, de l‟efficacité de la parascience en discussion permet de redistribuer les atouts ou les handicaps des débatteurs par rapport à leurs territoires conversationnels respectifs. Pour finir, signalons quand même qu‟il n‟y a rien là de mécanique ; le thème du débat, ainsi que ses rapports avec les territoires conversationnels de chacun, constituent autant de données de départ que les participants doivent chercher à orienter en leur faveur. Si un locuteur se révèle incapable d‟exploiter ses atouts, il peut voir une situation qui lui était au départ favorable tourner à son désavantage. Ainsi, dans le « Duel sur la Cinq » sur l‟astrologie (10/06/1988), le thème du débat est centré sur le problème de la scientificité de l‟astrolo-gie, puisque Jean-Claude Bourret propose du thème la formula-tion suivante : « faut-il croire (.) à l‟astrologie l‟astrologie est-elle une vraie ou une fausse science ». De plus, on a vu que l‟animateur présentait Dominique Ballereau comme un « scientifique professionnel », ce qui définit clairement les terri-toires conversationnels des participants en sa faveur. Pourtant, l‟astronome ne parvient pas à profiter de l‟avantage que lui
Faiblesse constitutive… 65
confère cette orientation du débat, et c‟est l‟astrologue Élisabeth Teissier qui, d‟un bout à l‟autre du débat, parle au nom de la science. Symétriquement, dans le « Duel » sur la voyance, le mage Dessuart oriente le débat non sur l‟explication scientifique de la voyance, mais sur les effets de ce don ; le professeur Galifret, renonçant à amener le débat sur un terrain où il puisse exercer sa propre expertise, accepte le thème proposé par son adversaire, et, lui opposant différents exemples de voyances erronées ou des tests montrant l‟incapacité de certains voyants à faire la preuve de leurs dons, met le mage Dessuart en difficulté sur son propre terrain.
3. UNE ASYMÉTRIE RENFORCÉE : CONTESTATION DU DROIT À LA PAROLE DES ADVERSAIRES DES PARASCIENCES
Il est clair que, dans les débats télévisés, chacun essaye de tirer parti au maximum de ce qui constitue ses points forts afin de s‟assurer le contrôle de l‟interaction. Ainsi, loin de se satisfaire de l‟avantage que leur confère le principe même des débats sur les parasciences, les partisans de ces dernières l‟utilisent afin de contester le droit à la parole de leurs adversaires, et de s‟en assurer le monopole. Une telle contestation est particulièrement grave : elle ne menace pas seulement le discours de l‟adversaire, mais l‟adversaire lui-même, puisque, comme le rappelle Windisch, « la négation du droit à la parole correspond à un acte de réfutation non pas uniquement du discours de l‟adversaire mais de sa place » (1987 : 83). Dans le débat sur les parasciences, l‟évaluation de la légitimité du discours de l‟adversaire (reposant, on l‟a dit, sur l‟évaluation de sa compétence) fonctionne presque toujours à sens unique : ce sont les partisans de ces disciplines qui accusent leurs adversaires d‟incompétence. Déjà Cicéron, dans son ouvrage sur la divination, mettait en scène un personnage favorable aux auspices, Quintus, qui reproche à Marcus sa méconnaissance du sujet :
C‟est en fait la difficulté et la peine d‟apprendre qui ont rendu la paresse discoureuse. On préfère soutenir qu‟il n‟y a rien dans les auspices plutôt que d‟apprendre ce qu‟il en est. (Cicéron, De la divination, Paris : Les Belles Lettres, 1992 : 80-81)
Dans la très grande majorité des cas, les partisans des parasciences arguent de la méconnaissance, par leurs adversaires, de la discipline discutée, pour remettre en question leurs allégations – et la légitimité même de leur participation au débat.
66 Le débat immobile
3. 1. Contestation de la compétence de l’adversaire en tant que scientifique
L‟accusation d‟incompétence lancée par le partisan des parasciences peut porter sur l‟adversaire en tant que scientifique. Ainsi, dans l‟émission « Santé à la une » sur l‟astrologie et la santé, le docteur Jean-Pierre Kauffman, qui utilise l‟astrologie dans son exercice médical, réagit à l‟intervention du docteur Samuel Lepastier, violemment opposé à de telles pratiques : JPK : lorsque le- notre confrère nous dit (.) les astres n‟ont aucune
efficacité (.) n‟ont aucune influence je veux quand même lui rappeler que le soleil (.) qui est un astre qui n‟est pas négligeable (.) a une influence sur le mé- connue sur le métabolisme thyroïdien (.) sur le métabolisme respiratoire (.) sur le métabolisme pulmonaire
(« Santé à la une » du 04/01/1993, TF1)
L‟acte de langage réalisé ici par le docteur Kauffman le pose en donneur de leçon, en professeur qui rappelle à un élève une leçon mal apprise, et cette distribution des rôles est clairement défavorable au docteur Lepastier, qui se trouve ainsi pris en défaut dans sa compétence même de médecin.
3.2. Contestation de la pertinence de la compétence de l’adversaire
Dans l‟exemple précédent, c‟est la qualité d‟expert de l‟adversaire des parasciences dans son propre domaine de compétence qui est contestée ; une telle attaque revient à invalider la légitimité statutaire dont il bénéficiait grâce, notamment, aux présentations prises en charge par l‟animateur. Mais le plus souvent, la contestation de la compétence des adversaires des parasciences passe par la contestation de leur légitimité thématique : les partisans des parasciences reconnaissent volontiers que leurs adversaires sont experts dans leur domaine, mais nient la possibilité d‟étendre cette expertise à la parascience en discussion. En un mot, ils contestent la pertinence du savoir de leurs adversaires. Ainsi, on a suggéré précédemment que Dominique Ballereau avait été invité à débattre avec Élisabeth Teissier à cause d‟une certaine proximité entre sa discipline, l‟astronomie, et l‟astrologie. Mais proximité n‟est pas identité ; et la plupart des astrologues – dont Élisabeth Teissier – ne reconnaissent aucune compétence aux astronomes en matière d‟astrologie :
Faiblesse constitutive… 67
ET : je vous prie de ne pas faire de jugement de valeur (.) parce que vous n‟êtes pas astrologue (.) vous parlez de quelque chose que vous ne connaissez pas […] monsieur je voudrais vous dire une chose (.) exactement comme Halley qui disait qui répondait à Newton (.) vous avez dû si vous avez lu mon livre lire cette phrase plusieurs fois (.) je vous réponds la même chose (.) lorsque Halley a dit à Newton (.) qui pratiquait l‟astrologie comment se fait-il qu‟un si éminent esprit pratique l‟astrologie (.) et Newton a répondu (.) la différence entre vous et moi c‟est que je l‟ai étudiée monsieur et vous non (.) alors je vous invite à faire la même chose (.) s‟il s‟agissait d‟astronomie je ne serais pas là aujourd‟hui
(« Duel sur la Cinq » du 10/06/1988, la 5)
On le voit, l‟astrologue dénie le droit à l‟astronome de parler de sa discipline, et affirme ne pas vouloir empiéter elle-même sur le domaine de compétence de son adversaire. De même, le numérologue Jean-Daniel Fermier répond à l‟attaque du physicien Henri Broch contre l‟arbitraire de la numérologie en l‟invitant à respecter la répartition des territoires conversationnels (ou ici, plus précisément, des domaines d‟expertise) : JDF : je suis désolé on ne participe pas à un débat si on ne connaît pas
le sujet (.) ça c‟est la moindre des choses (.) moi je n‟me permettrais pas de vous parler de physique monsieur (.) et et de vous critiquer sur vos travaux
(« Savoir plus » du 01/03/1993, France 2)
Une telle revendication, si elle était satisfaite, reviendrait à ne donner le droit de parler de l‟astrologie qu‟aux astrologues – de même que d‟ordinaire, seuls les astronomes sont habilités à parler d‟astronomie. Cela entraînerait une redéfinition globale du débat sur les parasciences, puisque sur une discipline donnée, on ne verrait plus s‟affronter les “pro” et les “anti”, mais les représentants de diverses tendances au sein même de la discipline. Mais le parallèle établi par Élisabeth Teissier entre l‟astrologie et l‟astronomie (ou par Jean-Daniel Fermier entre numérologie et physique) masque une différence fondamentale qui rend fallacieuse la demande de réciprocité. En effet, il n‟existe pas de débat sur le thème “pour ou contre l‟astronomie”, qui justifierait la présence sur le plateau d‟astronomes et de non astronomes, opposés à cette discipline. Si débat il y a, c‟est, précisément, entre astronomes de diverses tendances : il s‟agit alors de querelles d‟experts. En revanche, la caractéristique du débat sur les parasciences est que les disciplines sont contestées en tant que telles. Affirmer que seuls les astrologues peuvent parler d‟astrologie revient à redéfinir les termes du débat, et à prendre la validité de l‟astrologie, auparavant au centre de la discussion, comme présupposé de départ.
68 Le débat immobile
3.3. Dénonciation de l’ignorance de l’adversaire sur la parascience en discussion
Enfin, quelle que soit l‟identité de l‟adversaire qui lui fait face, le partisan des parasciences cherche à démontrer sa méconnaissance de la parascience en discussion, indépendamment du domaine de compétence qui lui est propre. Compétence pratique liée à l‟expérience de l‟adversaire comme client
Un critère souvent proposé par les partisans des parasciences afin d‟évaluer la compétence de leur interlocuteur sur la discipline discutée est d‟ordre pratique : il s‟agit de son expérience non pas comme praticien, mais comme “client” ou comme “patient”. Ainsi, un détracteur de l‟astrologie se verra demander s‟il connaît son thème, ou un adversaire de la numérologie, s‟il a fait faire son étude numérologique : JDF : excusez-moi monsieur avez-vous déjà avez-vous déjà eu une
étude numérologique vous-même ? HB : vous pouvez me la faire si cela vous intéresse JDF : non (.) vous par- vous parlez d‟un sujet que vous n‟connaissez
pas je suis désolé (JDF = Jean-Daniel Fermier, numérologue
HB = Henri Broch, physicien « Savoir plus » du 01/03/1993, France 2)
Quelle que soit la validité de l‟argument selon lequel seul celui qui a été consommateur de parasciences peut en parler en connaissance de cause, son efficacité interactionnelle est évidente : si l‟adversaire répond à la question du partisan des parasciences par la négative, sa réponse apparaît nécessairement comme un aveu, et il semble pris à défaut par le partisan des parasciences. De plus, le choix de ce critère d‟évaluation de la compétence de l‟adversaire permet de rester sur le terrain de l‟efficacité de la parascience – qui est, on l‟a dit, le fond de la discussion des mancies. Compétence liée à une connaissance théorique du sujet
Il est également possible d‟évaluer le droit à la parole de l‟adversaire à l‟aune de sa connaissance théorique du sujet. C‟est la base d‟une stratégie menée à deux reprises par le para-psychologue Yves Lignon, sous des formes très similaires mais dans des émissions différentes. La première fois, la contestation de la compétence de l‟adversaire (Alain Cuniot) apparaît après que ce dernier ait dénoncé la faiblesse des expériences en parapsychologie :
Faiblesse constitutive… 69
YL : il y a dans le monde entier (.) des centaines et des milliers d‟expériences qui sont réussies (.) et que vous êtes incapable de contester (.) si je vous demande que signifie (.) approximation de la loi binomiale par la loi normale1 (.) que me répondez-vous ? (.) vous ne me répondez rien (.) et ne me répondant rien (.) par manque de compétence (.) vous êtes incapable de juger des expériences fondamentales de parapsychologie
(« Duel sur la Cinq » du 15/04/1988, la 5)
Alain Cuniot réagit à cette mise en cause de sa compétence dès que Lignon lui cède la parole : AC : bien (.) euh ne prenons qu‟un cas (.) puisqu‟il y a eu toute une
série de choses qui est dite et nous n‟avons qu‟un temps limité (.) je pourrais reprendre chaque chose (.) vous parlez vous parlez vous parlez d‟un problème (.) de de de ma compétence (.) je ne suis peut-être pas d‟une grande formation scientifique (.) mais j‟ai une certaine vigilance critique
(« Duel sur la Cinq » du 15/04/1988, la 5)
On retrouve exactement le même procédé polémique dans le « Star à la barre » sur “la parapsychologie et le surnaturel”, adressé cette fois à l‟écrivain Cavanna : YL : écoutez bon (.) e- est-ce que vous est-ce que vous (.) est-ce que
vous pouvez me dire à quelle condition la loi normale constitue une approximation de la loi binomiale ? (.) non (.) vous ne connaissez rien au procès scientifique de la parapsychologie (.) rien de rien de rien
(« Star à la barre » du 09/05/1989, France 2)
Cette fois, c‟est Philippe Bouvard, invité également au titre de sceptique, qui répond en commentant le “coup” de Yves Lignon : PB : et c‟est pour ça qu‟votre fille est muette
(« Star à la barre » du 09/05/1989, France 2)
Le commentaire de Bouvard qui, à une question sérieuse, oppose une réponse plaisante, est double. D‟une part, il souligne le caractère jargonnant du discours de Lignon, qu‟il rapproche ainsi d‟une tentative d‟intimidation similaire : celle menée par Sganarelle qui assomme Géronte d‟humeurs peccantes et de galimatias en faux latin avant de poser son diagnostic. D‟autre part, il attaque l‟intervention de Lignon sous l‟angle de la pertinence, et conteste que, de l‟incapacité à répondre à la question, on puisse conclure à l‟incapacité à juger de la validité de la parapsychologie. Mais malgré tout, l‟attaque
1 Yves Lignon fait ici référence à différents modes de calcul des probabilités. Le
calcul faisant appel à la loi binomiale étant relativement complexe, il est possible, lorsqu‟on dispose d‟un éventail suffisant d‟événements, d‟avoir recours à une approximation de cette loi : la loi de Gauss, ou “loi normale”, dont le calcul est beaucoup plus aisé. Les deux types de lois sont souvent utilisés dans la recherche en parapsychologie, la nature des phénomènes nécessitant la mise en oeuvre d‟outils statistiques.
70 Le débat immobile
a porté, la question du parapsychologue étant restée sans réponse. Yves Lignon n‟aurait probablement pas posé la question à un interlocuteur susceptible d‟y répondre (et il semble que toute personne un peu familière avec le calcul statistique soit capable de définir les termes de “loi binomiale” et “loi normale”) : dans les deux cas, la chance de voir Cuniot ou Cavanna répondre sans ciller au défi était faible. Mais quand bien même son interlocuteur aurait eu le savoir suffisant pour répondre, les exigences du genre “débat télévisé” – particulièrement quand il s‟agit d‟une émission grand public, comme « Duel sur la Cinq » ou « Star à la barre » – rendent difficilement acceptable le degré de technicité nécessaire à l‟explication. Ainsi, l‟asymétrie de la position des “pro” et des “anti” dans le débat sur les parasciences, liée à la répartition des territoires conversationnels entre invités, est bien réelle. Lisible dès le départ à travers la séquence de présentations prise en charge par l‟animateur, elle est généralement renforcée à l‟issue des négociations portant sur la compétence des adversaires des parasciences, et donc sur la légitimité de leur participation au débat. La revendication, par les partisans des parasciences, d‟un statut de “quasi-spécialistes”, seuls habilités à se prononcer sur ce thème, passe donc par des procédés discursifs et des négociations explicites. Mais ils peuvent aussi choisir de tenir des rôles communicationnels (c‟est-à-dire d‟adopter un certain nombre de comportements, principalement langagiers) susceptibles d‟affirmer et de renforcer ce statut de spécialiste que leur confère le bénéfice du thème. En particulier, ils peuvent choisir de parler en expert, ou de parler en vulgarisateur. On peut considérer qu‟un locuteur parle en expert lorsque la production aussi bien que l‟interprétation de son discours nécessitent que l‟on possède une compétence spécialisée (qui “dépasse” la compétence encyclopédique minimum que l‟on suppose généralement à tout individu avec lequel on entre en communication). La mention de l‟interprétation du discours montre qu‟il est impossible de parler du rôle communicationnel tenu par un locuteur sans évoquer le rôle proposé corrélativement à l‟auditeur. Comme le souligne Vion,
la notion de rôle, comme la notion de place, ne saurait s‟analyser au niveau de l‟activité d‟un seul des partenaires de l‟interaction. On ne peut assumer le rôle de professeur qu‟en convoquant un auditoire où s‟actualisent les rôles complémentaires d‟étudiants. On ne peut jouer le rôle de père que vis-à-vis d‟une personne assignée au rôle d‟enfant, etc. Il paraît donc plus correct de parler de rapport de rôles que de rôles. (1992 : 82)
Faiblesse constitutive… 71
Si Vion parle ici plus spécifiquement des rôles sociaux, la remarque vaut aussi pour les rôles communicationnels. La relation impliquée par le rôle d‟expert est, en principe au moins, égalitaire et symétrique : dans une situation de communication “idéale”, un locuteur ne parle en expert que lorsque son interlocuteur dispose de la compétence nécessaire pour interpréter correctement son discours – c‟est-à-dire lorsqu‟il est lui-même potentiellement susceptible d‟assurer le rôle communicationnel d‟expert. Dans des émissions télévisées s‟adressant au grand public comme celles qui constituent le corpus, on peut donc prévoir que ce type de rôle n‟apparaîtra pas, les discours produits s‟adressant toujours en dernier recours au tiers absent et supposé profane incarné par l‟ensemble des téléspectateurs. Pourtant, on relève quelques apparitions de ce qu‟on ne peut qualifier autrement que de discours d‟expert. Ainsi, l‟astrologue Élisabeth Teissier, invitée de Patrick Poivre d‟Arvor dans l‟émission « Ex Libris » du 08/03/1990, voit ses prévisions antérieures confrontées à la réalité des événements. Elle justifie alors ses prévisions, erronées ou non, en usant d‟arguments techniques dont la compréhension nécessiterait une bonne connaissance de l‟astrologie : PPDA : bon le crack boursier en 87 enfin quelques y a des choses
troublantes c‟est sûr (.) bon mais y a [aussi des choses qui sont ET : [et qui sont d‟la déduction si
vous voulez qui sont d‟la déduction basée sur des cycles planétaires (.) c‟est pas du tout parce que d‟un coup j‟me dis ah tiens le 22 avril il pourrait se passer quelque chose (.) c‟est que je regarde dans les éphémérides et quand je vois qu‟il y a un (.) un croisement d‟influences planétaires extrêmement (.) de dissonances planétaires très très fortes qui se réunissent (.) grand cycle plus petit cycle dans une même journée comme par exemple pour le quinze février là (.) où j‟avais dit risque d‟inondation et c‟était le jour (.) le jour absolument au jour près où il y a eu la Bretagne et le Doubs
(« Ex Libris » du 08/03/1990, TF1)
Si même un profane peut interpréter le sens de l‟expression « cycles planétaires », les expressions « croisement d‟influences planétaires » ou « dissonances planétaires » – de même que la paraphrase qui en est proposée (« grand cycle plus petit cycle dans une même journée »), qui n‟en éclaircit le sens en aucune façon – nécessitent de la part de l‟auditeur, pour être comprises, une compétence spécialisée. Dans de tels cas (où un locuteur assume le rôle communicationnel d‟expert alors que la situation ne réunit pas les conditions nécessaires à son exercice), on peut considérer que l‟argument technique ne vaut plus par son contenu, mais par le fait qu‟il manifeste la compétence de celui qui l‟emploie. Il s‟agit d‟une stratégie extrêmement courante, quelles que soient les circonstances et les sujets débattus, et qui
72 Le débat immobile
repose sur ce que Kerbrat-Orecchioni appelle l‟effet d‟intimi-dation terroriste du jargon (1978 : 73). Mais le cas le plus normal, au vu de la situation de communica-tion, est aussi le plus courant : les participants au débat autour des parasciences – et, particulièrement, les parascientifiques – adaptent leur discours aux compétences de leurs destinataires, et assurent ainsi un rôle communicationnel de vulgarisateurs. On entendra momentanément par “vulgarisation” une activité cognitive et discursive visant à adapter le contenu complexe et spécialisé d‟un message afin de rendre possible son interprétation par un public de profanes. C‟est pourquoi, dans les interactions entre partisans et opposants des parasciences, les séquences au cours desquelles l‟un des deux débatteurs assure le rôle de vulgarisateur ménagent des plages au cours du débat au sein desquelles la polémique semble momentanément suspendue pour laisser place à un souci essentiellement didactique1. On verra toutefois que cette orientation didactique du discours peut être réinvestie à des fins strictement polémiques par les participants au débat. Le chapitre suivant propose de décrire les diverses manifestations de ce rôle communicationnel de vulgarisation dans le débat sur les parasciences.
1 Même si le discours de vulgarisation scientifique n‟échappe pas toujours à ce
que Schiele & Jacobi appellent le dialogisme polémique (1988 : 41).
Chapitre 4 :
Fonction argumentative
des séquences de vulgarisation
La vulgarisation est souvent associée à une problématique de divulgation du savoir. Quels que soient les domaines dans lesquels elle s‟exerce, l‟activité vulgarisatrice est généralement vue comme la reformulation, la traduction d‟un discours ésotérique en un autre discours destiné à une communauté de récepteurs non-spécialistes de la question. Aussi banal que soit le parallèle entre vulgarisation et traduction, il se pourrait bien qu‟il soit, au moins partiellement, trompeur. Parler de reformulation ou de traduction cantonne l‟activité vulgarisatrice au niveau lexical ; or, le travail du vulgarisateur ne se limite pas à la mise en correspondance de deux lectes. Il n‟est même pas certain que la principale difficulté de ce travail soit liée aux caractéristiques lexicales d‟un discours premier : c‟est sans doute au niveau conceptuel que le savoir qu‟il s‟agit de vulgariser pose problème. De plus, le discours ésotérique qui serait à l‟origine du message vulgarisé est le plus souvent difficilement repérable en tant que tel : il s‟agit souvent de divers fragments discursifs rassemblés par le vulgarisateur, voire d‟expériences non verbales dont il cherche à rendre compte. Enfin, il n‟est pas certain qu‟on puisse parler du discours de vulgarisation comme d‟un type de discours nettement circons-crit, permettant sans équivoque de signaler toute activité de vulgarisation. En effet, le message vulgarisé peut s‟exhiber, par divers procédés discursifs, comme le fruit d‟un travail de traduction, mettant en scène le locuteur dans son activité de vulgarisateur, et suggérant sans cesse l‟existence d‟un discours premier à l‟origine du discours vulgarisé ; mais il peut aussi mettre entre parenthèses ce caractère de discours-relais, et s‟assumer comme un discours autonome. La plupart des études linguistiques sur la vulgarisation portent sur le premier cas : celui où le discours vulgarisé se donne explicitement comme le résultat d‟une reformulation, en adoptant une structure de discours rapporté, ou en multipliant les paraphrases in praesentia. C‟est ce qui permet aux auteurs de ces études de parler de discours de vulgarisation. Cette approche est rendue légitime par leur objet d‟étude : ils travaillent généralement sur la vulgarisation scientifique, et plus précisément, sur des articles
74 Le débat immobile
parus dans des revues définies comme des revues de vulgarisation (Science & Vie, Pour la science...). Or, les stratégies mises en place par les auteurs de ces articles sont justement basées sur la mise en scène, l‟exhibition du travail de vulgarisation. Mais les études sur cette forme de vulgarisation scientifique n‟épuisent pas pour autant toutes les formes de vulgarisation. En effet, dans les cas où aucun travail de traduction, de reformulation, n‟est discursivement “mimé” (lorsque les lieux où le savoir s‟est élaboré ne sont pas évoqués, lorsque les formes savantes et les formes vulgarisées ne coexistent plus dans un même texte mais sont remplacées par des approximations lexicales), si on peut encore parler d‟activité vulgarisatrice, on ne peut plus parler de discours de vulgarisation comme d‟un type de discours caractérisé par certaines formes discursives plus ou moins spécifiques. C‟est pourquoi on évitera ici de se situer dans une perspective de typologie des discours, et on ne parlera pas de discours de vulgarisation. On cherchera simplement à repérer l‟existence de marques explicites – ou de mise en scène, selon l‟expression utilisée par Authier-Revuz (1982) – de l‟activité de vulgarisation dans le discours des participants au débat sur les parasciences. Ces réserves étant faites, les analyses classiques de la vulgarisa-tion scientifique, même si elles ne rendent pas toujours justice à l‟essence du travail de vulgarisation, proposent un cadre qui permet de décrire efficacement certains phénomènes discursifs liés à ce travail.
1. QUI VULGARISE ? CRITÈRES DE SÉLECTION DU VULGARISATEUR
La première tâche, si l‟on cherche à analyser l‟activité de vulgarisation dans le débat sur les parasciences, est de déterminer par qui elle est assumée. Il est donc nécessaire d‟identifier les critères de sélection du vulgarisateur, et d‟étudier ce qui se passe lorsqu‟un désaccord surgit sur le locuteur ainsi désigné comme vulgarisateur. Généralement, c‟est l‟animateur qui initie les séquences de vulgarisation. Il fait le lien entre les téléspectateurs absents du format de production de l‟interaction et les invités présents sur le plateau ; c‟est donc à lui de faire en sorte que le discours produit par les débatteurs soit adapté à ce qu‟attend le public absent, et à ce qu‟il est capable de comprendre. Aussi l‟anima-teur procède-t-il en permanence à des ajustements entre la compétence de ses invités et celle qu‟il prête à ses téléspecta-teurs. Il suscite ainsi souvent une activité de vulgarisation chez l‟un ou l‟autre des débatteurs, justifiant justement sa demande
Fonction argumentative … 75
par l‟ignorance du public dont il se fait le porte-parole. Ainsi, dans le « Duel sur la Cinq » sur la numérologie, l‟animateur Gilles Schneider (remplaçant ponctuel de Jean-Claude Bourret) invite la numérologue Nicole Laury à définir le terme gematria, et légitime cette requête par la probable méconnaissance du terme par le public (la demande de vulgarisation se traduit le plus souvent par la demande d‟une explication) : GS : oui non expliquez-nous un peu parce que la gematria je ne suis
pas sûr que si on faisait un sondage (« Duel sur la Cinq » du 11/08/1988, la 5)
Le “nous” ici posé comme destinataire de la séquence vulgari-satrice à venir englobe aussi bien l‟animateur que les téléspecta-teurs, et même l‟autre débatteur : le destinataire de la demande de vulgarisation est posé comme seul détenteur du savoir. La sélection du vulgarisateur semble obéir à deux contraintes : la logique propre au déroulement de l‟interaction d‟une part, les territoires conversationnels d‟autre part.
1.1. Sélection du vulgarisateur en fonction de la mécanique de l’interaction
Lorsque l‟animateur initie une séquence de vulgarisation au cours du débat, c‟est souvent parce qu‟un des débatteurs a employé un terme dont la compréhension par un public de profanes ne semble pas assurée. La règle est alors qu‟il demande la définition de ce terme au débatteur qui l‟a employé, que l‟expression incriminée relève du lexique de ce débatteur ou de celui de son adversaire. L‟animateur compense le fait d‟interrompre le discours d‟un locuteur par le fait que c‟est ce même locuteur qui est invité à poursuivre : il évite ainsi de perdre son tour de parole au profit de son adversaire. Ainsi, dans le « Duel » sur la numérologie, Nicole Laury est invitée à définir ce qu‟elle entend par chemin de vie : NL : mon neveu qui est tout petit (.) qui a sept ans (.) est arrivé au
monde avec un chemin de vie trois (.) c‟est-à-dire une vibration de communication d‟expression (.) et je ne dirais pas que tous les chemins de vie trois sont [artistes
GS : [qu‟est-ce que c‟est un chemin de vie trois ?
NL : ah un chemin de vie trois c‟est notre destinée [c‟est-à-dire GS : [ah bon NL : [notre marque de naissance si je puis [dire (.) donc (.) notre GS : [d‟accord [mmm
76 Le débat immobile
NL : destinée parce qu‟il y a une part de destinée mais il y a une énorme part de libre arbitre
(« Duel sur la Cinq » du 11/08/1988, la 5)
1.2. Sélection du vulgarisateur en fonction des territoires. conversationnels.
D‟autres critères interviennent dans la détermination du locuteur-vulgarisateur, qui peuvent aller dans le même sens que la mécanique des interactions, ou entrer en conflit avec elle. La règle primordiale qui gère la sélection du vulgarisateur est, en toute logique, la suivante : si l‟énoncé ou le terme problématique semble relever plus spécifiquement du domaine de compétence d‟un des interactants, c‟est à lui d‟assurer sa vulgarisation. Globalement, la règle d‟attribution du rôle de vulgarisateur selon les territoires conversationnels de chacun, dans le débat sur les parasciences, est respectée, tant par l‟animateur lorsqu‟il initie les séquences de vulgarisation que par les débatteurs lorsqu‟ils les assurent de leur propre chef. Pour ce qui est des séquences de vulgarisation initiées par l‟animateur, le fait, déjà évoqué, qu‟il pose le partisan des parasciences comme expert du thème du débat se reflète aussi dans la nature des actes de langage qu‟il suscite chez les défenseurs des parasciences, et qui renforcent l‟image du parascientifique comme détenteur du savoir. Ainsi, lorsque Jean-Claude Bourret cherche une confirmation terminologique, c‟est à l‟invité chargé de défendre la parascience qu‟il s‟adresse :
JCB : aujourd‟hui (.) pour ou contre la dianétique (.) alors (.) qu‟est-ce que la dianétique on va évidemment la définir dans un instant (.) pour en débattre Claude (.) Boublil médecin généraliste et dianéticien je ne sais pas si c‟est ce- comme cela que l‟on dit
CB : oui exactement JCB : exactement et Alain Cuniot que vous connaissez
(JCB = Jean-Claude Bourret
CB = Claude Boublil
« Duel sur la Cinq » du 18/05/1988, la 5)
Dès le départ, le partisan des parasciences apparaît donc comme le détenteur de la maîtrise des signes relevant du lexique parascientifique.
Par ailleurs, la séquence d‟ouverture de chaque « Duel sur la Cinq » se clôt par l‟attribution de la parole par l‟animateur à l‟un des débatteurs pour lancer le débat. Puisqu‟il n‟assure pas lui même le rôle de vulgarisateur, ce sera au premier locuteur de définir le thème du débat dans des termes “accessibles à tous”,
Fonction argumentative … 77
selon les propres mots de Jean-Claude Bourret. En accord avec la règle énoncée précédemment, dans la grande majorité des cas, c‟est au parascientifique de définir la parascience constituant le thème du débat, et d‟en exposer les principes fondamentaux (le déséquilibre numérique majeur entre les partisans et les adversaires des parasciences se double alors du fait que les opposants ne se voient invités à parler que très tard au cours de l‟émission). Ainsi, dans le « Duel » sur la dianétique, Jean-Claude Bourret achève la séquence d‟ouverture en cédant la parole à Claude Boublil : JCB : alors Claude Boublil il faudrait d'abord puisque vous êtes
médecin et que vous pratiquez la dianétique nous expliquer (.) expliquer aux téléspectateurs (.) ce que prétend être (.) la dianétique (« Duel sur la Cinq » du 18/05/1988, la 5)
Le statut des invités, et les territoires conversationnels qu‟il définit, servent clairement de justification au choix du premier locuteur (puisque). De ce choix découle une structuration du début de l‟interaction en deux temps : celui de l‟exposé (vulgarisé) des faits, auquel succède celui des arguments et de la polémique. Cette structuration en deux étapes assurées par des locuteurs différents (le partisan de la parascience pour la première, et son adversaire pour la seconde) apparaît nettement dans la séquence d‟ouverture du débat sur l‟instinctothérapie, au cours de laquelle Jean-Claude Bourret annonce les deux prochaines interventions : JCB : alors (.) Guy-Claude Burger je crois qu‟il faut d‟abord expliquer
(.) ce qu‟est l‟instinctothérapie et ensuite le professeur nous dira (.) pour quelles raisons il ne croit pas du tout à cette thérapeutique
(« Duel sur la Cinq » du 15/06/1988, la 5)
D‟une manière générale, le fait de prendre la parole en premier dans un débat constitue un atout important, puisque le locuteur qui ouvre la controverse a la possibilité de définir le cadre dans lequel la polémique doit s‟inscrire :
[Le responsable du premier pas énonciatif] est celui qui pose le thème à traiter, qui établit encore frontière entre ce qu‟il faut et ne faut pas considérer, qui asserte donc l‟existence d‟une certaine situation avec des objets qu‟il choisit pour les y inclure, en les affectant de propriétés qui vont les montrer selon un “éclairage” déterminé. L‟interlocuteur est alors contraint à “entrer sur ce terrain”, à discuter de cette situation, de ces objets : il doit s‟impliquer à son tour dans cette situation énonciative. (Vignaux 1988 : 30-31)
Chaque fois que, pour une raison ou pour une autre, la règle de respect des territoires conversationnels dans la désignation par l‟animateur du premier locuteur n‟est pas respectée, l‟adver-saire des parasciences profite de l‟occasion pour soumettre l‟activité définitionnelle à des fins argumentatives et non plus
78 Le débat immobile
didactiques ou platement explicatives, comme le suppose d‟ordinaire une activité vulgarisatrice – ce qui ne manque jamais de donner lieu à des négociations ultérieures. Dans le débat sur l‟astrologie, où, très exceptionnellement, c‟est l‟adversaire des parasciences qui se voit désigné comme premier locuteur, l‟astronome met à profit l‟atout dont il dispose en proposant une définition de l‟astrologie favorable au programme argumentatif qui est le sien : DB : alors qu‟est-ce que c‟est qu‟l‟astrologie (.) eh bien il suffit de lire
les livres d‟astrologie (.) c‟est tout simplement l‟influence (.) astrale l‟influence des astres (.) sur l‟individu (.) au moment de sa naissance (.) et qui paraît-il par une sorte de déterminisme absolu (.) euh fixe euh (.) toutes les phases de la vie de l‟individu donc de sa naissance à sa mort
(« Duel sur la Cinq » du 10/06/1988, la 5)
Une telle définition, loin de présenter la nécessaire objectivité des définitions vulgarisatrices, est clairement argumentative. Il s‟agit d‟une définition “orientée” qui, ayant construit un objet vulnérable aux attaques, autorise Dominique Ballereau à enchaîner par une proposition polémique : DB : il est bien évident que c‟est une (.) théorie à laquelle (.) peu de
gens croient (.) comment peut-on croire un seul instant que quand on naît (.) tel jour à telle heure à tel endroit (.) euh vous serez euh à cinquante ans euh poliomyélitique à soixante-cinq ans vous aurez des (.) vous aurez des choses
(« Duel sur la Cinq » du 10/06/1988, la 5)
Cet exemple met en évidence les dangers qu‟il y a, pour les parascientifiques, à laisser à leur adversaire la charge de définir les termes du débat. Élisabeth Teissier y est sensible, et, sitôt qu‟elle reprend la parole, propose une contre-définition de sa discipline : ET : il y a des des scientifiques […] qui défendent l‟astrologie et qui
sont pour une euh (.) pour une interdépendance universelle parce que l‟astrologie c‟est avant tout (.) un langage qui euh (.) qui relie (.) qui fait le ma- qui signe le mariage entre le le le ciel et la terre (.) c‟est-à-dire euh (.) c‟est le le système de l‟interdépendance (.) si vous voulez c‟est la science de l‟inter- indé- interdépendance universelle
(« Duel sur la Cinq » du 10/06/1988, la 5)
La définition que propose Élisabeth Teissier diffère de celle de Dominique Ballereau par son orientation argumentative : définir l‟astrologie comme « la science de l‟interdépendance universelle » lui permet de la mettre du côté des scientifiques d‟avant-garde pour lesquels, désormais, seul compte « le principe de l‟interdépendance universelle ». Elle en diffère également par le niveau de généralité auquel elle se situe ; Élisabeth Teissier ne conteste pas la première partie de la définition que Ballereau
Fonction argumentative … 79
propose de l‟astrologie (« l‟influence des astres sur l‟individu au moment de sa naissance »), mais suggère que cette définition ne rend pas compte du principal, contrairement à celle qu‟elle lui substitue, qui introduit d‟emblée une hiérarchie ( « avant tout »). Le même phénomène se produit au cours du « Duel sur la Cinq » sur la parapsychologie. On l‟a vu, au cours de ce débat, la répartition des tours de parole amène Alain Cuniot à prendre lui-même en charge la définition du terme psychokinèse : JCB : ou pour être plus simple afin que tout le monde comprenne euh
parce que psychokinèse c‟est un mot un petit peu compliqué (.) euh ce sont des esprits frappeurs
AC : euh non psychokinèse cela veut dire pouvoir de la pensée sur la matière (.) et on sait que la pensée a effectivement un pouvoir sur la matière et que l‟on peut créer des coups dans la mesure où la pensée a inventé le marteau (.) mais euh dans les théories de la psychokinèse (.) c‟est la pensée directement qui influe sur la matière que ce soit (.) en créant des coups (.) comme la maison hantée dont je vais parler ou également (.) ce dont je m‟apprête (.) que je m‟apprête à évoquer […]les phénomènes de psychokinèse de déplacement d‟objets à distance (.) ou de torsion de petites cuillères (.) en particulier euh de Jean-Pierre Girard
(« Duel sur la Cinq » du 15/04/1988, la 5)
La première proposition de la définition aurait pu être prise en charge par un partisan des parasciences. En revanche, la suite de la définition est ironique, et la définition, de vulgarisatrice, devient clairement argumentative. Finalement, il apparaît que dès que la définition d‟un terme appartenant au lexique d‟un des débatteurs est confiée, pour une raison ou pour une autre, à son adversaire, on quitte le terrain de la vulgarisation pour rejoindre de plain-pied le domaine de l‟argumentation. Mais de tels cas sont tout à fait exceptionnels dans le débat sur les parasciences ; la plupart du temps, chacun se charge de vulgariser les termes ou les concepts relevant de son propre territoire conversationnel. Lorsque les débatteurs initient une séquence définitionnelle ou explicative de leur propre chef, elle porte généralement sur un énoncé ou un terme en rapport avec leur propre domaine de compétence. Ainsi, dans le « Duel » sur l‟astrologie, l‟astronome Dominique Ballereau définit ce qu‟il convient d‟entendre par ondes vibratoires :
80 Le débat immobile
DB : vous nous donnez des grands mots influence cosmique euh (.) onde vibratoire et caetera (.) mais ce sont des choses que je connais bien (.) ce sont des choses que je connais bien (.) les ondes ce sont tout simplement ce que l‟on reçoit (.) euh par exemple des galaxies (.) euh des étoiles (.) que l‟on reçoit même de certaines planètes
(« Duel sur la Cinq » du 10/06/1988, la 5)
Symétriquement, dans le « Duel » sur la morphopsychologie, le morphopsychologue André Garel entreprend de définir le concept d‟expansion élective : AG : c‟est le problème de l‟expansion élective c‟est-à-dire c‟est c‟est
là où l‟énergie vitale de l‟individu (.) pourra le mieux s‟exprimer (« Duel sur la Cinq » du 01/07/1988, la 5)
Enfin, dans la dynamique des interactions, initier une séquence de vulgarisation peut être un moyen de garder ou de reprendre la parole, en arguant du respect des territoires conversationnels. C‟est ce qu‟on observe dans la séquence suivante, extraite du débat sur la dianétique, au cours duquel le dianéticien Claude Boublil, ayant entendu Alain Cuniot, citant l‟ouvrage de Ron Hubbard, employer le terme d‟engramme prénatal sans le définir, tente vainement d‟initier une séquence de vulgarisation : AC : [lisant] c‟est un fait scientifique (.) virgule (.) parce que c‟est
facile (.) à prouver (.) page quarante-huit (.) l‟engramme prénatal est un fait scientifique (.) ma première [observation concernant la
CB : [alors attendez vous parlez AC : [lecture du livre (.) ma première (.) ma première observation (.) CB : [vous parlez d‟un mot l‟engramme (.) vous avez utilisé un mot AC : [ma première observation en ce qui concerne la lecture du livre (.) CB : [qu‟il faut expliquer (.) il faut expliquer ce que c‟est qu‟un AC : [c‟est qu‟il y a une succession (.) d‟affirmations (.) sans référence CB : [engramme
(« Duel sur la Cinq » du 18/05/1988, la 5)
Étant donné le caractère anecdotique de la mention du terme d‟“engramme” dans l‟argumentation de Cuniot, il est probable que l‟insistance de Claude Boublil à proposer une explication tient moins à un souci de clarté qu‟à la volonté de “reprendre le crachoir” et de couper court à une attaque de l‟adversaire contre son ouvrage de référence.
2. ACTIVITÉS DISCURSIVES ASSOCIÉES AU RÔLE COMMUNICATIONNEL DE VULGARISATEUR
Dans le débat sur les parasciences, étant donné le déséquilibre lié aux territoires conversationnels analysé plus haut, l‟activité de vulgarisation est majoritairement le fait des partisans des parasciences. Les séquences de vulgarisation qu‟ils développent présentent les mêmes caractéristiques discursives que celles classiquement décrites pour la vulgarisation scientifique.
Fonction argumentative … 81
2.1. Le dispositif énonciatif de la vulgarisation Dans le corpus, les locuteurs choisissent souvent d‟exhiber l‟activité vulgarisatrice et de mettre en avant le dispositif énon-ciatif qui sous-tend l‟activité de vulgarisation, en particulier à travers une activité de paraphrase importante.
Les formes dialogales / monologales de vulgarisation L‟activité de vulgarisation peut se dérouler sous une forme monologale, où un seul locuteur prend en charge l‟élaboration du message vulgarisé, ou sous une forme dialogale, où plusieurs participants entrent dans une interaction à objectif vulgarisateur. De façon prototypique, les dialogues de vulgarisation mettent en scène un spécialiste, qui assure la scientificité du contenu, et un non-spécialiste qui joue le rôle du candide et dont la curiosité suscite l‟énoncé du savoir chez son interlocuteur (Mortureux 1982b). Dans le débat télévisé sur les parasciences, c‟est le présentateur-animateur qui remplit la fonction du candide, et sollicite, de la part de l‟expert, des séquences de vulgarisation, voire en propose lui-même en demandant une évaluation en retour : la vulgarisation prend alors la même forme dialogale que dans les dialogues de vulgarisation décrits par Mortureux. Mais l‟opposition entre monologal et dialogal ne recouvre en rien l‟opposition écrit / oral. Le corpus écrit comporte divers articles que l‟on pourrait décrire comme des entretiens de vulgarisation. C‟est le cas notamment de la « rencontre avec Rémy Chauvin » par Erik Pigani (Le Monde inconnu n°104, avril 1989 : 34-36), de l‟entretien par Franck Sénéquier Crozet avec le parapsychologue Raymond Réant (Nouveau L‟Inconnu n°158, août 1989 : 8-13) et avec Roger de Lafforest, découvreur de l‟“effet nocebo”1 (Nouveau L‟Inconnu n°157, juillet 1989 : 8-12).
La prégnance de la réalisation dialogale est telle qu‟il arrive que dans des textes monologaux, le locuteur utilise une figure connue en rhétorique sous le nom de subjection, et “mime” un dialogue au sein duquel il répondrait aux questions posées par un interlocuteur ignorant mais curieux. Ainsi, dans un article consacré à la médecine énergétique, l‟auteur explique comment déterminer les “causes premières” des pathologies, puis s‟interroge, au sens propre, sur les façons d‟agir sur ces causes :
C‟est ici que se placent nos limites : allons-nous pouvoir ou non soigner cette cause première ? Dans la plupart des cas, oui, tant
1 Il s‟agit, selon l‟auteur, de l‟effet nocif que pourraient avoir certaines ondes
négatives attachées à un individu ou à un lieu.
82 Le débat immobile
que le point de départ n‟est pas une anomalie matérielle, organique : à lésion matérielle, traitement matériel. (Gisèle & Michel Larroche, « Médecine énergétique. Consultation : domaine et philosophie. », Le Monde inconnu n°106, juin 1989 : 61).
La question prêtée à l‟interlocuteur fictif sert, comme dans les vrais entretiens de vulgarisation, d‟introducteur de thème, et rappelle le rôle communicationnel assumé par le locuteur : seul le spécialiste est habilité à répondre à une question portant sur ce qu‟il est possible de faire. Ce procédé, extrêmement fréquent, permet de légitimer le discours du locuteur par la curiosité d‟un interlocuteur fictif, curiosité à laquelle le locuteur se soumet en apportant les réponses demandées. Il confère au locuteur une position valorisante, puisqu‟il le pose comme détenteur du savoir, et donc seul locuteur habilité à aborder certains thèmes. Cette figure de subjection apparaît également dans des situations de face-à-face. Ainsi, dans le « Duel sur la Cinq » sur l‟astrologie, l‟astronome Dominique Ballereau initie une séquence vulgarisatrice en faisant parler un interlocuteur fictif : ET : ah mais non mais c‟est terrible que vous disiez [cela c‟est DB : [non ce n‟est ET : [terrible (.) c‟est une contre-vérité c‟est faux [ DB : [pas terrible c‟est vrai [qu’est-ce que c’est
qu’un astre (.) vous avez plusieurs catégories [d‟astres ET : [non mais attendez
(.) vous êtes [en train (.) vous parlez (.) écoutez DB : [vous avez des planètes ET : mon[sieur (.) il y a il y a un problème chez vous autres les DB : [vous avez (.) des étoiles ET : scientistes […] DB : qu’est-ce que c’est que ces choses-là ce [sont des ET : [bon DB : choses que l‟on étudie nous avec des instruments (.) [nous avons ET : [bon DB : des récepteurs nous avons des télescopes [des radiotélescopes ET : [bon
(« Duel sur la Cinq » du 10/06/1988, la 5)
Dans des interactions polémiques en face à face, la subjection intervient lorsque le véritable dialogue entre les débatteurs est impossible. En particulier, dans la première partie de l‟extrait, les chevauchements se multiplient, et Élisabeth Teissier, qui essaye de prendre à parti directement son interlocuteur, échoue à se faire entendre. En revanche, Dominique Ballereau, qui conduit un dialogue avec un interlocuteur fictif beaucoup plus docile que l‟astrologue, parvient momentanément à poursuivre le fil de son discours. Dans la fin de l‟extrait, les débatteurs se montrent plus coopératifs, dans la mesure où aucun véritable chevauchement n‟apparaît ; pourtant, la multiplication des régu-
Fonction argumentative … 83
lateurs par Élisabeth Teissier, ainsi que leur nature, indiquent clairement que l‟astrologue cherche à précipiter le tour de parole de son adversaire afin de prendre la parole à son tour. L‟activité vulgarisatrice se réalise également parfois sur un mode strictement monologal. Dans ce cas, la diversité des acteurs impliqués dans le processus de vulgarisation se traduit par la mise en place d‟un dispositif énonciatif complexe, qui affiche l‟activité du vulgarisateur en train d‟adapter à la compétence d‟un destinataire profane un savoir spécialisé élaboré en d‟autres lieux par des experts.
Vulgarisation et discours rapporté Lorsqu‟un locuteur prend en charge une activité de vulgarisation, il présente souvent le contenu scientifique de son discours non comme son propre produit, mais comme le fruit d‟une réflexion menée ailleurs, hors de l‟espace de vulgarisation du message. Cela suggère que le vulgarisateur occupe une position discursive intermédiaire, entre la communauté d‟origine, au sein de laquelle le message a été élaboré, et la communauté d‟arrivée, à laquelle il est destiné. Ainsi, le discours produit par le vulgarisateur s‟appuie lui-même sur un discours premier, dont il tire sa légitimité et qui garantit sa scientificité : c‟est pourquoi une forme courante de discours de vulgarisation rappelle sans cesse qu‟elle est issue d‟un discours primaire, qu‟elle ne fait que rapporter et reformuler. Cette légitimation par un discours ésotérique antérieur a pour conséquence que le discours de vulgarisation se caractérise souvent par un dispositif énonciatif spécifique qui consiste en un cadre global de discours rapporté :
[La vulgarisation scientifique] met au jour les stratégies qu‟adopte l‟énonciateur (V) d‟un discours (X) qui rapporte à un récepteur “quelconque” (W) le discours (Z) tenu par un chercheur ou une équipe de chercheurs (S) à ses / leurs pairs (S‟) : le schéma d‟une telle communication pourrait se présenter ainsi :
V dit X à W
où X : [S a dit Z à S‟] (Mortureux 1988 : 124) L‟importance des références à d‟autres instances d‟énonciation ne suffit pas à elle seule à caractériser le discours de vulgarisation. Comme le souligne Jacobi (1987), une forte intertextualité est le lot de tout discours produit par un locuteur qui a enquêté, interrogé, lu d‟autres articles ou d‟autres ouvrages, réuni une documentation importante. Mais dans le cas de la vulgarisation scientifique, l‟énonciateur du message vulgarisé ne peut reven-diquer aucune participation à l‟élaboration du contenu proprement scientifique ; il n‟est responsable que de sa mise en forme. La référence à des spécialistes responsables en amont de l‟éla-
84 Le débat immobile
boration du message est donc la seule stratégie de légitimation dont dispose le locuteur-vulgarisateur pour pallier son absence d‟autorité personnelle.
Paramètres de l’énonciation du discours-source Le discours des partisans des parasciences multiplie les références à un ailleurs où s‟élabore le savoir dont ils se réclament. Les coordonnées spatiales, temporelles et personnelles du discours primaire dont s‟inspire le discours parascientifique vulgarisé sont mises en avant. Au minimum, l‟identité du locuteur du discours-source est mentionnée ; souvent, les noms propres des chercheurs sont associés à la mention de leur titre et de leur institution d‟origine. Ainsi, dans un article intitulé « L‟Homme est une endosymbiose », William Chetteoui pose l‟existence dans tout être humain de différents systèmes énergétiques hiérarchisés : le soma, la psyché, puis le noétique ou spirituel. Il ne se présente pas lui-même comme la source de cette assertion, mais renvoie, au contraire, à des références extérieures :
L‟existence de cette hiérarchie est confirmée par l‟observation des phénomènes d‟intégration et de subordination (voir Dr Th. Brosse, La conscience-énergie, structure de l‟homme et de l‟univers. Ed. Présence, 1978). Réalité fondamentale à laquelle des savants soviétiques eux-mêmes parmi les plus éminents, tels que B.F. Lomow, de l‟Académie des Sciences, A.N. Léontiev, directeur de la faculté de psychologie de Moscou, A.N. Luria professeur à la même faculté, le Pr Inyuskin, continuateur à Almata des recherches du regretté Kirlian, attachent une particulière importance.
[…] Différents travaux tels ceux de l‟américain Harold Saxton Burr, de l‟université de Yale, de Jacqueline Bousquet, docteur ès sciences, de Wolkowski à Paris VII, conduisent au concept de champ bio-énergétique, lequel entre autres, pourrait annoncer le processus de gestation embryonnaire. (Autre Monde n°118, juin 1989 : 110-111).
Cette explicitation des statuts témoigne de l‟existence d‟un mode de légitimation du discours parascientifique vulgarisé similaire à celui décrit par Mortureux à propos de la vulgarisation scientifique. Parallèlement à la désignation des auteurs et des coordonnées spatiales du discours-source, le vulgarisateur s‟inscrit lui-même comme énonciateur du discours second. Cette inscription peut prendre une des formes souvent identifiées pour la vulgarisation scientifique, utilisant les pronoms personnels nous ou on : « citons », « précisons », « n‟oublions pas », « nous allons voir », « nous décrirons prochainement », etc. Nombreuses aussi, les tournures impersonnelles et les formes passives (« il n‟est pas
Fonction argumentative … 85
question de...», « il importe de distinguer...», « il faut savoir...») qui, selon Jacobi (1988), témoignent du souci chez le locuteur-vulgarisateur de reproduire l‟idéal impersonnel et “désincarné” du discours-source : le discours scientifique. Ces procédés discursifs, nombreux à l‟écrit, sont attestés également à l‟oral. Ainsi, Christine Hardy, invitée à l‟émission « Ex Libris », répond à une question de Patrick Poivre d‟Arvor en évoquant les autorités qui sont responsables du discours-source (les « scientifiques »), ainsi que les lieux où le savoir s‟élabore (les « laboratoires ») : PPDA : est-ce que nous avons euh Christine Hardy (.) en nous ces
possibilités au fond euh (.) de ces ces dons qui ne seraient pas exploités est-ce que c‟est valable pour tout le monde ou bien certains ont la chance (.) de les avoir ?
CH : oui alors c‟est justement là aussi (.) un résultat qui a été trouvé par les scientifiques donc dans ces laboratoires (.) c‟est que (.) tout le monde (.) tout le monde a des dons (.) euh à la fois de télépathie de clairvoyance et d‟une certaine influence justement (.) euh sur la matière
(« Ex Libris » du 08/03/1990, TF1)
2.2. Vulgarisation et paraphrase
L‟autre caractéristique du discours de vulgarisation souvent soulignée est l‟importance de l‟activité paraphrastique. C‟est en partie à des spécificités de type lexical que l‟on attribue la difficile diffusion de la science (cf. Jacobi 1988 : 104). L‟objectif de la vulgarisation serait alors de fournir des paraphrases dont la fonction est « de lever (ou contourner ?) l‟obstacle qu‟est censée opposer au “grand public” curieux des nouveautés produites par les chercheurs l‟existence des métalangages et terminologies (scientifiques, techniques, poli-tiques...) qui fonctionnent dans les discours-sources » (Mortureux 1982a. : 3).
Le vocabulaire technique La nécessité d‟une activité de vulgarisation suppose donc l‟existence d‟un vocabulaire technique à vulgariser. Certains de ces termes relèvent spécifiquement du lexique scientifique. Dans le débat sur les parasciences, les termes appartenant au lexique scientifique apparaissent dans la bouche d‟opposants aux parasciences (scientifiques ou non) aussi bien que dans celle des partisans des parasciences. Ainsi, William Chetteoui, dans un article où il aborde longuement les caractéristiques physiques (et particulièrement, le poids) de “l‟entité spiri-
86 Le débat immobile
tuelle” qui s‟échappe du corps lors de la mort d‟un individu, évoque longuement l‟A.D.N. et sa définition :
Toute cette langue magique et personnelle de la vie, s‟est aujourd‟hui éclaircie par des formules chimiques, l‟acide désoxyribonucléique (ADN), l‟étalon principal, presque inchangeable, d‟après lequel sont fabriquées les protéines et qui nous apparaît sous la forme du célèbre escalier en colimaçon de Watson et Crick. L‟ADN est le gardien des caractères génétiques, de toutes les particularités spécifiques et des propriétés héréditaires de la cellule vivante. Ces caractères et propriétés sont chiffrés à l‟aide d‟un code dans la molécule en spirale de l‟ADN. (Voir A. Chwartz, Le code de la vie, éd. Mir, Moscou, 1966). (W. Chetteoui, « L‟Homme est une endosymbiose », Autre monde, n°118, juin 1989 : 112)
À part la référence bibliographique finale, bien peu orthodoxe, tout, dans cet extrait, ressemble à une définition de l‟ADN telle qu‟on pourrait s‟attendre à la trouver dans des revues de vulga-risation : le terme-pivot (ADN) appartient au lexique de la génétique, et la paraphrase définitionnelle qui en est proposée se rapproche, par sa forme et par l‟analogie sur laquelle elle repose (« le gardien »), des mécanismes discursifs souvent décrits dans la vulgarisation scientifique. De façon générale, on trouve, dans le discours des partisans des parasciences, nombre d‟adjectifs (« microvibratoire », « électromagnétique », « subatomique », « neuro-végétatif », « tellurique »...), de substantifs (« les quanta », « les ondes », « des particules »...) qui sont ordinairement employés dans le champ scientifique. À côté de termes empruntés au technolecte scientifique appa-raissent des termes qui relèvent, cette fois, d‟un technolecte proprement parascientifique, propre à une parascience. Leur analyse met en évidence la présence de formes de compositions analogues à celles que Guilbert (1973) décrit pour le vocabulaire scientifique : – La composition savante, qui recourt au modèle gréco-latin où se combinent des éléments de base empruntés au grec, au latin ou au français. Ainsi, le préfixe bio-, très productif en science (biologie, biochimie, biosphère, bioclimat...), donne aussi naissance au substantif bioénergie ou à l‟adjectif bioénergé-tique. De même, le suffixe -logie, qui donne la biologie, la géologie, la psychologie, entre aussi dans la composition du nom de certaines disciplines parascientifiques : numérologie, astrologie, etc. Le nom de certaines disciplines est formé par l‟association du nom de plusieurs disciplines ayant une existence autonome en science (ethnométhodologie, psycholin-guistique, sociopragmatique..), ou dans le domaine des para-sciences (morphopsychologie, psychoastrologie, et même anthropocosmothéologie...) ; on le voit, le morphème psycho est
Fonction argumentative … 87
également très productif dans le domaine parascientifique, puisqu‟il donne, outre les exemples précédents, le terme de psychotronique, un moment proposé comme remplaçant de parapsychologie, ou psychokinèse, psychopathotactile, etc.
– La dérivation syntagmatique, qui donne des unités lexicales complexes, de type Nom + Adjectif, ou Nom + syntagme prépositionnel, qui se situent « à mi-chemin de la définition métalinguistique et du segment de phrase de discours » (Guilbert 1973 : 17). C‟est le mode de formation de l‟expression d‟« envoûtement par dédoublement somnambulique », qui prend sens par rapport à une typologie des différentes formes d‟envoûtement. On reviendra plus loin sur les diverses expressions dans lesquelles entre le mot énergie (cf. chapitre 8,§2). L‟habitude, dans le domaine scientifique, de nommer un phénomène du nom de son découvreur existe aussi dans le domaine parascientifique : c‟est le cas, par exemple, de l‟« effet Kirlian », supposé mesurer l‟aura énergétique des individus. De même, le vocabulaire scientifique regorge d‟expressions abrégées par des initiales. Ainsi, l‟acide désoxyribonucléique devient ADN. Parallèlement, dans le domaine parascientifique, le pouvoir d‟un sujet capable de produire des phénomènes psychokinétiques est nommé effet PK, la perception extra-sensorielle est désignée par les lettres P.E.S. (ou, plus souvent, d‟après les initiales anglo-saxonnes E.S.P.). Finalement, la co-existence, dans le discours des partisans des parasciences, de termes relevant aussi bien du technolecte scientifique que du technolecte parascientifique rend difficile, pour le destinataire profane, de déterminer clairement le champ conceptuel d‟origine des termes techniques. Ainsi, dans un même article, William Chetteoui évoque la psychotronique transpersonnelle, le code génétique, la « structure trichotomique du composé humain », et définit l‟homme comme « une endo-symbiose de différents systèmes énergétiques subordonnés à un niveau supérieur d‟intégration » (« L‟Homme est une endo-symbiose », Autre monde, n°118, juin 1989). Dans cet article sont juxtaposés des termes comme ADN, dont même des non-spécialistes ont entendu parler, et qu‟ils identifient sans hésiter comme appartenant au champ de la science, et d‟autres expres-sions dont la seule chose qu‟ils puissent dire est qu‟ils ne les connaissent pas, mais que leur mode de construction rend leur origine scientifique plausible. On a souvent souligné la fonction sociale du jargon dans le discours scientifique : signe de recon-naissance entre spécialistes, instrument d‟intimidation à l‟égard des profanes, il ne se contente pas de préserver la monosémie du discours scientifique, mais assure aussi à celui qui l‟utilise un
88 Le débat immobile
certain pouvoir. Tout semble suggérer que, dans le discours parascientifique, le jargon remplit des fonctions similaires, et peut aussi, dans certaines situations de communication, servir à manifester la compétence de celui qui l‟emploie (et, corrélati-vement, l‟ignorance de l‟adversaire) davantage qu‟à désigner avec précision certains concepts ou phénomènes.
Différents types de paraphrase Le vocabulaire technique, dans le débat sur les parasciences, fait l‟objet de paraphrases vulgarisatrice qui entraînent la co-présence, dans un même discours, d‟un lexique spécialisé, (du métalangage propre à une parascience ou à une science), et du lexique courant, supposé être celui du destinataire. Cette co-présence de deux langages, loin d‟être inhérente à toute activité de vulgarisation, relève en réalité d‟un choix opéré par le vulgarisateur, comme le montre fort bien Mortureux en comparant la vulgarisation de Descartes ou Fontenelle et la vulgarisation contemporaine :
[Chez Descartes ou Fontenelle] se déploie un “vocabulaire de vulgarisation” qui réalise bien une parole médiane : évitant de souligner l‟écart entre terminologie scientifique et vocabulaire courant, elle le masquerait plutôt, en offrant de l‟Astronomie une vision recevable par tous, y compris les Physiciens. Or cette rhétorique moyenne est conforme à l‟humanisme cartésien. Aujourd‟hui, en revanche, la plupart des discours de vulgarisation scientifique citent abondamment les termes scientifiques, en les doublant de paraphrases non marquées : par là ils creusent l‟écart, dirait-on, en même temps qu‟ils prétendent, sinon le combler, du moins le “franchir”, selon le mot de J.-M. Pelt. C‟est que l‟existence des vocabulaires spécialisés est aujourd‟hui largement admise, et personne n‟imaginerait que l‟on puisse en faire l‟économie. L‟hétérogénéité socio-linguistique est donc reconnue et plus ou moins acceptée, voire revendiquée. (1988 : 144)1
Ce choix est sans doute lié au fait que, en dehors de sa fonction d‟adaptation du niveau des connaissances, la paraphrase vulga-risatrice comporte également une importante valeur taxémique. Comme le rappelle Maingueneau, celui qui paraphrase se pose comme expert du code (ou des codes, dans le cas de la vulgari-sation : français standard, terminologie spécifique), et se place ainsi en position haute :
Par le renvoi au code linguistique et / ou au savoir qu‟elle suppose, la paraphrase place celui qui y recourt en position d‟énonciateur
1 De même, Messadié, analysant l‟évolution de la revue Scientific American,
souligne que de 1845 à 1970, le vocabulaire employé était très proche du lexique d‟un journal “ordinaire” ; ce n‟est qu‟à partir de 1970 que le vocabulaire “savant” fait son apparition dans Scientific American (« Sus au jargon ! », Science & Vie 905, février 1993 : 14-15).
Fonction argumentative … 89
“autorisé” capable de maîtriser les signes. Alors que l‟énonciateur ordinaire se contente de dire, celui qui peut rappeler ce que les mots veulent dire, revenir au fondement, se présente comme celui qui a accès, par-delà les pièges et les imperfections du langage, à ce lieu où le discours rencontrerait la chose même. (1987 : 69)
Le plus souvent, la fonction vulgarisatrice et la valeur taxémique de la paraphrase cohabitent, mais certains procédés discursifs existent, qui permettent à celui qui prend en charge l‟activité paraphrastique de souligner la compétence qu‟elle suppose. Dans bien des cas, l‟élément de la paraphrase que le vulgarisateur reprend à son compte, sans en marquer l‟hétérogénéité par rapport à son propre discours, est l‟expression en “français standard” ; c‟est l‟élément appartenant à la terminologie qui est désigné comme corps étranger : CH : il y a deux sortes de psychokinèse il y a (.) la psychokinèse sur
des objets euh (.) réels de notre réalité sur des barres de ferre euh sur des petits objets qu‟on essaye de déplacer (.) et on appelle ça la macro-psychokinèse […] alors qu‟il y a (.) une autre un autre type d‟expérimentation (.) euh qui est pratiqué couramment dans ces divers laboratoires et qui s’appelle (.) de la micro-psychokinèse c‟est-à-dire de la psychokinèse sur euh (.) système aléatoire
(« Ex Libris » du 08/03/1990, TF1)
Le vulgarisateur se situe alors du côté du récepteur dans le dispositif de vulgarisation. Mais il arrive que l‟ordre soit inversé, et que le locuteur marque l‟expression simplifiée comme étrangère à son propre discours. Il s‟associe ainsi aux producteurs du discours premier, plus qu‟aux destinataires du discours vulgarisé. C‟est le cas de William Chetteoui, qui écrit :
Dans l‟hypothèse d‟un retour cyclique de l‟entité humaine désincarnée, que l’on est convenu d’appeler du terme impropre de réincarnation, parce que limitatif d‟états multiples de l‟être, il paraît acceptable d‟admettre que la personnalité qui survit à la mort physique se transforme en principe mais ne se sépare pas du soi impersonnel qui est la conscience-énergie, l‟entité permanente que l’on est convenu d’appeler l‟esprit, laquelle s‟incorpore à chaque naissance, tandis que le psychisme est transmis par l‟hérédité. (« L‟Homme est une endosymbiose », Autre monde n°118, juin 1989 : 111)
Ici, ce sont successivement les expressions « retour cyclique de l‟entité humaine désincarnée » et « [le] soi impersonnel qui est la conscience-énergie, l‟entité permanente » que le locuteur-vulgarisateur reprend à son compte, alors que les termes empruntés au lexique du destinataire (« réincarnation », « l‟esprit ») sont tenues à distance – voire font l‟objet d‟un jugement évaluatif négatif.
90 Le débat immobile
Reste encore à s‟interroger sur l‟altérité qui est ainsi montrée du doigt entre discours technique et discours vulgarisé. En effet, si Fuchs parle de métaprédication d‟identité entre les deux termes de la paraphrase, elle souligne qu‟il ne peut pour autant y avoir identité stricte des sémantismes de X et Y, la paraphrase impli-quant toujours un déplacement du sens (1982 : 29). Le locuteur paraphrasant, lorsqu‟il pose l‟identification entre les séquences X et Y, le fait toujours en fonction d‟une visée discursive qui l‟autorise à considérer comme pertinentes certaines relations de similitudes entre X et Y, et à négliger momentanément les diffé-rences. Dans le cas de la paraphrase vulgarisatrice, le déplacement qui existe entre le terme appartenant à un métalangage et sa reformulation en langage courant est dû à une opération de simplification. Cette simplification est caractéristique de toute activité de vulgarisation, et fait peser sur le vulgarisateur une double contrainte très difficile à tenir : il doit à la fois tenir sa substance du milieu scientifique qui exige que le message ne soit pas déformé dans sa diffusion, et se rendre accessible au lecteur (ou auditeur) ordinaire, soucieux de ne fournir qu‟un effort cognitif “raisonnable”. Ces exigences contradictoires sont magnifiquement illustrées par la question d‟un journaliste à Albert Einstein, citée en exergue d‟un article de Albertini & Bélisle : « pouvez-vous expliquer en une phrase ce qu‟est la théorie de la relativité ? » (1988 : 225). L‟inconfort qui est ainsi attaché au rôle de vulgarisateur amène souvent celui qui le tient à signifier le caractère bien regrettable, certes, mais inéluctable, des approximations vulgarisatrices. Différents procédés discursifs peuvent marquer l‟irréductibilité du terme spécifique à sa reformulation en langage courant. C‟est le rôle, à l‟écrit, des guillemets, qui, lorsqu‟ils encadrent une expression du langage ordinaire, la marquent comme étrangère au discours du vulgarisateur et comme approximation du discours premier. Dans un article sur la « Médecine énergétique intégrale », on trouve plusieurs de ces guillemets simplificateurs :
[Les filtres-couleur] vont détecter des “fuites” d‟énergie hors de l‟organisme. […] Dès lors, la couleur harmonique de la fréquence en fuite va la “renvoyer à l‟expéditeur”, provoquant une légère surcharge. […] Une entrée anormale d‟énergie due à une trop grande perméabilité provoquera des lésions, à l‟inverse un blocage des échanges à travers ses diverses “couches” retentira sur les éliminations purement matérielles. (Le Monde inconnu n°105, mai 1989 : 23)
D‟autres ressources, lexicales cette fois, remplissent cette même fonction. C‟est le cas, notamment, de l‟expression une sorte de :
L‟Inconnu : Ce qui est étonnant, c‟est qu‟à l'époque vous étiez capable de pénétrer dans la matière par une sorte d'expansion de
Fonction argumentative … 91
la conscience […] Est-ce que ce n'est pas une sorte de psychanalyse en accéléré ? (« Les Nouveaux miracles de la parapsychologie », Nouveau L‟Inconnu, n°158, août 1989 : 9)
C‟est aussi la fonction de certains adverbes, comme schémati-quement ou grosso modo :
Schématiquement, l'homme fonctionne sur plusieurs plans interactifs mais séparés. (Le Monde inconnu n°105, mai 1989 : 23)
L‟Inconnu : on pourrait dire grosso modo qu‟il y a un spectre, spectre qui a été pressenti par André de Bélizal et que Jacques Ravatin appelle « spectre BCM », et qui est une manifestation vibratoire de très faible longueur d‟onde. (« L‟Effet Nocebo », Nouveau L‟Inconnu, n°157, juillet 1989 : 11)
On peut aussi y associer des expressions orales comme si vous voulez, qui soulignent l‟effort que fait le locuteur pour adapter son discours à son destinataire (l‟exemple qui suit est le fait d‟Élisabeth Teissier, au cours d‟un débat sur l‟astrologie) : ET : l‟astrologie c‟est avant tout (.) un langage qui euh (.) qui relie (.)
qui fait le ma- qui signe le mariage entre le le le ciel et la terre (.) c‟est-à-dire euh (.) c‟est le le système de l‟interdépendance (.) si vous voulez c‟est la science de l‟inter- indé- interdépendance universelle
(« Duel sur la Cinq » du 10/06/1988, la 5)
Le locuteur-vulgarisateur, lorsqu‟il fait ainsi le choix de souligner l‟irréductibilité du discours primaire et du discours second, et d‟expliciter l‟appauvrissement qui découle du passage de l‟un à l‟autre, contribue à magnifier le discours primaire, puisque « dire l‟approximatif, c‟est renvoyer implicitement à l‟absolu » (Authier-Revuz 1982 : 46). Ainsi, de même que la vulgarisation scientifique peut contribuer à la célébration du mythe de la science (Roqueplo 1974), la vulgarisation parascientifique contribuerait à élaborer une image magnifiée des lieux où s‟élabore le savoir parascientifique.
3. Conclusion : le rôle des séquences de vulgarisation dans la polémique
Au terme de cette application des études élaborées à partir de la vulgarisation scientifique au discours des partisans des para-sciences, il semble nécessaire d‟apporter quelques précisions sur l‟interprétation des conclusions. En premier lieu, le fait que les participants au débat (et, principalement, les partisans des parasciences) mettent en oeuvre une activité de vulgarisation est parfois interprété a priori, par les adversaires des parasciences, comme la manifestation d‟une stratégie machiavélique mise en oeuvre à des fins de légitimation. Il est peut être préférable de
92 Le débat immobile
considérer qu‟il s‟agit là avant tout du résultat d‟une contrainte imposée par le contrat de communication, liée à une situation où un message complexe, technique, caractérisé notamment par un lexique ésotérique, est adressé à un public plus ou moins vaste de non-spécialistes (et cette contrainte vaut presque autant pour les textes écrits que pour le corpus oral). Mais on peut en revanche parler de stratégie pour la réalisation discursive de cette activité, caractérisée par la mise en scène du rôle de vulgarisateur, à travers les différents procédés présentés plus haut. Et cette stratégie a des conséquences importantes sur la position des différents acteurs du débat sur les parasciences.
D‟abord, le rôle communicationnel de vulgarisateur, ainsi affiché par ceux qui l‟assument, redistribue les rapports de place dans le débat. On a rappelé l‟analyse taxémique de la paraphrase proposée par Maingueneau (1987 : 69). On peut étendre cette observation au rôle de vulgarisateur dans son ensemble, et affirmer que la mise en scène du locuteur-vulgarisateur lui permet de se poser comme indispensable maillon entre les spécialistes et les profanes. Cette relation du vulgarisateur à ceux au nom de qui il parle et ceux à l‟adresse de qui il parle est constitutive de son rôle, puisque, on l‟a vu, c‟est avant tout le rapport de rôles, plus que le rôle lui-même, qui est pertinent. Or, dans le dispositif de la communication vulgarisatrice, si c‟est le spécialiste qui bénéficie d‟une crédibilité maximale, reposant sur un statut et sur une compétence supposée, tout le travail d‟exhibition du vulgarisateur lui permet d‟affirmer sa supériorité sur le profane, en rappelant sans cesse que si le contenu du message est élaboré ailleurs, c‟est parce qu‟il est capable de le comprendre et de le traduire que les non-spécialistes peuvent malgré tout y avoir accès, sous une forme certes dégradée, mais seule adaptée à leur compétence. S‟il n‟est pas lui-même à l‟origine du discours-source, il n‟en est pas moins le “Grand Interprétant”. En marquant la distance entre le discours-source et sa forme vulgarisée, le vulgarisateur renforce son rôle en se posant comme indispensable, alors que, on l‟a vu, sa position est fragilisée par ailleurs par le fait que sa légitimité dépend essentiellement du discours des spécialistes. En ce sens, la position du vulgarisateur présente un paradoxe similaire à celle du porte-parole, qui ne constitue un locuteur autorisé que parce qu‟il accepte de s‟effacer au profit du groupe qu‟il représente (Marcoccia 1993). La valeur taxémique des séquences de vulgarisation illustre l‟observation faite par Windisch, qui souligne que les discours qui reposent sur une « compétence qui s‟exhibe » peuvent avoir des effets très marqués sur le déroulement d‟une polémique,
Fonction argumentative … 93
même si rien, dans leur matérialité linguistique, n‟en laisse entrevoir le caractère conflictuel :
C‟est le questionnement en termes de relations et de rapports de place entre le locuteur et ses interlocuteurs qui fait surgir cette dimension. En tenant ce genre de discours, le locuteur ne conteste pas un discours rival ; il veut mettre l‟adversaire dans une place impossible, intenable, dans la place d‟une personne incompétente, pour ne pas dire imbécile. (...) On peut dire qu‟un tel locuteur cherche à établir une relation de savoir à non-savoir, un rapport inégalitaire lui assurant une position et une image avantageuses dans la situation d‟interlocution par rapport au public - témoin. (1987 : 87)
Par ailleurs, le rôle de vulgarisateur entretient avec l‟argumenta-tion des rapports complexes. On a suggéré que la mise en place d‟une activité de vulgarisation supposait la suspension momen-tanée de la polémique. Lundqvist a soutenu cette idée en montrant que le caractère consensuel de la vulgarisation est directement lié à l‟image que le locuteur se fait de la compé-tence de son destinataire. À partir d‟une expérience où un scientifique est invité à écrire trois textes sur un même sujet, destinés respectivement à des experts, à des semi-experts et à des profanes, elle a observé que seul le premier de ces textes suivait ce qu‟elle appelle un programme argumentatif (les deux autres étant de type descriptif et narratif). Elle en conclut qu‟un scientifique n‟argumente que s‟il se fait de son destinataire une image de “contre-argumentateur” potentiel (ce qui suppose qu‟il lui prête une compétence au moins égale à la sienne) (Lundqvist 1991). Dans le discours de vulgarisation, cet efface-ment, au niveau discursif, des controverses qui peuvent éventuel-lement exister dans les échanges entre experts, construit du discours premier une image consensuelle, et confère au savoir élaboré par les spécialistes un caractère d‟autant plus certain qu‟il semble faire l‟accord des experts. Or, la vulgarisation, dans le discours des partisans des parasciences, se réalise de façon similaire à la vulgarisation scientifique ; elle contribue ainsi à suggérer que les parasciences reposent elles aussi sur des bases consensuelles, admises par les experts en la matière. Pourtant, les parascientifiques eux-mêmes admettent générale-ment qu‟il n‟existe pas encore de corps de savoir constitué dans la plupart des disciplines : on ne compte plus les chapelles en astrologie ou en numérologie. De plus, contrairement aux théories scientifiques, qui sont rarement contestées “du dehors” (même si la science elle-même fait l‟objet, en tant que telle, de nombreuses critiques), les théories parascientifiques sont systé-matiquement discutées par les adversaires des parasciences, qui mettent en cause aussi bien l‟établissement des faits que les
94 Le débat immobile
explications qui en sont proposées. Pour les partisans des parasciences, tenir (et afficher) le rôle communicationnel de vulgarisateur permet de sortir du débat, de nier le caractère conflictuel de leurs allégations, de faire, dans les limites de la séquence vulgarisatrice, comme si la polémique n‟existait pas. Pourtant, ces séquences, à la lumière du débat sur les parasciences, comportent des éléments fortement polémiques. Ainsi, lorsque Claude Boublil définit la dianétique comme une science sur le mental, ou qu‟André Garel traduit le suffixe -logos, qui entre dans la composition du terme morphopsychologie, par science, ils présentent cette définition comme une paraphrase vulgarisatrice manifestant un savoir, et non comme une définition argumentative qui marque une position dans un débat. Or, la scientificité de ces théories constitue précisément un des noeuds principaux de la polémique.1
Enfin, en dehors des similitudes formelles, on a vu que coexis-taient dans le débat des séquences de vulgarisation portant sur des notions tant scientifiques que parascientifiques : William Chetteoui définit aussi bien l‟A.D.N. que les quanta d‟esprit. Par ailleurs, le choix même des sujets et des invités, dans certaines émissions, facilite encore la confusion. Ainsi, dans l‟émission « Ex Libris » du 08/03/1990, Patrick Poivre d‟Arvor invite le journaliste scientifique Jean-Yves Casgha pour parler des neutrinos et des accélérateurs de particules, mais aussi de réincarnation ou d‟ovnis. Cette double proximité, formelle et matérielle, des discours de vulgarisation scientifique et para-scientifique, entretient une confusion entre la nature des discours-sources à l‟origine des discours vulgarisés scientifiques et parascientifiques, qui deviennent rapidement, pour le destinataire profane, indiscernables. Et cette confusion est d‟autant plus aisée que le discours de vulgarisation scientifique entretient des rapports complexes avec le discours ésotérique dont il tire sa légitimité, et ne réussit pas toujours à en retenir la scientificité. De nombreux auteurs s‟accordent ainsi pour constater que la vulgarisation scientifique n‟arrive pas à dire la science, à rendre compte de ce qui fait la scientificité d‟une théorie, mais ne fait que montrer le spectacle de la science, qu‟en célébrer le mythe. Cette incapacité à
1 Signalons que même la vulgarisation scientifique comporte une part importante
d‟argumentation, malgré la tendance précédemment mentionnée. En effet, dans la mesure où la vulgarisation scientifique vise à provoquer chez son destinataire une modification d‟un état de connaissance (Jacobi 1987 : 75), elle consiste souvent à montrer la non-validité des anciennes théories pour faire la place aux nouvelles – comme d‟ailleurs le discours scientifique ésotérique lui-même (Barthes 1978 : 37, Latour 1984 : 104).
Fonction argumentative … 95
restituer l‟essence même de l‟activité scientifique serait à l‟origine de certains effets pervers de la vulgarisation :
Promouvant en permanence de nouvelles théories, discréditant d‟anciennes théories considérées comme valides il y a quelques années seulement, elle [la vulgarisation scientifique] accrédite l‟idée suivant laquelle toutes les théories scientifiques sont faites pour être dépassées. En bref, tout est possible : erreur aujourd‟hui, vérité demain. Le caractère mouvant et provisoire du savoir scientifique à un moment libère les derniers garde-fous de l‟imagination populaire. Au lieu d‟apparaître comme une survivance anachronique, le mythe se présente désormais comme ce qui sera démontré bientôt, une fois les théories actuelles rendues caduques par de nouvelles découvertes. Ayant perdu tout repère du vrai et du faux, du probable et de l‟improbable, le public retourne à un état de crédulité fantastique. Ne pouvant plus juger le contenu des théories, il repose uniquement, pour se forger une opinion, sur la source des théories et leur apparence. (Kapferer & Dubois 1981 : 260)
C‟est cette équiprobabilité de tous les possibles que pose Anne Meurois-Givaudan, interrogée par Patrick Poivre d‟Arvor sur sa première réaction lorsque son mari lui a parlé de ses “voyages hors du corps” : AMG : je dois dire que quand Daniel m‟en a parlé je me suis dit après
tout pourquoi pas parce que tout est possible à la limite (« Ex Libris » du 08/03/1990, TF1)
On retrouvera ce phénomène souvent présenté comme un effet pervers de la vulgarisation scientifique dans l‟analyse des schématisations que les acteurs du débat présentent d‟eux-mêmes (et particulièrement, dans ce qui sera décrit comme l‟“appel à Galilée”). Finalement, le critère de compétence, qui, dans le débat sur les parasciences, assied le droit à la parole des locuteurs et renforce la crédibilité de leurs discours, favorise globalement les partisans des parasciences. Investis dès le départ du contrôle du thème grâce à la répartition des territoires d‟expertise, ils usent de cet avantage pour discréditer le discours de leurs adversaires, voire les réduire au silence. Le plus souvent vainqueurs des négociations sur la compétence, les défenseurs des parasciences manifestent leur position privilégiée dans le débat en développant une importante activité de vulgarisation, dont la valeur taxémique renforce leur position. Plus fondamentalement encore, les séquences vulgarisatrices gomment les frontières formelles entre savoir scientifique et parascientifique, et accroissent ainsi la crédibilité des théories parascientifiques.
Chapitre 5 : Le débat selon les
adversaires des parasciences :
la rhétorique de l’épouvantail
Les procédés analysés au chapitre précédent permettent aux acteurs du débat sur les parasciences, manifestant leur compé-tence, de revendiquer le droit d‟intervenir dans la polémique, et d‟en définir les termes. Cette recherche de légitimation se double de toute une série de procédés visant, cette fois, à construire et à imposer une interprétation du débat. Ce travail est indispensable, et son analyse est cruciale. Pour les débatteurs, c‟est un moyen de donner un sens à leur affrontement, et de l‟inscrire dans un cadre qui renforce leurs argumentations ; et pour l‟analyste, la reconstruction du cadre interprétatif proposé par les débatteurs est un fil d‟Ariane qui lui permet de relier différents procédés discursifs qui apparaissent a priori isolés et difficilement interprétables. En effet, d‟une manière générale, « pour tenir un discours sur n‟importe quel sujet, il faut en avoir une idée, s‟en être fait une certaine représentation » (Grize 1990 : 33). En dehors de cette représentation, qui guide le locuteur dans son travail cognitif, un individu engagé dans une polémique doit aussi construire sémiotiquement (à l‟aide du langage verbal, mais aussi d‟autres systèmes de signes) des images – des schématisations, selon la terminologie de Grize – des différents éléments qui interviennent dans cette polémique. Il doit ainsi élaborer une schématisation de lui-même (se constituer un ethos, dirait l‟ancienne rhétorique), de son adversaire (c‟est-à-dire de son interlocuteur ou, plus largement, du camp adverse), ainsi que de l‟affrontement qui les oppose et de l‟auditoire qui y assiste. Alors que l‟élaboration de représentations est à destination interne (elle se fait au seul bénéfice du locuteur), la construction de schématisations a une fin persuasive, et est à destination de l‟auditoire : il s‟agit, pour l‟individu engagé dans la polémique, de donner à l‟interaction un surplus de sens, en tirant chaque événement de la polémique, chaque réplique, chaque mimique, vers une interprétation qui renforce l‟orientation argumentative de son discours. Contrairement aux représentations, qui ne mettent en oeuvre aucun matériau verbal, les schématisations peuvent être mises à jour par des approches lexicales, rhétoriques ou argumentatives.
98 Le débat immobile
Dans le débat sur les parasciences, aussi bien les partisans que les adversaires des parasciences construisent de telles schématisations de leur propre camp, de leurs adversaires, ainsi que des relations qui les unissent. Les trois chapitres qui suivent décrivent ces schématisations, qui constituent des enjeux fondamentaux dans le débat. L‟interprétation du débat élaborée par les adversaires des parasciences (chapitre 5) repose sur une logique de dénonciation qui s‟incarne dans une “rhétorique de l‟épouvantail”. À cette interprétation s‟oppose la schématisation construite par les partisans des parasciences, qui s‟articule sur deux mécanismes argumentatifs principaux : les procédés de dissociation visant à trier le bon grain de l‟ivraie tant parmi les parascientifiques que parmi les scientifiques (chapitre 6), et la figure argumentative de l‟“appel à Galilée” (chapitre 7).
1. CHAMPS MÉTAPHORIQUES
Les opposants aux parasciences proposent une schématisation assez manichéenne du débat. Pour eux, il se réduit à l‟affronte-ment entre la raison, incarnée par la communauté scientifique, elle-même présentée comme un bloc, et les ténèbres, l‟obscu-rantisme, l‟exploitation sans scrupule de la misère humaine. Ils développent un discours catastrophiste reposant sur ce qu‟on pourrait appeler une “rhétorique de l‟épouvantail”, visant à imposer la nécessité de réagir devant ce qu‟ils appellent la “montée de l‟irrationnel”. Cette rhétorique de l‟épouvantail exploite un champ métaphorique qui associe le développement actuel des parasciences à divers types de catastrophes : guerre, raz-de-marée, épidémie, catastrophe écologique. Elle exploite la fonction argumentative de l‟analogie, qui consiste à transférer un jugement évaluatif généralement admis, du phore (de l‟objet pris comme base de l‟analogie) vers le thème (l‟objet dont il est question, et dont on cherche à faire admettre qu‟il est bon ou mauvais). Contrairement à la métaphore poétique, qui recherche « la fulgurance éblouissante qui troue le prosaïsme du discours » (Boissinot 1992 : 92), les métaphores argumentatives mises en oeuvre dans le discours des opposants aux parasciences, visant à présenter le développement de ces dernières comme une nuisance, sont d‟autant plus efficaces que les topoi sur lesquels elles reposent sont largement admis. Dans le discours des adversaires des parasciences, le caractère néfaste du phore n‟est guère contestable : qui peut louer les mérites d‟un raz-de-marée ou d‟une épidémie ?
Rhétorique de l‟épouvantail 99
1.1. La métaphore “liquide”
La métaphore aquatique, présentant les parasciences comme une masse liquide qui s‟engouffre plus ou moins violemment dans la société, est sans doute la plus courante. Ainsi, Henri Broch, préfaçant l‟édition française d‟un ouvrage d‟Isaac Asimov, souligne l‟actualité des textes présentés :
Je tiens à souligner combien tous ces textes sont d‟actualité dans un monde secoué dans ses fondements par des progrès scientifiques et technologiques tels qu‟ils finissent par le rendre quasi-magique aux profanes, ceci expliquant en partie ce déferlement d’obscurantisme qui nous envahit depuis déjà quelques années et contre lequel Isaac Asimov tente de nous mettre en garde. (Préface de Isaac Asimov, Les Moissons…: 14)
La métaphore en elle-même n‟est pas argumentative, dans la mesure où le terme « déferlement » n‟implique aucun jugement négatif (si ce n‟est qu‟il suggère une perte de contrôle de ce qui déferle). C‟est l‟association de la métaphore et du terme « obscurantisme », qui évoque, lui, un jugement négatif sans équivoque, qui permet de faire entrer l‟expression dans une logique de dénonciation. Diverses variations existent à partir de l‟isotopie aquatique. Certaines axiologisent directement la métaphore aquatique en évoquant une eau impure. Ainsi, Michel Rouzé dénonce « le marécage de l‟ignorance et de la superstition » (AFIS n°190 : 25). Yves Galifret, secrétaire général de l‟Union Rationaliste, cité par Michel Rouzé, reprend cette idée dans un texte où il évoque le combat des rationalistes contre les parasciences :
“En fait, on écope l‟eau dans une barque trouée. Nous rabâchons sans cesse les mêmes arguments. C‟est décourageant mais indispensable. Sans nous, la barque s‟enfoncerait encore plus”. Ne pas se laisser noyer, empêcher que d‟autres succombent, n‟est-ce pas assez pour continuer ? Le flot boueux ne montera pas toujours. (AFIS n°186 : 18)
Une variante est la métaphore écologique de la marée noire, qui apparaît une fois encore sous la plume de Michel Rouzé, évoquant le cas d‟enseignants dispensant des cours d‟astrologie à leurs élèves :
Souhaitons qu‟ils demeurent une exception : ceux qui ont la charge d‟aider la formation des jeunes esprits devraient être les premiers à endiguer la marée noire de l‟obscurantisme. (« “Parapsy 92” : du surnaturel au naturel », AFIS n°196 : 21)
On peut encore relever la métaphore filée par Alain Cuniot dans l‟introduction de son ouvrage de dénonciation des parasciences, inspirée d‟un film fantastique où une masse visqueuse, le blob, envahissait le monde moderne :
100 Le débat immobile
Hé oui, le Blob est parmi nous ! La matière visqueuse ne vient pas derrière un fauteuil pour happer le téléspectateur, le Blob est dans la télévision. Il est diffusé à France Inter lorsqu‟un farfelu béni par la direction des programmes décide que le destin du terrien repose sur l‟addition de sa date de naissance et des lettres de son nom. On appelle cela la numérologie. Car la matière visqueuse, pour ne pas effrayer, se pare des plumes d‟un pseudo paon à visage scientifique. (Incroyable…: 27)
1.2. La métaphore de la guerre et de l’espionnage Un autre champ métaphorique participant de la schématisation du camp adverse dans le discours des opposants aux parasciences évoque une activité guerrière, où la mère patrie, la Raison, serait victime des invasions et des tentatives d‟infiltration des tenants de l‟irrationnel. Ainsi, Michel Rouzé, dans le numéro 205 des Cahiers de l‟AFIS, s‟insurge contre l‟attitude favorable de certains enseignants envers les parasciences, et souligne :
Ce n‟est pas la première fois que nous constatons l’infiltration de la pseudo-science dans un milieu qui devrait être le plus actif contre l‟obscurantisme, celui de l‟enseignement. (AFIS n°205 : 31)
De même, Gérald Messadié, interrogé sur sa lutte contre l‟irra-tionnel, utilise une métaphore dont le phore est emprunté au domaine de l‟espionnage : AD : alors Gérald (.) vous connaissez bien le professeur Broch (.) [vous
GM : [oui
AD : avez échangé de [longues corres-
GM : [nous servons dans la même armée
AD : vous servez dans la même armée (.) et vous dites de lui que c‟est l’Attila de l‟absurdisant
GM : l‟Absurdistan oui
AD : l‟Absurdistan
GM : oui euh nous sommes entourés euh (.) par des ennemis (.) euh (.) constants (.) euh les citoyens de l‟Absurdistan ceux qui croient à (.) à la parapsychologie à l‟astrologie à la numérologie (.) euh à la mémoire de l‟eau (.) à ce à un certain nombre de fadaises de ce genre (.) et ça fait quand même de très nombreuses années que euh nous pourchassons euh les la cinquième colonne de l’Absurdistan
(« Nulle part ailleurs » du 30/09/1993, Canal +)
1.3. La métaphore de la maladie Les champs métaphoriques précédents sont souvent associés, par exemple dans un article paru en 1931 sur « la magie et la sorcel-lerie aux États-Unis », où s‟ajoute encore la métaphore de l‟épidémie :
Victime d‟une vague de superstition, comme le monde n‟en a pas connu depuis le Moyen-Âge, le peuple des États-Unis verse
Rhétorique de l‟épouvantail 101
125000000 de dollars (5 milliards 625 millions de francs-papier) à une armée de cent mille magiciens de toute espèce, qui se désignent par les noms de nécromanciens, astrologues, devins, oniromanciens, chiromanciens, phrénologistes, tireurs de cartes, diseurs de bonne aventure, liseurs de l‟avenir dans les feuilles de thé, et autres charlatans qui infestent cet immense pays d‟un bout à l‟autre. (Michel Mok, L‟En Dehors, 15 juillet 1931 : 12)1
La métaphore de la catastrophe naturelle est associée à celle de l‟épidémie sous la plume de Michel Rouzé, qui évoque le déve-loppement des parasciences en Pologne :
Nous avons parfois parlé de “marée noire” en évoquant la montée des croyances à l‟irrationnel, favorisée par l‟inquiétude des temps présents. Dans des pays de culture occidentale, le mal est tempéré par des anticorps (comme nos modestes Cahiers). Dans ceux où s‟est levée la chape des “vérités” officielles en même temps qu‟ils tombaient dans le désordre social, le charlatanisme envahit le terrain avec la rapidité d‟un virus dans une population non-vaccinée. (AFIS n°205 : 19)
À travers ces diverses métaphores, les parasciences, désignées par les termes axiologiquement marqués d‟« irrationnel » ou d‟« obscurantisme », sont personnalisées, mises en scènes comme des entités ennemies animées par une volonté « d‟infiltrer » ou de « s‟insinuer », de se « glisser subrepticement » au pays de Descartes. Face à elles, leurs adversaires font figure d‟irréductibles gaulois qui « mettent en garde », « résistent », « dénoncent », « écopent », « combattent », « sauvegardent » ce qui peut l‟être, et défendent le corps social contre cet ennemi multiforme que constituent les parasciences.
2. DÉNONCIATION DU RÔLE DES MÉDIAS
La rhétorique de l‟épouvantail est systématiquement associée à une dénonciation du rôle des médias, accusés d‟amplifier le phénomène, et de servir de caisse de résonance à la diffusion des disciplines non prouvées. On en trouve de nombreux exemples dans le corpus écrit. Ainsi, Gilbert Carraz, soulignant les dangers du développement des médecines douces, dénonce les vecteurs de ce développement :
1 L‟En dehors est un journal libertaire du début du siècle. Le fait que la
“rhétorique de l‟épouvantail” apparaisse dans des textes datant d‟une soixantaine d‟années permet de jeter le doute sur la réalité de la montée des parasciences. Contrairement à ce que suggère cette rhétorique, la progression des parasciences ne va pas de soi, et mérite d‟être analysée “objectivement”. En admettant même qu‟elle corresponde à une réalité, sa permanence historique invite à penser qu‟il s‟agit avant tout d‟une clause de style.
102 Le débat immobile
Ni la subordination, par trop étroite, à des croyances ancestrales périmées, ni le comportement de quelques écervelés, ne suffiraient cependant à provoquer le développement de pratiques dangereuses si elles n‟étaient pas propagées par une certaine presse écrite ou parlée, ou par des ouvrages jouissant d‟une scandaleuse publicité. […] Le public doit savoir que toutes ces floraisons (c‟est le cas de le dire) d‟articles, d‟ouvrages sur la médecine par les plantes, sont basées sur des intérêts financiers entre sectes religieuses, sociétés commerciales et la grande presse. (Médecines douces et charlatans, Grenoble : Glénat, p. 27)
La critique est parfois plus précise, et porte sur l‟organisation des débats sur les parasciences. Michel Rouzé dénonce ainsi le déséquilibre numérique qui y est de règle entre partisans et adversaires des parasciences :
On connaît la recette du pâté de cheval et d‟alouette, dont la composition recourt équitablement aux deux ingrédients : un cheval, une alouette. La télé a mis au point cette technique, qui donne l‟illusion de l‟objectivité. (« À votre santé : l‟astrologie au pâté d‟alouette », AFIS n°200 : 24)
Jean-Claude Pecker, interviewé sur l‟astrologie par une journaliste de l‟Express, va jusqu‟à refuser le principe même d‟une représentation symétrique des deux camps, et à contester le droit à la parole des partisans des parasciences :
Permettez-moi, d‟ailleurs, de protester contre la symétrie abusive entre les points de vue des astronomes et ceux des astrologues : il n‟y a pas de symétrie entre la vérité scientifique et la mystification. (L‟Express du 27 mai au 2 juin 1993 : 93)
Dans les débats télévisés, la dénonciation du rôle des médias présente certaines caractéristiques qui sont absentes des textes écrits. Lorsqu‟elle s‟exprime à la télévision, cette critique revêt le même caractère paradoxal que les protestations de Jean-Marie Le Pen, leader du Front National, qui, à chacune de ses apparitions télévisées, dénonce le silence imposé à son parti par les grands médias – ce à quoi il se voit régulièrement répondre que le fait même qu‟il puisse faire état de ses récriminations sur une chaîne de télévision en démontre l‟inanité. S‟en prendre ainsi aux médias dans leur ensemble, et au responsable du débat en cours en particulier, est le meilleur moyen pour se garantir une position inconfortable, et indisposer celui qui décide du temps de parole des invités : l‟animateur. Par ailleurs, le déséquilibre numérique dont souffrent presque toujours les adversaires des parasciences les accule à une posi-tion extrémiste qu‟ils n‟adopteraient sans doute pas dans un cadre plus équilibré, et qui encourage chez eux une véhémence qui tranche (souvent en leur défaveur) sur l‟atmosphère consen-suelle qui règne par ailleurs sur le plateau. Anticipant sur les réactions défavorables de la majorité des invités, ils en viennent
Rhétorique de l‟épouvantail 103
parfois à tenir un discours quasi-paranoïaque, qui les expose plus encore aux attaques de leurs contradicteurs. Ainsi, l‟écrivain Cavanna, invité à l‟émission « Mardi soir », se plaint de ce que les débats télévisés sur les parasciences réservent toujours le mauvais rôle aux rationalistes : DB : alors Cavanna (.) vous écoutez avec attention […] alors Cavanna
vous vous êtes radicalement contre vous croyez pas à à pas à tout ça
C : oui absolument oui moi je suis le vilain de service je suis le rationaliste [euh (.) qu‟on sort de sa boîte oui pour faire rigoler
DB : [pur et dur C : parce que je sais très bien que ce genre d‟émission (.) avec un
pour et un contre c‟est euh d‟abord c‟est le principe même est déjà (.) répugnant (.) est-ce qu‟on va faire une émission pour ou contre un et un font deux ?
(« Mardi soir » du 15/10/1991, France 2)
De façon assez similaire, lors de l‟émission « Durand la Nuit », Alain Cuniot sent monter les protestations à la fin de son inter-vention, et s‟exclame : AC : ça y est je sens que je vais être la pointe de (.) [rire] l‟agrément
de (.) [rire] allez-y (.) feu sur le rationaliste (.) feu sur le rationaliste [rire] [brouhaha, applaudissements ironiques]
(« Durand la nuit » du 11/05/1993, TF1)
Cette intervention s‟accompagne d‟une gestuelle où Cuniot, bras écartés, torse offert, se désigne comme cible aux flèches de ses adversaires qui l‟entourent de toutes parts, entraînant ainsi de vives réactions des invités du plateau, qui visent toutes à le tourner en ridicule. Plus tard, Brigitte Lahaie, invitée pour parler d‟une émission radiophonique où elle interprète les songes, enjoint vivement les autres invités à ne pas entrer dans le jeu d‟Alain Cuniot, et à ne pas lui concéder le rôle de martyr qu‟il se propose lui-même, suivie en cela par le parapsychologue Yves Lignon : BL : il faut surtout pas l‟attaquer il serait trop content GD : non non ce que je voudrais simplement dire [c‟est que YL : [non mais on ne tire
pas sur les ambulances surtout quand elles ont des pneus crevés (« Durand la Nuit », 11/05/1993, TF1)
À l‟appui de l‟hypothèse selon laquelle la sous-représentation des adversaires des parasciences à la télévision renforce la virulence de leur discours, on peut remarquer que dans la seule émission du corpus où les opposants aux parasciences sont plus représentés que leurs partisans, leur ton est beaucoup plus posé et moins dénonciateur que dans les autres émissions (il s‟agit de l‟émission « Nulle part ailleurs » dont l‟invité principal est Henri Broch).
104 Le débat immobile
3. POSITION DE L’AUDITOIRE : LES “GOGOS”
La schématisation du débat sur les parasciences par les “anti-parascientifiques” ne serait pas complète si elle n‟associait pas à l‟image qu‟ils proposent d‟eux-mêmes et de leurs adversaires l‟image de l‟auditoire lui-même. D‟une façon très générale, le simple fait de prendre parti clairement dans le débat constitue une menace pour la face d‟une partie au moins de l‟auditoire – celle qui a adopté la position opposée. En effet, si le caractère menaçant de la réfutation a été souligné à diverses reprises, il semble que le simple fait d‟affirmer une opinion nette sur un sujet peut constituer une menace pour les partisans de la position opposée. Cette caractéristique de l‟argumentation est liée à la logique du tiers exclu, qui veut que de deux positions contradictoires, l‟une soit nécessairement fausse. Selon cette logique, affirmer que l‟on a raison, c‟est affirmer du même coup que l‟autre a tort – ce qui constitue clairement une offense. C‟est ce qui explique sans doute le parti-pris de neutralité qui caractérise la fonction d‟animateur dans la plupart des émissions et des débats télévisés. Cet impératif de neutralité entraîne une multiplication des précautions oratoires. Ainsi, François de Closets, lançant l‟émission « Savoir plus » consacrée aux « marchands d‟avenir », évoque les Français qui consultent les voyants, et précise qu‟ « il n‟y a là rien que de très légitime ». Un peu plus tard dans l‟émission, introduisant Gérard Miller, il revient encore sur l‟impossibilité de donner tort aux dix millions de Français qui cherchent à connaître leur avenir : FC : alors (.) euh première question Gérard Miller vous êtes
psychanalyste (.) il est pas question il peut pas être question de dire que ces dix millions de Français ont complètement tort et de les culpabiliser
(« Savoir plus » du 01/03/1993, France 2)
En conclusion, François de Closets reprend le même thème, légitimant les critiques lancées contre la voyance au cours de l‟émission par l‟évocation des risques courus par le public : FC : alors (.) bon bien sûr hein (.) faut-il ou non consulter euh
astrologue euh devin euh numérologue euh (.) nous ne sommes pas là et c‟était pas notre propos euh de répondre (.) euh et simplement sachez-le sur le marché de l‟avenir (.) il n‟y a on l‟a dit hein très clairement ni règle ni déontologie donc euh (.) faites attention (.) regardez à deux fois (.) pour savoir où vous allez (.) parce que tout de même (.) il y a (.) des risques (.) des risques financiers (.) on l‟a vu (.) des risques plus graves (.) aussi il faut le dire (.) donc euh quand même (.) attention et j‟espère qu‟on vous a donné quelques pistes pour vous repérer
(« Savoir plus » du 01/03/1993, France 2)
Rhétorique de l‟épouvantail 105
Mais les invités de ces mêmes émissions ne peuvent se retrancher derrière une neutralité affichée, puisqu‟ils sont précisément admis sur le plateau pour prendre parti. La situation est fort délicate : certaines critiques portant sur les parasciences ou sur ceux qui ont en charge leur défense sur le plateau sont susceptibles de rejaillir sur la partie du public qui leur est favorable.1 Bien souvent, le militantisme qui anime les adversaires des parasciences les amène à adopter des positions radicales, à dénoncer plutôt qu‟à critiquer, à chercher à triompher de leur adversaire plus qu‟à ménager leur auditoire. Les critiques qui visent à démontrer l‟inanité des théories parascientifiques atteignent plus ou moins directement les “consommateurs de parasciences”, qui constituent, justement, la cible que les “anti-parascientifiques” cherchent à convaincre. C‟est le cas lorsque, s‟interrogeant sur les causes du succès des parasciences, les adversaires des parasciences présentent le simple fait que l‟on puisse adhérer aux thèses “para” comme une aberration. Ainsi, Dominique Ballereau, astronome, après avoir défini l‟astrologie, s‟étonne de son succès : DB : il est bien évident que c‟est une (.) théorie à laquelle (.) peu de
gens croient (.) comment peut-on croire un seul instant que quand on naît (.) tel jour à telle heure à tel endroit (.) euh vous serez euh à cinquante ans euh poliomyélitique à soixante-cinq ans vous aurez des (.) vous aurez des choses
(« Duel sur la Cinq » du 10/06/1988, la 5)
L‟astronome, en lançant une interrogation rhétorique, suggère une réponse du type “en aucune façon, dans des circonstances normales” (c‟est-à-dire à moins d‟être fou, stupide, aveugle, saoul, etc.... – circonstances exceptionnelles qui ne sont guère flatteuses pour les partisans des parasciences). Un peu plus loin, l‟astronome, caractérisant les personnes qui ne croient pas à l‟astrologie, trace en creux l‟image de ceux qui y sont favorables – et cette image en négatif est assez sévère : DB : vous venez de dire que je suis contre l‟astrologie (.) euh il existe
de par le monde (.) la totalité de la communauté (.) astronomique internationale qui est contre (.) la totalité de la communauté (.) scientifique tout court (.) physiciens chimistes et caetera (.) et d‟une manière générale (.) tous les gens de bon sens (.) euh n’acceptent pas l’astrologie
(« Duel sur la Cinq » du 10/06/1988, la 5)
1 C‟est le dilemme auquel sont confrontés les hommes politiques face à Jean-
Marie Le Pen : comment dénoncer les opinions de ce dernier avec la fermeté qui s‟impose, sans risquer de s‟attacher le ressentiment de son électorat ? On se souvient comment, il y a quelques années, Bernard Tapie avait résolu la question, renonçant à ménager les électeurs du Front National, qu‟il avait traités de “salauds”.
106 Le débat immobile
L‟inférence que cette caractérisation des opposants aux para-sciences permet de tirer sur les partisans de ces disciplines ne souffre d‟aucune ambiguïté. De façon assez similaire, le Marcus de Cicéron s‟exclamait, au sujet de la divination :
Voilà des contes que ne croient même pas les petites vieilles (Cicéron, De la divination… : 117)
Faut-il en déduire que ceux qui y croient sont “pires que des petites vieilles” ? On le voit, l‟explication la plus souvent proposée de l‟adhésion aux thèses parascientifiques est de supposer que leurs partisans sont affligés de quelque tare qui amoindrit leurs capacités intel-lectuelles. Un tel discours risque de mettre en danger ce qu‟on suppose être son objectif premier : gagner les lecteurs à sa cause. Comment peut-on espérer convaincre un auditoire dont on a dénoncé les « insuffisances cérébrales » ? La sympathie de qui peut-on espérer attirer, sinon de ceux qui étaient acquis d‟avance ? Pourtant, de tels discours, loin d‟être exceptionnels, illustrent assez bien l‟image que les opposants aux parasciences renvoient à leur auditoire. Le goût du public pour les parasciences est qualifié de « douteux » (Robert Joly, « La parapsychologie…» : 212), les partisans des parasciences sont décrits comme des « âmes simples » (AFIS n°201 : 19), des « esprits naïfs » (AFIS n°197, p.8), des « bonnes âmes » (Robert Joly, « La parapsychologie…»: 202), des « hommes de bonne foi mais hélas niais, crédules » (Henri Caillavet, postface à Alain Cuniot, Incroyable…: 311). Les “rationalistes” vont jusqu‟à proposer une interprétation pathologique de l‟adhésion aux parasciences. Dans l‟émission « Français si vous parliez » sur la cartomancie, le psychiatre Marcel Rufo met en doute la santé mentale de ses adversaires, après qu‟un cartomancien ait affirmé obtenir ses informations des esprits des défunts : MR : je communique avec les esprits (.) il est pas loin de
l‟hospitalisation ce garçon-là je veux dire que (.) avec ça on lui fait une hospitalisation à la de[mande d‟un tiers hein hein
AB : [les infirmiers sont là de toute façon (« Français si vous parliez » du 20/05/1993, France 3)
De même, le docteur Samuel Lepastier, psychiatre, lors de l‟émission « Santé à la une » consacrée à l‟application de l‟astrologie à la santé, décrit les adeptes de l‟astrologie comme des individus « pas très développés au niveau affectif », « obligés d‟emprunter leurs fantasmes à un système préconstruit » (« Santé à la une » du 04/01/1993). L‟utilisation du terme “gogos” pour désigner les consomma-teurs de parasciences cristallise parfaitement ce qu‟une telle image de l‟auditoire peut avoir de dangereux. Ce terme est
Rhétorique de l‟épouvantail 107
relativement récurrent chez les opposants aux parasciences. Un article du Canard enchaîné consacré aux « gogothérapies » dénonce « la pêche aux gogos » (Les Dossiers du Canard, juin 1990, « Le grand bazar du bizarre »). Un dossier de L‟Événement du Jeudi sur “l'irrationnel” est intitulé « L‟art de magnétiser les gogos » (L‟Événement du Jeudi du 26 octobre au 1er novembre 1989). Lors du « Star à la barre » sur “la parapsychologie et le surnaturel”, c‟est l‟animateur lui-même (Daniel Bilalian) qui introduit le terme. Repris par un de ses invités, le mage Alexis, il ouvre une rapide négociation, à laquelle participe Gérard Majax, sur le terme à adopter : DB : bien alors quand j‟dis quand j‟dis qu‟c‟est très facile d‟attraper
l‟gogo (.) je veux dire par là que (.) [vous êtes un MA : [le gogo est un mot ordinaire DB : bon ben alors disons le MA : c‟est vraiment ordinaire DB : bon alors qu‟es- que pourrait-on dire alors (.) si c‟est ordinaire MA : gogo c‟est vraiment je com- je comprends pas DB : le crédule (.) le crédule (.) Majax ? MA : le crédule GM : gaga DB : le ? GM : gaga DB : le gaga [riant] MA : mais c‟est dix millions de personnes
(« Star à la barre » du 09/05/1989, France 2)
Le caractère péjoratif des appellations substituées à “gogo” (« gagas », « crédules ») permet au mage Alexis de se poser en défenseur des consommateurs de parasciences en rappelant que ce sont dix millions de personnes (chiffre souvent avancé pour les clients de la voyance) que l‟on traite ainsi de “gagas”.1 La négociation aboutit finalement à l‟adoption du terme de crédule, avancé par Bilalian, mais cette adoption apparaît chez le mage Alexis comme une concession : MA : alors le crédule si vous voulez
(« Star à la barre » du 09/05/1989, France 2)
1 La défense des consommateurs de parasciences peut aussi constituer une
manière efficace de contrer une attaque personnelle ; c‟est ce que montre l‟échange suivant, opposant Cavanna au voyant Didier Derlich qui, attaqué, en appelle au respect du public :
C : vous êtes tous des charlatans DD : mais non on n‟est pas des charlatans C : absolument tous DD : non nous n‟sommes pas des charlatans (.) vous insultez dix millions de
personnes qui croient à la voyance monsieur (« Star à la barre » du 09/05/1989, France 2)
108 Le débat immobile
Aussi Macha Béranger propose-t-elle peu après une nouvelle appellation, qu‟elle présente comme une façon de caractériser les clients de la voyance sans les condamner : MB : j‟écoute toutes les nuits des gens qui ont besoin d‟être rassurés (.)
ce sont évidemment les clients de ces personnes (.) et quand je vois des sorciers (.) euh bien j‟ai très peur pour ceux que vous appelez les gogos (.) qui en fait sont des naïfs gentils et qui ont besoin d‟être aimés et d‟être rassurés
(« Star à la barre » du 09/05/1989, France 2)
Il n‟est pas certain que la nouvelle dénomination atteigne l‟objectif qu‟elle s‟assignait, “naïf” aussi bien que “gentil” constituant des euphémisations quasiment conventionnelles de “benêt”... Le terme de “gogo”, dont l‟utilisation est ici dénoncée, implique en fait une dualité que les acteurs du débat sur les parasciences ne manquent pas d‟exploiter. Le gogo est un idiot, comme le suggèrent la plupart des expressions qui désignent les arnaques : “attrape-nigaud”, “piège à c...”... Mais le gogo est aussi une victime ; comme victime, il doit être défendu, et l‟attaque de ses « arnaqueurs » est à son bénéfice entier. Faire des partisans des parasciences des victimes permet de faire oublier la connotation péjorative de “gogos”, et fait de l‟opposant aux parasciences non plus un arbitre de l‟intelligence ou de la bêtise, mais un défenseur d‟une partie de l‟auditoire, mise en danger par les parasciences. Les opposants aux parasciences insistent souvent sur des facteurs qui rendraient les consommateurs des parasciences plus vulnérables aux arnaques. Ces facteurs constituent autant d‟excuses à une crédulité conjoncturelle, liée à ce qu‟on pourrait résumer par les “aléas de la vie”. Ainsi, Cavanna, dans l‟émission « Mardi soir » consacrée à la sorcellerie, après s‟en être pris violemment aux consommateurs de parasciences, atténue l‟agression en évoquant les “difficultés de la vie” qui favorisent le recours aux parasciences : DB : comment e- e- vous expliquez vous que des gens puissent être
tentés par ça (.) c‟est [quoi c‟est C : [oh (.) très facilement (.) on est déçu (.) on a
euh sur le plan professionnel sur le plan sur le plan sentimental (.) euh la [santé enfin [on a des tas de sujets d‟angoisse vous savez
DB : [oui [voilà C : la vie c‟est quelque chose de vraiment (.) très difficile (.) à vivre
(.) [eh ben oui il y a des gens qui le vivent vraiment très mal (.) DB : [[sourire audible] C : qui ont besoin de se réfugier dans quelque chose (.) quelque
chose de facile (.) et quelque chose de passionnant (.) quelque chose de mystérieux et qui vous chatouille quelque part
(« Mardi soir » du 15/10/1991, France 2)
Rhétorique de l‟épouvantail 109
De même, Alain Cuniot, à l‟émission « Ex Libris », évoque les « situations de désarroi » qui rendent le public « vulnérable à ces pratiques ». Il reprend la même stratégie à « Durand la nuit » (11/05/1993), et assure au public qu‟il ne le condamne pas : AC : je comprends parfaitement (.) que des gens (.) qui sont en état de
désarroi qui se posent des questions (.) aillent consulter (.) des astrologues des voyants (.) et trouvent parfois des réponses (.) qui peuvent temporairement (.) leur apporter quelque baume
(« Durand la nuit » du 11/05/1993, TF1)
Mais il est difficile de faire disparaître le gogo derrière la victime – d‟autant plus difficile que les partisans des parasciences s‟efforcent de le faire resurgir. Ainsi, dans « Star à la barre », les invités en viennent à s‟opposer longuement sur les termes de “gogos” et de “victimes” : Philippe Bouvard : je voudrais faire amende honorable parce que je viens
d‟écouter ces messieurs je les ai bien regardés (.) euh vraiment ça respire l‟honnêteté le (.) la crédibilité euh [vraiment écoutez
Daniel Bilalian : [bien Cavanna alors vous n‟a- Cavanna vous n‟avez
Wolinski (mage) : on peut répondre à ça quand même (.) monsieur il se permet de traiter dix millions de personnes (.) hein qui sont les clients de la [voyance de gogos
PB : [je les traite de victimes [monsieur (.) de victimes (.) W : [de gogos vous les traitez PB: [de victimes le gogo est [une victime W : [ça fait [le gogo est une victime vous considérez
ces dix mille personnes comme des victimes DB : bien Didier Didier Derlich alors Didier [Derlich oui DD : [XXXX je crois que c‟est
un petit peu grave depuis le début de traiter les (.) de traiter le public qui a trait à la voyance de gogos (.) j‟crois qu‟y a pas
DB : ah non non [non XXXXXXX on dit qu‟ça serait facile (.) on dit W : [c‟est lamentable DB : que ça serait [facile (.) si vous aviez de mau[vaises intentions DD : [mais non [mais non DB : attendez moi (.) c‟est ce que j‟ai dit j‟ai pas dit autre chose hein
(« Star à la barre » du 09/05/1989, France 2)
Au début de cet échange, le mage Wolinski, mis en cause par la remarque ironique de Philippe Bouvard (c‟est de lui qu‟il s‟agissait lors de l‟échange précédent), suggère, par un procédé de liaison, que la schématisation du débat proposée par Bouvard a deux faces aussi indissociables que celles d‟une médaille : identifier les voyants à des charlatans, c‟est identifier du même coup leurs clients à des gogos. Or, on a vu que le terme de “gogo” était péjoratif : aussi Bouvard s‟efforce-t-il d‟imposer le terme de “victime”. Dans un premier temps, cette substitu-tion réussit, puisque le mage Wolinski, après avoir repris en écho la définition du gogo comme victime, répète son accusation en
110 Le débat immobile
utilisant, cette fois, le terme de “victime”. En revanche, Didier Derlich ignore complètement la rectification apportée par Philippe Bouvard, et, dans son intervention, critique à son tour l‟utilisation du terme de “gogo” : une fois de plus, ce sont les parascientifiques qui apparaissent comme dépositaires de l‟honneur d‟une partie de l‟auditoire.
4. PROCÉDÉS DE LIAISON ET DE DISSOCIATION
Enfin, la schématisation proposée par les opposants aux para-sciences met en oeuvre des procédés qui permettent de structurer l‟univers de discours en fonction d‟objectifs argumentatifs, en redéfinissant les relations qui unissent les éléments constitutifs de cet univers. Cette structuration se fait par des procédés de liaison ou de dissociation, définis par Perelman & Olbrechts-Tyteca dans le Traité de l‟argumentation :
Nous entendons par procédés de liaison des schèmes qui rapprochent des éléments distincts et permettent d‟établir entre ces derniers une solidarité visant soit à les structurer, soit à les valoriser positivement ou négativement l‟un par rapport à l‟autre. Nous entendons par procédés de dissociation des techniques de rupture ayant pour but de dissocier, de séparer, de désolidariser, des éléments considérés comme formant un tout ou du moins un ensemble solidaire au sein d‟un même système de pensée : la dissociation aura pour effet de modifier pareil système en modifiant certaines des notions qui en constituent des pièces maîtresses. (1988 : 255-256)
Les adversaires des parasciences privilégient les procédés de liaison, et renforcent ainsi le caractère manichéen du combat mis en scène par la rhétorique de l‟épouvantail : ils opposent une communauté scientifique unanime à une horde de charlatans plus malhonnêtes les uns que les autres. On a vu que l‟utilisation des termes de “parasciences”, “pseudo-sciences” ou “sciences parallèles” est déjà en elle-même argumentative, puisqu‟elle permet de rassembler des réalités diverses dans une même dénonciation, et de généraliser l‟opprobre qui pèse sur certaines disciplines à d‟autres, dont le statut “para” ne fait pas l‟unanimité (l‟homéopathie par exemple). L‟aspect polémique de ces procédés de liaison est mis en évidence par la réaction des partisans des parasciences, qui les dénoncent comme des amalgames (c‟est-à-dire comme des associations illégitimes), et leur opposent, on le verra, des procédés de dissociation systématisés. En effet, si, comme le rappellent les auteurs du Traité, un locuteur qui applique un procédé de liaison, soulignant la cohérence d‟un ensemble de choses semblables ou liées entre elles, les isole par là même d‟autres choses avec lesquelles elles n‟entretiennent pas ce lien,
Rhétorique de l‟épouvantail 111
l‟utilisation d‟un procédé de liaison entraîne aussi l‟apparition d‟un procédé de dissociation dans le dialogue, afin de contrer la visée argumentative de la liaison. Au sein des débats télévisés, les procédés de liaison se multiplient. On en trouve notamment à l‟envi chez Alain Cuniot. Dans le « Duel » sur les prophéties de Nostradamus, il déplace la discussion de la critique des interprétations proposées par Jean-Charles de Fontbrune aux interprétations de son père, arguant du fait que l‟ouvrage de M. de Fontbrune père faisait autorité à l‟époque, et que son fils n‟a fait que « reprendre le fond de commerce » du père. Jean-Charles de Fontbrune dénonce le procédé, refusant d‟être associé à son père : JCFB : à ce moment-là monsieur (.) p- prenons (.) les vingt-huit livres qui
ont été écrits après le mien (.) et les quarante avant le mien ou les trois cents (.) nous sommes là pour discuter du mien (.) et pas des autres (« Duel sur la Cinq » du 13/09/1990, la 5)
Dans le « Duel » sur la numérologie, Cuniot argumente en criti-quant les théories du numérologue Richard Bennet de la Vigerie ; son adversaire, Nicole Laury, invalide sa démarche, précisant que « chacun pratique la numérologie à sa manière », revendiquant ainsi une discussion spécifique. Ces procédés de liaison sont assez représentatifs de la stratégie adoptée par l‟ensemble des “anti-parascientifiques”, qui sacrifient les traits distinctifs aux points communs afin d‟accroître l‟efficacité polémique de leur discours. Cette stratégie porte non seulement sur la représentation qu‟ils proposent de leurs adversaires, mais aussi sur celle de leur propre camp. Ainsi, l‟astronome Dominique Ballereau, opposé à l‟astrologue Élisabeth Teissier, affirme parler au nom de la communauté scientifique, qu‟il présente comme unanime : DB : vous venez de dire que je suis contre l‟astrologie (.) euh il existe
de par le monde (.) la totalité de la communauté (.) astronomique internationale qui est contre (.) la totalité de la communauté (.) scientifique tout court (.) physiciens chimistes et caetera (.) et d‟une manière générale (.) tous les gens de bon sens (.) euh n‟acceptent pas l‟astrologie
(« Duel sur la Cinq » du 10/06/1988, la 5)
Devant les protestations d‟Élisabeth Teissier, il poursuit : DB : aucun physicien (.) aucun biologiste […] aucun astronome en
France (.) ne croit à l‟astrologie ne serait-ce qu‟à un millième de l‟astrologie (.) aucun (.) c‟est rejeté (.) et c‟est important
(« Duel sur la Cinq » du 10/06/1988, la 5)
De même, Henri Broch affirme l‟unanimité des astronomes contre l‟astrologie :
Pas une seule des personnes réputées compétentes dans ce domaine d‟études, c‟est-à-dire pas un seul astronome, ne croit à
112 Le débat immobile
l‟astrologie ! Au contraire, les astronomes, au travers essentiellement de leurs associations professionnelles nationales et internationales, lancent périodiquement des appels à la raison et dénoncent l‟inanité complète de l‟astrologie. (Au coeur…: 40)
Arrêtons là la démonstration : l‟évocation de l‟unanimité des scientifiques face aux parasciences est un lieu commun du discours des adversaires des parasciences qui découle des repré-sentations courantes de la science. En effet, le savoir scientifique est associé à l‟idée d‟universalité (garantie par son intersubjec-tivité) : la science ne peut donc parler que d‟une seule voix.
5. UNE POSITION ESSENTIELLEMENT DÉFENSIVE
Finalement, la schématisation proposée par les adversaires des parasciences les caractérise comme les tenants d‟une position essentiellement défensive ; symétriquement, ce sont les partisans des parasciences qui incarnent le pôle offensif du débat. Il est donc maintenant possible de compléter la définition de la situation rhétorique présentée au chapitre 1 : globalement, ce sont bien les partisans des parasciences qui jouent le rôle de proposants dans le débat, et avancent une proposition nouvelle, alors que leurs adversaires sont les opposants qui défendent l‟opinion commune, la doxa. Les dénominations des différents camps mettent parfois en évidence les intrications des positions représentées dans le débat : dans “parasciences”, il y a “science”. On a déjà mentionné que les dénominations des différentes disciplines réunies dans le débat sous le terme générique de parasciences mettent souvent en avant un lien ambigu avec une discipline scientifique “établie”. Ainsi, le terme de “parapsychologie” établit un lien avec la psychologie, tout en posant l‟existence d‟une altérité fondamentale (“para”). Paul-Louis Rabeyron, soulignant le caractère défensif de la position des rationalistes, définit ces derniers par rapport à ce à quoi ils s‟opposent, et évoque « la littérature parapsychologique et antiparapsychologique »1. Plus loin, il appuie cette vision du débat en évoquant la « croyance anti-paranormale » de Michel Rouzé. Une telle définition des positions est défavorable à ceux qui sont définis comme “anti-”, dans la mesure où elle ne leur reconnaît aucune identité propre, et ne les caractérise que négativement, en opposition avec une autre position considérée comme première. Au cours de débats télévisés, les partisans des parasciences exploitent ce point faible de leurs adversaires, et,
1 « Le Voyant et la science », in François Laplantine (éd.), Un voyant dans la
ville. Le cabinet de consultation d‟un voyant contemporain : Georges de Bellerive, Paris : Payot ; p. 250.
Rhétorique de l‟épouvantail 113
usant d‟un argument ad hominem, les accusent de vivre de ce qu‟ils dénoncent.1 Ainsi, le maître occultiste luciférien Octave Sieber, opposé à Alain Cuniot dans un « Duel sur la Cinq » sur la sorcellerie, lui lance : OS : est-ce que vous suiv- vous est-ce que vous recevez des
subventions de l‟Etat ? AC : oui figurez-vous OS : alors vous vous rendez compte vous vivez de ma charité en [plus AC : ]mais OS : ](.) parce que moi je paye des impôts AC : [pas du tout (.) pas du tout (.) le ministère de la recherche a aidé
ainsi que le ministère de la culture la réalisation d‟un festival (« Duel sur la Cinq » de mai 1990, la 5)
On retrouve la même stratégie dans la bouche de l‟astrologue Louis Saint Martin qui, au cours de l‟émission « Savoir plus » consacrée aux “marchands d‟avenir”, accuse le professeur Henri Broch de chercher à gagner de la notoriété en pourfendant les parasciences : LSM : monsieur se fait un nom en cassant l‟astrologie au lieu
d‟apporter des connaissances (« Savoir plus » du 01/03/1993, France 2)
Autre conséquence de la définition essentiellement négative des adversaires des parasciences : elle permet aux partisans de ces dernières de leur faire porter l‟entière responsabilité de la polémique, en les présentant comme des maniaques souffrant de curieuses obsessions. Dans le « Star à la barre » sur “la parapsy-chologie et le surnaturel”, Octave Sieber prend à parti Yves Lignon et Rémy Chauvin, qu‟il traite de « ratés », et propose ensuite ses services à Cavanna et Gérard Majax pour les guérir de leurs obsessions : OS : nous avons surtout affaire à des gens que l‟on aime la p- la chose
que l‟on ne peut pas dire en caméra et c‟est ce que j‟ai dit cet après-midi (.) c‟est qu‟on aime nos clients par exemple monsieur ou monsieur (.) [désignant Gérard Majax et Cavanna] je serais tout à fait d‟accord de le recevoir en consultation je vois des très grands obsessionnels bon je peux faire véritablement quelque chose sur eux et un travail (.) pour arriver à les délivrer de cette obsession ça je vous le garantis (.) ils ont réellement besoin d‟un parapsychologue [rires dans la salle, applaudissements]
Cavanna : quand on n‟est pas d‟accord on est obsessionnel (« Star à la barre » du 09/05/1989, France 2)
La définition négative du camp des opposants aux parasciences constitue donc réellement un handicap. En dehors des attaques précédentes, auxquelles elle donne lieu, une telle définition a
1 Une telle attaque rappelle un peu celles qui sont régulièrement dirigées contre
les critiques d‟art, accusés de ne savoir, justement, que critiquer, et de gagner leur vie aux dépens des artistes.
114 Le débat immobile
également des conséquences sur le “sens historique” du débat. Les “proposants”, dont la position est définie positivement, et qui représentent le pôle offensif du débat, sont souvent vus comme initiateurs de changement, vecteurs d‟idées nouvelles, voire révolutionnaires. Les “opposants” semblent alors lutter contre ce changement et défendre l‟ordre établi, et leur position apparaît conservatrice. Les stratégies adoptées par les adversaires des parasciences pour parer à ce danger sont de deux types. En premier lieu, on observe, de la part des “anti-parascientifiques”, des tentatives pour imposer de nouvelles dénominations aux parties en présence, en définissant la position de leurs opposants par rapport à leur propre position. Ainsi, Jacques Lemaire évoque « les antirationalistes de tous poils » (avant-propos de La Pensée et les hommes 18 : 7), tandis que François Laplantine explique la raideur de la position des scientifiques devant les parasciences par le « regain antirationaliste sans précédent » qui caractérise notre époque (présentation de François Laplantine (éd.), Un voyant… : 13). Mentionnons enfin le casse-tête soumis à notre sagacité par Jean-Pierre Vigier, qui évoque « la contre-offensive anti-rationaliste » pour désigner le discours des partisans des parasciences (cité dans Jean-Claude Pecker, Problèmes…: 40). Une autre façon de désamorcer l‟image conservatrice des adversaires des parasciences consiste à insister sur les antécédents historiques des disciplines parascientifiques, ce qui permet d‟affirmer que ce sont leurs défenseurs actuels, et non leurs adversaires, qui appartiennent au passé. Les “anti-parascienti-fiques” peuvent alors qualifier la position adverse de “réactionnaire”. Ainsi, Alain Cuniot, lors d‟un « Duel sur la Cinq » consacré à la sorcellerie, commence par s‟interroger sur le “sens historique” de la « mode actuelle de l‟irrationnel » : AC : ben euh ce que vous avez dit au début me paraît euh tout à fait
euh (.) la question essentielle (.) est-ce que (.) euh c‟est un retour en arrière la sorcellerie cette mode actuelle de l‟irrationnel (.) ou est-ce qu‟il y a effectivement (.) des possibilités que ça puisse servir (.) aux gens à l‟humanité est-ce que c‟est une nouvelle avancée ou est-ce que c‟est (.) un grand retour en arrière de mon point de vue évidemment (.) c‟est un grand retour en arrière (.) on ressuscite des vieilles fadaises (.) qui à une époque avaient été considérées en particulier depuis (.) ce siècle des Lumières qu‟on a honoré (.) à l‟occasion de notre Révolution de 89 l‟année dernière […] on est dans la mystification on est dans un (.) recul (.) de la pensée […] et voilà qu‟on ressuscite des badernes (.) que l‟on croyait évacuées que la raison le progrès scientifique (.) un humanisme vigilant intelligent (.) avaient mis sous le boisseau
(« Duel sur la Cinq » de mai 1990, la 5)
Rhétorique de l‟épouvantail 115
Enfin, le dernier effet indésirable de la rhétorique de l‟épouvantail est de suggérer une vision catastrophiste de la situation. C‟est bien l‟ensemble des partisans des parasciences qui est présenté par les métaphores comme le camp dominateur, dont les vues gagnent sans cesse du terrain, et comme le vainqueur probable de l‟affrontement au sein duquel les opposants aux parasciences font figure de résistants, défenseurs d‟une cause bien mal engagée. Et, sans doute selon l‟idée que les chants désespérés sont les chants les plus beaux, comptant sur l‟admiration que suscitent les causes sans espoir, les adversaires des parasciences insistent parfois sur le caractère inexorable de leur défaite. Ainsi, un lecteur, félicitant Science & Vie pour sa lutte contre les « blurgs », écrit :
Il est des moments où l‟on se sent impuissant face aux vieilles croyances ou aux nouvelles absurdités dont les charlatans de tout poil abreuvent le public. […] Quand numérologie, astrologie, conseil d‟entreprises par le vaudou et le benji, paramagnétisme et autres pseudo-sciences prétendent déterminer la marche du monde, il fait bon lire des articles encore écrits par des journalistes ou chercheurs compétents et honnêtes. (Science & Vie n°889, rubrique “Forum”, octobre 1991 : 10)
Le même pessimisme est sensible dans les propos de Yves Galifret, cités précédemment, où le secrétaire général de l‟union rationaliste estime que le combat contre les parasciences revient à écoper « de l‟eau dans une barque trouée ». Mais mettre en avant la pureté des derniers irréductibles dans la schématisation du débat est un pari risqué, et certains préfèrent présenter la dynamique de la cause des opposants aux parasciences sous un jour plus optimiste, qui laisse espérer une victoire prochaine. Cette dynamique pose le camp des “anti-parascientifiques” non plus comme numériquement stagnant ou pire, en récession, mais au contraire comme une position en pleine progression, en France comme aux États-Unis. Ainsi, Michel Rouzé, évoquant la réaction des scientifiques belges face aux apparitions d‟ovnis qui ont secoué leur pays en 1989, conclut :
“Comme c‟est abusant !” Un calembour qui résume bien la situation : de plus en plus nombreux sont les sceptiques résolus à ne plus permettre qu‟on se moque d‟eux. (AFIS n°194 : 22)
Il évoque également « les nombreux groupes “sceptiques” qui se créent aux U.S.A. et ailleurs ». (id. : 29). Mais cette dynamique n‟est associée à aucune schématisation cohérente du débat sur les parasciences, et entre même en contradiction avec certains des éléments mentionnés précédemment (rhétorique de l‟épouvantail) : elle ne peut en aucun cas prétendre rivaliser avec la dynamique caractéristique de la schématisation élaborée par les partisans des parasciences.
116 Le débat immobile
Au terme de ces réflexions, l‟image du débat élaborée par les opposants aux parasciences apparaît relativement simple, voire simpliste : elle met en scène une entité nuisible (et dont la nocivité est rarement argumentée) qui menace un corps social décrédibilisé (car crédule, naïf), et qui se heurte à la résistance de quelques Don Quichotte qui se posent comme arbitres de la rationalité. Cette caractérisation des différents acteurs du débat présente, on l‟a vu, diverses faiblesses. Outre quelques éléments contradictoires, elle souffre du handicap de toute position essentiellement défensive, qui impose une définition négative par rapport à l‟adversaire. Surtout, l‟image de la partie de l‟auditoire favorable aux parasciences – c‟est-à-dire de la cible de l‟argumentation – élaborée par les adversaires des parasciences hypothèque le succès de cette argumentation. À l‟inverse, la schématisation construite par les partisans des parasciences est beaucoup plus cohérente et puissante. Aux procédés de liaison mis en oeuvre par les adversaires correspond, dans le discours des partisans des parasciences, la mise en oeuvre systématique de procédés de dissociation, qu‟ils appliquent soit à leur propre camp, distinguant les charlatans des parascientifiques authentiques, soit à la communauté scientifique, qui éclate alors entre le camp des scientistes rétrogrades d‟une part, et le camp des scientifiques d‟avant-garde, favorables aux parasciences, d‟autre part.
Chapitre 6 : Le débat selon les
partisans des parasciences
I : Procédés de dissociation
Les procédés de dissociation que l‟on trouve dans le discours des parascientifiques s‟appliquent à deux objets : aux parasciences elles-mêmes, et à la communauté scientifique.
1. PROCÉDÉS DE DISSOCIATION AU SEIN DES PARASCIENCES
Les procédés de dissociation permettent aux parascientifiques de définir leur programme argumentatif, en opposant les propositions qu‟ils s‟engagent à défendre à celles dont ils entendent se distinguer. Ils peuvent ainsi se dissocier de certaines disciplines, pratiques ou personnes qui font l‟objet d‟attaques (dont ils se font même parfois l‟écho), en affirmant que ces attaques ne les concernent en rien.
1.1. Dissociations interdisciplinaires
S‟opposant à la stratégie des adversaires des parasciences, qui regroupent différentes disciplines sous un même chapeau de parasciences, les partisans des parasciences distinguent nettement les théories qu‟ils acceptent de défendre de celles qu‟ils excluent de leur plaidoyer. Cela leur permet de rejeter les critiques qui leur sont adressées sur les disciplines dont ils se dissocient. Une distinction est ainsi fréquemment établie entre voyance et astrologie, généralement par les astrologues. Au cours de l‟émission « Ex Libris », Patrick Poivre d‟Arvor semble assez au fait des distinctions entre disciplines, et lorsqu‟il reçoit l‟astrologue Élisabeth Teissier, il lui offre d‟entrée la possibilité de situer l‟astrologie par rapport à la voyance : PPDA : face à moi maintenant une lionne (.) Élisabeth Teissier qui sort
ses griffes dès qu‟on lui parle de voyance parce qu‟elle a horreur qu‟on raconte qu‟elle est voyante elle préfère dire qu‟elle est astrologue
ET : alors écoutez je je suis contente que vous me donniez la possibilité de mettre ça au point c‟est-à-dire que c‟est vraiment (.) comment dirais-je c‟est un (.) c‟est une confusion c‟est un (.) c‟est la discussion sur le sexe des anges cette histoire de voyance il faut vraiment en parler une fois pour toutes (.) je ne suis pas du tout voyante et je préférerais l‟être non pas que je sorte mes
118 Le débat immobile
griffes quand on parle de voyance (.) parce que je respecte beaucoup le don de voyance qui est pour moi une espèce de grâce un don (.) bon (.) d‟ailleurs je ne suis pas sûre que je ne l‟aie pas un peu […] moi sans ces éphémérides qui sont euh (.) faites par la NASA je ne peux rien dire ni sur quelqu‟un ni sur le monde ni rien (.) donc je suis totalement (.) comment vous dirais-je muette et [et je suis à ce moment-là monsieur tout le monde
PPDA : [c‟est-à-dire vous êtes plus une scientifique qu‟une intuitive
(« Ex Libris » du 08/03/1990, TF1)
La distinction introduite par l‟astrologue semble informative, et certainement pas polémique, puisque Élisabeth Teissier affirme son respect pour la voyance, qu‟elle place même “au-dessus” de l‟astrologie. Mais elle rappelle que les deux disciplines donnent lieu à des types de légitimation spécifiques. Si l‟on reprend les différents types d‟autorité distingués par Weber (1959), on peut dire que la voyance bénéficie d‟une autorité charismatique, qui repose sur l‟idée de don, alors que l‟astrologie (en tout cas telle que la présente Élisabeth Teissier) s‟appuie davantage sur une autorité de type légal-rationnel, sur l‟idée d‟une compétence acquise. La dissociation entre voyance et astrologie introduite en début d‟émission permet à l‟astrologue, un peu plus tard, de déplacer sur la première les critiques adressées à la seconde. Ainsi, après un échange sur l‟existence de prédictions erronées : PPDA : oh y en a quand même qui racontent de de vrais bobards hein [moi j‟en ai vus quelques uns où (.) [vraiment on s‟aperçoit ET : [oui mais alors là les [oui mais peut-être plus PPDA : [qu‟ils font [oui ET : [les voyants (.) peut-être [plus les voyants PPDA : bon en ce qui vous concerne pas trop souvent ça c‟est vrai
(« Ex Libris » du 08/03/1990, TF1)
La hiérarchie établie précédemment entre voyance et astrologie est ici renversée (puisque les prédictions astrologiques sont présentées comme plus fiables que les voyances), et le procédé de dissociation mis en oeuvre auparavant permet de détourner la critique de l‟animateur en lui proposant une autre cible.
1.2. Dissociations intra-disciplinaires
Les procédés de dissociation permettent aussi d‟opposer diffé-rentes pratiques au sein d‟une même discipline. Ainsi, certains astrologues ne reconnaissent que l‟application caractérologique de leur discipline, et rejettent son application prévisionnelle (en tout cas telle qu‟elle apparaît dans les horoscopes). Les disso-ciations ainsi introduites leur permettent une fois de plus de ne pas répondre aux critiques adressées aux pratiques qu‟ils
Procédés de dissociation… 119
rejettent. S‟en étant distingués, ils n‟ont plus à les défendre. Ainsi, Françoise Hardy, interviewée à l‟occasion de l‟enquête menée par 50 Millions de consommateurs sur la voyance, préconise :
Il vaut mieux considérer les horoscopes publiés dans la presse comme de simples divertissements. Quand je lis les divagations de certains astrologues, j‟ose à peine dire que je m‟intéresse à l‟astrologie car elle n‟a rien à voir avec la voyance : sur le plan prévisionnel, elle permet de prévoir des climats, non de prédire des événements. Sinon, elle est une approche partielle et particulière de la personnalité. (50 Millions de consommateurs n°257, janvier 1993 : 26)
Or, les adversaires des parasciences (particulièrement des mancies et de la voyance) mènent plus volontiers leurs attaques en critiquant le versant prévisionnel (en invoquant des prédictions erronées) qu‟en s‟en prenant au versant caractérologique, dont la méthode de discussion est plus difficile à établir (cf. chapitre 2, §1). Les parascientifiques qui rejettent l‟outil prévisionnel, mettent donc en difficulté leurs adversaires, qu‟ils privent de leur angle d‟attaque habituel. La redéfinition de l‟univers de discours opérée par les procédés d‟association et de dissociation s‟accompagne donc d‟une redéfinition des règles de la discussion. De telles dissociations peuvent intervenir à la suite d‟une mise en cause par l‟adversaire, mais aussi avant toute contestation : le locuteur anticipe ainsi sur des attaques prévisibles, et désarme son contradicteur.
1.3. Dissociations entre “les authentiques”/“les charlatans” Bien souvent encore, les procédés de dissociation mis en oeuvre par les parascientifiques organisent l‟univers de discours selon l‟opposition “les vrais, les authentiques” / “les charlatans”. Cette dichotomie, qui apparaît dans tous les débats sur les parasciences, répond aux procédés d‟association des opposants aux parasciences, accusés de pratiquer l‟amalgame. Les partisans des parasciences reconnaissent volontiers l‟existence de charlatans parmi eux, mais refusent la généralisation, arguant du fait que l‟existence de charlatans ou d‟escrocs dans d‟autres corps de métiers n‟implique pas la disqualification de l‟ensemble de la profession. Ainsi, lorsque Guillaume Durand évoque le charla-tanisme qui règne dans la profession, la voyante Maud Kristen et l‟astrologue Jacqueline Macou accordent leurs voix pour réclamer un traitement a pari de leurs disciplines :
GD : pour des gens comme vous euh qui effectivement enfin ceux qui sont venus ici ce soir (.) qui ont effectivement un rôle (.) bon qui qui semble-t-il n‟est n‟est pas contestable ou en tout cas qui obtiennent statistiquement un certain nombre de résultats (.) y a
120 Le débat immobile
quand même et même (.) euh Maud Johanne ou les autres l‟ont dit une part de charlatanisme qui existe aussi qui est considérable
JM : vous savez monsieur je vais vous répondre y en a dans les ministres y en a dans les médecins y en a dans les journalistes
MK : y en a partout [(.) chez les garagistes JM : [hein [rires et applaudissements]
(« Durand la nuit » du 11/05/1993, TF1)
Plus généralement, les séquences consacrées par un opposant aux parasciences ou par un animateur à la dénonciation des charlatans sont peut-être les seules occasions où les interventions des partisans et des adversaires des parasciences sont – au moins en surface – co-orientées. Dans des interactions, de tels phénomènes de coorientation argumentative ont la même fonction que les structures concessives analysées dans des discours monologaux, écrits ou oraux : la concession ainsi faite à l‟adversaire permet de désarmer ses attaques (puisqu‟il ne sert à rien de prêcher un convaincu), et de déplacer le désaccord. Ainsi, Guillaume Durand, présentant l‟enquête menée par Georges Golberine pour 50 Millions de consommateurs sur la voyance, affirme que son objectif argumentatif est par avance voué à l‟échec puisque, d‟une certaine façon, l‟accusé reconnaît les faits : GD : euh alors vous avez fait une enquête sur ce monde justement qui
est celui de la voyance (.) d‟une certaine manière c‟est une enquête qui est un p‟tit peu (.) euh j‟allais dire euh (.) qui était très complète (.) mais qui est un peu déminée parce que ce qu‟expliquait Maud Kristen parce que eux-mêmes parmi les voyants reconnaissent que c‟est farci de charlatans
(« Durand la nuit » du 11/05/1993, TF1)
Cette stratégie est renforcée par la revendication d‟un code de déontologie par les voyants ou les astrologues. Ainsi, lors d‟un « Ciel mon mardi », la voyante Maud Kristen renchérit sur le rationaliste Jacques Théodor, qui dénonce l‟existence de certaines pratiques scandaleuses chez les voyants, et, afin sans doute de garantir la sincérité de son indignation devant les pratiques évoquées, enchaîne sur la nécessité d‟établir un code de déontologie dans la profession : MD : mais vous savez on est les premiers à les dénoncer on en a honte
(.) parce que il faut l‟avouer (.) y a une gangrène dans ce métier parce que comme y a aucun moyen de contrôle (.) c‟est sûr que c‟est la porte ouverte à tous les abus et tant qu‟il n‟y aura pas justement un code (.) sérieux (.) qui pourrait être (.) obligé pour professer ça
CD : vous êtes tous d‟accord vous êtes tous pour ce code et pour cette euh [pour cette CSA de la voyance ?
MK : [oui bien sûr oui CD : bien sûr Mélissa (voyante) [ fait un signe d‟approbation]
Procédés de dissociation… 121
CD : oui bon ben courage hein j‟peux vous dire hein (« Ciel mon mardi » du 27/11/1990, TF1)
Il ne s‟agit pas ici de mettre en doute la sincérité d‟une telle revendication, mais simplement de souligner que l‟évocation d‟un code de déontologie va toujours de pair avec le procédé de dissociation qui oppose les authentiques aux charlatans, et qu‟il permet de reporter les accusations de malhonnêteté sur d‟autres. La proposition de l‟élaboration d‟un code de déontologie, même si elle témoigne d‟un souci de crédibilité bien légitime, ne peut recevoir l‟adhésion des opposants aux parasciences puisqu‟elle suggère l‟existence de “bons” voyants – ce que les “anti-parascientifiques” ne sont pas prêts à reconnaître. Plus généralement, les opposants aux parasciences reprochent à leurs adversaires de se livrer à une auto-apologie à travers l‟utilisation de procédés de dissociation, et de chercher à se blanchir sur le dos de boucs émissaires désignés comme charlatans. Ainsi, dans l‟émission « Star à la barre » sur “la parapsychologie et le surnaturel”, Didier Derlich dénonce les “faux voyants” de Divinitel ; ce qui lui vaut la remarque ironique de Cavanna : C : ça peut se résumer (.) ça peut se résumer à une formule
magnifique (.) c‟est (.) la le charlatan c‟est l‟autre (« Star à la barre » du 09/05/1989, France 2)
On retrouve la même critique dans la bouche du voyant Boris, invité à « Ciel mon mardi », qui se voit attaquer par une autre voyante, Maud Kristen : C. Dechavanne : est-ce que vous acceptez que Maud Kristen dise emploie
le mot de charlatan déjà ? B : [rire] je suis pas là pour attaquer madame CD : ah non non c‟est pas ça B : bon ce qui ce qui me ce qui m‟ennuie un peu c‟est que bon dire (.)
je les autres sont des charlatans entre parenthèses si c‟est moi qui vous le dis (.) alors je n‟en suis pas un (.) j‟ai du mal à comprendre
(« Ciel mon mardi » du 27/11/1990, TF1)
Finalement, ce procédé de dissociation est dénoncé aussi bien par les adversaires des parasciences, qui y voient une forme de dérobade, que par ceux qui sont ainsi désignés comme charlatans, et qui refusent de voir certains de leurs collègues se blanchir à leurs dépens.
1.4. La tradition / la modernité
Un dernier procédé de dissociation utilisé par les partisans des parasciences vise à opposer les “bonnes” parasciences aux “mauvaises” sur l‟axe temporel. On a vu précédemment que
122 Le débat immobile
leurs adversaires les dénonçaient comme des résurgences d‟un passé magique, des archaïsmes. Dans une perspective de légiti-mation scientifique, la prétention à la modernité est un atout1. Les partisans des parasciences cherchent donc parfois à opérer une rupture entre les formes “archaïques” de leurs disciplines et leurs formes modernes, déplaçant les critiques éventuelles du tout à la partie. Une telle dissociation apparaît notamment, dans l‟histoire, à travers le changement des noms des disciplines. Ainsi, la chiromancie devient chirologie, les devins sont rebaptisés voyants, médiums ou sujets psi, le spiritisme devient transcommunication. Dans le « Duel sur la Cinq » consacré à la voyance, Yves Galifret cherche à montrer l‟inanité de la voyance en opposant au mage Dessuart des exemples de voyances qui ne se sont jamais réalisées. Le mage répond alors : MD : alors j‟aurai pas le front comme certaines voyantes (.)
malintentionnées ou complètement stupides (.) de dire que nous ne nous trompons jamais (.) qu‟on sait tout qu‟on voit qu‟on entend tout (.) ça (.) c’est l’ancienne voyance que je trouve puérile (.) stupide et je comprends qu‟on ait pu se gausser à travers les siècles (.) de ce style de voyance (.) mais il n‟en demeure pas moins vrai (.) et moi aussi j‟ai des listes mais c‟est pas des petites listes elles sont innombrables (.) que je peux vous citer des voyances et il en arrive tous les jours (.) mais absolument fantastiques de précision (.) et qui démontrent l‟existence de ce fait
(« Duel sur la Cinq » du 22/04/1988, la 5)
La prétention à l‟infaillibilité est présentée par le mage Dessuart comme une caractéristique de l‟ancienne voyance, et fait l‟objet d‟un jugement négatif catégorique, appuyé par des adjectifs dépréciatifs très forts (« stupide », « puérile »). Le premier mouvement concessif de la figure d‟occupation est souligné par la reconnaissance explicite de la légitimité des critiques de l‟adversaire (« et je comprends qu‟on ait pu se gausser... »), alors que le deuxième mouvement de l‟occupation conclut à la validité de la voyance. La fonction essentiellement réactive de l‟intervention du mage montre bien que les procédés de disso-ciation peuvent être utilisés comme des réfutations lors d‟interactions argumentatives.
1 Cette aspiration à la modernité est observable même si, dans d‟autres
circonstances, les partisans des parasciences tirent au contraire parti de la tradition sur laquelle reposent les disciplines qu‟ils défendent, jouant ainsi à la fois sur un lieu de qualité (le mythe de l‟Âge d‟or, qui veut que le passé soit meilleur que le présent), et un lieu de quantité (si ces disciplines ont survécu au cours des siècles, où elles ont eu l‟occasion d‟être testées maintes et maintes fois, c‟est qu‟elles ont une validité).
Procédés de dissociation… 123
1.5. Dissociations et définitions des programmes argumentatifs
Finalement, on voit s‟esquisser une sorte d‟échelle sur laquelle tous les acteurs du débat prennent place en fonction du programme argumentatif qu‟ils se fixent (c‟est-à-dire des propositions qu‟ils s‟engagent à défendre). À une extrémité de cette échelle se situent les acteurs du débat qui rejettent globalement toutes les parasciences, et s‟opposent ainsi, généralement sans distinction, à tous ceux qui en font profession. Le représentant de ce groupe est sans aucun doute Alain Cuniot, mais aussi des personnages comme Albert Jacquard ou Jean-Claude Pecker, qui se prononcent régulière-ment contre toutes les formes de ce qu‟ils appellent les “pseudo-sciences”. Au degré inférieur de scepticisme se trouvent des personnages comme Yves Lignon ou Rémy Chauvin, qui ont par ailleurs une certaine légitimité scientifique (Rémy Chauvin pour ses travaux en éthologie animale, Yves Lignon par son statut d‟enseignant en mathématique à l‟uni-versité), qui s‟opposent à la grande majorité des parascienti-fiques professionnels, mais qui défendent quand même la vali-dité de certaines parasciences, et la réalité de certains phéno-mènes paranormaux. Un peu plus loin encore du groupe des “sceptiques radicaux”, on rencontre des gens comme la voyante Maud Kristen, qui s‟oppose violemment tant au groupe incarné par Alain Cuniot qu‟à une partie de sa propre profes-sion, qu‟elle accuse de charlatanisme. Elle s‟engage à défendre un corpus de faits paranormaux (plus spécifiquement, de voyance) quantitativement plus important que Chauvin ou Lignon (qui, on le verra, ne retiennent comme réellement “para” que très peu de phénomènes), mais son programme argumentatif ne l‟engage pas à défendre les pratiques les plus souvent mises en cause dans les débats télévisés, comme la voyance par Minitel ou les publicités abusives arguant de l‟infaillibilité des voyants. Enfin, à l‟autre extrémité de cette échelle se trouvent ceux qui défendent, sans discernement ni restriction, toute proposition relative à l‟existence de phénomènes paranormaux, ou toute pratique parascientifique. Cette échelle, qui reflète les programmes argumentatifs des acteurs du débat, se double, pour le camp des partisans des para-sciences, d‟une échelle de légitimité affichée, construite par les procédés de dissociation. En effet, rejeter une proposition hors de son programme argumentatif revient à se dissocier de ceux qui la défendent, et à revendiquer une crédibilité supérieure. Ainsi, Lignon et Chauvin, se dissociant de tous les autres parti-sans des parasciences, cherchent à s‟asseoir au sommet de cette
124 Le débat immobile
échelle de légitimité ; la position de voyantes comme Maud Kristen ou Yaguel Didier est intermédiaire. Vient enfin le groupe constitué par les parascientifiques invités dans les émissions télévisées, mais régulièrement mis en cause par d‟autres parascientifiques appartenant au groupe précédent. C‟est le cas par exemple de Mario de Sabato, de Christine Daguy, de Boris ou de Mélissa. Ce dernier groupe n‟en utilise pas moins lui-même des procédés de dissociation, désignant cette fois comme brebis galeuses des parascientifiques souvent non nommés, absents des plateaux de télévision, et qui n‟ont donc pas la possibilité de prolonger la chaîne des dissociations – du moins dans le débat public sur les parasciences. Cette échelle des programmes argumentatifs est confirmée, et en partie créée, par les responsables des émissions qui choisissent les invités, et décident de poser les questions touchant à l‟éta-blissement d‟un code de déontologie à Maud Kristen plutôt qu‟à Boris, de demander à Rémy Chauvin plutôt qu‟à Alain Cuniot de se prononcer sur tel ou tel témoignage sur la transcommunication. Le débat sur les parasciences n‟est donc pas un débat binaire, opposant deux camps parfaitement délimités ; au contraire, il met en jeu différentes positions argumentatives qui se définissent mutuellement. Les acteurs du débat qui se situent au milieu de l‟échelle ont pour adversaires le groupe des sceptiques, mais aussi tous ceux qu‟ils désignent comme charlatans. Ainsi, Yves Lignon, comme parapsychologue, se voit adresser les attaques que les “anti-parascientifiques” adressent à tous les parapsychologues. Mais il revendique par ailleurs une approche scientifique de la parapsychologie, et tient à se distinguer des parapsychologues qu‟il considère comme des charlatans : quand il est en leur présence, il leur adresse à son tour les mêmes critiques que les adversaires les plus farouches des parasciences. Une illustration assez spectaculaire de l‟influence de la situation sur les programmes argumentatifs assignés aux uns et aux autres est fournie par l‟argumentation du mage occultiste Octave Sieber. On a vu plus haut (cf. chapitre 4, §5) que celui-ci accuse Cuniot de vivre de son combat “anti-parascientifique”. Or, lors de l„émission « Star à la barre » consacrée à la parapsychologie et au surnaturel, Octave Sieber adresse exactement la même attaque à Yves Lignon :
Procédés de dissociation… 125
OS : bon euh mons- monsieur Lignon euh je vous vois pour la première fois mais enfin vous qui vous plaignez aussi longtemps des parapsychologues euh je m‟aperçois surtout que vous vivez de notre charité que vous vivez de nous pour l‟instant
(« Star à la barre » du 09/05/1989, France 2)
Ainsi, Cuniot et Lignon, en d‟autres circonstances ennemis jurés, trouvent en Octave Sieber un adversaire commun, qui leur adresse, à quelques mots près, la même argumentation. Les positions argumentatives dans le débat sur les parasciences ne sont pas totalement rigides, et des regroupements peuvent voir le jour au sein de cette échelle, traduisant des alliances ponctuelles contre un ennemi commun. Mais ces trêves ne sont que provisoires, et chacun revient rapidement au programme argumentatif qu‟il s‟est fixé par avance. Les procédés de dissociation constituent donc un des principaux moyens utilisés par les partisans des parasciences pour définir leur position au sein de la polémique, et pour définir le champ de leur engagement argumentatif. Mais les procédés de dissociation sont aussi appliqués par les partisans des parasciences au camp de leurs adversaires, afin d‟en construire une image qui renforce leur propre position dans le débat.
2. APPLICATION DES PROCÉDÉS DE DISSOCIATION AUX ADVERSAIRES DES PARASCIENCES
On l‟a vu, les adversaires des parasciences, dans les débats télévi-sés, ne sont pas toujours des scientifiques. Pourtant, c‟est presque toujours au nom de la science que les opposants aux parasciences parlent, et c‟est avant tout leur prétention à la scientificité qu‟ils contestent. C‟est donc l‟image de la science qu‟il s‟agit, pour les partisans des parasciences, de reconstruire. À cette fin, ils tentent de priver leurs adversaires de cette autorité de référence et de la présenter comme leur propre alliée. La dissociation opérée au sein des scientifiques par les partisans des parasciences consiste à distinguer un sous-groupe au sein de la science – rebaptisé “science officielle”–, défavorable aux parasciences, et qui reçoit diverses caractéristiques négatives. À cette “science officielle” sont opposés divers membres de la communauté scientifique, qui sont valorisés et présentés comme favorables aux parasciences : les formes d‟argumentation sont alors proches de l‟argument d‟autorité.
126 Le débat immobile
2.1. Requalification de “LA Science”
La stratégie récurrente utilisée par les partisans des parasciences est l‟adjonction d‟un adjectif épithète au substantif “science”, pour désigner la partie de la communauté scientifique qui leur est défavorable. L‟épithète accolé à “science” n‟explicite pas une qualité que la science aurait en tant que telle, mais, par une dénomination nouvelle, isole une nouvelle unité de sens, et suggère que la science n‟est pas une réalité homogène, mais recouvre en fait une science généralement qualifiée d‟“officielle”, et “autre chose”. Ainsi, Roger-Luc Mary, dans un article sur la cénesthésie, oppose ce qu‟il appelle la « science officielle » à « la Science Sacrée » (laquelle est « révélée par la Connaissance de la Tradition ») (Le Monde Inconnu n°104, avril 1989 : 30). Henri-Pierre Aberlenc, dans sa « Lettre ouverte aux rationalistes », évoque « la science classique » (Le Monde Inconnu n°106, juin 1989 : 10). Dans le domaine des médecines parallèles, on parle de « médecine classique » ou de « médecine officielle ». Ces dénominations sont exclusivement le fait des partisans des parasciences. Si leurs adversaires les rejettent, ce n‟est pas tant pour le qualificatif “officielle” ou “classique”, qui n‟a, en soi, rien de dépréciatif. C‟est surtout pour préserver une image homogène de la science, et pour éviter que les partisans des parasciences ne se réclament de l‟“autre” science, de la science non officielle :
Il n‟y a pas, il ne saurait y avoir de science “officielle” […] Il y a peut-être seulement science et autre chose : autre chose qui n‟est pas en soi, a priori, méprisable, qui peut animer une pensée vivante, heuristique, susceptible d‟être utile à la science. Mais cet “autre chose” n‟a aucune raison de se parer indûment des plumes de la science, de se métamorphoser parfois en escroquerie pseudo-scientifique. (André Lichnerowicz, « Le concept de science officielle », in Maurice Tubiana, Yves Pelicier, Albert Jacquard (éds.) Images de la science, Paris : Economica, 1984 ; p. 89)
L‟expression “science officielle” est le pendant, dans le discours des partisans des parasciences, des expressions “pseudo-sciences” ou “parasciences” dans le discours de leurs adversaires. Cette façon de désigner les tenants du discours adverse est argumentative, et en tant que telle, elle est rejetée par le groupe ainsi désigné. La caractérisation négative de la “science officielle” conduit parfois à nier le statut de scientifiques à des individus qui le sont pourtant statutairement, et à opposer les “faux” scientifiques, les usurpateurs, aux “vrais” scientifiques qui, eux, sont favo-rables aux parasciences. Au cours du « Duel sur la Cinq »
Procédés de dissociation… 127
consacré à l‟astrologie (10/06/1988), l‟astronome Dominique Ballereau se voit ainsi dépossédé de sa légitimité scientifique par son adversaire, l‟astrologue Élisabeth Teissier. Le processus qui aboutira finalement à la négation de la scientificité de l‟astronome commence dès le premier échange du débat, au cours duquel, on l‟a vu (cf. chapitre 4, §4), Dominique Ballereau présente la communauté scientifique comme unanime dans sa condamnation de l‟astrologie. Élisabeth Teissier utilise alors un procédé de dissociation afin de briser le consensus affiché par l‟astronome. À son adversaire, qui finit son tour de parole sur l‟assertion « s‟il n‟y a pas d‟influence astrale (.) il n‟y a plus d‟astrologie », elle répond : ET : (1) ah mais tout à fait (.) mais pour cela il faudrait que justement
(.) toute la corporation des astronomes soit de votre côté or il n‟en est rien (.) (2) et si euh je je je crois que ça serait un petit peu outrancier de
de balancer d‟une pichenette des gens comme Newton Kepler et (.) et Copernic qui eux-mêmes étaient euh je pense et vous le penserez comme moi d‟immenses astronomes (.) qui ont été à la source de découvertes très importantes pour l‟humanité (.) et qui (.) eux (.) ont pratiqué l‟astrologie […]
(3) les plus grands esprits ont cru et ou ont ont pratiqué l‟astrologie (4) bon (.) d‟autre part il y a des des scientifiques des astronomes
même mais surtout des grands de grands physiciens et surtout parmi les physiciens d‟avant garde (.) euh des gens qui défendent l‟astrologie et qui sont pour une euh (.) pour une interdépendance universelle […]
(5) contrairement à la loi mécaniste la la loi de cause à effet qui a régné dans la science jusqu‟au dix-neuvième siècle et à travers les (.) les scientistes (.) étriqués qui maintenant font figure de dinosaures face à à la physique moderne (.) et bien euh maintenant c‟est le principe de l‟interdépendance universelle qui compte (.) pour tous les scientifiques d‟avant-garde […] il n‟y a plus de système mécaniste et complètement réductionniste vous comprenez (.) et comme disait Einstein maintenant le le le dialogue le plus grave de l‟humanité a commencé maintenant (.) c‟est le dialogue entre l‟esprit scientifique (.) et la signification de la vie (.) il n‟y a plus de de de hiatus entre la physique et la métaphysique (.) et c‟est ce que prouve maintenant la physique moderne
(« Duel sur la Cinq » du 10/06/1988, la 5)
Dans son intervention, Élisabeth Teissier, après avoir explicité les règles de la discussion (1), oppose à son adversaire divers exemples de scientifiques qui ne rejettent pas l‟astrologie. Pour que sa réfutation soit efficace, il ne suffit pas que les individus présentés comme des exceptions à la règle énoncée par l‟astro-nome soient membres de la communauté scientifique : il faut aussi qu‟ils en soient des représentants éminents. C‟est pourquoi les premiers personnages cités par l‟astrologue sont Newton, Kepler et Copernic (2), qui sont des figures populaires de
128 Le débat immobile
l‟histoire des sciences, et dont Élisabeth Teissier sait par avance que leur qualité, unanimement reconnue, ne sera pas contestée par Dominique Ballereau (« je pense et vous le penserez comme moi ») – et sera aussi, et c‟est sans doute l‟essentiel, admise par l‟auditoire. De plus, l‟utilisation de l‟adjectif « immense », ainsi que l‟évocation des retombées des travaux de ces astronomes sur l‟humanité, soulignent l‟incommensurabilité entre la qualité des personnages cités comme références, et Dominique Ballereau, qui lui, est totalement inconnu de l‟auditoire, et dont seul le statut d‟astronome rend la parole légitime. Cette opposition met en évidence l‟immodestie de ce dernier, accusé par l‟astrologue de « balancer d‟une pichenette » des figures centrales de l‟histoire des sciences. Élisabeth Teissier transforme alors les propositions existentielles qui sous-tendaient son discours (“Kepler a pratiqué l‟astrologie” et “Copernic a pratiqué l‟astrologie” et “Newton a pratiqué l‟astrologie”), dans un mouvement inductif, en une proposition universelle (3) qui permet de poser une équation entre les “grands scientifiques” et les partisans de l‟astrologie. Dans la deuxième partie de son intervention, Élisabeth Teissier poursuit la même argumentation, mais en se référant cette fois-ci plus généralement à la science contemporaine. Son discours reprend alors la forme de propositions existentielles (4 : « il y a des des scientifiques des astronomes.... »). Les personnages invoqués sont désignés par des termes objectifs (« des scienti-fiques », « des astronomes ») ou valorisés par des adjectifs souli-gnant leur qualité (« surtout des grands de grands physiciens ») ou leur caractère visionnaire (« les physiciens d‟avant-garde », « tous les scientifiques d‟avant-garde »). L‟opposition entre le caractère rétrograde des adversaires des parasciences et le caractère visionnaire des scientifiques qui leur sont favorables est soulignée par la construction binaire (5 : « contrairement à.... eh bien maintenant... ») qui met en regard une situation révolue et la situation actuelle. L‟intervention d‟Élisabeth Teissier s‟achève sur une proposition qui, après avoir distingué la physique “rétrograde” de la physique “moderne”, présente à son tour cette dernière comme défendant unanimement un des principes fondateurs de l‟astrologie. Cette stratégie discursive n‟est pas propre aux parasciences : selon Latour, elle est fréquemment mise en place lors des grandes controverses scientifiques. Elle permet de rendre une situation irréversible, en « distribuant les “réactionnaires”, les “modernes”, les “avant-garde”, les “prématurés” », afin de les rendre modernes « en faisant passer tous les autres » (1984 : 59).
Procédés de dissociation… 129
L‟opposition entre anciens et modernes, tradition et révolution, n‟est donc pas anecdotique : elle entre dans une stratégie pour asseoir une position et imposer une issue au débat. Si l‟on revient à l‟interaction analysée précédemment entre l‟astrologue Élisabeth Teissier et l‟astronome Dominique Ballereau, on voit que ce dernier, conscient de l‟enjeu, refuse l‟image du débat proposée par son adversaire, qui affirme que l‟astrologie est prouvée par « la physique moderne ». Il s‟ensuit une violente mise en cause des compétences de Dominique Ballereau, qu‟Élisabeth Teissier accuse dans un premier temps de n‟être « pas très au courant », pour ensuite lui refuser le qualificatif de scientifique et lui attribuer celui de scientiste : ET : écoutez monsieur (.) il y a (.) il y a un problème chez vous autres
les scientistes (.) [parce que je ne dis pas que vous êtes un DB : [nous ne sommes pas scientistes nous sommes ET : [scientifique vous êtes un scientiste DB : [des scientifiques (.) je (.) je récuse le terme
(« Duel sur la Cinq » du 10/06/1988, la 5)
Enfin, vers la fin du débat, la poursuite de l‟interaction est mise en danger par le non respect, de la part des débatteurs, de la règle d‟alternance des tours de parole. Élisabeth Teissier en attribue la responsabilité à son adversaire, dont elle dénonce l‟attitude générale : ET : monsieur est là avec sa condescendance de pseudo-scientifique DB : non non non non (.) je ne suis (.) ah je vous respecte (.) je vous
respecte (.) par contre je ne respecte absolument pas l‟astrologie (.) nuance
(« Duel sur la Cinq » du 10/06/1988, la 5)
Ici s‟achève le processus initié dès le lancement du débat : alors que lors de la présentation des invités, Jean-Claude Bourret présentait Dominique Ballereau comme « un astronome donc un scientifique professionnel », il est ici traité de « pseudo-scientifique » par l‟astrologue Élisabeth Teissier, qui réalise ici un “coup de force” argumentatif, appliquant à son adversaire un qualificatif le plus souvent associé à son propre camp. L‟analyse détaillée du « Duel » sur l‟astrologie permet donc de mettre en évidence la visée argumentative des procédés de dissociation appliqués à la science : ils permettent de mettre en cause le statut de scientifique de l‟adversaire, tout en s‟assurant la caution des “bons” scientifiques. Ces références à la science comme instance de légitimation se font souvent sous la forme de ce que l‟on appelle l‟argument d‟autorité, et font l‟objet, dans les interactions, de fréquentes négociations.
130 Le débat immobile
2.2. Dissociations et argument d’autorité
Dans le débat sur les parasciences, procédés de dissociation et arguments d‟autorité sont intimement liés, puisque c‟est chez leurs adversaires que les partisans des parasciences vont chercher leurs références : c‟est auprès de scientifiques qu‟ils cherchent une caution aux disciplines qu‟ils défendent.
Définition de l’argument d’autorité Très généralement, l‟argument d‟autorité est défini comme un schème argumentatif qui repose sur l‟existence d‟un lien entre certaines caractéristiques d‟une personne (son prestige, sa compétence) et le crédit qu‟il convient d‟accorder à ses propos, puisqu‟« il appuie la vérité de la conclusion sur la personne de l‟énonciateur » (Plantin 1990 : 332). En cela, il est proche de la réfutation ad hominem, qui propose de rejeter une proposition sur la base de caractéristiques de son énonciateur (moeurs ou discours antérieurs). La structure logique que l‟on propose généralement de cet argument est la suivante :
X a dit que P (X est une autorité fiable à propos de P) Donc P.
La plupart des descriptions de l‟argument d‟autorité relèvent d‟une approche normative de l‟argumentation. Le plus souvent, l‟argument d‟autorité est associé à une démission intellectuelle : il suppose en effet que l‟on renonce à son propre jugement pour subordonner son opinion à celle d‟autrui. Quant à ses effets, l‟argument d‟autorité est rejeté comme “terroriste”, puisqu‟il vise à annuler le discours l‟adversaire, contraint au silence par le poids de l‟autorité (Grize 1990 : 45). Mais la condamnation globale de l‟argument d‟autorité n‟est guère tenable. Le caractère nécessairement limité du domaine de compétence de chacun rend son utilisation inévitable dès que l‟on cherche à se faire une idée sur un sujet qui sort de notre champ de savoir :
Comme tout le monde n‟est pas spécialiste de tout, il est rationnel d‟accepter de prendre tel médicament “sur la foi” d‟une prescription médicale, ou d‟acheter une voiture en espérant qu‟elle va rouler. L‟acceptation de l‟autorité conditionne ici le bon fonctionnement des objets techniques complexes, que tout un chacun traite comme des “boîtes noires”, acceptant la fonction sans demander la raison. (Plantin 1990 : 45)
La validité de cette forme d‟argumentation varie selon les situa-tions dans lesquelles elle est utilisée. Tel argument d‟autorité est
Procédés de dissociation… 131
acceptable pour un public de profanes, alors qu‟il n‟a pas lieu d‟être devant un public de spécialistes, où seuls sont recevables les arguments techniques. L‟argument d‟autorité, qui est donc spécifiquement un argument de profanes, échappe largement au contrôle de son destinataire, dont l‟incompétence l‟empêche de juger de la qualité de l‟autorité dont le locuteur se réclame, ainsi que de la façon dont elle est citée et interprétée : l‟acceptation ou non d‟un argument d‟autorité dépend grandement de la confiance que l‟on porte à celui qui l‟emploie, et des intentions qu‟on lui prête. C‟est pourquoi de nombreux théoriciens de l‟argumentation, acceptant l‟utilisation d‟un appel à l‟autorité dans le cas où le sujet débattu excède les compétences des personnes en présence, ont défini un certain nombre de conditions auxquelles l‟argumentation doit satisfaire afin d‟être considérée sinon comme valide, du moins comme acceptable ou rationnelle. 1. Le premier type de conditions d‟adéquation tient aux méca-nismes de discours rapporté que l‟argument d‟autorité met en oeuvre. D‟où un certain nombre de questions portant sur la citation elle-même : si elle relève du style direct, reprend-elle exactement les propos de l‟autorité citée ? Si elle est faite au style indirect, la reformulation est-elle fidèle ? Dans les cas où l‟expert invoqué s‟exprime en termes techniques, une opération de vulgarisation est nécessaire, puisque l‟argument d‟autorité, on l‟a dit, s‟adresse à des profanes. Cette opération ne déforme-t-elle pas les propos du spécialiste ? 2. Le deuxième type de conditions d‟adéquation porte sur la qualité de l‟expert. Le principe de base est que « l‟argument d‟autorité a la valeur de l‟autorité qu‟on invoque » (Plantin 1988 : 335). Or, dans de nombreux domaines, il est difficile d‟établir les critères permettant d‟évaluer la compétence d‟un expert. Différents éléments peuvent entrer dans une telle évaluation : – évaluation des prédictions antérieures de l‟expert ; – mise au point de tests permettant d‟évaluer certaines compé-tences précises ; – diverses informations sur l‟expert : qualifications profession-nelles, diplômes, témoignages de collègues... (Woods & Walton 1992 : 43) 3. La proposition P dont l‟autorité est présentée comme garant, doit relever de son domaine de compétence ; dans le cas contraire, il y a erreur de pertinence. 4. Toutes les contraintes qui pèsent sur la recevabilité d‟un témoignage pèsent aussi sur l‟évaluation d‟un argument d‟autorité (Govier 1985 : 84-85). En particulier, il convient de se demander si l‟autorité a un intérêt personnel à affirmer ce
132 Le débat immobile
qu‟elle dit : une expertise de la Seita prouvant, par ses expé-riences, que la cigarette ne cause pas le cancer serait irrecevable. 5. Enfin, certaines conditions sont liées à la nature même du sujet débattu. S‟agit-il réellement d‟un sujet qui puisse être tranché par un jugement d‟expert ? (Fogelin 1982 : 98). Pour cela, il faut qu‟il relève d‟un corps de savoir constitué, qui fasse l‟objet d‟un minimum de consensus, et non d‟un domaine de connaissance encore mouvant et controversé (Govier 1985 : 52). De plus, l‟argument d‟autorité doit préserver, en principe, la possibilité d‟un accès direct à la preuve. Si un désaccord se fait jour, l‟expert doit pouvoir prouver que son jugement repose sur une base objective, et expliciter les critères qu‟il a utilisés pour juger (Woods & Walton 1992 : 43-44). Les conditions d‟adéquation de l‟argument d‟autorité (et en particulier les conditions 2, 3 et 4) font apparaître que bien souvent, la critique de sa validité passe par une argumentation ad hominem – ce qui suppose que l‟on admette ce type d‟argumentation comme non fallacieux.
Évaluation de l’argument d’autorité par les locuteurs ordinaires
La conception de l‟argumentation développée dans cet ouvrage n‟est pas normative, et ce, pas plus pour l‟argument d‟autorité que pour les autres types d‟arguments. L‟analyse qui est menée ne cherche pas à savoir si l‟argumentation que les débatteurs développent lors des interactions est acceptable, rationnelle ou logiquement valide ; elle s‟intéresse aux effets que cette argu-mentation produit sur le déroulement de l‟interaction. À ce titre, il est pertinent d‟observer si l‟argument d‟autorité est accepté ou non par l‟adversaire et, quand il ne l‟est pas, quelles sont les justifications que ce dernier présente de son rejet. On verra que ces justifications rejoignent souvent certaines des conditions d‟adéquation présentées plus haut, et qui sont mises au point par les théoriciens de l‟argumentation. De telles convergences n‟ont en fait rien d‟étonnant. De même que les locuteurs ont une certaine compétence linguistique, largement normative, qui leur permet d‟évaluer les énoncés sémantiquement ou grammaticalement bien formés (et, éven-tuellement, d‟expliciter ces évaluations par des remarques du type “ça ne se dit pas comme ça” ou “ça n‟est pas français”), ils ont également intégré des normes argumentatives, d‟après lesquelles ils jugent telle argumentation acceptable ou inaccep-table, et qui leur permettent parfois d‟expliciter leur évaluation. La principale différence entre ces deux types de compétences est que l‟une est largement enseignée aux locuteurs lors de leur cursus scolaire, alors que les normes argumentatives ne font pas,
Procédés de dissociation… 133
du moins en France, l‟objet d‟un enseignement spécifique. Il n‟en reste pas moins que l‟analyse des débats fait apparaître que les locuteurs disposent de critères qui leur permettent d‟évaluer l‟acceptabilité des argumentations développées par leurs adversaires et, éventuellement, de mener des réfutations en invo-quant ces critères. Ainsi, lors du « Duel sur la Cinq » sur l‟astro-logie (10/06/1988), l‟astrologue Élisabeth Teissier compare la position de son adversaire, l‟astronome Dominique Ballereau, à celle de l‟Inquisition dans le procès contre Galilée. L‟astronome réagit en dénonçant l‟argumentation menée par Élisabeth Teissier comme fallacieuse :
DB : non non non non (.) rien à voir (.) c’est un amalgame (.) c‟est un amalgame (.) vous faites (.) vous faites des amalgames extrêmement savants (.) et ces amalgames je veux les dénoncer parce que c’est scandaleux
(« Duel sur la Cinq » du 10/06/1988, la 5)
Dominique Ballereau rejette donc l‟argumentation de son adversaire en l‟identifiant comme “amalgame” (c‟est-à-dire comme schème argumentatif irrecevable). De même, après une longue négociation sur la position d‟Hubert Reeves par rapport à l‟astrologie, Élisabeth Teissier s‟exclame :
ET : mais écoutez monsieur de toute façon (.) je vous je vous prie de ne pas faire de jugement de valeur.
(« Duel sur la Cinq » du 10/06/1988, la 5)
Ici, c‟est la désignation de l‟argumentation de l‟astronome comme “jugement de valeur” qui tient lieu de réfutation. Ces réactions constituent des enchaînements sur le dire, et non sur le dit : l‟explicitation de normes argumentatives permet donc, lors d‟interactions, la production de répliques (Kerbrat-Orecchioni 1990 : 206), dont l‟étude aurait un grand intérêt pour l‟ethnographie de la communication. Pour en revenir à l‟argument d‟autorité, l‟analyse du corpus fait apparaître qu‟il n‟a pas meilleure presse chez les profanes qu‟auprès des spécialistes de l‟argumentation. Dans la « Lettre ouverte aux rationalistes », Henri-Pierre Aberlenc, craignant qu‟on n‟interprète son développement comme un argument d‟autorité, nie avoir employé cette forme d‟argumentation, qu‟il condamne :
Bien qu‟encore minoritaires parmi leurs pairs, des scientifiques, dont certains de premier plan, sont par ailleurs des parapsychologues, des occultistes ou des mystiques convaincus. Nombre de ceux qui jetèrent les fondements des conquêtes modernes de la raison et de la science furent des adeptes de l‟ésotérisme : Léonard de Vinci, Francis Bacon, Descartes (le “père du Rationalisme” fut Rosicrucien), Pascal, Newton, Goethe, Dalton, Faraday et tant d‟autres jusqu‟à aujourd‟hui... Notre dessein, bien sûr, n’est aucunement d’employer ici le stupide
134 Le débat immobile
argument d’autorité (« Untel, qui fut un savant éminent, a dit ceci, donc c‟est juste ! »). (Le Monde Inconnu n° 106, juin 1989 : 10)
Il suffit, semble-t-il, qu‟un individu reconnaisse, dans le discours qui lui est adressé, un argument d‟autorité, pour que ce discours s‟en trouve discrédité, l‟argument d‟autorité appartenant à l‟ensemble des formes condamnées par les normes argumentatives intégrées par les locuteurs. Cette condamnation globale de l‟argument d‟autorité en tant que tel est d‟autant plus forte que les références à la science sont très présentes dans le débat qui nous occupe. Or (on y reviendra) le raisonnement sous-jacent à l‟argument d‟autorité et le raisonnement scientifique sont souvent présentés comme antinomiques, et nombreux sont ceux qui affirment que le second s‟est développé en opposition avec le premier. Malgré l‟opprobre qui pèse sur lui, l‟argument d‟autorité est fréquemment utilisé dans le débat sur les parasciences. Avant de voir les actualisations discursives de l‟argument d‟autorité dans le débat sur les parasciences, il convient de s‟arrêter un moment aux relations qu‟il entretient avec certaines problématiques linguistiques, et notamment celle du discours rapporté.
Argument d’autorité et discours rapporté
La prémisse “X a dit que P”, empruntée à la structure logique de l‟argument d‟autorité, suggère que sa réalisation discursive fait appel aux mécanismes du discours rapporté. C‟est aussi ce qu‟affirme Plantin, qui souligne que « l‟argument d‟autorité est fondamentalement en dépendance des mécanismes linguistiques de citation et de polyphonie » (1990 : 212). Il ne s‟agit bien entendu pas d‟assimiler toute citation à un argument d‟autorité, mais plutôt de considérer que certaines citations, dès lors qu‟elles valent plus par leur auteur que par leur contenu, assument la fonction d‟argument d‟autorité (Maingueneau, 1983a : 126). Comme forme du discours rapporté, l‟argument d‟autorité peut utiliser le style direct, indirect ou indirect libre. L‟utilisation du style direct, qui constitue une « théâtralisation d‟une énoncia-tion antérieure » (Maingueneau 1987 : 60), ne garantit pas plus que le style indirect l‟authenticité des propos rapportés. En revanche, il se présente comme un report littéral d‟un discours, vierge de la subjectivité du locuteur du discours citant, et peut faciliter la vérification de la condition d‟adéquation 1, concer-nant l‟exactitude de la citation. Le style indirect fait intervenir la subjectivité du locuteur, qui s‟inscrit dans la reformulation élaborée à partir du discours premier : se posent alors les
Procédés de dissociation… 135
questions liées à la fidélité à la source. À l‟oral, la distinction entre les différents types de discours rapporté est moins nette : certains indices qui permettent à l‟écrit de les distinguer (guillemets, tirets, alinéa) disparaissent, ce qui rend leur identifi-cation plus délicate. De plus, on rencontre souvent des argumen-tations qui semblent reposer sur les mêmes mécanismes que l‟argument d‟autorité, mais qui ne se présentent pas comme du discours rapporté. Ainsi, l‟astrologue Joëlle de Gravelaine, répondant à Anne Barrère qui l‟interroge sur les rapports entre l‟astrologie et la santé, aligne trois arguments : AB : l‟astrologie et la santé c‟est une vieille histoire JdG : c‟est une très très vieille histoire c‟est vrai mais j‟ai envie de vous
dire (.) tout simplement que (.) comme le dit Hubert Reeves nous sommes faits de la même poussière que les étoiles (.) et que euh y a une vieille règle (.) de Hermès Trismégiste qui dit que ce qui est en haut est comme ce qui est en bas (.) et il existe des un film superbe qui a été fait par la NASA (.) dans lequel on voit parfaitement (.) comment les (.) spirales qui sont à l‟intérieur (.) du corps se reproduisent d‟une manière extraordinaire dans les spirales qu‟on voit dans la galaxie
(« Santé à la une » du 04/01/1993, TF1)
Comme c‟est bien souvent le cas dans les argumentations authentiques, aucune conclusion n‟est explicitée. S‟il fallait en rétablir une, on pourrait proposer :
→ il y a donc correspondance entre les étoiles et le corps humain → l‟astrologie peut donc nous renseigner sur notre santé
Le choix des sources fait nettement apparaître les cibles succes-sivement visées par l‟argumentation. L‟évocation d‟Hubert Reeves est destinée à un public sensible à l‟autorité qui découle de la compétence, et précisément de la compétence scientifique. En revanche, il est clair que la référence à Hermès Trismégiste ne peut viser la même cible. Elle ne s‟adresse qu‟au petit nombre de personnes susceptibles de connaître – et de reconnaître comme légitime – cette référence à l‟intégration du dieu grec dans la tradition ésotérique. Enfin, la référence à la NASA montre bien que la source de l‟autorité n‟est pas nécessairement une personne, mais peut être une institution. Pour en revenir au problème de la citation, les deux premiers arguments d‟autorité utilisent des formes de discours rapporté. Quant au troisième argument d‟autorité, bien qu‟il relève clairement du même procédé argumentatif que les précédents, il ne fait pas appel au discours rapporté, à moins de considérer la NASA comme l‟énonciateur d‟un film assimilé à un discours sur les similitudes entre le corps et la galaxie. On considérera finalement que l‟argument d‟autorité peut prendre au moins trois formes différentes, chacune illustrée par Élisabeth Teissier dans le “Duel” sur l‟astrologie :
136 Le débat immobile
– la citation-autorité : ET : et comme disait Einstein (.) maintenant (.) le le le dialogue le plus
grave de l‟humanité a commencé (« Duel sur la Cinq » du 10/06/1988, la 5)
– l‟attribution d‟une position à l‟autorité : ET : il y a des des scientifiques des astronomes même mais surtout des
grands de grands physiciens et surtout parmi les physiciens d‟avant garde (.) euh des gens qui défendent l‟astrologie et qui sont pour une euh (.) pour une interdépendance universelle
(« Duel sur la Cinq » du 10/06/1988, la 5) – l‟évocation d‟une pratique : ET : des gens comme Newton Kepler et (.) et Copernic […] qui (.) eux
(.) ont pratiqué l‟astrologie […] les plus grands esprits ont cru et ou ont ont pratiqué l‟astrologie
(« Duel sur la Cinq » du 10/06/1988, la 5)
Par ailleurs, l‟appel à l‟humilité inhérent à l‟argument d‟autorité (comme en témoigne l‟appellation latine d‟argumentum ad verecundiam) apparaît très nettement dans la séquence suivante, qui oppose l‟astrologue Louis Saint Martin au physicien Henri Broch : LSM : vous savez Kepler disait (.) euh (.) rejeter l‟astrologie sans la
connaître sans la pratiquer sans l‟expérimenter c‟est une folie à trois dimensions (.) c‟était Kepler c‟était pas monsieur Broch ou monsieur Saint Martin qui s‟exprimait (.) hein (.) bon
HB : si vous voulez on peut discuter de l‟astrologie pour voir si XXX un p‟tit peu [XXXX
LSM : [XXXX quant à Einstein il disait c‟est une science en soi illuminatrice (.) j‟ai beaucoup appris grâce à elle (.) et je lui dois beaucoup
(« Savoir plus » du 01/03/1993, France 2)
On voit ici précisément en quoi l‟argument d‟autorité peut passer pour terroriste : il cherche à imposer silence et contrition à l‟adversaire, puisque ne pas s‟y soumettre, c‟est pécher par orgueil.
Réfutations de l’argument d’autorité Les conditions de validité de l‟argument d‟autorité établies par des théoriciens de l‟argumentation tracent les voies que la réfutation de cet argument, dans des interactions authentiques, peut emprunter.
1. Mise en cause de l‟exactitude de la citation La première réfutation de l‟argument d‟autorité repose sur la mise en doute de l‟existence de la citation. Dans son ouvrage Incroyable mais faux, Alain Cuniot propose une transcription du débat qui l‟a opposé à l‟astrologue Élisabeth Teissier lors d‟un « Duel sur la Cinq », puis multiplie, par écrit, les objections
Procédés de dissociation… 137
que le déroulement de l‟interaction ne lui avait pas permis d‟opposer à son adversaire. Se rapportant à la citation d‟Einstein mise en avant par Élisabeth Teissier (« comme disait Einstein maintenant le dialogue le plus grave de l‟humanité a commencé »), il commente :
Aristote, Dante, Balzac, Goethe, Kepler, Leibnitz, Spinoza, Luther, Descartes, Jung, Kant, Plotin, Paracelse, Mendel, Lavoisier, Pascal, Koestler, Freud, Malraux, Socrate, Pythagore, Levi-Strauss, Einstein, dont elle cite une phrase inconnue des physiciens. Elle a tout lu. Elle a tout compris. (Incroyable…: 45)
Clairement, Alain Cuniot cherche à contrer l‟argument d‟autorité employé par son adversaire en mettant en cause l‟exactitude de la citation rapportée par l‟astrologue. Mais cette remise en cause ne peut s‟effectuer sous la forme d‟une accusation directe de falsification : tant qu‟Élisabeth Teissier n‟indique pas ses sources avec précision, de façon à rendre possible une comparaison entre le discours premier et sa transposition dans le discours second, il est impossible à Alain Cuniot d‟affirmer qu‟Einstein n‟a jamais, en aucun lieu, en aucun moment de sa vie, dit cela. Il fait alors lui-même un usage très particulier de l‟argument d‟autorité, dont l‟existence est mentionnée par Perelman & Olbrechts-Tyteca (1988 : 416), et qui consiste à faire état de l‟ignorance ou de l‟incompréhension d‟un expert pour disqualifier le discours de l‟adversaire. Alain Cuniot, suggérant que les physiciens ne connaissent pas la citation avancée par Élisabeth Teissier, suggère non pas l‟incompétence des physiciens, mais l‟inexistence de la citation. Lors de débats télévisés, le problème de l‟exactitude de la citation débouche souvent sur des situations où, faute d‟avoir amené des pièces à conviction sur le plateau, chacun des débatteurs demande à être cru sur parole. Le seul moyen de résoudre le cercle vicieux du “parole contre parole” serait de prévoir les citations utilisées par l‟adversaire, et d‟apporter sur le plateau les sources – ou mieux : leur auteur, afin de le contredire. Une telle attitude ne porterait même pas nécessairement les fruits attendus, l‟adversaire pouvant toujours affirmer qu‟il a tiré sa citation d‟un autre ouvrage, que l‟on n‟aura pas cette fois à disposition. De plus, à se référer ainsi aux sources, on risque de passer pour “pinailleur” et, partant, de mauvaise foi : or, le soupçon de mauvaise foi disqualifie un locuteur, et prive son discours de toute crédibilité. 2. Discussion de la compétence de l‟autorité Une autre réfutation, plus maniable, consiste à contester la compétence de l‟expert invoqué. Ainsi, Evry Schatzman, débattant avec Suzel Fuzeau-Braesch (auteur du Que Sais-je ?
138 Le débat immobile
sur l‟astrologie, et favorablement disposée à l‟égard de cette discipline), met en cause les références de cette dernière :
Vous mentionnez par ailleurs les travaux de l‟astronome Treillis, ce dernier prétendant établir un lien entre les positions des planètes et les variations d‟activités solaires. Il faut pourtant savoir que ces travaux ne sont pas reconnus dans la communauté des astronomes et ceci, dans la mesure où ils reposent sur des statistiques insuffisantes et incomplètes. (« Débat : sur quoi repose l‟astrologie ? », Suzel Fuzeau-Braesch, Evry Schatzman, propos recueillis par Patrice Lanoy & Laurent Samuel, Ça m‟intéresse n°122, avril 1991 : 9)
Pareillement, le mage Octave Sieber, lors du « Duel » sur la sorcellerie, se voit opposer le même rejet par son adversaire Alain Cuniot, alors qu‟il avançait le Professeur Rhine comme exemple de scientifique favorable à la parapsychologie : OS : mais euh monsieur Cuniot mais le Professeur Rhine euh de
l‟université de Washington c‟est quelqu‟un euh qui vous ressemble un petit peu il a bien raconté et bien dit et écrit de quelle manière sont nos pouvoirs paranormaux (.) c‟est pas les laboratoires français qui l‟ont décou[vert
AC : [vous savez bien que Rhine est très contesté
(« Duel sur la Cinq » de mai 1990, la 5)
Ici encore, le fait que l‟autorité fasse l‟objet de contestations invalide l‟argumentation qui l‟invoque. Mais cet exemple fait apparaître un autre problème. Rhine est présenté comme un scientifique expert en parapsychologie. Or, il n‟existe pas d‟expert en parapsychologie sur lequel tous les avis des chercheurs du domaine en question convergeraient, dans la mesure où la parapsychologie (comme sans doute la plupart des parasciences) ne constitue pas ce que Govier appelle un corps de savoir reconnu (1985 : 352). De plus, on a vu que l‟argument d‟autorité ne pouvait avoir d‟efficacité argumentative que si l‟autorité prêtée à la source constituait un objet d‟accord (était reconnue par les deux parties en présence) : dans le cadre d‟un débat sur les parasciences, il est clair qu‟un argument d‟autorité reposant sur les travaux d‟un parapsychologue n‟a aucune chance de fonctionner. C‟est pourquoi le plus souvent, les débatteurs partisans des parasciences font appel à des autorités dont le domaine de compétence n‟est pas directement celui de la discipline en discussion. Il en résulte que la plupart du temps, les experts auxquels se réfère l‟argument d‟autorité sont cités hors du domaine de compétence dans lequel ils sont justement reconnus comme autorités. C‟est pourquoi, dans les réfutations de l‟argument d‟autorité, l‟évaluation de l‟expert est souvent indissociable de l‟identification de son domaine de compétence.
Procédés de dissociation… 139
3. Discussion du domaine de compétence de l‟expert C‟est ce qui apparaît notamment lors du « Duel » consacré à la voyance. Yves Galifret, opposé à la voyance, cite une étude parue dans Nature et concluant à l‟inanité de l‟astrologie. Le mage Dessuart riposte en évoquant les dissensions qui se font jour au sein même de la communauté scientifique sur la voyance, et évoque divers scientifiques favorables à la voyance : MD : je vais vous parler de scientifiques puisque c‟est ceux-[là qui YG : [euh non MD : [vous plaisent (.) et bien que vous vous prétendiez que ce ne sont YG : [euh ce sont les gens sérieux qui me plaisent MD : bon ben des gens sérieux je je peux vous citer Léonid Vassiliev (.)
en URSS YG : non (.) non non alors un [fumiste (.) quand j‟en parle (.) quand MD : [un un fumiste un savant russe YG : j‟en parle (.) quand j‟en parle à mes collègues soviétiques (.) ils
me disent pitié s‟il vous plaît euh pitié MD : alors je vais vous parler de Costa de Beauregard en France (.) de
[Jean Charon vous allez me [dire que ce [sont des fumistes aussi YG : [Costa de Beauregard [euh [Jean Charon n‟est pas
sérieux (.) Costa de Beauregard (.) demandez l‟avis des autres physiciens (.) pas pas sur Costa de Beauregard en tant que physicien sur Costa de Beauregard en tant qu‟utilisant la la physique (.) la physique euh corpusculaire pour justifier (.) la parapsy[chologie
MD : [ça (.) ça ne vous arrange pas (« Duel sur la Cinq » du 22/04/1988, la 5)
Les trois autorités présentées par le mage Dessuart sont rejetées par son adversaire. Léonid Vassiliev et Jean Charon ne sont pas acceptés comme experts. La compétence de Costa de Beauregard est reconnue dans son champ spécifique, mais niée pour les questions nécessitant une extrapolation à partir de ce champ. Il n‟est pas évident de déterminer si l‟un des deux débatteurs parvient à remporter cette négociation : le mage Dessuart n‟arrive pas à faire valider ses références par son adversaire qui, en tant que scientifique, serait habilité à le faire ; mais il riposte en présentant la résistance de son adversaire comme un symptôme de partialité. Les exemples précédents de réfutations de l‟argument d‟autorité montrent que les conditions 1, 2 et 3, que les théoriciens de l‟argumentation imposent à l‟argument d‟autorité afin de garantir sa validité, se retrouvent aussi dans les réfutations de cet argumentation par des profanes. Le corpus ne livre pas d‟exemples de réfutations basées sur les conditions 4. et 5.1;
1 On peut quand même facilement imaginer des réfutations basées sur 4. : ainsi,
un locuteur invoquant les travaux de Jacques Benveniste sur la mémoire de l‟eau pour justifier l‟homéopathie pourrait se voir répondre que les travaux en question, étant financés largement par les laboratoires Boiron, principaux
140 Le débat immobile
mais le recensement des modes de réfutation de l‟argument d‟autorité reste ouvert. Enfin, indépendamment des réfutations basées sur les conditions d‟adéquation, on peut imaginer qu‟un locuteur réfute un argument d‟autorité en lui opposant un autre argument d‟autorité, menant à une conclusion contraire ; mais aucun exemple ne vient étayer cette “case réfutative”, qui pour l‟instant, reste vacante. Finalement, la récurrence des arguments d‟autorité pourrait être symptomatique du fait qu‟un des enjeux les plus importants du discours des partisans des parasciences est la recherche d‟alliés (Latour 1989 : 54). Ils ne peuvent, bien sûr, reprendre à leur compte la vision du débat que leur proposent leurs adversaires (le bloc des scientifiques contre le bloc des charlatans) : ils lui substituent une autre image, qui voit ce qui était présenté comme “la communauté scientifique opposée aux parasciences” se rétrécir comme une peau de chagrin et s‟étioler du fait du départ des “nouveaux alliés” des parasciences, dont le revirement (et l‟évaluation de son poids argumentatif) est discuté âprement au cours du débat. Le camp des partisans des parasciences est grossi d‟autant ; et gagner une autorité à sa cause, ce n‟est pas seulement rallier à son camp un individu de plus. Latour propose l‟exemple d‟un locuteur qui étaye son discours en faisant appel au prix Nobel Andrew Schally ; cet individu met son adversaire en demeure de contester non seulement cette autorité, mais avec elle, « ses collègues, le conseil de l‟université de La Nouvelle-Orléans qui a donné une chaire à Schally, le Comité Nobel qui a récompensé son travail en lui décernant le prix le plus élevé, les nombreuses personnes qui en secret ont conseillé le Comité, le comité de rédaction de Nature, les rédacteurs qui ont accepté de publier l‟article, plus le conseil scientifique de la National Science Foundation et le National Institute of Health qui ont subventionné la recherche, plus les nombreux techniciens, ainsi que tous ceux qui ont contribué et qui sont cités dans les remerciements » (1989 : 51). Ainsi, l‟argument d‟autorité, en surface, repose sur le prestige. Mais, quand il fait appel à une autorité scientifique, il faut tenir compte du fait que la science fonctionne en réseaux, et qu‟une autorité entraîne derrière elle quantité d‟acteurs de statuts divers, et qui lui sont indissociablement liés : argument reposant sur un lieu de qualité, il constitue aussi, à un autre niveau, un argument du nombre. Et nombre des réfutations auxquelles il donne lieu consistent en des tentatives pour briser ces réseaux. Il en est ainsi notamment de la critique de la qualité de l‟expert :
producteurs de médicaments homéopathiques, ne remplissent pas la condition d‟impartialité nécessaire à la prise en compte de leurs résultats.
Procédés de dissociation… 141
quand le professeur Galifret affirme que ses « collègues soviétiques » demandent pitié lorsqu‟on leur parle de Léonid Vassiliev, ou qu‟il invite son adversaire à demander « l‟avis des autres physiciens » sur Costa de Beauregard, il cherche à désolidariser les autorités invoquées par le mage Dessuart du reste de la communauté scientifique et à les isoler, afin d‟affaiblir l‟argument du nombre qui sous-tend l‟argument d‟autorité. Dans l‟univers scientifique, où les vérités ne s‟imposent jamais d‟elles-mêmes, mais sont décidées par la communauté (dans la mesure où toute science est un travail collectif), la qualité et la quantité sont indissociables. Les procédés de dissociation qui apparaissent dans le discours des partisans des parasciences répondent donc point par point aux procédés de liaison utilisés par leurs adversaires. Alors que leurs adversaires les associent dans une même dénonciation, les défenseurs des parasciences crient à l‟amalgame et montrent du doigt les brebis galeuses qui les discréditent, manifestant ainsi leur propre honnêteté. Au bloc homogène mis en scène par les détracteurs des parasciences, ils opposent une communauté scientifique déchirée entre une “science officielle” rétrograde et une avant-garde éclairée qui leur est favorable. Cette “avant-garde” leur sert de vivier dans lequel ils vont puiser des autorités qui fonctionnent comme autant d‟alliés à la cause des parasciences.
Chapitre 7 : Le débat selon les
partisans des parasciences.
II : L’appel à Galilée
Dans le discours des partisans des parasciences, les procédés de dissociation, associés à l‟argument d‟autorité, contribuent donc à redistribuer les différents acteurs du débat sur l‟échiquier argumentatif pour redéfinir les camps en présence, ainsi que les positions que chaque acteur s‟engage à défendre. Mais cette restructuration resterait froide, incomplète, si elle n‟était pas associée à une interprétation du débat qui lui donne un sens. De même que les adversaires des parasciences présentent la contro-verse sur les parasciences comme la lutte acharnée de quelques esprits éclairés tentant d‟arracher des griffes de l‟obscurantisme une société en plein désarroi, les partisans des parasciences interprètent le débat comme la lutte d‟esprits ouverts, révolu-tionnaires, contre la censure d‟une institution omnipotente et sclérosée, qui cherche à étouffer la vérité afin d‟assurer la pérennité de sa domination. Cette schématisation, qu‟on appellera ici “appel à Galilée”, repose sur l‟établissement d‟un parallèle entre la controverse actuelle sur les parasciences et le procès de Galilée – ou plus précisément, le mythe auquel il a donné naissance (Redondi 1991).
1. ANALYSE DU MÉCANISME DE L’APPEL À GALILÉE La figure de l‟appel à Galilée, identifiée dans le débat sur les parasciences, apparaît également au cours d‟une controverse déjà mentionnée dans ce travail : l‟“affaire Benveniste”. L‟affaire Benveniste diffère des controverses locales qui constituent le débat sur les parasciences principalement par le fait qu‟elle s‟est déroulée, au moins en partie, sur ce que Collins & Pinch appellent le forum constituant (1991 : 303). Après la parution des résultats des travaux de Benveniste dans la revue Nature, revue “officielle” s‟il en est, en juin 1988, divers labo-ratoires ont cherché à les reproduire expérimentalement, faisant appel à des chercheurs institutionnellement reconnus, qui ont appliqué des protocoles unanimement admis au sein de la communauté scientifique ; or, il est très rare que les scientifiques fassent l‟honneur de telles discussions aux théories habituelle-ment désignées sous l‟appellation de “parasciences”. Mais
144 Le débat immobile
l‟affaire Benveniste s‟est aussi largement déroulée sur le forum officieux, dont il a été longtemps affirmé qu‟il ne contribuait pas à l‟élaboration des vérités “objectives”, mais dont l‟importance est aujourd‟hui de mieux en mieux admise. Ce forum comprend les articles parus dans les revues de vulgarisation, voire dans la grande presse, les émissions télévisées, les structures financières ou professionnelles, et même les simples ragots (id. : 303). Sur le forum officieux, l‟affaire de la mémoire de l‟eau a souvent été amenée à côtoyer les parasciences. Ainsi, la revue de vulgarisation Science & Vie, qui a suivi pas à pas la polémique, et s‟est située résolument du côté des adversaires de Benveniste, en traitait dans la rubrique « Blurgs », habituellement consacrée aux articles sur l‟astrologie, la numérologie, la parapsychologie, etc. Plus généralement, les adversaires des parasciences incluent très souvent la théorie de la mémoire de l‟eau dans leur dénonciation des parasciences. Un tel rapprochement a eu pour conséquence de faire naître certaines similitudes entre l‟argumentation menée par les différents acteurs de la polémique autour de la mémoire de l‟eau, et l‟argumentation développée par les protagonistes du débat sur les parasciences. Enfin, la polémique autour de la mémoire de l‟eau est directement liée au débat sur les parasciences dans la mesure où la théorie de Jacques Benveniste a été présentée par les partisans de l‟homéopathie comme une justification possible de cette thérapeutique. Il s‟agit donc d‟un des cas, relativement rares, où le débat sur une médecine parallèle abandonne la discussion de l‟efficacité pour aborder le terrain de l‟explication. La description de l‟appel à Galilée empruntera donc des exemples aux interactions polémiques qui constituent le coeur du débat sur les parasciences (débats sur l‟astrologie, la parapsychologie...), mais aussi à “l‟affaire Benveniste” qui, bien que périphérique, déploie des argumentations tout à fait similaires.
1.1. Le mythe de Galilée comme événement fondateur du débat sur les parasciences
L‟“appel à Galilée” peut être avantageusement décrit par ce que Maingueneau appelle la mémoire polémique. Maingueneau développe l‟idée que certaines polémiques (et peut-être même toutes) construisent une schématisation d‟elles-mêmes qui renvoie l‟image non pas d‟une controverse isolée, ponctuelle, mais d‟un débat lui-même inscrit dans une “tradition” polémique.
L‟appel à Galilée 145
La polémique ne se donne pas pour première ; elle ne se légitime qu‟en apparaissant comme la répétition d‟une série d‟autres qui définissent pour une formation discursive sa “mémoire polémique”. (1987 : 92)
Au sein de cette mémoire polémique, les protagonistes de la controverse isolent un “moment” polémique particulier, un événement qu‟ils jugent particulièrement représentatif ou parlant, et le constituent, en quelque sorte, en événement fondateur, en situation de référence par rapport à laquelle la polémique actuelle trouve son sens et sa cohérence. L‟affaire Galilée, ou plus précisément le procès de Galilée, semble constituer l‟événement fondateur par rapport auquel les partisans des parasciences proposent d‟interpréter le débat qui les oppose aux adversaires des parasciences. En quoi l‟affaire Galilée est-elle susceptible de servir de référence au débat sur les parasciences ? En fait, il semble que le personnage de Galilée, ainsi que son procès, ont rapidement dépassé les simples faits historiques pour prendre une dimension mythique. La lecture des textes consacrés à Galilée fait apparaître l‟existence d‟un grand nombre de désaccords. On passera sur les divergences factuelles ; dès qu‟on s‟intéresse à l‟interprétation qu‟il convient de donner au personnage et à l‟évaluation de ses travaux, les passions s‟échauffent. Certains voient en Galilée la figure du martyr des sciences, du héros précurseur de la rationalité moderne, d‟un courage intellectuel exemplaire et d‟une intelligence supérieure. Pour d‟autres (plus rares, il est vrai), Galilée incarne un personnage terriblement négatif, un monstre d‟orgueil et de duplicité, auquel ils finissent par nier toute dimension scientifique1. Il s‟agit bien sûr de positions extrêmes ; mais on peut dire plus généralement que prendre position par rapport à Galilée, c‟est prendre position par rapport à la science et à son histoire. Tout livre sur Galilée est un livre “à thèse”, et tout jugement sur Galilée est un jugement sur la science en général (Stengers 1989a). Il semble donc que toute évocation de Galilée, particu-lièrement en contexte argumentatif, a bien des chances de faire référence, plus qu‟au personnage historique, à un mythe, à un stéréotype culturellement dominant, susceptible d‟être exploité
1 C‟est le cas par exemple de Philippe Decourt, qui souligne « l‟orgueil sans
mesure », « l‟extrême vanité », la « duplicité » de Galilée qui aurait souffert de « troubles paranoïaques », pour finalement lui dénier toute dimension scientifique :
Il n‟y a pas eu de “révolution copernicienne”. Au contraire, avec les incroyables histoires d‟épicycles, Copernic et Galilée sont les derniers soutiens actifs d‟une fausse science archaïque. (Les Vérités indésirables, I, Paris : La Vieille taupe, p.35)
146 Le débat immobile
argumentativement sans équivoque possible. Quelle est la teneur de ce mythe ? Micheli le définit comme suit :
Galilée représente d‟une manière emblématique le savant moderne qui combat à la lumière de l‟expérience et de sa propre raison, la culture scientifique traditionnelle fondée sur la confiance invétérée dans l‟autorité d‟Aristote. Libre de tout préjugé, confiant dans ses propres moyens de recherche, il entreprend une lutte difficile qui se poursuit durant l‟époque suivante d‟une manière toujours plus ample et articulée. Jusqu‟à ce que la nouvelle méthode de recherche, promue par lui-même, s‟impose et devienne le caractère principal de l‟activité scientifique moderne. (1990 : 165)
Du vivant du savant déjà de très nombreux témoignages d‟affection, voire de dévotion, lui sont adressés. Au cours du dix-huitième siècle, le stéréotype intègre quelques éléments nouveaux : – dimension nationaliste ; – hypothèse de la torture (le savant aurait subi un dur interroga-toire et n‟aurait accepté d‟abjurer que sous la torture, d‟où la cécité qui l‟a frappé vers la fin de sa vie) ; – “Eppur‟ si muove” : cette exclamation, qui deviendra un slogan anticlérical au dix-neuvième siècle, apparaît dans l‟hagiographie de Galilée à la Révolution Française. Ajoutée à l‟hypothèse de la torture, apparue à la même époque, ces deux ornements à la biographie du savant permettent de le racheter aux yeux de la science, de compenser sa rétractation par les souffrances endurées et la permanence de ses convictions profondes. Galilée peut alors devenir un « saint martyr protecteur du progrès des sciences » (Redondi 1991 : 81). L‟expression de la vénération vouée à Galilée atteint son apogée au dix-neuvième siècle. À cette date, le stéréotype est clair : Galilée symbolise l‟irréductibilité de la Science et de la Religion, de la Raison et de la Foi. Les travaux qui tentent de décrire l‟évolution récente du “mythe Galilée” ne sont pas légion. Ils affirment le plus souvent la pérennité du stéréotype, qui continuerait à incarner le combat de la raison contre l‟obscurantisme religieux (Koyré 1966, Thuillier 1988). Pourtant, l‟invocation de Galilée, dans des contextes argumentatifs contemporains, révèle une certaine évolution du stéréotype – en particulier, l‟instance qui incarne la censure n‟est généralement plus l‟Église. Ainsi, face aux critiques déferlant sur les sondages d‟opinion, Jean Stoetzel multiplie les appels à Galilée :
Périodiquement, le procès de Galilée est instruit de nouveau : au nom de considérations idéologiques, morales ou politiques, on veut refuser aux scientifiques la possibilité de divulguer les résultats de leurs recherches. C‟est la valeur même des sondages qui est mise en cause et, avec elle, la légitimité des sciences humaines dont les enquêtes d‟opinion sont un des instruments.
L‟appel à Galilée 147
(Jean Stoetzel, cité dans Loïc Blondiaux, « Paul F. Lazarsfeld (1901-1976) et Jean Stoetzel (1910-1987) et les sondages d‟opinion : genèse d‟un discours scientifique », Mots 23, 1990 : 19).
Ici, c‟est une censure idéologique, morale ou politique qui est dénoncée, mais en aucun cas une censure religieuse : l‟appel à Galilée s‟est “laïcisé”. De même, dans un article intitulé « Vavilov : un Galilée soviétique », paru dans la revue de vulga-risation Science & Vie, Denis Buican évoque l‟histoire de Nikolai Vavilov, biologiste soviétique opposé au lyssenkisme, mort en prison en 1943. Le parallèle avec Galilée, établi dès le titre de l‟article, est repris plusieurs fois, et notamment dans le passage suivant :
Plusieurs membres de cette académie [Académie Lénine des Sciences Agricoles] furent emprisonnés, et la chasse à l‟ “ennemi du peuple” Vavilov fut ouverte. Parfaitement conscient du danger qui le guettait, Vavilov déclara en 1939 : “On pourra nous mener au bûcher, on pourra nous brûler vifs, mais on ne pourra pas nous faire renoncer à nos convictions” (ces paroles furent citées en novembre dernier par la Pravda, dans un article signé par deux membres de l‟Académie des Sciences, qui disaient que “même Galilée n‟est pas allé aussi loin”. On peut ajouter, à la décharge du Vatican, que Galilée vécut jusqu‟à sa mort naturelle à l‟âge de soixante-dix-huit ans ; il est vrai qu‟il s‟était renié, à la différence de Vavilov. (Science & Vie n°847, avril 1988 : 31)
Certains éléments du stéréotype restent les mêmes : Vavilov, comme Galilée, a clamé la vérité envers et contre tous (et, comme le souligne l‟article, avec plus d‟intransigeance encore que Galilée), comme lui, il a souffert des mesures de rétorsion prises contre lui par le pouvoir en place. Mais ce pouvoir n‟est plus l‟Église ou, plus précisément, la Sainte Inquisition : c‟est l‟État soviétique, c‟est-à-dire un pouvoir politique et laïque, qui a censuré et emprisonné Vavilov. Dans le débat sur les parasciences, le cadre argumentatif dans lequel s‟insère le syndrome Galilée est encore plus surprenant, lorsqu‟on se réfère au mythe de départ. Alors que le stéréotype originel présente le procès de Galilée comme le combat de la raison contre l‟obscurantisme religieux, l‟appel à Galilée, dans la polémique sur les parasciences, oppose la communauté scientifique, assimilée à l‟Inquisition, aux parascientifiques (qui sont, eux, assimilés à des défenseurs de l‟obscurantisme par leurs adversaires), qui se posent comme détenteurs du vrai, à l‟image de Galilée en son temps. Ce retournement de Galilée, figure emblématique de la science, contre la science elle-même, mérite qu‟on y consacre une analyse détaillée.
148 Le débat immobile
1.2. Appel à Galilée et figure du précédent
Formellement, l'appel à Galilée a la structure d'un “précédent”. Lorsqu'on argumente par le précédent, on établit un parallèle entre une situation S0, situation antérieure, de référence, et la situation actuelle S1, en posant un jugement d'analogie entre les deux situations S0 et S1, analogie légitimée par l'invocation de traits caractéristiques communs aux deux situations. La situation de référence S0 doit faire l'objet d'une interprétation culturelle présentée comme unanime, et doit être associée à une sorte de morale ou règle d'action supposée pouvoir être appliquée à S1. Pour pouvoir appliquer la description du précédent à l‟appel à Galilée, il faut en modifier légèrement la définition, et admettre que la situation de référence S0 peut servir aussi bien de modèle que d'anti-modèle (Perelman & Olbrechts-Tyteca 1988 : 492 sqq.). Elle peut donc servir la conclusion : “Il faut agir dans la situation présente de la même façon qu'on avait agi dans la situation de référence”, ou, au contraire : “Prenons garde à ne pas reproduire l'erreur qui a été commise par le passé lors de la situation de référence S0”. Dans le cas de l'appel à Galilée, la situation de référence est bien sûr l'affaire Galilée, réduite en fait au procès de Galilée, qui fonctionne globalement comme anti-modèle. Au sein de cet anti-modèle, on peut distinguer un pôle positif (Galilée), qui invite à l'identification, et un pôle négatif (l'Inquisition), qui suscite la répulsion. Si cette analyse du mécanisme argumentatif de l‟appel à Galilée est correcte, on peut s‟attendre à rencontrer, au cours de débats divers, des argumentations similaires, au sein desquelles Galilée sera remplacé par d‟autres personnalités de l‟histoire des sciences, sans que le mécanisme n‟en soit modifié. Se dessinerait alors une figure argumentative plus abstraite, plus générale, dont l‟appel à Galilée ne serait qu‟un cas particulier, et qui, comme l‟appel à Galilée, reposerait sur le mécanisme de différé temporel de la preuve, et en appellerait au jugement de l‟histoire. Selon ce schéma plus général, les situations virtuelles S0 et S1 pourraient être associées à toute paire de situations respectant le cadre général suivant :
S0 (Événement fondateur) : Toute occasion où, dans l‟histoire des sciences, une théorie ne rencontre qu‟incrédulité lors de sa première formulation, mais par la suite, se trouve fondée.
S1 (Polémique actuelle) : Toute situation où une théorie revendiquant un statut scientifique se le voit refuser par la “science officielle”.
L‟appel à Galilée 149
Enfin, l‟appel à Galilée peut viser deux types de conclusions, de force variable. Le premier mouvement argumentatif est radical, puisqu‟il présuppose la validité de la théorie défendue. L‟adversaire, qui lui est opposé, est pressé non pas de réserver son jugement, sous peine de reproduire une nouvelle affaire Galilée, mais de changer d‟opinion, et d‟admettre la validité de la théorie présentée comme novatrice, sous peine d‟attirer un jugement défavorable sur sa propre personne, puisqu‟en rejetant la théorie, il reproduit l‟anti-modèle. C‟est à cette conclusion que mène tout parallèle avec Galilée, dès lors qu‟il n‟est pas assorti de réserves spécifiant que la vérité de la théorie discutée ne fait pas partie des traits communs à S0 et S1. La conclusion plus faible consiste simplement en une invitation à la modération. Elle suggère à l‟adversaire de réserver son jugement, arguant du fait qu‟il appartient à l‟avenir de trancher, sans pour autant lui dicter une conduite précise. C‟est ce à quoi le Pr. Giuliano Preparata invite la communauté scientifique à propos de l‟affaire Benveniste :
Je crois qu‟il faudrait dire aux gens qui ont ces réactions violentes, passionnelles (ce qui est le contraire de la raison !) : regardez mieux ! Allez examiner les éprouvettes de Benveniste avec intérêt, curiosité – et, pourquoi pas, bienveillance ! N‟oublions jamais que nous sommes fiers d‟être les héritiers de la science moderne, et que cette science, c‟est par l‟hérésie de Galilée qu‟elle a commencé, avec une théorie qui était absolument irrecevable pour la représentation dominante du moment. Il faut toujours garder cette inquiétude : ne pas être comme les savants officiels de l‟époque, qui faisaient l‟erreur magistrale de refuser d‟aller regarder dans la lunette de Galilée ! (Cité par Philippe Alfonsi, Au nom de la science, Paris : Barrault-Taxi, 1991 : 62).
Giuliano Preparata ne cherche pas à substituer une opinion catégorique (favorable à Benveniste) à une autre opinion catégorique (défavorable, cette fois, au savant), mais demande simplement qu‟on ne reproduise pas l‟anti-modèle. On retrouve là une caractéristique de cette figure, soulignée par Perelman : alors que le modèle propose une ligne d‟action précise, calquée sur la situation de référence prise en exemple, l‟anti-modèle ne définit que négativement la ligne à suivre, et la conclusion à laquelle il conduit reste souvent floue (Perelman & Olbrechts-Tyteca 1988 : 493-494). Dans tous les cas, l‟appel à Galilée a pour conséquence argu-mentative le différé temporel de la preuve, puisque la contem-poranéité de la controverse est présentée comme obstacle à l‟émergence de la vérité : seul l‟avenir peut décider sereinement de l‟issue de la controverse. La force de ce différé de la preuve est considérable : il permet en effet de rejeter “en bloc” tous
150 Le débat immobile
les contre-arguments opposés aux partisans des parasciences, arguant du fait qu‟ils sont historiquement contraints par l‟état actuel des connaissances. Les partisans des parasciences invitent alors leur destinataire à faire une sorte de pari sur l‟avenir, et à anticiper sur le jugement de l‟histoire en choisissant leur camp : celui de Galilée, ou celui de l‟Inquisition.
1.3. Variantes de l’appel à Galilée
La description étendue de l‟appel à Galilée permet de rendre compte des diverses variantes de l‟appel à Galilée mises en évidence par l‟analyse du corpus. Dans le « Duel sur la Cinq » sur l‟astrologie, l‟astronome Dominique Ballereau, qui nie que le positionnement des astres à l‟instant de la naissance d‟un individu puisse avoir une quelconque influence sur son destin ultérieur, se voit assimilé à Lord Kelvin (anti-modèle = débat sur l‟aviation) dans un premier temps, puis à Galilée (anti-modèle = débat sur l‟héliocentrisme), par l‟astrologue Élisabeth Teissier : ET : vous savez qui vous me rappelez ? Lord Kelvin qui au début du
vingtième siècle disait l‟aviation n‟existe pas on ne pourra jamais voler parce que le métal est plus lourd que l‟air (.) voilà ce que vous me rappelez
DB : non non rien à voir (.) c‟est un amalgame ET : mais si (.) et Galilée alors ? et Galilée ? alors
(« Duel sur la Cinq » du 10/06/1988, la 5)
La même visée argumentative peut donc être portée aussi bien par le pôle négatif de l‟anti-modèle (par l‟identification de l‟adversaire à Lord Kelvin) que par son pôle positif (évocation de Galilée). Jacques Benveniste, présenté à diverses reprises dans la presse écrite comme un nouveau Galilée, met lui-même la réaction de la communauté scientifique face à sa théorie en parallèle avec des précédents historiques :
Il existe de nombreux exemples de ce processus d‟exclusion immédiate, au point que certains ont rétracté des résultats qui ont été redécouverts plus tard. Semmelweis avait compris que les femmes ne mouraient plus en couches lorsque les accoucheurs se lavaient les mains ; on lui rit au nez ; il en devint fou. Lord Kelvin : « Les rayons X ? Une supercherie ! » Un académicien des Sciences anonyme : « Le phonographe d‟Edison ? Un tour de ventriloque ». Il avait raison : qui peut croire que l‟on peut conserver une voix sur de la cire ! La radioastronomie ? « Unbelievable », pour l‟Astrophysical Journal. La mention du mot météorite ou des pierres de lune faisait mettre en transes l‟Académie des Sciences, il y a un siècle. Des pierres qui tombent du ciel ? Il faut être sérieux ! Le chemin de fer, le plus lourd que l‟air, les microbes, les divisions blindées... im-pos-sible ! (Jacques
L‟appel à Galilée 151
Benveniste, « La Vérité scientifique : faux vrai passeport pour de vraies frontières », Traverses 47, 1989 : 63).1
Benveniste insiste principalement sur le pôle négatif de l‟anti-modèle, ce qui renforce la grande virulence qu‟il déploie envers l‟Institution scientifique.2 Cette stratégie lui est peut-être aussi imposée par la loi de modestie : privilégier l‟évocation de l‟instance inquisitoriale permet de voiler le parallèle bien immodeste qu‟il établit du même coup entre lui-même et des figures légendaires de l‟histoire des sciences. Toujours au sein du débat sur les parasciences, on rencontre des argumentations que l‟on peut rapprocher de l‟appel à Galilée, bien qu‟aucun personnage connu ne vienne incarner le pôle positif ni le pôle négatif de l‟anti-modèle. Au cours d‟un « Ciel mon mardi » consacré au New Age, un participant adepte de l‟ex-corporation (voyage hors du corps) affirme ainsi qu‟au cours d‟une de ses expériences, il a vu la face cachée de la lune, et qu‟elle était habitée. Devant le scepticisme de l‟animateur, il réplique :
X : il y a un millénaire on était dans la science fiction quand on disait que la Terre était ronde (.) aujourd‟hui (.) on est dans la science fiction quand on dit que la face cachée de la Lune est habitée
(« Ciel mon mardi » du 19/02/1991, TF1)
Le locuteur évoque le précédent par la formulation de la théorie injustement rejetée lors de son apparition (« la terre [est] ronde ») et celle de la théorie qu‟il avance lui-même (« la face cachée de la Lune est habitée »), sans que leurs défenseurs ou leurs détracteurs ne soient nommés ; il s‟agit bien pourtant, sans équivoque possible, de la même figure argumentative.
2. MOTIFS DE L’APPEL À GALILÉE
Outre l‟argumentation par le précédent, qui constitue l‟ossature de l‟appel à Galilée, on trouve dans le discours des partisans des parasciences un certain nombre de “topiques”, au sens littéraire
1 Plus récemment, Jacques Benveniste, après la fermeture de son unité de
recherche par l‟Inserm, répondant aux questions de Globe Hebdo, se compare à Edison :
Globe Hebdo : Ne pensez-vous pas que la communauté scientifique, qui doute de vos résultats, vous renvoie l‟image d‟un fou ? JB : en 1850, on a dit à Edison que son invention pour transférer la voix d‟une pièce à l‟autre ne serait jamais qu‟un jouet... (Globe hebdo n°50, 19-25 janvier 1994 : 22)
2 Ainsi, interviewé par Le Canard Enchaîné, Benveniste déclarait : « en France, l‟élite scientifique est dressée contre moi. Tous des cloportes ! Soit dit sans méchanceté, les cloportes sont des bestioles sympathiques – simplement, elles aiment l‟ombre. » (Les Dossiers du Canard, juin 1990 : 38)
152 Le débat immobile
du terme (Curtius 1956), c‟est-à-dire certains motifs, certains thèmes récurrents, qui posent et renforcent cette argumentation. Chacun de ces topiques, pris séparément, ne constitue pas un appel à Galilée (aucun parallèle n‟y est établi avec une situation de référence) ; en revanche, chaque motif rend possible l‟éta-blissement du parallèle entre S0 et S1. Ainsi, la co-présence, dans un discours, de plusieurs de ces topiques construit une schématisation du débat en totale adéquation avec l‟interprétation de la controverse suggérée par l‟appel à Galilée, qu‟elle rappelle et renforce.
Ces topiques s‟organisent selon quatre axes. Le premier concerne la dynamique du débat construite par les partisans des parasciences, et le pari sur l‟avenir que l‟appel à Galilée implique. Le second pose la non scientificité du débat, et permet ainsi le parallèle avec la situation de référence. Le troisième est le portrait du Galilée moderne tracé par ses partisans. Le dernier relève de l‟exploitation pathétique de l‟appel à Galilée, et souligne les dangers encourus par le Galilée moderne.
2.1. Dynamique du débat construite par les partisans des parasciences
L‟appel à Galilée suppose que la dynamique du débat sur les parasciences ait certains points communs avec celle du débat autour de l‟héliocentrisme. Plus précisément, il est nécessaire de faire apparaître les adversaires des parasciences comme les gardiens de la tradition, attachés au passé, réfractaires à toute innovation, et, à l‟inverse, de présenter les partisans des parasciences comme les représentants d‟une théorie en plein développement, tournée vers l‟avenir, dont la validité sera démontrée par l‟histoire dans les années à venir. Les partisans des parasciences présentent donc le débat comme la manifestation d‟une rupture entre un ancien monde et un nouveau dont les contours se dessinent à peine, mais au sein duquel les parasciences ont leur place. Cette dynamique apparaît dans le titre des revues spécialisées dans les parasciences : Autre Monde – Le magazine de l‟ère nouvelle, L‟Inconnu – Le magazine de l‟actualité mystérieuse et des sciences du futur. De même, l‟ouvrage d‟Élisabeth Teissier, évoqué lors du « Duel sur la Cinq » sur l‟astrologie (10/06/1988), s‟intitule : L‟astrologie, Science du vingt-et-unième siècle. Le développement constant des parasciences est suggéré à travers divers procédés discursifs.
L‟appel à Galilée 153
– utilisation de « encore », « pas encore » : Le mérite et l‟originalité d‟Yves Lignon sont d‟avoir ouvert la voie, ému les esprits, sensibilisé l‟opinion universitaire française, bien qu‟assez timidement encore, ne voulant rien précipiter (M. Curcio, « Parapsychologie sur ordinateur », L‟Inconnu n°18, juin 1977 : 58)
En France, on refuse encore de les admettre officiellement (id. : 58)
– utilisation de « de plus en plus » : L‟opportunité [de la chirologie] en tant qu‟apport indiscutable à la relation d‟aide et à la connaissance de soi devient de plus en plus évidente pour un public curieux et informé (M. Questin, « La Chirologie », Autre monde n°118, juin 1989 : 107)
– adjectifs dénotant la modernité : Outre les dernières découvertes opérées en biologie, en géobiologie, en cosmobiologie, voici que renaît une nouvelle science (R.–L. Mary, « La Cénesthésie ou le reflet visible de la dimension humaine », Le Monde inconnu n°104, avril 1989 : 30)
La rupture ainsi introduite entre un monde ancien et l‟ère nouvelle est liée, pour bon nombre des acteurs du débat sur les parasciences, à l‟avènement de la physique quantique. On se gardera bien de s‟aventurer dans les méandres de la mécanique quantique ; on observera simplement que, de même que l‟évocation de Galilée dans le débat sur les parasciences dépassait de beaucoup les faits historiques, l‟évocation de la physique quantique a bien peu de rapports avec les enseignements techniques de cette théorie. Il semble que presque dès le départ, elle ait donné lieu à de telles extrapolations. L‟un des aspects de la théorie qui a été le plus souvent repris par ses divers commentateurs, et notamment par les parascientifiques, est le principe d‟indétermination d‟Heisenberg, qui remettrait en cause le déterminisme généralement admis en science par l‟indétermination fondamentale des formules de la mécanique des quanta. Le principe d‟indétermination n‟est pas philosophique, mais technique : comme le rappelle Lévy-Leblond,
son noyau dur est une inégalité mathématique selon laquelle une certaine grandeur physique est toujours supérieure à une certaine valeur limitée – la fameuse constante de Planck. (1984a : 18)
Mais le caractère hautement complexe de la théorie quantique n‟a pas empêché les nombreuses extrapolations philosophiques, morales, sociales, de proliférer autour de ce “noyau dur”. Selon Bensaude-Vincent, Langevin lui-même soupçonne que « ceux qui s‟empressent de constater la faillite du déterminisme sont moins motivés par les progrès récents de la physique que
154 Le débat immobile
par une vieille philosophie idéaliste et hostile à la science. » (Bensaude-Vincent, 1985 : 77). Quoi qu‟il en soit, le débat sur les parasciences fait apparaître la physique quantique comme argument en faveur de diverses théories, et de la parapsychologie en particulier. Ainsi, Mario Varvoglis souligne l‟intérêt des développements de la physique quantique pour la recherche psi :
Comme on le voit, l‟interaction entre la physique quantique et la recherche psi pourrait amener de grandes découvertes à propos de la relation entre l‟esprit et la matière. Il est à espérer que dans les prochaines années des physiciens, des neurophysiologues et d‟autres scientifiques porteront une attention de plus en plus grande aux données et aux méthodes de la parapsychologie scientifique, et qu‟ils exploreront les implications humaines du paradoxe EPR et du problème de la mesure en physique quantique. Nous ne pourrions que bénéficier d‟une avancée ouverte et courageuse dans le domaine énigmatique des interactions psycho-physiques. (« Quantons sous la psi ! », Autrement n°82, septembre 1986 : 149).
De même, François Laplantine, dans son ouvrage sur le voyant Georges de Bellerive, prend appui sur la physique quantique pour annoncer une possible explication par la science du phénomène de voyance :
Nous sommes en train de vivre depuis le début du siècle une véritable révolution épistémologique. Notre conception de la causalité linéaire issue de la physique classique a été bouleversée par la théorie de la relativité einsteinienne et la mécanique quantique. […] Nous vivons à vrai dire une époque charnière caractérisée, comme c‟est souvent le cas dans l‟histoire de la science, par la coexistence de deux paradigmes opposés, mais nous sommes toutefois en meilleure position qu‟il y a seulement une quarantaine d‟années pour approcher rationnellement des phénomènes aussi complexes et fuyants que la voyance. (« Voyance, “parapsychologie” et sciences humaines », in François Laplantine (éd.), Un voyant…: 21-67 ; p.40-41).
Ainsi, la physique quantique – plus précisément, une certaine interprétation de ses paradoxes – permet aux partisans des parasciences de construire une dynamique du débat qui situe les parasciences du côté d‟une science “révolutionnaire”, à l‟aube d‟un changement de paradigme, selon la terminologie kuhnienne . Les opposants aux parasciences accusent leurs adversaires d‟invoquer, en les déformant, les propos de scientifiques pour justifier les thèses “para”. Il faut reconnaître que, si extrapolation il y a, elle n‟est pas toujours le fait des partisans des parasciences. En effet, lorsque Costa de Beauregard affirme :
La télépathie n‟est pas irrationnelle non plus, car on peut télégraphier directement dans l‟ailleurs, mais on peut y télégraphier indirectement par un zig-zag de Feynman, en prenant
L‟appel à Galilée 155
un relais soit dans le passé, soit dans le futur (cité par Skrotzky 1989 : 119),
ou lorsque Targ & Puthoff, en 1977, estiment que À notre époque d‟ondes gravitationnelles […] et d‟interconnexion quantique, la charge de la preuve, quand il s‟agit d‟exclure la possibilité de fonctions paranormales, incombe aux sceptiques (cité par James Alcock, Parapsychologie : science ou magie ?, Paris : Flammarion ; p. 178),
leurs propos sont argumentativement orientés en faveur des parasciences, sans qu‟il soit nécessaire aux partisans de ces dernières de les solliciter illégitimement pour les faire pencher en leur faveur ; et c‟est ce qui rend leur évocation particulièrement douloureuse pour les adversaires des parasciences. Finalement, cette dynamique des parasciences, qui fait partie de la schématisation du débat proposée par les partisans des parasciences, vient renforcer l‟appel à Galilée : elle situe le débat sur les parasciences à une charnière de l‟histoire des sciences (de même que l‟héliocentrisme a introduit une rupture dans les paradigmes scientifiques de l‟époque), et identifie le camp des partisans des parasciences au vainqueur que l‟Histoire ne manquera pas de désigner. Mais toute prise de position, de la part du public, pour l‟un ou l‟autre camp, implique une prise de risque : elle relève forcément d‟un saut, d‟un pari sur l‟avenir. Cette “orientation vers l‟avenir” se traduit parfois par l‟explicitation de la nécessaire délégation de la résolution du problème à un avenir plus ou moins lointain. Ce différé de la preuve apparaît en particulier très fréquemment dans les divers articles sur l‟affaire Benveniste. Ainsi, Jacques Benveniste lui-même, réagissant à la polémique soulevée par la théorie de la mémoire de l‟eau, affirme en conclusion :
There is more to come. (Nature n°335, octobre 1988, « Benveniste on the Benveniste affair » : 759)
De même, Pierre Thuillier, interrogé sur la mémoire de l‟eau, tire des enseignements de l‟exemple de Wegener et de la dérive des continents (= S0), et invite à la patience, concluant sur :
Patience : on le saura. (Le Nouvel Observateur, 8-14 juillet 1988 : 26)
Enfin, Maurice Gross, interviewé par le quotidien Libération, conclut lui aussi sur le rôle d‟arbitre du temps :
Et le temps tranchera. (Libération, 29 juillet 1988 : 6).
156 Le débat immobile
2.2. Affirmation de la non scientificité du débat
Un autre motif de l‟appel à Galilée, lié à la dynamique du débat présentée ci-dessus, est l‟affirmation de la non scientificité du débat. Une des raisons fréquemment invoquées par les partisans des parasciences de l‟impossibilité à résoudre le débat est l‟absence d‟objectivité de la part de leurs adversaires, qui rejetteraient les théories parascientifiques non parce qu‟elles ne sont pas scientifiques, mais bien plutôt parce qu‟elles les dérangent, d‟un point de vue éthique, philosophique, ou simplement parce qu‟elles mettent en danger leurs intérêts (carrières, subventions...). Affirmer ainsi que la polémique, de scientifique, est devenue passionnelle ou idéologique, renforce l‟appel à Galilée en multipliant les points communs entre la situation de référence et le débat actuel, puisque Galilée a été condamné non parce que sa théorie était jugée non scientifique, mais parce qu‟elle entrait en conflit avec les Écritures. L‟affirmation de non scientificité du débat est parfois explicite ; c‟est le cas notamment dans les lignes suivantes, où Benveniste accuse ses détracteurs de ne pas respecter les règles de la controverse scientifique, qui imposent que la discussion ait lieu dans le cadre du laboratoire :
L‟opinion publique doit savoir que, parmi les nombreux scientifiques qui crient au déshonneur de la recherche française, pas un seul n‟est venu dans le laboratoire pour commenter scientifiquement ces résultats scientifiques. Cela indique que le débat n‟est pas, n‟a jamais été scientifique. (Science & Vie n°864, 1989 : 60)
De même, le professeur Rémy Chauvin assimile les controverses autour de la parapsychologie à des « guerres de religion », qu‟il invite à contourner en s‟attachant aux applications :
E.P. : Est-ce que vous voyez un avenir à la parapsychologie scientifique ? R.C. : Oui, et je ne vois qu‟une seule orientation du travail : dans les applications. Les controverses continuelles que l‟on connaît dans ce milieu ne servent à rien parce que l‟on ne pourrait jamais forcer quelqu‟un à croire ce qu‟il ne veut pas croire. Toutes les discussions que l‟on peut entendre à ce sujet n‟ont rien de scientifique, ce sont des guerres de religion ! […] On peut contourner ce problème inutile en cherchant directement les applications. (E. Pigani, « Rencontre avec Rémy Chauvin », Le Monde Inconnu n°104, avril 1989 : 36)
Plus souvent encore, la négation du caractère scientifique du débat passe par l‟établissement d‟une isotopie religieuse. Ainsi, Henri-Pierre Aberlenc, dans sa « Lettre ouverte aux rationa-listes », stigmatise les astronomes qui « pensent être qualifiés pour excommunier ce qu‟ils ne connaissent et ne comprennent
L‟appel à Galilée 157
pas vraiment au nom de leur discipline » (Le Monde Inconnu n°106, juin 1989 : 10). Jacques Benveniste, lui, évoque « les réticences, voire l‟agressivité, au nom de la déesse Raison, des adversaires de ce type d‟expérience » (cité dans de Pracontal 1990 : 15). Louis Pauwels & Jacques Bergier, dans Le matin des magiciens, évoquent les conséquences de la physique quantique sur le système de pensée de ceux qu‟ils appellent les « prêtres de Descartes » (cité par Jean-Claude Pecker, Problèmes… : 24). Or, l‟opposition entre le savoir scientifique et la croyance para-scientifique est fondatrice du discours des adversaires des para-sciences. On rencontre donc dans le discours de ces derniers une répartition des rôles parfaitement symétrique à celle qui est proposée par les partisans des parasciences, qui sont, à leur tour, assimilés à des croyants ou à des fanatiques.
2.3. Exploitation pathétique
On a vu qu‟une des composantes fondamentales du “mythe Galilée” est la souffrance infligée au savant pour obtenir sa rétractation. Dans l‟appel à Galilée, cette dimension pathétique est très présente, à travers l‟évocation des risques courus par le Galilée moderne. Si le pathos relève de la rhétorique, on peut aussi rattacher ce motif à une figure proprement argumentative décrite sous le nom d‟argument du sacrifice, argument que Robrieux, suivant Perelman, définit ainsi :
Il vise principalement à rendre crédible une thèse ou une action en arguant d‟un sacrifice qui ne pouvait être consenti sans une conviction et une bonne foi absolues. On met en balance la thèse et le fait du sacrifice, en espérant prouver une équivalence. Pour les Chrétiens, le sacrifice du Christ est à la mesure de la véracité de sa parole. (1993 : 138)
Dans le débat sur les parasciences, les allégations des partisans des parasciences ont d‟autant plus de poids que ceux qui les soutiennent ont tout à y perdre. Le pathos de l‟appel à Galilée s‟organise dans deux directions complémentaires : l‟une consiste à mettre en relief la fragilité de la situation du nouveau Galilée, et l‟autre, à attacher une image de toute-puissance et de cruauté à l‟Institution. Rémy Chauvin est un des acteurs du débat sur les parasciences qui rappelle le plus volontiers les freins imposés par la communauté scientifique à ceux qui touchent au paranormal. Dans un article de L‟Express sur l‟astrologie, il affirme :
Si vous voulez faire carrière au C.N.R.S., n‟étudiez surtout pas l‟astrologie. La haine de la communauté scientifique à l‟égard de cette pratique est digne de l‟Inquisition. (L‟Express, 27 mai - 06 juin 1993 : 90)
158 Le débat immobile
L‟argumentation peut aussi se focaliser sur les adversaires du Galilée moderne, et en souligner le pouvoir et la volonté de nuire. Une façon très simple d‟atteindre cet objectif est d‟expliciter le parallèle avec l‟Inquisition. Ainsi, Walter Stewart, chargé par la revue scientifique Nature de contrôler les protocoles mis en place par Benveniste, est traité de « grand inquisiteur de la science » par Jean Lesieur dans Le Point – le même journaliste évoque aussi la « rafale de coups » provenant d‟une « communauté sans pitié » (1er août 1988 : 55). De même, John Maddox, le directeur de Nature, fait l‟objet dans la presse écrite de portraits qui soulignent son pouvoir dans le monde de la science. Dans Libération, Gilles Pial, après l‟avoir présenté comme le « tout-puissant directeur de l‟hebdomadaire britannique Nature », poursuit :
Ancien journaliste scientifique d‟un grand quotidien britannique, John Maddox règne pour sa part sur les destinées de la première publication scientifique internationale. Il est “le” gardien du temple Nature, lieu de transit obligé de toute grande découverte. (Libération du 29/07/1988 : 4)
La conséquence de ce tableau des adversaires des parasciences, et des risques que prennent les Galilée modernes est l‟ambiance « paranoïde » dont Rabeyron a souligné l‟existence dans les débats sur la parapsychologie (1985 : 247), et qui se retrouve dans l‟affaire Benveniste à un degré encore plus fort, comme en témoignent les images utilisées par Jacques Benveniste lui-même pour qualifier l‟attitude de la communauté scientifique à son égard :
Je sais depuis plusieurs mois que des tueurs à gages veulent ma peau. La mise en vedette de mes résultats, incroyable pour des esprits cartésiens, agace. (Cité dans de Pracontal 1990 : 137)
Notons enfin que l‟exploitation pathétique de l‟appel à Galilée est aussi grandement renforcée par le mépris affiché par les adversaires des parasciences envers les partisans de ces disci-plines, et l‟humilité apparente que ces derniers leur opposent.
2.4. Portrait du Galilée moderne
Enfin, une composante récurrente de la schématisation du débat impliquée par l‟appel à Galilée est le portrait du Galilée moderne. Ce portrait, pour garantir l‟efficacité argumentative de l‟appel à Galilée, doit obéir à deux contraintes. La première est de souligner l‟excellence du personnage : pour être convaincant, le Galilée moderne doit être un représentant de qualité de la communauté scientifique. Mais, pour préférer la vérité à la fidélité envers sa communauté d‟origine, il doit aussi
L‟appel à Galilée 159
être dissident. Les portraits que la presse écrite a tracés de Jacques Benveniste pendant l‟affaire de la “mémoire de l‟eau” sont, à cet égard, exemplaires. Ainsi, Gérard Bonnot, au début d‟un article consacré au sujet, trace de l‟auteur de la nouvelle théorie le portrait suivant :
La dégranulation des basophiles, qu‟on peut mesurer en laboratoire, sur une culture de cellules, constitue un test. Il a été mis au point, en 1975, par le professeur Jacques Benveniste, directeur de l‟unité de recherche de l‟INSERM sur les mécanismes de l‟allergie de l‟hôpital Antoine Béclère, à Clamart. Il est aujourd‟hui universellement reconnu. (Le Nouvel observateur, 8-14 juillet 1988 : 24).
Cette phase de valorisation est suivie par la reconnaissance du côté “enfant terrible” de Benveniste. :
Il a gardé l‟esprit ouvert, il ne déteste pas jouer les francs-tireurs de la science. Avant la médecine, il s‟était passionné pour les voitures de course. À une brillante carrière hospitalo-universitaire il a préféré la recherche. En mai 1968 il était avec les étudiants contre les mandarins. Sa première découverte importante, une molécule dont le rôle se révèle capital dans les manifestations de l‟allergie, il l‟a faite à La Jolla, en Californie. Aujourd‟hui encore, ses travaux sont suivis avec plus d‟attention à l‟étranger qu‟en France. (id. : 25)
Après cette double caractérisation, la voie est libre pour le paral-lèle entre l‟affaire Benveniste et l‟affaire Galilée. Rémy Chauvin est présenté selon ces mêmes axes de l‟excellence et de la marginalité par rapport à l‟Institution :
Rémy Chauvin, professeur émérite à la Sorbonne, s‟est occupé pendant cinquante ans du comportement des animaux sur lesquels il a publié une trentaine d‟ouvrages traduits en onze langues, et environ deux cent cinquante publications spécialisées sur ses insectes sociaux favoris : les abeilles et les fourmis. Mais cet homme de science remarquable a la particularité de coiffer plusieurs casquettes et d‟avancer des opinions qui font frémir les esprits matérialistes : rien de ce qui concerne la parapsychologie ou l‟alchimie ne lui est étranger ! De plus, il affirme, dans ses ouvrages précédents, une position résolument anti-darwinienne maintenant bien connue et que, vu l‟importance du personnage, l‟on ose trop contester. (E. Pigani, « Rencontre avec Rémy Chauvin », Le Monde Inconnu n°104, avril 1989 : 34)
L‟analyse de l‟utilisation du connecteur mais (“c‟est un grand scientifique, mais il n‟est pas sclérosé pour autant”) permet de faire apparaître un des topoi associé au terme scientifique (selon lequel la qualification de “scientifique” permet les inférences “fermeture d‟esprit”, “attachement à l‟Institution”...).1
1 Les portraits de Galilée lui-même obéissent parfois à cette double
caractérisation du savant. Ainsi, Jean-Pierre Maury, après avoir souligné
160 Le débat immobile
Les divers motifs de l‟appel à Galilée ne constituent pas des figures indépendantes, dont chacune aurait sa logique propre, mais étayent tous le jugement d‟analogie entre S0 et S1 sur lequel repose le précédent. On ne s‟étonnera donc pas que certains d‟entre eux soient la cible de contre-argumentations de la part des adversaires des parasciences, qui, en les attaquant, tentent de démolir la schématisation du débat impliquée par l‟appel à Galilée.
3. RÉFUTATIONS DE L’APPEL À GALILÉE
Dès que l‟on s‟intéresse aux réactions provoquées par l‟appel à Galilée, on ne peut manquer d‟être frappé par l‟irritation, voire l‟appréhension, que cette figure semble susciter chez les adver-saires des parasciences. Certains d‟entre eux expriment clairement leur crainte d‟être assimilés aux inquisiteurs liquidateurs de Galilée. Dans l‟affaire de la mémoire de l‟eau, John Maddox, directeur de Nature, affirme avoir accepté la première publication des travaux de Benveniste de peur que celui-ci, justement, ne se fasse passer pour un Galilée moderne, victime d‟une nouvelle Inquisition : l‟Institution scientifique (de Pracontal 1990 : 13-14). De même, en 1986, un rapport au gouvernement sur les médecines douces préconisait de les intégrer au cursus d‟enseignement de la médecine afin d‟éviter « que certains producteurs de thérapies dites “novatrices” ne se fassent passer pour des martyrs » (Groupe de réflexion “Médecines différentes” 1986 : 46). Lorsque de telles tentatives d‟évitement échouent, divers modes de réfutation de l‟appel à Galilée restent à disposition.
3.1. Récuser le jugement d’analogie
La première réfutation possible de l‟appel à Galilée consiste à récuser le jugement d‟analogie sur lequel repose le précédent. C‟est ce que fait, par exemple, Gérald Messadié, rédacteur en chef adjoint de Science & vie, en affirmant :
La science n‟est pas une religion (Science & vie n°852, septembre 1989 : 14)
l‟importance des découvertes attribuées à Galilée, souligne aussi sa spécificité par rapport aux autres savants de son époque :
Galilée n‟est pas un professeur comme les autres. Ce serait déjà étonnant à notre époque de voir un professeur d‟université aller sur un chantier pour observer une machine dont le principe fait partie de son cours. Mais à l‟époque de Galilée, c‟est absolument stupéfiant ! Pour tous ses collègues, le monde du travail, celui des artisans ou des marins, n‟a rien à voir avec celui de l‟université. D‟ailleurs, leurs cours sont seulement des commentaires des ouvrages d‟anciens auteurs, principalement ceux d‟Aristote, qui datent du IVe siècle avant notre ère. (Galilée, le messager des étoiles, Paris : Gallimard ; p. 16)
L‟appel à Galilée 161
ou le physicien et mathématicien André Lichnerowicz, lorsqu‟il souligne :
Ma réaction n‟est pas celle d‟un censeur. (Science & vie n°856, janvier 1990 : 28)
Il s‟agit là de la forme minimale de la réfutation : la pure déné-gation. Le plus souvent, la critique du jugement d‟analogie comporte elle-même une argumentation. La réfutation du précédent s‟appuie sur la mise en évidence de divergences entre S0 et S1, présentées comme irréductibles. Ainsi, Norbert Bensaïd dénonce le retournement de l‟appel à Galilée contre la science elle-même, et refuse que l‟héliocentrisme soit assimilé à ce qu‟il appelle des « vérités révélées » :
On oublie qu‟avec Galilée, c‟était une vérité scientifique, née de l‟observation et de la raison, qui était énoncée ; et qu‟elle n‟avait pas été refusée au nom de la raison mais d‟une vérité religieuse révélée. Aujourd‟hui, au contraire, ce sont presque toujours les tenants des vérités révélées qui se révoltent quand elles sont rejetées au nom de la science – aussitôt déclarée “officielle” – et d‟une raison, forcément “bornée”. (Le Sommeil de la raison. Une mode : les médecines douces, Paris : Seuil, 1988 ; p. 16)
C‟est donc, pour lui, l‟incompatibilité de la nature des pôles attractifs et répulsifs de S0 et de S1 qui bloque le jugement d‟analogie, et, partant, l‟appel à Galilée. C‟est encore au jugement d‟analogie que s‟attaque Robert Joly lorsque, après avoir souligné l‟attrait du rôle de Galilée moderne (voir la citation de Joly reproduite précédemment), il ajoute :
Jouer son petit Galilée est un rôle, certes ambivalent, mais psychologiquement très attractif. Surtout quand, au fond on n‟est pas si persécuté que cela. Le taux d‟antenne des parapsychologues est plantureux et leurs publications, qui rencontrent pour les raisons indiquées plus haut, les goûts douteux d‟un large public, ont une diffusion à laquelle aucune étude sérieuse ne peut prétendre. À la dernière émission consacrée à la para à la R.T.B.F., le persécuté n‟a été ni Rémy Chauvin ni Jean Dierkens : ce fut notre collègue Rasmont, qui était pour ainsi dire le seul, sur huit ou neuf invités (le bel équilibre !) à s‟opposer nettement aux prétentions parapsychologiques, marginalisé par le fait même dans la discussion, et aussi par la morgue farfelue du premier et l‟assurance condescendante du second. (« La Parapsychologie…» : 211-212).
Précisément, ce que Joly dénonce ici, c‟est que, contrairement à Galilée, la position défendue par les partisans des parasciences ne leur fait courir aucun risque, ni même le moindre désagrément. Il en vient à renverser le parallèle, et à faire des adversaires des parasciences (ici, M. Rasmont) les “martyrs”.
162 Le débat immobile
3.2. Dénoncer le caractère pernicieux de l’appel à Galilée
Une autre façon de réfuter l‟appel à Galilée consiste à souligner qu‟il peut conduire à un raisonnement aberrant, selon lequel l‟invraisemblance d‟une théorie deviendrait un argument décisif en faveur de sa validité. Il s‟agit donc de dénoncer l‟appel à Galilée comme paralogisme de l‟affirmation du conséquent (c‟est-à-dire comme paralogisme qui, de l‟affirmation du conséquent, conclut à l‟existence de l‟antécédent). En effet, selon cette logique, « le scepticisme, aux yeux de certains parapsychologues, est le signe que leur doctrine fait partie d‟un nouveau paradigme qui attend sa “révolution kuhnienne” » (James Alcock, Parapsychologie…: 311). C‟est cette dérive de l‟appel à Galilée que dénonce notamment Alain Cuniot, commentant le parallèle avec Galilée établi par Élisabeth Teissier lors du « Duel sur la Cinq » sur l‟astrologie (10/06/1988) :
Mais Galilée ? Qu‟est-ce qu‟ils ont tous avec Galilée ?! Teissier, c‟est Galilée ; Dessuart c‟est Galilée ; Bennett, c‟est Galilée ; Corman, c‟est Galilée. Dernièrement, avec sa prétendue découverte de la « mémoire de l‟eau », le chercheur Benveniste, c‟était Galilée ! Et Burger, c‟est encore Galilée ! Il suffit qu‟un délirant ne soit pas suivi par la communauté scientifique qu‟il implore pour en appeler à Galilée – l‟incompris, le martyr qui avait raison. Mais si Galilée avait raison, ce n‟était pas parce qu‟il était incompris, c‟est parce qu‟il avait raison. Et l‟on peut être parfaitement incompris, non au motif qu‟on soit un temps incompréhensible, mais parce que, tout simplement, on a tort. (Alain Cuniot, Incroyable…: 292)1
3.3. Répondre au précédent par un autre précédent
Enfin, il reste toujours aux adversaires des parasciences la possibilité de répondre au précédent par un autre précédent. Ils opposent alors à l‟appel à Galilée d‟autres événements où, dans l‟histoire des sciences, une théorie nouvelle, à laquelle on avait sur le coup prêté quelque crédit, finit par être rejetée comme erronée. C‟est cette stratégie qu‟adopte Gérald Messadié qui, argumentant également par le précédent (cette fois-ci dans le sens perelmanien du terme, puisque S0 fonctionne comme modèle et non plus comme anti-modèle), oppose à la lecture de la polémique impliquée par l‟appel à Galilée une interprétation exactement symétrique :
1 C‟est ce même paralogisme que dénonce le titre de l‟ouvrage cité, Incroyable
mais faux.
L‟appel à Galilée 163
Le docteur Benveniste a reproché également à Maddox de se livrer à une « chasse aux sorcières », il serait plus juste de dire : à une chasse aux mythes. De Prosper Blondot, infortuné et désormais immortel découvreur des « rayons N », qui n‟avaient jamais existé, et qui firent pourtant l‟objet d‟une communication à l‟Académie des Sciences, à Donald Summerlin, qui truqua ses résultats de phénomènes imaginaires, et c‟est la vigilance de leurs confrères qui a permis de rétablir la vérité. (Science & Vie n°852, septembre 1989 : 13)
Les contre-exemples choisis par Messadié sont particulièrement polémiques : si le cas de Prosper Blondot relève simplement de l‟erreur, le cas de Donald Summerlin relève de la fraude scien-tifique : Messadié se situe ainsi dans le camp de ceux qui, dans la polémique sur la mémoire de l‟eau, ont soupçonné de fraude Benveniste et son équipe. Comme l‟appel à Galilée lui-même, ce mode de réfutation peut viser deux types de conclusions, l‟une forte, l‟autre plus modérée. La première solution vise à substituer la nouvelle grille de lecture, le nouveau cadre argumentatif, à celui impliqué par l‟appel à Galilée, et présuppose donc la fausseté de la théorie discutée. C‟est le cas notamment des propos de Gérald Messadié reproduits ci-dessus, ainsi que l‟atteste l‟application de la dénomination « mythe » à la théorie de la mémoire de l‟eau. Le deuxième type de conclusion vise simplement à mettre en balance la lecture de la polémique suggérée par l‟appel à Galilée et celle suggérée par le ou les contre-exemple(s) ; elle invite l‟auditeur à adopter une attitude prudente et à réserver son jugement. C‟est ce que fait Gérard Bonnot dans l‟exemple suivant :
Ce ne serait pas la première fois dans l‟histoire des sciences qu‟une expérience, réalisée par d‟authentiques chercheurs, a paru ébranler les colonnes du temple. Dans les années cinquante, il y a eu, en France, les canards du professeur Jacques Benoît, dont on avait changé l‟hérédité en leur injectant de l‟ADN d‟une autre race. Dans les années soixante, les greffes de peaux de souris du docteur William Summerlin éliminaient les problèmes de rejet. Chaque fois, on a fini par trouver la faille. C‟est pourquoi la science tient tellement à ses principes. Elle a appris qu‟ils sont en général plus solides que les faits. En général, mais tout de même pas absolument toujours. C‟est parce qu‟Henri Becquerel a cru, contre toute logique, qu‟une plaque photographique, enfermée dans un tiroir, à l‟abri de la lumière, pouvait être impressionnée par un vulgaire caillou, qu‟il a découvert un nouveau domaine de la physique, la radioactivité. C‟est parce que le modèle d‟atome imaginé par Niels Bohr violait délibérément les lois de la mécanique de Newton qu‟on a inventé la mécanique quantique. (Le Nouvel observateur, 8-14 juillet 1988 : 27)
La mise en balance, sans conclusion explicite, d‟exemples allant dans le sens de la condamnation de la mémoire de l‟eau et
164 Le débat immobile
d‟exemples argumentant en sa faveur – et particulièrement, le fait que ce soit sur ces derniers que s‟achève l‟argumentation par le précédent – invite à une attitude de réserve : elle n‟incite pas directement à admettre la validité de la théorie de la mémoire de l‟eau, mais elle évoque les dangers qu‟une attitude de rejet catégorique impliquerait. En ce sens, l‟orientation argumentative de cet extrait rappelle le mécanisme de p mais q tel qu‟il est décrit par Ducrot (1983) : mais introduit une opposition argumentative entre une proposition p, visant une conclusion r, et une proposition q, visant une conclusion non-r, la seconde conclusion étant celle défendue par l‟argumentateur. Dans l‟exemple précédent, p correspond au premier paragraphe, et q au second ; si on applique l‟analyse de Ducrot à cette séquence, c‟est bien la conclusion visée par le second paragraphe que le locuteur défend – c‟est-à-dire les deux conclusions possibles de l‟appel à Galilée. L‟avantage de la réfutation par le précédent est la symétrie argumentative qu‟elle implique. Si le partisan des parasciences a utilisé l‟appel à Galilée, c‟est qu‟il accepte le précédent comme forme d‟argumentation valide ; il est donc obligé de l‟accorder à son adversaire. Mais sa faiblesse réside dans le fait qu‟il n‟existe pas de contre-exemple qui bénéficie de la même notoriété que Galilée : Summerlin ou Blondot sont pour le grand public de parfaits inconnus, et sont donc moins aptes à le convaincre que Galilée, dont le mythe a une prégnance encore considérable. Finalement, les diverses schématisations proposées par les parti-sans des parasciences semblent redoutables par leur cohérence et leur complétude. L‟application de procédés de dissociation à leur propre camp permet de désarmer les critiques de l‟adver-saire, en les rejetant sur ce dont ils se sont dissociés. L‟application de ces mêmes procédés à la communauté scienti-fique permet de contourner le “terrorisme” qu‟exerce la science comme instance de légitimation en distinguant les “bons” scientifiques, ouverts aux parasciences et cités comme autorités, des “mauvais”, dont l‟opinion n‟a pas à être prise en compte. Le terrain est alors prêt pour l‟exploitation de l‟appel à Galilée, qui construit une schématisation du débat d‟une puissance et d‟une cohérence considérables. La place que ménage cette schématisation à l‟auditoire-cible est fort valori-sante, alors que le mépris affiché par les adversaires des para-sciences constitue un grave affront pour les partisans des parasciences et les indécis, qu‟il s‟agit pourtant de convaincre. De plus, l‟appel à Galilée permet de renouer avec une image populaire de la science. L‟activité scientifique moderne relève de ce que Alfonsi appelle la science “lourde” : elle implique un
L‟appel à Galilée 165
travail d‟équipe, de lourds équipements, du matériel coûteux. Or, cette image de la science rompt avec l‟image parfois inquiétante, souvent sympathique, du “savant génial” :
Cette tendance lourde s‟éloigne chaque jour davantage d‟un des mythes fondateurs de l‟activité scientifique : le travail en solitaire, l‟idée fulgurante qui met en rapport ce qui était séparé, prend à revers la “science officielle” d‟une époque, bref, tout ce qui témoigne du triomphe de l‟individu génial sur la pesante institution sclérosée. (Alfonsi 1989 : 146)
L‟appel à Galilée fait resurgir cette vision mythique de la science, et, mettant en scène de nouveaux génies incompris, la met à nouveau à portée du public. Face à ces schématisations puissantes, les adversaires des parasciences n‟ont pas su construire d‟image aussi cohérente de leur propre combat. Ils s‟en tiennent essentiellement à une rhétorique de dénonciation, qui ne peut convertir que les convaincus, et risque d‟indisposer les indécis. C‟est sans doute la raison majeure des difficultés qu‟ils éprouvent dans les débats publics sur les parasciences.
Chapitre 8 :
Discussion des phénomènes
Voilà que les acteurs du débat ont assis leur droit à la parole en manifestant discursivement, à travers divers procédés discursifs, leur compétence ; voilà qu‟ils ont construit un cadre interprétatif au débat, afin de fournir à l‟auditoire le moyen de comprendre les interventions des uns et des autres. On peut maintenant – et seulement maintenant – plonger dans l‟analyse des arguments qui visent à établir l'existence des phénomènes ou l'efficacité des théories. Cette analyse révèle que dès les prémisses “factuelles”, qui devraient servir de point de départ à l‟argumentation, apparaissent des désaccords dont l‟impossible résolution provoque une évolution de l‟objet du débat, qui se perd dans des mises en cause toujours plus abstraites et fondamentales. Dans une polémique, le désaccord structure l‟interaction ; le contrat de communication de la plupart des débats télévisés comporte même une clause de “nécessaire désaccord global”. Les acteurs du débat doivent pourtant définir une plate-forme commune, pour que la discussion puisse avoir lieu sur un terrain un peu plus ferme que les sables mouvants de l‟« interincompréhension généralisée » dont parle Maingueneau (1983b : 23-24). Ils passent ainsi des accords partiels, « nécessités conversationnelles » sans lesquelles l‟interaction ne peut se dérouler (Moeschler 1985 : 171). Ces accords peuvent porter sur deux types d‟objets : les faits, et les critères de preuve. Les “faits”, dans le débat sur les parasciences, sont portés par des énoncés visant le réel que les locuteurs cherchent à soustraire à la discussion en les présentant comme incontes-tables, parce qu‟objectivement établis. Ce statut de “fait” est donc fragile, puisqu‟il suffit que l‟adversaire réussisse à contester l‟incontestable, et à réintégrer le fait dans la polé-mique, pour que, d‟énoncé “vrai” susceptible de tenir lieu de prémisse dans une argumentation, il régresse au statut de conclusion à prouver. De tels glissements s‟observent fréquem-ment, et s‟accompagnent souvent d‟un déplacement de la discussion, des faits vers les critères d‟établissement des faits – ou, plus généralement, vers les critères de preuve. Ceux-ci constituent un deuxième type d‟objets d‟accord, qu‟on pourrait qualifier de “procéduraux”, qui définissent la ou les démarches
168 Le débat immobile
acceptables pour établir les faits. Dans le débat sur les para-sciences, la discussion sur les critères d‟établissement des faits se réduit à l‟alternative entre le recours à des moyens de preuve formels (l‟expérimentation), ou informels (les témoignages). Les objets d‟accord procéduraux définissent plus généralement les schèmes argumentatifs admis par les débatteurs dans la controverse ; on retrouve la problématique des éthiques argu-mentatives esquissée plus haut.
1. LA CHARGE DE LA PREUVE DANS LE DÉBAT SUR LES PARASCIENCES
Le problème de l'identification des objets d'accord (qui permet de déterminer ce qui sera considéré comme acquis et ce qui sera à prouver) s'articule avec l'attribution de la charge de la preuve (qui elle, vise à déterminer qui devra prouver).
1.1. Principes généraux
Grossièrement, on peut formuler la règle qui régit l'attribution de la charge de la preuve comme suit :
Si un locuteur avance une proposition a qui remet en cause une proposition b généralement admise, c'est à lui de faire la preuve de cette proposition a, et non à son adversaire de faire la preuve de b.
Ainsi, si deux adversaires s'affrontent, l'un affirmant que deux et deux font cinq alors l'autre soutient que deux et deux font quatre, c'est le premier qui doit faire la preuve de ce qu'il avance, et non le second. De plus, celui qui avance une proposition improbable doit faire lui-même la preuve de ce qu'il avance, et non mettre son adversaire en demeure de prouver la fausseté de cette proposition (une telle attitude mènerait droit à un sophisme ad ignorantiam). Le devoir de preuve est donc régi par un principe d'inertie. L'attribution de la charge de la preuve ouvre la voie à d‟éven-tuelles négociations visant à décider, de deux propositions, laquelle est la plus plausible. La position de celui à qui le devoir de preuve est attribué est rendue plus vulnérable, puisque, étant mise en discussion, elle ne “va plus de soi”. C'est un paradoxe de l'argumentation, qui vise à renforcer une proposition en l'appuyant par des arguments, mais qui, par le fait même qu'elle cherche à l'appuyer, en souligne la fragilité. S‟il est vrai que celui qui a la charge de la preuve voit sa position fragilisée, on peut s'attendre à ce que, dans un débat, chacun cherche à la rejeter sur l'adversaire, et à présenter comme acquises les propositions qu'il défend.
Discussion des phénomènes 169
1.2. Refus du devoir de preuve par les partisans des parasciences : rhétorique de l’acquis
Les partisans des parasciences mènent une stratégie qui vise à se décharger du devoir de preuve, en présentant l‟existence des phénomènes paranormaux ou l‟efficacité des mancies et méde-cines parallèles comme déjà établie. Un des procédés les plus simples consiste à faire mention de travaux, présentés comme décisifs, établissant les faits “para”. Diverses présentations de la télépathie contiennent des assertions explicitant le caractère acquis de la réalité des phénomènes télé-pathiques. C. Musès, auteur d‟un article intitulé « Le psi, nouvelle dimension des sciences », écrit ainsi :
La télépathie – c'est-à-dire la transmission de désirs ou d'images sans recours aux cinq sens – est désormais un fait bien attesté, déjà établi au début du siècle par des ouvrages comme celui de Tischner, Télépathie et clairvoyance. (cité dans Jean-Claude Pecker, Problèmes… : 43)
De même, Yvonne Castellan, auteur du « Que Sais-Je ? » sur la parapsychologie, écrit :
La télépathie est un fait, prouvé par l'expérience (transmission de pensée expérimentale), et par l'observation (cas spontanés). (La Parapsychologie, Paris : P.U.F., 1985 ; p. 37)
Cette stratégie, qui présente comme acquis ce qui, précisément, est contesté par l‟adversaire, exploite parfois une opposition entre ce qui se passe ailleurs (aux États-Unis ou, à l‟époque, en U.R.S.S.) où la recherche serait extrêmement avancée, et l'état des travaux en France, qui n'en seraient qu'à leurs balbutiements. Ainsi, le docteur Toffaloni, du syndicat des médecins ostéopathes, défend sa discipline : Dr T : on parle d'une profession ou d'une technique non éprouvée non
reconnue (.) non éprouvée c'est faux pour l'ostéopathie parce que tout a été écrit tout a été fait sérieusement aux États-Unis c'est bah vous savez en Europe on a des oeillères
(« Le Glaive et la balance », 1991) Ces assertions présentent une proximité formelle tout à fait remarquable, et se distribuent selon le schéma :
la télépathie la psychokinèse la prémonition ....
est
abondamment désormais bien ...
attestée prouvée établie ...
par des ouvrages comme celui de Tischner aux U.S.A. ...
qui peut se réduire à :
170 Le débat immobile
Nom d‟une parascience
est
adverbe marquant la force ou la rupture temporelle
adj. dénotant le caractère acquis de la parascience
autorité établissant la parascience
Cette structure rappelle certaines constructions du discours de vulgarisation, dont le locuteur n'est pas à même de légitimer lui-même les assertions, mais leur donne du poids en les rattachant explicitement au milieu au sein duquel elles ont été élaborées : un milieu « autorisé », où les faits sont « attestés », « établis », « prouvés par l'expérience » « dans des laboratoires ». La rhétorique de l‟acquis s'accompagne souvent de deux types de procédés de crédibilisation des faits, le premier reposant sur le lieu de la quantité, le second, sur le lieu de la qualité1. Le premier de ces procédés correspond à une opération de banalisation des faits. En effet, en principe du moins, le caractère extraordinaire d'un phénomène oblige celui qui le défend à apporter davantage de preuves que pour un phénomène banal. Aussi rencontre-t-on, chez les partisans des parasciences, diverses figures discursives visant à atténuer le caractère extraordinaire des phénomènes “para”. La façon la plus simple d'atteindre cet objectif est d'invoquer le grand nombre d'expériences dans ce domaine. Ainsi, Yves Lignon, dans le « duel » consacré à la parapsychologie, affirme qu' « il y a dans le monde entier des centaines et des milliers d'expériences qui sont réussies ». Partant, il estime que ce n‟est pas à lui de faire la preuve de ce qu‟il avance, mais à son adversaire de critiquer les dossiers qu‟il évoque : YL : mais de toute façon ceci monsieur Cuniot (.) c'est un faux débat
(.) euh ce n'est pas d'Yves Lignon qu'il faut parler (.) c'est de parapsychologie (.) et des expériences signées Yves Lignon qui sont publiées dans la presse scientifique (.) alors c'est la question que je vous pose (.) ces expériences les contestez-vous oui ou non (.) et si vous les contestez (.) où comment et pourquoi (.)autrement dit dans la mesure où je prétends qu'il existe (.) un dossier expérimental montrant la réalité du phénomène parapsychologique (.) dites-moi à quel endroit je me suis trompé
(« Duel sur la Cinq » du 15/04/1988, la 5)
Le fait de présenter l‟existence des phénomènes comme acquise autorise Lignon à rejeter sur l‟adversaire la charge de la preuve.
1 Pour les notions de lieu de quantité et de qualité, voir Perelman & Olbrechts-
Tyteca 1988 : 115-129.
Discussion des phénomènes 171
Une variante de cette stratégie de banalisation consiste à situer les phénomènes invoqués dans un corps de savoir présenté comme établi et relativement bien décrit. Ainsi, dans un article consacré à Raymond Réant, Franck Sénéquier Crozet affirme :
Les expériences de télépathie – qui sont l'ABC du métier – ne sont pour lui que des expériences de routine (« Les nouveaux miracles de la parapsychologie », Nouveau l'Inconnu 158, août 1989)
Ce type d'argumentation peut présenter l'ancienneté d'une discipline comme argument en faveur de sa validité, puisqu'elle a été éprouvée au cours des siècles par quantité d'individus. Le voyant Boris explicite ce raisonnement, après avoir stigmatisé la recherche européenne qui, en matière de parapsychologie, se laisserait damer le pion par les États-Unis : B : alors moi je veux bien on nous condamne mais je voudrais que
tout le monde se pose une question (.) ceci dit nous existons depuis la nuit des temps(.) le sorcier a existé avant l‟avocat avant le médecin (.) avant le scientifique (.) il existe encore (.) il a maintenant une nouvelle étiquette celui qui est de parapsychologue (.) avec tout ce que l‟on lit actuellement contre la parapsychologie expliquez-moi pourquoi les gens reviennent nous voir (.) bon expliquez-moi ça
(« Ciel Mon Mardi » du 27/11/1990, TF1)
Notons que c‟est également « depuis la nuit des temps » que les voyants arguent de l‟ancienneté de leur discipline pour en affirmer la validité, puisque c‟est ce que fait Quintus dans De la divination de Cicéron :
Moquons nous des haruspices ! Prétendons qu'ils sont sans foi et sans autorité ! Leur science, confirmée par un homme si sage, par l'événement et par la réalité, méprisons-la ! Méprisons aussi Babylone et ceux qui, observant depuis le Caucase les signes célestes, suivent par leurs calculs les mouvements des astres ! Taxons-les, dis-je, de sottise, de fourberie ou d'effronterie, ceux qui renferment dans leurs écrits, comme ils le disent eux-mêmes, une tradition de 470000 ans ! Considérons qu'ils mentent et qu'ils n'ont cure du jugement que porteront sur eux les générations à venir ! Soit ! Les barbares sont sans foi et trompeurs. Mais l'histoire grecque, est-elle également mensongère ? [...] Jamais l'oracle de Delphes n'aurait connu une telle affluence et une telle renommée ni n'aurait bénéficié de présents si riches de tous les peuples et de tous les rois, si toutes les époques n'avaient éprouvé la vérité de ses prophéties. (44-45)
Une autre stratégie, reposant cette fois sur le lieu de la qualité, s‟appuie au contraire sur la rareté du fait pour le crédibiliser. Le fait que, sur un grand nombre de phénomènes, on n'en retienne que quelques uns est présenté comme un argument en faveur de la solidité des phénomènes retenus :
172 Le débat immobile
Rémy Chauvin : dans toute ma longue vie j'ai eu l'occasion de rencontrer trois voyants dont un dont un est d'ailleurs un scientifique de renom (.) trois pas plus en quarante deux ans
(« Star à la barre » du 09/05/1989, France 2)1
De même, Bernard Martino, soutenu par la voyante Maud Kristen, suggère qu‟un phénomène “modeste” est plus crédible qu'un phénomène spectaculaire : BM : première conclusion j'aurais tendance à dire (.) personnellement
(.) que plus c'est gros (.) moins ça a de chances d'être [vrai CD : [donc plus BM : [c'est ce que je dirais aux gens (.) qui auraient tendance à y croire CD : [c'est gros moins c'est bon BM : trop facilement MK : oui moi je suis [d'accord BM : [moins ça a de chance d'être vrai (.) c'est-à-dire
que si c'est (.) euh j'ai entendu des discours fous j'ai entendu des gens qui me disaient qu'ils étaient capables de faire léviter un camion (.) sérieux
MK : ben voyons (« Ciel mon mardi » du 27/11/1990, TF1)
Une telle stratégie n‟est pas sans rappeler les procédés de disso-ciation utilisés par les partisans des parasciences dans l‟élabora-tion de leur schématisation du débat. Une fois encore, le fait de rejeter certains cas de phénomènes supposés paranormaux comme peu dignes de confiance permet d‟une part de manifester un ethos de locuteur objectif, critique, et d‟autre part, d‟accroître proportionnellement le crédit qu‟il convient d‟accorder aux rares cas préservés et qualifiés d‟ “authentiques”.
1.3. Réactions des adversaires des parasciences
Une telle stratégie suscite de multiples réactions parmi les adver-saires des parasciences, qui refusent eux aussi la charge de la preuve, et dénoncent les tentatives pour la renverser. Ces réactions s'accompagnent souvent de l'explicitation des critères d'attribution de la charge de la preuve. Ainsi, Henri Broch, essayant de dégager les caractéristiques des parasciences, mentionne l'« effet schizo » :
C'est, comme je l'ai rappelé, à celui qui affirme d'amener la preuve de la véracité de ses dires [...]. Il faut déclarer sans ambages que la non-impossibilité de quelque chose présentée
1 Les deux stratégies (reposant respectivement sur les lieux de quantité et de
qualité) peuvent être utilisées par un même locuteur. Ainsi, Rémy Chauvin, qui met ici en avant la rareté des phénomènes, affirme, lors de l'émission Mystères du 08/07/1992, à propos des poltergeists : « c'est des histoires très nombreuses (.) je me suis laissé dire que euh (.) il en arrivait toutes les semaines ».
Discussion des phénomènes 173
comme argument en faveur de cette chose est un sophisme qui s'apparente au délire schizophrénique (Le Paranormal…: 199).
Le premier commentaire méta-argumentatif (sur l‟attribution de la charge de la preuve) est doublé d‟un second commentaire de même nature, qui dénonce, chez l‟adversaire, l‟utilisation d‟une forme d‟argumentation jugée non recevable par Henri Broch (mais aussi par la plupart des théoriciens de l‟argumentation) : l‟argumentation par l‟ignorance. Même règle, énoncée cette fois par le magazine Science & Vie, répondant au courrier d'un lecteur qui reproche aux journalistes de rejeter l'astrologie sans prendre la peine d'argumenter :
Serait-ce donc à nous qu'il faut démontrer l'inanité de l'astrologie ? Si nous publiions une information selon laquelle les cochons volent à la pleine lune, ce serait à nous de le démontrer, et non pas à ceux qui ne nous croient pas. Cela étant, nous n'avons pas eu connaissance d'un seul travail d'astrologie méthodique (“scientifique” est un bien grand mot pour la question) qui démontre, soit l'influence du signe, soit celle des planètes. (Science & Vie n°892, janvier 1992 : 10)
La “plausibilité” de la théorie avancée, qui décide de l‟attribution de la charge de la preuve, peut faire l‟objet d‟évaluations contradictoires. Ainsi, les scientifiques Targ & Puthoff affirmaient en 1977 qu'
à notre époque d'ondes gravitationnelles [...] et d'interconnexion quantique, la charge de la preuve, quand il s'agit d'exclure la possibilité de fonctions paranormales, incombe aux sceptiques. (cité dans J. Alcock, Parapsychologie…: 178)
On le voit, l'évaluation du degré d'adhésion préalable de l'auditoire aux thèses discutées est loin d'aller de soi, et peut devenir elle-même objet du débat. Les négociations sur l‟attribution de la charge de la preuve montrent bien qu‟une fois encore, les critères méta-argumentatifs explicités par les acteurs du débat rejoignent largement ceux proposés par les théoriciens de l‟argumentation. Il existe donc bien des règles argumentatives intégrées par les locuteurs, qui peuvent entrer dans des séquences réfutatives au cours d‟interactions argumentées.
1.4. Charge de la preuve dans un débat télévisé
Enfin, il faut rappeler que dans le cadre des débats télévisés, l'attribution de la charge de la preuve est fortement liée à la détermination du premier locuteur : celui qui intervient en premier est identifié à celui qui a une thèse à défendre. On l'a vu, celui qui se voit attribuer la charge de la preuve se trouve d'une certaine façon en position de faiblesse ; il peut
174 Le débat immobile
donc être tenté de l'esquiver. Mais par ailleurs, le fait de prendre la parole en premier dans un débat peut représenter un atout de taille. Interviennent alors des choix stratégiques différents, qui mènent les débatteurs à privilégier l'une ou l'autre solution. Dans le « Duel sur la Cinq » consacré à la voyance, le professeur Galifret refuse l‟offre de Jean-Claude Bourret de parler en premier, considérant cette proposition comme une tentative d'inversion du devoir de preuve : JCB : alors (.) monsieur le professeur Galifret je vous propose (.)
d'ouvrir le duel intellectuel (.) et de nous expliquer quelle est votre position sur la voyance
YG : euh (.) je préférerais que ce soit (.) moi je n'ai rien à prouver (.) c'est celui qui affirme qui a la charge de la preuve (.) [n'est-ce pas
JCB : [alors mons- [monsieur le mage [Dessuart
YG : [(.) moi je (.) [je considère que le roi est nu (.) j'attends qu'on me démontre que le roi n'est pas nu
MD : alors cher professeur je pense que c'est exactement l'inverse (« Duel sur la Cinq » du 22/04/1988, la 5)
En revanche, lors du « Duel sur la Cinq » consacré à l'astrologie, l'astronome Dominique Ballereau accepte le tour de parole que lui offre l'animateur – et accepte du même coup la charge de la preuve : DB : alors je vous remercie d'aill- (.) d'abord de m'avoir invité (.) et
vous venez de dire que je suis contre l'astrologie (.) euh il existe de par le monde la totalité de la communauté astronomique internationale qui est contre (.) la totalité de la communauté scientifique tout court physiciens chimistes et caetera (.) et d'une manière générale tous les gens de bon sens euh n'acceptent pas l'astrologie (.) alors il est évident qu'il faut le prouver (.) il faut dire il faut donner des arguments (.) et je crois ce débat un peu court on va (.) on pourrait par exemple séparer en deux parties (.) d'abord est-ce que l'astrologie a véritablement un fondement scientifique est-ce qu'il existe véritablement une influence astrale comme le disent les astrologues (.) et ensuite j'aimerais beaucoup parler d'un deuxième domaine qui est aussi passionnant (.) c'est celui des prévisions astrologiques sur lesquelles je crois (.) il y a énormément de choses à dire alors qu'est-ce que c'est qu'l'astrologie eh bien il suffit de lire les livres d'astrologie c'est tout simplement l'influence astrale l'influence des astres sur l'individu au moment de sa naissance et qui paraît-il par une sorte de déterminisme absolu euh fixe euh toutes les phases de la vie de l'individu donc de sa naissance à sa mort il est bien évident que c'est une théorie à laquelle peu de gens croient
(« Duel sur la Cinq » du 10/06/1988, la 5)
Il tire ainsi un profit maximum de cet avantage puisque dans sa première intervention, il propose : – une schématisation du débat (en affirmant l‟unanimité de la communauté scientifique : « aucun astronome en France... ») ;
Discussion des phénomènes 175
– une identification des points controversables, et de l‟ordre qu‟il convient d‟adopter (définition de l‟astrologie, problème de l‟influence astrale, critique des prédictions) ; – une définition de l‟astrologie, très orientée argumentativement, et qui permet de poser un cadre dans lequel inscrire la polémique qui soit favorable à l‟astronome. Enfin, le refus de la part des adversaires des parasciences de considérer comme acquis les faits parascientifiques (ou l‟efficacité des techniques) a une conséquence importante sur le déroulement du débat. En effet, les acteurs de la controverse sur les parasciences semblent généralement admettre la procédure argumentative qui veut qu‟on respecte l‟ordre suivant : – établissement des faits ; – explication des faits ; – recherche d‟applications éventuelles. C‟est à cette procédure argumentative que se réfère Yves Galifret lors du « Duel sur la Cinq » consacré à la voyance. Son adversaire, le mage Dessuart, affirme que le phénomène de voyance a été établi depuis longtemps par les voyants eux-mêmes, puis invite le professeur Galifret, en tant que scientifique, à en élaborer une explication. Ce dernier s‟y refuse, arguant du fait que pour lui, rien n‟a été établi : YG : [lisant] et dit Fontenelle (.) tout cela est-il bien vrai (.) assurons-
nous bien du fait (.) avant de nous inquiéter de la cause (.) euh (.) il est vrai que cette méthode est bien lente pour la plupart des gens qui courent naturellement à la cause et passent par dessus la vérité du fait (.) mais (.) enfin (.) évitons le ridicule d‟avoir trouvé la cause de ce qui n‟est point (.) en d‟autres termes [...] avant de d‟expliquer quelque chose il faudrait montrer que ce quelque chose existe (.) or moi je dis [...] il n‟y a rien à démontrer dans la mesure où euh ce phénomène social ne repose sur aucune base scientifique objective
(« Duel sur la Cinq » du 22/04/1988, la 5)
Le passage de la discussion à l‟explication des phénomènes est donc en lui-même un enjeu du débat, et toute tentative de la part d‟un partisan des parasciences de lancer la discussion sur l‟explication constitue une tentative pour se décharger du devoir de preuve.
2. NÉGOCIATION DES PRINCIPES DE RÉSOLUTION DU DÉSACCORD
Les exemples analysés dans les paragraphes précédents font apparaître ce qui pourrait être une caractéristique du débat sur les parasciences : la prolifération des négociations méta-argu-mentatives, portant sur la façon dont le débat peut être mené. À
176 Le débat immobile
partir de désaccords sur l‟attribution de la charge de la preuve, les débatteurs, partant de la discussion de faits particuliers, en viennent à une négociation plus générale sur les critères d‟éta-blissements d‟un fait, négociation qui débouche elle-même bien souvent sur une tentative de définition plus fondamentale encore de ce qu‟il convient d‟entendre par “science”, “démarche” ou “esprit scientifique”. C‟est en tout cas ce que suggère l‟analyse de l‟établissement des phénomènes dans le débat sur les parasciences, analyse qui repose sur la tripartition entre paranormal, mancies et médecines parallèles.
2.1. Le paranormal
Les témoignages L'établissement d'un certain nombre de phénomènes paranormaux dépend presque exclusivement de témoignages : c'est le cas des apparitions d'ovnis, des expériences de décorporation, de communication avec l'au-delà... Il s'agit soit d'expériences inté-rieures, dont seul celui qui les vit pourrait témoigner, soit d'évé-nements qui se produisent spontanément, de façon imprévisible, et qui ne durent pas suffisamment longtemps pour faire l'objet d'une analyse “scientifique”. Les théories de l‟argumentation font dépendre la validité du témoignage de celle du témoin ; et la réfutation la plus naturelle d'un témoignage est une réfutation ad hominem, qui fait dépendre la crédibilité du récit de celle de son auteur. Les contestations les plus fréquentes d‟un témoignage sont : – la mise en cause de l'honnêteté du témoin. Le témoin a volon-tairement menti ou travesti les faits, pour diverses raisons (il voulait se “faire mousser”, il était payé pour ça, son récit contribuait d'une façon ou d'une autre à la réalisation d'un objectif personnel...) ; – la mise en cause de ses capacités de discernement, de façon ponctuelle (le témoin était ivre lorsque le phénomène s'est produit, ou particulièrement ému, ou il désirait fortement que le phénomène se produise) ou de façon permanente (le témoin ne dispose pas de toutes ses capacités intellectuelles, il est particu-lièrement impressionnable, il est myope...). Il s'ensuit que la réfutation d'un témoignage constitue un acte particulièrement menaçant pour le témoin, auquel il risque d‟infliger une blessure narcissique grave. La gravité de la menace dépend du type de réfutation utilisé : si l'adversaire met en avant une faillite momentanée des facultés de discernement du témoin (“il était terriblement bouleversé par la mort de sa mère”),
Discussion des phénomènes 177
l'offense est moins grave que, par exemple, une accusation de malhonnêteté. Or, les témoignages qui nous intéressent ici portent sur des phénomènes “paranormaux”, donc “extra-ordinaires”. Et plus le récit est incroyable, plus il est tentant de mettre en doute la fiabilité du témoin. Évoquant les travaux de Jefferson sur les récits produits par les témoins de détournements d‟avion, Wooffitt souligne l‟effort produit par les locuteurs pour afficher leur “normalité” (1992 : 78). Et si l‟incrédulité qui accueille de tels témoignages est forte (alors que l‟on sait que des événements comme les détournements d‟avion, bien que statistiquement improbables, existent), les récits relatant des phénomènes paranormaux (dont l‟existence même est souvent contestée) risquent de provoquer un rejet encore plus fort. On peut donc s'attendre à ce que les témoins anticipent sur les réfutations éventuelles, et fassent précéder leur témoignage de préambules constituant des figures d'occupations, afin de prévenir toute objection portant sur la personne. Ce travail d‟anticipation prend des formes différentes selon le type d‟accusation qu‟il s‟agit de prévenir. L‟attaque la plus fréquente dirigée contre les témoins de phénomènes paranormaux est une accusation de crédulité : les témoignages comportent donc souvent des dénégations de crédulité. Il existe même un topos des témoignages rendant compte de phénomènes paranormaux, qui consiste à revendiquer un esprit cartésien et à nier tout intérêt préalable pour les phénomènes de ce type. On suppose en effet qu‟une personne adepte des phénomènes paranormaux tend à interpréter tout phénomène bizarre comme, justement, paranormal. En revanche, on suppose qu‟une personne qui ne s'intéresse pas à ce domaine ne pense à ce type d'interprétation qu'après avoir éliminé toute autre explication : l'affirmation de l'existence de tels phénomènes n'en a que plus de poids. Ainsi, Jean-Yves Casgha, racontant l‟histoire du Dr X, témoin d‟une apparition d‟ovni, estime bon de préciser :
JYC : il voit deux lumières un petit peu bizarres qui se fondent l‟une dans l‟autre (.) euh (.) qui prennent la forme de ce qu‟on pourrait appeler un ovni (.) euh (.) lui à l’époque ne s’intéressait pas du tout à ça mais bon il avait quand même entendu parler
(« Ex Libris » du 08/03/1990, TF1)
Dans la même logique, la plupart des témoignages comportent une séquence mettant en scène la lutte du scepticisme contre la croyance, où le locuteur relate les épisodes au cours desquels sa conviction s'est forgée. C'est ce “parcours du combattant de la croyance”, au cours duquel la conviction doit se frayer son chemin, qu'illustre le récit de Corinne, invitée à l'émission « Bas
178 Le débat immobile
les masques » pour raconter comment elle est entrée en communication avec son mari après la mort de celui-ci (le passage est reproduit in extenso, malgré sa longueur, tant il est exemplaire) : MD : vous étiez (.) avant (.) versée vers l'au-delà [vous étiez quelqu'un C : [pas du tout MD : qui vous intéressiez à [ce genre de choses C : [absolument pas (.) euh d'abord j'étais très
cartésienne et j'essaye de le rester le plus possible [...]
MD : et alors comment (.) vous vous êtes retrouvée à entrer en communication avec lui [comment (.) comment s'est fait ce (.) ce
C : [aah MD : cheminement C : alors le cheminement euh d'abord j'ai donc été chez mes parents
(.) parce que j'étais incapable de m'occuper ni de mes enfants ni de moi (.) et j'ai eu entre les mains pareil par coïncidence disons (.) le le premier livre du père François Brune les morts nous parlent alors son titre est significatif (.) euh et dans la bibliographie de ce livre il y avait le livre de Monique Simonet À l'écoute de l'invisible (.) alors j'ai lu ces deux livres (.) qui parlaient euh donc de la communication avec les défunts au moyen d'un magnétophone (.) [moue] alors la première réaction j'me suis dit tout ça c'est d'la foutaise tout ça c'est pour euh (.) pour gagner d'l'argent tout ça c‟est pour euh (.) pour euh comment dire pour toucher les gens qui sont encore plus dans la douleur et qui sont encore (.) plus faciles à atteindre lors de pendant ces moments-là
MD : vous avez quand même tenté l'expérience puis[que C : [oui [ MD : [oui (.) puisque
c'que vous vouliez c'était entrer en communication avec votre mari (.) le retrouver [le rejoindre d'une certaine
C : [le liv- voilà le livre de Monique Simonet paraissait tellement vrai (.) c'était tellement empreint de vérité et de sincérité que bon (.) je m'suis dit s'il y a une possibilité quelque part de pouvoir le r'joindre pourquoi pas
MD : et ça a marché tout de suite (.) [avec le magnétophone ? C : [presque tout de suite MD : ah bon ? C : je suivais mot à mot la méthode prescrite et euh Madame
Monique Simonet préconisait entre 20 heures 23 heures (.) alors moi j'faisais entre 20 heures 23 heures (.) même des fois j'dépassais qu'importe (.) et j'avais rien (.) alors j'me suis dit bien le trente septembre donc à la fin du mois j'vais arrêter (.) parce que tout ça c'est pas vrai bon (.) et le 29 septembre (.) alors euh c'est coïncidence ou pas mais le 29 septembre donc j'enregistrais comme tous les comme tous les soirs (.) je posais toujours euh est-ce si tu es là est-ce que tu peux m'dire un p'tit mot euh bon (.) et là à la ré-écoute j'entends un p'tit murmure (.) alors je réécoute je réécoute (.) et plusieurs fois donc j'entendais toujours ce murmure et à force de réécouter (.) le premier message que j'ai eu de lui a été ma chérie ma chérie je t'aime (.) et un p'tit mot derrière que je n'comprenais pas (.) mais ça m'suffisait toujours pas parce qu'il fallait que j'aille toujours au bout (.) alors j'ai pris
Discussion des phénomènes 179
ma bande magnétique j'ai été dans un studio à Paris je je lui ai simplement dit qu'y avait une voix où je n'entendais pas bien euh (.) et y avait plein de bruits parce que c'est vrai qu'y avait plein de bruits (.) alors il a bien compris l'truc et il a enlevé plein de parasites et il a monté le le son (.) et là y avait plus aucun doute (.) là vraiment (.) alors on entendait bien ma chérie ma chérie je t'aime et le petit mot que je n'comprenais pas c'était je suis là (.) et là c'était sa voix (.) alors là j'ai dit maintenant j'y crois
(« Bas les masques » du 09/03/1993, France 2 C = Corinne, le témoin, MD = Mireille Dumas)
Au cours de cette séquence, le témoin tente de bloquer les infé-rences négatives que les récepteurs seraient susceptibles de tirer de ses propos de diverses manières. Après avoir affirmé son esprit cartésien (sa “normalité” au pays de Descartes), elle affirme avoir lu le livre de François Brune « par coïncidence », afin de bloquer les inférences négatives qui naissent de l‟intérêt préalable du locuteur pour le paranormal. Le hasard qui l‟a conduite à sa première lecture l‟entraîne alors (par la bibliogra-phie) vers d‟autres lectures. La première réaction (interprétation “normale”) est une réaction de rejet ; le discours rapporté met en scène, explicitement, sa propre voix, et implicitement, la voix supposée du destinataire, représentant de la “norme”, du “bon sens”, de la “raison”. Ce premier rejet semble contradictoire avec le fait que, selon les termes de Mireille Dumas, le témoin a « quand même » tenté l‟expérience. X1 invoque alors deux justifications à cette tentative : la douleur liée à la mort de son époux (elle acquiesce à la proposition de Mireille Dumas : « puisque c'que vous vouliez c'était entrer en communication avec votre mari le retrouver »), et la sincérité de l‟auteur du livre (« le livre [...] de Monique Simonet paraissait tellement vrai c'était tellement empreint de vérité et de sincérité »). De plus, le témoin ne dit toujours pas croire à la communication avec l‟au-delà, mais affirme seulement accepter sa possibilité (« pourquoi pas »). Son scepticisme perdure au cours de l‟expérience (« j'vais arrêter parce que tout ça c'est pas vrai »). Lors de la production du phénomène, le témoin souligne encore la normalité de sa réaction (« alors je réécoute je réécoute et plusieurs fois »), et sa dernière résistance (« mais ça m‟suffisait toujours pas ») est vaincue par l‟ultime épreuve, technique, cette fois (studio, appareillage, traitement de la bande...) qu‟elle fait subir au phénomène. Comme dans les témoignages analysés par Wooffitt, c‟est l‟intervention d‟un tiers (l‟employé du studio à Paris) innocent, ignorant tout de l‟histoire, qui vient confirmer le diagnostic qui commençait déjà à se dégager, et qui permet au locuteur de conclure au phénomène paranormal : « et là y avait plus aucun doute », « alors là j'ai dit maintenant j'y crois ».
180 Le débat immobile
L‟analyse de cette séquence montre bien comment l‟hostilité supposée des récepteurs entraîne la multiplication des procédés de crédibilisation chez le locuteur. Ces récits de résistance à la croyance sont également le fait d‟individus ayant produit certains phénomènes dans un cadre expérimental. Dans le cadre de la polémique sur la mémoire de l‟eau, le chercheur Jacques Benveniste évoque son scepticisme premier devant ses découvertes, mais aussi sa soumission aux faits :
Lorsque j‟ai accepté de tester ces différents produits homéopathiques, j’étais très sceptique. Je ne connaissais rien à l‟homéopathie, et ma culture scientifique – je dirais même scientiste – m‟incitait plutôt à penser que l‟homéopathie n‟était qu‟un placebo. D‟où ma grande surprise à la vue des premiers résultats. [...] Que voulez-vous, c‟est comme ça. On n‟y peut rien. C‟est un débat qui va sans doute me dépasser, qui me dépasse peut-être déjà. Mais les faits sont là. (Cité dans Kaufmann 1993 : 74)
Il est impossible de ne pas rapprocher de telles séquences de ce que Favret-Saada dit des récits des ensorcelés du Bocage normand. Elle mentionne notamment l‟apparition fréquente d‟une dénégation inaugurale dans les récits des ensorcelés, sous la forme « je n‟y croyais pas » ou « je n‟en avais jamais entendu parler ». L‟analyse qu‟elle fait de la fonction de telles séquences peut venir compléter celle proposée plus haut. Pour cette ethnographe, la dénégation initiale permet à l‟ensorcelé, qui vit désormais dans la logique des sorts, de préserver la communication avec l‟interlocuteur qui lui, est extérieur à la sorcellerie :
Ce qui se présente comme une dénégation – l‟affirmation qu‟on n‟avait jamais entendu parler des sorts – est avant tout une tentative pour laisser ouverte la possibilité de communiquer avec ceux qui n‟y sont pas pris. C‟est pourquoi tout discours d‟ensorcelé s‟ouvre par la référence obligée à un temps inaugural dans lequel celui qui parle et qui veut faire comprendre comment il y a été “pris” se place, vis-à-vis de la sorcellerie, dans la même position d‟extériorité que son interlocuteur sceptique. Pour éviter que son discours ne soit annulé, sous prétexte qu‟il équivaudrait à un délire, il commence par prendre ses distances à l‟égard de la croyance ; par déclarer que jamais, il n‟aurait pensé tout seul à un sort ; par souligner que d‟ailleurs ce diagnostic, qui lui a été posé par un autre, l‟a totalement surpris, lui qui était jusque-là, – comme vous et moi – incrédule, innocent, non initié. (Favret-Saada 1977 : 60)
Ainsi, le récit de résistance à la croyance aurait une double fonction vis-à-vis du destinataire du discours. D‟une part, il constitue en quelque sorte une figure d‟occupation, anticipant sur une réfutation ad hominem du témoignage arguant de la crédulité
Discussion des phénomènes 181
du témoin. D‟autre part, posant le locuteur au début du récit dans les mêmes dispositions intellectuelles que l‟interlocuteur sceptique, il invite ce dernier à penser que lui aussi pourrait parcourir le même chemin, et passer de l‟incrédulité à l‟intime conviction. Dans les exemples précédents, c'est le témoin lui-même qui anticipe sur une réfutation ad hominem. Mais l‟énoncé visant à crédibiliser le locuteur peut être également “hétéro-initié” ; ainsi, Mireille Dumas, toujours dans la même émission, interroge un invité, témoin d'une apparition d'ovni, sur son éventuelle ivresse, afin d'éliminer un facteur de rejet d'un témoignage : PM : et là j'ai voulu me r'tourner pour voir cette sphère lumineuse
qui XXX sur la banquette arrière (.) et c'est à c'moment-là que la voiture s'est slou- soulevée du sol
MD : mmm vous étiez à jeun ? [riant] PM : [riant]oui à jeun ça c'est [la première chose [d'ailleurs MD : [ben [ben il faut oui (.) il
faut qu'les choses soient dites PM : voilà
(« Bas les masques » du 09/03/1993, France 2)
La revendication d'une certaine crédibilité peut aussi s'appuyer sur le corps de métier auquel le témoin appartient et sur les stéréotypes qui lui sont associés. C'est le cas par exemple dans cette interview d'un officier de police lors de l'émission « Mystères » du 8 juillet 1992 : Animateur : euh dites-moi vous êtes policier depuis euh un certain temps
un policier c'est quelqu'un qui a la tête sur les épaules (.) vous n'avez jamais eu à connaître au cours de votre carrière d'histoire de ce genre ?
Le brigadier Piette : c'était la première fois (« Mystères » du 08/07/1992, TF1)
Le journaliste Jean-Yves Casgha joue le même rôle pour Patrick Poivre d'Arvor que le brigadier Piette pour l‟animateur de « Mystères » : PPDA à Jean-Yves Casgha : alors comme vous êtes journaliste que vous
avez besoin comme nous tous de toucher avant de de raconter (.) eh ben vous êtes allé le voir (.) un un de ces fameux soirs (.) avec votre caméra
(« Ex Libris » du 08/03/1990, TF1)
L‟évaluation des témoignages par les adversaires des parasciences se heurte enfin au fait que, dans les émissions télévisées comme dans les articles de presse, les auteurs de témoignages restent souvent anonymes. Ainsi, dans l‟émission « Ex Libris », Jean-Yves Casgha mentionne le cas d‟un homme qui, depuis qu‟il a été témoin d‟une apparition d‟ovni, voit régulièrement apparaître sur son ventre un triangle rouge. Il justifie ainsi la volonté d‟anonymat de ce dernier :
182 Le débat immobile
JYC : donc il se fait appeler Docteur X parce qu‟il veut surtout conserver l‟anonymat c‟est pas un phénomène de cirque (.) c‟est c‟est aussi mon point de vue
(« Ex Libris » du 08/03/1990, TF1)
Toute légitime qu‟elle puisse être dans certains cas, la volonté de garder l‟anonymat ne fait qu‟aggraver la faiblesse dont souffre déjà le témoignage en tant que tel. En effet, un témoignage n‟est ordinairement reçu comme élément de preuve que faute de mieux, lorsqu‟un accès direct aux faits est impossible. On l‟a vu, il a la crédibilité que l‟on veut bien accorder à son auteur. Or, lorsque celui-ci désire garder l‟anonymat, l‟évaluation du témoignage est encore une fois déplacée, cette fois sur l‟instance énonciative qui le soumet au téléspectateur ou au lecteur, auquel on demande une sorte d‟acte de foi “au carré”. Cette nouvelle instance, qui joue sa légitimité en présentant le témoignage, peut être un journaliste, un spécialiste, un animateur, ou le réalisateur de l‟émission. Même quand toutes les garanties sont réunies pour asseoir la validité du témoignage, on reste bien loin de la rigueur d'un protocole d'expérience scientifique, et les opposants aux para-sciences peuvent tout simplement rejeter l'authentification des phénomènes paranormaux par le recours à des témoignages. C'est ce que faisait déjà Marcus, qui interdisait à Quintus de défendre la divination en s'appuyant sur des témoignages car, disait-il,
Je pense qu'il n'est pas digne d'un philosophe de se servir de témoignages qui peuvent être vrais par hasard, ou de faux fabriqués par la mauvaise foi. C'est par des preuves et des raisonnements qu'il convient de démontrer pourquoi une chose est ce qu'elle est, et non pas à l'aide de faits accidentels, surtout quand j'ai le droit de ne pas y croire. (Cicéron, De la divination… XI, 27 : 112)
Reste alors la possibilité d'établir l'existence de phénomènes paranormaux grâce à des expérimentations.
Les expérimentations
Les partisans des parasciences, répondant aux exigences de leurs adversaires qui réclament des dossiers scientifiques, font alors état d'expérimentations en laboratoire, affirmant qu'elles présentent toutes les garanties de sérieux qu'on puisse souhaiter, et que tant que ces expériences n'ont pas été invalidées, on peut considérer les faits étudiés comme établis. Dans les ouvrages écrits par des opposants aux parasciences (et plus précisément, en France, dans les livres du physicien Henri Broch), on trouve des discussions détaillées de diverses expé-riences, comportant un examen critique du protocole utilisé,
Discussion des phénomènes 183
l'évaluation de fraudes éventuelles, etc. Mais dans le cadre d'émissions télévisées, de telles discussions ne peuvent avoir lieu (du moins tant que les contraintes liées au genre “débat télévisé” ne seront pas modifiées), étant donné le temps limité dont disposent les invités, et le fait que l'émission doit demeurer accessible à un public supposé incapable de suivre une discussion un tant soit peu technique. La polémique autour des expé-rimentations sur les phénomènes paranormaux tourne donc immédiatement à la bataille de références, et le téléspectateur est invité à croire sur parole des affirmations aussi catégoriques que contradictoires, selon le crédit qu‟il accorde aux débatteurs. Le « Duel sur la Cinq » consacré à la parapsychologie opposant Yves Lignon à Alain Cuniot est à cet égard extrêmement riche. Le premier développe une stratégie qui vise à amener Cuniot sur le terrain de la critique technique d'un dossier expérimental, sachant très bien que la situation (et le contrat de parole qu'elle implique) l'interdit, et connaissant aussi l'absence de formation scientifique de son adversaire. À trois reprises, il lui lance des injonctions du type : YL : alors expliquez-moi comment (.) dans le dossier Péchiney (.) on
peut trouver un trucage (.) concernant une certaine barre métallique (.) sur laquelle aucune torsion apparente n'a été remarquée (.) mais (.) sur laquelle on a détecté (.) des modifications de la structure moléculaire (.) le rapport scientifique qui a été publié dans la revue de métallurgie appliquée qui est une revue qu'on ne trouve pas dans les kiosques parce que c'est une revue scientifique (.) le rapport scientifique précise bien (.) que pour obtenir l'équivalent d'un tel phénomène (.) il faudrait placer la barre au coeur d'une centrale nucléaire (.) où est le trucage ?
(« Duel sur la Cinq » du 15/04/1988, la 5)
où il évoque le contenu du dossier, montrant par là qu'il le connaît – et qu'il a la compétence nécessaire pour le comprendre –, sans permettre à quiconque de juger de sa solidité. Chaque fois, Alain Cuniot se dérobe, et ne répond pas au défi de son adversaire. En effet, il est clair qu'un débat télévisé (surtout du type « Duel sur la Cinq », qui ménageait une plage de discussion de moins d‟un quart d‟heure au sein du journal de 13 heures) n'est pas le lieu d'une discussion critique détaillée d'un dossier scientifique ; et que si l'un des débatteurs avance qu'il existe des expérimentations scientifiques réussies, une telle affirmation sera extrêmement difficile à remettre en cause, à moins que son adversaire puisse faire état d'une critique établie par une autorité reconnue dans le domaine concerné, ce qui n'est pas le cas ici. La contre-attaque la plus fréquente chez les adversaires des parasciences est d'invoquer le pari lancé par Broch et Majax sur le 36-15 code ZET, qui offre 500 000 francs à qui fera la
184 Le débat immobile
preuve de pouvoirs paranormaux, selon un protocole d'expéri-mentation fixé par les auteurs du défi1. Ce défi reste toujours valable, le prix n'ayant été remporté par personne, ce qui, pour les “anti-parascientifiques”, est interprété comme la preuve de l'absence d'expérimentation réussie sur les phénomènes para-normaux. Mais cette contre-attaque est à son tour discutée par les partisans des parasciences qui, invoquant une spécificité du fait paranormal (qui met en jeu des facultés psi), réclament des protocoles d'expérimentation qui y soient adaptés 2, et finissent par redéfinir la science elle-même. Ainsi, François Laplantine, dans son travail consacré au voyant Georges de Bellerive, pose les limites des dispositifs d'expéri-mentation appliqués à la voyance :
Les performances du sensitif ne sont pas reproductibles à volonté à n'importe quel moment avec n'importe qui et qui plus est à la demande. Les conditions de rigidité qui sont celles du laboratoire constituent une épreuve dans tous les sens du terme pour le voyant. Rhine l'avait réalisé lui-même : plus les protocoles expérimentaux sont compliqués, monotones, exigent de la lenteur et surtout plus on les répète, plus le sujet perd de l'intérêt pour ce qui lui est demandé, et plus le taux de réussite va en décroissant. L'étude expérimentale de la voyance – comme l'étude expérimentale de la méditation, de la sexualité et de l'amour (cette dernière analogie nous est suggérée par Georges de Bellerive, pour lequel le don de la voyance est un acte d'amour) – en arrive à détruire le phénomène qu'elle se proposait d'étudier, car tester en laboratoire des sujets au cours d'actes sexuels, de méditation zen ou yoga, ou encore de voyance, c'est les conduire immanquablement à sortir de la sexualité, du yoga, du zen ou de la voyance. (« Voyance, “parapsychologie”…» : 45)
Le phénomène de voyance présenterait donc certaines caracté-ristiques (non reproductibilité, dépendance par rapport à l‟atmosphère dans laquelle se déroule l‟expérience), qui le rendraient difficilement testable par les protocoles “classiques”
1 La somme offerte à l‟époque où le corpus a été recueillie était effectivement de
500 000 francs ; elle est aujourd‟hui (novembre 1996) de 1 000 000. 2 Même en dehors du champ du paranormal, certains estiment que les protocoles
scientifiquement admis ne sont pas appropriés à certains objets "aux marges de la science". C'est notamment l'avis de Jacques Benveniste, qui estime que de tels dispositifs risquent de tuer la mémoire de l'eau :
La recherche ne peut pas vivre sans le consensus entre scientifiques de ne pas poser "toutes" les questions, mais seulement celles qui paraissent nécessaires à l'établissement, encore une fois en notre âme et conscience, d'une fragile vérité, qui n'est vraie que hic et nunc. C'est particulièrement le cas de la recherche en biologie, éminemment variable et utilisant un "matériel" précieux, souvent unique. Si l'on impose un prototype monstrueux de l'expérience idéale avec des cascades de contrôles contrôlant les contrôles, on tuera (on a très certainement tué) toute découverte aux marges de la science dont dépend de façon critique ses avancées. (« La Vérité scientifique : faux-vrai passeport pour de vraies frontières », Traverses 47, 1989 : 64.)
Discussion des phénomènes 185
d‟expérimentation. C'est ce que suggère la voyante Maud Kristen au cours d'« Ex Libris » : MK : la voyance c'est pas un système presse-bouton (.) bon ben vous
avez des jours où ça marche et des jours où ça marche pas (« Ex Libris » du 01/10/1990, TF1)
Cette spécificité supposée du phénomène de voyance amène Maud Kristen à refuser de soumettre ses facultés à un test, en invoquant la fragilité des facultés des médiums : MK : le problème c'est d'en trouver les modalités (.) moi je voudrais
quand même répondre à monsieur qui propose un chèque [...] de cinquante briques à qui sera capable de vous prouver des phénomènes paranormaux (.) or vous savez très bien que la voyance est fragile (.) on va pas parler de voyance on va parler d'un truc tout simple (.) j'vais citer monsieur Martino qui en parle dans son livre (.) est-ce que vous avez déjà essayé de faire pipi dans une éprouvette devant cinquante personnes ?
CD : si c'est cinquante mille francs à l'arrivée euh (.) moi j'irais bien essayer
(« Ciel mon mardi » du 27/11/1990, TF1
CD = Christophe Dechavanne)
Ce type de procédé est systématiquement interprété par les adversaires des parasciences comme une stratégie visant à neutraliser toute tentative d'invalidation expérimentale :
Ce qui mérite d‟être souligné est le fait que, généralement, les individus qui sont censés posséder des “pouvoirs” n‟en sont pas les générateurs mais uniquement les “focalisateurs”, les “médiums”. On peut donc dire, en schématisant à peine, que le “paranormal” a une existence propre. Il n‟est pas nécessairement “focalisé” sur un individu mais, lorsque cela est le cas, cet individu devient un “élu”. [...] Imperméable à toute analyse, cette “élection” a pour conséquence que l‟on ne peut blâmer l‟individu lors d‟un échec puisqu‟il n‟est que le médium de ces pouvoirs et non point la source. (H. Broch, Le Paranormal…: 170)
Finalement, la situation des partisans des parasciences n'est pas très confortable. Pour bénéficier de la légitimité attachée à la science officielle, il leur faudrait se soumettre à ses protocoles d'expérimentation ; mais cette exigence se heurte à ce qu‟ils considèrent comme la spécificité de l'objet parascientifique. Une telle double contrainte apparaît de façon assez caractéristique dans la « Lettre ouverte aux rationalistes » de Henri-Pierre Aberlenc :
Un sceptique rétorquera qu'une expérimentation rigoureuse, reproductible, étant très difficile sinon impossible en parapsychologie, les tentatives sérieuses n'auraient jamais rien donné (ce qui est faux). Un phénomène comme la télépathie (pour reprendre notre exemple) ne peut (généralement) pas être produit à volonté par un sujet. C'est une manifestation sporadique, imprévisible. Cela n'enlève rien à sa réalité, même s'il est fort malaisé de la soumettre aux méthodes classiques de la science expérimentale. (Le monde Inconnu n°106, juin 1989 : 9)
186 Le débat immobile
Henri-Pierre Aberlenc argumente ainsi sur le terrain de l‟adver-saire en arguant d‟expérimentations réussies (c‟est du moins l‟inférence qu‟on tire des deux parenthèses « ce qui est faux » et « généralement »), tout en menant une argumentation propre, contestant l‟adéquation de telles expérimentations à l‟objet “para”. L'hypothèse de la spécificité du fait paranormal conduit par ailleurs à admettre que la présence d'un sceptique sur un lieu d'expérimentation peut provoquer l'échec de cette expérimentation, puisqu'elle peut d'une façon ou d'une autre indisposer le sujet psi.1 Pour les adversaires des parasciences, l'exclusion des sceptiques des expériences en parapsychologie est interprétée à nouveau comme une tentative pour se mettre à l'abri de toute réfutation :
On constatera que les observateurs incrédules ne sont jamais les bienvenus dans une expérience de parapsychologie. [...] Seul un croyant peut donc assister aux phénomènes qui confirmeront son acte de foi, toute participation hérétique brouille les ondes qui produisent les manifestations surnaturelles [...]. Les théories affirmant la réalité des phénomènes que vous ne pouvez pas observer sont ainsi, définitivement, mises à l'abri de toute tentative de falsification. (G. Dispaux, La Logique et le quotidien. Une analyse dialogique des mécanismes d‟argumentation, Paris : Minuit, 1984 : 80-81)
Certains partisans des parasciences vont parfois plus loin, poussant leur raisonnement aux frontières de l'absurde. Ainsi, Roger de Lafforest conclut, à propos de l'effet nocebo :
C'est très difficile. C'est pour cela que la première façon de se protéger, comme je dis dans l'un de mes livres, c'est de ne pas croire à tout ça. (Nouveau L‟Inconnu n°157, juillet 1989 : 10-11)
L'idée est reprise en gros titre : « Bizarrement... la meilleure façon de se protéger des maléfices... consiste à ne pas y croire ! » (id. : 10). La formule est étonnamment paradoxale (on ne cherche à se protéger que de choses dont on est convaincu qu'elles existent), mais découle logiquement de l'idée que la présence d'un sceptique risque de “bloquer” l'apparition des phénomènes paranormaux.
1 C‟est sur une argumentation de ce type que s‟appuie Pécuchet répondant à
Bouvard, qui lui propose de mettre l‟hypnose à l‟épreuve en l‟endormant :
« – Eh bien, endors-moi », dit Bouvard. « – Impossible » répliqua Pécuchet, « pour subir l‟action magnétique et pour la transmettre la foi est indispensable ».
Discussion des phénomènes 187
Pour en revenir à la voyance, la spécificité des phénomènes psi fonde la revendication par les voyants d'un droit à l'erreur, mis en avant chaque fois qu'un adversaire leur oppose une voyance erronée. Dans le « Duel sur la Cinq » sur la voyance, Yves Galifret fait le compte-rendu d'une expérience menée avec des astrologues, expérience qui, selon le professeur Galifret, aurait démontré la non validité de l'astrologie. Le mage Dessuart réagit en mettant en avant la fragilité du phénomène de voyance : MD : cher professeur je ne doute pas de ça (.) c'est certain qu'il ne
s'agit pas encore une fois de science exacte c'est pas nous qui allons dire ça (.) et que nous sommes faillibles nous ne sommes que des sujets (.) mais euh l'histoire le démontre assez
(« Duel sur la Cinq » du 22/04/1988, la 5)
La voyante Maud Kristen va même jusqu‟à faire de la recon-naissance de la fragilité de la voyance un signe d‟honnêteté, et s‟insurge contre ses collègues qui affirment ne jamais se tromper. La revendication de ce droit à l'erreur est souvent soutenue par un parallèle avec les sciences “légitimes”, auxquelles ce droit est reconnu. Ainsi, le mage Dessuart, après qu‟Yves Galifret lui ait opposé ses erreurs passées, revendique une indulgence comparable à celle qui est accordée aux scientifiques : MD : alors je vais vous dire (.) des erreurs (.) l'apanage n'en est pas
réservé aux voyants des erreurs les scientifiques en commettent comme tout le monde (.) et je vais vous dire je le revendique ce droit à l'erreur (.) il s'agit d'une science humaine en matière de voyance (.) et non pas d'une science exacte
(« Duel sur la Cinq » du 22/04/1988, la 5)
Ce faisant, il s‟appuie sur l'argument a pari ou règle de justice, qui veut que des cas semblables subissent des traitements analogues. Toute différence de traitement de l'erreur en science et en parasciences est donc dénoncée comme une injustice. De même, Didier Derlich – pour qui, comme pour le mage Dessuart, la voyance est une science humaine au sens où l'erreur est humaine –, se voyant reprocher d'avoir promis à une auditrice qu'on retrouverait son fils disparu vivant (alors qu'on devait découvrir son corps quelques heures plus tard), dénonce une sévérité trop grande envers les voyants : DD : vous dites qu‟il y a des charlatans aussi bien chez les
scientifiques chez tout le monde (.) mais (.) il y a chez les voyants quelque chose chez les médiums par exemple (.) quelque chose qu'on ne nous permet pas (.) c'est surtout (.) c'est surtout le droit à l'erreur (.) on ne nous permet pas l'erreur
(« Star à la barre » du 09/05/1989, France 2)
L'existence de voyances erronées ne constitue alors en rien une remise en cause du phénomène de voyance. C'est ce qu'avance très clairement le Quintus mis en scène par Cicéron :
188 Le débat immobile
Je pense quant à moi que, même si bien des accidents induisent en erreur ceux qu'on voit deviner l'avenir par technique ou par conjecture, il existe cependant une divination. Mais les hommes peuvent, dans cette technique comme dans les autres, se tromper. Il peut arriver qu'un signe douteux ait été pris pour certain ; un élément a pu rester caché, lui-même ou son contraire. Mais il me suffit pour prouver mon propos qu'on trouve non seulement un certain nombre, mais même un assez petit nombre de faits pressentis et prédits par divination. Je dirais même sans hésiter que, si un seul événement a été pressenti et prédit de manière, lorsqu'il arrive, à se réaliser tel qu'il a été annoncé et s'il est clair que rien dans tout cela ne s'est fait par hasard ni fortuitement, la divination existe et tout le monde doit en convenir. (De la divination… LV, 124-125 : 91-92)
La fragilité du phénomène psi peut même permettre d'annuler un mode de réfutation des phénomènes paranormaux souvent utilisé par les adversaires des parasciences, qui consiste à dénoncer les cas de fraudes reconnus, puisque, si l‟on en croit François Laplantine,
Le trucage et la supercherie ne signifient pas nécessairement la négation de la “faculté” que l'on cherche à “tester”. Lorsqu'un individu, et a fortiori un individu particulièrement sensitif, ne ressent pas profondément la confiance du milieu dans lequel il se trouve (ou qu'il ressent une hostilité à son égard), lorsque les expériences auxquelles il est soumis ont un caractère fastidieux, lorsqu'il n'est pas au meilleur de sa forme ce jour-là – ce sont autant de variables qui se prêtent malaisément à l'analyse quantitative mais dont il faut tenir compte dans la compréhension d'un phénomène aussi complexe – il ne fournira pas les résultats que l'on pouvait attendre de lui. Il pourra dans ses conditions être tenté par la fraude et la simulation, car le groupe, souvent avide de sensationnel et pour lequel il ne peut pas se tromper (ou au contraire résolument hostile et pour lequel il doit nécessairement se tromper), l'entraînera à trop en faire. (« Voyance, “parapsychologie”…» : 45)
Voilà de quoi faire sortir de leurs gonds les adversaires des parasciences ! Pour eux, admettre ce point de vue revient à admettre que les parasciences sont uniquement confirmables. Une expérience qui échoue, une voyance erronée peuvent être imputées à la spécificité du fait paranormal ; en revanche, une seule voyance réussie, un seul déplacement d'objet à distance concluant et voilà le paranormal établi. Cette asymétrie entre confirmation et infirmation fonde, pour Flahault, l‟opposition entre le discours scientifique et ce qu'il appelle le « discours de l'Inconnu » :
Il me paraît nécessaire de considérer, en premier lieu, non pas la manière dont s'affirme le collage de chacun de ces deux discours à la réalité, mais la manière dont ce collage se forme avant qu'il ne soit contesté. Ceci est particulièrement important pour ce que j'appellerai le discours de l'Inconnu, par opposition au discours de la science. Si celui-ci, en effet, est en général reçu comme le
Discussion des phénomènes 189
discours incontestable par excellence, c'est que la présence d'une contestation et les moyens d'y répondre sont en jeu dès la production de ce discours, précisément comme l'un des ressorts essentiels de sa production. En revanche, le discours de l'Inconnu ne saurait utiliser systématiquement pour se constituer les moyens de sa propre contestation, pour la bonne raison qu'il ne les a pas en lui-même : il ne dispose que des moyens de se confirmer, et ce sont toujours les autres, ceux qui sont à l'extérieur de lui, qui usent à son encontre des moyens de l'infirmer. (1978 : 219)
Cette irréfutabilité du paranormal, liée à une définition des pouvoirs psi, relève peut-être aussi plus généralement des asser-tions seulement confirmables décrites par Kapferer au sujet des rumeurs (1990 : 284). Dans le cas des phénomènes paranormaux, s‟il est possible de montrer qu‟un cas précis, précédemment considéré comme une manifestation d‟un pouvoir “psi”, n‟est finalement pas probant, il est impossible de prouver par l‟expérience une proposition universelle de type : “les phéno-mènes paranormaux n‟existent pas”.
Rationalisation du phénomène Enfin, il faut mentionner une stratégie que les adversaires du paranormal utilisent parfois, quels que soient les arguments avancés par leurs interlocuteurs pour asseoir la factualité de leurs énoncés. Elle consiste à reconnaître l‟existence des faits observés, mais à en proposer des explications non paranormales, dans le cadre de théories établies, ce qui revient à nier toute spécificité au phénomène, et à lui refuser toute valeur de preuve en faveur du paranormal. C‟est cette stratégie qui est à l‟oeuvre chaque fois qu‟un adversaire des parasciences tente de reproduire par des voies non paranormales un phénomène prétendument paranormal, et argue du fait qu‟on peut le produire ainsi pour conclure qu‟il a effectivement été produit sans faire appel à un quelconque pouvoir psi. Le magicien américain James Randi ou l‟illusionniste français Gérard Majax s‟emploient à reproduire publiquement les performances de “sujets psi” au moyen de “trucs”, cherchant ainsi à jeter le discrédit sur les pouvoirs que ces sujets prétendent posséder. C‟est aussi la stratégie adoptée par le physicien Henri Broch. Au cours de l‟émission « Nulle part ailleurs », il s‟emploie à démontrer comment il est possible d‟arriver aux mêmes résultats que des parapsychologues, sans faire appel à aucun pouvoir paranormal. Après qu‟une collaboratrice de l‟émission, suivant ses directives, ait reproduit le “miracle” de la liquéfaction du sang de Saint Janvier, il énonce lui-même la règle sur laquelle il s‟appuie pour démontrer l‟inanité des parasciences :
190 Le débat immobile
HB : donc à partir du moment où on peut on peut disons (.) par une méthode ou une autre reproduire le miracle (.) alors nul n‟est en droit de dire (.) que c‟est un miracle
(« Nulle part ailleurs » du 30/09/1993, Canal +)
Une telle argumentation n‟est pas décisive, le fait qu‟on puisse produire un effet par un moyen ordinaire n‟excluant nullement qu‟on puisse l‟obtenir également par d‟autres moyens (même si un principe d‟économie veut que l‟on préfère les explications les plus triviales aux interprétations “para”). D‟autres éléments de preuves apportent parfois un poids supplémentaire à une telle argumentation ; c‟est le cas par exemple si l‟on arrive à démontrer que le sujet en question disposait du savoir ou de la technique permettant de produire le phénomène par le biais de l‟illusion. C‟est l‟argument qu‟avancent tour à tour Henri Broch et Alain Cuniot, qui rappellent le passé d‟illusionniste de Uri Geller afin de jeter le doute sur ses performances paranormales. Une autre version de cette même stratégie consiste à réduire le phénomène discuté à un phénomène naturel déjà décrit dans le cadre de la science existante. Ainsi, Alain Cuniot, dans le « Duel sur la Cinq » consacré à la parapsychologie, réduit l‟affaire de la maison de Vailhauquès à un phénomène géologique dont il souligne la banalité : AC : et à la fin du compte une équipe (.) de géologues (.) qui a été
jusqu‟au bout (.) d‟une étude (.) scientifique (.) rationnelle (.) pour euh expliquer quel était le phénomène des coups (.) en a conclu (.) qu‟il s‟agissait d‟un phénomène géologique [...] cela provenait (.) d‟un phénomène que l‟on connaît bien en matière de géologie par rapport (.) à des sources (.) de de niveaux différents (.) de coups de bélier (.) cela se produit (.) euh (.) par rapport (.) à (.) de constitution d‟ensembles calcaires avec euh (.) je vais passer les détails techniques mais en tous les cas (.) ce qui est très intéressant (.) c‟est que Jean-Claude Gilly (.) étant dans le puits (.) a réétabli le phénomène [...] Jean-Claude Gilly qui a étudié le problème avec son équipe et qui en a tiré les conclusions (.) euh (.) a (.) euh reproduit (.) géologiquement (.) les fameux phénomènes (.) qui étaient du point de vue d‟Yves Lignon (.) produits par un phénomène de psychokinèse
(« Duel sur la Cinq » du 15/04/1988, la 5)
Mais, de même que, précédemment, la possibilité de tricherie n‟impliquait pas la mise en oeuvre effective de trucs d‟illu-sionniste, ici encore, les partisans des parasciences affirment que les deux hypothèses (rationnelle et paranormale) peuvent coexister. Ainsi, Yves Lignon contre l‟offensive d‟Alain Cuniot en mentionnant l‟existence d‟un communiqué de presse rédigé avec Jean-Claude Gilly « précisant que l‟hypothèse géologique n‟excluait pas l‟hypothèse parapsychologique ».
Discussion des phénomènes 191
2.2. Les mancies
Alors que le débat sur le paranormal tourne avant tout autour de la question de l‟existence de phénomènes “para”, les mancies reposent sur l'affirmation de leur efficacité ; la proposition “ça marche” est donc le centre de la controverse sur leur validité.
Versant caractérologique Comme pour le paranormal, les adversaires des mancies cherchent parfois une explication rationnelle aux mancies, sans entreprendre l‟évaluation de la “mancie” elle-même. Cette stratégie, appliquée au versant caractérologique des mancies, revient à affirmer que si celui qui pratique la “mancie” a vu juste, c‟est qu‟il est simplement excellent psychologue, très habile à conseiller, à rassurer, à consoler ses clients, et à satisfaire ainsi pleinement la demande du consultant sans faire intervenir autre chose qu‟un bon sens du contact et une envie d‟aider. Par ailleurs, Aphek & Tobin montrent que les astrologues utilisent des formes linguistiques générales, polyvalentes, que le client lui-même a la charge de compléter en fonction de son expérience personnelle :
By presenting the client with persuasive and omniscopus, multi-proposeful, non specific, non-precise language exhaustive possibilities to choose from, as well as qualified statements, utterances containing frame words, omnibus words and umbrella terms, a scale of relativity as well as general truths, the fortune-teller supplies general contexts and broad content slots by varied linguistic means which permit the client to supply the specific content information form his own mind. (1989 : 31).
Un tel mécanisme conduit les auteurs à considérer la consulta-tion astrologique comme un exemple de communication symbiotique, où le client est à la fois la source et le destinataire du message, puisqu‟il cherche une réponse à une question, mais en fournit lui-même les principaux éléments. Les astrologues répondent généralement à une telle analyse en faisant état de cas où même un bon psychologue n‟aurait pas pu aboutir aux mêmes conclusions. C‟est le rôle, notamment, des études statis-tiques, qui cherchent à établir des corrélations entre certains signes du zodiaque et certaines prédispositions récurrentes. De telles études sont régulièrement invoquées dans le débat sur l‟astrologie, aussi bien par les partisans de cette discipline que par ses adversaires. Mais si le recours aux statistiques paraît un moyen relativement rigoureux d‟objectiver la validité ou non du versant caractérologique de certaines mancies, il n‟en est pas incontestable pour autant, le maniement des statistiques étant réputé délicat ; aussi est-il souvent critiqué, et rejeté comme un
192 Le débat immobile
moyen de preuve peu fiable. Une fois de plus, il apparaît que la contestation d‟un moyen de preuve formel (ici, les statistiques) peut difficilement se faire dans le cadre d‟un débat télévisé, ce qui tend à le soustraire à la discussion. Le rejet des statistiques comme moyen d‟établir la validité ou la non validité de l‟astrologie peut aussi être le fait des partisans de l‟astrologie, comme on le voit dans un article de Solange de Mailly-Nesle :
À mon sens, le vrai rôle de l'astrologue n'est pas de prédire de façon précise, mais de prévoir la qualité des événements possibles auxquels l'être peut être relié. De ce fait, on comprendra aisément pourquoi les statistiques ne sauraient rendre compte de l'astrologie. Le protocole d'accord de n'importe quelle étude statistique repose sur le principe de reproductibilité et parcellise l'objet qu'elle étudie pour mieux le classifier. Or en astrologie, “l'effet symbole”, étant donné qu'il exprime globalement différents plans de l'être, ne saurait reproduire exactement le même effet tel que l'entend la science. Le symbole trouve d'abord ses racines dans l'intériorité de l'être tout en se reflétant à l'extérieur. L'autre raison pour laquelle il me semble difficile d'utiliser la méthode statistique pour vérifier ou prouver l'efficacité de l'astrologie est qu'un thème forme un tout dont chaque partie est interdépendante. Et vouloir prouver la raison d'être de ce tout en n'analysant qu'une seule de ses parties, c'est réduire le tout à sa partie, c'est fausser le jeu. (« Astrologie / science : chiens de faïence », Autrement 82, septembre 1986, 41-45 ; p.44).
Le raisonnement développé ici est très proche de celui tenu par les partisans du paranormal, qui invoquent la spécificité du phénomène paranormal pour refuser de le soumettre aux proto-coles “classiques” d'expérimentation en laboratoire. Ici, c'est la spécificité de l'astrologie qui la soustrait aux modalités de vali-dation statistique.
Versant prédictif Le plus souvent, c'est sur la composante prédictive des mancies que la polémique se concentre. Elle permet en effet l‟applica-tion immédiate d‟un critère de scientificité classiquement admis, qui fait dépendre la validité d‟une théorie de sa capacité de prédiction. 1
→ Invocation par les adversaires des parasciences de prédictions erronées Dans le « Duel sur la Cinq » consacré à l'astrologie, Dominique Ballereau recense les prédictions erronées contenues dans
1 On retrouve la même organisation de l'argumentation pour la voyance qui, bien
que relevant du paranormal dans la mesure où elle repose essentiellement sur l'existence de pouvoirs "psi", permet aussi de prévoir l'avenir, et peut donc être évaluée selon les mêmes critères.
Discussion des phénomènes 193
l'ouvrage d‟Élisabeth Teissier, et leur oppose ce qui s'est réelle-ment passé : DB : j'ai l'honneur de vous dire que Simone Veil (.) eh bien (.) aurait
dû être élue présidente des Français dans l'hypothèse astralement plausible d'élections présidentielles anticipées (.) bon (.) en tren- en soix- en quatre-vingt-six (.) il n'y avait pas (.) d'élections (.) euh euh présidentielles
(« Duel sur la Cinq » du 10/06/1988, la 5)
Plus le contraste entre l'événement prévu et la réalité est fort, plus l'argumentation est efficace. Ainsi, Yves Galifret, plongeant dans l'histoire contemporaine : YG : une astrologue Françoise Robin (.) en 67 (.) prévoit (.) et elle est
assez célèbre (.) je ne vois aucun mouvement revendicatif important en 1968 (.) 1968 [riant] vous savez ce que c'était
(« Duel sur la Cinq » du 22/04/1988, la 5)
De telles séquences reposent sur l'utilisation polémique du discours rapporté. C'est de la mise en vis-à-vis de propos que l'adversaire ne peut renier (puisqu'il les a consignés dans un livre) et d'un discours pris en charge par le locuteur que naît l'orientation argumentative de la séquence. Aucune marque explicite de mise à distance n‟est nécessaire pour repérer ce type d‟altérité discursive, puisque
Ce qui rompt la continuité du Même, c'est le corps verbal de l'Autre, son mode d‟incorporation ; placé en conflit avec le corps citant qui l'enveloppe, l'élément cité s'expulse de lui-même du seul fait qu'il se soutient d'un univers sémantique incompatible avec celui de l'énonciation qui l'enferme. (Maingueneau 1984 : 121)
→ Discussion de la paternité de la prédiction On l‟a vu, la critique des prédictions par l‟adversaire des mancies implique que celui-ci rapporte, justement, les prédictions incriminées, afin de pouvoir les discuter. Il arrive que l‟auteur des prédictions refuse simplement de les reconnaître comme siennes ; c‟est le cas lors de l‟émission « Durand la nuit » du 11/05/1993, où le voyant Mario de Sabato, opposé au parapsychologue Yves Lignon (qui, durant toute une partie de l‟émission, fait figure de sceptique), nie avoir jamais prédit une apocalypse nucléaire : GD : alors qu‟est-ce qu‟il a annoncé comme apocalypse extraordinaire
[qui YL : [ben des apocalypses nucléaires de [ci de là MdS : [non non non [non non YL : [mais si ben
vous le savez MdS : ah non nucléaire jamais [ça c‟est faux YL : [jamais XXXX MdS : [je n‟ai non non non non non GD : [pas nucléaire une petite pas nucléaire
194 Le débat immobile
YL : des apocalypses tout court MdS : vous savez je vais vous dire (.) c‟est c‟est tout à fait simple (.) euh
non je j‟ai au contraire écrit que jamais il n‟y aurait de guerre nucléaire (.) [mais non (.) ça vous n‟avez pas dû bien lire
YL : [ah bon (« Durand la nuit » du 11/05/1993, TF1
GD = Guillaume Durand)
Dans de tels cas, deux paroles s‟affrontent, et à moins d‟avoir prévu la dispute et d‟avoir apporté un élément de preuve sur le plateau, il est difficile de faire triompher son point de vue autrement qu‟en mettant en avant sa bonne foi. Enfin, les attaques menées par les adversaires des mancies peuvent à leur tour être mises en cause par leur interlocuteur.
→ Réaction : négation du caractère erroné de la prédiction et réinterprétation de la prédiction
Une première réaction, pour le partisan des mancies qui se voit opposer des prédictions erronées, est d'affirmer que, précisément, ces prédictions ne sont pas erronées, contrairement à ce qu'affirme l'adversaire. Au cours du « Duel sur la Cinq » consacré à l'astrologie, Élisabeth Teissier esquive l'attaque menée par l'astronome Dominique Ballereau en arguant de l'existence de différents “plans” où peuvent se développer les événements prédits : DB : j'ai l'honneur de vous dire que Simone Veil (.) eh bien (.) aurait dû
être élue présidente des Français dans l'hypothèse astralement plausible d'élections présidentielles anti[cipées (.) bon (.) en trent-
ET : [bon (.) ben parce que je (.) DB : [en soix- en quatre-vingt-six (.) il n'y avait pas ET : [parce qu'elle avait un très bon thème elle l'a peut-être vécu sur
un plan personnel (« Duel sur la Cinq » du 10/06/1988, la 5)
La même stratégie d'esquive est développée plus explicitement encore au cours d'un « Ex Libris », où l'animateur lui oppose quelques prédictions peu probantes à propos de François Mitterrand : PPDA : ouais vous avez dit aussi dans Télé 7 Jours je l'avais lu que (.) y
aurait une période de déséquilibre pour François Mitterrand à Noël dernier bon (.) on n'a rien vu venir (.) vous recommencez d'ailleurs pour parce que vous êtes bon vous y croyez (.) euh en mai-juin prochain vous pensez qu'il va lui arriver des choses
ET : bon ben c'est-à-dire que c'est pas moi qui recommence ce sont les planètes qui reviennent au même endroit (.) [et et vous savez
PPDA : [mais cela dit il ET : [oui vous savez c'qui s'passe avec l'astrologie aussi c'est que PPDA : [s'passe rien quand même ET : euh (.) on ne sait pas toujours vous savez l'astrologie est un
miroir de l'être dans sa profondeur dans son authenticité dans
Discussion des phénomènes 195
son mystère (.) dans son intimité (.) alors quand on quand on dit quelque chose sur un homme politique (.) euh tout ne va pas dans la presse la presse sait beaucoup de choses mais (.) tout n'a c'est comme l'histoire de l'iceberg on ne voit que le dixième de ce qui affleure
(« Ex Libris » du 08/03/1990, TF1)
Que de telles réactions à la mise en cause de prédictions soient menées de bonne foi ou non, le résultat est qu‟elles les placent, momentanément du moins, à l‟abri de toute réfutation.
→ Réaction : revendication d'un droit à l'erreur Une autre défense possible devant l'invocation par l'adversaire de prédictions erronées consiste, comme pour le paranormal, à revendiquer un droit à l'erreur. Cette revendication ne repose plus cette fois-ci sur l'affirmation de la spécificité du fait paranormal, puisque les mancies n'impliquent pas nécessairement l'existence de facultés psi, mais uniquement sur l'appel à la règle de justice : comme les médecins, les scientifiques, les juges, les astrologues ont le droit de se tromper. Ainsi, Élisabeth Teissier défend le droit à l'erreur des astrologues, et dénonce les différences de traitement entre astrologues et scientifiques en égratignant au passage les voyants : PPDA [à propos des astrologues qui se trompent] : il faudrait les pendre
sur la place publique ET : non non c'est pas pourquoi écoutez s'il fallait pendre tous les
avocats euh véreux les médecins qui se trompent (.) les [météorologues qui se trompent tout toutes ces pseudo- ces PPDA : [tous les charlatans ET : sciences qu'on dite qu'on dit absolument comment dirais-je (.)
inattaquables et qui le sont uniquement parce qu'elles font partie si vous voulez d'un consensus culturel qui dans lequel elles sont complètement acceptées c'est la science officielle (.) mais euh on ne pardonne pas grand chose aux astrologues qui se trompent (.) mais moi je je je
PPDA : oh y en a quand même qui racontent de de vrais bobards hein [moi j'en ai vu quelques uns (.) où vraiment on s'aperçoit qu'ils
ET : [oui mais alors là PPDA : [font ET : [oui mais peut-être plus les voyants (.) peut-être plus les voyants
(« Ex Libris » du 08/03/1990, TF1)
L‟appel à la règle de justice qui sous-tend cette réfutation se transforme parfois plus spécifiquement en argumentation tu quoque. Ainsi le mage Dessuart oppose à une étude statistique montrant l‟inanité de l‟astrologie, qu‟il interprète comme l‟erreur ponctuelle des astrologues participant à l‟étude, une erreur scientifique : MD : bon alors des publications vous en avez chez les scientifiques je
vais vous en citer une il y a un siècle de ça un de vos collègues de l‟époque (.) avait découvert et émis la loi sur l‟éther la
196 Le débat immobile
propagation de la lumière par l‟éther à travers l‟espace (.) à partir de ça on avait expliqué je crois près de deux ou trois cents lois (.) qui devaient expliquer presque tout l‟univers (.) pour s‟apercevoir quelque temps après que c‟était une ineptie que cette fameuse loi de l‟éther (.) ne reposait sur rien
(« Duel sur la Cinq » du 22/05/1988, la 5)
→ Réaction : invocation de prédictions réussies Les partisans des mancies peuvent aussi réagir en développant non pas une stratégie défensive visant à neutraliser l'attaque de l'adversaire, mais une contre-attaque, consistant à lui opposer la même forme argumentative orientée vers une conclusion inverse. Les partisans des parasciences opposent alors à leur adversaire des cas de prédictions réussies. Ainsi, dans le duel qui oppose Yves Galifret au mage Dessuart, ce dernier répond à l'énumération de prédictions astrologiques erronées par l'énumération de voyances réussies, empruntées à des événements marquants de l'histoire, grande ou petite : prédiction de l'exil de Napoléon à Sainte Hélène, prédiction de l'invasion de l'Europe par des S.S., prédiction du naufrage du Titanic (voir plus loin, “rationalisation du phénomène, 2 : coïncidence).
→ Autres réfutations Enfin, il est intéressant de noter que certaines argumentations, utilisées à un moment dans l'histoire, sont tombées aujourd'hui en désuétude, pour des raisons plus ou moins claires. Dans le cas de De la divination de Cicéron, les motifs d'abandon de l'argumentation suivante, très marquée par les options philoso-phiques et religieuses du moment, sont assez clairs, et apparaissent nettement dans le discours de Quintus qui, pour soutenir la valeur des pratiques divinatoires, reprend le raisonnement des stoïciens :
L'existence de la divination est prouvée par les stoïciens de la manière suivante : “Si les dieux existent et qu'ils ne fassent pas connaître à l'avance l'avenir aux hommes, soit ils n'aiment pas l'humanité, soit ils ignorent l'avenir, soit ils estiment qu'il ne sert à rien aux hommes d'en être instruits, soit ils considèrent qu'il est indigne de leur majesté de le leur faire connaître, soit, enfin, les dieux eux-mêmes sont incapables de l'annoncer. Or il n'est pas vrai que les dieux ne nous aiment pas (car ils sont bienfaiteurs et amis du genre humain). Ils n'ignorent pas ce qu'ils ont eux-mêmes établi et ordonné. Il est également inexact qu'il ne nous importe pas de connaître l'avenir (car nous serons plus prudents si nous le connaissons). Ils ne considèrent pas non plus cette annonce comme indigne de leur majesté (rien, en effet, n'est supérieur à la bienfaisance). Enfin, il est impossible qu'ils soient incapables de connaître par avance l'avenir. Il n'y a donc pas de dieux sans qu'ils nous l'indiquent ; or il y a des dieux ; donc ils nous l'indiquent. Et s'ils indiquent l'avenir, ils ne sont pas sans nous donner des moyens pour comprendre leurs signes (sinon ils nous
Discussion des phénomènes 197
les enverraient en vain) ; et s'ils nous offrent les moyens, il est impossible que la divination n'existe pas. Par conséquent, la divination existe.” (De la divination…, XXXVIII, 82-83 : 69).
Marcus, lui, s'exerce à réfuter un tel raisonnement : Ainsi, de quelque côté que les stoïciens se tournent, toute leur argutie tombe nécessairement par terre. En effet, si l'avenir peut se produire de telle ou telle manière, la fortune est souveraine ; mais ce qui dépend de la fortune ne peut pas être certain. Et si chaque événement et le moment auquel il doit se produire sont déterminés d'avance, quel service les haruspices peuvent-ils me rendre ? (id. IX 24 : 110)
De même, Jean Calvin, dans son Avertissement contre l‟astrolo-gie, après avoir discuté la validité des prédictions des astrologues, affirme :
Toutes les divinations qui ont été faites n‟ont pas été fondées en raison ni en science. Ils [les astrologues] répliqueront que néanmoins on en voit la vérité par l‟issue. Je réponds que cela ne sert de rien pour approuver que ce soit un art licite. Or, nous sommes sur ce point là seulement, que c‟est une curiosité mauvaise et réprouvée de Dieu, et non pas si les devins adressent quelquefois à dire vérité ou non. Vrai est que tout ce qui vient du diable n‟est que mensonge. (Avertissement…: 29)
Même si, aujourd‟hui, l‟église (catholique, cette fois) condamne l‟astrologie, la contestation chrétienne des “diseurs d‟avenir” ne s‟exprime guère dans le cadre de débats télévisés.
→ Rationalisation du phénomène Le mode de réfutation des parasciences par rationalisation est assez développé pour les mancies. Il peut prendre trois formes : le diagnostic de prophétie auto-réalisatrice, l‟interprétation de la prédiction réussie en termes de coïncidence, et la critique des termes employés. 1. Les prédictions auto-réalisatrices Afin de ramener les prédictions avérées à des phénomènes explicables dans le cadre des connaissances admises, les adver-saires des mancies invitent à les considérer comme des self-fulfilling prophecies, ou « prophéties auto-réalisatrices », selon la traduction proposée par Bougnoux (1991 : 195). La notion de prophétie auto-réalisatrice rend compte des cas où l‟énoncé d‟une prédiction entraîne la réalisation de l‟événement ou de la situation prédite. Ce phénomène est d‟autant plus plausible que la croyance à la mancie est forte. Ainsi, Fernand Hallyn mentionne l‟anecdote suivante, selon laquelle la foi du Duc de Wallenstein envers Kepler aurait causé sa mort :
Le deuxième horoscope que fit Kepler en 1624 pour le duc de Wallenstein prévoyait pour mars 1634 des troubles dans le pays
198 Le débat immobile
qui devaient affecter le duc personnellement ; il fut effectivement assassiné le 25 février... Peut-être cette prédiction a-t-elle joué, par sa seule existence, un rôle dans sa propre réalisation : le fait que ce héros de nombreuses guerres mourut sans se défendre a parfois été interprété par l‟attente paralysante de la réalisation d‟un sort inéluctable. (« Kepler, l‟astrologie d‟un astronome », in La Pensée scientifique et les parasciences, Paris : Albin Michel, 1993 : 61)
Dans un cadre plus moderne, le physicien Henri Broch propose une interprétation en termes de prophétie auto-réalisatrice à Anne Placier, invitée à l‟émission « Savoir Plus » comme grande consommatrice de voyances : AP : moi on m‟a raconté un an et demi avant avant que je n‟la crée
que j‟allais créer une entreprise (.) je n‟en avais pas du tout la moindre idée je n‟pensais qu‟à mes livres à mes euh (.) à mes articles je n‟pensais pas du tout qu‟j‟allais créer une entreprise je l‟ai fait un an et demi plus tard (.) [on m‟l‟avait dit
HB : [c‟est p‟t‟être ça qui vous a donné l‟idée de la faire
AP : mais absolument pas (« Savoir Plus » du 01/03/1993, France 2)
2. Interprétation en termes de coïncidence Une deuxième tentative de rationalisation consiste à ramener les similitudes entre l‟énoncé prédictif et l‟événement prédit à un effet du hasard. Pour parer à cette interprétation, les parascientifiques insistent sur la similitude entre les termes de la prédiction et l'événement tel qu'il s'est réalisé. Le mage Dessuart construit ainsi un parallèle entre deux récits, parallèle qui repose essentiellement sur les chiffres communs à la catastrophe décrite dans un roman datant de 1898, et au naufrage du Titanic : MD : [récit d'une voyance réussie, puis : ] coïncidence direz-vous (.) je
vais vous en donner une autre et très belle (.) 1898 (.) un écrivain de science-fiction américain Morgan Robertson écrit un roman qui s'appelle Futility (.) les références existent (.) dans lequel il parle d'un navire géant (.) qui est lancé par une nuit d'avril (.) pour son voyage inaugural (.) il transporte trois mille passagers (.) il mesure huit cents pieds de long (.) il jauge soixante-dix mille tonneaux (.) et malheureusement il rencontre un iceberg (.) il coule (.) et comme il n'y a que vingt-quatre canots de sauvetage (.) il y a plus d'un millier de noyés (.) le roman existe 1898 (.) vous voulez savoir comment il appelle le navire dans son roman ? le Titan (.) or en 1912 quatorze ans après (.) le Titanic coule par une nuit d'avril (.) en rencontrant un iceberg (.) il filait vingt-cinq noeuds à l'heure il mesurait huit cents pieds de long (.) il jaugeait soixante-six mille tonneaux (.) et y a eu mille morts parce qu'il n'y avait que vingt canots [de sauvetage
YG : [bon réponse réponse d'abord premièrement il faudrait scientifiquement vérifier vos affirmations ce que je ne peux pas faire ici (.) ce que je ne peux pas faire [ici (.)
Discussion des phénomènes 199
MD : [j'ai YG : [euh deuxièmement les coïncidences existent et c'est précisément MD : [pas amené les livres non plus YG : les coïncidences qui frappent le public
(« Duel sur la Cinq » du 22/04/1988, la 5)
Yves Galifret, tentant de réfuter le discours du mage Dessuart, n'a pas d'autre solution que de proposer une interprétation des faits décrits par son adversaire en termes de coïncidence. Or, l'explication de Galifret n'en est pas une : l'invocation du hasard n'explique rien (mais se contente de suggérer qu‟il n‟y a rien à expliquer), alors que le mage Dessuart essaie de trouver un sens dans les similitudes entre les deux événements. De plus, l‟invo-cation de possibles coïncidence n‟est pas « émotionnellement satisfaisante » :
On trouve parfois les explications scientifiques peu satisfaisantes pour les sentiments. Voir une simple coïncidence dans le fait que quelqu‟un ait rêvé d‟un accident d‟avion qui se produit de fait deux ou trois jours plus tard est trop prosaïque pour s‟harmoniser avec l‟expérience émotionnelle. Une explication paranormale est sans doute beaucoup plus satisfaisante, car elle donne au rêve l‟importance que le sujet lui-même lui a donnée. (Alcock 1989 : 92)
Plus généralement, c'est une caractéristique des parasciences de créer du sens, de faire signifier tout, puisque, dans une vision holistique de l'univers, tout est lié : d'où ce refus des coïncidences et, plus généralement, de l‟idée de hasard, qu'on retrouve aussi chez Nicole Laury, dans le « Duel » sur la numérologie qui l‟oppose à Alain Cuniot : AC : la personnalité se fabrique (.) au fil des des (.) des rencontres (.) au
fil de sa propre volonté (.) [et non pas (.) et non pas à la suite (.) NL : [je suis tout à fait d'accord avec vous (.) AC : [de (.) euh conceptions complètement arbitraires (.) [d'éléments NL : [absolument [il n'y a pas AC : [fortuits (.) de la naissance (.) ou de l'agencement des lettres de NL : [d'arbitraire mais les AC : [son nom NL : [la naissance et le milieu sont aussi importants je suis
entièrement d'accord (« Duel sur la Cinq » du 11/08/1988, la 5)
Ce refus du hasard semble être un des éléments du succès des parasciences ; l'univers sort enfin de son indifférence au destin des individus, et leur parle d'eux. C'est sans doute un des éléments qui font la force de Nicole Laury et la faiblesse d'Alain Cuniot. 3. Discussion des termes de la prédiction Les adversaires des mancies suggèrent parfois que l‟apparent succès d'une prédiction est en fait dû à l'imprécision des termes
200 Le débat immobile
utilisés. C‟est ce que dénonce Cicéron par la voix de Marcus, critiquant les oracles que la tradition attribue à la Sibylle :
L‟auteur de ces vers a procédé avec astuce, en supprimant toute précision sur la personne et le temps, de sorte que, quoi qu‟il arrivât, cela parût avoir été prédit. Il s‟est également caché derrière l‟obscurité, afin que les mêmes vers pussent paraître s‟appliquer tantôt à tel événement, tantôt à tel autre. (De la divination… LIV, 110-111 : 162)
Les critiques de ce type sont si répandues que les partisans des mancies anticipent souvent, produisant des figures d'occupation, comme dans cette séquence d'« Ex Libris », où Patrick Poivre d'Arvor affirme qu‟Élisabeth Teissier avait prévu la catastrophe de Tchernobyl : PPDA : alors en 86 vous aviez prévu Tchernobyl ça c'est vraiment assez
net ET : au jour près d'ailleurs PPDA : au jour près [hein en parlant d'la visite ET : [et j'ai parlé quand même c'était pas vague parce
que j'ai parlé il faut bien le dire pour les sceptiques (.) de risques [de catastrophe écol- par gaz ou liquide toxi[que
PPDA : [d'accid- [gaz ou liquide toxique voilà c'est le mot
ET : et comme le langage astrologique ne connaît pas (.) ne connaissait chez les anciens la notion d'atome évidemment c'était difficile de dire bon (.) mais maintenant
(« Ex Libris » du 08/03/1990, TF1)
C'est pourtant précisément sur les termes de la prédiction que la reprend Alain Cuniot dans son ouvrage Incroyable mais faux :
Tchernobyl. Que dit Teissier dans son livre ? “J'annonçais dans „Horoscope 86‟ que la configuration astrale du 22 avril favorisait des „catastrophes par gaz ou liquides toxiques‟. Cela donna Tchernobyl.” (p. 195) En réalité, voilà très exactement ce qui est écrit dans „“Horoscope 86”, p.36 : “Citons pour 1986 les alentours des 9 et 22 avril (accidents dus à des gaz toxiques).” On constate alors que “accidents” est devenu “catastrophe” et qu'elle a rajouté le mot “liquides”. On comprend pourquoi. Des gaz toxiques, c'est une chose, ça n'a rien à voir avec le nucléaire. Mais “liquides”, ça colle. Ce trucage est assez honteux. Tirer vers soi l'émotion suscitée par la catastrophe de Tchernobyl, en manipulant son propre texte, afin de glorifier ses talents et auréoler l'astrologie – je laisse juges mes lecteurs. (p. 65)
On le voit, ce n'est que dans une argumentation écrite qu'on peut mener ce type de réfutation, et non “au pied levé” lors d'un débat télévisé à fort niveau de polémicité, à moins d'avoir prévu l'argument, et de pouvoir produire sur le plateau les documents
Discussion des phénomènes 201
originaux comportant les citations exactes – encore risque-t-on d'être accusé de mauvaise foi et de “pinaillage” verbal.
2.3. Les médecines parallèles
La discussion des médecines parallèles reprend la plupart des procédés argumentatifs identifiés dans la discussion du para-normal ou des mancies.
Les témoignages
Comme pour les mancies, la controverse autour des médecines parallèles porte essentiellement sur la discussion de leur effica-cité : c'est encore la proposition “ça fonctionne” – ou, plus précisément, “ça guérit” – qui est discutée. En cela, la discussion des médecines parallèles comporte souvent des séquences où sont exposés des cas de guérison. Ces séquences, comme pour le paranormal, prennent le plus souvent la forme de témoignages. On a vu la forme particulière que prenaient les témoignages attestant de phénomènes paranormaux, et particulièrement l'itinéraire de la conviction qui y était décrit. Dans le cas des médecines parallèles, la croyance n'a pas à se justifier : devant la maladie, tous les recours sont légitimes. Les témoignages attestant de l'efficacité des médecines parallèles respectent un script quasiment immuable : – récit de divers recours à la médecine “officielle”, qui prononce un diagnostic désespéré et échoue à soigner la maladie ; – recours avant abandon à un thérapeute “parallèle”, qui redonne espoir ; – description des résultats totalement inespérés obtenus grâce à la thérapeutique parallèle.
Cette structure de récit, qui oppose l‟“avant” de la médecine officielle et à l‟“après” de la médecine parallèle, est d'autant plus efficace qu'elle peut jouer sur le pathos, et que les cas qu'elle évoque sont dramatiques. Ainsi, dans l'émission « Le Glaive et la balance » consacrée aux médecines parallèles, une mère raconte le cas de sa fille :
Mme X : ma fille il y a dix ans souffrait d'une leucémie (.) et les médecins nous ont dit que c'était une leucémie prolymphoplastique B (.) c'est-à-dire la plus aiguë (.) la plus cruelle (.) euh ils m'ont d'emblée expliqué que (.) le euh ils arriveraient à obtenir une rémission (.) que trois mois après il y aurait une première rechute (.) et que le record mondial de survie ne dépassait pas six mois à un an (.) une de mes collègues qui était médecin (.) m'a donné l'adresse (.) d'un centre où je pourrais (.) euh avoir (.) des renseignements sur des médecines non officielles mais qui
202 Le débat immobile
avaient (.) certains résultats sur des maladies très graves (.) euh en particulier j'ai donc obtenu l'adresse du docteur Tubéry qui euh avait des résultats justement avec des leucémies (.) sans la participation du docteur Tubéry (.) eh bien notre fille ne serait plus là (.) et j'dois dire euh en plus que non seulement elle ne s'rait plus là (.) mais nous n'aurions pas une adorable petite fille (.) euh qu'elle a eue le la joie d'avoir il y a trois ans
(« Le Glaive et la Balance » 1991)
Un des ressort de la dramatisation est la prise en charge du témoignage par des proches des patients. De plus, ce qui importe dans ces récits, c'est de faire ressortir le contraste entre le verdict posé par la médecine officielle et le résultat obtenu par le thérapeute parallèle. La gravité de la maladie est soulignée par des formules hyperboliques (« la plus cruelle », « la plus aiguë »), ou par l‟évocation du délai annoncé par la “médecine officielle”, opposé à la rémission observée après traitement par une thérapie parallèle. Le témoignage constitue ainsi une sorte de revanche que prennent les malades ou leurs proches sur un diagnostic “officiel” jugé humainement insupportable. La contre-attaque la plus fréquente consiste à utiliser le même procédé argumentatif – la preuve par le témoignage – pour arriver à une conclusion anti-orientée. Il s'agit alors de faire état de cas où le recours aux médecines parallèles n'a débouché sur aucune guérison, ou même a eu des conséquences dramatiques. L'ouvrage d'Olivier Jallut1 sur le recours à des médecines parallèles dans le traitement du cancer cite l‟exemple de nombreuses personnes dont la maladie a connu une issue tragique parce qu'elles ont préféré des thérapies parallèles à la médecine classique. De même, la controverse autour de l'instinctothérapie a été principalement déclenchée par la révélation de cas où certains patients arrêtaient le traitement qui leur était prescrit par la médecine “officielle” afin de se soigner par l‟instinctothérapie.
Il est pourtant clair que dans la logique de spectacle qui est souvent à l'oeuvre dans les débats télévisés, les témoignages qui établissent la validité des thérapies parallèles l'emportent très largement sur les contre-témoignages. En effet, dans un domaine comme la santé, par lequel tout un chacun peut se sentir concerné, de tels récits ouvrent une perspective d'espoir pour des maladies que la médecine classique ne réussit pas à traiter. Dans cette logique de spectacle, le contre-témoignage ne peut compter que
1 Médecines parallèles et cancers. Modes d‟emploi et de non-emploi, Bordeaux :
L‟Horizon chimérique, 1992.
Discussion des phénomènes 203
sur l'exploitation du pathos lié à l'évocation d'une issue dramatique pour compenser cet avantage. Cette faiblesse du contre-témoignage apparaît encore plus nettement dans la discussion du paranormal (où l‟enjeu est l‟établissement de l'existence même des phénomènes) : il serait absurde, dans une émission télévisée, de consacrer une séquence à un individu qui affirmerait n'avoir jamais vu d'ovni, n'avoir jamais vécu de phénomène de voyance, n'avoir jamais réussi à capter les voix des morts sur magnétophone. Enfin, comme pour le paranormal, les adversaires des médecines parallèles peuvent refuser le principe même d'utilisation de témoignages comme moyen de preuve. Ainsi, Jean-Charles Sournia, ancien directeur général de la santé : JCS : alors euh quand on vient dire que les euh tel malade a été soigné
de sa leucémie de son cancer (.) contre lequel la médecine s'était révélée euh (.) inefficace (.) alors là je voudrais bien avoir des preuves je voudrais bien connaître un p'tit peu le dossier du malade
(« Le Glaive et la Balance » 1991, M6)
Les expérimentations Le refus de la preuve par le témoignage conduit alors à exiger des expérimentations scientifiques prouvant la validité de ces thérapies. Ainsi, le même Jean-Charles Sournia justifie l'absence d'enseignement universitaire à l'échelle nationale en ostéopathie en arguant de l'absence d'expérimentations probantes : JCS : certains prétendent que l'ostéopathie est une méthode fiable (.)
moi j'attends toujours qu'on m'en donne la preuve (.) et les euh (.) jamais on n'a préten- jamais les ostéopathes (.) les praticiens de l'ostéopathie (.) n'ont fourni des l- des preuves statistiques (.) montrant que dans le (.) euh dans telle ou telle maladie de l'estomac (.) ils ont de meilleurs résultats que le le le que les médicaments euh connus et les médecins et les médecins diplômés (.) moi j'attends qu'on me donne des preuves
(« Le Glaive et la Balance » 1991, M6)
De même, dans le « Duel sur la Cinq » qui l'oppose au fondateur de l'instinctothérapie, Guy-Claude Burger, le docteur Jean-Pierre Bader, s'appuyant sur l'absence de tests à grande échelle, qualifie l'instinctothérapie de « doctrine a priori ». Lorsque la discussion sur les expérimentations se prolonge, on retrouve les mêmes contraintes liées à la médiatisation du débat que celles qu'on avait pu observer à propos du paranormal. Comme les partisans des mancies ou du paranormal, les tenants des médecines parallèles peuvent revendiquer un mode de validation particulier, en affirmant la spécificité des médecines parallèles. Ainsi, François Laplantine & Paul-Louis Rabeyron
204 Le débat immobile
invoquent les difficultés liées à l‟irréductibilité des visions allopathiques et parallèles :
Les médecines parallèles, par leur volonté globalisante et personnalisante, sont elles aussi d‟emblée en dehors du cadre des évaluations thérapeutiques classiques. Pour un médecin parallèle, l‟ulcère gastrique est à resituer dans une typologie, un caractère, des modalités réactionnelles propres, des symptômes qui varient dans leurs détails suivant chaque patient, ce qui entraîne des conséquences thérapeutiques très individualisées. On comprend aisément que le dialogue soit d‟emblée difficile entre ces deux approches si différentes de la maladie et de la thérapeutique. (Les Médecines parallèles, Paris : P.U.F., 1987 ; p. 84)
Une fois encore, la revendication d‟une spécificité est ressentie par les adversaires des médecines parallèles comme une tentative d‟échapper à toute vérification. Ainsi, un médecin généraliste, interrogé sur l‟expérimentation en homéopathie, exprime un certain malaise devant ce qu‟il ne peut interpréter autrement que comme de la duplicité :
Je ne suis pas tout cela de très près, mais j‟ai l‟impression, parfois, d‟un double langage. Les homéopathes se plaignent qu‟on ne veuille pas évaluer leurs produits comme n‟importe quel autre. Et quand les analyses se font et qu‟elles sont négatives, ils se récrient et se retranchent derrière la “spécificité” de l‟homéopathie, qui ne permet pas qu‟on l‟évalue comme on le fait habituellement... Là, il me semble qu‟il faudra choisir, tout de même ! (Cité dans Alfonsi 1989 : 275)
Les tenants des médecines parallèles, comme les défenseurs des mancies, recourent parfois aux statistiques. Ce n'est plus la valeur du témoignage en lui-même qui importe, mais le nombre de personnes attestant de la validité des thérapies parallèles. Ainsi, un éditorial du magazine Médecines douces est consacré aux résultats d'un sondage effectué auprès des utilisateurs de ces thérapies1, et présente le fait que 70 % d'utilisateurs de médecines parallèles s'en déclarent satisfaits (pour le traitement des petites maladies) comme un élément de preuve de leur efficacité) :
Beau succès pour les médecines douces : leurs utilisateurs les jugent efficaces à une très large majorité. [...] L'an dernier, notre premier sondage [...] avait permis de démontrer le formidable impact de ces médecines dans le public : près d'un Français sur deux les avait déjà utilisées [...] Les médias en avaient pris bonne note mais avaient fait remarquer – à juste titre, après tout ! – que cela ne prouvait en rien leur efficacité. Qu'il faudrait un autre sondage pour savoir si les utilisateurs des médecines douces en étaient satisfaits. Eh bien, c'est chose faite aujourd'hui. Et c'est
1 Sondage Médecines douces / SOFRES mené du 3 au 8 octobre 1985 sur un
échantillon de 1000 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus, selon la méthode des quotas et stratification par région et catégorie d'agglomération.
Discussion des phénomènes 205
oui ! Bien entendu, ces affirmations claires et nettes ne servent pas de preuves scientifiques pour des thérapeutiques qui, bien souvent encore, n'en ont pas, ou pas assez. Mais en attendant d'établir ces preuves – ce à quoi l'on s‟attelle un peu partout dans les laboratoires, sous la houlette du ministère de la santé, d‟ailleurs – ne pourrait-on pas faire quelque crédit à l'opinion publique ? (Médecines douces n°47, décembre 1985 : 16)
Ce type d'argumentation peut paraître hors de toute discussion, mais dans les faits, ce n'est pas le cas : un opposant aux thérapies parallèles arguera que la guérison peut être due à d'autres facteurs, il invoquera l'effet placebo, et d'une façon générale, affirmera que le sondage donne accès à l‟évaluation subjective du patient sur sa propre guérison, et non à l'observation directe de l'évolution de la maladie : il ne permet donc jamais de conclure à la validité ou à la non validité d'une pratique thérapeutique. L‟invocation de l‟effet placebo constitue une réfutation par rationalisation de l‟efficacité des médecines parallèles, et permet de ne pas nier qu‟il y ait eu effectivement guérison suite à un traitement par une médecine parallèle, sans reconnaître pour autant la validité de la thérapeutique utilisée. Finalement, la controverse autour des principales allégations des parasciences (« ça existe » ou « ça marche ») semble fatalement vouée à l‟échec, puisqu‟elle ne débouche ni sur un accord sur les faits, ni même sur un accord sur les critères permettant d‟établir les faits. Il est même difficile d‟imaginer ce qui pourrait garantir une issue constructive au débat, puisque celui-ci obéit à un cercle infernal qui semble difficile à briser. Les partisans des parasciences tentent de substituer aux critères de test proposés par leurs adversaires d‟autres critères, tenant compte, cette fois, de la spécificité qu‟ils prêtent aux phénomènes “para” – position à laquelle il convient de reconnaître une parfaite cohérence, si l‟on se rapporte au cadre intellectuel qui leur permet de penser ces phénomènes. En revanche, du point de vue de leurs opposants, tout amendement imposé aux procédures habituelles d‟évaluation apparaît comme une tentative de se soustraire purement et simplement à l‟épreuve des faits, et la revendication d‟une spécificité n‟est vue que comme un stratagème visant à garantir l‟infalsifiabilité des théories parascientifiques. Pourtant, partisans et opposants aux parasciences ne cessent de se revendiquer de “la Science” ; mais parlent-ils de la même chose ? La partie suivante cherche à identifier la ou les conception(s) de la science à laquelle se réfèrent les différents acteurs de la polémique.
Chapitre 9 : La science des uns,
la science des autres
Les critères de scientificité qui sont discutés dans le cadre du débat sur les parasciences relèvent prototypiquement des sciences physiques. Une telle restriction est loin d‟aller de soi : des dénominations comme “parapsychologie”, “morphopsy-chologie”, voire “astropsychologie” évoquent naturellement un voisinage intellectuel avec la psychologie, et on pourrait s‟attendre à ce que ces disciplines lui empruntent un cadre conceptuel et méthodologique. Or, à part quelques références isolées, il est rare que les partisans des parasciences fassent appel aux sciences humaines ; ils se tournent en fait presque exclusivement vers les sciences dites “dures”, et plus particulièrement, vers la physique. Il est significatif que lors du « Duel sur la cinq » consacré à la voyance (22/04/1988), le mage Dessuart, qui se voit opposé au professeur Yves Galifret, directeur du laboratoire de psychophysiologie sensorielle de l‟université de Paris X, ne mentionne que des physiciens à l‟appui de sa discipline : Léonid Vassiliev, Jean Charon, Costa de Beauregard... La raison de l‟élection de la physique – et plus généralement, des sciences exactes – comme référence est sans doute que c‟est elle qui fournit « le prototype de la scientificité », et qui a « l‟impact socio-culturel à la fois le moins manifeste et le plus important » (Roqueplo 1974 : 20). La description des occurrences de l‟argument d‟autorité dans le débat sur les parasciences, au chapitre 6, présentait les définitions normatives de cet argument, afin de les rapprocher de ce qui transparaissait des évaluations de l‟argument d‟autorité par les locuteurs “ordinaires” à travers leurs réfutations. La partie qui suit a une construction similaire : les différents critères de scientificité élaborés par les épistémologues seront présentés, puis mis en relation avec les critères proposés par les acteurs du débat.
1. LA THÉORIE SCIENTIFIQUE COMME CONSTRUCTION INTELLECTUELLE
L‟épistémologie des sciences décrit le plus souvent le savoir scientifique comme une construction intellectuelle élaborée dans le respect de certains principes, comme la falsifiabilité, le recours à l‟expérimentation, l‟objectivité. Dans le débat qui
208 Le débat immobile
nous intéresse ici, ce sont les adversaires des parasciences qui, le plus souvent, se réclament de cette conception de la science.
1.1. Réfutabilité de la théorie
L‟analyse de la discussion des faits dans le débat sur les para-sciences a fait apparaître que toute la démarche des partisans des parasciences est interprétée par leurs adversaires comme un stratagème visant à rendre leurs allégations infalsifiables. Avant d‟aller plus loin dans l‟analyse du concept de science tel qu‟il apparaît dans le débat, il est nécessaire de préciser cette notion de falsifiabilité, qui est à l‟origine (plus ou moins directement) de la plupart des critères de scientificité proposés par les acteurs du débat.
Le falsificationnisme L‟idée de falsifiabilité des théories scientifiques n‟est certaine-ment pas l‟apanage exclusif de Popper, mais c‟est lui qui en a fait le pivot de sa Logique de la découverte scientifique qui, même si elle fait aujourd‟hui l‟objet de nombreuses critiques, n‟en continue pas moins à nourrir une grande partie des réflexions contemporaines sur la science. Chalmers résume ainsi les principes de base de la théorie de Popper :
[Le falsificationnisme] considère les théories comme des conjectures ou des suppositions librement créées par l‟esprit qui s‟efforce de résoudre les problèmes posés par les théories précédentes et de décrire de façon appropriée le comportement de certains aspects du monde ou de l‟univers. Une fois énoncées, les théories spéculatives doivent être confrontées rigoureusement et impitoyablement à l‟observation et à l‟expérience. Il faut éliminer les théories incapables de résister aux tests de l‟observation ou de l‟expérience et les remplacer par d‟autres conjectures spéculatives. [...] On ne s‟autorisera jamais à dire d‟une théorie qu‟elle est vraie, mais on tendra à affirmer qu‟elle est la meilleure disponible, qu‟elle dépasse toutes celles qui l‟ont précédée. (1987 : 73)
Le falsificationnisme repose sur l‟argument logique suivant : Popper affirme que « les théories scientifiques sont des énoncés universels » (1978b : 57). Un énoncé universel au sens strict peut s‟écrire sous la forme d‟une conjonction infinie d‟énoncés singuliers :
Tout A est B = a1 est B ET a2 est B ET..... an est B
Une telle conjonction, de par son infinitude, n‟est pas vérifiable, puisqu‟il est impossible de tester séparément tous les énoncés singuliers qui la composent. En revanche, Popper rappelle que « la négation d‟un énoncé universel au sens strict est toujours équivalente à un énoncé existentiel au sens strict » (id. : 67). Il
La science des uns, la science des autres 209
est donc possible de rechercher un énoncé existentiel qui entre en contradiction avec la théorie exprimée par l‟énoncé universel ; si un tel énoncé existe, la théorie est dite falsifiée, et si l‟effet qui la réfute est reproductible, elle doit être abandonnée, car elle ne permet pas de rendre compte du monde empirique de manière satisfaisante. Dans la pratique scientifique quotidienne, au détriment de l‟exigence de falsifiabilité posée par Popper, la tentation existe de préserver une théorie qui, pour diverses raisons, s‟est montrée particulièrement satisfaisante jusqu‟à ce qu‟elle soit mise en échec par un énoncé singulier, en la modifiant de façon à ce qu‟elle puisse surmonter la difficulté rencontrée. Popper dénonce de tels comportements, et préconise l‟élimination des théories modifiées pour éviter une falsification, si minime que soit la modification, et si fructueuse que se soit révélée la théorie jusqu‟alors. Et c‟est précisément sur ce point que portent la plupart des critiques auxquelles le falsificationnisme a donné lieu. Nombreuses et diverses sont les attaques contre la définition poppérienne de la scientificité, de Chalmers (1987) ou Latour (1984), qui dénoncent son incapacité à rendre compte de l‟histoire des sciences, à Boudon (1990), qui lui reproche d‟exclure injustement certaines théories du champ de la science. Considérer le falsificationnisme pur comme étalon de scientificité mène sans doute à une conception réductrice de la science – et en particulier, empêche de comprendre les théories en cours d‟élaboration. Il se pourrait bien en revanche que la notion de falsifiabilité soit un outil précieux pour comprendre comment diverses théories appréhendent le réel, et dans quelle mesure celui-ci peut agir en retour sur elles.
Croyance et réfutabilité Revenons à notre objet. Dans le débat sur les parasciences, qui constitue un cadre fortement polémique, les adversaires des parasciences ont tendance à prôner un falsificationnisme pur et dur, et à rejeter comme non scientifique toute théorie qui ne satisfait pas à la condition de falsifiabilité. Cela ne signifie pas que, hors controverse, les adversaires des parasciences n‟admettent pas les critiques du falsificationnisme présentées plus haut ; cela illustre simplement le fait que la polémique durcit les positions, et que chacun peut être amené à défendre une position plus radicale que celle qu‟il adopterait dans un contexte pacifié. L‟adoption du falsificationnisme comme critère de scientificité est à tel point répandue que pratiquement toutes les caractérisations des parasciences par des “rationalistes” font état de leur incapacité à être falsifiées par l‟expérience. Cette définition des parasciences par leur irréfu-
210 Le débat immobile
tabilité est parfois portée par des historiettes qui, selon leurs auteurs (opposants aux parasciences), illustrent le rapport au réel des partisans des parasciences. Ainsi, Henri Broch, dans son ouvrage sur le paranormal, reproduit une lettre écrite par un chasseur de sanglier à François Canac :
Savez-vous que mon garde-chasse repère avec le pendule la présence des sangliers dans une forêt ? J‟ai même découvert un fait nouveau et extrêmement intéressant, c‟est que les sangliers sont sensibles au fluide radiesthésique. Et la meilleure preuve, c‟est que, quand je vais à l‟endroit indiqué par le garde-chasse, les sangliers qui se sont méfiés sont toujours partis. (Le Paranormal…: 190)
De même, Kapferer & Dubois touchent au problème de la falsi-fiabilité lorsqu‟ils opposent les interprétations du réel quand ce qui est perçu est anodin et lorsqu‟il s‟agit d‟ovni. Selon eux, si on croit voir un lac mais que la vision s‟évanouit quand on s‟en approche, on conclut qu‟il n‟y avait pas de lac, et qu‟un mirage s‟est produit. Au contraire, si on remplace le lac par un ovni, on conclut à l‟existence de l‟ovni justement parce qu‟il a disparu lorsqu‟on s‟en est approché (ce qui, dans ce cas, serait anormal, serait que l‟ovni se laisse approcher et examiner à loisir) (Kapferer & Dubois 1981 : 71). Comme le remarque Bachelard à propos de la magie, « c‟est un signe de puissance que d‟échapper à l‟expérience » (1977 : 154). Par ailleurs, un lien est souvent établi entre falsifiabilité, ratio-nalité et croyance, par exemple par Alcock dans son ouvrage sur la parapsychologie :
On mesure la rationalité d‟une croyance au fait que, une fois formée, elle peut être mise à l‟épreuve et que le sujet cesse d‟y croire lorsque cette épreuve est négative. (1989 : 68)
Pour les “rationalistes”, toute croyance aux parasciences est nécessairement irrationnelle. Le défenseur des parasciences est alors vu comme un fanatique, c‟est-à-dire un individu « qui, adhérant à une thèse contestée, et dont la preuve indiscutable ne peut être fournie, refuse néanmoins d‟envisager la possibilité de la soumettre à une libre discussion, et par conséquent, refuse les conditions préalables qui permettraient, sur ce point, l‟exercice de l‟argumentation » (Perelman & Olbrechts-Tyteca 1988 : 82). Il en résulte une quasi impossibilité de convaincre le partisan du paranormal par des arguments rationnels. Aussi Gabriel Gohau (secrétaire général de l‟Union Rationaliste) évoque-t-il la nécessité de recourir à des subterfuges :
Il est bien difficile de convaincre de leur erreur ceux qui croient aux phénomènes paranormaux : il faut trouver un subterfuge pour que celui qui a adhéré à une foi accueille des arguments prisés dans la sphère du rationnel. (« La baguette magique de Brest et la cuiller tordue », AFIS n°201 : 11)
La science des uns, la science des autres 211
De même, dans le domaine des mancies, Frédéric Méridien pose la vanité de toute argumentation face à la croyance à l‟astrologie :
Impensable de raconter que les astrologues travaillent sur des données astronomiques médiévales. Inutile d‟étaler des kilomètres d‟arguments scientifiques réfutant cette mascarade, la foi ne s‟éradique pas à coups d‟arguments, si justes soient-ils. (Ma sorcière bien payée. Spirites et magiciens, Paris : Hermé, 1992 ; p. 94)
Sur les thérapies parallèles enfin, Olivier Jallut rapporte le témoignage d‟un médecin tentant de convaincre une patiente que les médecines parallèles ne pourraient pas la guérir de son cancer :
C‟était la première fois que le docteur Tanner se trouvait devant une telle incapacité de compréhension : aucun argument scientifique ne pouvait percer la cuirasse de la conviction de Mlle Z. Il parlait à un mur, à une croyante mystique perdue dans son rêve et impénétrable à tous ces arguments scientifiques provenant d‟un monde différent. (Médecines parallèles…: 21)
Ainsi, selon les adversaires des parasciences, indépendamment de la structure même des théories, c‟est avant tout parce qu‟elles sont assimilables à des croyances qu‟elles sont infalsifiables, et qu‟elles se situent hors d‟atteinte d‟une argumentation critique. Si l‟on en revient à une conception plus formelle du falsifica-tionnisme, il est possible d‟identifier d‟autres critères de scientificité rencontrés dans le débat sur les parasciences, qui sont en général dépendants de cette notion centrale de falsifiabilité : c‟est le cas par exemple de l‟exigence d‟expérimentation ou d‟objectivité.
1.2. Démarche expérimentale
Les définitions de la science, invoquées le plus souvent par les adversaires des parasciences pour dénier toute scientificité aux théories parascientifiques, posent généralement une équivalence entre la scientificité d‟une théorie et sa conformité à la démarche expérimentale (qui permet la confrontation au réel exigée par le falsificationnisme), démarche que les partisans des parasciences sont accusés de ne pas suivre. Ainsi, dans l‟émission « Durand la nuit », le scientifique Paul Caro, interrogé sur le statut scientifique de la parapsychologie en général et de la voyance en particulier, répond : GD : mais monsieur Caro je vous pose une question précise est-ce que
par exemple le scientifique que vous êtes (.) conteste dans son principe pas la personne (.) mais par exemple les dons de Maud
212 Le débat immobile
est-ce que ça vous paraît (.) euh je vais pas employer cette expression parce que elle est galvaudée et surréaliste mais (.) juste ou scientifique mais c‟est c‟est c‟est [entre vous
PC : [non alors il faut dire que tous ces phénomènes là (.) ne relèvent pas du tout de l‟étude par les méthodes scientifiques (.) il y a dans la science une méthode (.) qui est composée d‟un mélange de modèles théoriques (.) et d‟expérimentation basée sur des instruments (.) il est extrêmement clair que dans les cas euh de parapsychologie qui ont été rapportés (.) ils ne peuvent (.) ils ne sont pas des sujets d‟étude scientifique (.) par conséquent ce domaine est étranger à la science]
(« Durand la nuit » du 11/05/1993, TF1)
Schématiquement, l‟enthymème1 développé par Paul Caro est du type :
La science associe modèles théoriques et expérimentation Or les faits parapsychologiques ne peuvent être soumis à ce type d‟analyse → Donc les faits parapsychologiques ne relèvent pas de la science
Cet échange illustre le fait que tout jugement de scientificité ou de non scientificité sur une discipline, dans le débat sur les para-sciences, nécessite l‟explicitation de critères de scientificité, qu‟elle soit spontanée (comme dans l‟exemple précédent) ou suscitée par l‟interaction. Dans le même débat, c‟est sur l‟invi-tation de Brigitte Lahaie, astrologue amateur, qui avait auparavant présenté l‟astrologie comme une science, qu‟il est amené à le faire : PC : et puis je dirais qu‟il faut pas abuser du mot science je pense que
vous dites l‟astrologie est une science non (.) l‟astrologie est une pratique très ancienne (.) avec des racines historiques (.) [la science
BL : [qu‟est-ce que c‟est que la science ?
PC : c‟est alors ça se définit (.) par la combinaison d‟un modèle théorique (.) et d‟une méthode expérimentale (.) basée sur l‟utilisation d‟appareillages (.) qui repèrent des phénomènes physiques (.) ce n‟est pas le cas de l‟astrologie (.) ce n‟est pas le cas de la voyance (.) donc ce ne sont pas des sciences
(« Durand la nuit » du 11/05/1993, TF1)
La dynamique de l‟échange montre bien qu‟une définition de la science peut servir (et, dans les faits, sert souvent) à justifier un jugement polémique de non scientificité des parasciences. Les critères de scientificité peuvent évoluer au cours de l‟interaction, en fonction des réactions de l‟adversaire. Dans le « Duel sur la Cinq » consacré à l‟instinctothérapie, Jean-Pierre Bader, gastro-entérologue, invoque « l‟esprit de la science » et en propose une paraphrase définitionnelle :
1 On considérera ici que l‟enthymème est le pendant, en contexte argumentatif, du
syllogisme en logique.
La science des uns, la science des autres 213
JPB : permettez-moi de vous dire monsieur Burger que (.) vous utilisez le vocabulaire de la science mais que [(1) : vous n‟en utilisez absolument pas l‟esprit (.)] [(2) : parce que l‟esprit de la science (.) c‟est la validation des hypothèses] [(3) : or vous ne vous vous êtes parti d‟une idée complètement toute faite (.) qui est probablement une sorte de révélation qui vous est venue de je ne sais quel ciel (.) suivant laquelle l‟instinct alimentaire était infaillible] (« Duel sur la Cinq » du 15/06/1988, la 5)
La définition de la science avancée par Jean-Pierre Bader sert de prémisse à une argumentation enthymématique de type :
L‟esprit de la science c‟est la validation des hypothèses [2] Or vous partez d‟idées toutes faites (= vous ne cherchez pas à valider vos hypothèses) [3] → Donc vous ne respectez pas l‟esprit de la science [1]
La réalisation discursive de ce schéma argumentatif prend la forme d‟une séquence justificative remarquablement complète, où la conclusion est articulée avec les arguments par le connecteur parce que, les prémisses majeure et mineure étant elles-mêmes liées par le connecteur or, caractéristique des syllogismes en logique formelle, ou des enthymèmes en argumentation. Réagissant à cette accusation, Guy-Claude Burger ne remet pas en question la prémisse majeure (c‟est-à-dire la définition que son adversaire propose de l‟esprit de la science), mais conteste la prémisse mineure : GCB : je n‟ai pas du tout l‟impression du de l‟idée d‟un instinct
omniscient omnipotent pas du tout (.) euh pendant les premières années de notre expérience au contraire (.) nous avons interrogé la réalité je suis moi-même physicien au départ (.) je connais un petit peu la méthodologie que l‟on utilise au moins en physique (.) et qui me semble euh valable (.) c‟est-à-dire que (.) on pose une hypothèse (.) et j‟ai observé moi-même euh des variations dans la perception de saveurs
(« Duel sur la Cinq » du 15/06/1988, la 5)
La discussion se poursuit sur cette voie ; Jean-Pierre Bader maintient sa conclusion mais précise sa critique, en posant l‟expérimentation à grande échelle comme critère de scientificité : JPB : je sais un peu c‟que c‟est que l‟alimentation en tant que gastro-
entérologue je sais un peu ce que c‟est la diététique (.) et je sais ce qu‟est [(1) : une expérience portant sur les problèmes de l‟alimentation (.) [...] il y a actuellement des enquêtes qui sont faites dans le monde entier pour déterminer quels sont les aliments (.) qui peuvent être (.) agir positivement pour créer un cancer colorectal et les aliments qui peuvent jouer un rôle protecteur (.) ce sont d‟immenses travaux de recherche épidémiologique où on compare des populations] [(2) : vous n‟avez jamais fait ça monsieur Burger (.) vous êtes parti d‟une idée toute faite qui est que l‟instinct était tout puissant]
(« Duel sur la Cinq » du 15/06/1988, la 5)
214 Le débat immobile
Le critère de scientificité repose, comme précédemment, sur l‟idée d‟expérimentation, mais la précision qui lui est apportée permet de maintenir l‟affirmation de la non scientificité de l‟instinctothérapie. L‟enthymème est alors :
En médecine, respecter l‟esprit de la science implique de mener des études épidémiologiques à grande échelle [1] Or vous ne l‟avez pas fait [2] → Donc vous ne respectez pas l‟esprit de la science [implicite mais exprimé auparavant]
Guy-Claude Burger, cette fois, admet la mineure mais en atténue les conséquences, en expliquant la faiblesse de l‟expérimentation par un manque de moyens, et en affirmant avoir réussi à intéresser les centres de recherche officiels à la question. D‟où la réaction de Jean-Pierre Bader, qui concerne cette fois-ci plus l‟éthique médicale que la science elle-même : JPB : alors monsieur Burger j‟ai beaucoup de plaisir à vous entendre
dire que vous êtes lancé sur la voie de l‟expérimentation (.) mais alors vous faites [(1) : quelque chose que en général en tant qu‟homme de science on s‟interdit] (.) c‟est-à-dire que [(2) : vous passez à l‟acte avant que les démonstrations de la validité de vos thèses ne soient (.) ne soient acceptées par le monde scientifique]
(« Duel sur la Cinq » du 15/06/1988, la 5) Cette fois, le gastro-entérologue accepte la contre-argumentation menée par Guy-Claude Burger et produit une intervention évaluative positive – même si elle est probablement teintée d‟ironie, elle ne constitue pas moins une acceptation de l‟inter-vention précédente de l‟adversaire. Mais il déplace la controverse en énonçant une nouvelle règle de scientificité qui entre dans un nouvel enthymème de forme :
L‟éthique médicale impose qu‟on n‟applique une théorie qu‟après l‟avoir soumise au jugement de la communauté scientifique. [1] Or vous avez appliqué l‟instinctothérapie avant que les hypothèses sur lesquelles elle repose ne soient admises. [2] → Donc vous ne respectez pas l‟esprit de la science [implicite mais exprimé auparavant]
Finalement, malgré la contre-attaque menée par Guy-Claude Burger, par laquelle il revendique lui-même une certaine légitimité scientifique, c‟est Jean-Pierre Bader qui demeure l‟arbitre de la scientificité au cours du débat : il en énonce les critères (qu‟il déplace en fonction de l‟argumentation menée par son adversaire) et évalue la conformité ou la non conformité de la démarche du “postulant” par rapport à eux. Enfin, la référence à la méthode expérimentale impose l‟idée d‟une science toujours en mouvement, toujours révisable, et s‟oppose à une vision de la science énonçant des vérités abso-lues et immuables. Ce caractère provisoire de toute théorie scientifique découle directement, dans un cadre popperien, de
La science des uns, la science des autres 215
l‟asymétrie entre confirmation et falsification en science. Pour être scientifique, une théorie doit renoncer à rien énoncer qui se veuille définitif ; elle doit au contraire se contenter de l‟humilité d‟une tentative, laissant aux croyances la jouissance de la certitude. Cette conception de la science permet à Russell d‟opposer l‟atemporalité des religions au caractère provisoire de la science (1990 : 12). De même, Caro, observant l‟action du temps respectivement sur l‟oeuvre d‟art et sur la théorie scientifique, oppose ces deux domaines, les siècles confirmant le statut artis-tique de l‟une et rejetant l‟autre dans une préhistoire de la science (1990 : 13). L‟idée d‟une science constamment en sursis est revendiquée par tous les acteurs du débat sur les parasciences. On la trouve notamment sous la plume de Michel Rouzé, qui, interviewé par le Canard Enchaîné, se dit rationaliste mais pas scientiste :
Ca doit être dans la configuration de mes neurones, je suis rationaliste depuis toujours. Mais pas scientiste ! Entre rationalistes, on peut s‟engueuler. Il n‟y a pas de vérité absolue. La science est par essence mouvante et révisable. (« Les anti-mythes », Les Dossiers du Canard, juin 1990 : 39-40).
Corollairement, la permanence des principes théoriques d‟une discipline est dénoncée comme symptôme de non scientificité. Ainsi, Yves Pierseaux oppose les théories issues d‟une pensée rationnelle et l‟astrologie à travers leurs évolutions respectives :
La connaissance prend du temps, et la construction de la rationalité ne sera jamais achevée. La pensée rationnelle critique ne rejette donc pas le non-rationnel. Simplement, elle ne l‟immobilise pas dans une catégorie non soumise à la temporalité à savoir l‟irrationnel. Le savoir “spirituel” ne change pas. L‟astrologie est toujours la même depuis deux mille ans. (« La Pensée et les physiciens », La Pensée et les hommes 18, 1991 : 35)
Il est intéressant de rappeler que le même fait – la permanence des principes qui sous-tendent l‟astrologie – est utilisé par les partisans des parasciences comme un argument en faveur de cette discipline (on l‟a vu, la longévité de l‟astrologie sert une argumentation du type : “si ça ne marchait pas, ça aurait été abandonné depuis longtemps”).
1.3. Objectivité de la science
Une autre caractéristique admise de la science est son objectivité. Cette qualité a même été si souvent mise en avant qu‟il arrive que les adjectifs correspondants soient considérés comme interchangeables : dans le langage courant, une démarche objective est déjà (presque) scientifique. En quoi consiste
216 Le débat immobile
l‟objectivité de la science ? Bouveresse affirme que l‟idée popperienne de connaissance objective a deux faces :
D‟une part, elle signifie que c‟est du monde réel que parle la science, (et cela de mieux en mieux) donc que ce monde existe, et n‟est pas seulement notre représentation [...]. D‟autre part, elle signifie que la connaissance est distincte du sujet, et qu‟elle a une réalité objective, parmi les autres réalités de l‟univers. (1981 : 95).
Pour Popper, « la connaissance au sens objectif est une connais-sance sans connaisseur : elle est connaissance sans sujet connais-sant » (1978a : 122). Une telle position, loin de faire de la théorie scientifique une vérité absolue, la soumet à un contrôle social, qui a le pouvoir de la faire et de la défaire, puisque « l‟objectivité des énoncés scientifiques réside dans le fait qu‟ils peuvent être intersubjectivement soumis à des tests » (Popper 1978b : 41). Pour Russell, l‟exigence d‟objectivité rend compte du fait qu‟aucune approche scientifique de l‟expérience mystique n‟est possible. En effet, l‟homme de science, lorsqu‟il expérimente, apporte des changements dans le monde extérieur, mais ne change pas lui-même en retour. En revanche, l‟expérience mystique « exige des changements dans l‟observateur, par le jeûne, par des exercices respiratoires, et par l‟abstention soigneuse de toute observation extérieure » (1990 : 138). Cette analyse exclut par exemple du champ scientifique les expériences d‟ex-corporation comme celles mentionnées par Anne et Daniel Meurois-Givaudan dans l‟émission « Ex Libris » du 08/03/1990, ou tout autre phénomène impliquant une expérience vécue très forte, qui n‟est accessible qu‟avec participation de l‟observateur. La nécessaire intersubjectivité de la science rend aussi difficile-ment soutenable les définitions “mixtes” que proposent souvent de leur discipline certains partisans des parasciences. Ainsi, Nicole Laury, lorsqu‟elle définit la numérologie comme « à la fois une science et à la fois un art », pose l‟existence de lois vérifiables et répétitives qui régissent la numérologie, mais affirme aussi l‟importance du numérologue dans l‟exercice de la discipline (« Duel sur la Cinq » du 11/08/1988). Cette idée d‟universalité, d‟objectivité, d‟intersubjectivité de la science, quelle que soit la formulation adoptée, est largement admise, et c‟est en se référant à elle qu‟Henri Broch refuse le statut de science à la numérologie (il manque d‟ailleurs par là de pertinence, son adversaire, le numérologue Jean-Daniel Fermier, ne prétendant pas exercer une science) : HB : la numérologie c‟est quand même pas très compliqué imaginez
quelqu‟un a un (.) prénom une date de naissance il suffirait de changer par exemple l‟alphabet (.) il suffit de voir bon l‟alphabet
La science des uns, la science des autres 217
latin euh (.) par exemple on prendrait je sais pas euh (.) arabe euh vingt-huit signes hébreu vingt-deux [grec vingt-quatre
JDF : [c‟est exact il y a des systèmes qui correspondent à chaque culture à chaque civili[sation
HB : [donc la numérologie est différente JDF : la numérologie monsieur ça remonte [euh bien au-delà de HB : [c‟est c‟est là JDF : Pythagore [qui d‟ailleurs HB : [c‟est c‟est c‟est c‟est bien ce qui montre que c‟est ce
qu‟on appelle une pseudo-science (.) ça [c‟est un des [stigmates JDF : [non non [je HB : [manifestement c‟est quand il y a JDF : [je n‟prétends pas exercer une science monsieur (.) [d‟abord je n‟ai HB : [la science est JDF : [pas parlé de science XXX HB : [universelle (.) la science est universelle et tout être humain
capable de raisonner (.) est capable d‟accepter ses ses conclusions (.) et là on voit bien qu‟il y a une différence avec les pseudosciences c‟est qu‟i- il n‟y a pas une numérologie (.) il y a une numérologie française une numérologie italienne [...] de la même manière l‟astrologie il y a une astrologie européenne une astrologie euh (.) disons amérindienne une astrologie chinoise une astrologie indienne (.) pourquoi il n‟y a pas de physique des particules euh indienne de physique des particules chinoise il y a une physique des particules (.) et je veux dire les physiciens on est tous d‟accord d‟où qu‟on vienne (.) sur ces sujets-là (.) il se trouve que ça c‟est manifestement un des stigmates des pseudo-sciences à savoir (.) la non universalité c‟est-à-dire vos petits systèmes (.) ne marchent que pour des zones bien définies qui dépendent d‟un alphabet qui dépendent d‟une langue (.) qui dépendent d‟une zone
(« Savoir Plus » du 01/03/1993, France 2)
Dans cet échange, Henri Broch, après s‟être assuré de l‟accord de son adversaire sur les prémisses (l‟existence de plusieurs versions de la numérologie), énonce sa conclusion (il s‟agit de “pseudo-sciences”), puis énonce le critère de scientificité sur lequel il s‟appuie. Enfin, il étend son raisonnement et, à partir du même étalon de scientificité, arrive au même diagnostic : la non scientificité de l‟astrologie. La riposte des partisans des parasciences consiste à montrer que la science elle-même ne constitue pas un bloc unanime, et que différentes écoles existent sur un certain nombre de sujets au sein même de la communauté scientifique.
1.4. Adéquation à une description lexicale et argumentative du discours scientifique
L‟évaluation de la scientificité d‟une théorie passe aussi parfois par l‟analyse du discours qui la porte, et par la comparaison de ce discours avec l‟étalon que serait le “discours scientifique”.
218 Le débat immobile
Caractéristiques du discours scientifique Qu‟est-ce que le discours scientifique ? On trouve chez certains auteurs l‟idée qu‟il existerait, au-delà des sciences particulières, un concept de science qui les transcenderait toutes, la science, et qui s‟exprimerait dans une langue que l‟on pourrait considérer comme la langue de la science. Cette langue, rarement définie avec précision, ferait largement appel au formalisme mathéma-tique et aux formes de déduction logique. Ce point de vue est aujourd‟hui largement abandonné par les linguistes qui travaillent sur le discours scientifique. Petroff, s‟interrogeant sur la prise en compte du réel par le discours scientifique, rejette ainsi l‟idée d‟un langage scientifique commun aux sciences :
Existe-t-il, à part les modélisations mathématiques, une langue scientifique générale ? Nous répondrons, évidemment, par la négative, dans l‟état actuel de nos réflexions. (1990 : 195)
Même si la recherche de la langue de la science ne suscite plus guère d‟intérêt, les analystes du discours ont dégagé un certain nombre de traits (syntaxiques ou lexicaux) qu‟ils considèrent comme caractéristiques du discours scientifique, et qui font l‟objet d‟un consensus assez large. 1. Le discours scientifique est un discours impersonnel. Les analystes du discours scientifique s‟accordent généralement pour souligner son caractère impersonnel, qui se manifeste par la rareté des marques d‟énonciation et par la multiplication des transformations nominales, qui lui garantissent « l‟anonymat d‟un discours universel du vrai à la rationalité atemporelle et impersonnelle » (Authier-Revuz 1982 : 45). L‟impersonnalité du discours scientifique n‟est jamais utilisée comme critère de réfutation de la scientificité des parasciences ; à aucun moment on ne voit un adversaire des parasciences reprocher à un parascientifique la multiplication des marques de personne dans son discours. En revanche, cette caractéristique du discours scientifique est directement liée à la prétention à l‟objectivité évoquée précédemment ; or, celle-ci, on l‟a vu, est souvent utilisée dans le débat comme critère de démarcation. 2. Les terminologies scientifiques tendent à la monosémisation. Une autre caractéristique souvent prêtée au discours scientifique est lexicale. Contrairement à la complexité et à la souplesse du sens des mots dans le langage courant, où polysémie, connota-tions, emplois figurés viennent brouiller les cartes, dans le discours scientifique, la relation entre signe et référent serait bi-univoque. On parle de la monosémie (ou, plus prudemment, de la tendance à la monosémisation) du vocabulaire scientifique. Le lien entre univocité du terme scientifique et scientificité du
La science des uns, la science des autres 219
discours est explicitement établi par Petroff, qui rappelle l‟importance que les scientifiques eux-mêmes y attachent :
Un seul terme pour un référent et un seul référent par terme, tel est, tout d‟abord, le contrat de lecture qui a toujours fondé la confiance que tout destinataire accorde à l‟auteur d‟un discours scientifique ou technique. Si cette cohérence est mise en défaut, la scientificité même du propos est douteuse. Cette monosémie du terme scientifique ou technique apparaît comme fondamentale, indispensable, et elle est revendiquée par les scientifiques comme caractérisant leurs propres discours (1990 : 189)
L‟univocité du lexique scientifique ne serait donc pas une caractéristique superficielle, anecdotique ou accessoire du discours scientifique, mais serait au contraire constitutive de sa scientificité même. Alors que, on l‟a dit, l‟impersonnalité du discours scientifique ne sert jamais d‟argument dans le débat sur les parasciences, la stabilité sémantique des termes employés est parfois invoquée comme critère de scientificité. C‟est ce que montre l‟analyse de l‟utilisation du mot énergie dans le « Duel sur la Cinq » sur la morphopsychologie.
Analyse du mot “énergie” dans le discours des partisans des parasciences
Dans le débat sur les parasciences, la première étape d‟établis-sement des faits parascientifiques est rarement franchie ; leur explication n‟est donc presque jamais abordée. Quant elle l‟est, c‟est toujours par les partisans des parasciences, et le principe explicatif invoqué est l‟existence d‟une énergie agissante. Ainsi, Évelyne Leclerc, invitée à l‟émission « Ciel mon mardi » sur la superstition, explique à Christophe Dechavanne l‟efficacité des objets porte-bonheur : CD : il ne faut pas acheter des talismans mais on a tous des objets-
fétiches EL : non c‟est parce que les objets je pense sont chargés d‟énergie en
fait [...] tout ça c‟est une question d‟ondes c'est une question d‟énergie (.) c‟est ce que vous disiez à l‟instant
(« Ciel mon mardi », date inconnue, TF1)
De même, François Laplantine & Paul-Louis Rabeyron soulignent le rôle primordial que joue la notion d‟énergie en acupuncture, et plus généralement, dans toutes les médecines parallèles (Les Médecines parallèles…: 7). Comment s‟explique le succès de la notion d‟énergie ? Delon, dans un ouvrage retraçant l‟évolution du concept d‟énergie de 1770 à 1820, apporte un début de réponse. Tour à tour liée « au pouvoir premier accordé par Dieu et lové au coeur des choses » (1988 : 44), puis principe explicatif de phénomènes divers dans une philosophie matérialiste ou centre d‟une théorie de la volonté, la notion d‟énergie connaît à partir de la fin du dix-
220 Le débat immobile
huitième siècle un engouement sans précédent, qui se confirme au cours du siècle suivant. Elle participe d‟une vision holiste du monde et cherche à saisir l‟univers dans sa globalité : « à la traditionnelle disproportion entre l‟univers et l‟homme succède une exaltante participation de l‟individu à l‟énergie du tout » (id. : 189). Or, les parasciences sont souvent caractérisées par leur démarche holistique ; c‟est peut-être pour cela que faire de l‟énergie un principe explicatif unique paraît aussi séduisant. Que faut-il entendre exactement par énergie ? Rien de précis, si l‟on en croit Delon, pour qui le succès du terme est justement lié à son indétermination sémantique :
L‟intérêt d‟une telle idée réside dans sa polyvalence, on a presque envie de dire son ubiquité, c‟est-à-dire aussi son imprécision conceptuelle. (id. : 516).
Le Petit Robert oppose un sens strict à une acception figurée : I. Cour. 1°) Vieilli. Pouvoir, efficacité (d‟un agent quelconque). Force, vigueur (dans l‟expression, dans l‟art) (...). 2°) Force et fermeté dans l‟action, qui rend capable de grands effets. (...) Force, vitalité physique. II. Sc. 1°) Phys. Ce que possède un système s‟il est capable de produire du travail. 2°) Énergie chimique potentielle de l‟être vivant.
Or, il est souvent difficile de savoir de quelle acception relèvent les différentes occurrences du mot énergie dans le discours des parascientifiques. Lorsque le parapsychologue Raymond Réant parle d‟« énergie atomique », nulle doute, il se réfère au sens II 1°) du mot. Mais lorsque le journaliste qui l‟interviewe l‟invite à raconter l‟histoire d‟un cristal qu‟il lui a apporté, il répond :
Raymond Réant : je ne pourrais pas le faire maintenant, car, comme mes élèves pourraient vous le dire, je travaille toute la nuit. Je ne dors que deux heures par jour. Je m‟occupe en ce moment de faire revivre les morts, j‟y dépense toute mon énergie[1] et vous savez que l’énergie[2] doit être canalisée. Ce n‟est pas que je veux me soustraire à l‟expérience... L‟Inconnu : ça ne vous inspire rien ? Raymond Réant : Si ça m‟inspire quelque chose mais ça ne me donne rien de plus que le fait qu‟il y a une énergie [3]positive dedans et ça vous le savez... Une analyse, pour qu‟elle soit bien faite, il faut être bien détendu, avoir l‟esprit libre et puis, surtout, avoir de l’énergie [4]d‟avance. (L‟Inconnu 158, août 1989 : 10)
Globalement, le mot énergie, dans cet extrait, semble relever du sens I 2°) du dictionnaire. Mais la première occurrence renvoie à l‟expression “dépense d‟énergie”, qui, au sens littéral, renvoie aussi à l‟acception II 1°). Plus généralement, une éner-gie qui peut se “dépenser” (ou s‟économiser, puisqu‟on peut en constituer un stock « d‟avance »), suggère une réalité palpable, quantifiable, susceptible d‟être localisée aussi bien dans un parapsychologue que dans un cristal (voir occurrence
La science des uns, la science des autres 221
[3]). Quant à l‟association de l‟adjectif « positive » au substantif énergie, elle rend encore plus difficile l‟identification de l‟acception du mot. Dans la mesure où en science, on parle de charge électrique positive ou négative, l‟expression pourrait rappeler l‟acception II 1° ; mais l‟adjectif pourrait aussi qualifier les effets produits par l‟énergie en question : on serait alors dans l‟acception 1 2°). En fait, le mot énergie apparaît souvent dans le débat sur les parasciences sous une forme qui suggère qu‟il ne s‟agit pas des acceptions habituellement admises du terme. Il existe à coup sûr plusieurs sortes d‟énergie (énergie solaire, cinétique, méca-nique...) ; mais d‟ordinaire, l‟énergie est considérée comme indivisible, d‟où l‟effet de légère étrangeté produit par l‟expression plurielle rencontrée dans la bouche d‟un témoin, qui raconte comment sa tumeur cancéreuse a disparu grâce aux soins d‟une magnétiseuse : X : j‟étais déjà en chimio donc si vous voulez le traitement
fonctionnait (.) mais j‟étais très très fatigué et c‟était un complément on avait peur que le pire arrive et c‟est comme ça que je me suis retrouvé chez une magnétiseuse qui après euh (.) m‟a apporté beaucoup de satisfaction (.) j‟ai repris des énergies j‟ai bien surmonté le mal euh (.) tout va très bien
(« Envoyé spécial » du 14/10/ 1992, France 2)
De même, lorsque Henri-Pierre Aberlenc affirme que « les signes zodiacaux [...] désignent [...] des énergies présentes dans le coeur de l‟homme, dans un langage symbolique, poétique » (Le Monde inconnu 106, juin 1989), il est difficile de préciser le sens du mot énergie autrement qu‟en le paraphrasant par des termes très généraux comme potentialité, force... La spécificité de l‟acception du mot énergie est souvent marquée par l‟adjonction d‟un adjectif épithète au substantif. Dans la tradition vitaliste, l‟idée d‟énergie propose d‟établir un lien entre le corps et l‟âme, entre le physique et le moral : on parle alors d‟« énergie vitale de l‟âme » (Delon 1988 : 243). Cette expression d‟« énergie vitale » apparaît chez le morphopsychologue André Garel lors du « Duel sur la Cinq » du 01/07/1988. On en trouve un équivalent obtenu par l‟adjonction du préfixe bio- : William Chetteoui évoque à plusieurs reprises l‟existences de « champs bio-énergétiques » (« L‟Homme est une endosymbiose », Autre Monde 118, juin 1989). Le mot énergie peut aussi se voir adjoint un autre substantif construit en épithète : on obtient alors une expression comme « énergie-conscience », utilisée par l‟astrologue Solange de Mailly-Nesle pour distinguer la notion d‟énergie utilisée par les astrologues de celle des physiciens (« Astrologue / science : chiens de faïence », Autrement 82, septembre 1986 : 42).
222 Le débat immobile
Cette notion d‟énergie semble relever d‟une conception spiri-tualiste (elle est associée à la conscience), mais aussi d‟une conception matérialiste : elle est susceptible de s‟épuiser, d‟être localisée, d‟être transmise... Comme le magnétisme animal de Mesmer, si on la considère comme une théorie fondée sur une force matérielle, elle « participe d‟une laïcité et d‟une matériali-sation des phénomènes psychiques » ; comme théorie d‟une force supra-naturelle, elle « conforte une approche spiritualiste de l‟homme » (Delon 1988 : 175-176). L‟énergie comme principe explicatif se voit substituer d‟autres notions, qui permettent également une approche spiritualiste et matérialiste des phénomènes. La voyante Arielle, interrogée sur son pouvoir, affirme ainsi :
Voyez-vous, je débite des choses que je sais pas d‟où ça vient. Moi, je crois que c‟est une question d’ondes magnétiques, un peu comme le fil de la télévision ou de la radio. (Les Dossiers du Canard, juin 1990 : 63)
La numérologue Nicole Laury, elle, parle de la vibration des nombres : NL : ben voilà (.) tout simplement (.) c‟est en fait bon je suis née dans
une famille d‟artistes de musiciens de peintres donc j‟ai toujours parlé vibrations et je continue de parler vibrations avec les nombres (.) parce que pour moi un nombre (.) ça vibre (.) donc ça signifie quelque chose et ça émet un message (.) or (.) euh mon neveu qui est tout petit (.) qui a sept ans (.) est arrivé au monde avec un chemin de vie trois (.) c‟est-à-dire une vibration de communication d‟expression
(« Duel sur la Cinq » du 11/08/1988, la 5)
Dans les deux cas, les termes utilisés (ondes ou vibrations) désignent des phénomènes physiques, mais leur emploi suggère d‟autres interprétations : lorsque Nicole Laury parle de la vibration des nombres, il est clair que vibration n‟apparaît pas ici au sens propre.
L‟utilisation, par les partisans des parasciences, de termes ayant un sens technique au sein d‟une théorie scientifique, suscite souvent des négociations en situation de face à face. En particu-lier, lors du « Duel sur la Cinq » sur la morphopsychologie (01/07/1988), l‟utilisation du mot « énergie » provoque l‟apparition de négociations sur les signes, négociations qui débouchent elles-mêmes sur la contestation de la scientificité de la discipline en question. En effet, dans ce débat, le non respect de la monosémie du vocabulaire scientifique provoque une séquence polémique assez violente pour amener une “rupture de niveau” dans la controverse : partant d‟une discussion de la morphopsychologie, les débatteurs en viennent à une négociation sur les signes, puis à la discussion de la méthode elle-même,
La science des uns, la science des autres 223
Albert Jacquard faisant la leçon à André Garel sur ce qu‟il convient d‟entendre par “science”. Dès le début du débat, André Garel met en place un réseau sémantique autour de la morphopsychologie, dont les éléments, qu‟aucun lien explicite ne rassemble au départ, sont utilisés au cours de l‟interaction de manière interchangeable. Dès sa première intervention, définissant sa discipline, il introduit les termes qui constitueront ce réseau par la suite : AG : [...] morphopsychologie qui est un terme qui a été créé( (.) par le
docteur Louis Corman (.) en 1937 [...]qui a forgé ce mot (.) du grec morpho qui veut dire forme (.) et de psyché qui veut dire âme (.) ou ce qui anime (.) et de logos qui est science (.) euh il a créé ce vocable (.) pour rendre compte de sa démarche (.) qui était la suivante (.) il est parti d‟abord de la tradition qui est une tradition physiognomoniste (.) dite des types planétaires (.) et il a fait le rapprochement avec une loi (.) qui est bien connue qui est la loi de dilatation rétraction qui rend compte dans les formes de du vivant [...] cette loi rend compte du vivant dans ce sens où elle (.) l’énergie vitale (.) lorsqu‟elle trouve un milieu favorable pour s‟épanouir (.) pour se nourrir (.) va donner des formes en expansion des formes dilatées (.) et euh à l‟inverse lorsque cette énergie vitale ne trouve pas à s‟exprimer correctement dans ce milieu (.) les formes vont être des formes rétractées
(« Duel sur la Cinq » du 01/07/1988, la 5 )
Dans ce passage, André Garel propose une paraphrase par redoublement de l‟élément « psyche », qu‟il reformule par le substantif « âme », puis par la périphrase « ce qui anime ». L‟expression « énergie vitale » fonctionnera par la suite comme une paraphrase par substitution de cette chaîne paraphrastique. Ce n‟est qu‟après plusieurs échanges qu‟Albert Jacquard réagit à la seconde utilisation de l‟expression « énergie vitale » par André Garel : AG : c‟est le le problème de l‟expansion élective c‟est-à-dire c‟est c‟est
là où l’énergie vitale de l‟individu (.) pourra le mieux s‟exprimer AJ : mais qu‟est-ce que vous appelez vous voyez alors je suis
scientifique je le mot énergie je le comprends (.) [je sais ce que AG : [oui AJ : c‟est que l’énergie (.) l’énergie vitale je comprends pas pour moi
c‟est un mot creux (.) vide (.) ça n‟a pas de sens il y a de l’énergie (.) vitale (.) pourquoi pas de la bio-énergie pendant qu‟on y est ça n‟a pas de sens ces mots nouveaux (.) et qui en fait font référence à des concepts scientifiques précis (.) mais qui veulent dire tout autre chose (.) là où j‟ai peur d‟un dérapage (.) la science a des règles la science (.) a des rigueurs (.) elle a des mots (.) derrière ces mots il y a des concepts et puis tout d‟un coup (.) on emploie des mots un peu semblables pour dire quelque chose qui n‟est (.) pratiquement pas défini (.) et moi j‟ai très peur [...] on est très très loin de toute science
(« Duel sur la Cinq » du 01/07/1988, la 5 )
224 Le débat immobile
Albert Jacquard fait ici une utilisation très spécifique de l‟argument d‟autorité, déjà rencontrée chez Alain Cuniot (à propos de la citation d‟Einstein « inconnue des physiciens »). En associant la proposition « je suis scientifique » à la proposition « l‟énergie vitale je comprends pas », il invite le destinataire à tirer une inférence du type “l‟expression énergie vitale n‟est pas scientifique”. Il généralise sa critique à d‟autres expressions, puis en vient à proposer une série de caractérisations de la science qui fonctionnent comme critères de scientificité, pour conclure, comme dans tous les cas de négociation de critères de scientificité exposés précédemment, au non respect de ces critères par l‟adversaire, et donc à la non scientificité des thèses qu‟il défend. Une fois encore, loin de récuser les critères de scientificité proposés par l‟adversaire, le morphopsychologue énonce une réplique mettant en question la pertinence des reproches du généticien, puisqu‟il affirme qu‟il ne parle pas science mais psychologie. Dans cette nouvelle perspective, il peut proposer une redéfinition de l‟expression « énergie vitale » qui déplace la polémique du domaine de compétence de son adversaire sur son propre territoire conversationnel : AG : euh euh (.) oui alors (.) alors si je dirais que là (.) vous vous
parlez au plan scientifique uniquement mais il faudrait parler aussi psychologie (.) c‟est-à-dire qu’est-ce qui anime moi alors lorsque j‟employais le mot (.) tout à l‟heure énergie vitale sur lequel vous m‟avez repris (.) il s‟agissait plus de la psychologie de ce qui anime (.) de l’âme en fait (.) et donc c‟est oui qui va qui donne qui va donner vie à l’individu
(« Duel sur la Cinq » du 01/07/1988, la 5 )
Le généticien ne se contente pas de cette reformulation, et, partant d‟un terme qui appartient aussi – et par excellence – à son domaine d‟étude (« vie »), il reprend André Garel sur la chaîne paraphrastique qu‟il vient d‟établir, lui demandant de préciser chaque terme (au cours de l‟extrait suivant va réapparaître le terme psyché, introduit lors de la première intervention du morphopsychologue) : AJ : ah c‟est pas l‟âme qui donne vie tous les animaux vivent [et n‟ont AG : [qui qui AJ : [pas forcément une âme AG : [ce qui anime AJ : c‟est un [concept très particulier AG : [ce qui anime ce qui anime ce qui anime hein ce qui
anime c‟est-à-dire (.) la [psyché (.) ce qui anime donc et AJ : [ce qui anime AG : qui [et qui AJ : [vous voyez que on est en train de (.) on est en train de déraper
complètement (.) un animal [il vit (.) il a de l‟énergie en lui [il AG : [oui [oui
La science des uns, la science des autres 225
AJ : a des activités (.) et puis tout à coup on parle de psyché est-ce que vous parlez de la psyché d‟une bactérie ? de la psyché d‟une algue [bleue ? d‟un virus ? non ?
AG : [euh eh bien (.) enfin (.) oui (.) enfin dans la dans la mesure (.) dans la mesure où elle vit (.) eh bien le le son adaptation au milieu (.) se fera suivant la même loi de dilatation et de rétraction
(« Duel sur la Cinq » du 01/07/1988, la 5 )
Ce qui déroute ici Albert Jacquard, c‟est précisément cette chaîne de reformulations qui lui semble faire glisser le sens constamment de la physique à la métaphysique en passant par la psychologie, sans que ces changements de perspectives n‟impliquent de variations lexicales, puisqu‟ils sont traversés par l‟expression unique d‟« énergie vitale ». L‟issue de cette négociation sur le sens est difficile à établir ; elle se termine ici, sans être signalée par autre chose qu‟un changement thématique (le morphopsychologue fait évoluer la discussion vers les applications éventuelles de sa discipline dans le domaine du recrutement). À partir de cette négociation, le ton de l‟interaction devient de plus en plus polémique ; on notera que jusqu‟à la fin de l‟émission, les termes d‟énergie vitale, psyché, âme ou ce qui anime ne reviendront plus, ni dans la bouche d‟André Garel, ni, bien sûr, dans celle d‟Albert Jacquard, ce qui peut marquer un renoncement de la part du morphopsychologue à imposer son réseau sémantique.
1.5. Définition juridique de la science
Une dernière façon de caractériser la science tient compte des difficultés qu‟il y a à la définir intrinsèquement, à saisir la science en soi, et s‟appuie sur des caractéristiques plus facilement observables. Cette position est représentée notamment par Lévy-Leblond, pour qui toute tentative de définir la science est vouée à l‟échec :
Il est très difficile d‟arriver à définir la science par elle-même. On ne peut pas définir la science par son langage, c‟est pourquoi il est tout à fait faux que les mathématiques, premièrement, soient un langage, deuxièmement, qu‟elles soient le langage de la science ; troisièmement, que la science ait un langage unique... Il n‟y a pas d‟unicité de la science. Il n‟y a pas une méthode scientifique. Au fond, il est strictement impossible, à l‟heure actuelle, de donner une caractérisation de cette activité appelée activité scientifique en des termes purement épistémologiques ou méthodologiques. Si l‟on allait jusqu‟au bout de cette analyse, on aboutirait à une définition de la science qui serait purement empirique et sociologique : la science qu‟est-ce que c‟est ? C‟est ce que font les personnes qui s‟appellent des scientifiques, qui travaillent dans des lieux à la porte desquels est inscrit “laboratoires de sciences”. (1984a : 33)
226 Le débat immobile
Certains vont plus loin et insistent, de façon parfois provocante, sur le fait que les caractéristiques sociales de l‟activité scientifique en déterminent le contenu de façon décisive. Ainsi, Serres souligne le rôle de ce qu‟il appelle la « raison juridique » dans la constitution de la vérité 1:
Pour recruter ses pairs, décider des programmes, produire des résultats et les publier, la société scientifique canonise la vérité en se réglant sur des lois qui ne sont pas scientifiques : jurys de concours, d‟examen, de revue et de publication, réceptions académiques, grands prix et récompenses diverses, plaidoiries au cours de colloques, argumentations contradictoires. La raison juridique structure donc de l‟intérieur l‟argumentation et le développement propre de notre raison et garantit ses réussites. Il en résulte, selon moi, et j‟espère ne pas vous scandaliser, que le droit est plus grand que la science dans la mesure où, de l‟intérieur et par l‟aval de ses conséquences, il constitue notre propre activité. Tout se passe en effet comme s‟il en faisait advenir l‟objectivité. (1992 : 55)
De telles définitions de la science, centrées essentiellement sur le problème des publications, apparaissent dans la polémique sur les parasciences. Dans le débat qui oppose Alain Cuniot et Yves Lignon sur le dossier Péchiney, c‟est finalement le statut des revues dans lesquelles sont publiés les résultats contradictoires qui permet de départager le scientifique du non scientifique : YL : le rapport scientifique qui a été publié dans la revue de
métallurgie appliquée qui est une revue qu‟on ne trouve pas dans les kiosques parce que c‟est une revue scientifique (.) le rapport scientifique précise bien (.) que pour obtenir l‟équivalent d‟un tel phénomène (.) il faudrait placer la barre au coeur d‟une centrale nucléaire (.) où est le trucage ?
AC : réponse (.) je me référais euh (.) à Yves Farge qui était [...] directeur de recherches au CNRS et qui je crois maintenant est chez Péchiney (.) et qui a écrit parce que vous écrivez dans votre ouvrage (.) que personne (.) n‟a jamais critiqué ou remis en question (.) la fameuse expérience que vous évoquez [...] alors qu‟il y a des tas d‟articles [...]
YL : dans quelle revue scientifique a été publiée la critique d‟Yves Farge ? (.) le rapport de Char[les Puissard et de Jean Bouvet
AC : [dans une revue alors ça va vous faire bondir dans une revue de l‟union rationaliste (.) [eh oui (.) mais
YL : [ah la la la rev- AC : [Yves Farge n‟en reste pas moins compétent YL : [la revue de l‟union rationaliste n‟est pas considérée par le par
la communauté scientifique comme une revue scientifique (.) mais comme une revue philosophique (.) la preuve en est que vous défendez des positions philosophiques (.) et des choix éthiques vous n‟avez pas une opinion scientifique sur la parapsychologie
1 Il renverse ensuite l‟argumentation, puis conclut sur l‟existence d‟un feed-back
permanent entre la logique externe, la “raison juridique” de l‟activité scientifique d‟une part, et d‟autre part sa logique propre.
La science des uns, la science des autres 227
(.) vous avez une opinion philosophique et a priori sur la parapsychologie
(« Duel sur la Cinq » du 15/04/1988, la 5).
On trouve le même argument chez un opposant aux parasciences cette fois, dans la bouche de Yves Galifret, opposé au mage Dessuart lors d‟un « Duel sur la Cinq » consacré à la voyance (22/04/1988). Le mage, répondant à son adversaire, qui vient d‟évoquer une expérience défavorable à l‟astrologie, enchaîne : MD : cher professeur je ne doute pas de ça (.) c‟est certain qu‟il ne s‟agit
pas encore une fois de science exacte c‟est pas nous qui allons dire ça (.) et que nous sommes faillibles nous ne sommes que des sujets (.) mais euh l‟histoire le démontre assez parce que vous semblez collectionner les anecdotes et chercher dans [de vieux
YG : [non non ça MD : [livres YG : [n‟est pas ça c‟est pas d‟l‟anecdote [c‟est publication dans Nature MD : [non non mais enfin (.) c‟est YG : [(.) avec même l‟autographe de l‟auteur MD : [une bien sûr (.) j‟ai autant de publications à votre service qui
démontreront des exemples (.) [réels frappants réussis YG : [facile (.) facile à dire (.) facile à
dire [...] une publication dans Nature c‟est sérieux (« Duel sur la Cinq » du 22/04/1988, la 5)
Le professeur Galifret laisse à la revue Nature le soin de dire la science (bizarrement authentifiée par la signature de l‟auteur), face au mage Dessuart qui lui, ne dispose que de témoignages pour énoncer sa vérité. Les définitions institutionnelles de la science sont en général le fait d‟individus qui, d‟une manière ou d‟une autre, appartiennent ou ont appartenu à l‟institution scientifique, et qui, par là même, connaissent et acceptent le mécanisme de validation juridique des connaissances.
2. LA THÉORIE SCIENTIFIQUE COMME SOUMISSION AUX FAITS
Les précédentes négociations de définitions de la science sont presque exclusivement le fait des opposants aux parasciences ; lorsqu‟un partisan des parasciences se hasarde à en proposer sa propre définition, il y a fort à parier qu‟il appartient lui aussi, de près ou de loin, à la communauté scientifique (c‟est le cas, par exemple, de Guy-Claude Burger ou de Yves Lignon). Une autre définition de la science, qui semble propre aux parti-sans des parasciences, émerge du débat. Cette approche, contrai-rement à la précédente, qui mettait en avant la science comme théorie, est essentiellement empirique, et semble réduire le travail scientifique à l‟énoncé de faits. Dans le débat sur les
228 Le débat immobile
parasciences, cette conception a pour conséquence que les parti-sans des parasciences accusent leurs adversaires de refuser de voir le réel, de nier les faits (interprétant ce refus du réel dans le cadre de “l‟appel à Galilée”). Cette dénonciation est associée à un appel à l‟expérience immédiate, présentée comme la seule voie sûre vers la connaissance.
2.1. Dénonciation de l’aveuglement des opposants aux parasciences
Comme leurs adversaires, les partisans des parasciences reven-diquent le monopole de l‟objectivité. Pour eux, l‟objectivité est définie non plus par la possibilité de contrôler intersubjectivement une assertion, mais comme une disposition intellectuelle exempte de préjugés, synonyme d‟impartialité. Les partisans des parasciences, s‟ils admettent que l‟explication des phénomènes ne fait pas l‟objet d‟un consensus, considèrent que leur existence relève de l‟évidence et que leur négation par les adversaires des parasciences ne peut tenir que de la mauvaise foi. Fondamentalement, les partisans des parasciences reprochent à leurs adversaires de s‟attacher aux principes au détriment des faits. Le reproche est formulé explicitement par Élisabeth Teissier qui, après avoir rappelé à son interlocuteur les dangers qu‟il peut y avoir à refuser trop vite des théories novatrices, affirme :
ET : mais écoutez monsieur mais c‟est l‟expérience qui compte (.) vous vous parlez d‟un principe qui est impossible (.) vous êtes en train de me dire ça ne peut pas exister comme le docteur Knock (.) et moi j‟vous dis ça existe
(« Duel sur la Cinq » du 10/06/1988, la 5)
et continue, plus loin :
ET : vous dites a priori ça n‟existe pas [...] c‟est les faits qui existent monsieur les faits (.) les faits
(« Duel sur la Cinq » du 10/06/1988, la 5)
La même analyse est proposée par François Laplantine, qui affirme que l‟existence des faits en parapsychologie a été établie sans équivoque, mais que seules les réticences des scientifiques à voir leurs théories bouleversées expliquent que la parapsychologie ne soit pas intégrée à la recherche scientifique institutionnelle :
Si donc l‟on estime aujourd‟hui que la clairvoyance n‟existe pas, ce n‟est pas tant parce que nous manquerions de faits – ils sont au contraire extrêmement nombreux – mais parce que ces derniers contredisent d‟une manière véritablement frontale le “paradigme” au sens de Kuhn qui commande l‟état actuel de la recherche
La science des uns, la science des autres 229
scientifique. Il existe des faits de voyance – recueillis et établis dans les conditions mêmes exigées par la science – mais ne pouvant être intégrés à notre théorie de la rationalité scientifique, s‟opposant à elle (c‟est-à-dire aussi à notre façon de percevoir ce que nous appelons “la réalité”), ils ne peuvent qu‟être rejetés. (« Voyance, “parapsychologie…» : 38)
On assiste même parfois à un renversement du “monopole de l‟objectivité”, habituellement prêté aux scientifiques, et il arrive qu‟un non scientifique (dans l‟exemple qui suit, le prêtre Georges Morand) fasse la morale aux scientifiques, auxquels il rappelle l‟exigence d‟objectivité : GM : il me semble que si nous essayons d‟aborder (.) ces problèmes de
la voyance (.) non pas (.) avec au point de départ une idéologie rationnelle (.) toute faite (.) mais (.) je dirais avec l‟humilité du scientifique qui se plie aux faits (.) eh bien (.) il revient à ces scientifiques (.) que j‟attends toujours un peu d‟ailleurs (.) d‟étudier (.) scientifiquement (.) avec un esprit critique (.) mais sans jugement négatif a priori (.) l‟ensemble des phénomènes dont il était question (.) ce soir
(« Durand la nuit » du 11/05/1993, TF1)
Une telle interprétation de l‟attitude des adversaires des para-sciences peut entraîner de violentes mises en cause lors de situa-tions de face à face. Ainsi, Élisabeth Teissier accuse Dominique Ballereau de « mauvaise foi », et Yves Lignon traite Alain Cuniot de « menteur » et de « tricheur ». Lorsqu‟une stratégie offensive apparaît fréquemment dans un débat, elle fait l‟objet de figures d‟occupations qui cherchent à la “désamorcer”. Henri Broch, interviewé par Philippe Gildas, insiste ainsi sur son impartialité et affirme ne se prononcer qu‟après examen de chaque cas : PG : alors le professeur Broch est donc professeur à l‟université à
Nice (.) physicien (.) très sérieux et il a une passion il a décidé de ?
HB : de s‟intéresser à tout ce qui est hors de l‟ordinaire PG : oui et à démontrer que ce qui passe pour eh (.) extraordinaire est
souvent une escroquerie HB : pas d’a priori je veux dire on on regarde et il se trouve que
souvent c‟est le cas mais il faut j’ai pas d’a priori j‟examine y a un phénomène ça m‟intéresse je vais voir il se trouve que bon (.) jusqu‟à plus ample informé jusqu‟à maintenant on a toujours trouvé ce qu‟il y avait derrière et c‟étaient des escroqueries
PG : vous croyez à rien HB : non croire (.) à mon avis ça veut rien dire on peut pas croire à
quelque chose (.) il faut on va voir et on regarde peut-être que demain on trouvera quelque chose (.) en tout cas à l‟heure actuelle
(« Nulle part ailleurs » du 30/09/1993, Canal +)
230 Le débat immobile
2.2. Appel à l’expérience immédiate
Symétriquement, les partisans des parasciences construisent une image d‟eux-mêmes comme d‟observateurs objectifs de la réalité, dépourvus d‟a priori, acceptant les choses “telles qu‟elles sont ”. Bernard Martino, se posant comme dénué de préjugé, fait apparaître en creux l‟image d‟un adversaire partial : BM : et je me dis tiens tiens c‟est curieux (.) quand on accepte l‟idée (.)
qu‟à l‟intérieur du ventre de la mère il y a des relations particulières entre le foetus (.) et la maman (.) je ne refuse pas l’idée que (.) quand le bébé sort (.) cette relation peut continuer (.) sous une autre forme ou sous une autre pourtant ils sont séparés (.) et je ne refuse pas l’idée que cette ré- cette relation (.) s‟estompe avec le temps (.) dans la plupart des cas (.) je ne refuse pas [...] ou ne ou ne pas disparaître (.) ou revenir à l‟occasion d‟un accident d‟un choc brutal (.) c’est des hypothèses je ne les refuse pas a priori
(« Ciel mon mardi » du 27/11/1990, TF1)
Cette image d‟ouverture au réel des partisans des parasciences est renforcée par le fait qu‟ils se présentent comme soumis à une réalité qui leur dicterait sa vérité. Ainsi Rémy Chauvin justifie son opposition au darwinisme en affirmant que l‟observation le contraint à refuser l‟évolutionnisme, et à lui substituer l‟hypothèse de l‟existence d‟un « grand ingénieur » :
Vous savez, si on accepte vraiment de regarder les choses telles qu’elles sont et d’observer la nature telle qu’elle est, on rencontre des milliers de cas où elle s‟est amusée à complexifier les choses d‟une façon extraordinaire. Ce qui, évidemment, ne cadre pas du tout avec les théories de Darwin ou de Monod. [...] Parfois, quand je vois les aberrations auxquelles la nature nous confronte, je pense au doigt de Dieu. Mais vous savez que les scientifiques n‟aiment pas que l‟on mêle le Bon Dieu à leurs histoires... alors j‟ai préféré le terme de “Grand Ingénieur”. Je suis obligé de constater qu‟il y a dans la nature une intelligence à l‟oeuvre qui se rit du milieu et semble poursuivre un projet dont les buts sont loin d‟être compréhensibles. (Entretien avec R. Chauvin, Le Monde Inconnu n°104, avril 1989 : 35).
Finalement, chacun est amené à constater l‟échec des négocia-tions sur les critères de scientificité : les deux camps s‟accusent mutuellement de nourrir des a priori qui rendent vaine toute tentative de conciliation de leurs points de vue respectifs. Si les partisans des parasciences lancent un appel à l‟impartialité, ce n‟est pas à leurs adversaires qu‟ils s‟adressent, mais au tiers, spectateur et arbitre, cible de l‟argumentation. Devant l‟impos-sibilité de mener le débat vers une issue satisfaisante, Henri-Pierre Aberlenc, auteur d‟une « Lettre ouverte aux rationa-
La science des uns, la science des autres 231
listes », pose la vanité des discussions théoriques et lance un appel à l‟expérience immédiate, qui seule peut convaincre :
L‟argument essentiel de cette “lettre ouverte” n‟est pas théorique ! Il est nécessaire et suffisant de CONSTATER LES FAITS PAR SOI-MEME : qui a expérimenté la télépathie (par exemple) ou a recueilli des témoignages sérieux sur ce sujet ne pourra plus douter de sa réalité. Les ratiocinations de ceux qui n‟y voient qu‟illusion s‟effondreront désormais sous la force démonstrative de l’expérience. Que celui qui s‟interroge mène sa propre enquête ! Bien des cas pourraient être cités, mais le lecteur ne serait pas obligé de nous croire : seule la vérification personnelle peut convaincre. 1(Le monde Inconnu n°106, juin 1989 : 9)
Mais, précise l‟auteur, cette enquête personnelle ne peut être concluante que si, contrairement aux rationalistes qui s‟accrochent à leurs préjugés, le lecteur accepte de se départir de tout a priori et accepte les faits tels qu‟ils ne manqueront pas de se présenter à lui :
Si l‟enquêteur est vraiment désireux de trouver la vérité, s‟il domine son autocensure (fût-elle inconsciente), s‟il est persévérant nul doute qu‟il rencontrera tôt ou tard un de ces faits têtus que tant d‟esprits semblent aujourd‟hui ne pas vouloir accepter. (id. : 9)
Finalement, pour Henri-Pierre Aberlenc comme pour beaucoup de partisans des parasciences, la perception des phénomènes est la meilleure et la seule voie vers la connaissance. L‟appel à l‟expérience (et non l‟expérience elle-même) a une fonction argumentative. En cela, il se pourrait bien que Perelman & Olbrechts-Tyteca (1989 : 64) aient exclu un peu rapidement l‟appel à l‟expérience du champ de l‟argumentation. Si celui-ci se limite aux « moyens discursifs d‟obtenir l‟adhésion des esprits » (Perelman & Olbrechts-Tyteca 1988 : 10), dire : “regarde et tu verras” ou “observe et tu ressentiras” suppose déjà : – que la question peut être tranchée ; – qu‟elle peut l‟être par des moyens simples ; – que ces moyens sont à la disposition aussi bien de l‟adversaire (qui, s‟il refuse alors de se rallier à la position du locuteur, fait preuve de mauvaise foi) que de l‟auditoire ; – que la preuve sera nécessairement différée par rapport au discours lui-même, le temps de l‟argumentation et le temps de l‟expérience brute étant distincts (la question ne sera tranchée qu‟à l‟occasion d‟une hypothétique expérience de transcommunication, ou de télépathie, ou de psychokinèse, etc.). Or, affirmer fournir à l‟auditoire les moyens de trancher une question en discussion, tout en reportant la preuve elle-même en
1 Les majuscules et les caractères gras sont de Henri-Pierre Aberlenc.
232 Le débat immobile
dehors de l‟argumentation développée, tient déjà pratiquement lieu de preuve. Si un locuteur affirme qu‟une pile contient une charge électrique, et suggère à l‟auditoire, une fois à demeure, de poser la langue sur les deux lames d‟une pile plate pour en être convaincu, le fait même qu‟il fournisse les moyens de preuve, en même temps qu‟il affirme que la pile est chargée électriquement, suffit à convaincre, sans que chaque membre de l‟auditoire ne ressente forcément le besoin de faire l‟expérience (sinon par curiosité). Ce n‟est pas le réel lui-même qui tranche, mais la suggestion que le réel, dans certaines conditions, peut trancher.
2.3. De l’expérience vécue à l’expérimentation en laboratoire
Dans le débat sur les parasciences, les moyens de preuve admis par les participants s‟organisent sur un continuum qui va de l‟appel à l‟expérience personnelle à l‟expérimentation scienti-fique, en passant par l‟expérience indirecte, présentée sous forme de témoignages, et chacun de ces moyens de preuve est à même d‟influencer les opinions des destinataires de l‟argumentation en jouant sur des registres différents (exploitation du pathos des témoignages ou de l‟autorité de type légal-rationnel associée à l‟imagerie scientifique). Si on parle de continuum, c‟est que l‟analyse des divers emplois du terme expérience dans le corpus fait apparaître de continuels glissements entre les différents sens que ce mot peut avoir, évoquant des réalités qui vont de l‟expérience la plus intérieure (expérience mystique, par exemple) à des expérimentations hautement formelles et théorisées. Confions d‟abord au Petit Robert le soin de distinguer les différentes acceptions du mot « expérience » :
Expérience : 1. Le fait d‟éprouver qqch., considéré comme un élargissement ou un enrichissement de la connaissance, du savoir, des aptitudes. V. Pratique, usage. Expérience longue, prolongée d‟une chose. V. Habitude, routine. L‟expérience du monde, des hommes. L‟expérience d‟un métier, des affaires. (...) Le fait d‟éprouver une fois qqch. C‟est une expérience qu‟il ne recommencera pas ! Qu‟a-t-il retiré de cette expérience ? 2. Absolt. La pratique que l‟on a eue de qch., considérée comme un enseignement. L‟expérience démontre, confirme, vérifie, prouve que. 3. Absolt. Ensemble des acquisitions de l‟esprit résultant de l‟exercice de nos facultés (au contact de la réalité, de la vie). V. Connaissance, savoir, science. Avoir plus de courage, de bonne volonté que d‟expérience. (...) 4. Le fait de provoquer un phénomène dans l‟intention de l‟étudier (de le confirmer, de l‟infirmer, ou d‟obtenir des connaissances
La science des uns, la science des autres 233
nouvelles s‟y rapportant). V. Épreuve, essai, expérimentation ; événement (3). Faire une expérience, des expériences de physique, de chimie. (...) V. Expérimental. (...) Par ext. (cour.) V. Essai, tentative. Faire une expérience de vie commune. Tenter l‟expérience. Expérience malheureuse. (...)
L‟acception 3 n‟apparaît à aucun moment dans le corpus. En revanche, les acceptions 1, 2 et 4 y sont clairement identifiables à de nombreuses reprises. a) expérience intérieure : le premier type d‟emploi, aisément identifiable, s‟apparente au sens 1 ; il désigne « le fait d‟éprouver quelque chose », ou le récit de ce qui a été ressenti. En tout cas, il suppose une expérience intérieure, qui implique fortement la personne qui la vit : BR [interrogé sur ce qui lui permet d‟affirmer l‟existence d‟une vie
après la mort] : eh bien j‟ai eu la chance euh une chance assez exceptionnelle je dois le reconnaître euh de d‟avoir une vérification par moi-même (.) puisque j‟ai vécu une expérience spirituelle très particulière avec ma mère (.) ma mère étant décédée depuis deux ans
(« Duel sur la Cinq » du 01/10/1990, la 5)
MD [introduisant un invité témoin d‟une apparition d‟ovni] : et vous il y a une dizaine d‟années (.) donc vous étiez en voiture et il vous est arrivé aussi une chose une expérience assez incroyable
(« Bas les masques » du 09/03/1993, France 2)
Pour Flahault, l‟argumentation par le vécu, qui utilise l‟expérience-1 comme moyen de preuve, serait caractéristique de ce qu‟il appelle le “discours de l‟Inconnu”, et serait en partie responsable des incompréhensions qui se font jour lorsque des parascientifiques sont confrontés à des tenants de la “science officielle”, qui n‟admet pas ce type d‟argumentation (1978 : 151). b) Expérience liée à une longue pratique : dans le débat sur les parasciences, le terme d‟« expérience » est également employé pour revendiquer une crédibilité liée à une compétence particu-lière : CB : alors moi j’ai une expérience (.) très importante de la dianétique
parce que (.) je suis médecin généraliste depuis (.) dix-sept ans (.) et ça fait dix ans que je connais la dianétique
(« Duel sur la Cinq » du 18/05/1988, la 5 CB = Claude Boublil)
AG : j‟ai cité le les sources hein (.) j‟ai cité les sources qui sont euh (.) donc à la fois celle du docteur Louis Corman je pense que là (.) vous pouvez vous référer à à ses ouvrages et aux exemples qu‟il cite et à sa à sa à sa longue expérience parce que (.) c‟est c‟est (.) un pragmatique également
(« Duel sur la Cinq » du 01/07/1988, la 5)
234 Le débat immobile
Mais le plus souvent, le mot expérience dénote simplement une certaine familiarité avec un domaine : ET : mais écoutez monsieur mais c‟est l’expérience qui compte
(« Duel sur la Cinq » du 10/06/1988, la 5 ET = Élisabeth Teissier)
GCB : l’expérience nous montre que (.) on ne se trompe pas ou que très rarement
(« Duel sur la Cinq » du 15/06/1988, la 5 GCB = Guy Claude Burger)
c) Expérimentation : enfin, l‟acception la plus fréquente dans le corpus est le sens 4 du dictionnaire, au sens strict et par extension. Les cas suivants illustrent l‟acception 4 au sens strict du mot expérience : YG : 28 acceptent de participer à l’expérience (.) en toutes les en
double aveugle [...] les astrologues qui s‟étaient livrés à l’expérience [...] expérience rigoureusement contrôlée
(« Duel sur la Cinq » du 22/04/1988, la 5)
AJ : pour que ça soit démontré vrai (.) il faudrait un certain nombre tout de même (.) d’expériences de répétitions (.) de contrôles
(« Duel sur la Cinq » du 01/07/1988, la 5)
Les acceptions dérivant de 4 par extension dénotent une démarche dont l‟objectif serait l‟acquisition de savoir, mais selon un protocole informel, contrairement à l‟expérimentation scientifique. C‟est clairement le cas dans un extrait de « Bas les masques » où l‟invitée raconte qu‟elle ne croyait pas au départ à la possibilité de communiquer avec son mari défunt. Mireille Dumas reprend : MD : vous avez quand même tenté l’expérience puisque [...] c‟que vous
vouliez c‟était entrer en communication avec votre mari (« Bas les masques » du 09/03/1993, France 2)
Jean-Yves Casgha, dans l‟émission « Ex Libris », fait état d‟une contre-expérience du même type : JYC : la contre-expérience a été faite avec une zombie (.) à qui on disait
dans l‟hôpital (.) va nettoyer les mouchoirs (.) et elle partait la malheureuse Francina (.) elle nettoyait tous les mouchoirs
(« Ex Libris » du 08/03/1990, TF1)
Il est parfois quasiment impossible d‟attribuer à expérience un sens précis. Le plus souvent, l‟ambiguïté existe entre les accep-tions 1 et 4, ou entre l‟acception 4 au sens strict et 4 par extension.
– Flottement entre 4 au sens strict et 4 par extension : La distinction entre les deux variantes d‟expérience-4 peut constituer un enjeu important dans certaines interactions. Dans l‟émission « Star à la barre » sur “la parapsychologie et le
La science des uns, la science des autres 235
surnaturel”, l‟illusionniste Gérard Majax fait venir un complice qui fait éclater un verre à distance. Invité par l‟animateur, Daniel Bilalian, à se prononcer sur ce qu‟il vient de voir, Rémy Chauvin refuse, arguant du cadre non scientifique dans lequel s‟est déroulée l‟expérience : DB : bon (.) bien (.) euh je voudrais avoir votre réaction monsieur
Chauvin alors euh qu‟est-ce que vous en pensez vous de ça RC : je n‟en pense rien ça me paraît intéressant à première vue (.)
mais je voudrais répondre (.) [rires de la salle] je voudrais répondre d‟abord à Majax [...]
DB : non mais attendez là je vous parle de l’expérience monsieur (.) (.) euh
RC : oh ben celle-là euh (.) que voulez-vous que je vous dise ? DB : je sais pas est-ce que ça euh je sais pas moi je veux dire je vois
un verre (.) ça ça je vois un verre éclater comme ça [ça me (.) je RC : [ben c‟est DB : [voudrais avoir votre [point de [vue vous [qui vous intéressez à RC : [intéressant je [je [je n'ai [aucune op- je DB : [ça en tant qu‟universitaire (.) Monsieur Lignon RC : [mais n‟ai aucune opinion YL : nous sommes sur un plateau de télévision nous ne sommes pas
dans un laboratoire je n‟ai aucune opinion [huées du public] (« Star à la barre » du 09/05/1989, France 2)
Cet exemple fait apparaître assez clairement l‟amalgame parfois pratiqué par les professionnels de la télévision entre preuve médiatique et preuve scientifique.
– Flottement entre 1 et 4 : Enfin, certaines occurrences du mot expérience font apparaître une ambiguïté entre l‟acception 1, qui dénote une expérience intérieure, et l‟acception 4, qui dénote l‟approche scientifique d‟un phénomène. Cette ambiguïté découle directement du fait que les partisans des parasciences abordent des phénomènes qui comportent parfois une part importante de subjectivité sans renoncer pour autant à une étude scientifique de ces phénomènes. Ce type de flottement apparaît avec une grande systématicité chez Patrick Poivre d‟Arvor. Dans le « Ex Libris » du 8 mars 1990, il lance l‟émission en utilisant une première fois le mot expérience : PPDA : dans ces dossiers donc les dossiers de Jean Yves Casgha qui
viennent de paraître chez Robert Laffont (.) euh (.) vous avez abordé un grand nombre de sujets euh (.) qui sont tous plus impressionnants les uns que les autres hein j‟veux j‟veux pas (.) euh on va pas rentrer dans tous ces euh dans tous les détails que vous abordez (.) et on s‟aperçoit qu‟il y a un fourmillement d’expériences (.) aujourd‟hui dans le monde dont on parle pratiquement jamais (.) ou dont on parle avec des nuances euh (.) disons euh assez sceptiques
JYC : pour le moins [oui au moins sceptiques PPDA : [et on s‟aperçoit et oui on s‟aperçoit qu‟elles sont
solides (« Ex Libris » du 08/03/1990, TF1)
236 Le débat immobile
Les deux thèmes abordés immédiatement après cette introduction sont les tentatives d‟observation de neutrinos par les physiciens, et l‟hypothèse émise par deux astronomes péruviens évoquant une éventuelle collision entre la Terre et une autre planète : expérience semble dont pouvoir être rattaché à l‟acception 4. Dans l'intervention suivante, PPDA : alors un gros chapitre également dans votre livre (.) sur les
frontières de la vie (.) euh c‟est celui certainement qui va le plus fasciner les téléspectateurs il y a par exemple cette expérience qui n‟est pas une expérience d‟ailleurs qui se passe actuellement au Liban (.) d‟un enfant (.) qui revit la vie d‟un homme dont on sait qu‟il a été fusillé pendant la guerre du Liban
(« Ex Libris » du 08/03/1990, TF1)
l‟emploi du mot expérience, suivi immédiatement d‟une correction sans qu‟un substitut soit proposé, marque sans doute une réticence à employer le même mot dans deux acceptions bien distinctes dans un intervalle de temps jugé trop bref. Il l‟emploie pourtant encore une fois pour introduire le sujet suivant, qui raconte l‟histoire d‟un homme qui, depuis qu‟il a été témoin d‟une apparition d‟ovni, voit tous les ans un triangle rouge se former sur son ventre : PPDA : alors dans le même ordre d‟esprit (.) il y a l’expérience du
docteur X (.) euh (.) vous nous avez apporté des preuves (.) qui sont très très convaincantes ça on va les voir (.) avant de les voir il faut que vous nous racontiez (.) ce qu‟est l’expérience de ce médecin
(« Ex Libris » du 08/03/1990, TF1)
Ici, c‟est clairement l‟acception 1 qui est actualisée : l‟expérience en question relève à coup sûr du vécu, et, comme une histoire, elle peut être « racontée » (tout de suite après, l‟animateur en parle comme de « l‟histoire qui lui est arrivée »). L'analyse des occurrences du terme expérience montre que les phénomènes dont traite le débat sur les parasciences sont souvent désignés comme des expériences : sujets des reportages, témoignages, comptes-rendus d‟expérimentations. Mais cette dénomination unique masque en fait l‟hétérogénéité de ce que chacun accepte comme moyen de preuve dans la polémique : du fait brut au fait verbalisé par les témoins, au fait hautement élaboré, nettement délimité par un protocole expérimental, chacun parle de sa réalité, et, partant, définit sa science, selon le degré d‟abstraction qu‟atteint la définition du fait.
La science des uns, la science des autres 237
2.4. Schéma général de discussion
Finalement, les désaccords fondamentaux qui opposent partisans et opposants des parasciences se traduisent également par un désaccord sur le schéma général de discussion qu‟il convient d‟adopter dans le débat. Même si tous semblent tomber d‟accord sur un prototype de discussion très général, une analyse plus fine fait apparaître de multiples polémiques sur l‟interprétation qu‟il convient d‟en faire. Ce modèle de discussion consensuel consiste, on l‟a vu au chapitre 8, en la succession de trois étapes : établissement des faits, explication du phénomène, recherche d‟éventuelles applications Cette structuration oppose assez nettement deux phases empi-riques, en amont (énoncé des faits) et en aval (applications éventuelles), à une phase d‟expérimentation et d‟interprétation des données qui met en jeu des considérations plus théoriques. Elle pose également la soumission de cette phase plus théorique au constat préalable, qui existe en soi et indépendamment du traitement qui doit en être fait. Chacune des trois étapes du modèle de discussion des para-sciences est assumée par des acteurs bien déterminés. La production des faits, dans tous les domaines du paranormal qui supposent l‟exercice d‟un don, est exclusivement le fait des détenteurs de ce don, qui sont en généralement bien distincts des scientifiques. La recherche d‟explication de ces phénomènes est systématiquement attribuée par les partisans des parasciences aux scientifiques – c‟est-à-dire, dans certains débats, à leurs adversaires. Cette sorte de division du travail est fréquemment explicitée par les partisans des parasciences, qui proposent ainsi à leurs adversaires potentiels un rôle non plus antagoniste, mais complémentaire. Ils n‟hésitent pas à se poser comme sujets psi ignorants de la nature des phénomènes qu‟ils produisent, et fort désireux de voir les scientifiques, détenteurs du savoir, mettre en oeuvre leur capacité d‟analyse. Ainsi, le mage Dessuart propose, dès le début du débat qui l‟oppose à Yves Galifret, une répartition des tâches qui respecte ce schéma : MD : nous les voyants nous sommes des sujets (.) on n‟est pas des
scientifiques et c‟est pas (.) possible pour nous qui n‟avons pas l‟information nécessaire de démontrer les mécanismes de ce genre de phénomènes (.) on en est sujets (.) l‟histoire l‟a assez prouvé il y a eu des milliers et des millions de voyances qui ont été le fait de (.) gens qu‟on appelle des voyants (.) et parfois de gens qui n‟étaient pas des voyants professionnels (.) ce qui est doublement intéressant (.) mais comment voulez-vous que nous (.)
238 Le débat immobile
expliquions ces choses-là nous n‟avons pas les armes pour ça on n‟est pas des scientifiques
(« Duel sur la Cinq » du 22/04/1988, la 5)
Cette répartition des rôles est entérinée par les quelques scienti-fiques qui acceptent de travailler sur les parasciences. Certaines émissions fonctionnent dans leur ensemble selon cette répartition des tâches : les invités non scientifiques sont présents comme témoins, pour attester des faits, alors que les scientifiques, qui font figure d‟experts, sont là pour les expliquer. La “division du travail” entre les acteurs du débat fait apparaître un paradoxe important du discours parascientifique – paradoxe qui est tout à fait assumé par les partisans des parasciences. On l'a vu, le paranormal – et les parasciences en général – se définissent fondamentalement par le fait que les phénomènes qui leur sont associés échappent au cadre explicatif de la science du moment. Ainsi, la voyante Maud Kristen définit la voyance par le fait qu'elle permet de « savoir des choses qui ne peuvent pas être interprétées psychologiquement » (« Ex Libris » du 01/10/1990). Plus significatif encore est l'avertissement qui précède chaque numéro de l'émission « Mystères » (titre qui déjà, en lui-même, illustre bien cette caractéristique des faits “para”), et qui s'achève par la phrase :
Aujourd'hui, ces mystères sont encore inexpliqués. (« Mystères », TF1)
Or, le fait que certains partisans des parasciences réclament une explication de ces phénomènes, et plus encore, qu'ils confient cette tâche à un groupe (la communauté scientifique) à laquelle, le plus souvent, ils n'appartiennent pas, revient à accepter que le caractère paranormal des phénomènes se dissolve au profit de la normalité scientifique, et à limiter leur propre rôle à la production des phénomènes (pour ceux qui mettent en jeu des fonctions psi). Cet aspect paradoxal du discours de certains partisans des parasciences rend improbable la lecture du débat qui propose de considérer systématiquement ces derniers comme de farouches défenseurs de l'irrationnel, fermement opposés à toute tentative de rationalisation des faits “para”. Revenons pour l'instant au schéma de discours des parasciences. C'est en s'y référant que les partisans des parasciences accusent leurs adversaires, et leur reprochent de faire dépendre l'établis-sement des faits de l'élaboration d'une explication. Déjà, le Quintus mis en scène par Cicéron demandait à ce que l'existence des faits, en matière de divination comme en toute autre matière, soit reconnue avant et indépendamment de leur explication :
Tu demandes pourquoi chacun de ces phénomènes se produit ? Très bien. Mais ce n'est pas de cela qu'il s'agit à présent : ce que nous examinons, c'est si les phénomènes se produisent ou non.
La science des uns, la science des autres 239
C'est comme si je disais que l'aimant est une pierre qui attire et entraîne le fer, sans pouvoir en donner la raison, et si tu niais que la chose puisse réellement se produire ! C'est ce que tu fais à propos de la divination : nous la voyons de nos yeux, nous en entendons parler, nous la trouvons dans nos lectures, nous l'avons reçue de nos pères. Les gens n'en ont pas douté dans la vie courante avant la découverte de la philosophie, qui est une invention récente ; et depuis son succès, aucun philosophe ayant de l'autorité n'en a jugé autrement. (De la divination…, XXXIX, 86 : 71).
On retrouve la même volonté de préserver l'indépendance des phases 1 et 2 du débat dans les formes modernes de la polémique. On a vu notamment comment l'astrologue Élisabeth Teissier reprochait à l'astronome Dominique Ballereau de partir de l'impossibilité d'un principe (on ne voit pas comment les astres pourraient avoir une influence sur les destins individuels) pour conclure à l'impossibilité des faits (donc les astres n'ont pas d'influence sur les destins individuels). De même, Bertrand Méheust, dans un extrait précédemment cité, met en regard les raisons théoriques et les constats empiriques :
Malgré une foule de bonnes raisons théoriques, les SV [soucoupes volantes], qui semblent faire peu de cas de notre avis, continuent d'apparaître régulièrement sur toute la surface du globe. (Science fiction et soucoupes volantes, Paris : Mercure de France, 1978 : 15)
Bien que les partisans des parasciences reprochent à leurs adver-saires de ne pas respecter la stricte succession des deux premières phases du modèle de discussion des parasciences, il leur arrive de violer ce modèle à leur tour, en passant directement à la troisième étape. Constatant la vanité du débat mais soucieux malgré tout de faire triompher leur point de vue, ils sont parfois tentés par une démarche pragmatique, et soulignent l'intérêt de leur discipline en faisant valoir ses éventuelles applications. À cette fin, c'est un véritable argument pragmatique qu‟emploie Quintus. Établissant un parallèle avec certaines médecines, dont on ne comprend pas l'action mais dont on constate les effets bénéfiques, il reconnaît ne pas savoir sur quels principes repose l'art divinatoire, mais affirme que cette ignorance n'hypothèque pas les bienfaits de la divination :
Je vois ce que peut la racine de la scammonée pour purger et ce que peut l'aristoloche ainsi nommée de celui qui la trouva le premier et qui en dut lui-même la découverte à un songe, contre les morsures de serpent : cela me suffit. Pourquoi ont-elles ces vertus ? Je ne le sais pas. Il en est de même pour les signes annonciateurs de vent et de pluie, dont j'ai parlé. Quelle en est l'explication ? Je ne le sais pas bien, mais je reconnais, vois et approuve l'effet et le résultat de ces signes. J'accepte de la même façon le sens d'une lésion dans la fressure d'une victime, celui des lobes de son foie : mais quant à la cause de tout cela, je n'en sais rien. (De la divination…, X, 16 : 32)
240 Le débat immobile
C'est ce même argument pragmatique qui sous-tend le discours de Rémy Chauvin à propos de la parapsychologie :
EP : Est-ce que vous voyez un avenir à la parapsychologie scientifique ? RC : Oui, et je ne vois qu'une orientation du travail : dans les applications. Les controverses continuelles que l'on connaît dans ce milieu ne servent à rien parce que l'on ne pourrait jamais forcer quelqu'un à croire ce qu'il ne veut pas croire. Toutes les discussions que l'on peut entendre à ce sujet n'ont rien de scientifique, ce sont des guerres de religion ! Mon excellent ami Rhine, le père de la parapsychologie, était un prédicateur protestant qui voulait convaincre les gens. Il n'y est pas arrivé et personne n'y arrivera jamais. On peut contourner ce problème inutile en cherchant directement les applications. (E. Pigani, « Rencontre avec Rémy Chauvin », Le Monde Inconnu 104 : 36)
À son interlocuteur, qui souligne le caractère inhabituel d'une telle démarche, Rémy Chauvin répond par une argumentation par le précédent :
EP : On applique donc des choses que l'on ne comprend pas vraiment... RC : Ce n'est de toute façon pas nouveau : la machine à vapeur a été inventée longtemps avant qu'on ne comprenne pourquoi elle marche comme ça... (id. : 36)
Les adversaires des parasciences protestent contre un tel boule-versement du schéma de discussion. Ainsi, on a vu que le non respect des trois étapes (établissement des faits, explication, applications) par l'instinctothérapeute Guy-Claude Burger entraînait le gastro-entérologie Jean-Pierre Bader sur le terrain de l'éthique médicale, où l'exercice de thérapeutiques non prouvées sur des patients constitue une faute particulièrement grave. Finalement, les considérations précédentes sur le respect ou le non respect d'un schéma général de discussion dans le débat sur les parasciences amène à se demander s'il est possible d'éviter que ce débat ne s'enlise. En effet, si les participants du débat respectent ce schéma, ils risquent bien de buter sur l'établisse-ment des faits. L'absence d'accord sur ce problème amène peu à peu le débat vers la recherche de critères d'établissement des faits, puis, montant encore d'un degré dans la généralité, vers la recherche de critères de scientificité et d'une définition consen-suelle de la science – recherche qui, comme on l'a vu, est géné-ralement unilatérale, et non construite en collaboration par les interactants. Si les débatteurs décident au contraire de transgresser le schéma de discussion, d'autres problèmes surgissent. Lorsque les parti-sans des parasciences demandent aux scientifiques de travailler à l'explication des faits, alors que l'existence même de ces faits
La science des uns, la science des autres 241
n'est pas accordée, leurs adversaires les accusent de pétition de principe ; et aucune discussion saine ne peut naître d'un tel sophisme. Inversement, l'établissement d'un lien entre explication et établissement d'un phénomène par les opposants aux parasciences fait peser sur eux un soupçon de partialité ; et il est difficile de poursuivre une discussion dont l‟un des participants est soupçonné de mauvaise foi. Enfin, l'évocation par les partisans des parasciences d'éventuelles applications soulève le tollé général chez leurs adversaires, pour qui une telle démarche est un symptôme clair d'irresponsabilité. Ceci signifie-t-il que le débat public sur les parasciences est inexorablement voué à l'échec ? Ici encore, les positions argumentatives dans la controverse déterminent deux réponses différentes. Alors que toute la rhétorique mise en place par les partisans des parasciences affiche un optimisme résolu, et insiste sur l'idée que le triomphe de leur point de vue n'est qu'une question de temps (appel à Galilée), les opposants des parasciences font preuve, pour leur part, d'un pessimisme marqué. Si les partisans des parasciences mettent en avant les ennemis de naguère à présent gagnés à leur cause (figure du converti), les opposants aux parasciences posent l'impossibilité de convaincre leurs interlocuteurs, et soulignent la vanité du débat. Ce pessimisme est particulièrement notable sous la plume de Michel Rouzé, qui est pourtant le chantre de la lutte contre les parasciences:
Dans le discours obscurantiste, les mots ne correspondent pas à des concepts définis ; ils valent par le vertige qu‟ils engendrent. Dès lors les contradictions n‟ont aucune importance. Combattre le charlatanisme sur le terrain du débat rationnel est une lutte décevante. (AFIS n°196 : 20).
Raisonner avec les astrologues, soutenait Paul Couderc, rapportant les propos désabusés d‟un collègue, c‟est boxer un oreiller de plume : on l‟enfonce en un point, il se regonfle ailleurs. (« L‟astrologie déguisée en astronomie », Science & Vie n°887, août 1991 : 22.)
Plus généralement, les commentaires des acteurs du débat sur les parasciences évoquent l‟incommensurabilité des deux points de vue : la controverse est fréquemment qualifiée de “dialogue de sourds”, ce qui suppose l‟impossibilité d‟une discussion critique et constructive sur le sujet. L‟impossible résolution du désaccord sur l‟établissement des phénomènes “para”, qui témoigne de l‟existence de deux modes de rationalisation bien distincts chez les partisans et les opposants des parasciences, hypothèque lourdement toute résolution satisfaisante de la polémique.
242 Le débat immobile
3. DEUX MODES DE RATIONALISATION
Au terme de cette analyse, il est possible de dégager sommaire-ment deux grands modes de rationalisation à l‟oeuvre dans le débat médiatique sur les parasciences. Ces deux modes de ratio-nalisation se traduisent par l‟existence de deux conceptions opposées de la science chez les défenseurs et les adversaires des disciplines parascientifiques.
3.1. La science des adversaires des parasciences
La science à laquelle se réfèrent les adversaires des parasciences est une science comprise comme une élaboration théorique, abstraite, permettant de rendre compte le mieux possible du réel en fonction d‟une problématique donnée, et non comme un substitut ou un miroir objectif de ce réel. Cette science doit se former « contre la Nature, contre ce qui est, en nous et hors de nous, l‟impulsion et l‟instruction de la Nature, contre l‟entraî-nement naturel, contre le fait coloré et divers » (Bachelard 1977 : 23). Elle doit se défier de l‟expérience immédiate, qui, paradoxalement, fait la part belle à la subjectivité, alors qu‟une expérience qui s‟inscrit dans un cadre théorique hypothétique garantit par là même un minimum d‟objectivité. Pour Bachelard, la connaissance scientifique se construit donc non pas seulement parallèlement, mais contre la connaissance sensible. Elle doit admettre que la connaissance empirique ne peut « demeurer dans le plan de la connaissance rigoureusement assertorique en se cantonnant dans la simple affirmation des faits. Jamais la description ne respecte les règles de la saine platitude » (id. : 44). Et puisque l‟observation est en partie conditionnée par un certain nombre de présupposés liés aux attentes de l‟observateur, à ses connaissances, à ce qu‟il considère comme acceptable ou inacceptable, autant essayer de maîtriser l‟influence que ces présupposés peuvent avoir sur l‟observation et poser au départ la dépendance nécessaire entre établissement des faits et théorie. La distinction établie par Chalmers entre rationalisme et empirisme permet de préciser encore la conception de la science des adversaires des parasciences :
Les êtres humains, en tant qu‟individus, disposent de deux façons d‟acquérir une connaissance sur le monde : la pensée et l‟observation. Si nous privilégions le premier mode sur le second, nous obtenons une théorie rationaliste classique de la connaissance, et dans le cas contraire, l‟empirisme. (1987 : 186-187)
La science des uns, la science des autres 243
Les opposants aux parasciences, rappelant sans cesse que l‟observation est gouvernée (et les faits produits) par la théorie, se situent clairement du côté du rationalisme. Cette prédominance accordée aux concepts sur les jugements de faits peut conduire à des situations extrêmes, dans certaines controverses scientifiques. C‟est ce que met en évidence Stengers à propos de la polémique sur la mémoire de l‟eau. Pour elle, cette controverse révèle une conséquence de la méfiance envers l‟observation, lorsqu‟elle est poussée à l‟extrême : elle illustre le fait que dans certains cas, les “faits” perdent toute pertinence, et que seule une théorie peut défier une autre théorie :
Les épistémologues “anti-empiristes” avaient combattu, à force d‟exemples, la thèse selon laquelle un fait a, en droit, le pouvoir de faire s‟écrouler un édifice théorique. L‟impuissance du fait tend désormais à prendre valeur de règle. Les épistémologues avaient montré que les scientifiques ne traitent pas également tous les faits, quels qu‟ils soient. Bientôt peut-être certaines revues scientifiques énonceront-elles, en tant que règle officielle, qu‟elles n‟acceptent plus de publier que les “bons” faits, ceux qu‟une théorie plausible autorise. (1989b : 8-9)
Cette position, que l‟auteur qualifie de “anti-empiriste”, va à l‟encontre du falsificationnisme popperien, pose de nouvelles règles pour les controverses scientifiques et « ne conçoit le changement que comme lutte entre cadres conceptuels, que comme combat où la nature sera requise pour faire la différence, mais où seuls ont l‟initiative les concepts, les hypothèses, les problèmes » (id. : 20-21).
3.2. La science des partisans des parasciences Face à ces anti-empiristes (qui, dans un cadre non polémique, récuseraient peut-être ces positions extrêmes, mais qui sont poussés par la logique de la controverse à les faire leurs au cours du débat) se trouvent les partisans des parasciences, auxquels leurs adversaires reprochent de s‟en tenir à un empirisme radical, et de s‟accommoder trop aisément de l‟absence de théorie. La position des partisans des parasciences, telle qu‟elle se reflète dans le débat médiatique, semble relever de l‟attitude stigmatisée par Popper sous le nom de “théorie de l‟esprit seau”, et sur laquelle il revient en détail dans la connaissance objective :
La théorie que le sens commun se fait de la connaissance est simple. Si vous et moi voulons connaître quelque chose d‟encore inconnu à propos du monde, nous devons ouvrir l‟oeil, et regarder. Et nous devons tendre l‟oreille, et écouter les bruits, tout particulièrement ceux émis par les autres gens. Nos différents sens sont donc nos sources de connaissance – les sources, ou les entrées vers nos esprits. J‟ai souvent qualifié cette théorie de théorie de l‟esprit seau. (...) Notre esprit est un seau, vide à l‟origine – ou plus ou moins vide – et les matériaux entrent dans ce seau par la
244 Le débat immobile
voie de nos sens (...). [Selon cette théorie, ] Il existe une connaissance directe ou immédiate : i.e. les éléments d‟information purs et non adultérés qui sont parvenus jusqu‟à nous et ne sont pas encore digérés. Aucune connaissance ne pourrait être plus élémentaire et certaine que celle-ci (...) La connaissance qui dépasse la pure réception des éléments donnés est donc toujours moins certaine que la connaissance donnée élémentaire, laquelle constitue, en effet, l‟étalon de la certitude. (1978a : 72-73)
Cette conception de la connaissance, appliquée à la connaissance scientifique, donne naissance à ce que Chalmers (1987 : 23) appelle l‟inductivisme naïf, selon lequel un observateur doté d‟organes sensoriels en état de bon fonctionnement et dépourvu de préjugé garantit des énoncés d‟observations susceptibles de servir de base à des théories scientifiques.
Dans le débat médiatique sur les parasciences, la position des partisans de ces disciplines repose le plus souvent sur ce type de définition de l‟observation et de la connaissance. Elle s‟apparente à ce que Schlanger (1989 : 59) décrit comme la conception baconienne de l‟activité scientifique, réduite à une « cueillette des faits », et qui nie le rôle des concepts et des représentations théoriques dans l‟organisation de la recherche. Il semble que les positions qui s‟affrontent dans la querelle qui oppose créationnistes et évolutionnistes soient assez proches :
Creationism, when examined as a belief system, reflects a striking commitment to the assumptions and procedures of the first scientific revolution and is grounded in the epistemology of seventeenth and eighteenth century inductivism. (...) It is clear that there is a close alliance with the epistemic commitments of Baconianism, tempered with the Scottish Common Sense Realism of Thomas Reid. (...) True science, from this perspective, abandons metaphysical flights of fancy in favor of close empirical observation and strict processes of induction from those observations. (..) Science, in this view, is very much a universal, even egalitarian, human capacity. Human beings are said to be compelled by human nature to accept certain beliefs, including the existence of the external world and the consistency of one‟s perceptions of it. Since such beliefs are said to be almost universal, arguments from evidence of careful observations can attain as much objective (read : scientific) certainty as the human race can ever hope to attain. (Taylor 1991 : 1082)
Outre la similitude qui apparaît entre les images de la science mises en oeuvre dans le débat sur les parasciences et dans le débat dont Taylor a fait son objet d‟étude, l‟analyse que propose l‟auteur de ce néo-baconianisme souligne un fait crucial : le caractère égalitaire de cette conception de la science. Ce trait est évident dans les divers appels à l‟expérience lancés par les partisans des parasciences, qui font du destinataire l‟égal du
La science des uns, la science des autres 245
meilleur scientifique pour juger de l‟existence des phénomènes “para”. Alors que les “rationalistes” ne font que creuser davantage le fossé qui existe entre les scientifiques d‟une part, et le vulgus de l‟autre, les partisans des parasciences insistent sur la continuité qui existe entre sens commun, connaissance immédiate et connaissance scientifique. Ce point constitue un atout considérable pour les partisans des parasciences, puisque comme le souligne Bachelard, le réaliste a toujours un avantage sur le théoricien :
Entendez argumenter un réaliste : il a immédiatement barre sur son adversaire, parce qu‟il a, croit-il, le réel pour lui, parce qu‟il possède la richesse du réel tandis que son adversaire, fils prodigue de l‟esprit, court après de vains songes. (1977 : 131)
De façon plus générale encore, le discours des partisans des parasciences laisse apparaître ce que Boudon appelle les a priori de l‟épistémologie ordinaire. Cette épistémologie est présente dans la plupart des discours non formels : elle n‟est donc pas caractéristique du discours des partisans des parasciences. Mais elle est en revanche absente (ou masquée) dans le discours de leurs adversaires, qui adoptent une épistémologie savante, de philosophes. Une telle épistémologie recherche l‟abstraction, se définit contre le sens commun, et n‟hésite pas à aller à l‟encontre de propositions comme “tout a une cause”, “la connaissance est le miroir de la nature”, “tout a un sens” (propositions qui sont autant d‟exemples d‟a priori épistémologiques selon Boudon) (1990 : 231). Cet empirisme radical dont font preuve les partisans des para-sciences tranche parfois bizarrement sur les connotations spiri-tualistes de certaines des disciplines qu‟ils défendent. Ainsi, le spiritisme, qui a quitté aujourd‟hui le devant de la scène mais qui a connu un engouement extraordinaire à la fin du siècle dernier, visait la réconciliation entre science et religion. Aujourd‟hui encore, Boy & Michelat (1984), parmi d‟autres, voient dans les parasciences un « projet de réconciliation entre spiritualisme et rationalisme ». Finalement, considérer le débat sur les parasciences comme la lutte entre la science et la magie, le rationnel et l‟irrationnel, est au mieux non pertinent, puisqu‟une telle analyse n‟apporte aucune lumière nouvelle sur la question, et ne fait que repro-duire relativement fidèlement la vision du débat propre aux opposants des parasciences. Au pire, une telle analyse est tout simplement inexacte : à moins de soupçonner systématiquement les partisans des parasciences de mauvaise foi, et de voir dans leur discours un stratagème systématisé visant à leurrer l‟auditoire,
246 Le débat immobile
l‟analyse de leur position dans le débat fait apparaître un processus de rationalisation des phénomènes qui, s‟il n‟est pas immédiatement superposable avec la rationalisation scientifique de l‟univers telle qu‟elle est majoritairement définie par les scientifiques ou les épistémologues, n‟en a pas moins sa propre cohérence. Comme le dit Fischler,
Il nous faut bien admettre [...] que l‟affrontement entre astrologie et rationalisme anti-astrologisme n‟est nullement le choc de la rationalité contre l‟irrationnel, de la raison contre l‟obscurantisme, mais la collision de deux rationalisations contradictoires. (Préface à Morin (éd.) 1981 : 31)
À cet égard, la position de Taylor (1991) sur la polémique entre créationnistes et évolutionnistes est éclairante. Plutôt que d‟établir a priori des critères de scientificité, il suggère d‟analyser la construction rhétorique des images de la science au cours du débat :
In this spirit, the view of demarcation developed here holds that the social meaning of science is rhetorically constructed in and through the argumentative discourses of scientists as they defend particular interests in localized controversies. Consciously or otherwise, they construct working definitions of science which serve to exclude non- or pseudo-sciences in order to enhance their own cognitive authority and to maintain a variety of professional interests. (...) Understood in this way, demarcation is not a matter of the application of timeless or transcendant epistemic markers. Rather, it is a practical matter of rhetorical negotiation accomplished in and through processes of scientific argument. (...) Scientific argument is more than merely reflective of particular tacit understandings of science. Indeed, it is productive of those understandings insofar as competing understandings are bartered in scientific controversy. (1991 : 1080-1081)
Cette position l‟amène à critiquer l‟analyse généralement proposée par les adversaires des créationnistes, qui accusent ces derniers de ne “mimer” la science que pour mieux gagner l‟auditoire à des causes qui elles, n‟auraient rien de scientifique. Pour Taylor, l‟analyse rhétorique fait au contraire apparaître que la position des créationnistes s‟organise autour d‟une conception de la science qui leur est propre – et qui, on l‟a dit, est relativement proche de celle défendue par les partisans des parasciences. Il ne s‟agit pas pour autant d‟adhérer au discours créationniste, ni même de lui reconnaître une quelconque légitimité ; il s‟agit simplement de reconstituer la cohérence qui le sous-tend afin de mieux le comprendre pour, éventuellement, mieux s‟y opposer. Les réflexions de Taylor sur la querelle entre créationnistes et évolutionnistes sont directement applicables au débat sur les parasciences. Dans ce travail, on a cherché avant tout à éviter le
La science des uns, la science des autres 247
piège mis à jour par Taylor, et à ne pas chercher à appliquer des critères de scientificité définis “hors débat” afin d‟identifier et de figer les positions de chacun. De plus, considérer les partisans des parasciences comme les portefaix de l‟obscurantisme semble peu compatible avec ce qu‟on observe dans leurs discours même. En effet, comme le notent Boy & Michelat dans l‟analyse de leur sondage de 1984 sur la croyance des Français dans les parasciences,
la majorité des croyants estime en même temps qu‟il y aura, un jour, une explication scientifique de ces phénomènes ; signe, sans doute, que dans le système des représentations sociales il n‟y a pas de discontinuité entre l‟univers proprement scientifique et celui des parasciences. (1984 : 1561)
Cette confiance dans une explication scientifique à venir se traduit dans le discours des partisans des parasciences par un hyper-positivisme parfois surprenant. Ainsi, l‟animateur de « Mystères », Alexandre Baloud, clôt l‟émission du 08/07/1992 en reprenant les termes du journaliste Jean-Yves Casgha, et conclut sur la formule : AB : il n‟y a pas de paranormal pour moi il n‟y a que du normal (.)
pas expliqué (.) il faut que cette discipline euh vraiment devienne une science (.) et non plus euh (.) une activité maudite
(« Mystères » du 08/07/1992, TF1)
De même, le Dr Jean-Pierre Kauffman, au terme d‟une émission sur la morphopsychologie, lance cette profession de foi : JPK: je pense que (.) tout ce qui n‟a pas été démontré peut quand
même l‟être dans l‟avenir (« Français si vous parliez » du 08/04/1993, France 3)
Il est préférable d‟éviter de partir d‟hypothèses sur les intentions des divers acteurs du débat : c‟est pourquoi on ne verra pas dans cet hyper-positivisme une stratégie machiavélique et délibérée pour attirer la bienveillance de l‟auditoire, mais l‟indice d‟une conception particulière du processus de connaissance. Une approche rhétorique du problème permet donc de mettre en évidence l‟existence de deux modes de rationalisation bien distincts, qui relèvent de deux conceptions historiquement et philosophiquement identifiées de la science. Il est probablement un peu abusif d‟affirmer que chaque acteur du débat peut se reconnaître dans une de ces deux définitions de la science. Il se peut fort bien que dans leurs pratiques quotidiennes, hors de tout cadre polémique, chacun soit capable de développer une analyse de la démarche scientifique nuancée, fort différente de celle qu‟il adopte dans le feu de la controverse. Mais dans le cadre des diverses querelles qui constituent le débat médiatique sur les parasciences, les positions se radicalisent et s‟opposent
248 Le débat immobile
catégoriquement, pour se rallier à l‟une ou l‟autre des conceptions de la science présentées précédemment.
Conclusion
Au terme de cette réflexion, le débat médiatique sur les para-sciences montre finalement certaines caractéristiques par rapport auxquelles les comportements de ceux qui y participent trouvent leur cohérence. La première de ces caractéristiques est l‟asymétrie que le débat introduit, dès le départ, entre partisans et adversaires des para-sciences, à travers le rapport du thème aux territoires conversationnels, rapport qui favorise fortement les premiers. Cette asymétrie constitutive est encore renforcée au cours de la discussion par des négociations sur le droit à la parole des débatteurs, souvent remportées par les partisans des parasciences. Par ailleurs, l‟exercice d‟une importante activité de vulgarisation permet aux défenseurs des parasciences de se poser comme intermédiaires entre un savoir spécialisé (scientifique ou parascientifique) et un public profane. Outre la valeur taxémique attachée à la production d‟énoncés de vulgarisation, l‟activité vulgarisatrice, appliquant les mêmes mécanismes discursifs aux deux domaines scientifique et parascientifique, gomme la frontière entre ces deux types de savoirs.
Une autre asymétrie apparaît dans les images que chacune des parties propose du débat. La schématisation construite par les adversaires des parasciences, qui repose sur une rhétorique de dénonciation, est essentiellement défensive. Elle ne se définit que par opposition aux défenseurs des parasciences. De plus, l‟image qu‟elle renvoie de la cible des opposants aux parasciences (c‟est-à-dire de la partie de l‟auditoire favorable aux parasciences) est teintée de mépris, puisqu‟elle voit en eux des “gogos”. En revanche, la schématisation élaborée par les partisans des parasciences, décrite sous le nom d‟appel à Galilée, est cohérente. Exploitant une figure extrêmement populaire de l‟histoire des sciences, elle propose une grille de lecture qui permet d‟interpréter tous les éléments du débat, y compris le discours des adversaires, en des termes favorables aux parasciences. La distance qui sépare les schématisations des deux camps est en partie responsable de « l‟incompréhension réciproque parfaite-ment régulière » (Maingueneau 1983b : 23) que l‟on observe dans le débat. Chacun ne peut avoir accès directement au discours de son adversaire, et ne le comprend qu‟à travers
250 Le débat immobile
l‟interprétation qu‟il construit de l‟affrontement. La rhétorique de l‟épouvantail, aussi bien que l‟appel à Galilée, figent le débat, et manifestent que la polémique sur les parasciences tend inexorablement vers une sorte de débat immobile, bien peu susceptible de provoquer des mouvements dans les opinions. Ces interprétations divergentes du débat se reflètent également dans l‟incapacité des débatteurs à tomber d‟accord sur les faits, sur les moyens de les établir, et sur les règles à respecter dans la discussion. Cette incapacité est révélée par l‟échec des négocia-tions qui prolifèrent afin d‟établir les critères de preuve admis par les deux parties : – discussions cherchant à établir un protocole d‟expérimentation en vue d‟évaluer l‟existence des phénomènes ou de l‟efficacité des pratiques. Si les moyens de preuve ne sont pas à proprement parler discursifs (ils reposent sur une série de manipulations, sur un appareillage technique, etc.), la discussion de ces moyens de preuve relève pleinement de l‟argumentation. – discussions sur les schèmes argumentatifs admis dans un débat rationnel. Les discours manifestent l‟existence d‟une compétence argumentative chez les locuteurs, qui comporte un versant normatif permettant aux locuteurs d‟évaluer les arguments produits dans un débat, et éventuellement de les investir dans des séquences réfutatives méta-argumentatives. Finalement, ce que le débat médiatique sur les parasciences fait apparaître, c‟est que la notion de “fait” n‟est pas la même chez les partisans des parasciences et chez leurs adversaires. Les premiers admettent volontiers l‟idée d‟une expérience immédiate, accessible directement à l‟expérimentateur qui se réduit à un simple témoin. Pour les seconds, l‟expérience est nécessairement déjà théorisée, prise dans un réseau d‟hypothèses dans lequel elle prend sens. Plus encore que le concept de “science”, c‟est le rapport même à la réalité qui est en jeu. Ces caractéristiques du débat sont apparues à l‟analyse minutieuse du corpus. Il convient toutefois d‟en limiter la portée, en précisant qu‟elles ne concernent que le débat médiatique sur les parasciences. Le travail présenté ici ne prétend pas rendre compte de toutes les discussions possibles sur les parasciences, des interventions en colloque aux discussions entre amis en passant par les mises au point de protocoles d‟expérimentations entre experts dans des laboratoires. La télévision – et, plus géné-ralement, les médias – font peser des contraintes importantes sur la production des discours. Le caractère médiatique des interac-tions analysées ici est peut-être en partie responsable de l‟échec
Conclusion 251
des négociations entre scientifiques et parascientifiques qui y sont parfois initiées : exacerbation des faces et des susceptibilités liée au caractère public du débat, nécessaire superficialité des discussions, justifiée par l‟incompétence supposée de l‟auditoire, priorité donnée au principe de plaisir sur le principe de sérieux (Charaudeau 1991 : 17-18). Il faudrait encore confron-ter l‟analyse proposée ici à celle d‟autres types de débats sur le sujet, afin de faire la part du caractère médiatique des inter-actions dans l‟argumentation. Par ailleurs, le corpus médiatique analysé ici est limité dans le temps. La plupart des émissions et articles traités ont été diffusés entre 1988 et 1993, à une époque où le débat sur les parasciences était omniprésent dans les médias. A suivi une période pendant laquelle les débats ont fait place à des émissions non polémiques, mêlant reportages et plateaux, comme « Mystères » ou « l‟Odyssée de l‟étrange ». Au cours de « l‟Odyssée de l‟étrange » du 26 février 1996, l‟animateur Jacques Pradel, après une séquence de reportage posant la possibilité, pour des morts, de communiquer avec les vivants par le biais des postes de télévision, adresse à un de ses invités la question suivante : JP : et alors est-ce que vous avez réfléchi euh (.) euh pour savoir si on
peut les attribuer (.) vraiment (.) à des voix donc de de disparus ou si ça n‟est pas un phénomène parapsychologique avec les guillemets de (.) de rigueur provenant des personnes mêmes qui font l‟expérience ?
(« L‟Odyssée de l‟étrange », 26 février 1996, TF1)
Cette question illustre bien l‟opération de “réduction des possibles” qui accompagne le passage du format “débat télévisé” au format “talk show avec reportage”, puisque l‟alternative se limite à deux hypothèses paranormales. Aujourd‟hui, l‟immense succès rencontré par la diffusion de la série « X Files » (« Aux frontières du réel », M6) renoue avec la tradition bien ancrée du traitement fictionnel des phénomènes paranormaux à la télévision. « X Files » met en scène un simulacre de débat au sein même de la fiction, puisqu‟aux deux protagonistes principaux sont associés des positions argumenta-tives divergentes sur les phénomènes paranormaux – l‟agent Mulder croyant fermement à leur existence, et en particulier, aux ovnis, et l‟agent Scully incarnant une rationaliste sceptique, mais à l‟esprit ouvert. Actuellement, le traitement médiatique des parasciences dans le cadre de véritables débats se fait relativement rare ; pourtant, la plupart des arguments identifiés dans les débats analysés ici réapparaissent à l‟identique dans les émissions de type “reportage” ou “fiction” traitant des parasciences.
252 Le débat immobile
De plus, les quelques incursions proposées ici du côté de Cicéron ou de Jean Calvin suggèrent que, en dehors de quelques lignes argumentatives historiquement marquées (argumentations stoïciennes chez Cicéron, argumentations proprement religieuses chez Calvin), un nombre important d‟arguments visant à établir ou à discréditer les parasciences témoignent d‟une permanence historique tout à fait remarquable. Ces observations argumentent en faveur d‟une relative immuabilité du débat sur les parasciences, puisqu‟au cours de l‟histoire sont avancés les mêmes arguments, qui rencontrent toujours les mêmes objections. D‟un camp à l‟autre, rien ne convainc de façon durable, rien ne réfute de façon décisive : c‟est bien, de ce point de vue encore, un débat immobile.
ANNEXE
Liste des émissions télévisées du corpus
• « Duel sur la Cinq » du 15/04/1988 (“la parapsychologie”), la 5 • « Duel sur la Cinq » du 22/04/1988 (“la voyance”), la 5 • « Duel sur la Cinq » du 18/05/1988 (“la dianétique”), la 5 • « Duel sur la Cinq » du 10/06/1988 (“l‟astrologie”), la 5 • « Duel sur la Cinq » du 15/06/1988 (“l‟instinctothérapie”), la 5 • « Duel sur la Cinq » du 01/07/1988 (“la morphopsychologie”), la
5 • « Duel sur la Cinq » du 11/08/1988 (“la numérologie”), la 5 • « Duel sur la Cinq » de mai 1990 (“la sorcellerie”), la 5 • « Duel sur la Cinq » du 13/09/1990 (“Nostradamus et la guerre
du Golfe”), la 5 • « Duel sur la Cinq » du 01/10/1990 (“la vie après la mort”), la 5 • « Ciel mon mardi » du 27/11/1990 (“les voyants”), TF1 • « Ex Libris » du 08/03/1990 (“avons-nous un sixième sens ?”),
TF1 • « Ex Libris » du 01/10/1990, TF1 • « Mardi soir » du 15/10/1991 (“la voyance et la sorcellerie”),
France 2 • « Star à la barre » du 09/05/1989 (“la parapsychologie et le
surnaturel”), France 2 • « Mystères » du 08/07/1992, TF1
254 Le débat immobile
• « Santé à la Une » du 04/01/1993 (“l‟astrologie et votre santé”), TF1
• « Bas les masques » du 09/03/1993, France 2 • « Français si vous parliez » du 08/14/1993 (“la
morphopsychologie”), France 3 • « Français si vous parliez » du 20/05/1993 (“la cartomancie”),
France 3 • « Savoir plus » du 20/05/1993 (“la cartomancie”), France 2 • « Durand la nuit » du 11/05/1993 (“les voyants”), TF1 • « Nulle part ailleurs » du 30/09/1993 (invité : Henri Broch),
Canal +
BIBLIOGRAPHIE
ALBERTINI Jean-Marie & BELISLE Claire
1988 : « Les fonctions de la vulgarisation scientifique et technique », in JACOBI & SCHIELE (éds) 1988 : 225-245.
ALCOCK James E. 1989 : Parapsychologie : science ou magie ?, Paris : Flammarion.
ALFONSI Philippe 1989 : Au Nom de la science, Paris : Barrault-Taxi.
ANDRE-LAROCHEBOUVY Danielle 1984 : La Conversation quotidienne. Introduction à l'analyse
sémio-linguistique de la conversation, Paris : Didier Erudition.
APHEK Edna & TOBIN Yishai 1989 : The Semiotics of Fortune-telling, Amsterdam / Philadelphia :
John Benjamins.
AUTHIER-REVUZ Jacqueline 1982 : « La Mise en scène de la communication dans les discours
de vulgarisation scientifique », Langue Française 53 : 34-47.
BACHELARD Gaston 1977 : La Formation de l'esprit scientifique. Contribution à une
psychanalyse de la connaissance objective, Paris : Vrin.
BARTHES Roland 1978 : Leçon, Paris : Seuil.
BENSAUDE-VINCENT Bernadette 1985 : « France : un accueil difficile », in DELIGEORGES (éd.),
Le Monde quantique, Paris : Seuil, p.67-80.
256 Le débat immobile
BLACKBURN Pierre 1992 : Connaissance et argumentation, Ottawa : ERPI.
BOISSINOT Alain 1992 : Les Textes argumentatifs, Toulouse : Bertrand-Lacoste /
C.R.D.P. Toulouse.
BOUDON Raymond 1990 : L'Art de se persuader des idées douteuses, fragiles ou
fausses, Paris : Fayard.
BOUGNOUX Daniel 1991 : La Communication par la bande, Paris : La Découverte.
BOUVERESSE Renée 1981 : Karl Popper , Paris : Vrin.
BOY Daniel & MICHELAT Guy 1984 : « Les Français et les parasciences », La Recherche 161 :
1560-67.
CARO Paul 1990 : La Vulgarisation scientifique est-elle possible ?, Nancy :
Presses Universitaires de Nancy.
CHALMERS Alan F. 1987 : Qu'est-ce que la science ? Popper, Kuhn, Lakatos,
Feyerabend, Paris : La découverte.
CHARAUDEAU Patrick 1991 : « Contrats de communication et ritualisations des débats
télévisés », in CHARAUDEAU (éd.), La Télévision. Les débats culturels « Apostrophes », Paris : Didier érudition, p.11-34.
CHEVALIER Gérard 1986 : « Parasciences et procédés de légitimation », Revue
française de sociologie 27-2 : 205-219.
COLLINS Harry M. & PINCH Trevor J. 1991 : « En parapsychologie, rien ne se passe qui ne soit
scientifique », in CALLON & LATOUR (éds), La Science telle qu'elle se fait. Anthologie de la sociologie des sciences de langue anglaise, Paris : La Découverte, p. 297-343.
1994 : Tout ce que vous devriez savoir sur la science, Paris : Seuil.
CURTIUS E. R. 1956 : La Littérature européenne et le Moyen-Age latin, Paris :
Presses Universitaires de France.
DELON Michel
Bibliographie 257
257
1988 : L'Idée d'énergie au tournant des Lumières (1770-1820), Paris : Presses Universitaires de France.
DOS SANTOS José R. 1986 : « Les Médecines populaires ne rejoignent pas les
parallèles », Autrement 85 : 26-34.
DOURY Marianne 1994 : Analyse de l‟argumentation dans le débat autour des
“parasciences”, Thèse de doctorat, Université Lumière-Lyon 2.
1995 : « “Duel sur la Cinq” : dilogue ou trilogue ? », in Kerbrat-Orecchioni & Plantin (éds), Le Trilogue, Lyon : Presses Universitaires de Lyon, p. 224-249.
DUCROT Oswald 1983 : « Opérateurs argumentatifs et visée argumentative », Cahiers
de linguistique française » 5 : 7-36.
EBEL Marianne & FIALA Pierre 1981 : « La Situation d'énonciation dans les pratiques
argumentatives », Langue Française 50 : 53-74.
ECO Umberto 1985 : « La Mystique de Planète », in La Guerre du faux, Paris :
Grasset, p. 119-125.
ELZIERE Pierre 1986 : « Des Médecines dites naturelles », Sciences sociales et
santé IV-2 : 39-73.
FAVRET-SAADA Jeanne 1977 : Les Mots, la mort, les sorts. La sorcellerie dans le Bocage,
Paris : Gallimard.
FLAHAULT François 1978 : La Parole intermédiaire, Paris : Seuil.
FOGELIN Robert J. 1982 : Understanding arguments. An introduction to informal
logic, New York : Harcourt Brace Jovanovich.
FUCHS Catherine 1982 : « La Paraphrase. Entre la langue et le discours », Langue
Française 53 : 22-33.
GOVIER Trudy 1985 : A Practical study of argument, Belmont : Wadsworth.
GRIZE Jean-Blaise 1990 : Logique et langage, Paris : Ophrys.
GROUPE DE REFLEXION « MEDECINES DIFFERENTES »
258 Le débat immobile
1986 : Les Médecines différentes, un défi ? (Rapport au ministère des affaires sociales et de la solidarité nationale et au secrétariat d'Etat chargé de la santé), Paris : La Documentation française.
GUILBERT Louis 1973 : « La Spécificité du terme scientifique et technique »,
Langue française 17 : 5-17.
JACOBI Daniel 1987 : Textes et images de la vulgarisation scientifique, Berne :
Peter Lang. 1988 : « Le Discours de vulgarisation scientifique. Problèmes
sémiotiques et textuels », in JACOBI & SCHIELE (éds) 1988 : 87-117.
JACOBI Daniel & SCHIELE Bernard (éds) 1988 : Vulgariser la science. Le procès de l'ignorance, Seyssel :
Champ Vallon.
KAPFERER Jean-Noël 1990 : Rumeurs. Le plus vieux média du monde, Paris : Seuil.
KAPFERER Jean-Noël & DUBOIS Bernard 1981 : Echec à la science. La survivance des mythes chez les
Français, Paris : Nouvelles éditions rationalistes.
KAUFMANN Alain 1993 : « L‟Affaire de la mémoire de l‟eau. Pour une sociologie de
la communication scientifique », Réseaux 58 : 67-89.
KERBRAT-ORECCHIONI Catherine 1978 : « Déambulation en territoire aléthique », in Stratégies
discursives (Actes du colloque du centre de recherches linguistiques et sémiologiques de Lyon. 20-22 mai 1977) (collectif), Lyon : Presses Universitaires de Lyon, p. 53-102.
1980 : L'Enonciation. De la subjectivité dans le langage, Paris : Armand Colin.
1984 : « Les Négociations conversationnelles », Verbum t.VII fasc.2-3 : 223-243.
1990 : Les Interactions verbales 1, Paris : Armand Colin. 1992 : Les Interactions verbales 2, Paris : Armand Colin.
KOYRE Alexandre 1966 : Etudes galiléennes, Paris : Hermann.
LATOUR Bruno 1984 : Les Microbes. Guerre et paix Suivi de Irréductions, Paris :
A.M. Métailié. 1989 : La Science en action, Paris : La Découverte.
Bibliographie 259
259
LATOUR Bruno & WOOLGAR Steve 1988 : La Vie de laboratoire. La production des faits scientifiques,
Paris : La Découverte.
LEGRAND Jean-Louis & PRAYEZ Pascal 1986 : « L'Utopie de la médecine idéale », Autrement 85 : 12-21.
LEVY-LEBLOND Jean-Marc 1984a : « Science et connaissance », in Tubiana, Pelicier &
Jacquard (éds), Images de la science, Paris : Economica, 1984 : 15-21.
1984b : L'Esprit de sel - Science, culture, politique, Paris : Seuil.
LUNDQVIST Lita 1991 : « How and when are written texts argumentative ? », in van
EEMEREN, GROOTENDORST, BLAIR & WILLARD (éds), Proceedings of the second international conference on argumentation. June 19-22, 1990, Amsterdam : SICSAT : ISSA, p. 639-646.
MAINGUENEAU Dominique 1983a : Initiation aux méthodes de l'analyse du discours, Paris :
Hachette. 1983b : Sémantique de la polémique, Lausanne : l'Age d'homme. 1984 : Genèses du discours, Bruxelles : Mardaga. 1987 : Nouvelles tendances en analyse du discours, Paris :
Hachette. 1991 : L'Analyse du discours. Introduction aux lectures de
l'archive, Paris : Hachette.
MARCOCCIA Michel 1993 : « Le Stéréotype du porte-parole dans le discours
politique », in Plantin (éd.), Lieux communs. Topoï, stéréotypes, clichés, Paris : Kimé, p. 170-181.
MICHELI Gianni 1990 : « L'Idée de Galilée dans la culture italienne du XVIème au
XIXème siècle », in Galilée, l'expérience sensible (collectif), Paris : Vilo, p. 163-187.
MOESCHLER Jacques 1985 : Argumentation et conversation. Eléments pour une analyse
pragmatique du discours, Paris : Hatier.
MORIN Edgar 1981 : « De l‟ancienne à la nouvelle Babylone », in Morin (éd.)
1981 : 133-147.
MORIN Edgar (éd.) 1981 : La Croyance astrologique moderne. Diagnostic sociologique,
Lausanne : l‟Âge d‟homme.
260 Le débat immobile
MORTUREUX Marie-Françoise 1982a : Présentation de Langue Française 53 : 3-6. 1982b : « Paraphrase et métalangage dans le dialogue de
vulgarisation », Langue Française 53 : 48-61. 1988 : « La Vulgarisation scientifique. Parole médiane ou
dédoublée », in JACOBI & SCHIELE (éds) 1988 : 118-148.
NEL Noël 1990 : Le Débat télévisé, Paris : Armand Colin.
PERELMAN Chaïm & OLBRECHTS-TYTECA Lucie 1988 : Traité de l'argumentation. La nouvelle rhétorique,
Bruxelles : Editions de l'Université de Bruxelles. 1989 : « Logique et rhétorique », in Rhétoriques, Bruxelles :
Editions de l'Université de Bruxelles, p. 63-107.
PETER Jean-Pierre 1992 : « Quiconque n'est pas docteur n'est-il qu'un charlatan ? », in
Loux (éd.), Panseurs de douleurs. Les médecines populaires , Paris : Editions Autrement, p. 224-239.
PETROFF André Jean 1990 : « La question du sens dans les discours des communautés
techno-linguistiques », in NORMAND (éd.), La Quadrature du sens, Paris : Presses Universitaires de France, p. 181-198.
PETROSSIAN Lena 1981 : « L‟Anti-astrologisme », in Morin (éd.) 1981 : 119-122.
PLANTIN Christian 1988 : Les Mots, les arguments, le texte, thèse de Doctorat,
Université libre de Bruxelles. 1990 : Essais sur l'argumentation, Paris : Kimé. 1993 : « Situation rhétorique », Verbum 1-2-3 : 228-239. 1996 : L‟Argumentation, Paris : Seuil (Point Mémo).
POPPER Karl 1978a : La Connaissance objective, Bruxelles : Complexe. 1978b : La Logique de la découverte scientifique, Paris : Payot.
PRACONTAL Michel de 1990 : Les Mystères de la mémoire de l'eau, Paris : La
Découverte.
QUERE Louis 1989 : « “La vie sociale est une scène”. Goffman revu et corrigé
par Garfinkel », in Le Parler frais d‟Erving Goffman (collectif), Paris : Minuit, p.47-82.
RABEYRON Paul-Louis
Bibliographie 261
261
1985 : « Le Voyant et la science », in LAPLANTINE (éd.), Un voyant dans la ville. Le cabinet de consultations d‟un voyant contemporain : Georges de Bellerive, Paris : Payot, p.211-255.
REDONDI Pietro 1991 : « Le Mythe Galilée », Les Cahiers de Science & Vie (« Les
grandes controverses scientifiques n°2, Galilée, naissance de la physique moderne ») : 74-84.
ROBRIEUX Jean-Jacques 1993 : Eléments de rhétorique et d'argumentation, Paris : Dunod.
ROQUEPLO Philippe 1974 : Le Partage du savoir. Science, culture, vulgarisation,
Paris : Seuil.
RUSSELL Bertrand 1990 : Science et religion, Paris : Gallimard.
SCHIELE Bernard & JACOBI Daniel 1988 : « La Vulgarisation scientifique : thèmes de recherche », in
Jacobi & Schiele (éds), 1988 : 12-46.
SCHLANGER Judith 1989 : « La Pensée inventive », in STENGERS & SCHLANGER,
Les Concepts scientifiques. Invention et pouvoir, Paris : La Découverte / Strasbourg : Conseil de l'Europe, Unesco, p. 58-88.
SERRES Michel 1992 : « Commentaire historique », in Colloque pour la science -
Actes du colloque des 3 et 4 décembre 1991 (collectif), Paris : Fondation Electricité de France, p. 53-56.
SKROTZKY Nicolas 1989 : Science et communication. L'homme multidimensionnel,
Paris : Pierre Belfond.
STENGERS Isabelle 1989a : « Les Affaires Galilée », in SERRES (éd.), Eléments de
l'histoire des sciences, Paris : Bordas, p. 223-249. 1989b : Introduction de STENGERS & SCHLANGER, Les Concepts
scientifiques. Invention et pouvoir, Paris : La Découverte / Strasbourg : Conseil de l'Europe, Unesco, p. 7-23.
TAYLOR Charles Alan 1991 : « Demarcation as argument : the nature and functions of
“science” in scientific argumentation », in van EEMEREN, GROOTENDORST, BLAIR & WILLARD (éds) 1991 : 1080-1090.
THUILLIER Pierre
262 Le débat immobile
1988 : « L'Eglise doit-elle mettre fin au “scandale Galilée”? », La Recherche, 19-200 : 846-853.
TRAVERSO Véronique 1996 : La Conversation familière. Analyse pragmatique des
interactions, Lyon : Presses Universitaires de Lyon.
VIGNAUX Georges 1988 : Le Discours acteur du monde. Enonciation, argumentation
et cognition, Paris : Ophrys.
VION Robert 1992 : La Communication verbale. Analyse des interactions,
Paris : Hachette.
WEBER Max 1959 : Le Savant et le politique, Paris : Plon.
WINDISCH Uli 1987 : Le K.O. verbal. La communication conflictuelle, Lausanne :
l'Age d'homme.
WOODS John & WALTON Douglas 1992 : Critique de l‟argumentation. Logique des sophismes
ordinaires, Paris : Kimé.
WOOFFITT Robin 1992 : Telling Tales of the Unexpected. The organization of
factual discourse, Harvester Wheatsheaf : Barnes & Noble Books.
TABLE DES MATIERES
AVANT-PROPOS ....................................................................... 7 CHAPITRE 1 : COMMENT ANALYSER L‟ARGUMENTATION DANS UN DEBAT MEDIATIQUE ? ............................................ 13
1. Argumentation, analyse de discours, pragmatique ................ 13
2. Etudes sur les parasciences ..................................................... 19 2.1. Etudes de certaines pratiques parascientifiques ............. 19 2.2. Analyse de la construction des controverses sur les parasciences ............................................................... 20
3. Le corpus ................................................................................ 21 CHAPITRE 2 : LES TERMES DE LA POLEMIQUE ET LES ACTEURS DU DEBAT ..................................................... 27
1. Les disciplines parascientifiques ............................................ 28
2. “Parasciences”, “pseudo-sciences”, “sciences parallèles” .............................................................. 33 2.1. “Para”, “pseudo”, “parallèle” ......................................... 34 2.2. La (non-)scientificité des parasciences ........................... 37 2.3. Autres définitions des parasciences ................................ 40 2.4. Toute dénomination commune est nécessairement polémique ........................................ 42
3. Le débat sur les parasciences : acteurs et supports ............... 44 3.1. Les partis en présence .................................................... 44 Les partisans des parasciences .............................................. 44 Les adversaires des parasciences ........................................... 46
264 Le débat immobile
3.2. Les supports du débat .......................................................... 49 Les supports écrits ............................................................... 49 Le débat à la télévision ........................................................ 50 CHAPITRE 3 : FAIBLESSE CONSTITUTIVE DE LA POSITION DE L‟OPPOSANT .......................................... 53
1. Territoires conversationnels et contrôle du thème .................. 54
2. Séquence de présentation : une asymétrie de départ ............. 56 2.1. Présentation des partisans des parasciences ............. 57 2.2. Présentation des adversaires des parasciences .......... 60 2.3. Notoriété de l‟invité ..................................................... 62
3. Une asymétrie renforcée ....................................................... 65 3.1. Contestation de la compétence de l‟adversaire en tant que scientifique ............................................ 66 3.2. Contestation de la pertinence de la compétence de l‟adversaire ........................................................... 66 3.3. Dénonciation de l‟ignorance de l‟adversaire sur la parascience en discussion .............................. 68
CHAPITRE 4 : FONCTION ARGUMENTATIVE DES SEQUENCES DE VULGARISATION ................................... 73
1. Qui vulgarise ? ....................................................................... 74 1.1. Sélection du vulgarisateur en fonction de la mécanique de l‟interaction ........ 75 1.2. Sélection du vulgarisateur en fonction des territoires conversationnels .......... 76
2. Activités discursives associées au rôle communicationnel de vulgarisateur ...................................... 80 2.1. Le dispositif énonciatif de la vulgarisation ............... 81 Les formes dialogales / monologales .......................................... 81 Vulgarisation et discours rapporté .............................................. 83 Paramètres de l‟énonciation du discours-source ......................... 84 2.2. Vulgarisation et paraphrase ........................................ 85 Le vocabulaire technique ............................................................ 85 Différents types de paraphrase .................................................... 88
3. Conclusion : le rôle des séquences de vulgarisation dans la polémique ................................................................... 91
Table des matières 265
265
CHAPITRE 5 : LE DEBAT SELON LES ADVERSAIRES DES PARASCIENCES : RHETORIQUE DE L‟EPOUVANTAIL .......................................... 97
1. Champs métaphoriques .......................................................... 98 1.1. La métaphore “liquide” ............................................... 99 1.2. La métaphore de la guerre ......................................... 100 1.3. La métaphore de la maladie ...................................... 100
2. Dénonciation du rôle des médias ......................................... 101
3. Position de l‟auditoire : les “gogos” .................................... 104
4. Procédés de liaison et de dissociation ................................. 110
5. Une position essentiellement défensive ................................ 112 CHAPITRE 6 : LE DEBAT SELON LES PARTISANS DES PARASCIENCES I : PROCEDES DE DISSOCIATION ............................................ 117
1. Procédés de dissociation au sein des parasciences .............. 117 1.1. Dissociations interdisciplinaires .............................. 117 1.2. Dissociations intra-disciplinaires ............................. 118 1.3. “Les authentiques” / “les charlatans” ...................... 119 1.4. Tradition / Modernité ................................................ 121 1.5. Dissociations et définitions des programmes argumentatifs ............................. 123
2. Application des procédés de dissociation aux adversaires des parasciences ....................................... 125 2.1. Requalification de “LA Science” ............................. 126 2.2. Dissociations et argument d‟autorité ....................... 130 Définition de l‟argument d‟autorité ......................................... 130 Evaluation de l‟argument d‟autorité par les locuteurs ordinaires ................................................. 132 Argument d‟autorité et discours rapporté ................................ 134 Réfutations de l‟argument d‟autorité ....................................... 136 CHAPITRE 7 : LE DEBAT SELON LES PARTISANS DES PARASCIENCES II : L‟APPEL A GALILEE ........................................................... 143
1. Analyse du mécanisme de l‟appel à Galilée ................... 143
1.1. Le mythe de Galilée comme événement fondateur ....... 144 1.2. Appel à Galilée et figure du précédent .......................... 148 1.3. Variantes de l‟appel à Galilée ....................................... 150
2. Motifs de l‟appel à Galilée ............................................... 151 2.1. Dynamique du débat construite par les partisans des parasciences ................................... 152 2.2. Affirmation de la non scientificité du débat .................. 156
266 Le débat immobile
2.3. Exploitation pathétique ................................................. 157 2.4. Portrait du Galilée moderne .......................................... 158
3. Réfutations de l‟appel à Galilée ....................................... 160 3.1. Récuser le jugement d‟analogie .................................... 160 3.2. Dénoncer le caractère pernicieux de l‟appel à Galilée .......................................................... 162 3.3. Répondre au précédent par un autre précédent ............. 162 CHAPITRE 8 : DISCUSSION DES PHENOMENES ............................................ 167
1. La charge de la preuve .......................................................... 168 1.1. Principes généraux ........................................................ 168 1.2. Rhétorique de l‟acquis ................................................... 169 1.3. Réaction des adversaires des parasciences .................... 172 1.4. Charge de la preuve dans un débat télévisé ................... 173
2. Négociation des principes de résolution du désaccord ....................................................... 175 2.1. Le paranormal ...................................................... 176 Les témoignages ................................................................. 176 Les expérimentations .......................................................... 182 Rationalisation du phénomène ............................................. 189 2.2. Les mancies ........................................................... 191 Versant caractérologique ................................................ 191 Versant prédictif ...................................................................... 192 2.3. Les médecines parallèles ....................................... 201 Les témoignages ...................................................................... 201 Les expérimentations ............................................................... 203 CHAPITRE 9 : LA SCIENCE DES UNS, LA SCIENCE DES AUTRES ................ 207
1. La théorie scientifique comme construction intellectuelle ....................................... 207 1.1. Réfutabilité de la théorie ............................................... 208 Le falsificationnisme .......................................................... 208 Croyance et rationalité ....................................................... 209 1.2. Démarche expérimentale ............................................... 211 1.3. Objectivité de la science ................................................ 216 1.4. Adéquation à une description lexicale et argumentative du discours scientifique ..................... 218 Caractéristiques du discours scientifique ........................... 218 Analyse du mot “énergie” .................................................. 219 1.5. Définition juridique de la science ................................. 225
Table des matières 267
267
2. La théorie scientifique comme soumission aux faits ................................................ 228 2.1. Dénonciation de l‟aveuglement des opposants aux parasciences.................................... 228 2.2. Appel à l‟expérience immédiate .................................... 230 2.3. De l‟expérience vécue à l‟expérimentation en laboratoire ............................... 232 2.4. Schéma général de discussion ....................................... 237
3. Deux modes de rationalisation ............................................. 242 3.1. La science des adversaires des parasciences ................. 242 3.2. La science des partisans des parasciences ..................... 243 CONCLUSION .......................................................................... 249 ANNEXE ................................................................................... 253 BIBLIOGRAPHIE ..................................................................... 255
MARIANNE DOURY
LE DEBAT IMMOBILE
Cet ouvrage propose une analyse du débat sur les parasciences (astrologie, parapsychologie, ufologie, “médecines parallèles”, etc.), tel qu‟il se reproduit régulièrement dans les médias. La description repose sur l‟analyse d‟un corpus constitué d‟émissions télévisées, d‟articles de presse ou d‟ouvrages consacrés aux parasciences. Cette étude dévoile les stratégies discursives mises en oeuvre par les débatteurs pour défendre leurs thèses : construction d‟une image de leur camp et de celui des opposants, invocation de précédents prestigieux (appel à Galilée) ou développement d‟une rhétorique catastrophiste, discussion des faits et de leur interprétation, recherche conflictuelle d‟une définition de la science. Le débat immobile s‟inscrit dans le champ des recherches sur l‟argumentation. Le travail qu‟il présente fait aussi appel aux outils élaborés par l‟analyse du discours et la pragmatique des interactions. Cet ouvrage s‟adresse aux spécialistes de l‟argumentation et des sciences du langage, mais aussi aux lecteurs intéressés par la communication médiatique ou la sociologie des sciences. Marianne Doury, linguiste et spécialiste de l‟argumentation, est chargée de recherche au CNRS. Elle travaille au sein du Groupe de Recherche sur les Interactions Communicatives à l‟Université Lumière Lyon 2.