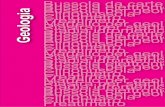Cultural History of Early Modern Streets – An Introduction (With Thomas Cohen)
Le cas de "Le livre de ma mère " d'Albert Cohen
-
Upload
khangminh22 -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of Le cas de "Le livre de ma mère " d'Albert Cohen
Année universitaire : 2020/2021
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE Ministère de L’enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique
Université Larbi Ben M’hidi, Oum El Bouaghi
Faculté des Lettres et des Langues Département de Français
Mémoire élaboré en vue de l'obtention du diplôme de Master
Spécialité: littérature générale et comparée
THÈME
Présenté par : Dirigé par :
Mlle Chahinez Marouf Mr. Bouzidi Attef
Mlle Chafika Gherriche
Du temps pour le temps: Le cas de
"Le livre de ma mère " d’Albert Cohen
Année universitaire : 2020/2021
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE Ministère de L’enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique
Université Larbi Ben M’hidi, Oum El Bouaghi
Faculté des Lettres et des Langues Département de Français
Mémoire élaboré en vue de l'obtention du diplôme de Master
Spécialité: littérature générale et comparée
THÈME
Présenté par : Dirigé par :
Mlle Chahinez Marouf Mr. Bouzidi Attef
Mlle Chafika Gherriche
Du temps pour le temps: Le cas de
"Le livre de ma mère " d’Albert Cohen
Dédicace
Je dédie ce travail particulièrement à ma
mère qui a fait de moi ce que je suis
aujourd’hui en témoignage de l’effort qu’elle a
déployée pour m’aider et qui a été toujours
pré de moi à me renforcer et me donner de
l’espoir.
À celui dont la présence me procure : la
volonté, le courage mon père Khelad.
À mes chers frères: Amin et Sohaib.
À mon amie et chère sœur: Amal.
À tous les esprits cherchant à savoir que je t'ai
connu
Durant mes études.
Chahinez
Dédicace
Je dédie ce travail
À mes chers parents qui m’ont vraiment
aidé tout de long de ce travail.
À mes chers frères et sœurs.
À mes meilleurs amis.
À toute ma famille sans oublier
personne.
Chafika
Tout d’abord nous remercions ALLAH le tout puissant pour nous avoir
donné la volonté et la patience pour réussir ce modeste travail. Nous tenons à remercier très sincèrement notre encadreur Mr. Bouzidi
Attef pour avoir accepté de diriger ce travail ainsi que pour ses conseils
et sa patience.
Nous tenons également à remercier tous les enseignants qui ont contribué à
notre formation et qu’ont toujours guidé et encouragé durant mon cursus.
Un grand merci également à toute personne qui a de près ou de loin
contribué à la réalisation de ce travail.
9
Table des matières
Introduction générale…………………...………………………………….12
Premier chapitre: L’instance narrative
1-La temporalité narrative……………………….………………..……..18
1-1-La temporalité dans la narration………...…………………….18
2-La voix narrative………………..………………………………………22
Deuxième chapitre: Le mode narratif
1- La distance…………………………………………………...…………28
1-1 Le discours narrativisé…………………………………………28
1-2 Le discours rapporté…………..………………………………..29
2-La perspective narrative………………………………………………..30
2-1 La focalisation zéro……………………………………………30
2-2 La focalisation interne………………………...……………….32
2-3 La focalisation externe…………………………..…………….33
3-L’auteur/narrateur……………...………………………………………34
4-Les fonctions du narrateur…………..………………………………….35
4-1 La fonction de communication……………………………….35
4-2 La fonction testimoniale………..…………………………….36
10
Troisième chapitre: Le temps du récit et le temps de
l’histoire
1- L’ordre temporel……………………………………..………………40
2- La vitesse narrative…………………..………………………………41
2-1 La pause…………………………………………………..…….42
2-2 La scène……………………...…………………………………43
2-3 Le sommaire……………………………………………………43
2-4 L’ellipse…………….…………………………………………..44
3- La fréquence événementielle…………….…………………………..44
3-1 Le mode singulatif………………………………………………44
3-2 Le mode répétitif……………..………………………………….44
3-3 Le mode itératif…………….……………………………………44
4- Les valeurs temporelles……………………..………………………..45
Quatrième chapitre: L’analyse des personnages
1-Le personnage…………………………….……………………………49
2-La classification des personnages…………………………………….53
2-1 Le héros………………….……………………………………53
2-2 Les personnages principaux…………….…………………….55
2-3 Les personnages d’arrière-plan……………………………….57
3- La classification sémiologique selon Philippe Hamon……………..57
Conclusion générale…….………………………………………………….70
Bibliographie………………….…………………………………………….72
Résumés…………...………………………………………………………...75
12
Introduction générale
Nous faisons face dans nos vies à de nombreux obstacles difficiles qui nous
repoussent, perdent espoir et nous remplissent de déception et de misère, et nous
devenons faibles et incapables de faire face à l'amertume de la vie. Ensuite, nous
avons perdu notre confiance en nous que nous ne pouvons pas changer. Parmi ceux-
ci obstacles est la mort ou la perte d'êtres chers. La vie humaine peut se noyer dans
une mer de tristesse et de désespoir. Et cela a causé une douleur insupportable. Dans
ce cas, nous agissons chacun différemment pour surmonter l'épreuve : certaines
personnes s'effondrent et pleurent et deviennent plus disposées à s'isoler de tout,
d'autres se tournent vers Dieu, convaincues qu'après la douleur vient toujours le
bonheur, et certaines ont la force et la patience pour traverser cette crise et toujours
croire Que quelque chose de beau s'en vient, et il y a ceux qui croient qu'écrire est
une solution pour oublier sa douleur.
Le but de notre écrivain derrière l'écriture est de retrouver un autre temps pour
vivre à nouveau avec sa mère, de cette façon il peut se débarrasser de sa souffrance
et guérir de sa tristesse, en écrivant ses journaux intimes avec sa mère.
Nous avons choisi de travailler sur « le livre de Ma mère » d'Albert Cohen, peut-
être parce que c'était l'un des meilleurs exemples autobiographiques, ou peut-être
parce que c'était la meilleure œuvre que nous voulions révéler à première vue.
Albert Cohen est né le 26 aout 1895 à Corfou, en Grèce, et est décédé à Genève le
17 octobre 1981. Il est un écrivain, dramaturge et poète suisse. Il publie son premier
roman en 1930, mais se n’est qu’en 1961 qu’il contribue au roman « Belle
seigneur » et en 1968 il remporte le Grand Prix du même roman de l’Académie des
sciences.
Les parents d’Albert sont issus d’une famille de savonniers .Alors qu’Albert n’a
que 5 ans, il décide d’immigre à Marseille après le massacre, où il crée une
entreprise d’œufs et d’huile d’olive. Il évoquera également la période de sa vie et de
nombreuses autres périodes dans « le livre de ma mère ».
13
Albert Cohen devient directeur des « paris Jewich Review » en 1925 et fut
rédacteur en chef sous des noms tels qu’Albert, Einstein et Sigmund Freud
(Sigmund Freud). À partir de 1926, il devient fonctionnaire du Bureau international
du travail à Genève, à cette période, il s’inspire et crée son plus célèbre roman
« Belle du Seigneur », et publie son premier roman en 1930.Il l’appelle « Solal ».Il
a été traduit dans de nombreuses langues, enfin, en 1938, il a publié
« mangeclous ».
Après 16 ans d’activités littéraires inactives, en 1954, il publie « le livre de ma
mère », qui raconte une énorme histoire sur son adolescence. L’amour pour sa mère
et toute la douleur causée par sa perte.
À 75 Ans, il souffre d’une grave dépression, et finalement il se fixe un nouvel
objectif : promouvoir son travail, pour sortir de la situation difficile. En 1979, il
publie « Le carnets 1978 » et donne plusieurs interviews. Quelques mois plus tard,
il mourut à Genève le 17 octobre 1981.
Dans « Le carnet de 1978 », il parlera des difficultés rencontrées dans l’écriture
de « le livre de ma mère »et dit que dans les années précédant la publication de la
version finale, il avait écrit plusieurs versions.
Le roman raconte les précieux souvenirs du narrateur et de sa mère, le saint
sabbat chez les Juifs, marchant ensemble, et les repas qu'elle lui préparait lorsqu'il
venait l'accompagner en vacances. L'histoire raconte l'histoire des détails, la façon
dont la mère s'habille, le type de bijoux qu'elle porte et l'histoire qui la rend aussi
belle qu'une jeune fille. Le narrateur n'a pas oublié les conseils de sa mère, et elle ne
ménage aucun effort pour lui donner une bonne éducation sur la base du respect et
de l'humilité.
Le narrateur nous montre aussi le regret insupportable après la mort de sa mère :
il n'a pas pu assister aux funérailles, et ce souvenir a continué à le tuer et l'a même
rendu incapable de survivre. Il nous a expliqué combien il en ferait et ne la verrait
qu'une fois.
14
L'auteur insiste sur le fait que l'amour de sa mère n'a d'égal aucun autre amour
sur cette planète.
Les dernières pages du roman sont l'appel de l'auteur pour que les gens prennent
soin de leur mère, insistant sur le fait que les mères sont irremplaçables et qu'elle
peut nous accepter en toutes circonstances.
Du temps pour le temps : le cas de « Le livre de ma mère » d’Albert Cohen est
l'intitulé que nous choisissons de donner à notre travail de recherche, porte sur
l'analyse narrative chronologique du roman. Nous limitons le temps d'histoire et le
temps d'écriture d'histoire, et fournissons autant de détails que possible. Le style de
l'analyse chronologique narrative dans notre roman a une grande influence, car nous
avons choisi des moments qui touchent l'âme du narrateur.
Le roman s'adresse également aux lecteurs, leur permettant de revivre tout ce que
l'auteur a vécu. Cela a également un effet sur le narrateur, l'aidant à se débarrasser
de sa tristesse et à soulager sa douleur.
Il est incontestable qu'un roman est un véritable portrait de la société et des
romanciers. Souvent, on n'est pas obligé de lire la biographie de l'auteur pour
comprendre sa vie. Lire un de ses romans suffit pour savoir dans quelle section il se
trouve. à travers L'outil idéal pour que les œuvres littéraires fassent écho, c'est le
meilleur moyen de s'exprimer.
Tout d'abord, nous avons choisis l'écrivain Albert Cohen, car il est l'un des plus
grands écrivains, a laissé un héritage littéraire extraordinaire, et a écrit de nombreux
romans qui le reflètent. Pour nous, nous considérons son style très charmant et
unique, un style basé sur les sentiments et le toucher des lecteurs, et ses romans ont
choqué le monde littéraire par leur excellente qualité.
La lecture de notre corpus nous a donné la possibilité de se mettre a la place de
notre auteur, une position qui nous a guidés à poser une série de questions parmi
lesquelles :
15
En premier lieu, comment le temps est-il mis en évidence dans le roman ? En
d'autres termes, si oui, existe-t-il une approche spécifique qui peut être utilisée pour
le prouver et le confirmer ?
En second lieu, a travers quels procéder littéraires la narration essaye-t-elle de
reconstruire le temps et ses manifestations dans le roman ?
Afin de répondre à ces questions et dans le cadre d'un enrichissement de notre
travail, nous avons décidé de diviser notre recherche en quatre chapitres:
Pour étudier le mécanisme de base du roman, nous aborderons d'abord la notion
de la temporalité narrative, nous définirons la notion de temps à la lumière de
Michel Butor et de sa performance dans les textes littéraires, nous analyserons donc
le temps de narration dans le roman et la voix narrative dans le 1er chapitre, puis
dans le 2ème chapitre nous tenterons de découvrir le mode narratif, nous pouvons
l'appliquer au roman, connaître les méthodes que le narrateur utilise pour exprimer
ce qu'il veut, le rendre plus compliqué et intéressant, et découvrir la vie de l'auteur
Albert Cohen, et il a été marqué comme résultat la perte de la mère se reflète dans
les mots. Ensuite, au 3ème chapitre, nous traitons le temps du récit et le temps de
narration dans notre corpus.
Enfin, nous passons au 4ème chapitre, basé sur l'analyse des personnages selon
Philipe Hamon en la combinant avec une psychocritique.
Notre objectif est de savoir si les techniques narratives peuvent être appliquées, et
si elles sont efficaces ou non pour notre récit et pour le personnage du narrateur.
Premier chapitre : L’instance narrative 1-La temporalité narrative
1-1-La temporalité dans la narration
2-La voix narrative
18
Dans ce chapitre nous aborderons la notion de la temporalité dans le roman
d’Albert Cohen Le livre de ma mère.
En premier lieu nous allons définir la notion de temporalité selon Michel Butor et
sa représentation dans un texte littéraire, ainsi nous analyserons le temps de la
narration dans le roman.
En dernier lieu nous traiterons les techniques narratives (l’auteur et le narrateur,
le schéma narratif, le mode narratif, l’instance narrative, les perspectives narratives,
la vitesse narrative, l’ordre temporel et la fréquence événementielle).
1- La temporalité narrative
1-1- La temporalité dans la narration
Nous commencerons notre recherche, selon la théorie de la temporalité
théoriquement parlant, le concept de la temporalité.
En tant que romancier, Michel Butor estime qu'il y a une difficulté à présenter les
événements d'un roman dans un ordre linéaire : Dans les histoires qui sont plus
classées chronologiquement, on ne pense pas le temps comme un continuum. Sauf
dans certaines circonstances.
L'alternance dans l'histoire, et ce qui rend cette interruption encore plus
significative, est l'essence de la vie contemporaine, ce qui pousse les écrivains à
présenter leurs histoires comme des blocs placés côte à côte, comme si on ressentait
ces interruptions dans l'existence humaine elle-même.
Michel Butor montre la possibilité de diviser le temps du romancier en au moins
trois moments, le temps de l’écriture, le temps de l’aventure, le temps de l’écrivain.
Le moment de l’écriture se reflète souvent le temps de l’aventure par l’heure de
l’écrivain. Ainsi l’écrivain fournit un résumé d’une histoire que nous lisons en deux
minutes ou une heure et ses événements il a eu lieu dans deux jours ou plus pour le
faire, ou un résumé d’accidents s’étalant sur des années, ou exactement le contraire
19
de ça. A travers cette division tripartite présentée par Michel Butor, nous constatons
qu’il y a un décalage entre ces temps.
Le romancier peut présenter un résumé des événements survenus en deux ans
(temps de l’aventure) et peut prendre est par écrit (le temps de l’écriture), tandis que
le moment de la lecture est deux minutes, en d’autres termes la techniques de
synthèse utilisée par l’écrivain pour presser la période de temps de l’histoire en une
courte section de texte.
Ces références empêchent le roman d’être rangé dans l’ordre chronologique,
donc la narration nous permet d’utiliser un laps de temps, ce qui conduit à une
régression dans le temps du récit.
« Le temps de la fiction, représente la durée du déroulement de l’action et
l’histoire dans toute sa linéarité. Le temps de la narration, représente l’ordre
temporel de la disposition des évènements dans le récit».1
Est selon Michel Butor, le temps de la fiction conçu comme le temps que
prend l’action dans sa réalisation. Une réalisation qui suit un cheminement et
une construction linéaire. Le temps de la narration quant à lui renvoie à
l’organisation temporelle de mise des faits dans le récit.
L’écrivain se distingue par un va et vient entre le présent et le passé. On peut
voir le chaos du temps du point de vue narratif, car l’auteur a raconté son enfance,
puis il a bondi et a raconté la douleur et la solitude après la mort de sa mère, puis il
a promis de raconter le souvenir de ses jours d’école. A l’Université de Genève,
toutes ces raisons conduisent à l’obsolescence.
Selon Genette, « Dans le cas du récit de fiction, l’histoire et la narration (donc
le narrateur et le narrataire) sont fictionnels, un acte de narration fictionnel
redouble l’acte réel de l’auteur».2
1 Michel Butor, Essai sur le roman, Ed. Gallimard collection idée, 1969, p. 11. 2 Cette présentation s’inspire de la théorie de jakobson et scharffer : Site web, le 05/06/2021 à 15 : 30.
20
Une histoire ne peut pas vraiment imiter la réalité, elle doit être Toujours un acte
de langage fictif.
Les récits dépassés peuvent avoir plusieurs fonctions ? car la psychologie d'un
personnage se développe à partir d'événements passés, la non-addiction peut
stimuler la curiosité des lecteurs en révélant partiellement les faits qui émergent.
Notre récit est un désordre temporel ou le narrateur retrace les évènements qui se
sont produits avant le moment actuel de l’histoire principale. En même temps, sa
psychologie et la psychologie de sa défunte mère ont été bien développées.
Le temps d’écriture est le moment où l’événement est écrit et est également
considéré comme le temps d’écriture, et le temps de lecture est un temps spécifique,
tant le temps de la narration que celui des romans sont marqués par des évènements
spécifiques.
Prenons l’extrait suivant :
« Un jour, à Genève, lui ayant donné rendez-vous à
cinq heures dans le square de l'Université, je n'arrivai, retenu
par une blondeur, qu'à huit heures du soir. Elle ne me vit pas
venir. Je la considérai, la honte au cœur, qui m'attendait
patiemment, assise sur un banc, toute seule, dans le jour
tombé et l'air refroidi, avec son pauvre manteau trop étroit et
son chapeau affaissé sur le côté. Elle attendait là, depuis des
heures, docilement, paisiblement, un peu somnolente, plus
vieille d’être seule, résignée, habituée à mes retards, sans
révolte en son humble attente, servante, pauvre sainte poire.»1
Un autre exemple :
« Elle m'a attendu trois heures dans ce square. Ces trois
heures, j'aurais pu les passer avec elle. Tandis qu'elle
m'attendait, auréolée de patience, je préférais, imbécile et 1 Albert COHEN, Le livre de ma mère, Paris, Gallimard, Coll. Folio, 1954, p. 29.
21
charmé, m'occuper d'une de ces poétiques de m’oiselles
ambrées, abandonnant ainsi le grain pour l'ivraie. J'ai perdu
trois heures de la vie de ma mère. Et pour qui, mon Dieu
?Pour une Atalante, pour un agréable arrangement de chairs.
J'ai osé préférer une Atalante à la bonté la plus sacrée, à
l'amour de ma mère. Amour de ma mère, à nul autre pareil. »1
Dans cet extrait le narrateur regrette qu'il n'ait pas pu l'approcher lorsque sa mère
avait besoin de lui; se souvient ce jour-là, elle l'avait attendu pendant 4 heures, mais
il n'a pas pu venir à cause de ses propres obstacles. Il était préoccupé par sa relation
avec sa mère et son relation avec sa mère L'écart entre eux n'est pas assez
satisfaisant.
« Amour de ma mère nul à autre pareil » Cette phrase a été répétée plusieurs fois
dans notre corpus, et l'auteur insiste par l'usage sur le fait que l'amour de sa mère n'a
d'égal aucun autre amour sur cette planète.
Dans cet extrait, il s’agit d’une narration ultérieure. Le narrateur raconte ce qui se
passe en pansant à sa mère. Il nous transmet directement ses sentiments au même
moment où il pense à elle.
Le compte passé simple / l’imparfait installe dans cet extrait une narration à deux
plans. Un premier plan conduit à l’imparfait que la narration prend soin de
prolonger. Et un second plan, conduit au passé simple que la narration préféré
écourter. L’attente de la mère est mise en opposition avec les retards répètes du fils.
Une attente affectueuse, pleine d’amour, de tendresse, d’excuses et de
compréhension. Et des retards, répétés, que le narrateur se remémore dans un regret
profond. Les verbes qui rapportent les actions du fils sont au passé simple. Ceux de
la mère sont à l’imparfait. Un passé simple, court brutal, furtif qui décrit des
instants de tristesse et de douleur. Et un imparfait qui dure et qui se prolonge pour
répondre à ce besoin insoumis de la présence de la mère.
1Albert Cohen, op.cit, p. 88.
22
Ces deux temps permettent au lecture une plus forte appréciation de l’extrait.
L’expression plus vieille d’être seule vient ainsi renforcer un sentiment de
culpabilité insurmontable.
2-La voix narrative
« Rien n’interdit au narrateur de dire « je » pour présenter ou commenter
l’histoire. Tant qu’il n’y joue aucun rôle en tant que personnage. »1
Le narrateur hétéro diégétique ne fait pas partie de l'histoire racontée, il suit
simplement les actions des personnages et ils racontent aux lecteurs, au contraire, le
narrateur homo-diégétique fait partie de l'histoire racontée, et il est l'un des
personnages qui construit l'histoire.
Le narrateur auto diégétique qui se raconte est le héros de l’histoire, il est le roi
de la diégèse, il est au cœur de l'histoire et il est partout.
« Ce que je viens de me raconter, c'est un souvenir du temps où ma mère était déjà
vieille et où j'étais un adulte, déguisé en fonctionnaire international. Je venais, de
Genève, passer une partie de mes vacances à Marseille, chez mes parents. Ma mère
était heureuse de ce que son fils, qui avait, pensait-elle avec beaucoup
d'exagération, une si noble situation chez les Gentils, acceptât de bon cœur d'aller
chaque sabbat à la synagogue de Marseille. Je l'entends qui me parle ».2
Un autre exemple :
« Je ne la veux pas dans les rêves, je la veux dans la vie,
ici, avec moi, bien vêtue par son fils et fière d'être protégée
par son fils. Elle m'a porté pendant neuf mois et elle n'est plus
là. Je suis un fruit sans arbre, un poussin sans poule, un
lionceau tout seul dans le désert, et j'ai froid. Si elle était là,
elle me dirait : « Pleure, mon enfant, tu seras mieux après. »
1 Gérard Genette, « Figures III », édition seuil Paris, 1972, P.203. 2 Albert Cohen, op.cit, p. 23.
23
Elle n'est pas là et je ne veux pas pleurer. Je ne veux pleurer
qu'auprès d'elle ».1
Nos lecteurs de notre livre et après l’avoir lu notre livre, nous pouvons dire avec
certitude que le narrateur est auto diégétique,, car le narrateur de ce livre raconte la
véritable situation de sa vie, il participe donc à la narration en tant que partie
principale, car ce qu'il nous dit est dans son privé la vie, personne ne les connaît
sauf lui, donc dans notre groupe, le narrateur est aussi le protagoniste.
En même temps, il raconte le deuil de sa mère après sa mort et exprime le besoin
de le revoir et d'être à ses côtés. Tous ces passages soulignent la situation auto
diégétique du narrateur.
Par conséquent, la voix narrative de notre personnage narrateur est auto
diégétique car il apparaît dans son histoire et il est un héros.
Quant au temps de narration, cela signifie que le narrateur peut raconter ce qui
s'est passé dans la réalité, ce qui est une narration ultérieure, ou le narrateur peut
raconter le futur, qui est une narration continue du passée - la fin du narratif
simultanée, ce qui signifie que l'histoire se déroule au moment de la narration.
« En ce dimanche, ma mère et moi nous étions ridiculement bien habillés et je
considère avec pitié ces deux naïfs d'antan, si inutilement bien habillés, car
personne n'était avec eux, personne ne se préoccupait d'eux. Ils s'habillaient très
bien pour personne »2
Le narrateur revient pour décrire sa vie avec sa mère et tous ses souvenirs avec
elle. Tout d'abord, la narration ultérieure est que lorsqu'il raconte des événements
dans un passé lointain, dans cet extrait le narrateur exprime un fait qui lui est arrivé
ainsi qu'à sa mère un dimanche où il était à la fois élégant, et qu'une personne
n'avait pas besoin de son élégance puisqu'il n'y avait personne pour se soucier de lui
à ses yeux.
1 Albert Cohen, op.cit, p. 117. 2 Ibid. p. 45.
24
L'imparfait, dont le narrateur se sert pour raconter un fait qui s'est passé dans le
passé pour s'étendre, envoie son sens directement en même temps que sa mère
pense.
Les récits précédents sont répétés par l'écrivain avec son désir d'elle, alors qu'il se
souvient de tous les détails pour rechercher une autre vie dans laquelle sa mère peut
revivre dans la narration, le narrateur a toujours le besoin urgent de faire revivre sa
mère.
« Maintenant, c'est la nuit Pour ne plus penser à ma mère, je suis sorti dans le jardin.
Ma douleur et ma rouge simarre que le vent écartait en deux ailes sur la vivante nudité
apparue me faisaient un pauvre roi fou dans la nuit insupportable où elle me guettait t.
Un chien errant m'a regardé avec les yeux de ma mère, et je suis rentré ».1
L'écrivain veut arrêter de penser à sa mère et sortir du traumatisme psychologique
qui l'a fait s'ennuyer de sa vie tragique et lui a peint la tristesse et la douleur
Dans cet extrait, il s’agit d’une narration simultanée. Les événements sont
racontés en même temps qu'ils se produisent et s'écrivent, qu'il s'agisse de pensées
ou d'actions, et notre écrivain raconte ici à l'heure actuelle la nuit difficile qu'il passa
et sortit au jardin pour oublier un peu, l'écrivain veut arrêter de penser à sa mère et
sortir du traumatisme psychologique qui l'a fait s'ennuyer de sa vie tragique et lui a
peint la tristesse et la douleur sur le visage. Ce fut une nuit difficile pour lui qui lui a
fait sentir que sa mère le regarde et voit ses yeux partout.
Le narrateur nous raconte ce qui s'est passé lorsque nous avons pensé à sa mère, il
nous a directement fait part de ses sentiments en pensant à elle.
Enfin, selon la narration antérieure, quand il pense à l'avenir et se demande s'il
pourra revoir sa mère.
1 Albert Cohen, op.cit, p. 131.
25
Après cette étude, la temporalité narrative dans Le livre ma mère d’Albert Cohen
nous obtenons un ensemble de résultats, dont les plus importants sont :
- La temporalité narrative d’importante déclaration de trésorerie, qui a suscité
l’intérêt des chercheurs et érudits pour l’étude contemporaine du discours narratifs,
et en particulier le modèle temporel proposé par Gérard Genette.
- la temporalité narrative comprend à deux niveaux : le temps de l’histoire et le
temps de la narration, le premier étant multidimensionnel, car de nombreux
évènements peuvent se déroule simultanément.
-Le paradoxe temporel est soit un retour dans le passé, soit une anticipation
d’événements ultérieurs.
- Considéré la récupération des mouvements du temps les plus importants dans
le contrôle du romancier de discours car ils sont au même niveau couper la
fréquence du récit croissant d’un retour vers le passé et faites-en une structure de
nouveaux identifie dans le récit et devenir un important de ses partie de la
préemption est un mouvement qui donne au lecteur un état d’attente et d’attente
Apocalyptique ce qui se passera dans le futur.
-Le temps dans le roman est le temps virtuel, et le temps historique est le temps
dans le passé de la révolution; cette fois est la base de l'occurrence d'autres
événements dans le roman.
Deuxième chapitre: Le mode narratif 1- La distance
2-4 Le discours narrativisé
2-5 Le discours rapporté
2- La perspective narrative
2-1 La focalisation zéro
2-2 La focalisation interne
2-3 La focalisation externe
3- L’auteur/narrateur
4- Les fonctions du narrateur
4-1 La fonction de communication
4-2 La fonction testimoniale
28
« La notion de (mode) renvoie aux procédures de régulation de l’information
narrative ». 1 La rédaction d’un texte implique des différentes techniques qui
produiront des résultats précis. La distance entre le narrateur/ l’histoire et la
perspective narrative gèrent l’organisation des événements du récit. La narration
suppose qu'il y a une instance à l'origine du texte. Le statut du narrateur dépend de
son rapport à l'histoire et de son niveau narratif. Par conséquent, il faut identifier le
statut du narrateur et les fonctions qu'il assume.
1- La distance
« Analyser la (distance), c’est évaluer le degré des informations fournies par le
récit. C’est une nouvelle façon d’aborder la vielle question de l’illusion mimétique.
Le terme distance est comme l’explique Genette à comprendre comme une
métaphore spatiale : de la même façon qu’un tableau ne nous apparait pas avec la
même précision. »2
L’analyse du mode narratif consiste à observer la distance entre le narrateur et
l'histoire. La distance peut connaître la validité de l'histoire et l'exactitude de
l'information véhiculée. Il y a de nombreux types de discours qui apparaissent
progressivement la distance entre le narrateur et le texte.
1-1- Le discours narrativisé
« Le discours narrativisé résume les paroles du personnages en les évoquant
comme n’importe quel événement. Le récit demeure donc très éloigné des mots
effectivement prononcés ; il se contente d’une référence très vague à leur
contenu. »3
Les faits ou les paroles des personnages sont inclus dans la narration et traités
comme les autres événements. L'histoire reste éloignée des mots réellement
prononcés. Elle fait que des références ambiguës pour son contenu.
1 Vincent Jouve, Poétique du roman, Armand Colin, Paris, 2007 (2e édition), p.32. 2 Ibid. 3 Ibid. p.35.
29
Prenons cet extrait :
«Ce que les morts ont de terrible, c'est qu'ils
sont si vivants, si beaux et si lointains. Si
belle elle est, ma mère morte, que je pourrais
écrire pendant des nuits et des nuits
pour avoir cette présence auprès de moi,
forme auguste de mort, forme allant lentement
auprès de moi, royalement allant, protectrice
encore qu'indifférente et effrayamment
calme, ombre triste, ombre aimante et
lointaine, calme plus que triste, étrangère
plus que calme. »1
Dans ce passage le narrateur nous raconte l'horreur qui réside dans les morts
vivant, sa mère qui est si belle et si loin. La distance narrative que le narrateur
utilise est le discours narrativisé (une sorte de résumé). Il nous raconte ce souvenir
pour ressentir sa présence près de lui pour ressentir calme et sérénité.
1-2- Le discours rapporté
« Le discours rapporté, citation littérale des paroles du personnage au style direct,
abolit toute distance. »2
Quand le discours est rapporté le narrateur cite littéralement les paroles du
personnage.
Prenons cet extrait :
« Si elle était là, elle me
dirait :« Pleure, mon enfant, tu seras mieux
après.» Elle n'est pas là et je ne veux pas 1 Albert Cohen, op.cit, p. 116. 2 Vincent Jouve, Poétique du roman, p.36.
30
pleurer. Je ne veux pleurer qu'auprès d'elle. »1
Dans cet extrait le narrateur ne peut pas pleurer devant sa mère, même s'il est
triste parce qu'il n'aime pas la voir souffrir. La distance narrative que le narrateur
utilise est le discours rapporté. Il a vu sa grande proximité avec le récit, c’est sa
propre vie.
1- La perspective narrative
« la focalisation concerne le problème des point de vue. Si étudier la voix
consiste à répondre à la question (Qui raconte ?), analyser la focalisation, c’est
répondre à la question (Qui perçoit ?). Les deux questions ne se recoupent pas : le
narrateur d’un récit à la troisième personne peut choisir de présenter l’histoire
selon son point de vue, à travers celui d’un personnage ou, encore, de façon neutre.
Il n’y a pas de lien direct entre la personne qui raconte et le point de vue à partir
duquel l’histoire est présentée ».2
L'accent est mis sur le problème du point de vue. La focalisation permet de
découvrir en quelle position se trouve le narrateur. Si l'étude du son consiste à
répondre à la question (qui dit?), alors l'analyse focalisée est la réponse à la question
(qui perçoit?). Les deux questions ne se chevauchent pas : le narrateur à la troisième
personne peut raconter l'histoire de son point de vue, selon un point de vue
personnel ou de manière neutre. Il n'y a pas de relation directe entre la personne qui
raconte l'histoire et le point de vue dans lequel les détails de l'histoire sont
présentés. On distingue trois types de focalisations : la focalisation zéro, la
focalisation interne et la focalisation externe.
2-1- La focalisation zéro
« On parlera de focalisation zéro lorsque le récit n’est focalisé sur aucun
personnage. Il s’agit donc d’une absence de focalisation : le narrateur, n’ayant pas
à adapter ce qu’il dit au point de vue de telle ou telle figure, ne pratique aucune
1 Albert Cohen, op.cit, p. 119. 2 Vincent Jouve, Poétique du roman, p. 39, 40.
31
restriction de champ et n’a donc pas à sélectionner l’information qu’il délivre au
lecteur. Le seul point de vue qui, en focalisation zéro, organise le récit, est celui du
narrateur omniscient. »1
La focalisation zéro renvoie à un point de vue omniscient du narrateur. Il sait plus
que les personnages. Le narrateur connait les pensées, les faits et les gestes de tous
les personnages. Le narrateur est à la base de son récit, il est omniscient, il se trouve
partout, il connait même les moindres détails de son histoire, car il est en train de
raconter sa propre vie qu’il a vécue. L’histoire n’est focalisée sur aucun personnage.
Le narrateur n’exerce aucune limitation ou ajustement de champ.
Prenons ce passage :
« J'entends ma mère qui me dit avec son sourire
sage : « Cette vie ne te conviendrait pas,
tu ne pourrais pas, tu resterais le même. »
Et elle ajoute ce qu'elle m'a dit tant de fois
en sa vie : « Mon seigneur un peu fou, mon
prince des temps anciens. » Elle dit encore, en
se rapprochant : « Et puis, je n'aimerais pas
que tu changes, ne sais-tu pas que les mères
aiment que le fils soit supérieur, et même un
peu ingrat, c'est signe de bonne santé. »2
Dans ce passage le narrateur sait les paroles et les sentiments du protagoniste (sa
mère). Ici, le narrateur se souvient les mots de sa mère et manque ces moments avec
elle. Son omniscience lui permet d’avoir une profonde connaissance dans le fond du
protagoniste. Il n’y a pas d’ajustement de champ. Alors nous somme en focalisation
zéro.
1 Vincent Jouve, Poétique du roman, p. 40. 2 Albert Cohen, op.cit, p. 124.
32
2-2- La focalisation interne
« On parlera de la focalisation interne lorsque le narrateur adapte son récit au
point de vue d’un personnage. C’est donc ici qu’il y a restriction de champ et
sélection de l’information. Le narrateur ne transmet au lecteur que le savoir
autorisé par la situation du personnage. En focalisation interne, le savoir du lecteur
sur l’histoire ne peut donc excéder celui d’une figure particulière. »1
Le narrateur en sait autant qu'il connaît le personnage focalisateur. Il ne peut pas
connecter les pensées des autres personnages. C'est donc là que la portée et le choix
des informations sont limités. Le narrateur transmet seulement au lecteur la
connaissance que la situation du personnage permet. Par conséquent, La
connaissance de l'histoire du lecteur ne peut excéder une certaine connaissance
personnelle.
Prenons ce passage :
« Nous ne connaissions personne à Marseille.
Fiers quoique pauvres, nous ne fréquentions
personne. Ou plutôt, personne ne nous
fréquentait. Mais nous ne nous l'avouions
pas ou, peut-être, ne nous en rendions-nous
pas compte. Nous étions si nigauds, si perdus
en cet Occident, et si peu dégourdis que
lorsque mes parents faisaient du feu dans la
cheminée, ils mettaient non des bûches mais
de minces planchettes aussitôt consumées. »2
Dans ce passage le narrateur décrit la souffrance de sa famille qui s’est rendues à
Marseille lorsqu’ils ne connaissent personne. Il parle de la difficulté d'une vie
misérable, a tel point que ses parents utilisaient de petits panneaux chauffants qui ne
suffisaient pas pour durer longtemps.
1 Vincent Jouve, Poétique du roman, p. 41. 2 Albert Cohen, op.cit, p. 43.
33
2-3- La focalisation externe
« On parlera de la focalisation externe lorsque l’histoire est racontée d’une façon
neutre comme si le récit se confondait avec l’œil d’une caméra. Alors qu’en
focalisation zéro le narrateur en sait plus que le personnage et qu’en focalisation
interne il en sait autant que lui, en focalisation externe il en sait moins que lui. »1
Le narrateur connaît moins les personnages. Il est très similaire à l'œil de la
caméra, car il suit les actions des personnages de l'extérieur, mais il ne peut pas
deviner leurs pensées. L'histoire donc être racontée de manière neutre. Cette
focalisation se traduit par cette forme (Narrateur < Personnage).
Prenons ce passage :
« Allongée dans le grand dortoir, indifférente,
piteusement seule, celle qui s'était réjouie
de cette bonne place dans le train et de
cette chance, tant réjouie de toute sa large
face. Allongée et insensible, celle qui s'était
enfantinement réjouie de la belle robe que je
lui avais offerte. Où est-elle, cette maudite
robe qui vit encore, elle, quelque part et avec
l'odeur de ma mère? »
Le narrateur souffre et ne veut pas accepter l'idée que sa mère est morte. Il évoque
un souvenir devant le train et se demande où est-elle et sa robe ici ?
1 Vincent Jouve, Poétique du roman, p. 41.
34
3- L’auteur/narrateur
« L’écrivain est celui qui existe ou à existé, en chair et on os, dans notre monde.
Le narrateur est celui qui semble raconter l’histoire à l’intérieur du livre mais
n’existe qu’en mots dans le texte. Il constitue, en quelque sorte, un énonciateur
interne. Cette distinction fonde en grande partie la liberté de l’écrivain ».1
L’auteur est une personne réelle qui a écrit l’histoire de son histoire, on trouve
toujours son nom inscrit dans la page de couverture de son livre. Contrairement à
l’auteur, le narrateur est une instance imaginaire joue le rôle de raconter l’histoire
écrit par l’auteur, donc le narrateur créé par l’auteur afin de raconter les événements
passes dans le roman.
Prenons cet extrait :
« A dix-huit ans, je quittai Marseille et j'allai
à Genève où je m'inscrivis à l'Université et
où des nymphes me furent bienveillantes.
Alors, la solitude de ma mère devint totale.
Elle était déracinée à Marseille. »2
Dans cet extrait le narrateur raconte ses débuts où il a fait ses études secondaires
à Marseille. Après il a poursuivi ses études universitaires à Genève. La narration est
à la première personne (JE). Cette technique permet au narrateur d’être un
personnage principal dans l’histoire qu’il raconte.
Le roman qui est entre nos mains est un roman autobiographique, Albert Cohen
l’auteur a écrit son roman, et Albert Cohen le narrateur raconte sa propre vie, il
assume deux fonctions, la narration et l’écriture, ce critère on le trouve dans les
romans autobiographiques qui contiennent des faits réels qui sont déjà passés dans
la vie de l’auteur. Automatiquement il ne peut pas se cacher derrière une autre
personne car c’est son propre histoire qui la déjà vécu.
1 Yves REUTER, Introduction à l’analyse du roman, Ed Armand Colin, Paris, 2006, p. 36. 2 Albert Cohen, op.cit, p. 57.
35
4- Les fonctions du narrateur
« Selon la perspective et le mode choisi, le narrateur apparaitra plus au moins
dans la narration. Dans le mode du raconter, il pourra intervenir directement, en
assumant des fonctions complémentaires et plus variées que celles que tient tout
narrateur. »1
Le narrateur apparaît plus ou moins dans l’histoire qu’il raconte. Il peut intervenir
directement, pour assumer des fonctions intégrées et plus diversifiées, Cela dépend
de la perspective et de la situation choisie. Dans notre corpus nous avons constaté
que le narrateur assume en grande partie deux fonctions : fonction de
communication et fonction testimoniale.
4-1- La fonction de communication
« La fonction communicative consiste à s’adresse au narrataire pour agir sur lui
ou maintenir le contact. »2
La fonction communicative permet au narrateur de créer et instaure un contact un
contact direct avec le narrataire.
Prenons cet extrait :
« A neuf heures du soir, ma mère plia bagage
et nous allâmes attendre le tram, près de la
vespasienne aux relents mélancoliques, tout
en regardant, hébétés et comme hypnotisés,
les riches qui arrivaient joyeusement en bande
et en voiture jouer à la roulette du Casino.
Nous, on attendait silencieusement le tram,
humbles complices. Pour chasser la neurasthénie
de cette solitude à deux, ma mère chercha
un sujet de conversation. « En rentrant,
1 Yves REUTER, Introduction à l’analyse du roman, p. 64. 2 Ibid.
36
je te recouvrirai tes livres de classe avec du
joli papier rose. » Sans comprendre pourquoi,
j'eus envie de pleurer et je serrai fort la
main de ma mère. La grande vie, comme vous
voyez, ma mère et moi. Mais on s'aimait. »1
Dans cet extrait Le narrateur raconte une journée où il a voyagé avec sa mère. Ils
attendaient tranquillement le tram. Ils regardaient des gens riches et heureux en
groupes dans des voitures de luxe. La mère coupe ce calme et promit à son fils
qu'elle envelopperait ses cahiers de rose, mais sans préciser la raison. À ce moment-
là, il embrassa les mains de sa mère et eut envie de pleurer. Mais malgré toutes ces
souffrances, leurs vies étaient heureuses avec tout l'amour. On retrouve donc le
narrateur essayant d'ouvrir un canal de communication avec sa mère.
4-2- La fonction testimoniale
« Le Narrateur atteste la vérité de son histoire, le degré de précision de sa
narration, sa certitude vis-à-vis les événements, ses sources d’informations, etc.
Cette fonction apparaît également lorsque le Narrateur exprime ses émotions par
rapport à l’histoire, la relation affective qu’il entretient avec elle (implication). »2
Cette fonction apparaît lorsque le narrateur exprime ses sentiments par rapport à
l'histoire et le lien émotionnel qu'il entretient avec elle. Il témoigne et reconnaît la
véracité de son histoire, le degré d'exactitude des événements et les sources de ses
informations.
Prenons ce passage:
« Je me retourne et je vois des objets qu'elle
a vus et touchés. Ils sont là, près de moi, ce
stylo, cette valise. Mais elle, elle n'est pas là.
Je l'appelle par son nom de majesté et elle 1 Albert Cohen, op.cit, p. 50. 2 Lucie Guillemette et Cynthia Lévesque, La narratologie, Signo, Théories sémiotiques appliquées, Québec 2006. En suivant les travaux de G. Genette, Figures III, édition Seuil, Paris, 1972, p. 129.
37
ne répond pas. Ceci est horrible car toujours
elle répondait et si vite elle accourait. Que je
l'ai appelée en sa vie, pour tout, pour rien. »1
Dans ce passage, le narrateur nous parle des choses (ce stylo, cette valise) qu'elle
lui rappelle lorsqu'il la voit. Il décrit le sentiment horrible qu'il ressent lorsqu'il
l'appelle et qu'elle ne lui répond pas, après qu'elle avait l'habitude de venir le voir
rapidement s'il l'appelait. Donc on découvre à quel point le narrateur a besoin de sa
mère et lui manque à tout moment de sa vie.
1 Albert Cohen, op.cit, p.128.
Troisième chapitre: Le temps du récit et le temps de l’histoire
1- L’ordre temporel
2-La vitesse narrative
2-1 La pause
2-2 La scène
2-3 Le sommaire
2-4 L’ellipse
3-La fréquence événementielle
3-1 Le mode singulatif
3-2 Le mode répétitif
3-3 Le mode itératif
4-Les valeurs temporelles
40
Dans ce chapitre nous aborderons d'autres techniques narratives. En premier lieu
nous allons expliquer l’ordre temporel et ses deux grands types d’anachronies
narratives. Ainsi nous analyserons la vitesse narrative.
En dernier lieu nous traiterons la fréquence événementielle et les valeurs
temporelles.
1- L’ordre temporel
Selon Yves REUTER: «Il existe deux grands types d’anachronies narratives.
L’anachronie par anticipation (appelée prolepse ou cataphore), qui consiste à
raconter ou à évoquer à l’avance un événement ultérieur. L’anachronie par
rétrospection (appelée analepse ou anaphore, ou encore « flash-back » dans le
cinéma), qui consiste à raconter ou à évoquer après coup un événement
antérieur ».29
L'histoire qui est racontée passe par des événements et des faits bien définis et
dans une séquence définie. La succession de ces événements peut s'arranger selon le
cours véritable de l'histoire ou bien dans le chaos. Le narrateur utilise un style ou un
technique pour faire passer le message. La présentation des actions et des faits dans
le récit est insuffisante et ne correspond pas à leur véritable ordre. Cet ordre
chronologique est utilisé comme méthode ou processus dans un but précis.
« Genette désigne ce désordre chronologique par anachronie. Il existe deux
types d’anachronie :
1. L’analepse : Le Narrateur raconte après-coup un événement survenu avant le
moment présent de l’histoire principale.
2. La prolepse : Le Narrateur anticipe des événements qui se produiront après la
fin de l’histoire principale.»30
29 Yves REUTER, Introduction à l’analyse du Roman, p. 80.
30 Lucie Guillemette et Cynthia Lévesque, La narratologie, Signo, Théories sémiotiques appliquées, Université du Québec, 2006.
41
Le narrateur parle de son enfance puis il saute et raconte la souffrance et sa
solitude après la mort de sa mère, après il s’engage a raconter ses souvenirs, toutes
ces raisons là ont causé ce qu’on appelle une anachronie. Les anachronies peuvent
avoir plusieurs valeurs dans un récit. Si les analepses acquièrent une fonction
explicative, alors que la psychologie d’un personnage est développée à partir des
événements de son passé, les prolepses peuvent quant à elles exciter la curiosité du
lecteur en dévoilant partiellement les faits qui surviendront ultérieurement.
Notre récit est un concentré d’analepses, le narrateur raconte après-coup un
événement survenu avant le moment présent de l’histoire principale.
2- La vitesse narrative
Selon Yves REUTER : «la vitesse concerne le rapport entre la durée fictive des
événements (en années, mois, jours, heures …) et la durée de la narration (ou plus
exactement de la mise en texte, exprimée en nombre de pages ou de lignes) »31
Cela signifie que le temps du récit commensurable, en termes de volume
(mesurable en nombre de lignes ou de pages), un temps de narration quantifiable en
siècle, années, jours, minutes ...
« Le narratologue répertorie quatre mouvements narratifs (1972 : 129) (TR :
temps du récit, TH : temps de l’histoire) :
1. La pause : TR = n, TH = 0 : L’histoire événementielle s’interrompt pour laisser la
place au seul discours narratorial. Les descriptions statiques font partie de cette
catégorie.
2. La scène : TR = TH : Le temps du récit correspond au temps de l’histoire. Le
dialogue en est un bon exemple.
31 Yves REUTER, Introduction à l’analyse du Roman, p. 80.
42
3. Le sommaire : TR < TH : Une partie de l’histoire événementielle est résumée
dans le récit, ce qui procure un effet d’accélération. Les sommaires peuvent être de
longueur variable.
4. L’ellipse : TR = 0 ; TH = n : Une partie de l’histoire événementielle est
complètement gardée sous silence dans le récit. »32
2-1 La pause
La pause relative à un ralentissement du temps de l'histoire, dans lequel il ne se
passe rien ou peu de choses. Il s'agit de fragments non narratifs, tels que des
descriptions et des commentaires.
Prenons cet extrait :
« L'après-midi du vendredi, qui est chez les
Juifs le commencement du saint jour de sabbat,
elle se faisait belle et ornée, ma mère.
Elle mettait sa solennelle robe de soie noire
et ceux de ses bijoux qui lui restaient encore.
Car j'étais prodigue en ma rieuse adolescence
et je donnais des billets de banque aux mendiants
lorsqu'ils étaient vieux et avaient une
longue barbe. Et si un ami aimait mon étui
à cigarettes, l'étui d'or était à lui. »33
Dans cet extrait le narrateur décrit trop, il prend son temps quand il écrit, il fait
très souvent des redondances et se répète beaucoup, il fait aussi beaucoup de
flashback sur son enfance. Il répète des événements et des souvenirs afin de les faire
revivre.
32 Lucie Guillemette et Cynthia Lévesque, La narratologie, Signo, Théories sémiotiques appliquées, Université du Québec, 2006. 33 Albert Cohen, op.cit, p. 14.
43
2-2 La scène
La scène est quand le temps du récit correspond au temps de l’histoire. Elle
recourt généralement au dialogue, créant l'illusion que le temps passé à lire reflète le
temps passé par le narrateur ou le personnage dans la conversation. Les nombreux
dialogues dans notre corpus sont des bons exemples :
« Elle me dit soudain qu'elle aurait
préféré que je sois médecin, avec un beau
salon et une lionne de bronze, et que j'aurais
été plus heureux ainsi. « Maintenant que je
suis morte, je peux bien te le dire. » Puis elle
me demande si je me rappelle notre promenade,
le jour des souliers de daim. « On était
heureux », me dit-elle. Pourquoi ai-je sorti
de ma poche un énorme faux nez de carton?
Pourquoi m'en suis-je affublé royalement et
pourquoi maintenant »34
Nous remarquons que Le temps de notre lecture de ce dialogue est égal au temps
qu’il met à se dérouler. C'est-à-dire qu’il y a une égalité entre le temps du récit et le
temps de l’histoire (TR = TH). Le narrateur essaie de faire vivre le lecteur avec lui
dans l'instant de narration.
2-3 Le sommaire
Le sommaire est un résumé en quelques mots ou quelques lignes d’une longue
durée de l’histoire ce qui provoque un effet d’accélération.
34Albert Cohen, op.cit, p. 115.
44
2-4 L’ellipse
L'ellipse consiste à omettre certains éléments logiquement nécessaires à la
compréhension du texte, il s'agit en fait d'ignorer certains événements afin
d'accélérer le récit.
3-La fréquence événementielle
3-1- Le mode singulatif : 1R / 1H : On raconte une fois ce qui s’est passé une
fois. nR / nH : On raconte n fois ce qui s’est passé n fois.
3-2- Le mode répétitif : nR / 1H : On raconte plus d’une fois ce qui s’est passé
une fois.
3-3- Le mode itératif : 1R / nH : On raconte une fois ce qui s’est passé plusieurs
fois.35
Prenons cet extrait :
« Mais rien ne me rendra ma mère, ne me
rendra celle qui répondait au nom de Maman,
qui répondait toujours et accourait si vite au
doux nom de Maman. Ma mère est morte,
morte, morte, ma mère morte est morte,
morte. »36
La fréquence événementielle narrative est la relation entre le nombre d'un
événement dans l'histoire et le nombre de fois où il est mentionné dans l'histoire.
Dans notre corpus, le mode de répétitif existe toujours, c'est-à-dire lorsqu'un
événement est raconté plusieurs fois dans l'histoire, et que notre auteur narrateur se
répète beaucoup (la mort de sa mère). 35 Lucie Guillemette et Cynthia Lévesque, La narratologie, Signo, Théories sémiotiques appliquées, Université du Québec, 2006. 36 Albert Cohen, op.cit, p. 174.
45
4-Les valeurs temporelles
«De façon similaire, les indications temporelles peuvent « ancrer » le texte
dans le réel lorsqu’elles sont précises et correspondent à nos divisions, à
notre calendrier ou à des événements historiques attesté.»37
Le temps est une structure de base dans un travail fictif, car nous ne pouvons
pas imaginer une histoire ou un récit qui soit libre de cette structure pivot dans le
processus narratif. Les indications temporelles implicites données par une forme
verbale ce sont les valeurs des temps donc chaque mode a des significations et des
valeurs différentes, de même que chaque temps, selon le contexte dans lequel est
employé. La valeur temporelle est la valeur de base des formes de langage, elle
localise des faits ou des actions selon la chronologie : avant, en même temps ou
après le moment de référence.
Dans notre corpus on peut constater un désordre temporel au niveau de la
narration, car l’auteur parle de son enfance puis il saute et raconte la souffrance et
sa solitude après la mort de sa mère, après il s’engage a raconter ses souvenirs
quand il était étudiant à l’université de Genève, donc il nous semble approprié de
remettre en question la valeur et la signification des temps verbaux utilisés.
4-1-Le présent de la narration
« Dans le sens strict, le présent indique que le fait a lieu au moment même de la
parole » 38 . Dans un récit autobiographique, l'utilisation du présent peut avoir
plusieurs interprétations, l’une de ces utilisations est le présent d’énonciation
exprime les faits situés au moment ou l’on parle. « Chaque homme est seul et tous
se fichent de tous et nos douleurs sont une île déserte ».39
Un autre emploi à prendre en compte est Le présent de narration rapporte des
faits passés ; il s’emploie pour rapporter des actions passées en rendant plus
vivantes, et donne une impression de direct. « Va, je t'aime, ma seule consolation, 3Yves Reuter, Introduction à l’analyse du roman, p. 57. 38 Le petit Grevisse, Grammaire française, Bruxelles, de Boeck, 2005, p185. 39 Albert Cohen, op.cit, p. 09.
46
va sur les pages où tristement je me complais et dont le strabisme morosement me
délecte ».40
4-2-L’imparfait
L’imparfait évoque l’arrière plan du récit (description du décor et
personnages), il s’emploie dans les descriptions (installer le décor et même les
personnages dans leur situation spatio-temporelle. « L'après-midi du vendredi, qui
est chez les Juifs le commencement du saint jour de sabbat, elle se faisait belle et
ornée, ma mère. Elle mettait sa solennelle robe de soie noire et ceux de ses bijoux
qui lui restaient encore ».41
C'est un temps itératif, il s’emploie pour des actions qui se répètent. « Ayant fini
d'orner pour le sabbat son humble appartement qui était son juif royaume et sa
pauvre patrie, elle était assise, ma mère, toute seule, devant la table cérémonieuse
du sabbat et, cérémonieuse, elle attendait son fils et son mari ».42
4-3-Le passé composé
Le passé composé exprimer une action qui a été complètement accomplie sans
précision de date ni de durée. « Elle m'a porté pendant neuf mois et elle n'est plus
là ».43
Il signifie le fait qu’il est complètement terminé à un moment donné, ou le
passé est indéfini. Il évoque une vérité générale ou une action passée par rapport
au moment où l’on parle ou écrit, « qu'elle est venue me voir en secret ».44
40 Albert Cohen, op.cit, p. 10. 41 Ibid. p. 14. 42 Ibid. p. 16. 43 Ibid. p. 119. 44 Ibid. p. 117.
Quatrième chapitre : L’analyse des personnages
1-Le personnage
2-La classification des personnages
2-1 Le héros
2-2 Les personnages principaux
2-3 Les personnages d’arrière-plan
3- La classification sémiologique selon Philippe Hamon
49
À propos de ce Barthes Roland a dit : « il n y a pas de récit sans personnages »1.
Un roman est une série d’événements qui raconte une histoire décrivant des
personnages et des événements fictifs.
C’est aussi le plus grand genre fictif en termes de taille, de multiplicité de
personnages et de diversité d’événements.
Là où chaque roman a une histoire, l’histoire a donc des événements qui se
déroulent dans le roman. Et donc ces évènements sont mis en œuvre par les
personnages parce qu’ils sont à la base de chaque roman. Les personnages animent
l’histoire et lui confèrent une dimension de réelle.
Chaque personnage peut avoir des caractéristiques qui le distinguent d’un autre
personnage. Il peut jouer différents rôles, le roman se compose de conflit, de
dialogue et de description entre eux.
1- Le personnage
Roland Barthes, il prétendait que le personnage venait d'un roman, mais il
montrait au lecteur la réalité que l'auteur voulait déclarer à travers son
personnage: « c’est devenu un individu, bref un être pleinement constitué… le
personnage a cessé d’être subordonné à l’action, il a incarné d’emblée une essence
psychologie »2.
Dans les œuvres dramatiques et narratives, basées sur l'histoire, les personnages
ne sont plus liés à une action unique, mais incarnent une sorte d'essence
psychologique.
Les personnages sont les éléments qui portent les effets des événements. Ils sont
souvent créés par les auteurs pour assumer certaines fonctions qui aident les auteurs
à transmettre des informations et à assurer le succès du roman. Par conséquent, les
personnages sont les plus importants. Les éléments de base de toute œuvre littéraire.
1 BARTHES Roland, Introduction à l’analyse structurale du récit, 1996. p. 75. 2 Joelle Gardes – Tamine, Marie –Claude Hubert, Dictionnaire de critique littéraire, Ed Armand Colin, Paris,
1999, p 155.
50
D'une part, ces essences peuvent être comptées par type, et d'autre part, elles sont
la connaissance et la compréhension des personnages.
Le rôle de la transformation littéraire en tant que « personne » se manifeste dans
le « réalisme psychologique », faisant en sorte que ce rôle réponde à certaines
normes.
Le personnage occupe une place importante dans la structure de la forme
narrative, car il est du côté objectif un outil et le moyen pour le narrateur d’exprimer
sa vision, et du point de vue technique, il est l’énergie motrice autour de laquelle
tous les des éléments de la narration sont lancé, comme le plus souvent il provient
du côté de l’auteur Où chaque personnage a une fonction qui aide l’auteur à
communiquer son message et donc son succès, nous concluons que le personnage
est une composante essentielle et importante du roman.
En écrivant, l’auteur transmet ses pensées et ses sentiments à l’aide des
personnages du roman.
Prenons l’extrait suivant :
« Nous ne connaissions personne à Marseille où, de notre île grecque de Corfou
nous avions débarqué comme en rêve, mon père, ma mère et moi, comme en un rêve
absurde, un peu bouffon. Pourquoi Marseille? Le chef de l'expédition lui-même n'en
savait rien. Il avait entendu dire que Marseille était une grande ville. »1
Le narrateur est né à Corfou, puis ils ont atterri dans la célèbre métropole
française Marseille. En tant que nouvelle destination. Le narrateur raconte ici ses
débuts avec de sa famille et le changement qui les a touchés, lorsqu'ils ont voyagé
pour la première fois à Marseille, le célèbre pays, et où ils ne connaissaient
personne.
Pourquoi Marseille ? Peut-être parce que c'est une ville grande, célèbre et où le
père allait trouver du travail.
1 Albert Cohen, op.cit, p. 34.
51
A travers cet extrait, l'écrivain parle de l'espace, comme s'ils transportaient " à
Marseille de leur île grecque de Corfou " et le ressentaient comme un rêve ridicule.
Il utilise l’imparfait pour raconter les souvenirs, et parler de leur début, et c'est
parce qu'il ne veut pas quitter son passé et y rester et prolonger la narration en
parlant de tous les détails de sa mère en raison de son désir pour elle.
Selon Milan Kundera :
« Dans son livre L'Art du roman, Milan Kundera retrace l'évolution que l'on peut
observer dans le roman, selon lui, de Don Quichotte de Crevantes. Inviolable :
donner le plus d'informations possible sur son apparence physique et sa manière de
parler et de se comporter ; la révélation de son passé, dans laquelle se trouvent
tous les motifs de son comportement actuel ; Le personnage doit avoir une
indépendance totale : l'auteur et ses considérations doivent disparaître pour ne pas
déranger le lecteur qui veut succomber à l'illusion et considérer la fiction comme
une réalité ».1
Le narrateur fournit autant d'informations que possible sur le personnage. À
l'intérieur du roman, chaque personnage est complètement différent d'un autre
personnage en termes de statut social, d'apparence, de comportement et même de
sa vie passée, qui se considère comme une motivation pour le faire réagir.
Le personnage doit être libre et indépendant, et l'auteur doit lui donner
suffisamment de canaux pour permettre aux lecteurs de vivre le roman de manière
réelle.
Prenons l’extrait suivant :
« Elle restait là, assise et toute amour familial, à leur énumérer déjà en pensée tout
ce qu'elle avait cuisiné et lavé et rangé. De temps à autre, elle allait à la cuisine
faire, de ses petites mains où brillait une auguste alliance, d’inutiles et gracieux
tapotements artistes avec la cuiller de bois sur les boulettes de viande qui
mijotaient dans le coulis grenat des tomates. Ses petites mains potelées et de peau si
1 KUNDERA, L’Art du roman, Éditeur Gallimard, (2 février 1995).
52
fine, dont je la complimentais avec un peu d’hypocrisie et beaucoup d’amour, car
son naïf contentement me ravissait.».1
Dans cet extrait, l'auteur évoque l'aspect psychologique, il Passe une bonne
enfance avec sa mère, de bons souvenirs qui lui ressemblent, les moments joyeux et
heureux de cette période, une famille idéale et le grand amour qui existe entre le fils
et la mère.
Ce qui l'a amené à rechercher les souvenirs de sa mère d'elle assise, cuisinant et
lavant, pour revivre avec elle en écrivant des mémoires. Pour oublier aussi sa
tristesse et sa douleur, en écrivant à son sujet, sa nostalgie et son désir d'elle
diminuent.
Il a offert à sa mère l’éternité. L’imparfait, ce passe inachevé, renforcé par " là", ce
déictique « La déictique sont des termes « pronoms personnels ou démonstratifs,
adverbe de lieu ou de temps, déterminants ou pronoms possessifs » qui ne prennent
leur sens que dans le cadre de la situation d’énonciation. Les déictiques désignent
les partenaires de la communication : locuteur et allocutaire « ici », « là », « hier »,
etc. sont des mots déictiques car ils ne sont compris quel lorsque la situation
d’énonciation est connue. »2
Une précision spatiale, d’excite un sentiment rageux de manque et de nostalgie.
Cette mère, "amour", que la vie a faite de tendresse et de compréhension, était pour
a famille une source de confort et de bienveillance.
« toute amour » le narrateur ajoute une personnification de type de figure de style,
il incarne l'amour de sa famille, nous avons trouvé la gradation et l’énumération de
tout ce que fait sa mère.
La mécanique narrative ainsi construite permet une extension du temps. Un
prolongement dans l’indéfini de la vie d’une mère que la narration ne veut pas voir
finir.
1 Albert Cohen, op.cit, p. 18. 2 https://www.etudes-littéraires.com/figures-de-style/deicrique.php. Consulté le 10/06/2021.
53
2- La classification du personnage
L’histoire montre l’importance des personnages en fonction de leur rôle et de leur
position, car ils sont au centre d’idées ont la première place dans le roman. Selon les
théoriciens, on peut classer entre 3 classes de personnages :le héros, les personnages
principaux, et les comparses.
2-1- Le héros
Philipe Hamon propose de le considérer comme un personnage qui subit un phénomène d’emphase, d’intensification, il se différencie des autres personnages
par sa qualification, sa distribution, son autonomie et sa fonctionnalité. Il est aussi(…) l’objet d’un pré désignation et d’un commentaire explicite.1
Selon Philippe Hamon, le héros a des caractéristiques qui le rendent spécial dans
l'histoire. Le héros a des qualités et des rôles qui créent des caractéristiques qui le
distinguent des autres personnes de l'histoire. Le centre de l'histoire est la personne
qui prend les principales décisions et qui en supporte les conséquences. Le héros
influence les circonstances des autres personnages, car c'est lui qui crée le reste des
personnages. Tous les personnages de l'histoire sont causés par la relation qu'ils
entretiennent avec le protagoniste.
Prenons ces extraits suivant : « Soudain je me rappelle notre arrivé à
Marseille .J’avais cinq ans. En descendant du bateau, accroché à la jupe de maman
coiffée d'un canotier orné de cerises, je fus effrayé par les trams, ces voitures qui
marchaient toutes seule ».2
« J'étais paradoxalement le préféré des douces sœurs catholiques. Elles me
donnaient des leçons de maintien, me recommandaient d'avoir une contenance
modeste et de ne jamais balancer mes bras dans la rue, comme un mondain ».3
1 ACHOUR Cristiane, BEKKET, Amina, Clefs pour la lecture des récits (convergences critiques 2), Editions du Tell, 2002, p. 50.
2 Albert Cohen, op.cit, p. 12.
3Ibid. p. 13.
54
« Je me souviens aussi de nos promenades du dimanche, en été, elle et moi, tout
jeune garçon. On n'était pas riches et le tour de la Corniche ne coûtait que trois
sous ».1
« O mon passé, ma petite enfance, ô chambrette, coussins brodés de petits chats
rassurants, vertueuses chromos, conforts et confitures, tisanes, pâtes pectorales,
arnica, papillon du gaz dans la cuisine, sirop d'orgeat, antiques dentelles, odeurs,
naphtalines, veilleuses de porcelaine, petits baisers du soir, baisers de Maman qui
me disait, après avoir bordé mon lit, que maintenant j'allais faire mon petit voyage
dans la lune avec mon ami un écureuil ». 2
On considère le narrateur comme le héros de son histoire parce qu'il nous raconte
l'histoire.
Dans ces extraits, le narrateur parle de nostalgie et veut remonter dans le passé et
revivre une série de comportements laissés en mémoire. L'auteur nous raconte avec
un enthousiasme extraordinaire ses souvenirs avec sa mère, combien ils sont
intéressants quand ils sont ensemble, ils réagissent naturellement, ne faisant jamais
semblant de sourire. Il raconta l'histoire de sa mère allant à Genève pour le revoir, et
comment elle lui avait préparé quelques jours, le saint sabbat juif, et les plats que sa
mère lui préparait, tous nostalgiques.
Prenons l’extrait suivant :
« Ton enfant est mort en même temps que toi. Par ta mort, me voici soudain de
l'enfance à la vieillesse passé. Avec toi, je n'avais pas besoin de faire l'adulte ».3
« C'est le seul faux bonheur qui me reste, d'écrire sur elle, pas rasé, avec la
musique inécoutée de la radio, avec ma chatte à qui, en secret, je parle dans le
dialecte vénitien des Juifs de Corfou, que je parlais parfois avec ma mère. »4
1Albert Cohen, op.cit, p. 15. 2 Ibid. p. 19. 3 Ibid., p. 18. 4.Ibid. p. 27.
55
Dans ces deux extraits, la mort de la mère apporta une douleur inévitable à son
fils, qui se retrouva seul dans un monde vaste et violent. Même s'il avait peur, il ne
pouvait pas oublier sa mère, surtout dans la nuit noire, quand il était seul dans la
chambre à fumer une cigarette et allongé sur le lit, il ne pouvait toujours pas oublier
sa mère.
2-2- Les personnages principaux
Dans chaque œuvre de fiction, il y a des personnages qui interprètent un acte
principal ainsi que des personnages qui jouent des rôles secondaires.
Le personnage principal est un élément important et essentiel dans les événements
de l'histoire.
Dans une œuvre de fiction, on peut retrouver plusieurs personnages principaux
dans un même roman, et ils sont décrits par les rôles qui leur sont attribués.
Ces rôles sont souvent détaillés là où ils ont un certain prestige, c'est-à-dire que
l'écrivain se trouve d'abord au haut de la liste des personnages de l'œuvre de fiction.
Prenons l’extrait suivant :
« Mais ses yeux étaient magnifiques et ses mains étaient mignonnes et j'aimais
baiser ses mains. »1
Dans son roman, le narrateur tente de décrire sa mère et comment elle passe le
plus clair de son temps et ce qu'elle fait quand il est absent d'elle. Le narrateur
utilise l’imparfait pour décrire sa mère, pour la beauté de ses yeux et de ses mains.
Il souhaite lui baiser les mains jusqu'à son désir et sa nostalgie de ses traits, alors
qu'il revit ses traits dans son imagination, signe de sa grande souffrance à la suite de
sa séparation.
A travers cette description, on voit que le narrateur laisse un impact sur le lecteur,
qui est de la pitié pour lui et une tentative de comprendre ses sentiments. 1 Albert Cohen, op.cit. p. 10.
56
Prenons l’extrait suivant :
« A table, elle mettait tous les jours la place du fils absent. Et même, le jour
anniversaire de ma naissance, elle servait l'absent. Elle mettait les morceaux les
plus fins sur l'assiette de l'absent, devant laquelle il y avait ma photographie et des
fleurs. Au dessert, le jour de mon anniversaire, elle posait sur l'assiette de l'absent
la première tranche du gâteau aux amandes, toujours le même parce que c'était
celui que j'avais aimé en mon enfance. »1
Dans cet extrait, le narrateur démontre son grand amour pour sa mère, un amour
infini qui ne cesse de grandir de jour en jour, et un très fort sentiment d'affection et
de complicité à travers l'histoire. Le narrateur et sa mère sont sa seule inspiration.
Elle est tout dans sa vie, et il a partagé tous les détails de leur histoire d'amour
inexplicable qui l'a fait se sentir comme un couple, pas seulement une relation mère-
fils.
Dans cet extrait, le narrateur utilise le passé composé pour raconter des actions
passées et des faits qui se sont déroulés en quelques instants. Il parle de sa mère en
l'absence, comment elle s'est comportée comme si elle était présente.
Il a utilisé un outil désignant l'indicateur de temps " le jour ", car c'est aujourd'hui
l'anniversaire du narrateur, et sa mère était à table comme avec elle. L’imparfait,
pour expliquer que sa relation avec sa mère, était plus que la relation d'un fils et
d'une mère en raison de l'intensité de leur amour, et il la considérait comme l'amour
de son enfance.
Dans notre histoire, il y a deux personnages principaux pour lesquels nous ne
pouvons pas déterminer le rôle du héros,
Le personnage principal du roman est l'auteur décrivant sa mère et exprimant son
amour pour elle et son intérêt pour elle, Par contre, une mère qui aime son fils et ne
vit que pour lui. Le narrateur est le protagoniste de l'histoire, il est le roi de
l'histoire, il est au cœur de l'histoire, il est partout.
1 Albert Cohen, op.cit. p. 20.
57
2-3- Les personnages d’arrière-plan (les comparses)
Les comparses sont des éléments qui apparaissent occasionnellement dans
l’histoire, presque toujours absents, et du fait de leur bas statut et à l’opposé
extrême du statut de héros et autres personnages, ils interviennent de manière rare et
amicale (primaire, secondaire).
Prenons l’extrait suivant :
« Chaque sabbat, à Marseille, où je venais, de Genève, passer mes vacances, ma
mère nous attendait, mon père et moi, qui allions revenir de la synagogue avec les
brins de myrte à la main. »1
Le narrateur complète la bonne famille en présentant le père, car à Marseille, son
père se rendait régulièrement tous sabbat à la synagogue avec des brins de myrte.
Le narrateur n'avait pas besoin d'un troisième personnage pour continuer
l'histoire. Cependant, il y a un troisième personnage, qui est la figure du père, qui ne
l'a mentionné que parfois. Le narrateur utilise l’imparfait, c'est qu'il raconte ce qui
s'est passé dans un passé lointain, qu'il revient en arrière pour décrire sa vie avec sa
mère et tous ses souvenirs avec elle.
3-La classification sémiologique selon Philippe Hamon
Philipe Hamon a classé les personnages fictifs en trois types : les personnages
référentiels, les personnages embrayeurs et les personnages anaphores.
3-1- Les personnages Référentiels
« personnage historique (Napoléon trois dans les Rougons-Macquart , Richelieu
chez A. Dumas…), mythologique (Vénus, Zeus…) allégoriques (L’amour. Lahaine)
ou sociaux l’ouvrier, le chevalier, le picaro … tous renvoient à un sens plein et fixe,
1 Albert Cohen, op.cit, p. 16.
58
immobilisés par une culture, et leur mobilisation dépend directement du degré de
participation du lecteur à cette culture »1
Ce type de personnage est généralement utilisé dans les romans pour exprimer des
faits ou pour exprimer des faits ou pour faire penser à des souvenirs ou à des faits.
Comprend des personnalités historiques, sociales, religieuses et mythologiques.
La plupart de ces caractères font référence à une signification spécifique et fixe qui
est définie par une culture et leurs lectures sont liées à la compréhension du lecteur
de cette culture. Autrement dit, ses références sont différentes, déterminées par une
culture tribale acquise.
3-2- Les personnages embrayeurs
«Personnages porte parole, chœurs de tragédie antique, interlocuteurs
socratiques, personnage d’impromptus, coteurs et auteurs intervenant…personnage
de peintre, écrivains, des narrateurs, de bavard, d’artistes, etc. »2
Ce sont des personnages importants de l’histoire et peuvent être attribués à leurs
rôles utiles, c'est-à-dire qu’ils peuvent devenir des porte-parole, des potins et même
des personnages de chorale. Ils se considèrent comme un outil pour représenter des
auteurs ou des orateurs, et les personnages attrayants sont une sorte d’outil
permettant à l’auteur de faire la distinction entre ceux qui sont présents et ceux qui
sont présents.
3-3- Les personnages anaphores
« Ces personnages tissent dans l’énoncé du réseau d’appels et des rappels à
désossements d’énoncés disjoints et de longueurs variables, ils sont en quelques
sortes les signes mnémotechniques du lecteur ; personnages de prédicateurs,
1 HAMON Philippe., « pour un statut sémiologique du personnage », Poétique du roman, Ĕd. Du seuil, coll «
oints », 1977. p. 122. 2 Ibid.
59
personnages douées de mémoires, personnages qui sèment ou interprètent des
indices, etc ».1
Ces rôles sont responsables des fonctions de l’organisation pour éviter les
malentendus parmi les lecteurs et la confusion des idées dans l’histoire, ainsi que la
cohésion des évènements de l’histoire.
Sur la base de notre histoire, nous ne pouvons pas classer les personnages ni
comme des personnages référentiels, ni comme des personnages anaphores, ni
comme des personnages embrayeurs car l'histoire ne contient pas d'actions.
La théorie proposée par Philip Hamon peut être appliquée à n'importe quel rôle,
et la théorie est basée sur les trois axes de base.
Notre histoire s'articule autour de deux axes en raison du manque de personnages et
de rôles :
A- L’être
Le portrait
Il s'agit d'un ensemble de caractéristiques propres à un rôle spécifique en termes
de vêtements, de corps et de psychologie par rapport à d'autres rôles.
Le corps
La personnalité de l’auteur est l’apparence qui le rend unique, notamment la
couleur des yeux, la taille, le visage, les cheveux, etc.
Il est représenté par le sexe masculin ou féminin, avec des caractéristiques
corporelles différentes telles que la taille, la brièveté, la graisse, la minceur, les
défauts et les anomalies, qui peuvent être dues à l'hérédité ou à des événements. Le
conteur dans cette dimension dessine sa personnalité en fonction de ces
caractéristiques en plus d'autres traits distinctifs du personnage.
L’habit 1 HAMON Philippe., « pour un statut sémiologique du personnage », Poétique du roman. p. 122.
60
C’est le style des vêtements que porte le personnage, qui permet au lecteur de se
faire une idée des personnages de l’histoire tels que l’âge, le niveau intellectuel. Où
le style vestimentaire est un critère important et fondamental pour connaître la
signification des personnages.
La psychologie
L'auteur est la personne qui définit le personnage de l'histoire. Il a précisé le rôle
qu'il jouera. Il peut être généreux, amical, nerveux, paresseux, actif ... etc. Lorsque
les choix psychologiques de l’auteur sont pleinement étudiés, la personnalité du
personnage est très importante et le succès de son rôle garanti.
La biographie
C'est un type d'écriture littéraire, et une définition spécifique de ce type est
racontée à partir d'autres types et moins claire, c'est dans une narration de parties de
la vie d'une personne, et une autobiographie est la narration d'une personne de son
histoire de vie.
Prenons l’extrait suivant:
« Ce que je viens de me raconter, c'est un souvenir du temps où ma mère était déjà
vieille et où j'étais un adulte, déguisé en fonctionnaire international. Je venais, de
Genève, passer une partie de mes vacances à Marseille, chez mes parents. Ma mère
était heureuse de ce que son fils, qui avait, pensait-elle avec beaucoup
d'exagération, une si noble situation chez les Gentils, acceptât de bon cœur d'aller
chaque sabbat à la synagogue de Marseille. Je l'entends qui me parle. »1
Là où l’auteur parle précisément avec sa propre personnalité dans son
autobiographie, il mentionne des passages qui font ressortir sa vie et sa carrière, afin
que le lecteur en soit conscient et lui permette de représenter clairement le
personnage.
1 Albert Cohen, op.cit, p. 23.
61
Après lecture de notre corpus, nous pouvons confirmer que le narrateur est
autobiographique, car le narrateur raconte les faits réels de sa vie, il participe
donc à la narration en tant qu'élément principal, car l'élément qu'il a dit est le
sien, et à côté de lui, Non on les connaît, c'est pourquoi dans notre corpus, le
narrateur est en même temps le protagoniste.
Le narrateur, dans cet extrait utilise beaucoup de narration incomplète d'une seule
prise, pour décrire sa mère quand elle était vieille, heureuse et fière du métier de son
fils.
Traits psychologiques et physique
On voit que l'écrivain ne s'est pas beaucoup décrit et n'a pas assez décrit sa mère, il
y a une économie dans la description des personnages. On sait peu de choses sur le
caractère de l'écrivain et de sa mère, dans la description physique.
Quant aux traits psychologiques que nous observons chez notre écrivain, et parlant
fréquemment de sa mère, nous pouvons les déduire de ce qu'il dit ou fait.
62
L’être : Le tableau suivant illustrera mon analyse des personnages du roman
Les
personnages
Caractéristiques
physique
Caractéristiques
psychologique
La tenu
vestimentaire
Le
personnage
narrateur
Ma tête- un beau cœur –
mes jeunes et prestes
mains-dents acérées.
Peur-bonheur-
triste-pitié-
Joie-content-
douleur-calme-
folle-mal-
désespoir.
Sa mère
Ses petites mains ou
brillait une auguste
alliance- Elle était alors
si jolie, ma vielle
Maman.
Ses doigts de glace.
Fière-naïve-
heureuse-
Bouleversante de
bonheur.
Sa solennelle robe de soie
noire-
Ses bijoux.
63
Tentative de psychanalyse
Nous avons eu du mal à analyser ce personnage pour se décrire très peu lui-même
et sa mère, nous allons donc recourir à la psychanalyse sur lui pour pouvoir
découvrir son blocage.
D’après la définition approchée par Freud, on peut dire que la psychanalyse est
une bonne démarche, elle envisage l'étude de troubles physiques tels que
l'instabilité, la solitude et la tristesse, qui sont similaires à la situation de notre sujet
dans le corpus.
La psychanalyse est un bon processus qui consiste à étudier les troubles vécus par
le personnage principal.
Prenons l’extrait suivant :
« Dans ma solitude je me chante la douce berceuse, si douce, que ma mère m'a
chantée, ma mère sur qui la mort a posé ses doigts glacés et je me dis, Avec une
crise de gorge sèche qui ne veut pas sortir Je me dis que ses petites mains ne sont
plus chaudes et que je ne les rendrai plus jamais douces sur mon front. »1
La solitude caractérise la vie de notre héros, et il préfère aussi rester seul et loin
des humains, notre héros est très désolé de ne pas avoir passé assez de temps avec
sa mère, malheureusement il est sorti avec sa mère puis n'est pas venu. Quand il
était seul, il y pensait et disait que ce n'était pas un bon choix pour sa mère.
Le narrateur, après la mort de sa mère, préfère s'isoler des gens et rester seul dans
une pièce sombre, faisant ainsi de l'écriture une solution pour oublier sa mère et
conserver à travers elle les beaux souvenirs du départ.
La mort de sa mère a fait de lui une personne complètement différente du passé.
Son absence lui a laissé un vide inévitable, sur ce que nous pensons être la raison
principale de ses actions et de ses ennuis, car il l'a pleurée pendant de nombreuses
1 Albert Cohen, op.cit, p. 73.
64
années et n'a pas accepté son absence, la psychanalyse est donc un système que
nous suivons pour atteindre les choses cachées.
Le présent prédominant dans cet extrait, alors que le narrateur parle de sa
solitude, comment il la passait parfois, avec la chanson de sa mère.
Le narrateur, énumère son présent pour exprimer une habitude qu'il prend dans sa
solitude, et un fait qu'il voulait dire. Le narrateur a déploré sa mère qu'il ne pourrait
plus jamais mettre ses mains chaudes sur son front.
D’après Willie Apollon :
« La psychanalyse interpelle le sujet dans son rapport à la jouissance et à la
mort, à travers la maladie, le sexe, le désespoir, l’impasse totale, l’angoisse
paralysante et le sentiment du fin du monde…aussi la psychanalyse est-elle le
développement d’une expérience d’une expérience singulière faisant appel au sujet
et mobilisant toutes les ressources intimes pour résoudre ses problèmes. »1
Sur la base du concept de Willie Apollon, la psychanalyse est donc une discipline
qui nous guide, elle nous guide pour visiter des choses cachées que nos yeux ne
peuvent pas voir .Nous concluons que sa définition s'applique à notre personnalité,
qui souffre d'une instabilité remarquable, car il ressent après la mort de sa mère que
c'est la fin du monde. Ces problèmes qu'il a surmontés de chagrin et de désespoir
exigent une forte personnalité à surmonter.
Prenons l’extrait suivant:
« Je ne veux pas qu'elle soit morte. Je veux un espoir, je demande un espoir. Qui
me donnera la croyance en une merveilleuse vie où je retrouverai ma mère? Frères,
ô mes frères humains, forcez-moi à croire en une vie éternelle, mais apportez-moi
1 WILLY Apollon, une école pour la psychanalyse, pour le conseil d’Ethique de l’Ecole freudienne du
Québec, Septembre 1998.
65
de bonnes raisons et non de ces petites blagues qui me donnent la nausée tandis
que, honteux de vos yeux convaincus, je réponds oui, oui, d'un air aimable. »1
A chaque fois, notre héros confirme qu’il ne peut plus résister à une vie sans
mère, il l’aime tellement qu’il pense que sa vie ne vaut rien.
Notre personnage principal vit dans un groupe de souvenirs douloureux qui ne lui
permettent pas de vivre et de continuer sa vie comme le reste de l'humanité comme
s'il était le seul à avoir perdu sa mère.
Le narrateur croit au changement de sa vie vers le bonheur, et souhaite restaurer
sa mère, qui lui a causé une grande tristesse. Du début à la fin du roman, le cœur de
ce que le narrateur a dit était sa mère. Il a donné l'impression que sa mère était sa
vie. Bien que la description de son "corps" n'était pas assez adéquate, il ne nous a
pas donné Son nom ou son prénom, il cache juste ces informations personnelles,
mais il nous donne l'occasion de revivre avec sa mère de manière très touchante à
travers le choix des mots et le style d'écriture triste et sentimental. Mais vouloir la
retrouver à tout prix, vouloir simplement revivre la joie de l'enfance, lui a donné une
barrière psychologique dont même la littérature a du mal à se débarrasser.
Le narrateur a répété à plusieurs reprises le verbe «vouloir » pour révéler la réalité
de ce qu'il veut et refléter son importance dans le contenu de ces phrases répétées
comme un désir précieux pour lui sur lequel il ne peut pas faire de compromis, qui
réalise un équilibre entre émotion et parole.
Avec cette répétition, il a expliqué que sa vie n'est rien sans sa mère, et combien
elle lui manque, comme s'il avait besoin d'une dose d'espoir dans la vie dans
laquelle se trouve sa mère.
1 Albert Cohen, op.cit, p. 152.
66
B- Sublimation de la figure de la mère divine
Prenons l’extrait suivant :
« Ton enfant est mort en même temps que toi. Par ta mort, me voici soudain de
l'enfance à la vieillesse passé. Avec toi, je n'avais pas besoin de faire l'adulte. »p.53
L'histoire concerne la mère du narrateur, car le narrateur a écrit cette histoire en le
but de lui rendre hommage. Revenue de la cuisine, elle allait s'asseoir, très sage en
sa domestique prêtrise, satisfaite de son pauvre petit convenable destin de solitude,
uniquement ornée de son mari et de son fils dont elle était la servante et la
gardienne. »1
Un autre exemple : « L'après-midi du vendredi, qui est chez les Juifs le
commencement du saint jour de sabbat, elle se faisait belle et ornée, ma mère. Elle
mettait sa solennelle robe de soie noire et ceux de ses bijoux qui lui restaient
encore. »2
Tous ses mots et textes tournent autour de sa mère, ce qui indique qu'elle est dans
la vie du narrateur. Le personnage de la mère tutrice, généreuse, gentille, nounou,
comme il la décrit comme consacrant toute sa vie à son fils, le narrateur, qui n'a pas
fourni suffisamment d'informations personnelles sur lui et sa mère, même son nom
ne l'a pas mentionné dans le roman, et décrit sa beauté avec les bijoux qu'elle portait
et sur sa douceur et sa naïveté.
Le narrateur clarifie sa présence lorsqu'il se souvient de leur dialogue, tout en
clarifiant au lecteur certaines scènes par l'écriture. Le narrateur a beaucoup utilisé
l’imparfait, et a souvent utilisé ces extraits, indiquant qu'il parlait du passé. C'est le
moment idéal pour décrire le passé, les traits et les habitudes de sa mère.
Dans le premier extrait, « Ton enfant est mort en même temps que toi. Par ta
mort » on remarque qu'il y a une expression figurative qui est une métaphore de la
perte de l'amour de la vie et de la mort des sentiments de l'écrivain par la mort de sa
mère. 1 Albert Cohen, op.cit, p. 19. 2 Ibid. p. 14.
67
Dans le troisième extrait, le narrateur commence par l'indicateur de temps «après-
midi » qu'il emploie pour nous montrer l'heure et l'événement sur la ligne du temps.
Nous pouvons dire que la narration dans le passé incomplet, nous parle du
vendredi après-midi, qui est considéré comme le début du Saint Sabbat pour les
Juifs, et comment sa mère s'est préparée pour ce jour.
Prenons l’extrait suivant:
« Mon fils, explique-moi ce plaisir que tu as à aller à la montagne. Quel plaisir,
toutes ces vaches avec leurs cornes aiguisées, avec leurs gros yeux qui vous
regardent? Quel plaisir, toutes ces pierres? Tu risques de tomber, alors quel
plaisir? Es-tu un mulet pour aller sur ces pierres du vertige? N'est-ce pas mieux
d'aller à Nice, où il y a des jardins, de la musique, des taxis, des magasins? Les
hommes sont faits pour vivre en hommes et non dans les pierres, comme les
serpents. »1
Ce récit est réel au personnage maternel, bien qu'il n'y ait pas de personnages
secondaires dans l'histoire. L'histoire entre la mère et le fils portait sur une relation
tragique entre eux. La narration n'avait pas besoin d'un troisième personnage pour
continuer l'histoire. Parfois, il mentionnait son père.
Le présent, principalement dans cet extrait, alors que le narrateur a ouvert un
canal de communication avec sa mère, répétant des moments et des dialogues pour
gagner du temps et revivre avec elle, et c'est une indication du degré de son désir
pour elle.
Le narrateur lui explique l'adresse de sa mère et ses questions pour s'enquérir
d'elle, quand son fils part à la montagne, surpris par son comportement que la
campagne n'y est rien et qu'il ne peut y vivre à cause de sa difficulté, et lui conseille
aller dans un meilleur endroit en raison de la facilité de ses affaires et de son
développement.
1 Albert Cohen, op.cit, p. 28.
68
C- Occultation de la figure du père
La figure paternelle est classée comme une personnalité d'arrière-plan pour être
complètement absente, comme le narrateur y fait parfois référence. Pourquoi le
narrateur n'a-t-il pas pleuré son père comme celui de sa mère?
Nous voyons l'écrivain qu'il est en deuil blanc pour son père, bien qu'il ne l'ait pas
décrit comme violent ou cruel. Le père de l'écrivain était souvent absent et absent,
travaillant toute la journée, rarement à la maison et à table avec sa famille.
On en conclut donc que le narrateur a vu le monde aux yeux de sa mère, un
monde dans lequel il n'y a que sa mère et une mère qui voit le monde dans son fils.
Analyse des personnages dans le roman d'Albert Cohen Ma mère Nous avons
effectué une analyse sémiotique des personnages selon Philippe Hamon.
Nous avons remarqué que le personnage principal ne se distinguait pas par un
grand nombre de traits car il y a une absence totale d'informations personnelles,
cette étape ne nous a pas permis de les connaître beaucoup physiquement.
Nous avons analysé et catégorisé les personnalités selon la théorie de Philippe
Hamon sur la connaissance du rôle que jouent nos personnalités.
Nous concluons que notre expérience d'analyse des personnages est un gain pour
nous car elle nous donne un avant-goût des moments de souffrance et du partage de
sa vie douloureuse.
70
Conclusion
A la fin de notre travail qui s’intitule « Du temps pour le temps: Le cas de "Le livre de ma mère " d’Albert Cohen, nous avons posé la question de la manière dont le temps narratif est analysé dans notre groupe, de son applicabilité. Le temps narratif et ses réflexions sur notre auteur, notre roman et nos personnages.
Pour mieux illustrer notre travail, nous l'avons divisé en deux parties comportant
chacune deux chapitres.
Nous avons d'abord expliqué la temporalité narrative, puis nous avons inséré des
passages de notre roman pour prouver notre point de vue. Mais revient toujours à la
case départ, de sorte que le temps que regrette l'auteur-narrateur qui n'a pas passé
avec sa mère est chronique ou prolongé.
Dans les trois premiers chapitres, on peut très bien conclure ici que notre histoire
est passée par presque toutes les techniques de narration, Cela souligne et nous
permet d'identifier facilement le deuil vécu par l'auteur/personnage. Notre histoire
est donc une histoire autobiographique pour nos narrateurs, une écriture
autobiographique aux prises avec la douleur et le chagrin.
Dans le 4ème chapitre, nous avons terminé sur une analyse sémiotique des
personnages selon Philip Hamon. Nous l'avons combiné avec la psychanalyse de
Freud, Ces deux concepts théoriques sont appliqués d'abord pour tomber
apparemment dans le cercle vicieux du personnage du narrateur avec ses souvenirs
à sa défunte mère, Toute l'histoire tourne autour d'une figure sainte semi-sainte, et
enfin la figure du père volontairement couvert de deuil blanc.
En conclusion, notre corpus le livre de ma mère de livres était une expérience
d'écriture, pour un narrateur racontant ses souvenirs avec sa mère à la recherche
d'un autre temps et d'une vie dans laquelle se trouvait sa mère. Notre recherche se
concentre sur l'analyse du temps, et que
Il existe de nombreux processus littéraires par lesquels l'histoire tente de
reconstruire le temps et ses manifestations dans le roman.
72
Corpus Albert COHEN, Le livre de ma mère, Paris, Gallimard, Coll. Folio, 1954.
Ouvrages théoriques
1. ACHOUR Cristiane, BEKKET, Amina, Clefs pour la lecture des récits
(convergences critiques 2), Editions du Tell, 2002.
2. BARTHES Roland, Introduction à l’analyse structurale du récit, 1996.
3. GENETTE Gérard, Figure III, Edition Seuil, Paris, 1972.
4. HAMON. Philippe., « pour un statut sémiologique du personnage», Poétique
du roman, Ĕd. Du seuil, coll « oints », 1977.
5. JOUVE. Vincent, Poétique du roman, 2émé Edition Armand COLIN, Paris,
2007.
6. KUNDERA Milan, L’Art du roman, Éditeur Gallimard, (2 février 1995).
7. Le petit Grevisse, Grammaire française, Bruxelles, de Boeck, 2005.
8. Michel Butor, Essai sur le roman, Ed. Gallimard collection idée, 1969.
9. Vincent Jouve, Poétique du roman, Armand Colin, Paris, 2007 (2e édition).
10. WILLY Apollon, une école pour la psychanalyse, pour le conseil d’Ethique
de l’Ecole freudienne du Québec, Septembre 1998.
11. Yves REUTER, Introduction à l’analyse du roman, Ed Armand Colin, Paris,
2006.
Dictionnaires 1. Joelle Gardes – Tamine, Marie –Claude Hubert, Dictionnaire de critique
littéraire, Ed Armand Colin, Paris, 1999.
Sitographies
1. Cette présentation s’inspire de la théorie de jakobson et scharffer : Site web,
le 05/06/2021 à 15 : 30.
73
2. GUILLEMETTENT et Lucie et LEVESQUE, Lucie Guillemette et Cynthia
Lévesque, La narratologie, Signo, Théories sémiotiques appliquées, Québec
2006.
3. https://www.etudes-littéraires.com/figures-de-style/deicrique.php. Consulté
10/06/2021.
75
Résumé
Parmi les nombreux romans d'Albert Cohen, nous avons choisi le livre de ma
mère pour l’étudier. Dans notre travail de recherche, nous avons établi une analyse
du temps narratif, qui est l'un des thèmes dominants de la création littéraire
mondiale. Il exprime les moments difficiles vécus par le narrateur en raison de la
perte de sa mère. Cela nous montre. Comment fonctionne le temps dans les œuvres
littéraires, c'est parce que la narration est un foyer multiaxes. Le temps narratif nous
raconte son mécanisme de fonctionnement et sa fonction dans la structure générale
du roman. Il a raconté la douleur après la mort de sa mère là-bas. Au cours de notre
travail, nous essayons d'analyser le caractère du narrateur en recourant à quelques
concepts théoriques de la psychanalyse, sans oublier de parler du temps et des
techniques narratives, qui sont les éléments de base de ce thème.
Mots clés : Le temps, la narratologie, les techniques narratives.
76
ملخص
ي، أنشأنا تحليًلا ، اخترنا كتاب والدتي لدراسته. في عملنا البحثبين روايات ألبرت كوهين العديدة من
، وهو أحد الموضوعات المهيمنة على اإلبداع األدبي العالمي. وهي تعبر عن األوقات الصعبة للوقت السردي
كيف يعمل الوقت في األعمال األدبية هو أن السرد هو هذا يظهر لنابسبب فقدان والدته. التي يمر بها الراوي
تركيز متعدد المحاور. يخبرنا زمن السرد عن آلية عملها ووظيفتها في البنية العامة للرواية. وروى األلم بعد
ظرية المفاهيم النوفاة والدته هناك. نحاول في سياق عملنا تحليل شخصية الراوي من خًلل اللجوء إلى بعض
، وهي العناصر األساسية لهذا الموضوع.ى الحديث عن تقنيات الوقت والسرد، دون أن ننسللتحليل النفسي
الزمن, السرد, تقنيات السرد. الكلمات المفتاحية:
77
Summary
Among Albert Cohen's many novels, we have chosen my mother's book to study.
In our research work, we established an analysis of narrative time, which is one of
the dominant themes of global literary creation. It expresses the difficult times
experienced by the narrator due to the loss of his mother. That shows us. How time
works in literary works is because storytelling is a multi-axis focus. Narrative time
tells us about its operating mechanism and its function in the general structure of the
novel. He recounted the pain after his mother died there. In the course of our work
we try to analyze the character of the narrator by resorting to some theoretical
concepts of psychoanalysis, without forgetting to talk about time and narrative
techniques, which are the basic elements of this theme.
Key words: Time, Narratology, narrative techniques.