Un marché international inattendu : Bilbao dans les années 1560
L'art du réalisme. Le champ du cinéma français au début des années 2000 (\"Actes de la...
Transcript of L'art du réalisme. Le champ du cinéma français au début des années 2000 (\"Actes de la...
L'ART DU RÉALISMELe champ du cinéma français au début des années 2000Julien Duval
Le Seuil | « Actes de la recherche en sciences sociales »
2006/1 n° 161-162 | pages 96 à 115 ISSN 0335-5322ISBN 202084026X
Article disponible en ligne à l'adresse :--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------http://www.cairn.info/revue-actes-de-la-recherche-en-sciences-sociales-2006-1-page-96.htm--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
!Pour citer cet article :--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Julien Duval, « L'art du réalisme. Le champ du cinéma français au début des années 2000 », Actes de la recherche en sciences sociales 2006/1 (n° 161-162), p. 96-115.DOI 10.3917/arss.161.0096--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Distribution électronique Cairn.info pour Le Seuil.
© Le Seuil. Tous droits réservés pour tous pays.
La reproduction ou représentation de cet article, notamment par photocopie, n'est autorisée que dans les limites desconditions générales d'utilisation du site ou, le cas échéant, des conditions générales de la licence souscrite par votreétablissement. Toute autre reproduction ou représentation, en tout ou partie, sous quelque forme et de quelque manièreque ce soit, est interdite sauf accord préalable et écrit de l'éditeur, en dehors des cas prévus par la législation en vigueur enFrance. Il est précisé que son stockage dans une base de données est également interdit.
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
EH
ES
S -
-
193.
48.4
5.20
1 -
04/0
9/20
15 1
3h14
. © L
e S
euil
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - E
HE
SS
- - 193.48.45.201 - 04/09/2015 13h14. © Le S
euil
LA FAÇADE D’UN « COMPLEXE » PARISIEN EN DÉCEMBRE 2005. Comédies nationales et films d’acteurs priment au pôle économiquementdominant du champ, confronté à la concurrence des productions états-uniennes et des blockbusters (ici, un remake de King Kong).
161 GROUPÉ*5.qxd 17/03/06 22:29 Page 96
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
EH
ES
S -
-
193.
48.4
5.20
1 -
04/0
9/20
15 1
3h14
. © L
e S
euil
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - E
HE
SS
- - 193.48.45.201 - 04/09/2015 13h14. © Le S
euil
97
Ceux qui s’en prennent en France à un système d’aidespubliques trop favorable, selon eux, au « cinéma d’au-teur » et ceux qui redoutent l’hégémonie croissante du« cinéma commercial » (au mépris de « l’art » ou de la« diversité culturelle ») semblent au moins s’accorderpour considérer que le cinéma français se divise endeux secteurs, l’un tourné vers le commerce et unpublic élargi, l’autre davantage vers la « création ».Dans ces conditions, il est tentant, en s’appuyant surles travaux sociologiques consacrés au champ littérai-re, de proposer un modèle simple : le champ cinéma-tographique se caractériserait par une « structure dua-liste1 » au sein de laquelle les productions commercialess’opposeraient aux films d’auteurs.
Mais cette façon de voir les choses reste assez abs-traite et n’est pas totalement satisfaisante. La référen-ce au champ littéraire a des inconvénients. Elle paraîtgénéraliser le point de vue particulier des cinéastes quise pensent sur le modèle des écrivains et fait écran auxnombreuses conséquences de l’importance, au cinéma,des coûts de production (et de diffusion)2. Reconduire,dans une description qui se veut rigoureuse, les notionsde «cinéma d’auteur» et de «cinéma commercial» n’estpas moins discutable. Il s’agit là, en effet, de simplescatégories de perception qui, du fait qu’elles sont trèslargement partagées, sont investies d’un fort pouvoirde suggestion. Mais ce sont de simples catégories declassification pratiques qu’il faut se garder de traiter
comme des catégories savantes. À poser trop rapide-ment l’opposition du « cinéma d’auteur » et du « ciné-ma commercial», il devient difficile, par exemple, d’ana-lyser la dimension commerciale du premier ou decomprendre que des succès au box-office (comme,récemment, Le Fabuleux Destin d’Amélie Poulain)soient régulièrement perçus comme des « films d’au-teur ». Il faudrait par ailleurs préciser explicitement siles deux notions renvoient à deux secteurs distincts etétanches ou si elles désignent de simples polarités. Dansle premier cas, c’est sur l’unité ordinairement prêtéeau « cinéma français » qu’il conviendrait de s’interro-ger ; dans le second, il faudrait dépasser l’oppositioncommercial/auteur pour comprendre la région, sansdoute centrale dans le champ, qui subirait simultané-ment l’influence des deux pôles.
Pour surmonter ces problèmes, cet article se pro-pose de construire empiriquement le champ du cinémaen France. Des données statistiques ont été spécia-lement réunies à partir de sources publiques en fonc-tion de l’objectif poursuivi et une analyse des cor-respondances multiples3 a été réalisée. Ses résultatsont été interprétés à l’aide de concepts sociologiquesprécis. Cette façon de procéder permet d’éviter lesdeux écueils qui consistent à établir d’emblée unparallèle avec le monde littéraire et à poser a prioril’existence de deux entités qu’on pourrait appeler« cinéma d’auteur » et « cinéma commercial ». En
1. Voir Pierre Bourdieu, Les Règles de l’art.Genèse et structure du champ littéraire,Paris, Seuil, coll. « Libre examen », 1992,en particulier p. 165-200.2. L’importance des coûts et la nécessitéd’une diffusion massive sont une dimen-
sion de la rupture que le cinéma a intro-duite dans l’histoire de l’art. Dans son essaide 1935 sur la reproductibilité, WalterBenjamin relevait ainsi qu’un film devaitdisposer d’un très large public (« en 1927,on a pu établir que, pour couvrir ses frais,
un grand film devait disposer d’un publicde neuf millions de spectateurs ») et notaitqu’il ne pouvait être une propriété indivi-duelle, contrairement à un tableau ou àquantité d’œuvres d’art (« L’œuvre d’art àl’ère de sa reproduction mécanisée», Écrits
français, Paris, Gallimard, 1991, p. 146).3. Sur l’analyse des correspondances, voirBrigitte Le Roux et Henry Rouanet, GeometricData Analysis. From Correspondence Analysisto Structured Data Analysis, Dordrecht, KluwerAcademic Publishers, 2004.
Julien Duval
L’art du réalismeLe champ du cinéma français au début des années 2000
ACTES DE LA RECHERCHE EN SCIENCES SOCIALES numéro 161 – 162 p. 96-115
161 GROUPÉ*5.qxd 17/03/06 22:29 Page 97
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
EH
ES
S -
-
193.
48.4
5.20
1 -
04/0
9/20
15 1
3h14
. © L
e S
euil
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - E
HE
SS
- - 193.48.45.201 - 04/09/2015 13h14. © Le S
euil
proposant une description empiriquement fondée duchamp, on peut, au contraire, faire de ces deux ques-tions des enjeux de l’analyse.
L’espace des cinéastes
Cette première étude du champ cinématographique seconcentre sur les cinéastes. Dans une activité aussi for-tement collective, à laquelle prennent part des catégo-ries très diverses d’agents (sociétés de production, dedistribution, « talents », techniciens, mais aussi hautsfonctionnaires, responsables de télévision, critiques,journalistes spécialisés, etc.), les cinéastes occupent, aumoins depuis plusieurs décennies, une place centrale.Même si leur rôle est parfois plus modeste (sans êtrejamais négligeable), ils sont aujourd’hui, en bien descas, les initiateurs ou/et les maîtres d’œuvre des films,au point d’en apparaître parfois comme les «auteurs4 ».Pour une telle catégorie, cependant, la constructiond’une «population de référence» pose problème. Il n’estguère pertinent de rassembler sans distinction tous ceuxqui réalisent des produits susceptibles d’être considéréscomme des « films » ; cela revient à réunir dans unemême catégorie l’amateur tournant des films de vacanceset le professionnel coordonnant la réalisation d’un pro-duit destiné à une très large diffusion dans un cadrecommercial. Pour construire un groupe sociologique-ment homogène et pertinent, il faut tenir compte del’existence d’une définition dominante (et restrictive)du film de cinéma. Adossée à des oppositions ou desdifférenciations hiérarchisées (entre la fiction et le docu-mentaire, le long et le court-métrage, l’amateurisme etle professionnalisme, le commercial et le non-commer-cial), elle accorde un statut privilégié à des « longs-métrages» de fiction projetés dans des salles commer-ciales. Ce qui s’apparente à une définition très largementpartagée du film de cinéma résiste, pourtant, fortementà l’explicitation. Tout critère avancé peut être immé-diatement récusé, à l’aide de quelques exceptions remar-quables, tel documentaire, par exemple, ou tel film trèscourt qui a conquis un large public ou une place incon-testée dans « l’histoire du cinéma». De plus, même lescritères en apparence les plus généralement partagéssont contestés par des agents périphériques œuvrant,par exemple, à la « réhabilitation » de formes ou degenres cinématographiques dominés.
Plutôt que de se conformer à l’exigence (scolas-tique) de la définition préalable, il a paru préférable,pour déterminer l’ensemble des cinéastes pertinents,de prendre pour point de départ ce qui est, en quelquesorte, premier dans la pratique : l’existence d’un
ensemble de relations entre des agents et des groupesqui donnent naissance à des enjeux spécifiques. Ladéfinition dominante du « film de cinéma» n’est qu’unproduit secondaire (et en grande partie implicite) del’histoire et du fonctionnement de cet espace de rela-tions. Il est facile d’identifier quelques enjeux très lar-gement poursuivis par les (des) cinéastes : les parts demarché, le « box-office », le soutien des médias, lareconnaissance d’agents qui, comme certains critiques,sont dotés d’une autorité sociale pour juger en matiè-re de cinéma, l’obtention de fonds publics, ou encorele concours des grandes sociétés de production qui dis-posent d’un capital financier et de savoir-faire facili-tant non pas seulement la production d’un objet maté-riel, mais sa transformation en un produit destiné àune large diffusion sociale. L’ensemble des cinéastesparticipant à la lutte pour ces ressources – dont la plu-part, mais pas tous, se définissent dans un cadre natio-nal – est sociologiquement pertinent ; il diffère en par-tie de celui qui aurait pu être construit sur la base decritères préalables. Les documentaristes, par exemple,comme les réalisateurs de films d’animation ou ceuxqui sont réputés « militants », n’en sont pas systémati-quement exclus ; s’ils le sont très généralement, ce n’estpas en vertu d’un critère arbitraire, mais parce que,sauf exception, ils sont écartés, par des mécanismesalliant probablement l’exclusion et l’auto-élimination,d’une lutte qui privilégie fortement (mais pas exclusi-vement) les auteurs de longs-métrages de fiction, etles relègue dans des sous-espaces organisés autourd’autres enjeux.
1. Ensemble des cinéastes pris en considérationL’ensemble des cinéastes en activité, mobilisés parces enjeux, a été construit parallèlement auxvariables (qui renvoient aux enjeux pertinentsdans le champ). L’objectif poursuivi est de faire ensorte que les différents profils existants (au regarddes variables retenues en éléments actifs dansl’ACM) soient représentés. Dans un premier temps,on retient tous les réalisateurs de films « français »sortis à Paris en 2003. Un tel critère ne paraît pasintroduire de biais, mais il n’atteint pas entièrementl’objectif visé : il laisse en effet échapper des«profils » rares correspondant à des cinéastes qui,très efficients dans le champ, n’ont pas sorti de filmen 2003. L’ensemble initial est donc augmentédans un deuxième temps. À mesure que lesvariables actives sont renseignées, des noms sontrégulièrement ajoutés (tous les récipiendaires duprix Delluc, tous les auteurs de succès au box-office des années précédentes, tous les réalisa-teurs dont des films avaient été présentés danscertains festivals, etc.). De plus, sont systémati-
98
Julien Duval
4. En procédant ainsi, l’analyse risque de consacrer une approche « auteuriste » qui s’est historiquement constituée, mais ce biais est apparu comme un moindre mal. D’abord, l’inter-prétation et le commentaire de l’ACM permettent d’en corriger certains effets indésirables. Ensuite, les autres solutions envisagées au début de ce travail (ainsi, celle qui auraitconsisté à étudier sur une population plus large –mais aussi beaucoup plus hétérogène– que les seuls cinéastes) présentaient des inconvénients nettement plus importants.
161 GROUPÉ*5.qxd 17/03/06 22:29 Page 98
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
EH
ES
S -
-
193.
48.4
5.20
1 -
04/0
9/20
15 1
3h14
. © L
e S
euil
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - E
HE
SS
- - 193.48.45.201 - 04/09/2015 13h14. © Le S
euil
quement intégrés tous les réalisateurs membresde la société civile des Auteurs-Réalisateurs-Producteurs (ARP) en 2004, ainsi que les signa-taires de quelques textes de « cinéastes » (soutienaux sans-papiers en 1997, pétition de l’ACID en2004). Mais l’ensemble obtenu qui totalise 541noms apparaît alors trop large : il comporte descinéastes pour lesquels il n’est pas possible ou paspertinent de renseigner toutes les variables actives,par exemple des cinéastes qui ne sont pas ou plusen activité (ainsi, les lauréats des premiers prixDelluc). Il faut donc, dans un troisième temps,écarter des individus : 1) 119 réalisateurs5 d’ununique long-métrage sorti trop tard pour que leschiffres de leur exploitation commerciale dispo-nibles au moment de la collecte des donnéespuissent être tenus pour fiables ; 2) 129 cinéastessans films sortis sur la période récente(1997–2003), ou dont l’unique film sur la périodevenait juste de sortir au moment de la collecte desdonnées –ces cinéastes n’avaient parfois été recen-sés que comme membres de l’ARP ou signatairesd’appels de cinéastes ; 3) 21 cinéastes dont lacarrière s’est déroulée, pour l’essentiel, à l’étran-ger et 22 cas correspondant à des cinéastestravaillant dans des genres pratiquement exclusdu circuit commercial. Au total, 250 individusactifs sont pris en compte dans l’ACM.
2. Les propriétés (variables actives)Ces propriétés qui correspondent à des enjeuxpertinents dans le champ ont été choisies6 de façonà être variées et aussi peu redondantes quepossible. La liste définitive des propriétés retenuesobéit à des considérations matérielles liées à ladisponibilité et à l’accessibilité des données, ainsiqu’à des contraintes techniques : il n’est pas raison-nable, par exemple, de prendre en compte despropriétés qui, comme l’obtention d’un Oscar,sont pertinentes mais exceptionnelles.
a) L’économie des filmsLe succès commercial des films (box-office) (◊)V1 (4 modalités). Le marché français. Selon lenombre (moyen) d’entrées en salles réalisées parleur(s) film(s) sorti(s) entre 1997 et 2003, lescinéastes sont répartis en 4 classes : moins de50 000 entrées (25,6 %), de 50 000 à 200 000entrées (21,6 %), entre 200 000 et 1 milliond’entrées (32 %), plus de 1 million d’entrées(20,8 %).V2 (6 modalités). La variable sur les marchéseuropéens (source utilisée : base Lumière del’Observatoire européen de l’audiovisuel) permetde savoir si les films du cinéaste s’exportent. Elleest renseignée de la façon suivante : pour le plusgros succès commercial réalisé par chaque cinéasteen France entre 1997 et 2003, le nombre d’entréessur le territoire français est rapporté au nombred’entrées sur l’ensemble des marchés européens
(25 pays). Selon la valeur de ce rapport, lescinéastes sont répartis en 6 catégories : marchéeuropéen très large (rapport inférieur à 60 % :13,2 % des cinéastes), marché européen large(rapport compris entre 60 et 85 % : 19,6 %),marché européen limité (entre 85 et 95 % :26,4 %), marché européen très limité (entre 95et 100 % : 19,2 %), marché uniquement français(rapport de 100 % : 14 %). Dans 7,6 % des cas,l’information n’est pas disponible.Le financement des films (2)V3 (3 modalités). La variable mesure la proxi-mité du cinéaste aux grandes sociétés de produc-tion. Dans les quelques cas où un cinéaste a étéfinancé par différentes sociétés, la variable estrenseignée sur la base de son film le plus récent.Elle compte trois modalités : Gaumont, UGC,Pathé ou Renn Productions (22,8 %) ; Les FilmsAlain Sarde (10,4 %) ; non produit par de grossessociétés (66,8 %).V4-V7 (4 x 2 modalités). Ces variables indiquentsi le cinéaste a bénéficié, ou non, de l’apport finan-cier des grandes chaînes de télévision : coproduc-tions par TF1 (28 % sont concernés), France 3(39,2%), le Studio Canal (28,4%), Arte (32,4%).Les variables V3 à V7 sont renseignées à partirdes catalogues disponibles sur le site d’Unifranceet portent sur la période 1990 – 2003.V8 (2 modalités). La variable indique si le cinéastea bénéficié en 2002 ou 2003 de l’avance surrecettes (18,8 %).Réalisation de films publicitaires (■■)V9 (2 modalités). La variable permet de repérerles réalisateurs (22% des cinéastes) de films publi-citaires (diffusés à la télévision), c’est-à-dire desfilms directement liés à une demande économiquediffusés à la télévision. La source utilisée est labase de données de l’Inathèque qui porte sur lapériode 1996 – 2003.
b) La reconnaissance des cinéastesPrésence dans les trois grands festivals interna-tionaux (∆)V10-V12 (2 + 2 + 3 modalités). Ces variablesindiquent, pour chacun des trois grands festivals,si au moins l’un des films du cinéaste y a étéprésenté entre 1995 et 2003. Pour Venise et Berlin,les variables sont dichotomiques (16 % et 19,6 %des individus sont concernés). Pour Cannes, lavariable a trois modalités : au moins un film ensélection officielle (12,8%), sélection(s) à Cannesmais seulement dans des sections parallèles(23,6 %), aucun film à Cannes (63,6 %).La reconnaissance critique (b)V13 (4 modalités). L’indice de reconnaissancecritique est construit à partir des critères suivants :la projection d’au moins un film du cinéaste à laCinémathèque française entre janvier 2000 et mars2004, le soutien par Les Cahiers du cinéma(mesuré de deux façons : cote attribuée par la
99
L’art du réalisme
5. Ce décompte n’a qu’une valeur indicative dans la mesure où, parfois, plusieurs raisons concourent à écarter un même cinéaste. 6. Ces choix sont aussi des exclusions. Ona, par exemple, rejeté une variable relative aux prises de position publiques, parce qu’elle paraissait renvoyer à un enjeu moins déterminant dans le champ que les propriétésprises en compte à travers les variables finalement retenues.
161 GROUPÉ*5.qxd 17/03/06 22:29 Page 99
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
EH
ES
S -
-
193.
48.4
5.20
1 -
04/0
9/20
15 1
3h14
. © L
e S
euil
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - E
HE
SS
- - 193.48.45.201 - 04/09/2015 13h14. © Le S
euil
Julien Duval
100
GRAPHIQUE 1. L’ESPACE DES PROPRIÉTÉS. Nuage des 40 modalités actives dans le plan 1-2. Les mar-queurs sont de tailles proportionnelles aux effectifs.
161 GROUPÉ*5.qxd 17/03/06 22:29 Page 100
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
EH
ES
S -
-
193.
48.4
5.20
1 -
04/0
9/20
15 1
3h14
. © L
e S
euil
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - E
HE
SS
- - 193.48.45.201 - 04/09/2015 13h14. © Le S
euil
L’art du réalisme
101
GRAPHIQUE 2. LES CINÉASTES. Nuage des 250 individus dans le plan 1-2.
161 GROUPÉ*5.qxd 17/03/06 22:29 Page 101
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
EH
ES
S -
-
193.
48.4
5.20
1 -
04/0
9/20
15 1
3h14
. © L
e S
euil
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - E
HE
SS
- - 193.48.45.201 - 04/09/2015 13h14. © Le S
euil
revue au dernier film du cinéaste ; nombre de filmsayant figuré dans les listes annuelles de «meilleursfilms» publiées par la revue), le soutien par Positif(mesuré de deux façons : projection d’un film dansune rétrospective organisée par la revue, traite-ment réservé aux derniers films sortis). Un scoreest calculé à partir de ces critères, qui permet derépartir les cinéastes en 4 classes : forte recon-naissance critique (8 %), bonne reconnaissancecritique (20,8 %), reconnaissance critique limitée(17,2 %), sans reconnaissance critique (54 %).Prix et récompenses nationaux (C)V14 (2 modalités). La variable indique si le réali-sateur a reçu au moins une fois dans sa carrière leprix Delluc (11,2 % des cinéastes).V15 (3 modalités). Un score est calculé par lerecensement du nombre de fois, entre 1976 et2004, où le(s) film(s) du cinéaste a (ont) concourupour les principaux Césars (film, réalisateur, scéna-riste). Il est pondéré en fonction du nombre defilms réalisés durant la période. Trois classes sontdistinguées, selon que les cinéastes ont concoururégulièrement (14,4%), ponctuellement (16%) oujamais (69,6 %).
Les résultats de l’ACM font apparaître que deux grandsprincipes différencient les cinéastes en activité : d’unepart, leur volume de capital global ; d’autre part, leurposition sur un continuum opposant un pôle com-mercial à un pôle plus autonome bénéficiant d’uneforte reconnaissance auprès de la critique et dans lesfestivals internationaux.
L’analyse des correspondances multiples7 portesur 250 individus actifs et 15 variables actives (41modalités). Mis à part la rubrique « réalisation defilms publicitaires », les rubriques contribuent defaçon équilibrée à la variance du nuage.Le premier plan factoriel. L’interprétation peut seconcentrer sur le premier plan factoriel : les deuxpremières valeurs propres (l1=0,2110 ;l2=0,1887), qui représentent 23,9 % de lavariance, sont proches l’une de l’autre et nette-ment séparées des suivantes (l3/l2=0,52). Ellescorrespondent à un taux modifié cumulé de 92 %(54 % pour l’axe 1 et 39 % pour l’axe 2).Les deux grands groupes de variables contribuentde façon équilibrée aux deux axes.Axe 1 (l1=0,2110). On retient, parmi les 40modalités actives, celles dont la contribution estsupérieure à 2,5% (1/40), en les regroupant, dans4 cas (signalés dans le tableau 1 par un astérisque),avec une (ou deux) autre(s) modalité(s) proche(s)du critère. On considère, au total, 24 modalités quicontribuent à 90,6 % de la variance de l’axe.L’axe 1 [voir tableau 1 et graphique 1] oppose, dehaut en bas, des propriétés valorisées dans l’espace(César, sélection dans les festivals, larges marchés,
reconnaissance critique) à l’absence de ces proprié-tés. Il peut s’interpréter comme mesurant, de basen haut, une proximité croissante aux enjeuxcentraux dans le champ, ou encore un volumeglobal croissant de capital.Axe 2 (l2=0,1887). On retient les modalités dontla contribution est supérieure à 2,5%, en regrou-pant deux d’entre elles (signalées dans le tableau 2par un astérisque), avec une autre modalité prochedu critère. On considère, au total, 18 modalités quicontribuent à 86,3% de la variance de l’axe.L’axe 2 [voir tableau 2 et graphique 1] regroupe, àdroite, les modalités relatives aux succès commer-ciaux et aux sociétés économiquement dominantes,et, à gauche, les modalités témoignant d’une fortereconnaissance symbolique. On note une opposi-tion entre la reconnaissance critique (trois modali-tés à gauche) et l’absence de reconnaissance (unemodalité à droite). L’axe peut être interprété, degauche à droite, comme menant d’un pôle symbo-liquement dominant à un pôle économiquementdominant.
Degré de consécration et notoriété externe
Si le champ cinématographique se construit dans lalutte pour des enjeux qui lui sont propres, le principefondamental de différenciation parmi les cinéastesréside dans le degré auquel ils participent à cette lutte.L’accès aux ressources rares qui conditionne un exer-cice durable de l’activité, succès commerciaux oureconnaissance symbolique, est très inégal. Très élevéau cours de périodes antérieures, au point de n’auto-riser qu’un très petit nombre d’entreprises, l’investis-sement économique que suppose la réalisation d’unfilm et, dans une certaine mesure, l’accès à une diffu-sion commerciale s’est abaissé, sous l’effet d’innova-tions techniques et des systèmes d’aide en France quifacilitent le montage financier des films (et notammentde premiers longs-métrages), mais aussi de réglemen-tations. Canal Plus, lors de sa création, se vit ainsiimposer l’obligation de consacrer une partie de sonchiffre d’affaires à la coproduction de films et de pro-grammer au moins 50 % de films européens ; une telledisposition a stimulé la production française, la chaî-ne diffusant environ un nouveau film par jour. Depuisles années 1960, un nombre important de cinéastesréalisent chaque année une première œuvre diffuséedans un réseau commercial : les premiers films repré-sentent, à la fin des années 1990, environ 35 % d’uneproduction annuelle s’élevant en moyenne à environ150 films. On peut comprendre dans ces conditionsqu’un réalisateur entré dans le métier en 1963 (BenoîtJacquot) parle de la France comme du « seul pays au
102
Julien Duval
7. On a utilisé une variante de l’ACM dite « ACM spécifique » qui permet d’écarter des modalités de non-intérêt (ici, la modalité « information non disponible » de V2). Sur cettevariante, voir B. Le Roux et H. Rouanet, op. cit., p. 203-204 et p. 369-384, et B. Le Roux, « Analyse spécifique d’un nuage euclidien : application à l’étude des questionnaires »,Mathématiques, informatique et sciences humaines, 146, printemps 1999, p. 65-83.
161 GROUPÉ*5.qxd 17/03/06 22:29 Page 102
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
EH
ES
S -
-
193.
48.4
5.20
1 -
04/0
9/20
15 1
3h14
. © L
e S
euil
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - E
HE
SS
- - 193.48.45.201 - 04/09/2015 13h14. © Le S
euil
L’art du réalisme
103
Contribution ContributionQuestion relative Modalités relative
de la question En bas En haut
V15. César 16,8 % César : jamais 4,8 %César : régulièrement/ponctuellement* 12 %
V1. Marché français 10,1 % Moins de 50 000 entrées 6,5 %200 000 à 1 million/1 million et plus* 3,6 %
V14. Prix Delluc 10,0 % Prix Delluc 8,9 %
V3. Grosses sociétés 9,8 % Non produit par de grosses sociétés 3,1 %de production Gaumont, UGC, Pathé, Renn 2,8 %
Les Films Alain Sarde 3,9 %
V2. Marché européen 9,2 % Très large/large/limité* 3,8 %Marché uniquement français 4,0 %
V12. Sélection à Cannes 7,9 % Sélection officielle 6,5 %
V13. Reconnaissance 7,6 % Forte reconnaissance 2,8 %critique Bonne reconnaissance 2,6 %
Reconnaissance limitée/sans* 2,2 %
V11. Sélection à Berlin 7,2 % Sélection 5,8 %
V5. Coproductions 6,9 % Pas coproduction 2,7 %France 3 Coproduction 4,2 %
V4. Coproduction TF1 4,7 % Coproduction 3,4 %
V10. Sélection à Venise 4,5 % Sélection 3,8 %
V9. Films publicitaires 4,1 % Réalisation de films publicitaires 3,2 %
98,8 % 90,6 %
Interprétation de l’axe 1. Contribution (en %) des variables et des modalités retenues à la variance de l’axe 1.
Tableau 1
Contribution ContributionQuestion relative Modalités relative
de la question À gauche À droite
V13. Reconnaissance 15,0 % Forte reconnaissance 5,2 %critique Bonne reconnaissance 2,7 %
Sans reconnaissance 6,1 %
V7. Coproduction Arte 14,2 % Pas de coproduction 4,6 %Coproduction 9,6 %
V12. Sélection à Cannes 11,0 % Aucun film à Cannes 4,0 %Sélection officielle 3,2 %Sections parallèles 3,8 %
V8. Avance sur recettes 10,1 % Avance sur recettes 8,2 %
V4. Coproduction TF1 9,9 % Pas de coproduction 2,8 %Coproduction 7,1 %
V1. Marché français 9,5 % < 50 000/50-200 000* 3,2 %Plus de 1 million 6,3 %
V10. Sélection à Venise 8,8 % Sélection 7,4 %
V3. Grosses sociétés 6,5 % Gaumont, UGC, Pathé, Renn* 4,9 %de production
V9. Films publicitaires 5,8 % Réalisation de films publicitaires 4,5 %
V11. Sélection à Berlin 3,4 % Sélection 2,7 %
94,2 % 86,3 %
Interprétation de l’axe 2. Contribution (en %) des variables et des modalités retenues à la variance de l’axe 2.
Tableau 2
Note. Dans les tableaux, les regroupements de modalités sont signalés par des astérisques.
161 GROUPÉ*5.qxd 17/03/06 22:29 Page 103
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
EH
ES
S -
-
193.
48.4
5.20
1 -
04/0
9/20
15 1
3h14
. © L
e S
euil
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - E
HE
SS
- - 193.48.45.201 - 04/09/2015 13h14. © Le S
euil
monde où un garçon de 16 ans qui veut être cinéastepeut être sûr de le devenir un jour ».
Mais les déclarations de ce genre doivent être com-plétées par les récits de jeunes cinéastes qui disent leursdifficultés, une fois leurs films réalisés, à les «montrer».Le volume important de la production, qui résulte del’abaissement des barrières à l’entrée, a, en effet, pourcontrepartie de fortes inégalités entre les films. Les longs-métrages faisant, une même année, l’objet d’une sortiecommerciale ne sont pas des unités homogènes qui s’ad-ditionneraient sans problème. Certains ont une diffu-sion tellement restreinte qu’ils ne diffèrent finalementguère des films privés de toute exploitation commer-ciale. Les œuvres sont en effet inégalement exposées :en 2003, tandis que 12% des films français sortaient àParis dans plus de 40 salles, 53% étaient diffusés dansdix salles ou moins et 20% dans une salle unique8. Ilssont aussi très inégalement vus. En 2003, alors que leplus gros succès de l’année touchait six millions de spec-tateurs en salles et que 10% des nouveaux films étaientvus par plus d’un million de personnes, deux tiers atti-raient moins de 200000 spectateurs (et un tiers moinsde 10000). À ces chiffres qui portent sur l’exploitationen salles, on ne peut objecter que la diffusion des filmss’opère aujourd’hui, et à certains égards de façon prin-cipale, par les cassettes vidéo, les DVD et les diffusionstélévisées, car ces outils semblent renforcer les inégali-tés de diffusion, bien plus que contribuer à les réduireou les inverser : seul un très petit nombre de produc-tions, toujours à fort potentiel commercial, accède aucircuit qui, de l’exploitation en DVD à la programma-tion sur les canaux pay-per-view des chaînes payantespuis sur les grandes chaînes hertziennes9, étend consi-dérablement l’étendue de leur public. La diffusion d’unetrès grande majorité de films s’achève, au mieux, aprèsune très courte exploitation en salles, par une diffusionsur une chaîne (ou à une heure) confidentielle. Ainsi, siles barrières sont relativement faibles à l’entrée duchamp, beaucoup de films restent à sa périphérie. Lesinégalités qui s’observent entre les films se répercutentsur ceux qui les font et le cinéma, loin d’être un marchédu travail homogène, tend à se diviser en deux secteurs :l’un peut être rémunérateur et offrir la possibilité de car-rières, quand l’autre se caractérise par les « carrièreséclair » et une précarité professionnelle affectant lescinéastes bien sûr, mais aussi les acteurs, les technicienset les sociétés de production10.
Les résultats du box-office, comme l’existenced’un secteur précaire, renvoient à l’inégale distribu-tion du capital au champ cinématographique mais
ils n’en donnent qu’une image partielle. Ils font, parexemple, écran aux effets, également inégalitaires,qu’exercent des instances comme les festivals inter-nationaux ou la critique, en se focalisant sur un petitnombre de noms et de films : les quelques films dési-gnés comme de futurs « classiques » ou comme leséléments d’une « œuvre » sont du même coup pré-destinés à un cycle de vie beaucoup plus long queles productions bien plus nombreuses qu’ignorentces instances. Le principe de différenciation majeurparmi les auteurs distingue non pas seulement lesauteurs de gros succès commerciaux, mais ceux quidétiennent les attributs les plus prisés dans l’espa-ce, les sélections dans les grands festivals interna-tionaux, le concours des grandes sociétés de pro-duction et des grandes chaînes de télévision, les prixnationaux comme le prix Delluc ou les Césars. Lescinéastes se distribuent sur un continuum, depuisceux qui ont accumulé, plus ou moins rapidement,les signes d’une reconnaissance forte et variée, jus-qu’aux quasi-inconnus et aux vieux « marginaux »pratiquement dépourvus de tout capital leur per-mettant de s’imposer auprès des instances les pluspuissantes dans le champ.
Les propriétés les plus valorisées dans l’espacesont très discriminantes (pour les variables dicho-tomiques, les effectifs des modalités associées àdes propriétés sont toujours inférieurs à 40 %,souvent même à 20 %) et, comme on le voit surle graphique 2, le nuage des individus est plusdense à sa base qu’à son sommet. De plus, alorsque les profils en haut de l’axe 1 s’identifientchacun à un unique cinéaste, la partie inférieurede l’axe compte neuf profils communs à plusieursindividus (34 cinéastes sont concernés par cesneuf profils). Cinq cinéastes, par exemple, présen-tent le profil P1 exclusivement composé demodalités renvoyant à l’absence de propriétés(et au plus faible nombre d’entrées en salles).Ces profils correspondant à un faible volume decapital auraient très vraisemblablement été repré-sentés par un bien plus grand nombre d’indivi-dus si l’on avait, par exemple, pris en comptedans l’ACM les réalisateurs qui, ayant sorti avant1996 leur unique long-métrage, n’ont aujour-d’hui pratiquement plus d’autre activité de« cinéaste » que celle qui consiste à se proclamertel en adhérant à un groupement ou à unemanifestation professionnelle. La professionétudiée se compose donc d’un petit ensemble degros porteurs de capitaux (les 50 ou 100 indivi-dus qui se projettent dans la partie supérieurede l’axe 1 forment une liste, sans doute très
104
Julien Duval
8. Comptages réalisés à partir du « classe-ment 2003 des films », Le Film français,supplément au no2039, 6 février 2004.Les comptages ne prennent pas en
compte les reprises (ni, pour le nombred’entrées, les films dont l’exploitationn’était pas terminée au 30 décembre2003).
9. Sur ce circuit, voir Régine Chaniac etJean-Pierre Jézéquel, La Télévision, Paris,La Découverte, col. « Repères », 2005,p. 67.
10. Voir Yann Darré, Histoire sociale ducinéma français, Paris, La Découverte,coll. « Repères », 2000, p. 98-99.
161 GROUPÉ*5.qxd 17/03/06 22:29 Page 104
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
EH
ES
S -
-
193.
48.4
5.20
1 -
04/0
9/20
15 1
3h14
. © L
e S
euil
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - E
HE
SS
- - 193.48.45.201 - 04/09/2015 13h14. © Le S
euil
complète, de « plus grands cinéastes français enactivité »), et d’un grand nombre de petitsporteurs (en un sens, presque indénombrables).
L’opposition centrale, entre les cinéastes les plus consa-crés et ceux qui se caractérisent par l’absence des pro-priétés les plus valorisées, n’est pas indépendante del’âge, mais elle ne lui est pas mécaniquement liée. Ellerecouvre une opposition entre des cinéastes assez âgésqui se sont fait un «nom» (par exemple, Éric Rohmer,Jean-Luc Godard, Michel Deville, Claude Chabrol,Bertrand Tavernier, tous dans la partie supérieure du gra-phique 2 [voir cartouche 1]) et des cinéastes peu connus,souvent jeunes dans le métier. Le vieillissement dans lechamp peut correspondre à une accumulation progres-sive de capital, en permettant la constitution d’une noto-riété, l’accès progressif à des budgets plus importants ou
à des festivals plus prestigieux. L’univers, toutefois, n’estpas gouverné par la logique des carrières bureaucra-tiques : des cinéastes déjà âgés et dotés d’une œuvreimportante (les points représentant, par exemple, LucMoullet, Jean-Daniel Pollet, Jean-Marie Straub et DanièleHuillet – tous nés entre 1933 et 1937– sont dans la par-tie inférieure du graphique 2 [voir cartouche 1]) restent peuconnus quand de jeunes réalisateurs connaissent uneconsécration accélérée à la suite d’un gros succès ou/etd’une reconnaissance précoce (Mathieu Kassovitz,François Ozon, Cédric Kahn, nés en 1966 et 1967 maissitués dans le haut du graphique 2).
La relation, telle qu’elle vient d’être décrite, entrel’âge et le volume de capital est confirmée
lorsqu’on utilise, comme éléments supplémen-taires, la date de naissance (information dispo-nible pour 225 cinéastes, soit 90 %) ou le tempsécoulé depuis la sortie du premier long-métrage ducinéaste. L’âge des cinéastes pris en compte variede 28 à 85 ans et est en moyenne de 52,8 ans(écart-type de 12,2 ans). L’ancienneté moyenneest de 17 ans (le plus ancien a débuté en 1957).Les deux variables sont bien sûr corrélées (lecoefficient vaut 0,78). Découpées en tranches de10 ans, elles sont particulièrement bien repré-sentées sur l’axe 1 et s’ordonnent le long de l’axe1 (avec, en bas, les moins de 50 ans et ceux quiont débuté après 1990) ; l’écart entre les pointsmoyens et les modalités extrêmes est importantdans les deux cas (1,17 – resp. 1,19– écart-type del’axe 1 pour l’âge –resp. pour l’ancienneté–). L’âgeet l’ancienneté des cinéastes, exprimés en années,sont corrélés avec la coordonnée sur l’axe 1 (lecoefficient vaut, respectivement, 0,34 et 0,42).
Regarder le volume de capital global comme le premierprincipe de différenciation peut heurter une vision duchamp façonnée par les seuls résultats du box-officenational ou par l’opposition (en fait, seconde) entre« films commerciaux » et « films d’auteurs » ; celaconduit en effet à rapprocher des cinéastes très éloi-gnés sous ces derniers critères. Leurs propriétés com-munes sont pourtant nombreuses. Par exemple, de
« grands cinéastes », dont les résultats sont très diffé-rents au box-office national, peuvent se succéder dansla liste des plus gros succès français aux États-Unis,comme, en 1999, Luc Besson, Francis Veber, ÉricRohmer, Erick Zonca et Catherine Breillat11. Ils se
105
L’art du réalisme
11. Éric Rohmer et Catherine Breillat, parexemple, ont peu de chances, même pourleurs films les plus commerciaux, de figureren France parmi les cinq plus grands
succès français de l’année, mais cela peutarriver de façon très compréhensible auxÉtats-Unis : les films français y sont d’abordmoins nombreux, mais surtout le « cinéma
d’auteur » y connaît une dépréciation moinsforte que des films plus commerciaux (sonpublic potentiel est sans doute moins réfrac-taire aux films tournés dans une autre
langue que l’anglais et il a, de surcroît,davantage le charme de l’exotisme que desfilms «commerciaux» toujours, peu ou prou,influencés par les productions américaines).
161 GROUPÉ*5.qxd 17/03/06 22:29 Page 105
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
EH
ES
S -
-
193.
48.4
5.20
1 -
04/0
9/20
15 1
3h14
. © L
e S
euil
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - E
HE
SS
- - 193.48.45.201 - 04/09/2015 13h14. © Le S
euil
côtoient aussi régulièrement dans des médias ou desmanifestations aspirant, de façon permanente ou ponc-tuelle, à donner une représentation panoramique du«cinéma français ». Un sondage réalisé pour Téléramaétablit ainsi en 2000 une liste de « cinéastes mar-quants » qui appartiennent à deux régions bien diffé-rentes du champ (la droite comme la gauche du gra-phique 2 [voir cartouche 2]12). De façon analogue, lescinéastes les plus connus font l’objet de citations nom-breuses dans Le Monde. De même, la manifestationprofessionnelle des Césars récompense la quasi-tota-lité des cinéastes les plus connus (sans les distinguertous avec la même régularité) : généralement peu por-tée, par son esprit et son organisation, à récompenser
des formes de cinéma d’apparence trop ou trop peucommerciale, elle fait des exceptions pour les plusgrands, au moyen de « Césars d’honneur » ou à lafaveur de films atypiques. Par-delà leurs différences,les mieux dotés en capital peuvent aussi se retrouverdans le Who’s Who dont l’un des principaux critèresd’admission est la notoriété journalistique.
Comme on le vérifie sur le graphique 3, lescinéastes ayant une notice dans le Who’s Who inFrance et dans The International Who’s Who13,deux indicateurs d’une forte notoriété externe (quiconcerne, respectivement, 22,4 % et 17,8 % descinéastes), sont très majoritairement dans la partiesupérieure de l’axe 1. Le point moyen correspon-
106
Julien Duval
12. Outre les cinéastes figurant sur le cartouche, le sondage proposait les noms de Claude Sautet, Maurice Pialat (qui, ayant sorti leur dernier film en 1995, n’ont pas été retenuspour l’ACM). 13. The International Who’s Who, Londres, Europa Publications.
GRAPHIQUE 3. LA NOTORIÉTÉ EXTERNE DES CINÉASTES. Sous-nuage des individus présents dans le Who’sWho in France et dans le International Who’s Who. Les symboles de taille plus grande correspondent auxpoints moyens.
161 GROUPÉ*5.qxd 17/03/06 22:29 Page 106
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
EH
ES
S -
-
193.
48.4
5.20
1 -
04/0
9/20
15 1
3h14
. © L
e S
euil
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - E
HE
SS
- - 193.48.45.201 - 04/09/2015 13h14. © Le S
euil
dant à l’annuaire international se situe un peuplus haut sur l’axe 1 et un peu plus à gauche surl’axe 2, et le nuage des individus concernés estplus concentré (sa variance est plus faible sur lesdeux axes). En effet, l’annuaire internationalrecense particulièrement les cinéastes françaisdont les films sont présentés dans les grands festi-vals internationaux et exclut certaines gloiresnationales peu connues à l’étranger (en particulier,certains acteurs-réalisateurs du pôle commercial).
Quelle que soit leur proximité ou leur distance au pôlele plus commercial, les plus gros porteurs de capitauxont une probabilité forte de figurer dans le Who’s Who.Il s’agit là d’un indicateur, parmi d’autres, d’une carac-téristique importante du champ : la grandeur y va depair avec une forte notoriété externe, et notammentmédiatique ; les hiérarchies internes ne peuvent y dif-férer très sensiblement, comme cela arrive dans d’autresunivers, des hiérarchies journalistiques, elles en sontmême, bien souvent, une forme de retraduction. Lesentreprises ne peuvent être viables et s’imposer dansle champ sans recueillir, au minimum, les faveurs d’unassez large public et, de façon presque toujours indis-sociable, l’attention de médias de grande diffusion. Lecapital symbolique joue au cinéma, comme dans tousles champs de production culturelle, un rôle majeur,mais il y est particulièrement puissant lorsqu’il prendla forme d’une notoriété et d’une reconnaissance acqui-se auprès d’un large public et de grands médias. Lenom connu d’un très grand nombre est investi d’ungrand pouvoir, le nom d’une «star», par exemple, pou-vant convaincre à lui seul de grosses sociétés de pro-duction de débloquer des sommes considérables.L’importance jouée, au cinéma, par la notoriété exter-ne rend compte, notamment, des conditions d’entréedans la profession14 : très difficile à des inconnusdépourvus, par définition, de cette ressource très puis-sante dans l’espace qu’est la notoriété externe, l’entréesemble très facile à des agents déjà connus commeacteurs de cinéma (parmi les cinéastes de l’ACM,Josiane Balasko, Agnès Jaoui, etc.), à la télévision(Chantal Lauby, Didier Bourdon, etc.) ou dans d’autresdomaines culturels (Patrice Chéreau, Jean-PhilippeToussaint, Gérard Lauzier, Bernie Bonvoisin, etc.).
Si, au cinéma, la notoriété externe tend à être unecondition, autant qu’un effet, de la reconnaissanceinterne (celle qui s’obtient auprès de leurs pairs), ilfaut cependant tenir compte du deuxième principe dedifférenciation qui structure l’espace. Ainsi, les «grands
cinéastes » qui tendent à présenter des propriétéscommunes, telles que la notoriété externe, la recon-naissance des Césars ou un succès commercial mini-mal, les ont acquises différemment selon leur plus oumoins grande distance au pôle le plus commercial.S’il arrive régulièrement que les instances internesviennent consacrer des cinéastes qui se sont affirmésavec des succès commerciaux et l’aide des médias detrès grande diffusion – la télévision en particulier –, lemécanisme tend à s’inverser au pôle le plus autono-me : le succès commercial –qui peut survenir assez tar-divement dans leur carrière – et la large notoriétémédiatique résultent alors davantage d’une recon-naissance antérieurement acquise dans les festivalsinternationaux et au pôle le plus spécialisé et le plusculturel du champ journalistique.
Les forces commerciales
Certaines régions du champ (la droite des graphiques)peuvent être tenues pour plus commerciales que lesautres, en ce sens que les films y réalisent plusqu’ailleurs, et dans un délai relativement court, des pro-fits économiques substantiels. La production et la dif-fusion des films y mobilisent aussi des moyens matérielsplus importants. Les quelques institutions (les grandessociétés de production et de télévision) qui concentrentces moyens se trouvent ainsi investies d’un rôle et d’unpouvoir déterminants sur cette région du champ. Leurinfluence tient à leurs ressources économiques, maisaussi à des croyances diffuses qui renferment une défi-nition implicite de la réussite cinématographique(conquérir rapidement un large public, être rentable) etdésignent des moyens privilégiés pour la réaliser (l’em-ploi de «stars», l’utilisation d’effets spéciaux, le recoursà des genres ou des scènes convenues, etc.).
Sans être entièrement comparables aux « majors »américaines, les grandes sociétés de production fran-çaises, comme Gaumont, Pathé, Renn Productions,UGC, dominent économiquement un secteur où untrès grand nombre de sociétés sont de bien plus peti-te taille et/ou très éphémères (alors que Gaumont etPathé sont des firmes très anciennes puisqu’elles datentpratiquement des débuts du cinéma)15. Elles partici-pent, directement ou par des participations dansd’autres sociétés, à la plupart des grands succès16.Gaumont, Pathé et UGC détiennent des réseaux desalles, souvent modernes et très bien équipées ; ce sont
107
L’art du réalisme
14. Elle explique également pour une partl’importance bien connue de l’héréditéprofessionnelle au cinéma (les cinéastesconsidérés dans l’ACM comptent plusieursenfants de cinéastes – ainsi que, sous troisnoms différents, un couple et leur fils).15. Voir Laurent Creton, Économie du
cinéma. Perspectives stratégiques, Paris,Nathan, coll. « Cinéma », 1995. Pour lacomparaison avec les « majors », voir AllenJ. Scott, « French Cinema. Economy, Policyand Place in the Making of a Cultural-Products Industry », Theory, Culture andSociety, 17(1), 2000, p. 1-38 : les grosses
sociétés françaises sont plus petites que les« majors » et n’entretiennent pas le mêmetype de rapports entre elles, ni avec les« indépendants ».16. Pour la période 1973–1995, GaumontInternational, Gaumont, Renn Productions,les Films Christian Fechner et les Films
d’Alain Sarde (isolés, dans l’analyse statis-tique, au sein d’une modalité particulière)arrivent en tête du classement des sociétés,aussi bien en fonction du nombre de filmsproduits que des parts de marché. Voir L. Creton, op. cit.
161 GROUPÉ*5.qxd 17/03/06 22:29 Page 107
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
EH
ES
S -
-
193.
48.4
5.20
1 -
04/0
9/20
15 1
3h14
. © L
e S
euil
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - E
HE
SS
- - 193.48.45.201 - 04/09/2015 13h14. © Le S
euil
ainsi des structures de distribution et d’exploitationavec lesquelles les petites unités de production ne peu-vent rivaliser. Les grandes chaînes hertziennes, dontTF1 est une sorte de symbole, jouent aujourd’hui unrôle tout aussi décisif dans les régions les plus com-merciales du champ. D’abord, elles fournissent prèsde 40 % des financements du cinéma français et lesfilms produits sans l’aide d’une chaîne de télévisionsont aujourd’hui très rares. Ensuite, elles constituentdes lieux d’exposition : elles diffusent des films et inter-viennent dans leur « promotion », laquelle représenteune étape de plus en plus importante pour les filmscoproduits par les « majors » et les grandes chaînes.Les journaux télévisés, les émissions de talk show fontconnaître certains films, par la diffusion de bandes-annonces ou d’interviews d’acteurs (parfois de réali-sateurs), les chaînes ayant, bien sûr, d’autant plus inté-rêt à promouvoir un film qu’elles en sont coproductriceset qu’elles le diffuseront quelques années plus tard.
La télévision constituant un espace différencié,les choix de coproductions de films diffèrent d’unechaîne à l’autre. La position sur le graphique 1des modalités relatives aux coproductions montreque TF1 et France 3 (dans la partie supérieuredroite sur le graphique 1) produisent des cinéastesoccupant des positions plus élevées qu’Arte (surle graphique 1, dans la partie gauche, au niveaude l’axe 2). Sur l’axe 2, les cinéastes coproduits parArte sont très éloignés de ceux coproduits parTF1 (de fait, seuls sept cinéastes ont été copro-duits par les deux chaînes), France 3 occupantune position intermédiaire (33 cinéastes ont étéproduits à la fois par TF1 et France 3, 34 parFrance 3 et Arte). La position des différents pointsrenvoie aux politiques des différentes chaînes (quine consacrent pas toutes le même budget auxcoproductions) à l’égard du cinéma. TF1, la chaînela plus puissante économiquement, est très sélec-tive, posant des conditions explicites et n’inves-tissant plus dans des films sans intérêt commercialpour elle. France Télévisions a des exigences moinsrigides mais comparables. Elle participe plus queTF1 à des films considérés comme «commerciauxde qualité », voire « exigeants » (lesquels ne sontpas toujours diffusés, ou à des horaires de faibleaudience). Les chaînes Canal Plus et M6 sont– pour des raisons différentes – moins fortementassociées à une région particulière de l’espace.
Les grosses sociétés de production et les grandeschaînes s’impliquent dans les films peu nombreux quiconcentrent l’essentiel de l’audience, des financementset de l’attention médiatique ; elles s’investissent en par-ticulier dans la petite dizaine annuelle de gros succès,dans les plus gros budgets (au début des années 2000,plus de 15 millions d’euros, parfois même 30). Ellesimpriment leurs fins commerciales à ces films qui,inconcevables sans elles, sont donc d’abord des pro-
duits commerciaux, même s’ils sont rarement présen-tés comme tels : l’une des fonctions de la promotion,à la télévision ou dans des magazines spécialiséscomme Première ou Studio magazine, est, précisé-ment, d’entourer ces produits de la rationalité écono-mique et du calcul d’un discours qui est celui de« l’émerveillement », du « coup de foudre », de la« folie » ou du « divertissement ». Même si le phéno-mène n’a pas en France la même ampleur qu’aux États-Unis, certains films sont parfois de simples élémentsd’entreprises commerciales qui les dépassent et quiimpliquent aussi l’industrie de la musique (à traversles bandes musicales) ou celle du merchandising.
Les cinéastes les plus proches du pôle commercialdoivent d’abord leur notoriété aux succès (commer-ciaux) qu’ils ont connus dans un passé proche (DidierBourdon, Alain Chabat [voir cartouche 3]) ou / et un peuplus lointain (Claude Zidi, Francis Veber). Nombred’entre eux prennent part à la production de leurspropres films, mais pour se réapproprier une partiedes profits économiques engendrés par leur travail plu-tôt que, comme en d’autres régions du champ, pouracquérir une forme d’indépendance artistique. Indicecertain d’une soumission aux contraintes commer-ciales, certains d’entre eux réalisent des publicités ou
des clips, satisfaisant ainsi ouvertement des demandesdu monde économique ; quelques-uns, au pôle le pluscommercial (Étienne Chatiliez, Philippe Muyl, Pitoff),étaient même spécialisés, avant de venir au cinéma,dans la réalisation de films publicitaires (ils en ont par-fois importé l’esthétique dans leurs films de cinéma).
Les logiques commerciales tendent aujourd’hui à serenforcer et à se sophistiquer : cette évolution, évidem-ment particulièrement visible dans les régions du champqui ont toujours été les plus soumises à ces logiques,
108
Julien Duval
161 GROUPÉ*5.qxd 17/03/06 22:29 Page 108
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
EH
ES
S -
-
193.
48.4
5.20
1 -
04/0
9/20
15 1
3h14
. © L
e S
euil
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - E
HE
SS
- - 193.48.45.201 - 04/09/2015 13h14. © Le S
euil
affecte, directement ou par ricochet, l’ensemble de l’es-pace. Les plus gros succès de ces dernières années nesont plus seulement des films qui ont engendré desrecettes très importantes ; ils ont aussi la particularitéde l’avoir fait en un temps très court. Ils sortent dansun nombre de salles beaucoup plus élevé que les succèsdes années 197017, beaucoup d’exploitants aspirantaujourd’hui à une rotation rapide des films permettantde « faire le plein» en un temps minimal et d’éviter aumaximum les fauteuils vides. Dans ces conditions, souspeine de disparaître très vite des salles, un film doit ren-contrer le succès dès « la première séance du mercre-di », selon une croyance qui, à se généraliser, devientauto-réalisatrice (les films susceptibles de la contrediretendent à être précocement éliminés). Ces transforma-tions sont particulièrement défavorables aux cinéastesles plus éloignés du pôle le plus commercial.
Les grandes chaînes de télévision, à travers leursémissions de « promotion », contribuent à un investis-sement intense et collectif, dans une logique commer-ciale, sur un petit nombre de films, les «phénomènes»qui, après de gros succès en salles (puis souvent sur lemarché de la vidéo et du DVD), réalisent des audiencestrès spectaculaires lors de leurs passages, un ou deuxans plus tard, sur les chaînes qui les ont coproduits ouen ont acheté les droits de diffusion. Le renforcementdes logiques commerciales est inséparable de l’intri-cation croissante du monde du cinéma (commercial)et de la télévision. Beaucoup d’acteurs et de cinéastesà succès viennent aujourd’hui de l’univers de la télé-vision18. Durant les années 1990 et 2000, un nombretrès important d’animateurs ou de comiques, que latélévision – souvent Canal Plus – avait fait connaître,sont passés au cinéma, entraînant souvent avec eux lesréalisateurs de leurs émissions ou de leurs sketches(par exemple, Djamel Bensalah, Alain Berbérian, ÉricLartigau, metteurs en scène des premiers films à suc-cès de vedettes de Canal Plus –Djamel Debbouze, «LesNuls », Kad et Olivier). Des animateurs et des humo-ristes très médiatisés deviennent eux-mêmes réalisa-teurs (Alain Chabat, Patrick Timsit) et les films conçuscomme des prolongements de programmes comiques,qui ont d’abord été des succès d’audience à la télévi-sion, se sont multipliés. Une chaîne comme TF1 impo-se aussi des exigences liées à ses intérêts commerciaux :elle réclame l’emploi dans les films qu’elle coproduitdu très petit nombre d’acteurs très médiatiques et ban-kable et n’apporte plus guère son concours financierqu’à des films susceptibles d’attirer massivement,
quelques années plus tard, le public très hétérogènede ses prime time. Elle traite, en somme, avec le mondedu cinéma comme avec une sorte de sous-traitant.
Le pôle le plus commercial du cinéma françaisentretient nécessairement un rapport très ambivalentavec le pôle le plus commercial du cinéma étatsunien(souvent identifié à « l’industrie hollywoodienne »).Celui-ci est à la fois perçu comme un concurrent et unmodèle. Le cinéma américain ou, plus exactement, sesproductions les plus commerciales représentent, audébut des années 2000, plus de 50 % des entrées ensalles en France ; elles fournissent la plupart des plusgros succès (en 2003, 16 des 20 premiers films au box-office) et près de la moitié des films programmés à latélévision. Certains producteurs et cinéastes français(Jean-Jacques Annaud, Luc Besson ou, jeunes dans lemétier, Pitoff, Christophe Gans, Jan Kounen) entre-prennent de se donner les mêmes objectifs et lesmêmes moyens que les productions hollywoodiennes :dans le cadre de coproductions (parfois à l’échelleeuropéenne), ils montent des films à gros budget etgrand spectacle pour un marché international.D’autres optent pour la comédie : ce genre permet deremporter des succès commerciaux importants avecdes budgets relativement réduits (parfois, autour desept ou huit millions d’euros), mais il condamne sou-vent au seul marché européen (voire français). Des« maîtres », plus ou moins âgés, de la comédie natio-nale comme Gérard Oury, Francis Veber, Claude Zidi,Jean-Marie Poiré, Gérard Jugnot [voir cartouche 4], per-pétuent une tradition visant un « public familial » etreposant sur des vedettes peu connues hors de France.Ils se sont imposés par de gros succès dans les décen-nies antérieures, à des époques où la part du cinémaaméricain sur le marché français était beaucoup plusfaible qu’aujourd’hui. Par là, ils s’opposent à des réa-lisateurs plus jeunes davantage portés vers des formesde comédies importées des États-Unis et destinées ausegment commercial des « adolescents », ou vers lespastiches de productions américaines (jusque dans leurtitre : La Tour Montparnasse infernale, Double zéroque ses protagonistes décrivent comme « un film amé-ricain avec plein de conneries dedans»). L’ambivalenceque le cinéma américain suscite au pôle le plus com-mercial du champ s’exprime bien dans deux tendancesen apparence contradictoires. D’un côté, les signes deconsécration venus des États-Unis semblent assezgénéralement prisés : le succès (même très relatif) surle marché américain, une nomination aux Oscars, la
109
L’art du réalisme
17. Au début des années 1970, un filmsortant dans 25 salles dans la régionparisienne atteignait un «maximum absolu »(voir Joëlle Farchy, L’Industrie du cinéma,Paris, PUF, coll. « Que sais-je ? », 2004).
18. L’intrication croissante entre les mondesdu cinéma et de la télévision prend uneforme spécifique au pôle le plus commer-cial du champ cinématographique, maiselle ne lui est pas propre. Ainsi, la conti-
nuité entre téléfilm et film de cinéma s’estde façon générale renforcée dans lesannées 1990, nombre de « réalisateurs »contemporains passant (ou étant passés)de l’un à l’autre (en dépit de cette évolu-
tion, le film de cinéma semble conserverbien souvent une forme de supériorité surle téléfilm parce qu’il tend à mobiliser desmoyens économiques plus importants età conserver un plus grand prestige).
161 GROUPÉ*5.qxd 17/03/06 22:29 Page 109
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
EH
ES
S -
-
193.
48.4
5.20
1 -
04/0
9/20
15 1
3h14
. © L
e S
euil
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - E
HE
SS
- - 193.48.45.201 - 04/09/2015 13h14. © Le S
euil
réalisation à Hollywood d’un remake par une major,voire l’invitation à tourner un film à Hollywood(Francis Veber, Jean-Marie Poiré). De l’autre, chacunou presque tend à se poser (ou à être perçu) en repré-sentant d’une « exception française ». Le réalisateur degrosses coproductions peut ainsi déclarer qu’il chercheà « imposer notre pensée » à l’étranger, quand l’auteurd’une comédie stigmatisée comme « franchouillarde »est présenté, dans un dessin humoristique, comme uneincarnation de « l’exception culturelle française ».
Il coexiste donc, dans les régions du champ les plussoumises aux logiques commerciales, des stratégiesdifférentes. Pour s’en convaincre définitivement, il fautévoquer les héritiers plus ou moins revendiqués de la«qualité française» telle qu’elle s’est définie après guer-re19, avec son attachement artisanal au « travail bienfait » et l’emploi de grandes vedettes. Les programmesde l’enseignement secondaire, à travers le « patrimoi-ne littéraire» (Le Colonel Chabert, Cyrano de Bergerac,etc.) ou les figures et grands moments de l’histoirenationale (Napoléon, la guerre de 1914, l’Occupation,etc.), fournissent la matière privilégiée de productionsà gros budgets en partie conçues pour contribuer aurayonnement national. Elles s’exportent parfois trèsbien. L’État peut les soutenir financièrement et à tra-vers le système scolaire qui leur assure un public. Ellesne se distinguent guère du pôle le plus commercial duchamp que par une légitimité culturelle qui leur per-met, notamment, d’obtenir une forte reconnaissancesymbolique dans les manifestations professionnellescomme les Césars, mais aussi parfois dans les festivalsinternationaux. Elles s’inscrivent, en fait, dans unezone intermédiaire de l’espace difficile à classer dans
les catégories habituelles du « cinéma commercial » etdu « cinéma d’auteur ». Il y a une continuité entre lescinéastes réputés « commerciaux » qui font des adap-tations académiques de classiques scolaires, et ceuxqui, considérés comme des « auteurs », s’inspirent dela « Série noire ». Claude Berri [voir cartouche 5] pour-rait être le modèle de cette région intermédiaire duchamp : comme cinéaste, il a pu signer un film à grosmoyens d’après Germinal et se prêter à l’exercice dufilm d’« auteur » autobiographique à petit budget ;comme producteur, il a financé des comédies du pôlele plus commercial (Claude Zidi ou, plus récemment,Alain Chabat) et se targue d’avoir aidé quelques-unsdes noms les plus emblématiques du « cinéma d’au-teur» (Jacques Doillon, Philippe Garrel, Alain Cavalier,Éric Rohmer).
Les modalités qui, dans la partie supérieure dugraphique 1, occupent une position centrale surl’axe 2 correspondent, pour certaines, à despropriétés neutres (en ce sens qu’elles sont relati-vement indépendantes de la distance auxlogiques commerciales), mais renvoient, pourd’autres (la sélection fréquente aux Césars, lesfilms produits par Alain Sarde), à des caracté-ristiques qui tendent à être spécifiques auxcinéastes de la zone intermédiaire. Elles corres-pondent, de fait, à des sous-ensembles decinéastes plus ou moins dispersés, selon les cas,sur l’axe 2 : la variance du sous-nuage des indivi-dus est ainsi plus élevée pour les sélectionsponctuelles aux Césars (0,27) et pour lesmarchés européens larges, assez larges ou limités(0,23) que pour les coproductions par France3 (0,20), les productions Alain Sarde (0,18) oules sélections fréquentes aux Césars (0,17).
110
Julien Duval
19. Voir Y. Darré, op. cit., p. 44.
161 GROUPÉ*5.qxd 17/03/06 22:29 Page 110
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
EH
ES
S -
-
193.
48.4
5.20
1 -
04/0
9/20
15 1
3h14
. © L
e S
euil
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - E
HE
SS
- - 193.48.45.201 - 04/09/2015 13h14. © Le S
euil
Une autonomie relative
Si les usages communs de la catégorie du « cinémacommercial » sont critiquables, il faut tenir compte desfonctions de disqualification que la catégorie remplit,en certains endroits du champ, dans les luttes symbo-liques. Dans des régions de l’espace (celles qui cor-respondent à la partie gauche sur les graphiques),nombre de groupes et d’agents stigmatisent le « ciné-ma commercial » dont ils entendent se démarquer. Defait, les entreprises auxquelles ils participent touchentrarement un public aussi large que les films les mieuxclassés au box-office. Elles bénéficient en outre, auprèsde la critique et /ou des festivals internationaux, d’unereconnaissance symbolique interdite aux plus gros suc-cès commerciaux. Elles participent de systèmes decroyances qui, assez différents, ne s’accordent peut-être que pour rejeter – plus ou moins ouvertementd’ailleurs – les définitions de l’excellence cinémato-graphique qui ne connaissent d’autres critères que lesrésultats commerciaux et l’étendue du public conquisà court terme. Le système d’aides publiques qui, aumoins sur la période récente, privilégie cette région duchamp allège quelque peu le poids des contraintes éco-nomiques. Il contribue à rendre possibles des entre-prises qui, économiquement très risquées, tendent àse réclamer de valeurs importées de champs artistiquesdotés, comme la littérature, d’un degré d’autonomierelativement élevé. Mais, en matière cinématogra-phique, les conduites n’obéissant qu’aux nécessitésd’un « art » sont difficiles à tenir durablement ; ceuxqui les adoptent, quand ils ne sortent pas du champ,y occupent des positions marginales. Le travail derecherche doit composer avec des logiques commer-ciales qui s’exercent de façon simplement moins sys-tématique qu’à l’autre pôle du champ et s’inscriventsurtout dans des marchés plus restreints, où le capitalculturel joue un grand rôle.
Dans cette région du champ, la reconnaissancesymbolique constitue l’une des ressources les plus fon-damentales des cinéastes. Elle est tout particulière-ment liée à des institutions qui sont apparues dansl’entre-deux-guerres et se sont imposées à partir desannées 1950. Les grands festivals – et, sans doute,Venise plus que Cannes et Cannes plus que Berlin –sont ainsi des instances très prestigieuses qui délivrentun verdict « international » et aspirent à composer desflorilèges du cinéma mondial. Les figures historiquesde la Nouvelle Vague (Jean-Luc Godard ou ÉricRohmer) et quelques cinéastes un peu plus jeunes(André Téchiné ou Jacques Doillon) y sont très fré-quemment invités et se trouvent ainsi confortés dansleur statut d’« auteurs » majeurs [voir cartouche 6]. Pourles autres, l’accès à des lieux aussi sélectifs opère un
effet de consécration : elle marque que le film (et ceuxqui l’ont fait) est digne de figurer dans un florilègemondial, d’être soumis à un jury international et pres-tigieux, de s’ajouter à la liste des grands films sélec-tionnés par le passé (et passés à la postérité – les autressont oubliés). La sélection dans ces festivals opère letransfert d’un capital de type principalement artistique :les premiers jurys du Festival de Cannes comptaientainsi des écrivains consacrés dans le champ littéraire(parfois des écrivains-cinéastes, comme Jean Cocteauou Marcel Pagnol) ; depuis les années 1960, ils sont,au moins en partie, composés de personnalités ducinéma antérieurement consacrées à Cannes. Desmécanismes semblables régissent, mais à une échellenationale, l’attribution des prix Vigo ou Delluc. Créédans les années 1950 (principalement par Jean Cocteauet des cinéastes communistes), le premier est décernépar un jury composé de critiques, d’acteurs, d’éditeurs
de littérature et de cinéastes consacrés. Le second estremis par des critiques, mais la presse spécialisée estminoritaire dans le jury. Les films ont souvent rem-porté, avant d’être primés, un succès commercial aumoins relatif et le prix a souvent primé des artistesvenus de champs plus légitimes (Jean Cocteau, AlainRobbe-Grillet, Patrice Chéreau), ne récompensant desentreprises formelles ou expérimentales que lors-qu’elles prennent une forme plus commerciale (AlainResnais, Lucas Belvaux). La critique, en tout cas sousla forme qu’elle a prise dans les grandes revues spé-cialisées à partir des années 1950 (particulièrement,Les Cahiers du cinéma et Positif), est également puis-sante dans cette région du champ. Elle établit des hié-rarchies, distingue des films et des cinéastes. Son sou-tien peut permettre à des entrants de gagner unenotoriété et d’élargir leur public.
111
L’art du réalisme
161 GROUPÉ*5.qxd 17/03/06 22:29 Page 111
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
EH
ES
S -
-
193.
48.4
5.20
1 -
04/0
9/20
15 1
3h14
. © L
e S
euil
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - E
HE
SS
- - 193.48.45.201 - 04/09/2015 13h14. © Le S
euil
Pour comprendre ces institutions, et les effets symbo-liques qu’elles exercent, il faut les appréhender nonpas isolément, mais comme des éléments d’un milieusocial organisé autour de croyances communes. Au-delà de Venise, Cannes ou Berlin, un très grand nombrede festivals, moins médiatiques, proposent aussi desflorilèges très sélectifs et sont parfois également entou-rés d’un grand prestige (ainsi, les manifestations deRotterdam, Thessalonique, Locarno). La critique ciné-matographique ne se réduit pas aux grandes revuesspécialisées, mais englobe aussi, outre des revuesd’avant-garde parfois éphémères, les tribunes de titresparticulièrement lus dans des fractions bien dotées encapital culturel (Les Inrockuptibles, Télérama,Libération, Le Monde, etc.). Il faut aussi mentionnerles cinémathèques qui, créées à partir des années 1930sans « but lucratif », ont consacré la vision des filmscomme œuvres pérennes dont le cycle de vie ne s’achè-ve pas avec leur exploitation commerciale. Elles ontcontribué à construire et à entretenir un « canon » defilms classiques, relayées en cela par les ciné-clubs,aujourd’hui largement disparus, et le circuit des «sallesd’art et essai ». Si ce sont souvent des initiatives pri-vées qui ont contribué à structurer le milieu, l’État ya joué un rôle, par des subventions, par sa politiqueculturelle (la création des « salles d’art et essai » ou, en1959, du mécanisme d’avance sur recettes), ou enco-re à travers la télévision publique (avec, particulière-ment dans les années 1970 et 1980, les horaires réser-vés à des films de « ciné-clubs », ou avec Arte).L’ensemble de ce milieu20 assure aux cinéastes les plusautonomes par rapport aux logiques commerciales,des institutions susceptibles de les reconnaître et deles consacrer, mais aussi un public pourvu des dispo-sitions, et parfois des connaissances spécifiques, quela réception de leurs films exige. Le milieu entretientla croyance selon laquelle la vision d’un film est unepratique cultivée. Ses institutions les plus exigeanteset les franges les plus intégrées de son public tendentà appréhender le cinéma comme une culture savanteet les (bons) films comme des produits artistiques pre-nant place dans une « histoire du cinéma » distinguantdes courants, des œuvres majeures et des périodes21.
Les films produits dans cette région relativementautonome ne supposent pas tous la détention d’uneculture aussi spécifique, mais ils exigent presque tou-jours des dispositions ou des compétences concentréesdans des groupes sociaux bien dotés en capital cultu-
rel. Des films procédant, de façon revendiquée ou non,à une rupture avec les « conventions », les « stéréo-types », l’« idéologie » ou l’« esthétique » des produc-tions les plus commerciales demandent, par exemple,un « sens critique », c’est-à-dire une disposition qui estliée (comme l’intérêt pour les recherches formelles oustylistiques) au capital culturel. Les connaissancesrequises pour s’approprier la « lecture » qu’un cinéas-te propose d’une œuvre littéraire consacrée, ou enco-re la capacité à saisir l’intérêt esthétique ou politiquede scènes d’une apparente banalité (il y en a beaucoupdans les fictions et les documentaires produits à cepôle du champ), correspondent également à des res-sources culturelles. Enfin, l’appartenance aux fractionsintellectuelles de la bourgeoisie favorise, à tout lemoins, l’intérêt du spectateur pour des personnagesqui se recrutent fréquemment dans ces groupes. Il n’estdonc pas étonnant qu’au sein de l’ensemble du publicdes salles de cinéma, celui qui fréquente « l’art et essai»se caractérise par une proportion particulièrement fortede diplômés de l’enseignement supérieur (70% contre29 %), de cadres, de professions intellectuelles et deprofessions intermédiaires (51 % contre 21 %)22.
Les cinéastes semblent présenter des propriétésdu même type. La profession du père, indicateurde l’origine sociale, a pu être obtenue pour 72individus. Une variable à huit modalités a étéconstruite et placée en éléments supplémentaires.L’information étant plus accessible pour lescinéastes connus, toutes les modalités, sauf celle quicorrespond aux non-réponses, se projettent dansla partie supérieure de l’axe 1. Sur l’axe 2, elless’ordonnent de droite à gauche dans un ordre quivoit croître le capital scolaire du milieu d’origine :père artisan ou commerçant (n = 12 ; coordonnéesur l’axe 2 : 0,712) ; père à la télévision ou dans laproduction cinéma (n=8; 0,652); père employé ouagriculteur (n=7, 0,22) ; père profession artistique– acteur, cinéaste, scénariste, musicien, écrivain,technicien cinéma… (n = 17, 0,2) ; père industriel(n = 8, 0,11) ; père profession libérale ou cadre(n = 14, – 0,33) ; père enseignant, universitaire,journaliste (n=6, – 0,83). Cela conduit à mettre enrelation la structure du champ cinématographiqueet la structure de l’espace social.Par ailleurs, après avoir classé les œuvres litté-raires en quatre catégories, on a construit desvariables dichotomiques renseignant si les cinéastesavaient, ou non, déjà réalisé l’adaptation d’un livrerelevant de chacune de ces catégories. Les modali-tés positives se situent toutes dans la partiesupérieure de l’axe 1. Sur l’axe 2, elles semblent
112
Julien Duval
20. Pour d’autres éléments sociologiquessur ce milieu, voir Yvette Delsaut,« Éphémère 68. À propos de Reprise deHervé Le Roux », Actes de la recherche ensciences sociales, 158, juin 2005, p. 62-95.
21. Sur ce type d’appréhension desproduits culturels, et sur ses conditionssociales, voir Pierre Bourdieu et Alain Darbel(avec Dominique Schnapper), L’Amour del’art. Les musées d’art européens et leurpublic, Paris, Minuit, coll. « Le sens
commun », 1969.22. Les chiffres cités sont extraits durapport du CNC, «Le public des cinémas Artet essai » (mai 1999). Jean-Michel Guyfournit des données convergentes dans lespassages qu’il consacre au public des films
présupposant une «compétence en matièrede cinéma » dans La Culture cinématogra-phique des Français, Paris, La Documen-tation française, coll. « Questions deculture », 2001.
161 GROUPÉ*5.qxd 17/03/06 22:29 Page 112
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
EH
ES
S -
-
193.
48.4
5.20
1 -
04/0
9/20
15 1
3h14
. © L
e S
euil
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - E
HE
SS
- - 193.48.45.201 - 04/09/2015 13h14. © Le S
euil
s’ordonner, de droite à gauche, selon une légitimitélittéraire croissante : les films tirés de bandes dessi-nées, best-sellers, romans d’aventures et de capeet d’épée (n=18) ; puis les adaptations de la collec-tion « Série noire » (Gallimard) ou de romans deGeorges Simenon (n = 13) ; puis les films extraitsd’auteurs contemporains – hors best-sellers –(n = 14) ; enfin, les adaptations de classiques dela littérature européenne (n = 20). C’est là l’indiced’une relation d’homologie entre le champ cinéma-tographique et le champ littéraire.
La tendance à suivre le modèle des champs artistiquesles plus autonomes engendre une production qui trou-ve des marchés économiques (certes, parfois très res-treints) dans des groupes sociaux détenant un importantcapital culturel (général ou spécifique), que sont lesfranges les plus intégrées du milieu cinéphilique ou lepublic plus ou moins étroit des autres champs artistiques.Les cinéastes se consacrant à un travail de recherche,qui ne prend sens que par rapport à une histoire spéci-fique (celle du cinéma ou celle de l’art), se condamnentà un public trop limité pour permettre des entreprisesvraiment durables. Ils peinent en outre à obtenir un véri-table soutien de la part d’institutions prestigieuses qui,elles-mêmes soumises à des contraintes commerciales etmédiatiques, ne peuvent totalement les promouvoir, bienqu’ils représentent une forme très accomplie des valeursd’autonomie dont elles se réclament. En un sens, la seulereconnaissance à laquelle ils puissent pleinement pré-tendre de façon réaliste est le jugement assez imprévi-sible de la « postérité » (qu’une institution comme laCinémathèque peut paraître anticiper). Jean-Marie Straubet Danièle Huillet, par exemple [voir cartouche 1], cumu-lent les signes d’une très forte reconnaissance auprès
d’agents et d’institutions très autonomes (laCinémathèque ou Jean-Luc Godard), mais leur « exi-gence» semble les condamner à une position margina-le : leurs films sont régulièrement présentés dans les fes-tivals internationaux, mais dans des sections parallèlesplutôt qu’en compétition officielle, ce qui limite sensi-blement leur notoriété nationale et internationale ; LesCahiers du cinéma les regardent comme des figuresexemplaires, sans avoir jamais pris sur la période récen-te le risque de placer leurs films en couverture de la revue.
Très fragiles commercialement en raison de l’étroi-tesse du public, les entreprises avant-gardistes évoluentrégulièrement dans des formes d’expérimentation relevant du champ de l’art et beaucoup finissent dansdes expositions plutôt que dans des salles de cinéma.Cette destination peut paraître assez logique lorsque lemetteur en scène ne conçoit le cinéma que comme unmoyen pour réaliser un projet formé dans le champ del’art. En revanche, elle ressemble à un échec pour lesentreprises qui se définissent par rapport à une « his-toire du cinéma» et aux problèmes spécifiques que l’au-tonomisation du champ a constitués (les problèmes demise en scène en particulier – qui supposent de conce-voir le travail du cinéaste comme irréductible à desquestions littéraires ou plastiques). Le champ tend àrejeter ces entreprises qui ne se définissent pourtantque par rapport à lui.
En fait, l’autonomie conquise dans le champ ne l’apas été, loin s’en faut, par un renversement radical deslogiques commerciales. Plusieurs éléments peuvent êtrerappelés à ce sujet. La célébration de certains «auteurs»hollywoodiens (comme Alfred Hitchcock), et du styleet /ou de la vision du monde propre qu’ils seraient par-venus à imposer en dépit des contraintes économiquesqui pesaient sur eux, a joué un rôle central dans laconstruction du cinéma comme culture savante23.Aujourd’hui encore, la critique la plus prompte à sou-tenir des démarches avant-gardistes constitue réguliè-rement en objets de discours esthétiques des films hol-lywoodiens (dans les années 1990, Batman ou Titanicont été défendus par Les Cahiers du cinéma). On saitaussi que les innovations formelles développées enEurope dans les années 1960 et 1970 restaient des rup-tures partielles avec le modèle que Hollywood, toujourstrès soumis (mais à un degré et sous des formes diffé-rentes selon les époques) à des logiques commerciales,a imposé comme «classique»24. Au total, une produc-tion restreinte, visant comme dans d’autres champs leseul public des pairs, est très difficile. Les stratégiesd’autonomie se doivent d’être particulièrement réalistes.Celles qui parviennent à acquérir une reconnaissance et
113
L’art du réalisme
23. Sur ce point, voir Philippe Mary, « Un nouvel ordre artistique. La “politique des auteurs”, la Nouvelle Vague et l’invention du cinéma d’auteur (1950 – 1960) », thèse de docto-rat, EHESS, sous la direction de Louis Pinto, 2002, à paraître en 2006. 24. Sur ce point, voir « Alternatives modes of film practice », in David Bordwell, Janet Staiger et KristinThompson, The Classical Hollywood Cinema. Film Style and Mode de Production to 1960, New York, Columbia University Press, 1985, p. 378-385.
GRAPHIQUE 4. LES ADAPTATIONS LITTÉRAIRES (modalitéssupplémentaires correspondant aux adaptations de livres).
161 GROUPÉ*5.qxd 17/03/06 22:29 Page 113
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
EH
ES
S -
-
193.
48.4
5.20
1 -
04/0
9/20
15 1
3h14
. © L
e S
euil
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - E
HE
SS
- - 193.48.45.201 - 04/09/2015 13h14. © Le S
euil
une légitimité interne, leur donnant une chance de pro-duire des effets dans le champ, se doublent de straté-gies économiques, parfois tout à fait conscientes. Ainsi,Jean-Luc Godard ne doit pas son pouvoir symboliquedans le champ (personne, même dans les régions lesplus commerciales, ne peut totalement l’ignorer) à sesseules recherches formelles, mais aussi aux «deals25 »par lesquels il a pu apporter «un logo» à des stars quifacilitaient, en retour, le financement et la médiatisationdu film. D’autres stratégies existent, comme celle quiconsiste, en quelque sorte, à réaliser plusieurs films enun seul, de façon à toucher des franges différentes dupublic relativement bien doté en capital culturel : lamême œuvre sera perçue comme une simple comédiesentimentale par ces franges les plus larges, comme «unmarivaudage» par un public mieux doté et comme untravail de recherche en matière de mise en scène par unpublic encore plus restreint. Un projet autonome peuts’accompagner d’une organisation de moyen ou de longterme : sans toujours aller jusqu’à créer une société deproduction spécifique, les cinéastes peuvent prévoir d’al-terner des films inégalement risqués, les plus commer-ciaux permettant de financer les plus ambitieux. Un pro-jet d’auteur important recouvre donc très souvent unedimension économique, comme le montre encorel’exemple des coproductions internationales, autremoyen de faire exister des films voués, dans un paysdonné, à un public potentiel trop étroit.
La reconnaissance symbolique et la réussitecommerciale représentent deux formes de succèsopposées mais non exclusives (sinon sous leursformes extrêmes). Ainsi, il est vrai [voir graphique1] que les modalités aux positions les plus extrêmessur l’axe 2 sont, à droite, le plus grand nombred’entrées et, à gauche, la plus forte reconnais-sance critique. De même, aucun des cinéastesrattachés à cette dernière modalité n’affiche unnombre moyen d’entrées supérieur à quatremillions (soit un seuil plus élevé que celui retenupour le codage). Enfin, les cinéastes réalisant plusd’un million d’entrées sont fréquemment « sansreconnaissance critique » (71 % se rattachent àcette modalité qui ne concerne que 54 % del’ensemble de la population). Cependant, descinéastes très consacrés peuvent cumuler, du moinsen fin de carrière, les deux formes de succès. C’est,par exemple, le cas de Claude Chabrol, AlainResnais ou Roman Polanski [voir cartouche 7]dont les films réalisent en moyenne plus d’unmillion d’entrées ; plus généralement, il faut noterqu’un quart seulement des réalisateurs se ratta-chant à la modalité «forte reconnaissance critique»réalisent moins de 50000 entrées (soit une propor-tion sensiblement équivalente à celle qui s’observedans l’ensemble des cinéastes étudiés).
Ces stratégies consistent à trouver un point d’équilibreentre des aspirations à l’autonomie et des «concessions».Le sous-espace le plus autonome du champ est soumisà une tension qui reproduit, à son échelle, l’oppositionstructurant l’ensemble du champ. Inspirées par un réa-lisme nécessaire, ces stratégies courent le risque de perdreles faveurs des franges les plus intégrées du milieu «ciné-philique » et des institutions les plus liées aux valeursd’autonomie. La conception dominante de l’autonomie,dans la critique et certains festivals devant encore beau-coup aux luttes de « la Nouvelle vague » contre « laQualité française», ces stratégies exposent au soupçonde « compromissions » ou de « trahison », car la quêted’un public élargi évoque les productions plus commer-ciales qui prennent appui sur le marché de l’enseigne-ment secondaire. Les entreprises de ces cinéastes qui,souvent issus de la « cinéphilie », sont entrés dans lemétier vers les années 1970 (Bertrand Tavernier, ClaudeMiller, mais aussi André Téchiné, Constantin Costa-Gavras, Alain Corneau, ou naguère Yves Boisset qui n’aplus tourné, sur la période récente, que pour la télévi-sion), sont ainsi condamnées à deux perceptions contra-dictoires. Elles peuvent être vues comme des tentativespour exporter ou prolonger des innovations du pôle leplus autonome; elles bénéficient d’ailleurs souvent d’uneforte reconnaissance aux Césars ou dans les festivalsinternationaux les plus soumis aux contraintes média-tiques. Mais le pôle autonome dénonce aussi en elles destentatives pour banaliser, atténuer, voire « récupérer» àdes fins commerciales ses innovations.
Le champ cinématographique est donc structurépar deux grands principes, le volume et la structure
114
Julien Duval
25. L’expression est de Jean-Luc Godard lui-même (Sophie Grassin et Olivier de Bruyn, « Un certain Godard », Première, 327, mai 2004, p. 126).
161 GROUPÉ*5.qxd 17/03/06 22:29 Page 114
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
EH
ES
S -
-
193.
48.4
5.20
1 -
04/0
9/20
15 1
3h14
. © L
e S
euil
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - E
HE
SS
- - 193.48.45.201 - 04/09/2015 13h14. © Le S
euil
du capital détenu par les agents (ces principes défi-nissent des sous-espaces eux-mêmes traversés par desfacteurs de différenciation plus fins ; certains ont étéévoqués ci-dessus). Il présente donc la structure carac-téristique des univers de production culturelle. Si lerapprochement avec le champ littéraire s’impose par-ticulièrement, c’est que le champ cinématographique,et particulièrement sa région la plus autonome, a entre-tenu des relations plus étroites avec lui qu’avec aucunautre univers artistique ; la longue tradition des sujetslittéraires, comme le rôle des écrivains dans les ins-tances de légitimation naissantes (festivals ou revuesde cinéma), en témoignent. Le parallèle entre les deuxactivités a cependant ses limites : les contraintes éco-nomiques sont notablement plus fortes au cinémaqu’en littérature, ce qui confère un rôle sensiblementplus important à la notoriété externe (et, en particu-lier, médiatique) et rend bien plus précaires les pro-ductions destinées à un seul public de pairs.
L’apport de l’analyse empirique n’est pas de faireémerger une structure insoupçonnée des profession-nels, des critiques ou des spectateurs connaisseurs,mais plutôt de saisir, avec une assez grande précision,ce qui fonde objectivement les perceptions de cesagents quand ils parlent de « grand cinéaste »,d’« inconnu » ou de « réalisateur mineur », de « filmd’auteur » ou de « production commerciale ». Ainsi,l’analyse rappelle qu’il existe une correspondanceentre les catégories cognitives que les agents mobili-sent pour décrire le champ et les structures objectivesqui organisent celui-ci. Mais en recourant à desconcepts plus rigoureux26 que ceux qui sont habi-tuellement utilisés, l’analyse rend visibles des carac-téristiques du champ difficiles à voir et à nommer dansles catégories ordinaires, tout particulièrement lecontinuum qui mène du pôle le plus commercial aupôle le plus autonome et qui contredit l’hypothèse dedeux secteurs antagonistes et distincts (le « secteurcommercial » et le « cinéma d’auteur »).
Ainsi, l’opposition que l’on opère (mentalement)entre «cinéma d’auteur» et «cinéma commercial » ren-voie, aujourd’hui, à l’existence de deux sous-espacesqui s’opposent sous certains rapports, mais ne se lais-sent pas séparer par une ligne de partage objective. Onpeut alors esquisser une hypothèse au sujet des trans-formations du champ cinématographique en France.La notion d’« auteur », en effet, semble avoir d’abord
existé comme catégorie subjective, sans véritable fon-dement dans les choses (elle tendait d’ailleurs à l’époqueà passer pour un « discours d’intellectuel », voire pourune forme de « délire ») : lorsqu’elle s’impose dans lesannées 195027, le champ cinématographique présenteune autre configuration qu’aujourd’hui, les cinéastes yrecherchant presque tous un large succès commercial.À partir des années 1960, la notion de « cinéma d’au-teur » acquiert une forme d’existence objective ; ellerenvoie, au moins en partie, à un sous-espace qui dis-pose de structures de production et de diffusion spéci-fiques et qui tend à reléguer les verdicts commerciauxau second plan pour s’organiser autour d’instances deconsécration symbolique. Il se produit ainsi, au sein duchamp, une bipolarisation objective qui, sans aller jus-qu’à une scission en deux secteurs, est suffisammentnette pour que le « cinéma d’auteur» puisse être oppo-sé, sous certains rapports, au pôle le plus commercial.
Parmi les transformations actuellement à l’œuvredans le champ, plusieurs vont dans le sens d’une bipo-larisation accrue. L’hégémonie et l’autarcie du pôle leplus commercial tendent ainsi à se renforcer, sous l’ef-fet de l’intensification des contraintes économiques,des politiques suivies par les grandes chaînes de télé-vision en matière de coproduction, de programmationet de «promotion» du cinéma. La télévision contribue,sensiblement moins qu’au temps du monopole de ser-vice public, à élargir le marché des régions les plus auto-nomes. Par ailleurs, la quasi-disparition des « ciné-clubs » et de nombre de revues spécialisées, comme laréduction de l’assise commerciale d’auteurs très consa-crés28 ou l’attraction croissante que le champ de l’artsemble exercer au pôle le plus autonome, témoignentd’un affaiblissement de celui-ci. Un avenir possible duchamp pourrait bien résider dans une recompositionautour de deux secteurs presque dépourvus de relationsl’un avec l’autre : le premier serait fortement soumisaux logiques commerciales qui s’intensifient ; le seconddévelopperait des stratégies de recherche très auto-nomes, mais dans la marginalité. Ceux qui évoquentaujourd’hui deux secteurs aux intérêts antagonistes (lesuns pour s’en prendre à un « art sans spectateur », lesautres pour dénoncer l’hégémonie croissante du «ciné-ma commercial »), donnent une vision déformée del’état actuel de cet univers, mais ils énoncent peut-êtrece que le champ risque de devenir si les transforma-tions aujourd’hui à l’œuvre se poursuivent.
115
L’art du réalisme
26. À l’emploi de ces concepts s’ajoutentdes reformulations ; l’adoption de l’expres-sion de « pôle le plus commercial », parexemple, permet d’échapper à certains desproblèmes posés par le terme de « cinémacommercial ».
27. Pour le développement qui suit, voir, surla naissance de la politique des auteurs, P. Mary, op. cit., et, sur l’état du champavant la Nouvelle Vague, Y. Darré, op. cit.(notamment p. 44-45), ainsi que l’article dePhilippe Mary dans ce numéro.
28. Deux cinéastes qui ont débuté dansles années 1960 ou 1970 font ainsi en2004 un même constat : Jacques Doillonnote qu’« il faut se bagarrer [aujourd’hui]pour faire 100000 entrées quand […] monpremier long-métrage en faisaient 500000»
(Première, mai 2004) et Jean-Luc Godardexplique : « à une époque, on disait qu’onfaisait le film pour 200000 amis possibles,aujourd’hui, ils sont certainement moinsnombreux » (Les Cahiers du cinéma, 590,mai 2004).
161 GROUPÉ*5.qxd 17/03/06 22:29 Page 115
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
EH
ES
S -
-
193.
48.4
5.20
1 -
04/0
9/20
15 1
3h14
. © L
e S
euil
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - E
HE
SS
- - 193.48.45.201 - 04/09/2015 13h14. © Le S
euil




























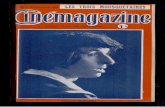











![[2006] Gimello-Mesplomb F. La politique publique du cinéma en France](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/6337a94dd102fae1b6077a90/2006-gimello-mesplomb-f-la-politique-publique-du-cinemaen-france.jpg)

