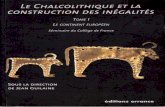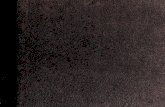Langage et identité : les non-coïncidences du dire dans la littérature du XXème siècle. Les cas...
-
Upload
univ-poitiers -
Category
Documents
-
view
3 -
download
0
Transcript of Langage et identité : les non-coïncidences du dire dans la littérature du XXème siècle. Les cas...
LANGAGE ET IDENTITÉ :LES NON-COÏNCIDENCES DU DIRE DANS
LA LITTÉRATURE DU XXe SIÈCLE.LES CAS DE ROBERT ANTELME ET
DE CLAUDE SIMON
Stéphane BIKIALO
« LeMêmenous aperdus, leMêmenous aoubliés, leMêmenous a – – »
Paul Celan, La Rose de personne
Le langage est pour l’homme moins un instrument de communication quel’espace d’émergence et de constitution d’une subjectivité, d’une identité : « c’estdans et par le langage que l’homme se constitue comme sujet ; parce que lelangage seul fonde en réalité, dans sa réalité qui est celle de l’être, le conceptd’“ego” » 1. C’est cette relation constitutive, cette construction ou cettepréservation de l’identité par et dans le langage que nous allons commenter dansL’Espèce humaine de Robert Antelme (1947) et L’Acacia de Claude Simon (1989).Dans ces deux textes en effet, le sujet ou le personnage sont mis en doute par
1. E. Benveniste, Problèmes de linguistique générale, t. 1, Gallimard, « Tel », 1966, p. 259.
12-Bikialo 9/11/06 16:13 Page 145
l’expérience des camps ou de la guerre. L’écriture rend compte de ce statut dusujet. R. Antelme pose d’ailleurs avec pertinence cet enjeu du langage :
C’est peut-être le langage qui nous trompe ; il est le même là-bas qu’ici ; nous nous servons desmêmes mots, nous prononçons les mêmes noms. Alors on se met à l’adorer car il est devenul’ultime chose commune dont nous disposions. […] Notre langue […] est toujours la même,inviolable. Ils peuvent beaucoup mais ils ne peuvent pas nous apprendre un autre langage quiserait celui du détenu. Au contraire, le nôtre est une justification de plus de la captivité.On aura toujours cette certitude, même méconnaissable pour les siens, d’employer encore cemême balbutiement de la jeunesse, de la vieillesse, permanente et ultime forme del’indépendance et de l’identité 2.
L’objectif ne sera pas de rapprocher, de comparer les écritures deR. Antelme et de C. Simon, dont les différences sont ostensibles, au niveau de lanature du récit en particulier puisque L’Espèce humaine est explicitementautobiographique, tandis que L’Acacia est tout au plus « à base de vécu » 3 et seprésente comme un roman. Dans les deux cas, toutefois, se joue une expérienceextrême, au sens étymologique de ce qui est le plus à l’extérieur, ou à la limite(avec l’idée du seuil, de quelque chose d’extérieur à soi), qu’il s’agisse del’expérience concentrationnaire ou de celle de la guerre de manière plus générale.
Ce lien thématique en induit un autre, plus fondamental selon nous, et quirelève du style. Dans ces deux ouvrages se trouve problématisée et mise en scènedans l’écriture l’opacité constitutive de la langue et du réel, donc du dire. RolandBarthes a clairement rappelé cette opacité foncière en notant que « le réel n’estpas représentable, et c’est parce que les hommes veulent sans cesse le représenterpar les mots qu’il existe une histoire de la littérature » 4. « L’impossible » de lalangue et de son rapport au réel est à l’origine du concept de « lalangue » proposépar Jacques Lacan et parfaitement commenté par Jean-Claude Milner dansL’Amour de la langue : « lalangue est, en toute langue, le registre qui la voue àl’équivoque. Nous savons comment y parvenir : en déstratifiant, en confondantsystématiquement son et sens, mention et usage, écriture et représenté » 5.
L’Espèce humaine comme L’Acacia, sur des modes différents, mettent en œuvrecette opacité constitutive qui devient donc une opacité montrée. Celle-ci passepar ce que Jacqueline Authier-Revuz a appelé les « non-coïncidences du dire » 6.
146 Stéphane BIKIALO
2. R. Antelme, L’Espèce humaine, Gallimard, 1957 (1947), rééd. coll. « Tel », 1978, p. 51.3. C. Simon « Et à quoi bon inventer ? Entretien avec M. Alphant », Libération, 31 août 1989, p. 24.4. R. Barthes, Leçon, Seuil, coll. « Points », 1978, p. 21-22.5. J.-C. Milner, L’Amour de la langue, Seuil, 1978, p. 22.6. J. Authier-Revuz, Ces mots qui ne vont pas de soi. Boucles réflexives et non-coïncidences du dire, t. 1 et 2, Larousse,
1995.
12-Bikialo 9/11/06 16:13 Page 146
Ces champs de non-coïncidence relèvent d’une configuration énonciativeconstituant un mode du dire complexe, dédoublé, participant de la réflexivitélangagière – donc méta-énonciatif 7 – nommée par J. Authier-Revuz la « modalitéautonymique » :
En un point de [son] déroulement, le dire se représente comme n’allant plus « de soi ». Le signe,au lieu d’y remplir, dans une apparente transparence, dans l’effacement de soi, sa fonctionmédiatrice de nomination, s’interpose – avec son signifié et son signifiant – dans sa matérialité,comme un objet qui, rencontré dans le trajet du dire, s’y pose comme objet de celui-ci ; etl’énonciation de ce signe, au lieu de s’accomplir « simplement », dans l’oubli qui accompagneles évidences inquestionnées, se redouble d’une représentation d’elle-même 8.
Cette opacification, ce non-un du dire peut relever de quatre types de non-coïncidence : non-coïncidence interlocutive entre les deux co-énonciateurs ; non-coïncidence du discours à lui-même, dans les boucles mettant en scène le jeu d’undiscours autre ; non-coïncidence entre les mots et les choses, dans les bouclesévoquant la question de la nomination, de la propriété, de l’adéquation ; et non-coïncidence des mots à eux-mêmes dans la polysémie, l’homonymie, lescalembours…
Il s’agira pour nous d’observer le ou les types de non-coïncidenceprédominants dans chacun des ouvrages étudiés à travers un certain nombre deformes syntaxiques et énonciatives. Le non-un du dire se manifeste en effet àtravers des formes plus ou moins marquées notamment par la ponctuation :italiques, parenthèses, tirets doubles, virgules. Emergera ainsi une « positionénonciative » 9 spécifique qui participe du style de l’œuvre. Le style a en effetpartie liée selon nous à la constitution dans et par l’écriture d’un sujet.Construction du sujet et du texte sont donc conjointes. Or les non-coïncidencesdu dire « inscrivent, au cœur du sujet et du sens, [une] division fondatrice et[une] menace de déliaison » 10, elles sont une représentation du sujet parlant auxprises avec le langage.
LANGAGE ET IDENTITÉ 147
7. Défini comme auto-représentation du dire en train de se faire, auto-initié par le locuteur et immédiat surla chaîne linéaire du discours.
8. J. Authier-Revuz, « Énonciation, méta-énonciation. Hétérogénéités énonciatives et problématiques dusujet », dans Les Sujets et leurs discours (dir. R. Vion), Publications de l’Université de Provence, 1998, p. 64-65.
9. Ibid., p. 75.10. Ibid., p. 75.
12-Bikialo 9/11/06 16:13 Page 147
L’ESPÈCE HUMAINE DE ROBERT ANTELME
Le titre L’Espèce humaine pose, par l’article défini, à la fois l’existence duréférent et son unicité :
la variété des rapports entre les hommes, leur couleur, leurs coutumes, leur formation en classesmasquent une vérité qui apparaît ici éclatante, au bord de la nature, à l’approche de noslimites : il n’y a pas des espèces humaines, il y a une espèce humaine. […] C’est parce qu’ilsauront tenté de mettre en cause l’unité de cette espèce qu’ils seront finalement écrasés. (p. 229)
Mais par ce titre R. Antelme ne fait pas qu’invalider le projet nazi, il empêcheaussi la stigmatisation exclusive du peuple allemand favorisée par un certainmanichéisme. C’est ce qu’évoque La Douleur de Marguerite Duras :
Robert L. a parlé. […] Alors il a commencé à raconter pour que ce soit dit avant sa mort.Robert L. n’a accusé personne, aucune race, aucun peuple, il a accusé l’homme 11.
Cette dialectique de l’unité et de l’altérité de l’homme est posée tout au longde l’œuvre, à travers les formes de non-coïncidence ; non-coïncidence du discoursà lui-même tout d’abord, posant le problème de la langue de l’autre,essentiellement l’allemand, et non-coïncidence des mots avec les choses ou lesêtres, signalant que l’identité et la réalité en général ne vont plus de soi.
Non-coïncidence du discours à lui-même : la langue de l’autreJ. Authier-Revuz définit cette forme de non-coïncidence du discours à lui-
même comme « la rencontre par l’énonciateur dans les mots de son discours, demots venus d’ailleurs » 12.
La langue allemande est ici principalement cette langue autre qui intervientrégulièrement dans le fil du discours. Ces mots allemands relèvent de la modalitéautonymique en ce qu’ils apparaissent au sein du dire en train de se faire à la foisen usage et en mention, utilisés et cités en même temps. Ce type de non-coïncidence est marqué par des indices typographiques qui réalisent –parenthèses, notes de bas de page – ou non 13 – italiques, guillemets – undédoublement formel sur la chaîne du discours.
148 Stéphane BIKIALO
11. M. Duras, La Douleur, Gallimard, 1985, rééd. « Folio », p. 67.12. J. Authier-Revuz, Ces mots qui ne vont pas de soi, op. cit., p. 235.13. J. Authier-Revuz (ibid., p. 134) note ainsi que ces « signaux – non segmentaux – déjouent la contrainte
de la mono-linéarité verbale et réalisent, par superposition ou incorporation matérielle à la chaîne verbale,une coïncidence au plan du signifiant entre l’énonciation et son reflet opacifiant ».
12-Bikialo 9/11/06 16:13 Page 148
Les notes de bas de page sont assez limitées dans le texte 14. Elles ont toutesune valeur explicative, de traduction-définition de termes allemands spécifiquesà l’organisation et la hiérarchie du système concentrationnaire. Ainsi la note dela page 17 appelée par le terme « stubendienst » :
Détenu responsable de l’administration du block, sous l’autorité du détenu chef du block(blockättester), lui-même sous l’autorité du détenu lagerältester (chef des kapos, responsable dufonctionnement du camp devant les SS).
Le marquage très fort du redoublement dans ce cas met à distance de manièremaximale le terme allemand. Est souligné ainsi le caractère original voire originelde ces statuts qui ne peuvent être simplement traduits mais doivent être expliquéscomme des hapax de la langue – allemande aussi 15 – et du monde contemporain,des créations réservées à ce système. Le contenu même de la note présente unerécursivité des définitions mettant en avant la hiérarchisation extrême de cescamps. Une telle hiérarchie a notamment pour but de réduire les contacts directsentre SS et détenus. La stratégie SS de négation de l’identité humaine des détenuspasse par une absence de relation aussi bien physique que langagière. D’où larareté des formes de non-coïncidence interlocutive 16 entre détenus et allemands,emblématique d’une non-coïncidence philosophique du point de vue allemand.Les SS utilisent en permanence des médiateurs, afin d’éviter ces contacts directsque seule leur défaite les obligera à supporter : « Je suis collé contre la sentinelle[…]. Il n’a jamais connu un ennemi d’aussi près » (p. 264).
Certaines notes (p. 135) ont une valeur équivalente aux parenthèses quiservent souvent à une traduction de l’allemand en français : « il a dit qu’il étaitschreiber (secrétaire). Il deviendra lagerältester (doyen du kommando) » (p. 26) ;« Zu fünf (par cinq) » (p. 27) ; « chacun est un häftling (détenu) type » (p. 32) ;« Ruhe ! (silence !) gueule le grand SS » (p. 37).
Ces formes présentent fréquemment un cumul de l’italique pour le motallemand et des parenthèses pour sa traduction en français. Le double marquagetypographique renforce la distance, la non-coïncidence entre les deux discours parla rupture qu’il induit sur la chaîne discursive. La prégnance de ces formessouligne donc à la fois l’importance de la langue allemande, son emprise sur le
LANGAGE ET IDENTITÉ 149
14. Environ quatorze occurrences aux p. 17, 60, 71, 131, 132, 133, 135, 149, 162, 171, 181, 201, 215, et217.
15. C’est en tout cas l’effet produit par la note.16. Définie par J. Authier-Revuz comme des boucles méta-énonciatives dans lesquelles le « tu » est explicite-
ment convoqué dans une relation entre deux interlocuteurs.
12-Bikialo 9/11/06 16:13 Page 149
récit et sur les détenus, et son statut de langue autre. Cette langue autre est lalangue du pouvoir dans les camps, la seule langue imposée, qui ne peut donc ques’imposer dans ce récit :
la langue allemande – celle langue qui, ici, est celle du bien, leur latin –(p. 36),
Pour les SS et les nazis, si nous ne parlons pas l’allemand, si nous sommes maigres et laids àvoir, si nous ne sommes pas utilisables devant un tour, c’est que nous représentons laquintessence du mal. (p. 61)
En traduisant ainsi les termes allemands, l’énonciateur remet cependant encause l’omnipotence de cette langue. Il induit une connivence avec le lecteur,supposé non allemand et donc ayant besoin de cette traduction.
Mais il est aussi une abondance de termes non traduits, souvent les pires, lesinsultes, les ordres répétitifs : « schwein » (p. 17, 228), « scheisse » (p. 17, 34, 69,82, 176, 227), « los » (p. 41, 46, 47, 122, 148, 153, 194, 216, 259, 260),« antreten » (p. 38, 69, 217, 231, 235, 250), etc. Par l’absence de traduction, cestermes apparaissent comme de purs signifiants, dont le son – et la prononciationfréquemment évoquée par des verbes introducteurs comme « gueuler », « crier »– suffit à provoquer des actions. L’italique ne marque pas seulement dans ce casle statut de langue étrangère, il note aussi la mise à distance de ce discourshaineux, ce qu’explicite parfois une formule méta-énonciative : « Leur propredéfaite vue à travers la victoire de ceux qu’ils appelaient alles scheisse » (p. 156).
Paroles dont le sens importe peu, mais aussi paroles dont la haine brute nepeut être traduite, « comme si les mots eux-mêmes étaient chargés d’un pouvoirmaléfique et salissant, comme obscènes » 17. Une idée que l’on retrouve chezGeorges Steiner, dans Le Transport d’A.H. :
Tout ce qui vient de Dieu, Loué soit Son Nom, a toujours une seconde face, un revers de malet de néant. Ainsi en est-il du Verbe, du don de la parole qui est la gloire de l’homme et ledistingue à jamais du silence et des bruits animaux de la création. Quand Il créa le Verbe, Dieupermit aussi son contraire. Le Silence n’est pas le contraire du Verbe mais son gardien. Non,Il créa sur la face nocturne du langage une parole infernale. Dont les mots vomissent la hainede la vie 18.
150 Stéphane BIKIALO
17. Cl. Simon, L’Acacia, Éditions de Minuit, 1989, p. 65-66.18. G. Steiner, Le Transport d’A. H., 1979, Le Livre de Poche, « Biblio » (1981),
p. 60.
12-Bikialo 9/11/06 16:13 Page 150
Deux restrictions s’imposent toutefois à cette emprise du discours de la hainesur le texte d’Antelme : d’une part ce discours est nettement circonscrit, d’autrepart il n’est pas le seul à être noté comme négatif, et le langage des détenus l’estparfois aussi.
Le marquage très précis des frontières entre discours de l’énonciateur etdiscours de l’autre par les notes, les guillemets, les italiques et les parenthèsespermet en effet de « circonscri [re] la place de l’autre comme celle d’un « corpsétranger » nettement séparé du « propre » » 19, sans risque interprétatif de mélangedes deux discours. Ces formes limitent donc le pouvoir de la langue allemandeen la cantonnant, en l’isolant dans le texte.
L’italique et les guillemets introduisent souvent ces discours rapportés, cetteparole de l’autre non prise en charge par l’énonciateur. Dans le cas des guillemets,l’hétérogénéité énonciative dont elles sont l’indice suffit à distinguer les deuxdiscours. Mais le problème est plus délicat pour les italiques et certains guillemetsportant sur un terme isolé qui ont des valeurs multiples. Dans ce cas, des ajoutsmétalinguistiques explicites suppriment toute ambiguïté :
il [Lucien] sera vorarbeiter, c’est-à-dire qu’il sera chargé, comme il le dit lui-même, de pousserle travail (p. 52)
Le policier sort le type de la merde.– Va te laver, dégueulasse !Le « dégueulasse » s’appuie contre le mur (p. 295)
[…] – Nous sommes des détenus spéciaux, nous a dit, quelques jours plus tard, le dentiste(p. 60)
La ponctuation, mais aussi le cotexte, marquent la mise à l’écart du terme etdésignent explicitement son origine énonciative par le nom propre « Lucien » oules syntagmes nominaux définis « le policier » et « le dentiste ». Le plus fréquentest cependant le renvoi à un discours autre, non pris en charge par l’énonciateur,mais non identifié précisément. Ainsi dans le passage consacré au civil allemand,ce « nazi puceau » qui frappe les détenus pour s’affirmer :
La révélation de la fureur SS […] ne soulevait peut-être pas autant de haine que le mensongede cette bourgeoisie nazie qui entretenait cette fureur, la calfeutrait, la nourrissait de son sang,de ses « valeurs ». (p. 198)
LANGAGE ET IDENTITÉ 151
19. J. Authier-Revuz, Ces mots qui ne vont pas de soi, op. cit., p. 285.
12-Bikialo 9/11/06 16:13 Page 151
Les termes axiologiquement marqués (« haine », « mensonge ») qui précèdentle mot « valeurs » mis entre guillemets soulignent le caractère ironique,antiphrastique de ce nom connoté méliorativement. Dans ce type d’occurrence,la non-coïncidence des discours rejoint la non-coïncidence des mots aux chosesque nous aborderons par la suite. À travers le langage nazi, c’est aussi une certaineconception de la réalité qui apparaît évidemment distanciée par l’écrivain. Ainsi,pour rester dans le même registre, cet emploi et cette conception des « héros » :« Ils étaient quelques-uns qui cognaient, c’étaient les héros (p. 147), mais aussi des« bons » détenus et de la « justice » : « chercher parmi les têtes les bonnes dont ilspourront se servir » (p. 27) ; « Ils rendaient la justice » (p. 194). Ces mots enitalique ont une portée ironique, en ce qu’ils sont la parole de l’autre récuséeindirectement, par l’analyse de l’ensemble du texte. L’intérêt de l’italique est eneffet qu’il note la non-coïncidence sans l’interpréter. Il s’agit d’une caractérisationde la manière de dire sans spécification, une sorte de manque, de creux à comblerinterprétativement 20.
Ainsi les italiques renvoient principalement à la langue du pouvoir – parutilisation ou non du mot allemand –, ce qui témoigne de l’emprise langagièreet idéologique des « maîtres » du camp, puisqu’ils ne peuvent être évincés du textemême écrit après-coup. Mais la mise à distance qu’elles signalent est aussi lamarque d’une résistance à cette invasion de la langue et de l’idéologie qu’ellevéhicule. Parler allemand dans les camps, c’est devenir, à l’instar de Lucien,« l’auxiliaire de langue française de ceux qui commandaient dans la langueallemande » (p. 133).
« Les futurs kapos parlent la même langue que lui [le vieux SS]. […] la languea circonscrit le danger » (p. 30). Symbole d’une communauté, d’une complicitérecherchée par certains, la langue allemande est rejetée par les autres détenus. SeulGilbert saura en faire bon usage, « c’est-à-dire qu’il ne se servit de la langueallemande que pour tenter de neutraliser les SS, les kapos, les meister » (p. 133) :« Gilbert arrive. Immédiatement, il parle en allemand au meister. Il le cloue.Avec son propre langage, il l’attire à lui » (p. 63). Lorsque la libération seraimminente, le signe que ce n’est pas fini passe encore par la langue : « on nousparle encore la même langue » (p. 286), tandis que l’espoir passe par « la voix quiparle, égale à la nôtre, le langage de l’homme qui sait, qui donne le pain et quin’insulte pas » (p. 288).
152 Stéphane BIKIALO
20. Voir, J. Authier-Revuz, Ces mots qui ne vont pas de soi, op. cit., p. 136.
12-Bikialo 9/11/06 16:13 Page 152
Le texte incarne toutefois également par la mise en avant de ces formes denon-coïncidence du discours à lui-même cette résistance au langage du pouvoir.Comme l’a parfaitement formulé J. Authier-Revuz en effet,
désigner […] des points de non-coïncidence où surgit un autre discours (quel que soit cet autre,et les rapports évoqués entre les deux), c’est, pour un discours, circonscrire – et donc dénier –la non-coïncidence généralisée d’un dire dont tous les mots sont « d’emprunt », réduire lamenace de dépossession, […] établissant ainsi, par différence, le reste du discours dans lacoïncidence à soi, le un, […] se construire différentiellement une identité 21.
Les formes de non-coïncidence du discours à lui-même semblent donccirconscrire le danger d’une langue unique, du pouvoir arbitraire, en la faisantintervenir ponctuellement sur la chaîne discursive. Il convient de noter toutefoisque les interventions de l’allemand ne sont pas réservées aux paroles des nazis oude leurs subordonnés. Il y a tout d’abord certains mots allemands qui permettentune réconciliation des hommes au-delà de l’idiome, en particulier ce « langsam »prononcé par un civil employé à l’usine :
– Langsam ! (lentement).On s’est retourné vers lui comme s’il venait de déclencher un signal tonitruant. On l’a regardésans rien répondre, sans faire le moindre signe de connivence. Lui aussi nous a regardés, il n’arien dit d’autre. […]Langsam ! Ça suffisait bien.[…] Dire langsam à des gens comme nous, qui sommes ici pour travailler et crever, cela veutdire qu’on est contre les SS » (p. 59)
La reprise de ce terme (p. 80, 100, 184) souligne son importance, mais aussisa rareté. Il est le signe que la langue nazie n’est pas la langue allemande, n’en estqu’une altération, une déformation. Elle peut être aussi cette langue musicalequ’écoute sans la comprendre R. Antelme dans sa conversation ou plutôt sonéchange avec un évangéliste allemand (p. 75). Comme l’a écrit R. Barthes, « onn’est jamais propriétaire d’un langage. Un langage ça ne fait que s’emprunter, quese passer comme une maladie ou une monnaie » 22. Maladie dans le cas de lalangue nazie, la langue allemande se fait valeur d’échange dans d’autres cas,comme dans la dernière partie, « la fin », où le dialogue avec les Américains sefait en allemand :
LANGAGE ET IDENTITÉ 153
21. J. Authier-Revuz, ibid., p. 270.22. R. Barthes, Le Grain de la voix. Entretiens 1962-1980, Seuil, 1981, rééd. « Points », p. 87.
12-Bikialo 9/11/06 16:13 Page 153
on peut parler aux soldats. Ils vous répondent […]. Ils essayent de dire en anglais que New-York est beau, et ils le disent en allemand. Lorsque le soldat demande s’ils connaissent Paris,croyant répondre yes, ils disent ja. Alors les types rigolent un peu, et le soldat aussi. (p. 300)
Derrière ce rire retenu se lit toutefois une gêne, le sentiment que l’on ne peutse défaire de l’emprise d’une langue qui s’est voulue universelle, unique parl’arbitraire. Cette image ambiguë d’une nouvelle utilisation de la langueallemande se traduit par le fait qu’il n’y a pas de réelle communication dans cecas comme dans l’épisode de la page 75. Ambiguïté qui se poursuivra dans lesdernières lignes et même le dernier mot du livre, qui s’achève par un dialogue enallemand.
Que ces dernière lignes soient à interpréter comme la marque indélébile d’uneexpérience traumatisante qui est passée en grande partie par le langage, et quiuniquement pourra être non pas effacée mais distanciée par l’écriture littéraire eten français, ou encore comme le rétablissement d’une sorte d’harmonie, d’unitéde l’espèce humaine dans le langage derrière la diversité des langues, d’uneacceptation de l’autre, cela demeure pour nous indéterminé.
Reste que dans L’Espèce humaine, le langage est un enjeu de résistance à labrutalité nazie, qu’il s’agisse de la langue allemande dans le « langsam » ou dansson utilisation par d’autres, ou de la langue française, langue des détenus qui leurpermet de « supporter » l’expérience concentrationnaire. Ainsi de Félix qui
contre le jet et les coups, […] n’avait que le génie de sa langue. « Bande de salauds, vous serezbaisés ! » Félix draguait tout ce qu’il savait d’injures ; toutes les combinaisons de mots […](p. 192)
Les échanges rares entre détenus – la faiblesse physique réduisant au minimumle moindre échange langagier – sont des moments lors desquels s’affirme unesorte de bonheur de la coïncidence du discours à lui-même :
Ils en avaient des histoires comme celle-là, avec de la fine, un copain, la femme qui râle ou quise marre avec, ils savaient ce que c’était, le boulot aussi. Tout le monde se comprenait, onpouvait parler longtemps comme ça. On décrivait tout. […] À partir de ce moment, chacunétait devenu un personnage. (p. 114)
Par le langage se réaffirme une identité niée, d’où l’importance aussi de la« séance récréative » organisée par Gaston :
Ainsi un langage se tramait, qui n’était plus celui de l’injure ou de l’éructation du ventre, quin’était pas non plus les aboiements de chiens autour du baquet de rab. […] Au cœur de la mine,dans le corps courbé, dans la tête défigurée, le monde s’ouvrait. (p. 201)
154 Stéphane BIKIALO
12-Bikialo 9/11/06 16:13 Page 154
Dans ce dernier exemple, ce n’est pas seulement la langue nazie qui estévoquée, mais aussi celle des détenus le plus souvent. Cette « face nocturne dulangage » mentionnée dans la citation de G. Steiner supra est aussi celle desFrançais :
Fange, mollesse du langage. Des bouches d’où ne sortait plus rien d’ordonné ni d’assez fort pourrester. C’était un tissu mou qui s’effilochait. Les phrases se suivaient, se contredisaient,exprimaient une certaine éructation de la misère ; une bile de mots. Tout y passait à la fois : lesalaud, la femme abandonnée, la soupe, le pinard, les larmes de la vieille, l’enculé, etc. […]L’Enfer, ça doit être ça, le lieu où tout ce qui se dit, tout ce qui s’exprime est vomi à égalitécomme dans un dégueuli d’ivrogne. (p. 141)
Ce rapprochement est également sensible par le fait que la non-coïncidencedu discours à lui-même, l’utilisation de termes opacifiants, s’effectue au seinmême de la langue française. La non-coïncidence, marquée par les italiques, peuttémoigner de la distance entre ceux du camps, « d’ici », et ceux restés en France,ceux de « là-bas » 23: « les Alliés avaient lancé la grande offensive » (p. 168),« L’État-Major allié doit estimer que la situation évolue très favorablement » (p.284), ou d’un vocabulaire spécifique aux détenus : « Il y avait aussi une véritablebrute qui avait été enfermée, assurait-on, pour un « crime crapuleux » et qu’onappelait l’assassin » (p. 131), « Gaston avait envisagé la veille d’organiser pour cedimanche une séance récréative » (p. 200).
Mais R. Antelme se sert surtout de l’italique pour mettre à distance ses propresmots, souligner que les formules figées peuvent prendre des connotationsdifférentes voire opposées dans ce contexte spécifique. Ainsi lorsque Gilbert sauveun détenu des coups qui l’attendent, en parlant au SS, celui-ci est dit « hors ducoup » (p. 37). Par la syllepse sur le mot « coup » – pris au sens figuré maisrenvoyant aussi au sens propre, concret – intervient dans le texte la non-coïncidence des mots avec les mots. Le mot se présente comme un « nœud designifications » selon une formule de Cl. Simon, c’est-à-dire à la fois opaque etdynamique, vivant. « On sentirait aussi, muette, profonde, la veine du corps : « Cen’est pas moi qui prends. » » p. (23). Cette veine du corps, signe que le détenun’est plus que « l’ombre de soi » 24, est aussi la chance de n’être pas celui qui prendà ce moment.
LANGAGE ET IDENTITÉ 155
23. Pour une opposition explicite des deux espaces ainsi évoqués, voir les p. 92-93.24. Voir D. Dobbels, « La veine du corps », dans Robert Antelme. Textes inédits sur « L’Espèce humaine ». Essais
et témoignages, Gallimard, 1996, p. 235.
12-Bikialo 9/11/06 16:13 Page 155
On retrouve un procédé semblable dans la réactivation de sens étymologiques :« Il fait quelques pas vers la porte. On accompagne sa sortie » (p. 42) ; « le trianglemauve signifiait objecteur de conscience. L’objecteur était celui qui avait opposéDieu à Hitler. À celui-là on reconnaissait une conscience » (p. 74). Dans les deuxcas, le terme est opacifié du fait du rappel de son sens étymologique, qui met àdistance le verbe « accompagner » dont le rapprochement par le champdérivationnel avec « compagnon » est ici déplacé, ou rappelle la puissancesubversive et identitaire de l’expression « objecteur de conscience ».
Par les formes de non-coïncidence du dire, le langage apparaît à la fois commeun danger, une « sorcellerie » (p. 169), et comme une force vitale, (re)donnantune identité au scripteur : « langage et signes redeviennent déchiffrables. Lemonde n’est plus ce chaos que des mots vides de sens désespèrent de décrire. Ilest une réalité vivante et difficile que le pouvoir des mots, peu à peu,conquiert » 25. C’est précisément à ces rapports entre langage et réalité que nousallons désormais nous intéresser à travers l’analyse des formes de non-coïncidencedes mots et des choses.
Non-coïncidence entre les mots et les chosesAu-delà de, ou à travers, les non-coïncidences entre deux discours, ce sont
dans ce texte deux conceptions de la nature humaine et de la réalité quis’affrontent. Comme l’a parfaitement écrit Georges Perec,
le principe essentiel du système concentrationnaire est partout le même : c’est la négation. Ellepeut être extermination immédiate, mais c’est, en fin de compte, le cas le plus simple. Elle est,plus souvent, destruction lente, élimination. Il faut que le déporté n’ait plus de visage ; qu’il nesoit plus qu’une peau tendue sur des os saillants 26.
Le projet nazi repose sur le gommage des identités, des individualités quipasse par l’absence de nom propre : « Nous sommes le nombre, le nombre, et,nous non plus, pour lui, nous ne pouvons pas porter de nom » (p. 25), « Je luiai demandé s’il pouvait me dire son nom. – Cela n’a plus d’importance, m’a-t-ilrépondu » (p. 294).
Le nom propre, en tant que « désignateur rigide », relève de l’identité sociale,de même que l’ensemble des propriétés descriptives individualisantes. Selon
156 Stéphane BIKIALO
25. G. Perec, « Robert Antelme ou la vérité de la littérature » (1963) repris dans Robert Antelme. Textes inéditssur « L’Espèce humaine ». Essais et témoignages, Gallimard, 1996, p. 235.
26. G. Perec, op. cit., p. 180.
12-Bikialo 9/11/06 16:13 Page 156
Clément Rosset,
on s’en tient à vos faits et geste (et peu importe que ceux-ci aient été en l’occurrence faussés ettruqués), pas à ce qui peut vous passer par la tête. Or le domaine des faits et gestes, commecelui des papiers et documents, qui relève de l’identité sociale, est le seul à avoir cours officiel ;le reste […] appartient au domaine à jamais invérifiable et incertain de vos fantasmes et de vosrêveries 27.
Apparaissent dans cette perspective à la fois la puissance de la négation nazieet sa vanité. Nier l’identité sociale, c’est renvoyer une image altérée de soi, ce quemontrent les formes de non-coïncidence au niveau de la désignation et de lacaractérisation physique des détenus :
Quelque chose est apparu sur la couverture étalée. Une peau gris noir collée sur des os : la figure.Deux bâtons violets dépassaient de la chemise : les jambes (p. 34),
les zébrés apparaissent sur le plancher jusqu’au fond du wagon : matière gris-bleu-violet,brouillardeuse dans le faible matin (p. 32)
Vous en avez fait cet homme pourri, jaunâtre, ce qui doit ressembler le mieux à ce que vouspensez qu’il est par nature : le déchet, le rebut, […] de la vermine qui crève (p. 94),
un enchevêtrement de loques zébrées, de bras recroquevillés […] ; des bouches ouvertes vers leplafond, des visages d’os couverts de peau noirâtre avec les yeux fermés, des crânes de mort,formes pareilles qui ne finiront pas de se ressembler, inertes et comme posées sur la vase d’unétang. (p. 228)
Les détenus sont réduits à l’état d’ombres, de « vestes rayées »(p. 80), ce que marque la figure de la nomination ou de la caractérisationmultiple. Cette configuration se caractérise par une mise en relation syntaxiquede nominations équivalentes d’un point de vue sémantico-référentiel, créant ainsiune nomination complexe, partagée, n’abordant pas le référent comme UN, déjàconstruit mais construit par et dans le texte 28. Dans l’exemple de la page 94, ledétenu est d’abord nommé par le syntagme « cet homme pourri », puis par lesgroupes nominaux définis « le déchet », « le rebut », « la vermine ». Cettenomination multiple est le signe que ce référent ne va plus de soi, ne peut qu’êtreapproché par approximations successives. Le détenu subit ainsi, à travers cesformes, un processus d’altération, de fragmentation de son identité, qui
LANGAGE ET IDENTITÉ 157
27. C. Rosset, Loin de moi. Étude sur l’identité, Éditions de Minuit, 1999, p. 23-24.28. S. Bikialo, Plusieurs mots pour une chose. De la nomination multiple au style de Claude Simon (Thèse de
doctorat, Université de Poitier,s 2003) ou un résumé dans l’Info grammaticale, n° 2004.
12-Bikialo 9/11/06 16:13 Page 157
correspond à la manière dont il est traité et envisagé par les Allemands. Onpourrait multiplier, à l’échelle du texte, les nominations intervenant dans cecadre 29, et notamment les comparaisons ou métaphores animales :
même si l’on devient des rats, un convoi de rats (p. 29),
Nous avons écouté comme des bœufs (p. 37),
nous sommes comme des oiseaux morts (p. 257),
on ressemble à des épaves […]. Ils rôdent autour des petits tas couchés, des nids à poux […]Notre tas est une caverne aux parois grouillantes qui pourrait s’effriter, disparaître en poudresous le soleil (p. 288),
un morceau de bois avec des loques mauves qui flottent autour. Un épouvantail. (p. 152) 30
Par le rapprochement discursif d’entités distinctes, la nomination multiplefavorise la création de ce référent à mi-chemin entre l’homme et l’animal qu’estle détenu.
Si ressemblant aux bêtes, toute bête nous est devenue somptueuse ; si semblables à toute plantepourrissante, le destin de cette plante nous paraît aussi luxueux […]. Nous sommes au pointde ressembler à tout ce qui ne se bat que pour manger et meurt de ne pas manger, au point denous niveler sur une autre espèce. (p. 228)
Ce nivellement est précisément celui recherché par les SS, et il passe parl’abolition des différences physiques :
On se transforme. La figure et le corps vont à la dérive, les beaux et les laids se confondent.Dans trois mois, nous serons encore différents, nous nous distinguerons encore moins les unsdes autres. Et cependant chacun continuera à entretenir l’idée de sa singularité, vaguement.(p. 92)
Dans les camps ou par l’écriture, l’opposition au système nazi passe par unerevendication identitaire, une lutte contre ce nivellement dont le fait d’êtrenommé est un signe et qui implique de « ne pas se laisser recouvrir parl’anonymat » (p. 93) :
j’ai donc été désigné ici directement, on s’est adressé à moi seul, on m’a sollicité spécialement,moi, irremplaçable ! (p. 27),
158 Stéphane BIKIALO
29. Voir notamment p. 28, 39, 101, 120, 232. Les termes qui reviennent le plus souvent sont ceux de « ver-mine » (p. 84, 104, 118) et de « peste » (p. 80, 183), métaphores hygiéniques.
30. M. Duras nomme « Robert L. » à son retour « la forme » (op. cit., p. 70).
12-Bikialo 9/11/06 16:13 Page 158
Le même principe d’identité que le SS voulait établir hier en me demandant de répondre« oui » à mon nom, je ne cesserai pas de tenter de le reconstruire pour m’assurer que c’est bienmoi qui suis là. (p. 39)
Même si dans certains cas, il faut savoir se fondre dans la masse, profiter decet anonymat : « j’ai enlevé mes lunettes pour ne pas me faire repérer […]. Il fautêtre lisse, terne, déjà inerte » (p. 241).
Cette revendication existentielle est marquée au plus près du texte par lesformes fréquentes de dislocation du pronom personnel sujet qui intervient ainside manière redoublée : « nous avons, nous aussi, notre calendrier » (p. 77) ; « nousaussi, nous pouvons voir cela » (p. 232) 31. La dislocation se traduit par ledétachement du pronom marqué par la virgule, qui permet d’accentuer le« nous », marque de subjectivité par excellence, accentuation d’autant plus netteici qu’il y a reprise intégrale du signifiant. L’accent mis sur ce « nous » est aussiune manière de l’opposer au « ils » des SS, 3e personne caractérisé parE. Benveniste de « non-personne », en ce qu’elle est exclue de la relationinterlocutive. Il y a là une manière indirecte de rappeler que l’écriture, lamémoire, le langage seront du côté des survivants détenus, que la négation dontils sont l’objet n’est qu’un moment historique, ponctuel, qui ne peut perdurer.Alain Parrau a bien rappelé que la parole est du côté des détenus, que les SS quiavaient d’abord cherché à « maquiller » (p. 33), « déguiser » (p. 55) ont étéensuite réduits au silence. D’où l’importance de ce « nous » comme trace : « maprésence dans ce matin laisse des traces indiscutables et transmissibles » (233). Lareconnaissance d’une identité se fait par la mise en avant des différences, desspécificités de chacun :
Les SS qui nous confondent ne peuvent pas nous amener à nous confondre. Ils ne peuvent pasnous empêcher de choisir. […] L’homme des camps n’est pas l’abolition de ces différences. Ilest au contraire leur réalisation effective. (p. 93)
C’est dire le caractère paradoxal de cet ouvrage et de l’expérience qu’iltransmet, paradoxe dont rendent compte les non-coïncidences examinées dans ledétail du texte aussi bien au niveau du langage que de l’identité. Le détenu doiten effet à la fois lutter contre cette altération de lui-même que tentent de lui fairesubir les SS, revendiquer l’unité de son être et de sa langue, et en même tempsrevendiquer cette non-coïncidence, non seulement pour s’opposer aux SS, nepas être comme eux, mais aussi pour affirmer sa différence.
LANGAGE ET IDENTITÉ 159
31. Voir aussi p. 15, 17, 19, 22, 69, 112, 118, 262…
12-Bikialo 9/11/06 16:13 Page 159
Ces paradoxes ont été commentés par Maurice Blanchot au niveau du rapportà autrui, dans les pages consacrées à L’Espèce humaine de L’Entretien infini 32: « ilfaut qu’au dehors de ce moi que j’ai cessé d’être se restaure, dans la communautéanonyme, l’instance d’un Moi-Sujet, et non plus comme pouvoir dominateur etoppresseur dressé contre « autrui », mais comme ce qui peut accueillir l’inconnuet l’étranger » 33. Cette restauration du moi par le biais d’autrui exprime la vanitédu projet SS, car « Il y a entre eux et nous une relation que rien ne peut détruire[…] Vous êtes nous-mêmes ! » (p. 246).
D’où les paradoxes affirmés dès l’avant-propos et rappelés au cours del’ouvrage :
La mise en question de la qualité d’homme provoque une revendication presque biologiqued’appartenance à l’espèce humaine. (p. 11)
en nous niant comme hommes, les SS avaient fait de nous des objets historiques (p. 80)
Plus on est contesté en tant qu’homme par le SS, plus on a de chances d’être confirmé commetel. (p. 101)
Comme nous l’avons souligné précédemment, la mise en avant de points denon-coïncidences souligne en effet par contraste la coïncidence, le UN du restedu discours. Ce qui est transposable au niveau de l’espèce humaine, commel’illustre la page 229.
C’est par autrui, qu’il s’agisse des Allemands ou des amis détenus, que le sujetpeut retrouver une intégrité. Comme le rappelle C. Rosset, « il ne saurait être demoi que de l’autre, dont l’étayage assure l’éclosion et la survie du moi » 34, ce quiest particulièrement sensible avec l’épisode de K, qui semble méconnaissable :
Cependant, quelques-uns le reconnaissaient encore. Cela n’était donc pas arrivé sans témoin.Ceux qui étaient couchés à côté de lui le reconnaissaient encore. Aucune chance de jamaisvraiment devenir personne pour tous. (p. 180)
Plus encore, (et ultime paradoxe), le sujet sort renforcé de cette expérienceconcentrationnaire : « Les perspectives de libération de l’humanité dans sonensemble passent par ici, par cette « déchéance » » (p. 101).
160 Stéphane BIKIALO
32. M. Blanchot, L’Entretien infini, Gallimard, 1969, p. 191-200.33. M. Blanchot, op. cit., p. 197.34. C. Rosset, op. cit., p. 48.
12-Bikialo 9/11/06 16:13 Page 160
Plus qu’une remise en cause de l’identité des détenus, ou afin d’arriver à cetteremise en cause, les SS cherchent à promouvoir une conception de la réalité quileur serait propre, et qui ne serait pas partagée par les détenus. Identité et réalitésont donc liées : « Parce que ce qui est, est ; ce que nous sommes, nous lesommes » (p. 71).
D’où la nécessité de formulations pléonasmiques qui soulignent l’opacité dela réalité et du mot qui la désigne :
un wagon qui est un wagon, un cheval qui est cheval, les nuages qui viennent de l’ouest,toutes les choses que le SS ne peut pas contester sont royales […]. Ce n’est pas parce que lesSS ont décidé que nous n’étions pas des hommes que les arbres se sont désséchés et qu’ils sontmorts. (p. 50)
Ces non-coïncidences illustrent par surcroît la difficulté à rendre compted’une expérience « inimaginable », « indicible ». Aussi R. Antelme affirme-t-ildans son avant-propos :
À peine commencions-nous à raconter, que nous suffoquions. À nous-mêmes, ce que nousavions à dire commençait alors à nous paraître inimaginable. Cette disproportion entrel’expérience vécue et le récit qu’il était possible d’en faire ne fit que se confirmer par la suite.Nous avions bien à faire à l’une de ces réalités qui font dire qu’elles dépassent l’imagination.(p. 9)
Mais ce terme « d’inimaginable » sera repris à la fin de l’œuvre et qualifié de« mot du vide » (p. 302). La nécessité de la parole, de l’écriture se heurte en effetà cette contradiction souvent commentée. C’est dans ce cadre qu’interviennentles non-coïncidences du dire, et la nomination multiple en particulier. Direquand même, dire sans dénier la part d’inimaginable de cette expérience vécue,c’est faire la part dans l’écriture à la non-coïncidence : « nous ne sommes pas dansun wagon, mais dans une caisse » (p. 28), « Aux chiottes – un espace entouré dequatre planches hautes… » (p. 73), « une sauce liquide qui tenait lieu de soupe »(p. 159). Ce qu’on appelle habituellement « wagon » 35, « chiottes », « soupe » sontdonnés comme inaptes à rendre compte de la réalité, d’où ces formulationscomplexes, partagées.
Le réel en général est foncièrement irreprésentable. C’est en prenant acte decette impossibilité qu’une nouvelle littérature est née – ou s’est développée car l’onpeut en trouver des traces dans les siècles antérieurs – au XXe siècle. Claude Simonreprésente de manière particulièrement pertinente et affichée ce courant littéraire.
LANGAGE ET IDENTITÉ 161
35. Ce n’est qu’à la fin que le wagon « redevient “wagon de chemin de fer” » (p. 287).
12-Bikialo 9/11/06 16:13 Page 161
L’ACACIA DE CLAUDE SIMON
Autant L’Espèce humaine, en raison de son caractère autobiographique,permettait un traitement indistinct du sujet de l’écriture et du personnageprincipal, autant l’analyse de L’Acacia se doit de dissocier ces deux instances.C’est pourquoi nous aborderons d’une part le statut des personnages et d’autrepart le sujet de l’énonciation à travers des formes de non-coïncidencesessentiellement des mots avec les choses ou les êtres. Ce type de non-coïncidencessature en effet l’œuvre de C. Simon et L’Acacia en particulier, au point qu’il nousapparaît être à la base de toute étude du style de cet ouvrage. Nous nousconcentrerons enfin sur les personnages directement aux prises avec la guerre, àsavoir la période de 1939-1940 : L’Acacia se présente en effet comme une série dechapitres tous placés sous l’égide d’une ou de plusieurs dates – ce qui n’empêchepas des brouillages temporels signifiés dès l’épigraphe 36.
Dissolution du personnage dans l’histoireL’écriture de C. Simon se caractérise par une rareté des noms propres,
« désignateurs rigides » selon Kripke, servant à identifier avec précision lespersonnages. La nomination s’effectue au moyen de « désignateurs non rigides »,« contingents » pour reprendre les notions proposées par F. Corblin 37. La saisiedes personnages s’opère donc sur le mode de signalements contingentsmultiformes, saisissant le personnage à partir de propriétés descriptiveséphémères :
Pour les cavaliers exténués qu’il dépassait en remontant la colonne, mornes, sales (pas laglorieuse et légendaire boue des tranchées : simplement sales : comme peuvent l’être deshommes qui n’ont pas eu le temps ni de se déshabiller ni de se laver depuis six jours, […]),clignant de sommeil dans la lumière du matin, tassés sur leurs selles comme des paquets, avecleurs dos voûtés, presque bossus, leurs casques barbouillés de boue […], leurs joues saleshérissées d’une barbe de six jours, leurs yeux comme sales aussi, poussiéreux. (p. 29-30)
S’ouvrant par un syntagme nominal défini pluriel, l’extrait offre une série decaractérisations de ces cavaliers, qui ne sont donc approchés que par despropriétés descriptives et contingentes. Ces cavaliers n’étant pas apparus depuis
162 Stéphane BIKIALO
36. « Time present and time past36. Are both perhaps present in time future,36. And time future contained in time past » (T.S. Éliot, Four quartets)37. F. Corblin, « Les désignateurs dans les romans », Poétique, 1983, n° 54.
12-Bikialo 9/11/06 16:13 Page 162
l’ouverture du roman, c’est donc une construction de la référence qui se donneà lire à travers ces caractérisations. Mais cette référenciation s’effectue sur le modede la non-coïncidence des mots avec les choses. L’adjectif « sales » en effet est notécomme opaque de par sa réutilisation à l’issue d’une reformulation négative « pas[…] simplement », et son application distributive aux différentes parties du corps(« leurs joues sales », « leurs yeux comme sales »). La négation prend une valeurpolémique, renvoyant à un stéréotype de la guerre ou de la littérature de guerre.Le « simplement sales » note donc le refus d’une écriture épique, avec ses hérosguerriers. L’expérience de la guerre telle que l’envisage C. Simon se veut détachéedes modèles empiriques et culturels, pour en restituer le caractère brut.J. Kaempfer a bien opposé le récit de guerre classique où « règne une écritureimpériale » avec ses « héros altiers », et le récit de guerre moderne, qui « s’intéresseaux sans-grades […] dont il adopte le point de vue partiel et non-héroïque » 38.On retrouve là une revendication de R. Antelme précisant : « nous étions lesdétenus les plus pauvres, la dernière classe de détenus » (p. 17). G. Perec acommenté ce « refus du gigantesque et de l’apocalyptique […] qui gouvernel’organisation de son récit jusque dans ses moindres détails, et lui donne sacoloration spécifique : une simplicité, une quotidienneté jusqu’alors inconnue, etqui va jusqu’à trahir la « réalité » afin de l’exprimer d’une manière plusefficace » 39.
Décrits plus qu’identifiés, les personnages vont dans la suite de ce chapitre êtreévoqués par des syntagmes nominaux définis toujours assez généraux :« l’escadron, la colonne des vivants, se doublait d’une seconde colonne… »(p. 32), par des métonymies ou des comparaisons : « les bustes continuantdocilement à osciller d’avant en arrière sur les selles, les têtes renversées tournantd’un même mouvement » (p. 31), « assourdis, et restant encore ainsi, pareils à desstatues de sel » (p. 33), ou encore par des pronoms : « les chevaux qui, commeeux (les cavaliers), n’avaient pratiquement rien mangé » (p. 32), « ce qu’ils (lescavaliers) étaient en train de vivre » (p. 40).
Cette dernière forme de nomination multiple est particulièrementintéressante. La parenthèse sert en effet rarement à expliciter une référencevirtuellement ambiguë. Il s’agit donc bien d’une manière d’exhiber la non-coïncidence des mots et des choses et la nécessité d’une nomination plurielle, endeux temps, pour accéder aux personnages, ou plutôt à ce qu’il en reste.
LANGAGE ET IDENTITÉ 163
38. J. Kaempfer, Poétique du récit de guerre, Corti, 1998, p. 12-13.39. G. Perec, op. cit., p. 178.
12-Bikialo 9/11/06 16:13 Page 163
C’est encore une fois le paradoxe de la nomination multiple et du récit d’uneexpérience-limite que nous retrouvons ici. Les formes de non-coïncidenceremettent en cause le UN des personnages, leur identité, et en même temps lesdotent d’une abondance de propriétés qui leur donne une consistance indéniable.Cela est d’autant plus net lors d’assimilations de ces personnages à des stéréotypesou à des mythes. Ainsi ce cavalier qui passe dans
un froissement d’air fouetté emportant avec lui un cliquetis d’aciers, futile et joyeux, commesi cavalier et cheval ne formaient qu’une seule et même créature mythique faite d’une matièresemblable à du métal, pourvue d’ailes invisibles aux plumes de métal (et non pas foulant la terremais se déplaçant légèrement au-dessus, la frappant ou plutôt l’effleurant à peine […], passant(c’est-à-dire pas lui : l’espèce de nuage invisible au sein duquel il était porté) presque à lestoucher. (p. 31)
Ce personnage, renommé plus loin « l’homme-cheval » (p. 35), semble nonseulement se fondre avec son cheval mais baigner dans une sorte d’irréalité,parfaitement marquée par les reformulations en « non pas… mais », « ou plutôt »,et « c’est-à-dire ». Ces reformulations indiquent une non-coïncidence des motset des choses, exprimant la difficulté à rendre compte de ce statut décalé dupersonnage. Celui-ci est comme dissous dans un « nuage invisible », ce quisouligne sa posture de gradé. Pour filer la métaphore, l’on pourrait dire que cecavalier plane dans les hautes sphères, et est totalement inadapté à la situation.
Par ces nominations multiples, ces comparaisons constantes des personnagesavec des animaux, apparaît bien le fait que selon C. Simon, « Je est d’autres.D’autres choses, d’autres odeurs, d’autres sons, d’autres personnages, d’autreslieux, d’autres temps » 40.
Les personnages de C. Simon s’avèrent toujours en mutation ; ils seconstruisent et se dissolvent dans un même mouvement qui est celui de l’écriture.On retrouve de nouveau un des paradoxes illustré chez R. Antelme d’uneconstitution de l’identité par les autres, par l’écriture et dans la négation de cetteidentité par les autres. Aussi peut-on lire dans L’Acacia :
[…] et cela (la mutation) en passant par une succession de phases au cours desquelles ilsauraient d’abord soudainement grandi, atteint à toute vitesse le stade de la puberté […], puisd’hommes faits (l’unique jour où ils avaient pu se battre), puis (par un de ces troublants jeuxde la langue dont on ne sait si celle-ci se moule sur ce qu’elle dit ou l’inverse) défaits, dans tousles sens du terme, c’est-à-dire non seulement parce qu’ils appartenaient (mais appartenaient-
164 Stéphane BIKIALO
40. C. Simon, La Corde raide, édition du Sagittaire, 1947, p. 175.
12-Bikialo 9/11/06 16:13 Page 164
ils encore à quelque chose, ou plutôt y avait-il encore quelque chose à quoi ils puissentappartenir ?) à une armée vaincue […] (p. 45)
La non-transparence du dire dans cet extrait est explicitée par descommentaires métalinguistiques, et met donc en relation l’écriture et laconstruction des personnages. Mais c’est aussi leur rapport à la réalité qui estévoqué à la fin par le verbe « appartenir » dont les reformulations récursivessoulignent le caractère inadapté à la situation.
L’écriture témoigne en effet d’un processus de construction du personnage quise dissout dans l’Histoire « avec sa grande H », selon l’heureuse formule deG. Perec, et ne coïncide plus avec le monde, la réalité :
comme si s’était détachée d’eux la dernière section de la chaîne (ou plutôt du cordon ombilical)qui les raccordait à leur vie passée, et il leur semblait maintenant être là depuis des heures,condamnés […] à fondre et à se dissoudre lentement […] (p. 240)
C’était l’Histoire qui était en train de les dévorer, d’engloutir tout vivants et pêle-mêle chevauxet cavaliers, sans compter les harnachements, les selles, les armes (p. 242)
Dans une réalité qui ne va plus de soi, le personnage simonien se trouve clivé,partagé jusqu’à la dissolution. Toutefois, on peut noter avec B. Andrès que « lesujet simonien résiste à la dissolution qui le menace » 41, non pas comme lecritique le fait en rattachant le personnage de C. Simon à « Claude Simonpersonnage », ce qui nous semble un avatar plus fin mais persistant des approchesbiographiques, mais en ce que le personnage est ainsi mieux à même de rendrecompte d’une expérience extrême et se trouve ainsi, par la non-coïncidence, enphase avec la réalité vécue. D’autre part, si le personnage se dissout, c’est pourmieux faire entendre la présence de l’énonciateur ayant en charge le récit.
Émergence du sujet de l’énonciation dans le texteDu fait de leur statut méta-énonciatif, les non-coïncidences du dire exhibent
la présence du sujet d’énonciation. À rebours d’une littérature désincarnée,objective, termes par lesquels on a souvent qualifié le « Nouveau Roman » et unegrande partie de la littérature de la seconde moitié du XXe siècle, l’écriture deC. Simon pourrait être commentée à l’aide de ce titre de Jean Cayrol, On vousparle. Les formes de non-coïncidence ont ainsi cette double fonction de mimesisd’un monde et d’une langue qui ne vont plus de soi, et d’une mise en avant de
LANGAGE ET IDENTITÉ 165
41. B. Andrès, Profils du personnage chez Claude Simon, Édition de Minuit, coll. « Critique », 1992, p. 272.
12-Bikialo 9/11/06 16:13 Page 165
la textualité, du processus scriptural 42. Les non-coïncidences du dire, essentiel-lement des mots avec les choses dans le cas de C. Simon exhibent en effet d’unepart l’absence de transparence de la relation au monde et à la langue despersonnages et du sujet de l’écriture, ce qu’emblématise l’image de
cette pellicule visqueuse et tiède qu’il avait essayer d’enlever de son visage en l’aspergeant d’eaufroide [et qui], s’était aussitôt reformée, plus imperméable encore, le séparant du mondeextérieur, de l’épaisseur d’une vitre, (p. 283)
ainsi que cette phrase à valeur méta-énonciative :
de sorte que plus tard, quand il essaya de raconter ces choses, il se rendit compte qu’il avaitfabriqué au lieu de l’informe, de l’invertébré, une relation d’événements telle qu’un espritnormal (c’est-à-dire celui de quelqu’un qui a dormi dans un lit, s’est levé, lavé, habillé, nourri)pouvait la constituer après coup, à froid, conformément à un usage établi de sons et de signesconvenus, c’est-à-dire suscitant des images à peu près nettes, ordonnées, distinctes les unes desautres, tandis qu’à la vérité cela n’avait ni formes définies, ni noms, ni adjectifs, ni sujets, nicompléments, ni ponctuation (en tout cas pas de points), ni exacte temporalité, ni sens, niconsistance. (p. 286)
Cette phrase, à travers des formes de non-coïncidence – de nominationmultiple ou de reformulation – exhibe la difficulté à rendre cette expérienceextrême de la guerre à partir du langage, difficulté déjà évoquée dans l’avant-propos de L’Espèce humaine.
Claude Simon et Robert Antelme nous apparaissent ainsi représentatifs d’uncourant d’écriture parcourant le XXe siècle qui met en scène la non-coïncidencedu dire afin non plus de la subir mais de l’exploiter. Il s’agit d’écrivains quiprennent acte du fait que la réalité et la langue ne vont plus de soi, sont traverséspar du non-un. C’est pourquoi, en écho aux « comment dire ? » (p. 180),« comment s’appellent ? » (p. 176) présents dans L’Acacia, l’on trouve dansl’ouvrage de R. Antelme des expressions comme « cela on l’a reconstitué plustard » (p. 219), ou
Je ne sais donc pas mieux ce que je vois encore que ce que j’ai cessé de voir. Mais c’est sûrementla pression de ce qui n’apparaît plus qui fait surgir, éclatants et possédés de vie, ces quelquesmorceaux de jour et de noir. (p. 275)
166 Stéphane BIKIALO
42. Nous nous appuyons là sur les belles analyses de C. Rannoux (L’Écriture du labyrinthe. Claude Simon, « LaRoute des Flandres », Paradigme, 1997).
12-Bikialo 9/11/06 16:13 Page 166
Dans ces deux récits se lit un processus d’écriture fondé sur la mémoire, surune conscience intérieure aux prises avec la langue et la réalité. R. Antelmerappelle que « Si la mémoire n’existait pas, il n’y aurait pas de camps deconcentration ».
La mémoire et l’écriture sont les conditions et les moyens d’une préservationdu sujet, comme le note C. Rosset, selon lequel sans la mémoire « l’unité du moise disperserait et se désagrégerait en sensations isolées et indépendantes les unesdes autres » 43.
Au-delà des différences stylistiques sensibles entre ces deux auteurs, la mêmeconscience et la même inscription dans le texte d’une absence de transparence dela réalité et du dire, de ses non-coïncidences, permet donc de les réunir.
G. Perec avait pensé intituler son article sur l’auteur de L’Espèce humaine« Robert Antelme ou la naissance de la littérature », article qu’il achève par cesmots : « la littérature commence ainsi, lorsque commence, par le langage, dans lelangage, cette transformation pas du tout évidente et pas du tout immédiate, quipermet à un individu de prendre conscience, en exprimant le monde, ens’adressant aux autres » 44. C’est pourquoi ce que nous avons esquissé à partir deC. Simon mériterait d’être développé, et généralisé à un ensemble d’écrivains duXXe siècle, qu’il s’agisse de Beckett, Sarraute, Céline, Perec, et en amont Proust,Joyce… autant d’auteurs qui inscrivent à des degrés et selon des modes différentsde la non-coïncidence dans leur dire. Comme le rappelait C. Simon,
Ce qui s’est passé après la dernière guerre est lié à Auschwitz. Il me semble qu’on l’oubliesouvent quand on parle du « nouveau roman ». Ce n’est pas pour rien que Nathalie Sarrautea écrit L’Ère du soupçon ; Barthes, Le Degré zéro de l’écriture. Que des artistes comme Tapiès ouDubuffet sont partis des graffitis, du mur, ou que Louise Nevelson a fait des sculptures à partirde décombres. Toutes les idéologies s’étaient disqualifiées. L’humanisme, c’était fini 45.
LANGAGE ET IDENTITÉ 167
43. C. Rosset, op. cit., p. 26.44. G. Perec, op. cit., p. 190. M. Ruszniewski-Dahan (Romanciers de la Shoah. Si l’écho de leur voix faiblit…,
L’Harmattan, 1999) va dans le même sens lorsqu’elle évoque « l’écriture asymptotique » (p. 43) qui relie-rait le récit juif et l’évolution du roman français dans les années 60.
45. C. Simon, « Et à quoi bon inventer ? Entretien avec M. Alphant », op. cit.
12-Bikialo 9/11/06 16:13 Page 167