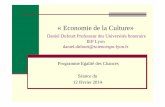« Gens de caste » ou « Personnes-Blanches » ? Esquisse du statut de l’étranger natif du pays dogon
La vision de Pierre à Joppé (Ac 10,9-16). Esquisse d’une histoire d’un commentaire dans...
-
Upload
ideo-cairo -
Category
Documents
-
view
2 -
download
0
Transcript of La vision de Pierre à Joppé (Ac 10,9-16). Esquisse d’une histoire d’un commentaire dans...
527LA VISION DE PIERRE À JOPPÉ (AC 10,9-16)RB. 2009 - T. 116-4 (pp. 527-556).
LA VISION DE PIERRE À JOPPÉ (AC 10,9-16)ESQUISSE D'HISTOIRE D'UN COMMENTAIRE
DANS L'OCCIDENT LATIN
PAR
Fr. Adrien CANDIARD o.p.
Couvent Saint-Thomas-d'Aquin7, avenue Salomon
F-59800 LILLE
SOMMAIRE
Le livre des Actes est, dans l'Occident patristique et médiéval, bien connumais très peu commenté. La présente étude s'intéresse à cette réceptionparadoxale en suivant les commentaires d'une péricope, la vision de Pierre àJoppé (Ac 10,9-16). Sous une apparente inertie du corpus des commentaires, ondistingue quelques évolutions très nettes∞∞: une lecture progressivement moralede l'épisode, qui néglige l'accueil des païens dans l'Église∞∞; une note de spiri-tualité monastique qui domine au moyen âge, avant qu'une interprétation detype missionnaire ne réapparaisse au XIIIe siècle.
SUMMARY
The Book of Acts was well known in the West in the patristic and medievalperiods, but very seldom commentated on. This study looks at this strangereception, by way of the commentaries on one passage, Peter’s Vision at Joppe(Ac 10: 9-16). Under the apparent inertia of the commentaries, we can discoversome clear developments: a progressively moralistic view of the passage,which disregarded the welcome of pagans into the Church; a monastic spiritu-ality which is predominant during the Middle Ages, until a missionary interpre-tation recurs in the 13th century.
2453-09_03_Candiard 06-15-2009, 14:12527
528 ADRIEN CANDIARD
1 Cette recherche a été entreprise dans le cadre de notre mémoire de Master 2, sousla direction de M. Gilbert Dahan, soutenu le 24 septembre 2008 à l’École pratique desHautes Études (Paris), intitulé Les commentaires du livre des Actes des apôtres dansl’Occident latin des Pères à Hugues de Saint-Cher.
2 Instructionum ad Salonium libri duo. CSSEL 31 (1894), K. Wotke éd. CCSL 66,C. Mandolfo éd.
3 Sermo 148 PL 38, col. 799-800 (Ac 5, 1-12) Sermo 149 PL 38, col. 800-807 (Ac10) Sermo 150PL 38, col. 807-814 (Ac 17,18).
4 Sermo 176 (Ac. 10, 9-15) CCSL 104, pp. 712-716.5 Complexiones Actuum Apostolorum. PL 70, col. 1381-1406.6 De Actibus apostolorum (Historia apostolica). CSEL 72, McKinlay éd., 1951.
CCSL 130-130A, A. P. Orban éd., 2006.
La réception du livre des Actes des apôtres en Occident latin1 réserveun paradoxe surprenant∞∞: considéré comme un des livres les plus impor-tants du Nouveau Testament, il est également le moins commenté.
La place du livre dans le corpus des Écritures chrétiennes semblen’avoir jamais fait difficulté∞∞: on ne connaît pas de canon biblique quioublie de le citer, et les Pères s’y réfèrent explicitement dès le IIe siècle.Le livre fait l’objet de citations nombreuses tout au long de la périodepatristique. Au moyen âge, il reste une source importante des règlesmonastiques et des correspondances spirituelles. De plus, l’expressionde vita apostolica est le cri de ralliement, le modèle proclamé de toutesles réformes∞∞: il ne s’agit pas seulement de la fondation des Ordres men-diants au XIIIe siècle, qui ont donné au mouvement une ampleur inéga-lée∞∞; déjà, les clercs célibataires de la Réforme grégorienne comme leslaïcs des confréries, les chanoines réguliers comme les moines blancs deCîteaux, tous ont cherché à mener la vie des Apôtres, tous ont créé duneuf pour revenir à l’idéal primitif.
Pourtant, les Actes sont l’un des livres bibliques les moins commen-tés, tant par les Pères que par les médiévaux. Nous ne disposons pasd’un seul véritable commentaire patristique complet∞∞: quelques ques-tions d’Eucher de Lyon2, trois sermons d’Augustin3, parfois repris parCésaire d’Arles4, quelques autres sermons festifs, un résumé de Cassio-dore5 et un commentaire en vers d’Arator6∞∞; quant aux grands commen-taires grecs (Origène, Chrysostome), ils ne sont pas traduits en latin. Onne peut donc pas dire que les commentateurs médiévaux ploient sous lefardeau de l’héritage patristique, bien qu’il convienne de nuancer∞∞: lesPères ont commenté telle citation, tel épisode, mais en général dans unautre contexte, souvent argumentatif. Il faut attendre le haut moyenâge pour que cette matière éparse se cristallise en deux véritables com-mentaires, qui ne se connaissent pas∞∞: d’une part, les commentaires
2453-09_03_Candiard 06-15-2009, 14:12528
529LA VISION DE PIERRE À JOPPÉ (AC 10,9-16)
(Expositio et Retractatio plus tardive) de Bède le Vénérable7∞∞; d’autrepart, un commentaire curieux du IXe siècle, rapporté par deux manus-crits et attribué unanimement à Raban Maur, bien qu’il ne puisse vrai-semblablement pas être de lui8. Nourris de citations patristiques, surtoutle texte de Bède, ces deux commentaires synthétisent et innoventcomme on ne le fera plus au cours du moyen âge∞∞; ils fourniront l’essen-tiel de la matière de notre exposé. En effet, après deux bons sièclesde silence, la Glose ordinaire9, probablement compilée au début duXIIe siècle, s’abreuvera presque exclusivement à ces deux sources,qu’elle se contente en général de juxtaposer, et c’est sur la Glose ordi-naire que les maîtres parisiens du XIIe siècle (Pierre le Chantre10,Etienne Langton11, le Pierre de Poitiers de l’Historia apostolica12) fon-deront, sans aucune originalité, leurs commentaires des Actes. Au débutdu XIIIe siècle, Hugues de Saint-Cher13, commentateur de toute la Bible,reste très largement influencé par la Glose∞∞; beaucoup de commenta-teurs immédiatement postérieurs ne se détacheront pas de Hugues. Ilconvient toutefois d’excepter un commentaire peu connu, œuvre dudominicain sicilien Thomas de Lentini14.
La rareté des commentaires est d’abord une question∞∞; mais ellereprésente également une chance pour le chercheur. Plus que pour aucun
7 M. L. W. LAISTNER, Bedae Venerabilis Expositio Actuum apostolorum et Retrac-tatio, Cambridge (Mass.) 1939 (editio critica ex 15 codicibus)∞∞: Kraus reprint, NewYork, 1970. L’édition Laistner est reproduite dans CCSL 121.
8 Nous désignerons ici l’auteur de ce commentaire comme le pseudo-Raban Maur.Une édition de ce commentaire fondamental est en cours. Les deux manuscrits qui lerapportent sont Ms. Cambridge, Univ. Ee III 51 (XIII, script. per fratrem JohannemLambert Carmelitam), f. 198-238∞∞; Ms. Oxford, Balliol College 167 (XII, GuilelmusGray), f. 143-174.
9 Ed. de Strasbourg, Adolph Rusch, 1480-81, reproduite dans Biblia latina cumglossa ordinaria [Karlfried Froehlich and Margaret T. Gibson, éd.], Turnhout, Brepols,1992 [in IVe volume].
10 Le commentaire n’est pas publié. Nous l’avons lu dans le ms. Paris, Mazarine 176f. 243-255.
11 Inédit également, il est par exemple lisible dans le ms. Paris, nat. lat. 14526f. 174v°-180.
12 Historia Actuum Apostolorum (Historia ecclesiastica), PL CXCVIII, col. 1645-1722. Il s’agit de la suite du principal manuel médiéval d’histoire sainte, l’Historiascolastica de Pierre le Mangeur. La critique récente a montré que les passages couvrantles Actes sont probablement l’œuvre de Pierre de Poitiers, continuateur du Mangeur(voir le travail de Ph. MOORE, The work of Peter of Poitiers Master in Theology andChancellor of Paris (1193-1205), coll. Publications in Medieaeval Studies, Notre-Dame,Indiana, 1936).
13 La Postille de Hugues a fait l’objet de très nombreuses éditions imprimées. Nousl’avons lue dans une édition de Venise, 1600.
14 Inédit lui aussi, il n’est rapporté que par le seul ms. Paris, Nat. lat. 14.379, II (f. 1-107).
2453-09_03_Candiard 06-15-2009, 14:12529
530 ADRIEN CANDIARD
autre livre, elle permet de saisir, presque d’un seul regard, la totalité dela production exégétique qui nous est parvenue sur un livre biblique enOccident. Il est possible de tout lire∞∞; il devient donc envisageable d’étu-dier avec précision, et de manière exhaustive, les influences, les copieset les évolutions, les écoles et les oppositions. Menée à bien, une étudecomplète peut se révéler précieuse pour notre connaissance de l’histoirede l’exégèse patristique et médiévale. Mais une histoire complète del’exégèse des Actes des apôtres ne peut se fonder que sur l’étude descommentaires de péricopes précises∞∞: c’est bien dans la comparaisonprécise des textes, dans les influences successives, dans le suivi exactdes sources et de leur réélaboration, que nous pouvons dépasser leslignes générales pour esquisser une généalogie rigoureuse.
Nous avons choisi de porter notre attention sur la vision de Pierreà Joppé, racontée dans les versets 9 à 16 du chapitre 10 des Actes desapôtres15. Cet épisode est bien caractérisé, mais relativement court∞∞; rap-portant une vision, il compte un grand nombre de détails dont les com-mentateurs peuvent donner des interprétations ponctuelles, qui serontdes indices précieux pour suivre précisément les influences des uns surles autres.
D’autres raisons que cette simple commodité ont guidé notre choix,qui sont davantage théologiques. D’une part, la péricope est à plus d’untitre centrale dans l’économie des Actes∞∞: par sa place, elle est à la char-nière entre les deux grands cycles du livre, le cycle de l’Église de Judéedominé par la figure de Pierre, et le cycle des voyages de Paul. Alorsque, dans le premier, les Gentils ne sont admis dans l’Église qu’à titreexceptionnel et individuel (l’eunuque éthiopien converti par Philippe),le second montrera l’extraordinaire expansion missionnaire de l’Églisedans le monde païen∞∞; pour passer de l’un à l’autre, pour faire ce pas dumonde juif à la gentilité qui est le sujet principal du livre des Actes, ilfaut la double autorité d’une révélation divine et du prince des apôtres.
15 Pour mémoire, rappelons le texte de la péricope dans la Vulgate. Nous citons laversion Weber, que nous avons ponctuée pour faciliter la lecture∞∞; les variantes serontnombreuses, mais rarement significatives, chez les commentateurs que nous étudierons.Postera autem die, iter illis facientibus et adpropinquantibus civitati, ascendit Petrus insuperiora ut oraret circa horam sextam et cum esuriret voluit gustare. Parantibus autemeis, cecidit super eum mentis excessus et videt caelum apertum et descendens vasquoddam, velut linteum magnum quattuor initiis submitti de caelo in terram, in quoerant omnia quadrupedia et serpentia terrae et volatilia caeli. Et facta est vox ad eum∞∞:«∞∞Surge, Petre, et occide et manduca.∞∞» Ait autem Petrus∞∞: «∞∞Absit, Domine, quianumquam manducavi omne commune et inmundum.∞∞» Et vox iterum secundo ad eum∞∞:«∞∞Quae Deus purificavit ne tu commune dixeris.∞∞» Hoc autem factum est per ter, etstatim receptum est vas in caelum.
2453-09_03_Candiard 06-15-2009, 14:12530
531LA VISION DE PIERRE À JOPPÉ (AC 10,9-16)
D’autre part, la place importante qu’elle occupe dans la constructionlittéraire du livre des Actes n’empêche pas que son importance pourle lecteur dépend avant tout du contexte du lecteur lui-même. Or cecontexte est extrêmement différent d’une époque à l’autre∞∞: quelle quesoit l’interprétation précise que l’on donne de la péricope, qu’on accepteune lecture plus littérale (les interdits alimentaires juifs ne valent pluspour les chrétiens) ou une lecture plus allégorique et vaste (les Gentilssont appelés à faire eux aussi partie de l’Église), ces thématiques étaientimportantes à l’époque de la rédaction du livre∞∞: il s’agit pour Luc delégitimer l’accueil des païens dans l’Église, quitte à accepter une ruptureavec le monde juif traditionnel. À l’époque patristique, certains débats– en sens inverse cette fois – avec des courants remettant en cause lacontinuité du christianisme et de la Première Alliance vont donner unenouvelle vigueur à ces thèmes, sans empêcher toutefois qu’ils perdentde leur actualité. Quant aux lecteurs médiévaux de la péricope, ils ne sesentent guère plus concernés par ces questions∞∞: le rapport de l’Églisechrétienne au monde juif est stable, et ne fait plus guère l’objet de dé-bats, du moins comparables à ceux des premiers siècles. La rupture avecle judaïsme est une évidence∞∞: personne ne réclame le retour aux inter-dits alimentaires ni ne remet en question le baptême des païens. Et laréception, comme un héritage pleinement chrétien, par le biais d’unelecture spirituelle, de l’Ancien Testament est une autre évidence quepersonne ne discute plus. Que doit alors faire l’exégète∞∞? répéter lesaffirmations des Pères sans les trier, quitte à ne répondre à aucune ques-tion∞∞? ou réélaborer des réponses qui, sous l’apparence de la continuité,vont tenir compte des problèmes intellectuels et spirituels qui leur sontcontemporains∞∞?
1. Les commentaires antérieurs à Augustin
Les commentaires grecs
On a signalé la plus grande abondance de commentaires grecs desActes. Les exégèses de la vision de Pierre sont, naturellement, plusnombreuses encore, et les analyser toutes n’entre pas dans notre pro-pos∞∞; leur influence sera très limitée sur la tradition latine. Dégageonstoutefois quelques traits significatifs16.
16 Nous nous appuyons sur la recension établie et commentée par l’exégète suisseFrançois BOVON dans sa thèse de doctorat publiée, De Vocatione Gentium. Histoire del’interprétation d’Act. 10,1-11.18 dans les six premiers siècles, Tübingen, J. C. B. Mohr,1967, pp. 92-194.
2453-09_03_Candiard 06-15-2009, 14:12531
532 ADRIEN CANDIARD
François Bovon distingue dans le monde grec deux grandes lignesd’interprétation, qui ne sont d’ailleurs pas exclusives puisque certainsauteurs, comme Origène, les tiendront simultanément. Avant de repren-dre les termes commodes de sa typologie, signalons pour éviter leseffets d’optique qu’ils ne correspondent pas nécessairement à des choixherméneutiques différents∞∞: la plupart des commentaires de la péricopeque François Bovon a rassemblés sont issus, non de commentaires sui-vis à proprement parler, mais d’écrits de circonstance où la vision dePierre vient servir d’exemple ou d’argument. Rien ne dit que tel auteur,qui tient une ligne d’interprétation dans tel ou tel contexte précis depolémique ou d’enseignement, n’en aurait pas tenu une autre dans descirconstances d’expression différentes.
La première de ces lignes, que nous qualifierons de rituelle, interprètela vision de Joppé comme la fin des interdits alimentaires posés par laLoi, et plus largement des prescriptions légalistes. C’est une interpréta-tion des plus littérales∞∞: la vision concerne la nourriture, il s’agit donc denourriture. C’est l’analyse que l’on retrouve chez un auteur aussi ancienque Clément d’Alexandrie (fin du IIe siècle)17, dans sa version la plusrestrictive∞∞: témoin de débats de l’Église primitive, il défend la thèse dela liberté alimentaire, au nom de l’indifférence, sans du reste en tirer dethéorie plus générale sur le rapport des chrétiens à la Loi juive. C’est cesens littéral que, dans un contexte cette fois nettement polémique18,reprendra Cyrille d’Alexandrie19 pour justifier l’abandon, déjà parfaite-ment accompli à son époque, des observances alimentaires juives∞∞; pourdéfendre le sens littéral de la vision, et se fondant sur ce sens littéral,Cyrille développe qu’il convient de donner à la Loi un sens allégorique∞∞:les interdits alimentaires n’étaient absurdes que littéralement, mais doi-vent être entendus spirituellement. On notera que les deux auteurs dontnous venons de mentionner l’appui à la thèse «∞∞littéraliste∞∞» sont desauteurs de la tradition alexandrine, réputée vigoureusement «∞∞allégoriste∞∞».Cette version littérale aura, comme nous le verrons, peu de succès chezles Pères et auteurs de langue latine.
Mais plusieurs Pères grecs, à l’inverse, interprètent la vision de Pierrecomme une allégorie, ou plus exactement une parabole présentée par
17 Dans le Paedagogus, lib. I, cap. 2. Le commentaire d’Actes 10 se trouve dans PG8, col. 405-408.
18 Le patriarche répond longuement aux critiques de l’empereur Julien, formuléesdans l’Adversus Christianos, qui reprochait aux chrétiens de préférer la vision de Pierreà la Loi de Moïse.
19 Pro sancta christianorum religione, adversus libros athei Iuliani IX (PG 76, col.984-992)
2453-09_03_Candiard 06-15-2009, 14:12532
533LA VISION DE PIERRE À JOPPÉ (AC 10,9-16)
Dieu à Pierre∞∞: les animaux purs ou impurs qu’il aperçoit représententtous les hommes, Juifs ou Grecs, tous appelés au même salut. Cetteinterprétation s’appuie sur le texte même des Actes (Ac 10,28), et seratenue par Cyrille de Jérusalem20 ou Épiphane21. Ce dernier, dans lePanarion 30, où il combat le végétarisme des Ebionites, écarte mêmeexplicitement une interprétation alimentaire de cette péricope, interpré-tation qui pourrait le servir (elle montrerait qu’il est permis de se nourrirde viande) mais dont il tient malgré tout à démontrer l’inanité. Maisc’est essentiellement en Occident que cette interprétation sera déve-loppée.
Origène, quant à lui, tient à la fois les deux lignes d’interprétation∞∞: lavision indique à la fois la fin des interdits alimentaires et l’appel desGentils au salut∞∞; il lui arrive même de ne pas sembler distinguer lesdeux sens22∞∞: exégèses littérale et allégorique se complètent harmonieu-sement. On comprend que la plupart des Pères grecs n’aient pas eu àchercher plus loin que dans les écrits d’Origène pour soutenir l’une oul’autre ligne23, ou pour tenir comme lui les deux lignes en même temps,comme le fera à son tour Jean Chrysostome24. Mais les trois principauxpassages25 où Origène se réfère à la scène montrent que ce qui l’y inté-resse davantage, c’est qu’elle s’ajoute à son dossier de justification de lalecture allégorique de la Loi∞∞: Pierre a su (Ac 10,28) appliquer aux hom-mes ce qu’il a vu des animaux, et devient ainsi, avec l’apôtre Paul dontil cite maintes fois les passages sur l’interprétation de la Loi, un maîtreen lecture allégorique. L’influence d’Origène, plus que de tout autrePère grec, sur les commentaires occidentaux sera grande∞∞: ses homéliessur le Lévitique seront connues, lues et imitées dans le monde latingrâce à la traduction de Rufin26.
20 Catéchèse baptismale 17, PG 33 (col. 997-100).21 Panarion 28 et 30 (PG 41, col. 377-381 et 405-473).22 PG 14, col. 1253∞∞: «∞∞Ubi ergo omnes gentes per agnitionem fidei a contaminatione
mundatur, ibi et omnis cibus verbo Domini et oratione purgatur.∞∞»23 F. Bovon, p. 103.24 Dans ses homélies sur les Actes, il donne une interprétation de tendance plutôt lit-
térale, mais poursuit par une lecture allégorique∞∞: «∞∞La nappe est un symbole de toute laterre∞∞», «∞∞les animaux qui sont dedans, ce sont les Gentils∞∞; ‘Tue et mange’, cela signifiequ’il faut se rendre chez les Gentils. Que cela se produise trois fois désigne le bap-tême.∞∞» Mais la véritable originalité de Jean est à chercher dans l’interprétation qu’ildonne de la psychologie de Pierre∞∞: il était déjà, bien avant Joppé, convaincu de l’inanitédes interdits alimentaires et de l’ouverture aux païens, mais il lui fallait l’autorité decette vision pour convaincre l’Église de Jérusalem, plus conservatrice.
25 De oratione 27,12∞∞; Homélies sur le Lévitique 7,4∞∞; Commentaire de la lettre auxRomains 5,1 et 10,3.
26 ORIGENES secundum translationem quam fecit Rufinus, In Leuiticum homiliae, CB29 (W.A. Baehrens, 1920), p. 280-507.
2453-09_03_Candiard 06-15-2009, 14:12533
534 ADRIEN CANDIARD
Les premières interprétations latines
Notons d’abord, chez quelques commentateurs latins, la forte in-fluence des Pères grecs. C’est le cas de Cassien27 et de Jérôme28, tousdeux tenants de la double signification de la vision, qu’ils héritent trèsprobablement d’Origène. Pour François Bovon, l’influence grecque estencore plus nette chez des auteurs, qu’il qualifie d’ «∞∞exceptions lati-nes∞∞», qui ne se réfèrent au texte que dans un contexte alimentaire oulégaliste, pour en donner une lecture littérale, comme Pierre Chrysolo-gue dans un sermon29 ou Eucher de Lyon. Parmi les six questions que cedernier pose sur les Actes, l’une est en effet relative à notre passage∞∞:
«∞∞Pourquoi appelait-on nourriture commune une nourriture que l’on pensaitimpure∞∞? Parce que c’était aller visiblement contre l’interdit de Dieu, encommun avec tous les autres hommes, qui ne se soumettaient pas dans lechoix de leurs nourritures à l’observance de la Loi, observance par laquelleles juifs se glorifiaient d’être du côté de Dieu. Cette nourriture a été purifiéepar Dieu, quand il a dit à Pierre∞∞: Ce que Dieu a purifié, toi, ne l’appelle pas‘commun’.∞∞»30
Mais cette question peut bien être posée directement, sans présuppo-ser une nécessaire influence patristique orientale∞∞: l’emploi péjoratif dumot communis, attesté dans la Bible avant la Vulgate, n’était pas fré-quent dans la langue latine, et semble avoir toujours surpris les lecteursde l’époque patristique31. Eucher ne s’en fait probablement que l’écho.Jérôme, dans son Commentaire de Matthieu, reprendra pour la mêmeexplication les termes mêmes d’Eucher, avant de les développer defaçon plus originale32.
Mais ces interprétations latines ne sont pas les plus anciennes. Laplus ancienne exégèse de la vision qui nous soit parvenue, bien qu’origi-
27 Il se réfère à la vision dans ses Institutions cénobitiques III, 3, 4 (CSEL 17,pp. 35-36).
28 Jérôme utilise en particulier la vision de Pierre dans son commentaire de la lettreaux Galates, I. 2, 7-9 (PL 26, col. 361).
29 Sermon 163, De terrenorum cura descipienda, PL 52, col. 628.30 CCSL 66, p. 179. «∞∞Quare prius communis cibus vocabatur, qui putaretur
immundus∞∞? Quod contra interdictum tunc Dei in commune caeteris pateret hominibus,qui in ciborum discretione legis obseruantiam non tenebant, per quam Iudaei partem Deise esse jactabant. Purificatus est autem etiam Domino dicente ad Petrum∞∞: Quae Deuspurificavit, ne tu commune dixeris.∞∞»
31 Quelques références sur cet étonnement dans F. BOVON, p. 116, n. 1. Il faut ajouterJérôme à la liste patristique qu’il propose.
32 CCSL 77, pp. 128-129∞∞: «∞∞Populus iudaeorum partem dei se esse iactitans com-munes cibos uocat quibus omnes utuntur homines, uerbi gratia suillam carnem ostreaslepores et istiusmodi animantia quae ungulam non findunt nec ruminant nec squamosain piscibus sunt. Vnde et in Actibus apostolorum scriptum est∞∞: Quod Deus sanctificavittu ne commune dixeris.∞∞»
2453-09_03_Candiard 06-15-2009, 14:12534
535LA VISION DE PIERRE À JOPPÉ (AC 10,9-16)
nellement écrite en grec, doit être comptée avec les Latins qui la connu-rent davantage, et semblent s’en être inspirés sur le fond∞∞: c’est celle queprésente Irénée dans son troisième livre Contre les hérétiques33, quiprend résolument parti pour une lecture allégorique du passage.
Pierre voyait une révélation, dans laquelle la voix céleste lui dit∞∞: ‘Ce queDieu a purifié, toi ne le déclare pas commun’, ce qui signifie que le Dieu quiavait distingué par la Loi entre le pur et l’impur a purifié les nations par lesang de son Fils.
Il faut voir dans cette vision une image de la réalité de l’économiechrétienne, de l’œuvre de salut apporté par le Christ. Là encore, le con-texte argumentatif d’Irénée n’est pas sans influence∞∞: il entend démon-trer, contre les gnostiques, que le Dieu de la Loi est bien le même que leDieu de Jésus-Christ, que l’Ancien et le Nouveau Testament témoignentde la même promesse. Dans ces conditions, on comprend qu’il n’insisteguère sur l’épisode comme fin des prescriptions alimentaires, qui ris-querait de donner argument à ses adversaires, mais se concentre surcette rupture moins nette, l’ouverture au païen, où l’élément de rupturejoue dans son sens∞∞: si Pierre hésite à baptiser Corneille, soulignera-t-ilun peu plus bas34, c’est bien parce qu’il est convaincu de continuer àservir le Dieu des Juifs, et non un Dieu différent.
Peu après lui, Tertullien reprendra dans une brève mention cette lec-ture allégorique et universaliste35 de l’épisode, dans un contexte qui luisouffle un détail dont la postérité sera grande∞∞: écrivant sur la prière, iltrouve dans ce passage une preuve scripturaire du caractère apostoliquede la prière de sexte. Cela lui permet de fonder la prière des «∞∞petitesheures∞∞» sur des exemples apostoliques (tierce se fondant sur la Pente-côte, et none sur la montée de Pierre et Jean au temple de Jérusalem),inaugurant une tradition différente de l’Orient (qui veut y rappeler lesdifférents moments de la passion de Jésus), une tradition qu’on retrouvechez Cyprien36 ou chez Jérôme37, et dont l’influence est encore sensibleaujourd’hui dans la liturgie romaine des heures38.
33 IRÉNÉE, Adversus haereses, III, 12, 7, SC 34, p. 224.34 IRÉNÉE, op. cit., III, 12, 15 (SC 34, p. 250).35 TERTULLIEN, De oratione, XXV, 3 (CCSL 1, p. 272)∞∞: «∞∞Petrus, qua die uisionem
communitatis omnis in illo uasculo expertus est, sexta hora orandi gratia ascenderat insuperiora.∞∞» Le passage est néanmoins difficile, du fait de l’ambiguïté du termecommunitas, dont on ne sait s’il renvoie à l’universalité du salut ou à l’impureté des ali-ments. Jeu de mots ou distraction de Tertullien∞∞?
36 CYPRIEN, De dominica oratione, 34 (CSEL 3).37 JÉROME, Commentaire sur Daniel II, 6, 10 (CCSL 75 A, p. 832).38 Voir en particulier l’oraison de l’office du milieu du jour du mardi de la 2e se-
maine∞∞: «∞∞Dieu qui as révélé à l’Apôtre Pierre ta volonté de sauver tous les hommes,
2453-09_03_Candiard 06-15-2009, 14:12535
536 ADRIEN CANDIARD
Trois exégèses latines antérieures à Augustin complèteront ce tourd’horizon des premières interprétations de la vision de Pierre à Joppé.Celle d’Hilaire intervient pour ainsi dire en passant, au détour des der-nières pages de son commentaire sur Matthieu39, où le linceul du Christlui rappelle cet autre linge que Pierre aperçoit en vision∞∞:
«∞∞Ici il enveloppe le corps dans un suaire. Et dans cette même étoffe, nousretrouvons tous les genres des divers animaux descendus du ciel vers Pierre.Ce n’est sans doute pas trop solliciter le texte que comprendre que sous lenom de cette étoffe, c’est l’Église qui a été mise au tombeau avec le Christ.Car alors en lui, comme dans le mélange de l’Église, la diversité des ani-maux purs et impurs a été avalée.∞∞»40
Hilaire paraît être le premier auteur, du moins dans le monde latin, àproposer une troisième lecture du sens de la vision∞∞: non plus celle, litté-rale, de la fin des prescriptions rituelles, ni celle, allégorique, du salutdes païens, mais désormais, développant l’allégorie hors du contexte lit-téral, la vision renvoie à la situation de l’Église, qui compte en son sein,non des Juifs et des Grecs, mais des purs et des impurs, des bons et desmauvais. Il est aisé de voir dans ce déplacement une adaptation à lasituation d’Hilaire∞∞: la relation des Juifs et des chrétiens venus du paga-nisme n’est guère centrale dans la vie des Églises de Gaule de la pre-mière moitié du IIIe siècle, tandis que la coexistence au sein de l’Églisede chrétiens d’élite et de chrétiens tièdes, de martyrs et de lapsi, se poseavec la plus grande acuité. Il est probable que cette situation pousseHilaire à moraliser davantage cette péricope, quitte à s’éloigner résolu-ment du sens voulu par Luc.
Ambroise, sur plus d’un point, dépendra de Hilaire41∞∞: dans son com-mentaire de l’évangile de Luc, il reprendra ce rapprochement du linceulet de la nappe, pour en tirer un enseignement un peu différent∞∞: il revientà l’interprétation classique des animaux comme figure des nations
accorde-nous de déployer toutes nos énergies au service de ce dessein de ton amour.∞∞»(Livre des heures. Prière du temps présent, Paris, A.E.L.F., 1993, p. 780.)
39 HILAIRE DE POITIERS, Commentarius in Matthaeum, XXXIII, 8 (PL 9, col. 1075-1076). On s’étonne que F. Bovon, qui connaît ce texte, ne relève pas sa profonde origi-nalité.
40 «∞∞Hic munda sindone corpus involvit. Et quidem in hoc eodem linteo reperimusde coelo ad petrum universorum animantium genera summissa. Ex quo forte non super-flue intelligitur, sub lintei hujus nomine consepeliri Christo ecclesiam∞∞: quia tum in eo,ut in confusione ecclesiae, mundorum atque immundorum animalium fuerit congestadiversitas.∞∞»
41 Sur cette influence, voir G. TISSOT, «∞∞Introduction∞∞» à AMBROISE DE MILAN, Traitésur l’évangile de S. Luc I, Paris, Cerf, 1956 (SC 45), p. 16.
2453-09_03_Candiard 06-15-2009, 14:12536
537LA VISION DE PIERRE À JOPPÉ (AC 10,9-16)
païennes, sans reprendre l’interprétation morale de son devancier42.Mais la plus longue interprétation que donne de la péricope l’évêque deMilan se trouve dans son De Spiritu sancto43, où il utilise le passagepour appuyer des thèses sur l’égalité des personnes divines dans laTrinité. C’est le rôle central de l’Esprit qui l’intéresse donc avant tout, etqui commande l’essentiel de ses développements∞∞: la suite du récit mon-trera que c’était déjà l’Esprit qui avait donné la vision∞∞; et c’est le mêmeEsprit qui en révèlera le sens en se répandant sur les païens. Il ajouteune double interprétation de la triple répétition de la vision∞∞: elle luiparaît exprimer le mystère de la Trinité∞∞; il la rapproche également de latriple confession de foi baptismale, une idée qu’il emprunte probable-ment à Origène44.
Maxime de Turin, contemporain d’Augustin, ne connaît sans doutepas l’œuvre de ce dernier, mais il est comme lui influencé assez généra-lement par Ambroise. Cette influence n’est guère sensible dans le ser-mon45 qu’il consacre à notre péricope. Contrairement aux deux exégèsesprécédentes, celle que présente Maxime n’est pas fortuite, prise commeargument ou illustration d’autre chose∞∞: il s’agit bien d’abord, pour leprédicateur, d’expliquer la vision à ses auditeurs. Pour autant, ce com-mentaire est loin d’être complet∞∞: le récit est tronqué, passant soussilence le refus de Pierre et la fin de la vision∞∞; et le prédicateur, qui pa-raît préférer expliquer les détails plutôt que l’économie du texte, passed’un élément à un autre sans ordonnancement très net. Fidèle à la tradi-tion, Maxime voit dans cette vision l’image de la vocation des Gentils∞∞;le récipient figure pour lui l’Église, dont il précise toutefois qu’elle estpure et sans tâche, pareille à une nappe de lin. Plus originale est son in-terprétation de la faim de Pierre∞∞: on ne peut, dit-il, l’entendre au senslittéral, car Pierre – qui est un ascète – est en prière, et ne peut donc êtresensible à la faim∞∞; il faut donc y voir une faim spirituelle.
42 CCSL 14, p. 385∞∞: «∞∞Bonum linteum misit Ioseph ille uir iustus, et fortasse illudquod Petrus uidit e caelo ad se esse demissum, in quo reant genera quadrupedum etferarum et uolucrum ad similitudinem gentium figurata. Mystico igitur uguento illopistico consepelitur ecclesia, quae diuersitatem populorum fidei suae conmunionesociauit.∞∞»
43 AMBROISE, De Spiritu sancto, lib. II, cap. X, 103-106 (PL 16, col. 796-797). Dansce passage, Ambroise entend montrer qu’il n’y a dans la Trinité qu’une seule volonté,vocation et jussion.
44 ORIGENES, Homiliae in Leviticum 7,4 (PG 12, col. 485)∞∞: «∞∞Quae enim mundavit,non sub una appellatione mundantur, neque sub secunda, sed nisi et tertia appellationominetur, nemo mundatur.∞∞»
45 Sermon 2, CCSL 23, pp. 6-8.
2453-09_03_Candiard 06-15-2009, 14:12537
538 ADRIEN CANDIARD
«∞∞Mais, à mon avis, Pierre, après sa prière, n’avait pas faim de la nourrituredes hommes, mais de leur salut∞∞; il n’était pas gêné par le jeûne de soncorps, mais se souciait de l’indigence des croyants.∞∞»46
Pierre a faim du salut des Juifs, et n’est guère rassasié car ces derniersn’accueillent pas sa prédication. Dieu va donc le rassasier par cette vi-sion∞∞: il pourra nourrir son désir en gagnant à Dieu non les seuls Juifs,mais également les païens. Et le premier fruit de cette promesse de ras-sasiement, c’est l’ «∞∞immolation∞∞» de Corneille. Maxime utilise en effetune version assez littérale, différente de la Vulgate mais aussi desVeilles latines plus fréquentes47, qui met dans la bouche de Dieu l’or-dre∞∞: «∞∞Immola et manduca∞∞!∞∞», pointant l’aspect sacrificiel de l’épisodeprésent dans le texte grec original.
Les premières exégèses latines de la péricope que nous avons rencon-trées sont incomplètes, souvent au service d’autres argumentations, rare-ment brillantes∞∞; elles témoignent d’un consensus sur l’interprétationgénérale, et d’une grande diversité dans le détail. Elles s’accordent pres-que toutes sur le sens global à donner à la vision, qu’elles interprètentcomme une allégorie du salut des païens, mais quand il s’agit d’expli-quer précisément tel ou tel symbole, la créativité est grande∞∞: chaqueauteur n’explique que les détails qu’il veut, et souvent de manière per-sonnelle∞∞; nous n’avons pu relever que deux traditions qui présupposentnettement qu’un auteur ait lu ses prédécesseurs∞∞: celle qu’inaugure Ter-tullien sur la sexte, et l’influence d’Hilaire sur Ambroise dans l’imagedu linceul.
2. L’exégèse augustinienne
a. Augustin
La vision de Pierre à Joppé, «∞∞passage cher à Augustin∞∞» d’aprèsYves Congar48, n’occupe pas le premier rang des passages cités et com-mentés par l’évêque d’Hippone49, mais ce dernier s’y réfère malgré tout
46 “∞∞Sed puto Petrum post orationem non cibum esurisse hominum sed salutem∞∞; necinedia uexatum esse corporis, sed inopia credentium laborasse.∞∞”
47 À notre connaissance, seul CHROMACE D’AQUILÉE (Sermon 3, CCSL 9A, p. 616-617) connaît le même texte que Maxime de Turin. La Vulgate dira Occide et manduca,suivant la traduction la plus couramment attestée auparavant (Ambroise, Jérôme,Cassien et parfois Augustin). Toutefois, Augustin emploie le plus souvent une troisièmeversion, Macta et manduca, que l’on retrouve chez beaucoup d’auteurs qui dépendentdirectement de l’évêque d’Hippone (Césaire d’Arles, Cassiodore, Arator, Grégoire…).
48 Bib. Aug. 28 Bruges, 1963, p. 586, n. 1.49 H.-I. MARROU, Saint Augustin et l’augustinisme, Paris, 1959, donne quelques indi-
2453-09_03_Candiard 06-15-2009, 14:12538
539LA VISION DE PIERRE À JOPPÉ (AC 10,9-16)
un nombre de fois significatif∞∞: environ trente-cinq occurrences, répar-ties dans des œuvres assez différentes – sermons, discours sur les psau-mes, traités polémiques, commentaire de la Genèse50… Les différencesde contexte expliquent qu’il ne s’intéresse pas toujours au même pointdu texte, privilégiant tantôt l’extase, tantôt le contenu de la vision∞∞; maisces différentes occurrences, dans différents contextes, n’impliquent pasdes exégèses différentes∞∞: on constate au contraire une grande unitéd’interprétation, qui correspond toujours à l’explication la plus complèteet la plus longue que donne Augustin de la péricope, dans son sermon14951.
Au cours de ce sermon, prononcé probablement le samedi aprèsPâques, Augustin entend répondre à plusieurs questions scripturaires, etcommence par expliquer de manière assez complète la vision de Pierre,à laquelle la moitié de ce long sermon est consacrée. Soulevés quelquesjours plus tôt au cours d’un sermon, quelques problèmes d’interprétationde l’Écriture n’avaient pas été résolus, en dépit des promesses répétéesd’Augustin52. La question initiale ou, pour mieux dire, l’accroche du ser-mon justifiant l’interprétation de la vision est une critique qu’Augustinprête à quelque adversaire vraisemblablement imaginaire∞∞: Dieu de-mande-t-il à Pierre de pécher en l’encourageant à la gloutonnerie∞∞? Laréponse sera naturellement négative, et Augustin ne s’attarde guère surcette question peu pertinente.
Son explication de la vision, particulièrement complète, progresse endeux temps distincts. Il commence par une explication plutôt littérale,qui lui donne l’occasion d’expliquer l’étonnement de Pierre devantl’ordre de Dieu, et donc de rappeler les interdits alimentaires de la Loijuive∞∞; mais, dès cette étape, Augustin rappelle les fondements de la lec-ture allégorique du Premier Testament∞∞:
cations chiffrées (pp. 84-86) des passages les plus cités par Augustin, qui permettent dese faire une idée, sans prétendre à l’exhaustivité. Les trente-cinq occurrences d’Ac 10,9-16 le placent très loin d’une dizaine de passages (essentiellement de l’évangile de Jean,de la Genèse, des lettres aux Romains et aux Corinthiens ou de l’évangile de Matthieu)cités plusieurs centaines de fois.
50 Les références les plus significatives, sur lesquelles nous garderons malgré tout unœil car telle ou telle formule reviendra chez les auteurs postérieurs, sont Enarrationes inpsalmos, Ps. 30, en. 2, s. 2, PL 36, col. 242∞∞; Ps. 73, par. 16, PL 36, col. 938∞∞; Sermo266,6, PL 38 col. 1228.
51 PL 38, col. 800-807. L’explication de la vision de Pierre occupe les col. 800-803.52 C’est peut-être à ces questions que font référence les dernières lignes du sermon
259 dans l’édition des Mauristes (PL 38, col. 1196). Migne l’affirme dans une note (quiparle fautivement du sermon 269), col. 800, mais rien ne permet de l’affirmer avec cer-titude.
2453-09_03_Candiard 06-15-2009, 14:12539
540 ADRIEN CANDIARD
«∞∞Tous les animaux que les Juifs n’ont pas le droit de manger sont les signesdes choses, et comme on l’a dit, les ombres des réalités à venir.∞∞»53
Suit une explication morale des interdits alimentaires, où le sabotfendu signifie les bonnes mœurs et la rumination la méditation de la Loide Dieu. Les chrétiens, l’ayant compris par les paroles de l’apôtre, nesont donc plus tenus à ces interdits alimentaires pris au sens littéral,mais au respect d’un double commandement∞∞: la rectitude de la vie et larumination de l’Écriture. Cette lecture n’a rien d’original∞∞: elle se trouveen substance chez Origène, dans la septième homélie sur le Lévitique, etelle sera régulièrement reprise par les Pères. Mais là n’est pas la clef dela vision∞∞: ce n’est qu’un élément de contexte qu’Augustin se voit obligéde rappeler à ses auditeurs. Mais la vision doit être comprise comme uneallégorie, et non comme la levée d’interdits alimentaires qu’il juge évi-demment périmés.
Ce qui le prouve, avance Augustin, c’est la présence des serpentsdans le récipient. Dieu ordonnerait-il à Pierre de manger des serpents,alors que non seulement les Juifs s’y refusent, mais qu’aucun peuple dela terre ne s’y abaisserait∞∞? Evidemment non. Ce n’est donc pas de man-ger qu’il est ici question, mais d’intégrer à l’Église des peuples nou-veaux, issus de la gentilité. Le fond de cette interprétation n’a rien denouveau, surtout dans le monde latin où elle est la norme, mais Augus-tin présente des traits qui lui sont propres∞∞: d’une part, il insiste sur lafigure de Pierre, qui bien souvent représente toute l’Église∞∞; d’autre part,surtout, on est frappé par le réalisme de son expression. Pierre, qui estl’Église, doit s’assimiler les païens, et pour cela doit d’abord les tuer,c’est-à-dire tuer le péché qui fait d’eux des païens∞∞:
«∞∞Il fallait donc les tuer et les manger, c’est-à-dire pour que soit tuée en euxla vie passée, où ils ne connaissaient pas le Christ, et qu’ils s’agrègent à soncorps, comme à la vie nouvelle de la communauté de l’Église.∞∞»54
On remarque l’équilibre et l’exhaustivité de l’explication d’Augustin∞∞:tout en prenant partie sans ambigüité pour une ligne d’interprétation,l’interprétation allégorique et universaliste, il ne néglige pas de présen-ter les éléments de l’autre ligne, en en donnant il est vrai une lecturedéjà fortement morale. Par cette synthèse vaste et relativement originale,
53 «∞∞Omnia enim animalia quae iudaeis prohibita sunt manducare, signa sunt rerum,et sicut dictum est, umbrae futurorum.∞∞»
54 «∞∞Occidendi ergo erant et manducandi, id est, ut interficeretur in eis vitapraeterita, qua non noverant Christum∞∞; et transirent in corpus ejus, tanquam in novamvitam societatis Ecclesiae.∞∞»
2453-09_03_Candiard 06-15-2009, 14:12540
541LA VISION DE PIERRE À JOPPÉ (AC 10,9-16)
Augustin se prépare à fournir du matériau aux commentateurs ultérieurs,même si ces derniers n’ont connu le plus souvent ce sermon qu’à traversdes intermédiaires incomplets.
Augustin termine l’explication de la vision en ajoutant deux interpré-tations de détail. La première concerne l’utilisation du mot linteum, pro-pre d’ailleurs à la version latine de l’épisode, qui est signe pour lui depureté et d’incorruptibilité. La seconde porte sur la triple répétition de lavision∞∞: à une interprétation trinitaire rapidement esquissée, qui ressem-ble à celle d’Origène55, il ajoute diverses considérations sur les chiffrestrois, quatre et douze qui sont bien dans sa manière∞∞; en revanche, il nereprend pas à son compte la lecture résolument baptismale d’Ambroise.
b. La postérité d’Augustin
Nous avons déjà signalé que le sermon 149 d’Augustin, qui n’est cer-tes pas la seule occurrence de l’interprétation que l’évêque d’Hipponedonne de la vision mais demeure la plus complète, n’a que relativementpeu circulé, en particulier au moyen âge. Il sera pourtant très bienconnu, et même souvent textuellement cité. Ce paradoxe ne surprendplus si l’on étudie précisément la postérité immédiate du sermon∞∞: entrele Ve et le VIIe siècle, plusieurs auteurs vont se l’approprier, qui servi-ront d’intermédiaires pour les auteurs médiévaux∞∞: Arator ou Grégoirele Grand le seront pour la doctrine, mais Césaire d’Arles transmettrajusqu’aux mots mêmes d’Augustin.
Césaire d’Arles
Dans un sermon56 manifestement prêché en temps pascal, un jour oùla vision de Pierre était une lecture liturgique57, l’évêque d’Arles repre-nait littéralement le sermon 149 d’Augustin. Hormis la phrase d’intro-duction et un résumé final d’ailleurs sans originalité, il n’a pas un motdu sermon qui lui soit personnel.
Pour autant, cette reprise n’est pas pour nous sans enseignement, dansla mesure où Césaire ne reprend pas la totalité du sermon d’Augustin. Ilest en particulier significatif qu’il en ait retiré l’essentiel de la premièrepartie, centrée sur l’interprétation littérale du texte∞∞; Césaire n’en retient,précisément, que la fin, qui construit déjà une lecture allégorique de la
55 In Leviticum homeliae, 7, 4, p. 384∞∞: Nisi enim in patre et filio et Spiritu sanctofueris mundatus, mundus esse non poteris.
56 Le sermon 176 déjà mentionné (CCSL 104, p. 713).57 Les premiers mots du sermon le laissent penser∞∞: «∞∞Modo cum lectio Actuum
apostolorum legeretur, audiuimus quod beatus Petrus circa horam sextam…∞∞»
2453-09_03_Candiard 06-15-2009, 14:12541
542 ADRIEN CANDIARD
Loi juive. La lecture allégorique, que le sermon d’Augustin privilégiait,est ici la seule retenue.
Cette réélaboration n’est pas sans conséquences pour la suite∞∞: lesermon de Césaire, comme souvent, a circulé au moyen âge et jusqu’àl’édition des Mauristes sous le nom d’Augustin58. Il nous est par-venu par une collection de lettres d’Augustin59 et surtout d’homéliesd’Augustin60∞∞: cette dernière a connu un très grand succès, bien plus quela collection contenant le sermon 149 lui-même. Il y a fort à parier quec’est donc dans le sermon de Césaire que les auteurs médiévaux ont lu,sous une fausse attribution à Augustin, les mots même d’Augustin.
Il y a là davantage qu’une hypothèse pour un commentateur médiévaldes Actes, et non des moindres∞∞: Bède le Vénérable, à travers lequelbeaucoup liront à leur tour, ou croiront lire, Augustin. En effet, Bèdeutilise par exemple un passage du sermon 149, mais son texte diffèrelégèrement de celui d’Augustin. En effet, là où Bède écrit∞∞:
«∞∞La teigne n’attaque pas le lin (linteum), alors qu’elle détruit les autres tis-sus. Et c’est pourquoi celui qui veut entrer dans les mystères de l’Église ca-tholique doit exclure de son cœur la corruption des mauvaises pensées etainsi s’assurer incorruptiblement dans la foi∞∞: il ne sera pas attaqué intérieu-rement par des pensées impures comme par des teignes.∞∞»
on reconnaît sans peine les idées d’Augustin, mais ce dernier emploiedes formulations légèrement différentes61. Ce ne serait qu’un détail, oule résultat d’une copie maladroite, si la formulation de Bède ne se trou-vait textuellement, au mot près, dans le sermon de Césaire. Le texte adonc connu un étonnant voyage∞∞: écrit par Augustin, il est copié très lar-gement par Césaire, puis dans cette dernière version réattribué à Augus-tin, tandis que le véritable texte de ce dernier ne circule guère plus.
Arator
S’il est probable que le poète-exégète ait connu l’explicationd’Augustin et s’en soit pour partie inspiré, il apparaît cependant comme
58 Sur les collections auxquelles il a appartenu, voir CCSL 103, pp. lvi-lvii et lxxv-lxxxiv
59 Collectio Lemovicensis, par ms BnF lat. 2768 (Xe s.), fol. 110-145v.60 Collectio quinquaginta homeliarum sancti Augustini (reprise par les Mauristes
dans t. V), pour laquelle Morin cite pas moins de vingt-quatre manuscrits, dispersés dansl’Europe entière, allant du IXe au XIIIe s.
61 «∞∞Linteum tinea non consumit, quae uestes alias corrumpit. excludat unusquisquede corde suo corruptiones malarum concupiscentiarum, atque ita incorruptibiliterfirmetur in fide, ut prauis cogitationibus tanquam tineis non penetretur.∞∞» (PL 38, col.804).
2453-09_03_Candiard 06-15-2009, 14:12542
543LA VISION DE PIERRE À JOPPÉ (AC 10,9-16)
un commentateur assez original, qui n’hésite pas à interpréter minutieu-sement chaque détail de l’épisode dans le chapitre XXI, qu’il consacre àla vision62.
D’Augustin, il reprend le réalisme de l’expression, pour parler del’entrée dans l’Église par assimilation∞∞:
«∞∞On voit donc que le Maître/ Ordonne que les nations soient transvaséesdans les entrailles de l’Église.∞∞»63
Il insiste également, comme Augustin, sur la figure de Pierre commeimage de toute l’Église. C’est encore parmi les lieux communs del’augustinisme, mais non dans le sermon 149, qu’Arator va puiser l’inter-prétation de la «∞∞sixième heure∞∞» comme expression du sixième âge dumonde, celui du salut64∞∞; il y ajoute, de manière originale, une référence àla rencontre de Jésus et de la Samaritaine. De même, il n’hésitera pas àdévelopper considérablement la brève notation trinitaire reçue d’Augus-tin, et de l’essentiel de la tradition patristique, pour expliquer la triplerépétition de la vision∞∞: sous la plume du poète, cette affirmation de laTrinité devient polémique, et pourfend hardiment Ariens et Sabelliens.
Mais sur l’interprétation générale qu’il donne du passage, Arator sedémarque très fortement d’Augustin. En effet, si les animaux de lavision désignent bien le monde entier, le sous-diacre de Rome ne sem-ble laisser aucune place à la problématique du rapport du monde juif à lagentilité65. Au contraire, la diversité des animaux s’explique pour lui,comme avant lui pour Hilaire, comme un motif moral∞∞: l’Église s’ouvreà tous les hommes, bons ou mauvais.
«∞∞Retenant chaque espèce d’oiseau ou de bestiaux, de bêtes sauvagesEt de reptiles en même temps∞∞; ils correspondent aux mortelsEn fonction de leurs mérites et de leurs vices.∞∞»66
62 CCSL 130, pp. 290-293. De eo ubi beatus Petrus hora diei sexta, cum esuriret incenaculo, uas sibi cum omnium animalium generibus uidit ostendi. Vnde cum se negaretposse comedere, audiuit uocem, ne immunda aut communia diceret, quae Deusmundauit∞∞; et hoc ter est factum.
63 «∞∞Patet ergo, quod Auctor / Iussit in Ecclesiae transfundi uiscera gentes.∞∞»64 La question des six âges du monde, le sixième étant celui du salut, correspondant
aux six jours de la création, traverse la totalité de l’œuvre d’Augustin (par ex. dans le DeTrinitate, CCSL 50, IV, 4∞∞: Et sexta aetate generis humani filius dei uenit et factus estfilius hominis ut nos reformaret ad imaginem dei.)
65 On s’étonne que DEPROOST (p. 95) puisse commenter ainsi le passage∞∞: «∞∞Aratorreprend également l’interprétation de la vision telle que la proposait déjà saint Luc, dansle sens d’un élargissement des promesses du salut au monde païen.∞∞» Nous ne voyonsaucune mention spécifique du paganisme ni du judaïsme dans le texte.
66 «∞∞Omne genus retinens uolucrum pecudumque, ferarum / Reptiliumque simul∞∞;mortalibus ista cohaerent / Ex meritis uitiisque suis.∞∞»
2453-09_03_Candiard 06-15-2009, 14:12543
544 ADRIEN CANDIARD
Originale aussi est l’image du Calvaire qui vient terminer le chapitreen donnant le sens suprême de la vision∞∞: l’universalité de la Rédemp-tion offerte en Jésus-Christ.
Grégoire le Grand
Plus dépendante d’Augustin sera la version que Grégoire le Grandutilisera fréquemment, sans jamais donner toutefois de commentaire àproprement parler de la vision de Joppé. Mais l’exemple revient sous saplume une petite dizaine de fois, toujours chargé de la même significa-tion. Ainsi, c’est dans le contexte de la concurrence entre l’Église et laSynagogue que Grégoire rappelle la décision des apôtres, divinementinspirés, de passer aux païens∞∞:
«∞∞C’est pourquoi il fut dit au premier pasteur, presque par la bouche de cettelionne [dont il est question dans livre de Job, que Grégoire commente]∞∞: ‘Tueet mange’. Ce qui est tué est retranché de la vie, mais ce qui est mangé de-vient le corps de celui qui le mange. On dit donc ‘Tue et mange’, c’est-à-direextermine-les du péché où ils vivent et fais d’eux tes propres membres.∞∞» 67
L’interprétation reste celle, dominante en Occident, de l’intégrationdes Gentils dans l’Église. On voit que Grégoire n’hésite pas à marquerencore le réalisme de l’expression déjà présent chez Augustin, en insis-tant bien sur l’action d’avaler et d’incorporer. Cette image semble dureste l’avoir tout particulièrement marqué, au point qu’il l’évoque spon-tanément presque chaque fois que, dans son commentaire du livre deJob, il explique une page où il est question de dents∞∞; et dans ses éclair-cissements, une certaine truculence se fait parfois jour68.
67 Moralia in Iob, lib. XVIII, cap. xxxv, 56 (CCSL 143A, p. 923)∞∞: «∞∞Vnde et ipsiprimo pastori quasi huius leaenae ori dicitur∞∞: macta et manduca. Quod mactatur quippea uita occiditur, id uero quod comeditur, in comedentis corpore commutatur. Macta ergoet manduca dicitur, id est a peccato eos in quo uiuunt interfice et a seipsis in tua illosmembra conuerte.∞∞»
68 Par exemple Moralia, XI, xxxiii, 45 (CCSL 143A, p. 610)∞∞; XIV, l, 58 (idem,p. 733)∞∞; le plus bel exemple reste XIII, xii, 15 (idem, p. 677), que nous ne résistons pasau plaisir de citer∞∞: «∞∞Percusserunt maxillam meam, satiati sunt poenis meis. Maxillaquippe Ecclesiae sancti praedicatores sunt, sicut sub Iudaeae specie per Ieremiamdicitur∞∞: Plorans plorauit in nocte et lacrimae eius in maxillis eius∞∞; quia in aduersitateEcclesiae illi amplius plangunt qui uitam carnalium confringere praedicando nouerunt.Per ipsos quippe sancta Ecclesia iniquos a uitiis conterit et quasi glutiens in sua membraconuertit. Vnde ipsi quoque primo praedicatori uelut maxillae Ecclesiae dicitur∞∞: Occideet manduca. Hinc est etiam quod Samson maxilla asini tenuit et hostes peremit∞∞; quiaRedemptor noster simplicitatem atque patientiam praedicantium suae manu uirtutistenens, a uitiis suis carnales interfecit. Et maxilla in terram proiecta postmodum aquasfudit quia data morti praedicatorum corpora magna populis monstrauere miracula.Maxillam ergo Ecclesiae peruersi feriunt, cum bonos praedicatores insequuntur.∞∞»
2453-09_03_Candiard 06-15-2009, 14:12544
545LA VISION DE PIERRE À JOPPÉ (AC 10,9-16)
Cassiodore
Notre parcours patristique ne serait pas complet si nous ne mention-nions le commentaire déjà cité de Cassiodore, qui n’apporte toutefoisque peu de chose à notre propos. Si l’influence d’Augustin sur le séna-teur est nette dans ses copieux commentaires des psaumes, elle est bienmoins perceptible dans les Complexiones qui tiennent davantage, on l’adit, du résumé que de l’exposition. Qu’on ne juge par le passage qu’ilconsacre à la vision de Joppé, que nous pouvons citer intégralementsans craindre de traîner en longueur∞∞:
«∞∞Alors que Pierre se trouvait dans la maison dont il vient d’être questionvers la sixième heure du jour, il eut faim et voulut manger∞∞; alors il eut uneextase∞∞: il vit un récipient, comme une étoffe de lin blanc, où se trouvaienttous les animaux, serpents et volatiles, qu’on descendait du ciel. Et une voixlui dit∞∞: ‘Lève-toi, Pierre, tue et mange’, et peu après ‘Ce que Dieu a purifié,ne va pas, toi, le déclarer impur’. Cela s’est produit trois fois, puis le réci-pient est remonté aux cieux. Cela signifiait que les peuples du monde entierétaient destinés à croire au Christ Seigneur.∞∞»69
Seule la dernière phrase entend donner une explication, qui placeCassiodore dans la ligne dominante en Occident mais ne nous renseignepas davantage.
3. La vision de Pierre commentée au haut moyen âge
On a pu constater que le dossier patristique latin à la disposition despremiers commentateurs médiévaux était loin d’être négligeable∞∞: sansêtre abondant, il représente un nombre de matériaux disponibles bienplus sérieux que pour la plupart des passages des Actes. Ces matériaux,très divers dans le détail, sont toutefois largement identiques dans l’in-terprétation générale, et de plus dominés par la figure d’Augustin.
On a noté l’importance du haut moyen âge dans l’élaboration descommentaires médiévaux∞∞: deux commentateurs, Bède et le pseudo-Raban, feront l’essentiel d’un travail que les commentateurs ultérieursréutiliseront largement. Or leurs commentaires de la vision de Joppé
69 PL 70, col. 1388-1389∞∞: «∞∞Petro autem in supradicta domo posito circa horam dieisextam cum esuriret et gustare vellet, supra eum cecidit mentis excesus∞∞: viditque vas,velut candidum linteum, in quo erant omnia quadrupedia, et serpentia, et volatilia,summutti de caelo∞∞; et facta est vox ad eum∞∞: Surge, Petre, macta et manduca∞∞; paulopost∞∞: Quae purificavit Dominus, tu ne dixeris immunda∞∞: quod factum est tertio, et vasreceptum constat in caelos∞∞: significabat enim Domino Christo totius mundi gentes essecredituras.∞∞»
2453-09_03_Candiard 06-15-2009, 14:12545
546 ADRIEN CANDIARD
montrent particulièrement bien en quoi le travail de ces deux auteurs,dans la manière même de procéder, diffère considérablement.
a. Bède le Vénérable
Bède ne s’est jamais caché de faire œuvre de compilateur∞∞: c’est par-ticulièrement le cas dans la première des œuvres qu’il a consacrées auxActes, l’Expositio. L’apparat critique des commentaires consacrés àAc 10,9-16 dans l’édition de Laistner met déjà en lumière plusieurs em-prunts littéraux, essentiellement à Augustin (en fait, comme nousl’avons vu, à Césaire d’Arles), à Jérôme et à Ambroise, auteurs de textesque nous avons déjà rencontrés et auquel Bède exégète a constammentrecours. Mais une lecture plus attentive nous révèle d’autres emprunts.Le fond des commentaires sur Ac 10,9 est emprunté à Arator, mais misen prose∞∞: c’est chez ce poète qu’il trouve l’interprétation de la montéede Pierre à l’étage, ou les références au sixième âge du monde ou aupuits de la Samaritaine. De même, on retrouve des formules d’Augustintirées d’autres passages que le sermon 149, en particulier, sur «∞∞Occideet manduca∞∞», l’injonction∞∞:
«∞∞Tue dans les nations ce qu’elles étaient et fais-en ce que tu es.∞∞»70
Malgré cette mosaïque d’emprunts et d’inspirations, le commentairede Bède n’est pas sans originalité, dont la première réside paradoxale-ment dans les références bibliques dont son exégèse est issue∞∞: pasmoins d’une douzaine de citations bibliques s’introduisent dans le com-mentaire. Certes, les Pères expliquaient déjà la Bible par la Bible, et laméthode n’a rien de nouveau∞∞; mais ce qui l’est davantage, ce sont lestextes utilisés. Certains rapprochements avaient déjà été opérés par lesPères∞∞: la Samaritaine (Jn 4) ou la triple confession de Pierre (Jn 21)étaient déjà apparus sous la plume d’Arator et d’Ambroise, sans mêmementionner les textes nécessaires à la compréhension des interdits ali-mentaires de l’Ancienne Alliance. Mais Bède sait innover, et la plupartde ses citations sont originales∞∞: délaissant le rapprochement opéré parHilaire entre la toile de la vision et le suaire du Christ, il y voit plutôt latunique sans couture que jouent les soldats, une image d’ailleurs classi-que de l’Église∞∞; il est aussi le premier à utiliser l’Apocalypse dans sonexplication du passage.
70 «∞∞Occide in gentibus quod fuerant et fac quod es.∞∞» La formule est fréquente sousla plume d’Augustin∞∞: Enarrationes in psalmos, Ps. 30, en. 2, s. 2, PL 36, col. 242∞∞;Ps. 73, par. 16, PL 36, col. 938∞∞; Sermo 266,6, PL 38 col. 1228. Mais on ne la trouve pasdans le sermon 149, ni dans sa reprise par Césaire d’Arles∞∞: même pour Augustin, Bèdea croisé différentes sources.
2453-09_03_Candiard 06-15-2009, 14:12546
547LA VISION DE PIERRE À JOPPÉ (AC 10,9-16)
Mais deux groupes de citations bibliques nous semblent particulière-ment significatives, bien que relativement discrètes. Tout d’abord, dansle commentaire de Ac 10,12, les animaux qui apparaissent à Pierre luidonnent l’occasion d’une compilation, comme le moyen âge en serafriand, de passages bibliques où à l’homme sont accolées des figuresanimales. Ce sont toujours des images du péché, et leur convocationdonne au verset un sens moral évident que Bède n’explicite jamais.Ouvertement, il tient la ligne interprétative occidentale, augustinienne,d’une vision signifiant l’introduction des païens dans l’Église au mêmetitre que les juifs∞∞; dans les faits, il a recours à la même solution queHilaire, sans que rien permette d’affirmer qu’il l’ait connu∞∞: il moralisela vision, qui devient un encouragement pour l’Église à travailler à laconversion des pécheurs, à s’assimiler les pécheurs, à les transformer ensaints. Il établit ainsi une forme de synthèse, que nous qualifierons parcommodité de «∞∞pagano-morale∞∞».
Cette interprétation implicite vient être confirmée par un deuxièmegroupe de citations, qui interviennent pour commenter Ac 10,13, ‘Occideet manduca’∞∞: ces citations viennent de la lettre aux Galates, avec enparticulier le célèbre «∞∞Je vis, mais ce n’est pas moi qui vis, c’est leChrist qui vit en moi∞∞»∞∞: cette union mystique au Christ vécue par Pauldevient la clef de l’appel de Pierre à dévorer les animaux de la vision.Les commentateurs antérieurs, en particulier Grégoire, avaient déjà notéqu’en mangeant, Pierre, l’Église, s’assimilait les animaux, les païens,pour ne faire plus qu’un∞∞: cette unité de tous les peuples au sein d’unemême Église devient pour Bède, à la faveur de son recours à Paul,l’union de chaque homme au Christ, avec lequel il est appelé à s’assimi-ler, à ne faire qu’un. L’interprétation morale du verset précédent tend àdevenir, selon un mouvement naturel chez les commentateurs monasti-ques, une interprétation mystique.
Le détachement de Bède vis-à-vis de ses prédécesseurs est donc aussidiscret (une lecture superficielle laisserait l’apparence de la plus totalecontinuité) que, sur le fond, spectaculaire. Il répond évidemment à unchangement de contexte∞∞: la question du rapport juifs/gentils au sein del’Église, déjà moins brûlante dans l’Antiquité tardive, est devenue sansaucune actualité dans l’Angleterre du VIIIe siècle. Il correspond égale-ment à un changement d’intérêt de la part du lecteur, plus désireux detrouver dans le texte biblique le matériel d’une méditation mystique,d’un cheminement spirituel.
Sur la vision de Pierre, la Retractatio n’apportera guère de nouveautédécisive. Bède a pour son nouveau commentaire travaillé sur le texte
2453-09_03_Candiard 06-15-2009, 14:12547
548 ADRIEN CANDIARD
grec, et ajoute des notations tout à fait originales∞∞: après Maxime deTurin, et de façon plus explicite, il peut par exemple remarquer que leterme traduit généralement par Occide ou Macta, en grec qÕson, signi-fie avant tout «∞∞sacrifier∞∞»∞∞: l’érudition philologique se met alors au ser-vice de l’interprétation allégorique, puisqu’elle permet de rapprocher lavision du sacrifice du Christ.
On a déjà noté l’influence considérable des commentaires de Bèdesur l’ensemble de la production médiévale∞∞: nous aurons l’occasion dela constater dans ce cas précis. Bède joue un double rôle∞∞: il est un com-mentateur lu pour lui-même, mais il est aussi le relais de la tradition desPères, qu’il a compilés, qu’il transmet, mais aussi vis-à-vis desquels ilfait largement écran. Rares en effet sont ceux qui, par la suite, prendrontla peine d’aller lire directement les Pères, sans passer par Bède.
b. Le pseudo-Raban
On connaît le caractère aussi mystérieux que fondamental de ce com-mentaire des Actes, qui réserve de longs commentaires à la vision dePierre71. Il inaugure le genre littéraire de la glose, et commente dans lecas de notre péricope presque chaque détail d’un passage qui en comptebeaucoup. C’est le premier commentaire complet de la vision que nousrencontrons, et probablement le plus complet de notre corpus.
L’auteur du commentaire cite ici moins fréquemment, moins littérale-ment que Bède, les œuvres des Pères, mais le réseau de référencespatristiques est aussi serré que dans le commentaire du moine anglais∞∞:ainsi, sur le placement de l’épisode à la sixième heure, il a lui aussirecours au sixième âge du monde, emprunté à Arator, mais il y ajoutel’origine de la prière de sexte, lue chez Tertullien.
Alors que Bède restait relativement sobre, le commentaire attribué àRaban laisse à son lecteur un sentiment de confusion, dû à la multipli-cité des idées exprimées ou évoquées, voire frôlées∞∞: il semble ne jamaisse résoudre à choisir, et rechercher l’exhaustivité, fût-ce au prix de laclarté. Sans cesse, pour chaque détail, une interprétation morale origi-nale peut se doubler d’une allégorie classique72, l’explication d’un termedifficile voisine avec une citation biblique, et une discussion sur lameilleure leçon à adopter avec une typologie allégorique des vices hu-mains.
71 Ms. Oxford, Balliol College 167, f. 161 r° et v°.72 Ainsi, commentant la faim de Pierre∞∞: ET CUM ESURIRET. ieiunis simul et oratio-
nibus dantur exempla. mystice autem salutem gentium compaciendo esuriit. quae nuncin uisione ostenditur. Et ideo sexta hora uisa est quia sexta seculi etate facta est.
2453-09_03_Candiard 06-15-2009, 14:12548
549LA VISION DE PIERRE À JOPPÉ (AC 10,9-16)
Comme presque tous les auteurs que nous avons rencontrés, celui denotre commentaire adopte la ligne d’interprétation allégorique sur lesalut apporté aux nations païennes. C’est ainsi qu’il conclut, par exem-ple, le commentaire de Et vidit celum apertum ∞∞:
«∞∞Spirituellement, cela veut dire que les cieux sont dès lors ouverts auxnations.∞∞»73
Mais la vision elle-même reçoit deux interprétations différentes, qu’ilprésente successivement et longuement, séparées par la formule∞∞: «∞∞Enun autre sens∞∞» (Alio quoque sensu). Dans la première, la toile estl’image du corps physique de Jésus, sans péché, mort et ressuscité, puismonté au ciel. On sent l’influence probable de l’image du suaire, trou-vée par Hilaire et reprise par Ambroise, mais le développement qu’enfait le pseudo-Raban est tout à fait personnel, et sans jamais se référerau suaire lui-même. Toute l’humanité (les animaux de la vision) doitdevenir le Christ, devenir ses membres («∞∞ut omnes efficiantur eiusmembra∞∞»).
Nous voilà arrivés au même résultat que Bède, mais par un chemintrès différent. D’ailleurs, les trois types d’animaux qui représententl’humanité entière (bêtes sauvages, reptiles, oiseaux) reçoivent une in-terprétation encore plus originale, d’ailleurs unique dans l’histoire del’exégèse du passage, puisqu’il veut y voir les trois parties de la philo-sophie74∞∞; mais l’explication s’interrompt avant d’être arrivée à terme,sans doute par corruption du texte dans le manuscrit d’Oxford que nousutilisons.
L’auteur propose alors un autre schéma d’interprétation∞∞: la toilen’est plus le corps physique du Christ mais l’Église, son corps mystique,dans lequel les païens sont appelés à entrer. Ce schéma correspond da-vantage à l’explication patristique traditionnelle. C’est d’ailleurs sur deslignes d’interprétation tout à fait traditionnelles dans le fond quel’auteur continue et achève son explication de la scène, notamment del’hésitation de Pierre. Il rappelle l’interprétation spirituelle tradition-nelle, depuis Origène et Augustin, des interdits alimentaires, mais en lapersonnalisant∞∞: si la rumination renvoie toujours à la méditation de la
73 «∞∞Spiritaliter uero celos ab hinc gentibus designat esse apertos.∞∞»74 QUADRUPEDIA ethicam id est moralem qui moribus terrenis uelut pecora incuruati
sunt. REPTILIA physicam id est rationalem qui de supernis ut potuerunt – hoc est de diiset astrologia – meditati sunt. On croit reconnaître un reste de la tripartition classique,que l’auteur a certainement pu connaître par Augustin (Cité de Dieu VIII,6)∞∞: physique,logique, éthique. Mais le texte est manifestement corrompu et incomplet.
2453-09_03_Candiard 06-15-2009, 14:12549
550 ADRIEN CANDIARD
Parole de Dieu, le sabot fendu ne signifie plus les bonnes œuvres, maisla distinction des sens de l’Écriture ou des personnes de la Trinité∞∞:
«∞∞C’est ainsi qu’il n’a pas le sabot fendu, celui qui ne distingue pas la lettrede l’esprit, ou qui ne distingue pas les personnes de la Trinité.∞∞»75
Cet exemple résume bien la méthode de ce commentaire, qu’onretrouve presque constamment∞∞: citer l’interprétation traditionnelle, sou-vent personnalisée, et y ajouter nombre d’idées neuves et originales.
4. La vision de Pierre dans le moyen âge central
Beaucoup de commentaires du moyen âge central, très largementinspirés de la Glose ordinaire, se ressemblent, parfois jusqu’à l’identi-que∞∞; les examiner tous serait ici inutile et fastidieux. Aussi avons-nouspréféré ne présenter que quelques commentaires importants ou signifi-catifs. On s’étonnera peut-être de ne rencontrer ni Étienne Langton, niHugues de Saint-Cher∞∞: ces deux auteurs n’ont, au moins dans leur com-mentaire de cette péricope, rien apporté qui ne fût déjà dans la Glose∞∞; lepremier la résume très brièvement, quand le second la copie de manièreplus généreuse, mais jamais plus originale.
a. La Glose ordinaire
Si les deux commentaires principaux laissés par le haut moyen âge sesont révélés assez différents, une synthèse – ou du moins une cohabita-tion – des deux exégèses est possible∞∞: c’est du moins l’opinion du com-pilateur anonyme de la Glose ordinaire, qui n’hésite pas à recourir mas-sivement et simultanément aux deux commentateurs pour expliquer lavision de Joppé.
Le pseudo-Raban fournit d’abord la quasi-totalité de la gloseinterlinéaire∞∞: dans notre texte, Bède y est utilisé une fois. Mais il estcité de manière ramassée, souvent résumée. Quant à Bède, il est l’auteurle plus cité de la glose marginale, tant à partir de l’Expositio que de laRetractatio, toutes deux mises à contribution.
La glose interlinéaire, malgré la brièveté de ses notations, ne se con-tente pas d’expliciter le sens de mots difficiles∞∞: elle donne bien souventdes interprétations spirituelles, parfois complétées de citations bibliquestrès abrégées. Parce qu’elle est empruntée à un auteur unique, elle four-nit une explication relativement cohérente de la vision∞∞: d’une part, le
75 «∞∞Ungulam itaque non diuidit qui litteram a spiritu uel trinitatis personas nondistinguit.∞∞»
2453-09_03_Candiard 06-15-2009, 14:12550
551LA VISION DE PIERRE À JOPPÉ (AC 10,9-16)
uas quoddam est compris comme représentant le corps physique duChrist, comme le proposait le pseudo-Raban de façon originale par rap-port à la tradition patristique∞∞; d’autre part, les interprétations moralesde tel ou tel détail sont souvent valorisées. C’est ainsi que la gloseinterlinéaire s’écarte – ce qui est très rare – du pseudo-Raban76 et de sonexplication philosophique, pour proposer une interprétation neuve dusens de chaque animal de la vision. Nous indiquons en italique le textebiblique, tandis que la glose interlinéaire est indiquée entre crochets∞∞:
«∞∞Les quadrupèdes et les serpents [accrochés aux biens terrestres/ venimeuxet trompeurs/ les trois genres de païens que l’Église a ramenés à l’unité] dela terre et les oiseaux [les orgueilleux] du ciel.∞∞»77
La glose marginale, elle, est bien plus disparate. Si elle semble privi-légier l’interprétation ecclésiale de la vision78, c’est sans exclusive∞∞: elley juxtapose également des considérations textuelles, l’interprétationlittérale et spirituelle des interdits alimentaires, beaucoup d’allégories dedétail et plusieurs citations de l’Écriture.
La lecture de la Glose ordinaire ne donne pas les idées claires.L’accumulation des gloses interdit d’y trouver une ligne interprétativeprécise∞∞: la Glose ne choisit pas∞∞; elle n’est pas un commentaire à pro-prement parler, mais un outil de travail, qui permettra au véritable com-mentateur de faire ses choix exégétiques en connaissance de cause, sansignorer les opinions de ses prédécesseurs.
b. Pierre le Chantre
Nous avons déjà remarqué la grande proximité de ce commentaireavec la Glose ordinaire. Ce fait, général pour toute l’œuvre, est tout àfait visible dans le commentaire de la vision de Pierre79. Le Chantresemble d’abord se contenter de lire les notations de la glose inter-linéaire, y ajoutant très occasionnellement un élément de la glose margi-
76 Cette glose diffère du moins de la version du manuscrit d’Oxford, qui est incom-plet et confus dans ce passage. Une vérification dans le manuscrit de Cambridge seraitnécessaire.
77 «∞∞Quadrupedia et serpentia [herentes terrenis / virulenti et dolosi / tria gentiumgenera que in vnitatem redacta fuit ecclesia] terrae et volatilia [superbi] caeli.∞∞»
78 Par exemple∞∞: «∞∞Vas quoddam. Beda [Ex]. Ecclesia incorruptibili veritate et fidepraedita. Linteum autem tinea non consumit∞∞: quae vestes alias corrumpit. Ideo fidelisexcludit de corde corruptionem malae cogitationis∞∞: sic incorruptibiliter firmatus fide∞∞:vt praua cogitatione. quasi a tinea non rodatur in mente. […] Quattuor initia quibuslinteum dependebat∞∞: quattuor sunt plagae orbis quibus extendit ecclesia vel quattuor ini-tia∞∞: euangelistae quattuor sunt. per quos ecclesia caelesti dono imbuta sublimatur.Linteum. Pro ecclesia. pro candore sanctitatis et mortificatione carnis.∞∞»
79 Ms. Paris, Mazarine 176 (87), f. 248 v°.
2453-09_03_Candiard 06-15-2009, 14:12551
552 ADRIEN CANDIARD
nale80∞∞; il adopte donc d’abord l’interprétation, tirée du pseudo-Raban,du uas quoddam comme symbolisant le corps physique du Christ. Onest alors surpris de trouver une réminiscence d’Hilaire de Poitiers, quine se trouve pas dans la Glose∞∞:
«∞∞C’est pourquoi son corps est enveloppé dans un suaire pur.∞∞»81
Pierre la connaît-il de première main∞∞? Ou dispose-t-il d’une versionde la Glose légèrement différente de la nôtre∞∞? Difficile d’en juger.
Puis le commentaire de Pierre s’interrompt, et l’adverbe mystice in-troduit une seconde explication de la toile qui descend du ciel, en utili-sant cette fois la glose marginale. Il ne s’agit pourtant pas d’une inter-prétation plus spirituelle que la précédente, mais de l’interprétationecclésiale, qui prend ici une forme plus cohérente que dans la Glose or-dinaire.
Puis le commentaire reprend, suivant fidèlement la glose interlinéaire,jusqu’à une interruption plus surprenante, prenant la forme d’une ques-tion∞∞:
«∞∞Mais n’était-il donc pas investi d’une force d’en haut∞∞? Comment alorsignorait-il qu’il devait manger ces animaux∞∞? Réponse∞∞: bien qu’évidem-ment rempli de l’Esprit il sût cela, toutefois [il le dit] pour que ne pas causerde scandale pour les juifs en passant aux païens, parce qu’il avait encoreen horreur les nourritures communes et parce qu’il avait peur d’aller chezles païens à cause de leur sauvagerie∞∞; de sorte que le Seigneur lui a ditplus clairement d’aller porter l’évangile aux païens. C’est la réponse dumaître.∞∞»82
Notre manuscrit est une reportatio d’étudiant, c’est-à-dire des notesde cours prises sur le vif, puis généralement mises au net. Sans doute cepassage témoigne-t-il de l’enseignement réel de Pierre, peut-être inter-rompu par un étudiant, à moins qu’il n’ait introduit lui-même ce débutde question théologique. Cette interruption est en tous cas significative,car elle met l’accent sur un point jusque-là systématiquement négligépar les commentateurs∞∞: les conditions de l’extase et le sens de l’inspira-
80 Pour expliquer Vidit celum apertum, il juxtapose les deux gloses (la glose margi-nale est en italique)∞∞: «∞∞non in reseratione elementi sed divuina reuelatione. in quodesignatur celos gentibus terre apertos et introitum pandendum.∞∞»
81 «∞∞Unde et inuolitum corpus eius sindone munda.∞∞»82 «∞∞Sed nonne indutus uirtute ex alto∞∞? quomodo ergo ignorabat hec animalia esse
mactanda∞∞? R[esponde]o∞∞: licet plenus spiritus scilicet hoc sciret tamen ne scandalumpreberet iudeis per transitum ad gentes et quia adhuc etiam horrebat cibos comunes etquia timebat ire in gentes propter crudelitatem eorum, et ut manifestius dominus eieuangelium ad gentes. Magister ait.∞∞»
2453-09_03_Candiard 06-15-2009, 14:12552
553LA VISION DE PIERRE À JOPPÉ (AC 10,9-16)
tion apostolique. La réponse, toutefois, ne s’appuie que sur des élémentsdu récit, sans élaborer de doctrine théologique sur le point soulevé.
Plus original que le commentaire d’Étienne Langton, ce commentairedu Chantre reste donc très marqué par la Glose, dont il cherche toutefoisà organiser la matière, présentant des interprétations cohérentes succes-sives.
c. L’Historia apostolica
Le chapitre 47 de l’Historia apostolica83 raconte l’épisode de lavision de Pierre. Son auteur suit fidèlement la progression du texte bibli-que, qu’il cite d’ailleurs d’abondance, mais en n’hésitant pas à en indi-quer les variantes, ce qu’il fait d’après la Glose84.
Cette dernière semble bien la source principale de notre texte, maisl’auteur de l’Historia y fait une sélection tout à fait radicale∞∞: il ne se pré-occupe pas du sens spirituel, et ne cite de la Glose que ce qui permettrad’expliciter le sens littéral le plus simple. Sur ce point, le matériel fournitpar la Glose est déjà d’une grande richesse∞∞: notre auteur y trouve le sensdes mots difficiles, comme extasis85, ou l’explication de la crainte dePierre devant ces aliments «∞∞communs∞∞»86∞∞; mais il doit élaborer lui-même une complexe description de la toile qui descend du ciel.
Ce souci exclusif du sens littéral souffre deux exceptions. La pre-mière touche le sens de la vision, que l’auteur de l’Historia ne laisse passans explication∞∞:
«∞∞Et comme il avait faim, une voix lui dit∞∞: ‘Lève-toi, Pierre, tue et mange.’C’est comme si on lui avait dit en esprit∞∞: ‘Passe aux païens, tue en eux lesvices et ainsi incorpore-les à l’Église.∞∞»87
On reconnaît bien l’interprétation «∞∞pagano-morale∞∞», mêlant lesdeux thématiques∞∞: le sens est bien l’ouverture aux païens (transi adgentes), mais la note morale ne peut être ignorée (occide in eis vitia).
83 PL 198, col. 1675-1676.84 Ainsi∞∞: «∞∞Postera autem die iter facientibus illis, et appropinquantibus civitati
Joppe∞∞», vel «∞∞apparentibus∞∞», secundum aliam litteram.85 «∞∞Cecidit super eum extasis∞∞», qua Domino operante, passus est alienationem
mentis, ita ut non uteretur sensibus humanis86 Et est idioma Hebraeorum, reputantium cibos immundos, quibus communiter
utebantur gentes. Unde vocabant communes, quasi immundos. Abhorruit ergo Petrus,quod dictum est ei «∞∞manduca∞∞», quia ostensa ei fuerant quadrupedia et serpentia,secundum legem immunda, quia grave videbatur ei uti cibis in lege prohibitis, etmaxime timebat reprehensionem Judaeorum, si uteretur cibis gentilium.
87 «∞∞Et cum esuriret, facta est vox ad eum, dicens∞∞: Surge, petre, macta etmanduca.∞∞» Ac si diceretur ei in spiritu∞∞: Transi ad gentes, et occide in eis vitia, et sicEcclesiae incorpora.
2453-09_03_Candiard 06-15-2009, 14:12553
554 ADRIEN CANDIARD
L’autre exception surprend davantage, car elle n’est pas nécessaire àla compréhension du récit. Elle concerne le sens de la triple ostension dela vision, que l’Historia comprend dans un sens sacramentel traditionneldepuis Ambroise88. La référence à ce dernier se trouve dans la Glose, oùl’auteur l’a certainement lue, mais le développement qu’il en donne estoriginal.
À ses lecteurs, l’Historia apostolica donne donc à connaître un récitde la vision de Pierre à la fois proche du texte biblique et, bien que dé-pouillé pour l’essentiel d’interprétations allégoriques, tout à fait con-forme à l’interprétation occidentale traditionnelle, en particulier tellequ’elle s’est fixée avec Bède.
d. Thomas de Lentini
Ce dominicain sicilien de la première génération des frères prêcheurs,n’ayant probablement pas fréquenté les maîtres parisiens, propose unelecture, certes traditionnelle, mais plus originale des Actes des apôtres.L’importance de la Glose reste grande dans son explication de lapéricope, mais elle est bien moins centrale que pour les commentateursprécédents.
L’explication de la vision de Pierre89 commence par le rappel de ladiuisio textus du chapitre («∞∞deuxième partie du chapitre∞∞: comme aupa-ravant il est question de l’envoi de Corneille, sur la venue de Pierre verslui grâce à la révélation de la vision ∞∞») et une diuisio de la péricope elle-même. Il ajoute des notations sur la scène, comme s’il répondait à unquestionnaire ou suivait une grille d’analyse littéraire («∞∞lieu∞∞: monter.Temps∞∞: autour de la sixième heure∞∞»90). Le sens de la vision de Pierreest immédiatement explicité, ce qui est nouveau∞∞: alors que les maîtresparisiens avaient l’habitude d’accumuler les commentaires sans tenter desynthèse, Thomas montre ouvertement quelle signification il donne àl’épisode, à travers une remarque qu’il est d’ailleurs seul à faire.
«∞∞La révélation fut donc double∞∞: il y en eut une par la vision, une autre parl’inspiration. La première concernait l’appel des païens, l’autre son cheminpour appeler les païens.∞∞»91
88 «∞∞Hoc autem factum est ei ter∞∞», scilicet vas semel, iterato, et tertio in terrademissum, et vox ter audita est, pro commendanda veritate visionis, vel fide Trinitatis.Nam, ut dicit Ambrosius, in catechismo fit trina interrogatio, scilicet credis in Deum∞∞?abrenuntias Satanae∞∞? vis baptizari∞∞? Similiter trina unctio, in vertice, sive fronte∞∞; inscapulis, in pectore∞∞; in baptismo quoque fit trina immersio.
89 Ms. Paris, BnF lat. 14379, ff. 61v° et 62.90 «∞∞ Locus∞∞: ascendere. tempus∞∞: circa horam VI ∞∞»91 «∞∞Duplex autem fuit reuelacio∞∞: una fuit per uisionem, altera per inspiracionem.
Una fuit de gencium uocacione, altera de suo itinere ad uocandum gentes.∞∞»
2453-09_03_Candiard 06-15-2009, 14:12554
555LA VISION DE PIERRE À JOPPÉ (AC 10,9-16)
La suite du commentaire est, formellement, plus habituelle. Mais s’ilutilise souvent les explications de la Glose, il sait aussi s’en détacherlonguement et ne pas l’utiliser pour tel ou tel verset qu’il explique demanière originale. Ainsi, quelle signification donner à la mention de la«∞∞sixième heure∞∞»∞∞?
«∞∞C’est la plénitude de la chaleur et de la lumière, parce qu’il fallait appelerles païens à la chaleur de la foi. À cet heure-là Jésus s’assit sur le puits, encet âge du monde-là (à savoir, le sixième) il est venu, ce jour-là il fut conçuet à cette heure-là crucifié.∞∞»92
On reconnaît la traditionnelle référence à la Samaritaine et au sixièmeâge du monde, mais tout le reste est original. Plus originale encore estl’explication donnée de la faim de Pierre, où après une réélaborationde l’interprétation spirituelle traditionnelle (Pierre a faim du salut desnations), il ajoute un sens «∞∞littéral∞∞» propre∞∞:
«∞∞D’après le sens littéral, tu as en Pierre un triple exemple∞∞: celui de laprière, celui de l’abstinence ou du jeûne et celui de la tempérance. C’estpourquoi le texte dit ‘manger’ et non ‘se gaver’∞∞»93.
Intégralement originale, cette fois, sera son explication du verset«∞∞Occide et manduca∞∞»∞∞:
«∞∞Lève-toi∞∞: par la constance et la sollicitude. Tue ∞∞: par la prédication, oubien la mortification de la chair et de l’erreur. Mange ∞∞: par la conversion,c’est-à-dire incorpore-les à toi-même. Note que cela a été dit d’abord àPierre, qui était le chef de l’Église.∞∞»94
Thomas conserve le sens traditionnel, augustinien, de l’injonctiondivine (tibi incorpora), mais il le double d’une dimension plus morali-sante∞∞: Pierre n’est pas d’abord la figure de l’Église, mais un modèle devie chrétienne, qui doit exciter le lecteur à la vertu. Cette dimensionmorale n’est toutefois pas systématique∞∞: alors que d’autres commenta-teurs interprètent volontiers les interdits alimentaires de façon morale,Thomas passe très rapidement sur cette explication, ne donnant guèreque le nécessaire à la compréhension de l’épisode de Pierre à Joppé.
92 «∞∞Hoc est plenitudo feruoris et lucis. Quod gentes uocandae erant ad feruoremfidei. Hac hora Ihesus sedit super puteum, hac etate uenit – scilicet sexta –, hac dieconceptus, hac hora crucifixus.∞∞»
93 «∞∞Secundum litteram, habes in Petro triplex exemplum∞∞: orationis, abstinencie siueieuinii et temperancie. Unde dicit gustare, non uagare.∞∞»
94 «∞∞Surge∞∞: per constantiam et sollicitudinem. Occide∞∞: per predicacionem siuecarnis et erroris mortificacionem. Manduca ∞∞: per conuersionem, hoc est tibi incorpora.Et nota quod hoc primo dictum est Petro qui erat caput ecclesie.∞∞»
2453-09_03_Candiard 06-15-2009, 14:12555
556 ADRIEN CANDIARD
L’inertie d’un corpus dont nous n’avons pourtant présenté ici que lespoints les plus saillants est réelle, et parfois stupéfiante. Les commen-taires s’inscrivent dans une continuité qui fonctionne comme un cadretrès restrictif∞∞; et la péricope que nous avons étudiée ici est de ce pointde vue parfaitement représentative de l’exégèse médiévale des Actes.
Pour autant, cette incontestable fixité ne nous a pas masqué deuxprincipales évolutions, qui n’apparaissent pas au premier abord maisdont les touches discrètes viennent peu à peu remettre en cause l’appa-rence d’immobilité. La première est la plus évidente, et concerne le sensgénéral de la péricope∞∞: la question de l’admission des païens dansl’Église, qui est au cœur de la problématique lucanienne, perd progres-sivement de son actualité, jusqu’à devenir au moyen âge tout à faitobsolète∞∞; les commentateurs, tout en maintenant l’interprétation latinetraditionnelle, élaborent donc dans le même temps une autre interpréta-tion, plus morale, de la péricope. Cette ligne morale commence à poindrechez Hilaire, mais la synthèse de l’interprétation traditionnelle (l’admis-sion des païens) et de la lecture morale (il faut faire disparaître le péché)est réalisée par Bède, avant d’être adoptée par tous.
La seconde évolution est plus subtile, et concerne la figure de Pierre.Les Pères en faisaient une lecture à la fois institutionnelle (il est lafigure du corps de l’Église) et missionnaire (le moyen de l’assimilationdes païens, c’est la prédication). Avec Bède, Pierre devient un contem-platif qui tuera en lui les vices par l’ascèse∞∞: on passe du missionnaire aumoine. Les commentateurs successifs renforceront longtemps cette ten-dance∞∞; ce n’est qu’au XIIIe siècle, dans un commentaire en marge desmilieux parisiens, que cette lecture commence peu à peu à retrouver ladimension missionnaire. Les ordres mendiants, il est vrai, viennent deredécouvrir la vitalité de la «∞∞vie apostolique∞∞».
L’exégèse des Actes y a-t-elle contribué, ouvrant la route vers desréalités sociales nouvelles∞∞? L’hypothèse serait tentante, mais peu com-patible avec la chronologie∞∞: au contraire, il faut attendre que ces réalitéss’imposent dans la société médiévale avec la force de l’évidence pourque, timidement, le corpus accepte progressivement de les prendre encompte. Mais s’il semble bien que l’exégèse savante ne soit pas à l’ori-gine des mouvements de «∞∞vie apostolique∞∞», elle n’y est pas indiffé-rente et ne demeure pas un univers clos.
2453-09_03_Candiard 06-15-2009, 14:12556







































![[Avec Maroun Aouad] « Un fragment retrouvé (sur la composition des éléments) du troisième Livre perdu du Grand commentaire au De Caelo par Averroès »](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/632759077dcfcb263e03e332/avec-maroun-aouad-un-fragment-retrouve-sur-la-composition-des-elements.jpg)