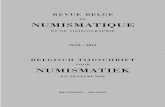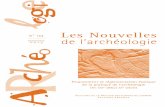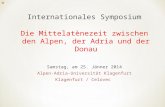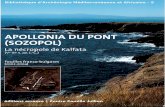Les monnaies des fouilles belges d'Apamée sur l'Oronte, Syrie (2005-2010)
La Tène remise au jour : fouilles de 2003 et thèse en cours
Transcript of La Tène remise au jour : fouilles de 2003 et thèse en cours
29
Au cours de l’été 2003, une équipe de l’Office et musée d’archéologie de Neuchâtel a procédé à une fouille de quelques mois sur le site éponyme du second âge du Fer, préalablement à des travaux de génie civil dans le camping qui occupe aujourd’hui les lieux 1.
Le but de cette communication est de rappeler briè-vement les principaux résultats obtenus au cours de cette intervention 2, puis de présenter les perspectives offertes par ceux-ci pour la ré-étude du corpus, en particulier dans le cadre d’une thèse de doctorat inscrite à l’Université de Neuchâtel.
Objectifs et méthode de fouille
La zone touchée par les travaux recouvre en partie les surfaces anciennement excavées (voir Honegger ce volume, fig. 1) 3 par nos prédécesseurs, qui avaient pro-cédé à une fouille méthodique et exhaustive de ce qui constituait alors le site archéologique, à savoir le comble-ment d’un ancien bras de la Thielle 4. Notre intervention s’est ainsi focalisée sur les berges de l’ancien cours, dont les parties hautes n’avaient pas nécessairement été observées au cours des fouilles « officielles ». Ces berges sont connues pour avoir livré les bois de construction de six « habita-tions », mises au jour par Emile Vouga dans les années 1880 (Vouga 1885). Nous espérions ainsi y découvrir des éléments semblables. Par ailleurs, nous nous trouvions dans les environs immédiats de l’extrémité nord-ouest du Pont Desor, où les vestiges d’une route d’accès pouvaient éventuellement être conservés.
Parallèlement à ces objectifs d’ordre « architectural », le but principal de l’intervention de 2003 était de met-tre en évidence la stratigraphie, dont l’analyse était res-tée plutôt sommaire jusqu’alors : sa compréhension nous paraissait indispensable à la construction d’une réflexion
La Tène remise au jour : fouilles de 2003 et thèse en cours
Gianna Reginelli Servais
sur la topographie des lieux, ainsi que sur la répartition et la datation des découvertes. Aussi avons-nous pratiqué de grands transects, perpendiculaires à l’ancien cours, qui permettaient par la même occasion de positionner les anciens travaux sur le cadastre actuel. La fouille a été effectuée à la pelle mécanique, à l’exception de deux zones dans les sondages (S 3798 et S 3802), dont les couches archéologiques ont fait l’objet de décapages manuels.
Stratigraphie et repères chronologiques
La tranchée S 3798 a livré une séquence stratigraphique qui renouvelle complètement la vision que l’on pouvait s’en faire à la lecture de l’ouvrage de référence sur La Tène. En effet, la question de la stratigraphie demeure un point faible de la monographie de Paul Vouga qui, après avoir constaté que les objets provenaient de toutes les couches, conclut : « Comme tous les objets recueillis, à quel [sic] niveau qu’ils apparaissent, se révèlent contemporains, leur position stratigraphique est sans valeur ; aussi n’en tien-drons-nous pas compte » 5 (Vouga 1923).
Or ce constat ne s’applique pas pour les berges déga-gées en 2003, bien au contraire : les vestiges archéologi-ques découverts datent de diverses périodes et sont strati-fiés (fig. 1) 6. Ainsi, la couche 4 contenait de la céramique datant du milieu de la période Hallstatt (Ha C-D) ; la couche 9 a livré de la céramique et de la faune attribuées au milieu de la période La Tène (LT C2-D1). Quant aux dépôts antérieurs et postérieurs à ces deux phases de fréquentation, ils témoignent des nombreuses étapes de la formation du paysage à l’exutoire du lac, entre le Néolithique et aujourd’hui, que nous résumons ici à grands traits.
La séquence débute au Néolithique moyen, alors que le site est sous l’eau du lac : les limons (couche 1) et la
30
Fig. 1. Relevé stratigraphique du sondage S 3798. Pour le détail de la description, voir Reginelli Servais 2007.
craie (couche 2) lacustres le confirment. La couche 1 a livré une planchette de chêne, dendrodatée de 3824 avant J.-C., qui fournit un terminus post quem pour la mise en place des sédiments situés au-dessus. Puis la cote du lac baisse, suffisamment longtemps pour permettre la forma-tion de tourbe (couche 3). On observe ensuite une phase d’érosion, qui entaille en biseau les strates 1 à 3. Les galets de la couche 4 constituaient une plage, à la limite entre terre et lac 7. Un cordon littoral (couche 5) atteste un évé-nement relativement brutal, lié à une montée du niveau du lac.
Une baisse importante de la nappe phréatique inter-vient vers le milieu du premier âge du Fer. Elle est, selon nous, à l’origine du creusement du chenal « proto- historique » de la Thielle. L’ensemble des couches suivan-tes (à partir de la couche 6) est dès lors à mettre en relation avec un milieu fluviatile. Après une durée d’activation relativement brève, la rivière emprunte un nouveau tracé, probablement plus à l’est. L’ancien chenal est comblé peu à peu de sable (couches 6 à 9), intercalé de fins horizons de limons crayeux et organiques, déposés dans une dynami-que plutôt calme. Au sommet du remplissage, la couche 9 renfermait les vestiges archéologiques datés de LT C2. Les couches supérieures (10 à 15) ont, quant à elles, livré des vestiges anthropiques modernes (20e siècle).
Mobilier archéologique
L’horizon hallstattien (couche 4) contenait de la céramique attribuée par l’étude typologique à la tran-sition Ha C-D1, soit vers 650 avant J.-C., ainsi que quelques restes de faune. Les données stratigraphiques semblent montrer que les vestiges se sont retrouvés sur une ancienne plage du lac, qui servait alors de berge à la rivière. Rappelons que du mobilier hallstattien avait déjà
été découvert au cours des fouilles anciennes, puis lors des travaux de William Wavre et Paul Vouga, sans que sa pré-sence n’ait jamais fait l’objet d’une tentative d’explication. La majorité des tessons proviennent du sondage S 3802 : les remontages sont nombreux et montrent que la plupart des fragments appartenaient à un lot de récipients de for-mes et de dimensions variées, cassés sur place, sous la pile XIII du Pont Desor (voir ci-dessous). La faible dispersion des tessons témoigne d’un milieu en courant faible.
L’horizon laténien (couche 9) renfermait surtout des restes de faune (1200 fragments), dont Patrice Méniel a fait l’étude, et dont il présente les principaux résultats dans ce volume. Les 250 tessons de poteries sont datés de LT C2. Le bon état de conservation des ossements et de la céramique, leur faible fragmentation et leur dis-persion peu étendue indiquent, comme pour la couche hallstattienne, un milieu calme, concordant avec l’image que l’on se fait d’un replat de berge, le long d’un bras secondaire de la Thielle.
Dans l’ensemble des surfaces fouillées, les vestiges métalliques ont été très peu nombreux, et, parmi eux, les bons marqueurs chronologiques ont malheureusement été trouvés hors contexte 8.
Le Pont Desor
À La Tène, la présence humaine au cours du premier âge du Fer bénéficie donc désormais d’un solide contexte stratigraphique et est confortée par des datations dendro-chronologiques correspondant à la typochronologie du mobilier céramique.
Près de 50 pieux et bois couchés ont été découverts en 2003, parmi lesquels ceux du sondage S 3802, qui ont été d’un apport majeur (fig. 2). Deux alignements per-ceptibles dans le terrain ont été confirmés par l’analyse
432 m
Sc. 811 Sc. 711 Sc. 911 Sc. 1011
431 m
430 m
1 m N
2
1
3
14
5
6
7 7f
7e 7d 7c 7a
7b
6b
6a
8
8a 8b
8c
9
4
9
10 15
10 11
13 12
31
Ainsi, d’anecdotique qu’elle paraissait à la lueur des trouvailles de nos prédécesseurs, la fréquentation du site au Hallstatt est à considérer, depuis 2003, comme une problé-matique à part entière, aux côtés des thèmes « classiques » liés au second âge du Fer sur le site éponyme.
Au final, ces datations, couplées aux résultats livrés par la stratigraphie, donnent au plan de La Tène une profon-deur historique inédite.
Pistes de recherche
Au regard de ce qu’on savait de La Tène jusqu’à aujourd’hui, ces résultats sont exceptionnels. Toutefois, ils ne peuvent se suffire à eux-mêmes compte tenu du potentiel encore inexploité dont est porteur le site. Cette nouvelle intervention a véritablement déclenché la reprise de l’étude de l’ensemble de référence. Comme par ailleurs le site offre l’opportunité de travailler sur des archives abondantes, globalement d’excellente qualité, il nous a semblé avantageux de confronter et de combiner docu-ments anciens et résultats récents, dans le cadre de pro-blématiques nouvelles.
La réévaluation du corpus a pris deux formes, depuis début 2007 10 : un projet du Fonds national suisse de la recherche scientifique, dont les principaux objectifs ont déjà été décrits (Kaenel et Reginelli Servais 2008), et une thèse de doctorat inscrite en archéologie préhistori-que à l’Université de Neuchâtel, dont nous exposons briè-vement ci-dessous quelques lignes directrices.
dendrochronologique. Selon notre hypothèse d’interpré-tation, ils appartiennent à deux des piles du Pont Desor 9. L’une (à l’est) était connue de nos prédécesseurs – elle se trouve à l’intérieur de leurs limites de fouilles (1907) et portait le numéro XII. La pile ouest, en revanche, était jusqu’ici totalement inconnue et a été désignée par le numéro XIII.
Le pieu 159 de la pile orientale (XII) a été daté à la fois par la dendrochronologie et par la méthode du 14C : le dernier cerne présent date de 662 avant notre ère (Gassmann 2007, et ce volume). L’analyse ayant éta-bli une corrélation avec les pieux nos 156, 157 et 184, il s’avère donc que la construction de cet alignement se place entre 660 et 655 avant J.-C. Longtemps considéré comme romain, le Pont Desor devient ainsi l’un des plus anciens ouvrages de ce type connu en Suisse. Quant à la relation entre les tessons de céramique et la pile XIII du pont, sous laquelle ils se trouvaient, elle doit encore être étudiée, mais vu l’exiguïté de la surface fouillée, les hypo-thèses d’interprétation demeureront limitées.
Un troisième montage entre deux pieux (M5, voir Gassmann ce volume, fig. 3), que la datation au radiocarbone fait remonter également au premier âge du Fer, apporte un élément de plus à l’importance et à l’éten-due de l’implantation humaine sur les bords de la Thielle à cette période. La fonction de ces pieux, bien qu’encore difficile à déterminer, pourrait être liée à l’aménagement des anciennes berges. Il en va de même pour les montages M3 et M4, qui semblent en être le pendant laténien, sur la rive sud.
Fig. 2. Plan du sondage S 3802. La surface hachurée a été fouillée manuellement. Infographie Philippe Zuppinger.
XII
XI
X
XIII
Pont Desor
XII159
157
156178
176
178
176
184
M2
M1
1908
19072003 (S 3802)
5 mN
32
Alors que la portion du chenal fouillée en 1910 avait été très pauvre en découvertes, le replat (couche 9) mis au jour en 2003 en a livré une grande quantité. P. Vouga expliquait cette carence en objets en l’attribuant à une sorte de remontée du fond du chenal, en amont et en aval de laquelle les objets auraient été « entraînés » (Vouga 1912 et 1923 ; fig. 4). Pour notre part, nous chercherons à étayer une hypothèse plus fonctionnelle qu’acciden-telle : les concentrations de mobilier se situeraient le long des berges de l’ancien cours et aux abords immédiats des ponts, c’est-à-dire à proximité de leur position initiale sur terre ferme et sur les ponts.
Un deuxième thème de réflexion porte sur les associa-tions d’objets. Le détail de certaines descriptions, parfois accompagnées de plans, permet aujourd’hui de poser des questions que P. Vouga et ses prédécesseurs ne pouvaient pas envisager dans le contexte scientifique qui était le leur. Ainsi, la découverte telle que reconstituée à la figure 5 était interprétée comme un guerrier tombé au combat en défendant des entrepôts fortifiés (Vouga 1914). Depuis les années 1970, l’interprétation cultuelle a pris le pas sur la fonction économique et/ou guerrière qu’on attribuait à La Tène. À l’instar des observations effectuées sur les sanctuaires celtiques du nord de la France, on imagina alors des expositions de trophées, composés d’armes et de « restes » humains et animaux. L’assemblage de la figure 5 ne manquera pas pourtant d’évoquer une tombe ... La frontière entre pratiques cultuelles et funéraires est ren-due de plus en plus floue, notamment à la suite de décou-vertes récentes (Le Mormont, dans le canton de Vaud, par exemple), où les deux sphères se rencontrent de manière particulièrement explicite. Les associations d’objets per-mettront d’aborder cette problématique.
Si la diversité des catégories d’objets recueillis à La Tène – armes, chars, outils, vaisselle, monnaies, etc. – ne pose plus de problème dans l’interprétation du lieu de culte, leur typochronologie suggère en revanche une lon-gue présence humaine sur les lieux, car elle s’inscrit dans un spectre plus large que celui proposé par P. Vouga (La Tène II). Ainsi, bien que Thierry Lejars (2007 et à paraî-tre) ait mis en évidence un trophée d’armes datant du LT C2 (appartenant à la collection Schwab), l’étude des
Divers fonds d’archives conservent les témoignages des recherches anciennes à La Tène : lettres, journaux, notes, relevés et plans permettent de restituer avec précision l’historique des travaux et des découvertes. Le Laténium abrite en particulier la majeure partie des documents se rapportant aux fouilles officielles, qui constituent notre source d’informations privilégiée. La qualité de ces der-niers est inégale : des relevés stratigraphiques très précis côtoient des croquis sommaires du profil de l’ancien cours. Certains objets sont reportés sur les plans, avec la profondeur à laquelle ils gisaient, d’autres sont unique-ment mentionnés dans le journal des fouilles, sans autre détail sur l’emplacement de leur découverte. La première étape a donc consisté à opérer un choix parmi les docu-ments les plus pertinents pour répondre à la probléma-tique développée dans la thèse. Intitulée provisoirement « La Tène revisitée. Topo-stratigraphie du site éponyme », celle-ci articulera plusieurs types d’approches pour tenter de restituer des ensembles d’objets cohérents du point de vue typochronologique. Puis, sur la base de ces ensem-bles, nous chercherons à comprendre le fonctionnement de La Tène comme site cultuel et/ou profane, dans l’es-pace et dans le temps. Concrètement, cela consiste à se pencher sur trois questions. La première touche aux rap-prochements stratigraphiques, dont nous présentons en quelques lignes un exemple.
La principale coupe réalisée en 2003 (voir fig. 1 et Honegger ce volume, fig. 1/A) se situe approxima-tivement dans le prolongement nord-ouest et non loin de la coupe C-D de 1910 (fig. 3 et voir Honegger ce volume, fig. 1/B ; Vouga 1912). Les deux relevés, distants d’une dizaine de mètres seulement, montrent les mêmes couches de sable fouillées à près de 100 ans d’intervalle. L’examen de la morphologie des couches confirme qu’en 2003, nous avons observé l’un des replats de la berge de l’ancienne Thielle. Bien que la présence de plusieurs des ces replats (ou méplats) ait été observée par W. Wavre et P. Vouga, la fouille du lit avait été généralement arrêtée à la « palissade » formée par la juxtaposition dense de pieux, plantés presque tout le long de la rive nord de l’ancien cours : selon le schéma suivi jusqu’alors, au-delà de cette « palissade », on se trouvait hors du lit proprement dit.
Fig. 3. Le profil C-D des fouilles de 1910, au point le plus étroit de l’ancien cours de la Thielle. Détail du plan IV, publié dans Vouga 1912 (voir fig. 4).
33
Fig. 4. Les courbes de niveau montrent, à la hauteur du profil C-D, une remontée du fond de l’ancien cours, de part et d’autre de laquelle seraient restés piégés les objets. Vouga 1912, plan IV.
Fig. 5. La Tène, le 2 septembre 1913. Découverte d’un squelette humain accompagné de deux fibules, d’un bracelet en fer, d’un couteau, d’une lance et d’un bouclier en bois. Reconstitution proposée dans l’exposition « Par Toutatis ! La religion des Celtes », Laténium, 2007-2008. Photographie Jacques Roethlisberger.
34
de ces ensembles, dépend en grande partie du récole-ment en cours dans le cadre du projet FNS 11, puisque de nombreuses collections ont été fractionnées et disper-sées à travers le monde.
Résultats préliminaires et perspectives
En résumé, les résultats obtenus en 2003 sont essen-tiels par leur apport à la compréhension de la stratigraphie et de la topographie du site : les dépôts sédimentaires stra-tifiés et datés enrichissent et affinent nos connaissances sur la formation du paysage à l’exutoire du lac ; associés aux datations dendrochronologiques et radiocarbone, ils donnent aux vestiges architecturaux une dimension chro-nologique qui leur faisait défaut jusqu’ici.
Appliqués aux anciennes fouilles et à leur documen-tation, ils éclairent les acquis de nos prédécesseurs d’un jour nouveau : ces résultats permettront de répondre, du moins dans une certaine mesure, aux questions res-tées ouvertes depuis la parution de la monographie de P. Vouga en 1923.
monnaies, par exemple, pourrait mettre en évidence une phase plus tardive de la fréquentation du site et/ou un changement dans le type de culte pratiqué. De la même manière, la présence d’outils doit être analysée tant dans le cadre de la construction et de l’entretien des ponts et des renforts de berges que dans le contexte de dépôts votifs.
Une troisième approche se situe à cheval entre ana-lyse stratigraphique et association d’objets : il s’agit de l’étude par collections ou collectionneurs. L’idée sous-jacente est que chaque « explorateur » de La Tène a tou-ché à une partie spécifique du site : les « pêcheurs » d’an-tiquités auraient « exploité des filons » à des profondeurs limitées, près du Pont Desor ; Alexis Dardel-Thorens n’aurait procédé qu’à des ramassages de surface, le long de la plage au nord-ouest du Pont Vouga ; enfin, seules les fouilles officielles auraient touché aux couches pro-fondes de l’ancien chenal, entre les deux ponts. Ces pré-supposés, véhiculés dès les débuts de la fouille du site, se vérifient-ils à l’examen des collections restituées ? Quel genre d’ensembles forment ces collections ? Que nous disent-ils sur le fonctionnement du site ? Cette démar-che, basée sur la reconstitution aussi fidèle que possible
35
Notes1 Je tiens à remercier Béat Arnold, chef de l’Office et musée d’ar-
chéologie de Neuchâtel, de m’avoir confié ces travaux en 2003, puis l’élaboration des résultats. De même, ma gratitude va à l’ensemble des personnes qui ont participé à la fouille et à l’analyse des données.
2 Les résultats préliminaires ont été présentés lors du colloque de l’AFEAF de 2005, à Bienne (Reginelli 2007) auxquels je renvoie le lec-teur pour de plus amples détails. Les actes présentent par ailleurs tout un « dossier » sur le site de La Tène (p. 343-403). D’autre part, un volume de la série La Tène, un site, un mythe, présentant l’ensemble et le détail des résultats de cette fouille, est en préparation.
3 Le plan présenté ici bénéficie de la découverte récente d’une borne ancienne dans la forêt bordant le site de La Tène, sur la base de laquelle avaient été dressées les cartes de Maurice Borel. Grâce à cette borne, les plans des fouilles de William Wavre et Paul Vouga ont pu être reposi-tionnés environ 1,6 m plus au sud qu’on ne les avait placés jusqu’ici. Je remercie tout particulièrement Philippe Zuppinger de la réalisation et du suivi des cartes et des plans.
4 Ces fouilles, dites officielles, se sont déroulées entre 1907 et 1917. Pour l’histoire des travaux à La Tène, voir Reginelli Servais 2007.
5 Sur l’œuvre et la personnalité de P. Vouga, voir Kaeser 2006 ; pour une ébauche d’explication à ce constat à La Tène, voir Reginelli Servais 2007, p. 128-129.
6 L’étude de la stratigraphie a été réalisée avec l’aide de Judit Becze-Deák, pédologue à l’OMAN. Plus de détails dans Reginelli 2007.
7 La présence de tessons de céramique du premier âge du Fer dans cette couche résulte d’un événement ultérieur : les fragments de vases se sont mêlés aux éléments de la plage préexistante.
8 Il s’agit en particulier de fibules, d’un potin et d’un as de Nîmes (voir note 7 dans Reginelli 2007).
9 Grâce au repositionnement expliqué dans la note 3, le décalage de la pile XII entre les anciens plans et celui de 2003 passe ainsi de 6,50 m (Reginelli 2007) à 4,75 mètres.
10 Elle avait été amorcée par les travaux de Thierry Lejars, qui tra-vaille depuis une dizaine d’années sur la collection La Tène du Musée Schwab, à Bienne (Lejars 2007 ; Lejars and Josset 2007 ; Lejars à paraître).
11 Projet n° 100012-113845 du Fonds national suisse de la recherche scientifique. Requérant principal et direction : Gilbert Kaenel. Co-requérants : Michel Egloff, Béat Arnold, Alain Schnapp.
Bibliographie
Gassmann Patrick 2007 Nouvelle approche concernant les datations dendrochro-
nologiques du site éponyme de La Tène (Marin-Epagnier, Suisse). Annuaire d’archéologie suisse, 90, pp. 75-88.
Kaenel Gilbert et Reginelli Servais Gianna 2008 La Tène a fêté ses 150 ans. Archéologie Suisse, 31/1,
pp. 34-35.
Kaeser Marc-Antoine (dir.) 2006 De la mémoire à l’histoire : l’œuvre de Paul Vouga (1880-
1940). Des fouilles de La Tène au « néolithique lacustre ». Neuchâtel, Service et musée cantonal d’archéologie (Archéologie neuchâteloise, 35), 168 p.
Lejars Thierry 2007 La Tène : les collections du musée Schwab à Bienne
(Canton de Berne). In : Barral P. et al. (dir.), L’âge du Fer dans l’arc jurassien et ses marges. Dépôts, lieux sacrés et territorialité à l’âge du Fer. Actes du 29e colloque interna-tional de l’Association française pour l’étude de l’âge du Fer, Bienne, 5-8 mai 2005. Besançon, Presses universitaires de Franche-Comté, 826, pp. 357-365.
à paraître La collection Schwab. Lausanne, Cahiers d'archéologie romande.
Lejars Thierry et Josset David 2007 La Tène : la collection Schwab. In : La Tène : la recher-
che – les questions – les réponses. La publication sur l’état de la recherche et son histoire. Bienne, Musée Schwab, pp. 34-45.
Reginelli Gianna 2007 La Tène revisitée en 2003 : résultats préliminaires et pers-
pectives. In : Barral P. et al. (dir.), L’âge du Fer dans l’arc jurassien et ses marges. Dépôts, lieux sacrés et territorialité à l’âge du Fer. Actes du 29e colloque international de l’Associa-tion française pour l’étude de l’âge du Fer, Bienne, 5-8 mai 2005. Besançon, Presses universitaires de Franche-Comté, pp. 373-390.
Reginelli Servais Gianna 2007 La Tène, un site, un mythe, 1. Chronique en images (1857-
1923). Neuchâtel, Office et musée cantonal d’archéologie (Archéologie neuchâteloise, 39), 208 p.
Vouga Emile 1885 Les Helvètes à La Tène : notice historique. Neuchâtel,
J. Attinger.
Vouga Paul 1912 La Tène. Quatrième rapport, fouilles de 1910 et 1911.
Musée neuchâtelois, 49, pp. 7-15. 1914 La Tène. Cinquième rapport. Fouilles de 1912 et 1913.
Musée neuchâtelois, nouvelles série, 1, pp. 48-68. 1923 La Tène. Monographie de la station publiée au nom de la
Commission des fouilles de La Tène. Leipzig, Hiersemann.