La structure de Liber honoribus de Saint-Julien de Brioude à la lumière des cartulaires de son...
-
Upload
moscowstate -
Category
Documents
-
view
4 -
download
0
Transcript of La structure de Liber honoribus de Saint-Julien de Brioude à la lumière des cartulaires de son...
1
La structure du Liber de honoribusde Saint-Julien de Brioude à la lumière des cartulaires de son époque
Igor FILIPPOV *
La reconstitution des documents anciens dans leur état primitif ainsi que lareconstitution des fonds d’archives disparus est un défi intellectuel séduisant. C’est aussile devoir de chaque chercheur qui est contraint de travailler avec des copies tardives ou avecdes épaves de la documentation originelle appartenant à l’époque qu’il examine. Cela vautpour n’importe quelle collection des textes, du moins, si l’on ne se limite pas à l’étuded’un fait concret reflété dans un document particulier, mais si l’on s’intéresse aux questionsplus générales d’histoire de la société, de l’économie, de la famille, du droit, des mentalités,etc. Dans ce cas, le recours aux larges groupes ou aux corpus de documents, tels lescartulaires, devient indispensable. Les problèmes liés à l’épuration d’un texte desmodifications tardives et à l’estimation de la représentativité des sources se posent alors avectoute leur force. Un autre problème clef lié à l’étude des cartulaires concerne le degréd’exactitude des copies ainsi confectionnées. Je ne l’aborderai ici qu’en passant, bien qu’ils’agisse du revers de la médaille, ainsi que l’ont montré les recherches récentes 1.
Il est clair aujourd’hui que chaque cartulaire est un échantillon par rapport à la massedes documents qui existait dans les archives correspondantes. Mais la nature de cetéchantillon n’est pas du tout évidente. La question n’est pas abstraite. Pierre Bonnassie,ayant à sa disposition les cartulaires catalans ainsi que la documentation originale qui servitde base à leur composition, a montré que ces deux groupes de textes fournissent deuxtableaux assez différents de la société, notamment en ce qui concerne le type destransactions dominantes : ce sont les donations qui constituent la plupart des chartesincluses dans les cartulaires, tandis que parmi les originaux ce sont les actes d’achat quiprédominent 2. Il est également clair que d’habitude la composition d’un cartulaire est lerésultat du travail de plusieurs personnes, souvent fortement éloignées les unes des autresdans le temps et travaillant dans des circonstances et selon des règles assez différentes. Cesdeux facteurs constituent un obstacle majeur pour l’historien qui cherche à établir l’étatprimitif d’un cartulaire et à comprendre sa corrélation avec la masse des documentsoriginaux dont le cartulaire est un reflet, parfois assez vague.
De ce point de vue, les archives de Brioude sont parmi les plus difficiles à étudier.Premier obstacle : on ne possède aujourd’hui que des copies du Liber de honoribus Sancto
* Université d’État - Lomonossov, Moscou .
1 Dans ce contexte il faut citer en premier lieu deux recueils d’articles : Les Cartulaires. Actes de la Table ronde (Paris, 5-7 décembre 1991) réunis par O. GUYOTJEANNIN, L. MORELLE et M. PARISSE, Paris, 1993 ; Les cartulaires méridionaux,dir. par D. LE BLÉVEC, Actes du colloque de Béziers, 20-21 septembre 2002, Paris, 2006, et deux ouvrages individuels :P. GEARY, Phantoms of Remembrance. Memory and Oblivion at the End of the First Millenium. Princeton, 1994, ch. 3 ;P. CHASTANG, Lire, écrire, transcrire. Le travail des rédacteurs de cartulaires en Bas-Languedoc (XIe-XIIIe siècles), Paris, 2001.
2 P. BONNASSIE, La Catalogne du milieu du Xe à la fin du XIe siècle, Toulouse, 1975-1976, p. 23-25.
Juliano collatis, également connu sous le nom de Grand cartulaire de Brioude,confectionnées à la fin de l’Ancien régime tandis que l’original, que l’on suppose crééautour de 1100, a disparu, probablement pendant la Révolution. La plus importante deces copies, le ms. lat. 9086 de la BnF, date de 1677. Pour aggraver la situation, le manuscritoriginal a été déformé au XVIIe siècle par Jean du Bouchet (certaines pages ont été extraites,d’autres insérées) puis relié de nouveau, avant de servir de matériel pour la copie qui nousest parvenue 3. Deuxième obstacle : on ne dispose plus, sauf exceptionnellement, des actesoriginaux, ni des copies isolées de ces actes. Troisième obstacle : on sait très peu de l’histoiredes archives de Brioude avant le XVIIe siècle et, même pour cette époque, il ne nous resteque des fragments des inventaires anciens des archives de Brioude. Du reste, très peud’érudits avaient accès au chartrier du chapitre avant sa disparition à l’époquerévolutionnaire. Il y a par ailleurs des raisons de penser que ce chartrier a subi des pertessensibles avant l’époque des érudits, notamment pendant l’incendie de 1571.
La présence, dans le présent recueil, de l'article de Jean Berger, qui connaît les archivesmédiévales de Brioude mieux que n’importe qui de nos jours, simplifie beaucoup ma tâche.Ses études de l’histoire infiniment compliquée de ces archives à la fin du XVIIe siècle et desquestions qui y sont liées me libèrent de la nécessité de traiter le problème des altérationsdu texte du Grand cartulaire et de la falsification présumée de certaines de ses chartes à cetteépoque. Mon but est plus restreint et plus abordable pour un chercheur étranger. Jevoudrais montrer certaines possibilités de reconstitution du Grand cartulaire dans sa formeinitiale, offertes par l’analyse comparative des cartulaires médiévaux.
On sait que les cartulaires ont été organisés en fonction de principes très divers. Le plusrépandu était le classement géographique dont on connaît quelques versions. On distinguele groupement des chartes par comtés ou par provinces ecclésiastiques, puis, dans leurcadre, par vicairies ou directement par castra ou villæ ou par paroisses où l’institutionpossédait des terres et des droits 4. Ce cas de groupement se retrouve, à partir du XIe siècle,dans plusieurs abbayes bénédictines du Midi. Le Grand cartulaire de Saint-Victor deMarseille en offre un exemple particulièrement clair mais c’est aussi grosso modo le cas descartulaires d’Aniane, de Conques, de Gellone, de Lérins… Certains cartulaires de cegroupe sont organisés en fonction des domaines sans un classement régulier par comté,diocèse, etc. Parmi les exemples on peut citer les cartulaires de Saint-Cyprien de Poitiers(ca. 1155) 5, de Saint-Sernin de Toulouse (le dernier tiers du XIIe siècle) et de Saint-André-le-Bas de Vienne (ca. 1211 ou un peu plus tard) 6, ainsi que le « cartulaire blanc » de Saint-Denis élaboré au début du XIVe siècle 7. Il est à noter que dans le cadre du dossier consacré
Igor FILIPPOV — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
2
3 Voir : H. DONIOL (éd.), Cartulaire de Brioude (Liber de honoribus sancto Juliano collatis), Clermont, Paris, 1863, p. 1-26 ; A.-M. et M. BAUDOT (éd.), Grand Cartulaire du Chapitre Saint-Julien de Brioude. Essai de restitution, (désormaisabrégé CSJB) Clermont-Ferrand, 1935, introduction, p. VII-XLI, ainsi que : M. J. DEPOIN, « L’expertise de Mabillon.La filiation des La Tour d’Auvergne », dans Mélanges et documents publiés à l’occasion du deuxième centenaire de la mortde Mabillon, Ligugé-Paris, 1908, p. 126-143.
4 L’encadrement géographique et la nomenclature des unités géographiques utilisées dans les cartulaires afin de localiserles objets fonciers qui ont changé de mains ont leur propre histoire et constituent un problème à part. Voir P. CHASTANG,« Du locus au territorium. Quelques remarques sur l'évolution des catégories en usage dans le classement des cartulairesméridionaux du XIIe siècle », Annales du Midi, 2007, t. 119, p. 457-474.
5 Cartulaire de l’abbaye de Saint-Cyprien de Poitiers, publ. par L. RÉDET, Poitiers, 1874.
6 Cartulaire de l’abbaye de Saint-André-le-Bas de Vienne, publ. par C.U.J. CHEVALIER, Lyon, 1869.
7 R. GROSSE, « Remarques sur les cartulaires de Saint-Denis aux XIIIe et XIVe siècles », dans Les cartulaires, Paris, 1993, p. 285.
à un domaine particulier, les chartes du cartulaire toulousain sont classées en fonction dela date 8. La règle pour les cartulaires cisterciens est d’être organisés par granges ; tels sontles cartulaires de Gimont, de Pontigny, de Silvanès, de Valmagne 9. Or, la règle n’est pastoujours rigoureusement respectée ; notamment les premières parties du cartulaired’Obazine (XIIe-XIIIe siècles) et du cartulaire de Bonnevaux (début du XIVe siècle)manifestent des traces distinctes d’organisation chronologique 10. Il y a finalement desrecueils dont les chartes sont classées selon des repères généraux de la géographie physique.Un exemple célèbre est le premier cartulaire du chapitre d’Arles composé à la fin duXIe siècle ; ses chartes sont regroupées en deux parties : concernant les domaines à l’ouestdu Rhône et au nord de la Durance et, réciproquement, les domaines à l’est du Rhône etau sud de la Durance 11. Parfois on constate un classement par pays, au moins pour unepartie des chartes, comme dans le cartulaire de la Sauve Majeure où on rencontre ungroupement distinct des chartes espagnoles et anglaises 12. Or, dans tous ces cas,l’organisation géographique permettait de grouper les notices concernant les mêmesdomaines ou les domaines voisins, ce qui était le plus utile en cas de litiges ou du point devue de la gestion.
Dès le Xe siècle, on trouve aussi des cartulaires dont les chartes sont organisées par ordrechronologique et qui rappellent des chroniques ; parfois, comme dans le cas des cartulaires-chroniques de Saint-Bertin 13, de Saint-Bénigne de Dijon 14 ou de Saint-Arnoul de Metz 15,on a du mal à dire avec certitude s’il s’agit véritablement d’un cartulaire orné des noticeshistoriques ou d’une chronique complémentée par des copies de chartes. Mais il s’agittoutefois d’une exception plutôt rare. Plus souvent on a, dans ce cas, à faire à de vraiscartulaires ayant un minimum de signes explicitement chronographiques (une noticehistorique au début), mais dont les actes sont classés en fonction de leur date. Le cartulairede Saint-Amand dont la partie initiale a été composée entre 1118 et 1123 en offre un bonexemple 16. Un autre exemple est le cartulaire de Flavigny créé vers 1120, peut-être sur labase d’un autre registre, antérieur d’un siècle 17. D’habitude, comme ce fut le cas à Cluny (lesdeux premiers cartulaires, A et B, confectionnés dans la deuxième moitié du XIe siècle) ou àMontier-en-Der dont le premier cartulaire a vu le jour aux alentours de 1127 ou à Vierzon
— — — — — — — — — — — — — — — — — — La structure du Liber de honoribus de Saint-Julien de Brioude
3
8 Cartulaire de l’abbaye de Saint-Sernin de Toulouse (844-1200), publ. par C. DOUAIS, Paris, Toulouse, 1887, p. XVI.
9 Cartulaire de l'abbaye de Gimont, éd. par A. CLERGEAC, Paris-Auch, 1905 ; Cartulaire de l’abbaye de Silvanès, éd. parP.-A. VERLAGUET, Rodez, 1910 ; Premier cartulaire de l’abbaye cistercienne de Pontigny (XIIe-XIIIe siècles), publ. parM. GARRIGUES, Paris, 1981 ; H. BARTHÈS « Le cartulaire de l’abbaye Sainte-Marie de Valmagne », Bulletin de l’Académiedes sciences et lettres de Montpellier, 2005, t. 36, p. 297-316.
10 Le cartulaire de l’abbaye cistercienne d’Obazine (XIIe-XIIIe siècles), publ. par B. BARRIÈRE, Clermont-Ferrand, 1989,p. 33-41 ; Cartulaire de l’abbaye Notre-Dame de Bonnevaux, au diocèse de Vienne, ordre de Cîteaux, publ. parU. CHEVALIER, Grenoble, 1889.
11 F. MAZEL, « Cartulaires cathédraux, réforme de l’Église et aristocratie : l’exemple des cartulaires d’Arles (v. 1093-1095)et d’Apt (v. 1122-1124) », dans Les cartulaires méridionaux, sous la dir. de D. LE BLÉVEC, Paris, 2006, p. 63.
12 Grand cartulaire de la Sauve Majeure, publ. par Ch. HIGOUNET et A. HIGOUNET-NADAL, Bordeaux, 1996.
13 Cartulaire de l’abbaye de Saint-Bertin, publ. par B. GUÉRARD, Paris, 1840.
14 Chronique de l’abbaye de Saint-Bénigne de Dijon, publ. par F. BOUGARD et J. GARNIER, Dijon, 1875.
15 M. GAILLARD, « Le “Petit cartulaire” de Saint-Arnoul de Metz », Bulletin de la Société nationale des Antiquaires deFrance, 2000, p. 124-143.
16 H. PLATELLE, « Le premier cartulaire de l’abbaye de Saint-Amand », Le Moyen Âge, 1956, vol. LXII, p. 301-329.
17 The Cartulary of Flavigny, 717-1113, éd. C.B. BOUCHARD, Cambridge (Mass.), 1991.
au XIIe siècle, c’est plutôt l’abbatiat particulier qui sert de cadre au groupement des chartes,dans lequel les chartes sont néanmoins copiées plus au moins selon la date 18. Normalement,les cartulaires de ce groupe ne sont pas gros : à peu près 60 chartes à Flavigny, à peu près 160à Montier-en-Der… Mais il y a des exceptions, par exemple le cartulaire de Casauriacontenant 970 chartes 19. Il faut ajouter que, par rapport aux cartulaires rangésgéographiquement, ce type a une aire de diffusion relativement limitée. On n’en trouve pasde traces dans la Catalogne, où dominent les cartulaires classés par domaines. Dans le Midifrançais, ce type de cartulaire n’a pas été populaire non plus.
Dans certains cartulaires on rencontre un groupement selon le statut de la personne quia émis le document : le plus souvent on a copié d’abord les bulles des papes, les diplômesroyaux, les chartes des évêques, puis les chartes des princes, puis les documents des autrespersonnes, clercs et laïcs. C’est le cas par exemple du cartulaire de l’abbaye Saint-Léger deSoissons (fin du XIIe siècle) 20, de la première partie du cartulaire de Saint-Pierre-de-Préaux(ca. 1227) 21 et du cartulaire du chapitre de Langres créé vers 1232 22. Ce type de cartulaireétait assez populaire à l’époque. Mais on trouve des éléments de ce classement beaucoupplus tôt, notamment dans le cartulaire d’Aniane, qui commence par la Vita de saint Benoît,les diplômes et les bulles 23, et dans le Grand cartulaire de Saint-Victor au début duquelles scribes ont copié nombre de bulles, diplômes et autres documents les plus importantspour la constitution du temporel monastique. On connaît aussi des cartulaires organisésen fonction du type de document transcrit. De bons exemples en sont offerts par lecartulaire de Saint-Vaast d’Arras commencé en 1170 et constitué de dossiers thématiques(acquisitions, listes des censitaires, documents relatifs aux reliques disputées…) 24, par lecartulaire de Saint-Cyr de Nevers (deuxième moitié du XIIe siècle) où les copies des chartesdes donations sont précédées par les statuts du chapitre, les actes d’élection des chanoines,les documents concernant les repas dus par l’évêque, la comptabilité exigée par leschanoines, le règlement du service des défunts 25 et par le premier Liber feodorum del’évêché de Langres (c. 1270-1280), où les actes d’inféodation sont suivis par les chartesd’achats, d’échanges, de dettes, de conventions, etc. Le Liber viridis, alias le Petit cartulaire
Igor FILIPPOV — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
4
18 M. HILLEBRANDT, « Les cartulaires de l’abbaye de Cluny », Mémoires de la Société pour l’Histoire du Droit et desInstitutions des anciens pays bourguignons, comtois et romands, 1993, fasc. 50, p. 7-18 ; L. MORELLE, « Des moines faceà leur chartrier : étude sur le premier cartulaire de Montier-en-Der (vers 1127) », dans Les Moines du Der 673-1790,éd. D. GUÉNIOT, Langres, 2000, p. 224 sq. ; Le cartulaire de Vierzon, texte édité par G. DEVAILLY, Paris, 1963, p. 21.
19 L. FELLER, « Le cartulaire-chronique de San Clemente a Casauria », dans Les cartulaires, Paris, 1993, p. 261-262.
20 Cartulaire de l’abbaye de Saint-Léger de Soissons, publ. par l’abbé PÉCHEUR, Soissons, 1870.
21 Le Cartulaire de l’abbaye bénédictine de Saint-Pierre-de-Préaux (1024-1227), publ. par D. ROUET, Paris, 2005,p. LXVI-LXVII.
22 Voir H. FLAMMARION, « Une équipe de scribes au travail au XIIIe siècle : Le grand cartulaire du chapitre cathédralde Langres », Archiv für Diplomatik, Schriftgeschichte, Siegel - und Wappenkunde, 1982, Bd 28, S. 271-305.
23 Cartulaire de l’abbaye d’Aniane, éd. par P. ALAUS, L. CASSAN et E. MEYNIAL, Montpellier, 1905, p. 1-132. D’autresexemples fameux sont fournis par le cartulaire de l’église du Saint-Sépulcre de Jérusalem (qui contient en fait très peude chartes admises par de simples particuliers), par le Livre noir de l’église d’Angers, le Cartulaire de Saint-Maurice deVienne, etc.
24 B.-M. TOCK, « Les textes non diplomatiques dans les cartulaires de la province de Reims », dans Les cartulaires,Paris, 1993, p. 46-47.
25 Cartulaire de Saint-Cyr de Nevers, par R. DE LESPINASSE, Nevers-Paris, 1916, p. 6.
26 Voir A.-M. LEMERLE-BAUDOT, S. D’HUART, « Le “Liber Viridis”, petit cartulaire de Brioude », Almanach de Brioude,1967, année 47, p. 9-13.
de Brioude, confectionné à la fin du XIIIe siècle 26 et présenté à notre colloque par Jean Berger est un autre exemple intéressant ; les chartes y sont groupées en cinq parties :privilegia papalia, privilegia regalia, emptiones, compositiones, recognitiones feudorum. Assezsouvent, parallèlement à la composition d’un cartulaire, on créait des recueils à part pourdes bulles (à Saint-Denis, à Cluny, à Saint-Gilles, plus tard à Saint-Victor…), et parfoispour certaines autres catégories de documents 27.
Plus rare est le classement d’après l’office (du doyenné, du chambrier, du cellérier, del’infirmier, de l’aumônier, etc.), dont la fonction était l’objectif stipulé de telle ou telledonation ou d’une réorganisation interne des ressources de l’établissement. Il n’était pasexceptionnel que les chartes destinées à soutenir le fonctionnement d’un officeconstituassent un cartulaire à part, comme c’était le cas à Saint-Denis 28. Mais on connaîtaussi des cartulaires cumulatifs divisés en sections correspondant à des offices particuliers.Le Grand cartulaire de l’abbaye de Saint-Germain d’Auxerre (1266-1271) en aurait puêtre un exemple classique si le groupement des chartes transcrites n’y était pas brouillé parl’usage d’autres styles de classement : chronologique, topographique et typologique 29. Eneffet, assez souvent, on constate une combinaison de principes différents dont l’unnéanmoins prédomine ; les premiers cartulaires de Cluny en sont de bons exemples. Ilfaut admettre que les cartulaires organisés en fonction du type de document, de lacondition sociale du bienfaiteur ou de l’office particulier qui a profité du bienfait sontl’œuvre plutôt du bas Moyen Âge tandis que les cartulaires plus anciens des Xe, XIe, XIIe
et même du début du XIIIe siècle (ainsi que plusieurs cartulaires plus tardifs) sontcaractérisés surtout par une structure géographique ou chronologique.
Assez souvent la structure d’un cartulaire n’est pas du tout évidente. Parfois c’est lerésultat d’un changement de la méthode employée pour transcrire les actes, changementcausé par le remplacement du scribe et par l’altération du plan de la transcription engénéral. C’est le cas, par exemple, du cartulaire du chapitre d’Agde dont la première partiecomposée entre 1187 et 1215 suit, bien que peu rigoureusement, un ordre géographique,tandis que la deuxième partie qui date des années 1227-1236 « apparaît comme unensemble de dossiers relatifs à des affaires litigieuses » 30. Puisque d’habitude cette altérationse manifeste dans les cahiers finals du cartulaire, sa détection ne présente pas un problèmeinsurmontable. Parfois on hésite à établir la structure d’un cartulaire à cause des insertionsdes chartes copiées postérieurement à l’exécution du texte primitif ; il s’agit soit de vielleschartes qu’on avait omises pour quelque raison, soit de chartes nouvelles qui sont entréesaux archives particulières après la constitution du noyau du cartulaire. Ces insertionsdéguisent l’organisation initiale du cartulaire et celui qui travaille avec une édition dequalité médiocre, indifférente à l’état du manuscrit et à sa paléographie, est souventstupéfait par le désordre apparent que présente la séquence des chartes transcrites. Sans
— — — — — — — — — — — — — — — — — — La structure du Liber de honoribus de Saint-Julien de Brioude
5
27 Par exemple, à Farfa, le moine Gregorio di Cattino a composé vers 1100 une chronique de son monastère, uncartulaire (« Liber floriger chartarum cenobii Farfensis ») et un recueil à part - « Liber Largitorius » composé des chartesfixant l’octroi des bénéfices et les autres aliénations des biens monastiques. Voir : Liber Largitorius vel Notarius monasteriipharphensis, éd. G. ZUCHETTI, vol. 1-2. Roma, 1913.
28 R. Grosse, « Remarques sur les cartulaires de Saint-Denis… », op. cit., p. 287-288.
29 N. DEFLOU-LECA, « L’élaboration d’un cartulaire au XIIIe siècle : le cas de Saint-Germain d’Auxerre », Revue Mabillon,1997, n. s., t. 8 (= 69), p. 183-207.
30 Cartulaire du chapitre cathédral Saint-Étienne d’Agde, éd. par R. FOREVILLE. Paris, 1995, p. 41.
surprise, on se trouve surtout dans une situation difficile quand on ne dispose que d’unecopie tardive du cartulaire, exécutée sans prendre en compte ses particularitéscodicologiques et paléographiques (changement de mains, textes transcrits à la marge d’unefeuille, etc.), qui pourraient aider à comprendre l’histoire du manuscrit. Hélas, cettesituation n’est pas rare. En effet, on est assez souvent condamné à juger d’un cartulaire parune copie de l’époque moderne. C’est le cas par exemple des cartulaires des chapitresd’Agde 31 et de Béziers 32 où des églises d’Apt et de Mâcon 33. Leur organisation estcaractérisée par les spécialistes comme manquant d’un ordre clair, même si on peutdistinguer des indices d’un classement par domaine, assez perceptibles dans le cas ducartulaire de Mâcon. C’est aussi le cas du Liber de honoribus de Brioude dont la structure,en apparence, ne ressemble à aucun des classements exposés plus haut et qui donnel’impression d’un véritable chaos.
En cas d’absence ou de manque criant de documentation supplémentaire provenant desmêmes archives que le cartulaire (le cas le plus fréquent), c’est l'analyse comparative descartulaires qui peut aider à éclaircir la situation. Certes, étant donné la variété typologiqueconsidérable des cartulaires médiévaux, la comparaison du cartulaire de Brioude avecn’importe quel cartulaire mieux compréhensible est incapable, par elle-même, de nousfournir une réponse immédiate concernant sa structure initiale. Mais elle peut - paranalogie - éclaircir le processus du déguisement progressif de cette structure et ainsi donnerdes pistes précieuses.
Pendant plusieurs années j’ai travaillé sur l’histoire des archives de Saint-Victor deMarseille et de ses deux cartulaires - du Grand cartulaire créé entre 1079 et 1097 et du Petitcartulaire, composé au milieu du XIIIe siècle. La proximité des dates avec celles del’achèvement des cartulaires de Brioude est symbolique et sans doute pas tout à faitfortuite : on sait que la création des cartulaires, comme des autres instruments de la gestionecclésiastique, est souvent le reflet des idées et des besoins communs de l’Église. Il y a defortes raisons de penser que l’apparition d’un nombre important de cartulaires à la fin duXIe siècle est étroitement liée à la réforme grégorienne. On peut donc espérer que lacomparaison du cartulaire énigmatique de Brioude avec celui de Saint-Victor, qu’on estbien mieux placé pour examiner, ne serait pas inutile pour une meilleure compréhensiondu premier. Bien sûr, il ne faut pas se limiter à un seul modèle de référence : la comparaisonavec les cartulaires des autres institutions, surtout des mêmes époques, région et types,serait également instructive - surtout si la constitution de ces cartulaires est plus claire etcompréhensible. Malheureusement certaines comparaisons, y compris les plus logiquesdans ce cas-là, par exemple avec le Cartulaire de Sauxillanges 34, ne peuvent nous donnerque des renseignements limités car ce cartulaire nous est parvenu, lui aussi, sous la formede copies du XVIIe siècle (celles de Baluze) et du XVIIIe siècle, quoique sans une préhistoireaussi décourageante que dans le cas du ms. lat. 9086. De ce côté, le Grand cartulaire deSaint-Victor qui nous est accessible dans sa forme initiale et accompagné par une quantité
Igor FILIPPOV — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
6
31 Ibidem, p. 31-43 ; P. Chastang, Lire, écrire, transcrire… op. cit., p. 272-420.
32 Cartulaire de Béziers (Livre noir), publ. par J. ROUQUETTE. Montpellier, 2009 (réédition stéréotype du livre publié en1918-1922, mais fournit une “présentation” utile d’H. Barthès) ; P. Chastang, Lire, écrire, transcrire… op. cit., p. 34-38.
33 Cartulaire de Saint-Vincent de Mâcon, connu sous le nom de “Livre enchaîné”, publ. par M.-C. RAGUT, Mâcon,1864 ; F. Mazel, Cartulaires cathédraux… op. cit., p. 71-80.
34 Cartulaire de Sauxillanges, publ. par H. DONIOL, Clermont-Ferrand - Paris, 1864.
considérable d’actes originaux 35, ainsi que d’inventaires anciens et de nombreuses citationsd’autres actes, déjà disparus, par les historiens du XVIIe et du XVIIIe siècle, offre beaucoupplus de possibilités cognitives - une situation qu’on ne trouve en France que rarement. Cesont ces possibilités de recherche presque exceptionnelles qui ont déterminé, il y a 30 ans,mon choix de Saint-Victor pour un case study de l’histoire des archives médiévales 36. Pourautant que je sache, Monique Zerner qui a commencé ses recherches consacrées auxcartulaires victorins dans les mêmes années, sans rien connaître de mes études ni de monexistence, a été guidée par des considérations semblables 37. Ses articles sur ce sujet sont bienmieux faits que le mien, notamment parce qu’elle a travaillé avec les manuscrits des textesqui - malgré tous mes efforts - ne m’étaient pas accessibles à cette époque. Je n’ai pu doncanalyser moi-même l’écriture et le travail des scribes particuliers, ni la composition descahiers constituant le cartulaire ; en conséquence certains détails importants m’ontéchappé. Or, en dépit des conditions différentes du travail et à cause des objectifs différentsde nos enquêtes respectives (pour ma part, j’étais intéressé en premier lieu par la corrélationentre le cartulaire et la masse des actes originaux), nous sommes arrivés, dans l’essentiel, àdes conclusions assez proches, et c’est une simple constatation d’affirmer que mon articlea été publié cinq ans plus tôt. Je profite de cette occasion pour remercier Mme Zerner dem’avoir très aimablement aidé dans mes recherches ultérieures.
Le Grand cartulaire de Saint-Victor est un codex en 188 feuilles in-folio (plus tard2 autres feuilles de moindre taille ont été cousues) ; 736 chartes y étaient copiées, ou unpeu plus car 2-3 feuilles sont perdues. Le cartulaire s’ouvrait par les documents les plusimportants : les bulles, les diplômes, les titres de donation des comtes de Provence, desvicomtes et des évêques de Marseille, d’autres grands seigneurs qui ont constitué la basedu patrimoine du monastère. Suivent les autres documents groupés selon des diocèses età l’intérieur du diocèse - selon les paroisses. À en juger par l’écriture, du moins au début,le travail a été exécuté par plusieurs équipes de scribes, dont chacune se concentrait sur undossier (ou sur deux ou trois dossiers) consacré aux chartes provenant d’un certain diocèse.Parfois le copiste, en commençant le travail avec les chartes du coffre qui lui était confié,en signalait le fait. Ainsi nous lisons au début du folio 113 : Cartas de episcopatuForojuliense 38 ; puis suivent les 117 chartes (nos 486-602, d’après le numérotage deséditeurs) qui concernent les droits et les possessions de l’abbaye dans l’évêché de Fréjus.
— — — — — — — — — — — — — — — — — — La structure du Liber de honoribus de Saint-Julien de Brioude
7
35 Un cas très rare, pas seulement en France mais aussi en Italie, pour laquelle on peut citer l’exemple de Montecassino.Voir P. CHASTANG, L. FELLER, J.-M. MARTIN, « Autour de l’édition du Registrum Petri Diaconi. Problèmes de documentationcassinésienne : chartes, rouleaux, registres », Mélanges de l’École Française de Rome, 2009, 121/1, p. 99-135. D’habitude lacréation d’un cartulaire a condamné les chartes originales, au moins celles des personnes privées, à la disparition.
36 Les résultats ne sont publiés qu’en russe : I.S. FILIPPOV, « Les Archives de l’abbaye de Saint-Victor de Marseillependant le haut Moyen Âge. Un essai de reconstruction », Sredniye Veka [= Le Moyen Âge], 1988, vol. 51, p. 201-221; idem, La France méditerranéenne dans le haut Moyen Âge. Le problème de la formation du féodalisme, Moscou, 2000,p. 94-135. Une traduction française de l’article de 1988 est accessible aux AD Bouches-du-Rhône.
37 M. ZERNER, « L’élaboration du grand cartulaire de Saint-Victor de Marseille », dans Les Cartulaires. Paris, 1993,p. 217-246. Plus tard, elle a publié trois autres articles sur ce sujet : « Cartulaire et historiographie à l’époque grégorienne :le cas de Saint-Victor de Marseille », Provence historique, 1999, t. XLIX, p. 523-539 ; « L'abbaye de Saint-Victor deMarseille et ses cartulaires : retour aux manuscrits », dans Les cartulaires méridionaux, Paris, 2006, p. 163-216 ; « LeGrand cartulaire de Saint-Victor de Marseille : comparaison avec Cluny, crise grégorienne et pratique d’écriture » dansSaint-Victor de Marseille. Études archéologiques et historiques. Actes du colloque Saint-Victor, Marseille, 18-20 novembre2004, M. Fixot et J.-P. Pelletier (éd.), Turnhout, 2009, p. 295-322.
38 Cartulaire de l’abbaye de Saint-Victor de Marseille, (désormais abrégé CSVM) publ. par B. GUÉRARD, L. DELISLE,J. MARION, Vol. 1-2. Paris, 1857 (puis - CSVM), vol. 1, p. 490.
On observait cet ordre régulièrement, les dérogations sont plutôt apparentes, dues à lafixation par une charte d’une transmission de biens appartenant simultanément à deuxdiocèses ou plus (à cause de quoi son attribution à tel ou tel diocèse était assez aléatoire) 39
ou aux changements des limites des diocèses.Les rédacteurs partaient du principe que le cartulaire serait complété par les copies de
nouveaux documents. C'est pour cela qu'ils avaient laissé, particulièrement à la fin ducodex, une série de folios vierges, et que certains n'étaient que partiellement remplis. Audébut, les copistes essayaient d'observer les vieilles règles et, si possible, recopiaient lesnouveaux documents à côté de ceux qui leur étaient logiquement liés. Ainsi, une chartede 1100, concernant l’une des acquisitions de l'abbaye sur le territoire du castrum de Six-Fours situé dans le diocèse de Toulon 40, fut placée dans la partie inférieure non utilisée dufolio 104, ce qui était cohérent, puisqu'à la feuille 105 commençait la rubrique Deepiscopatu Tolonense 41 et qu’immédiatement après se trouvaient plusieurs chartes plusanciennes concernant Six-Fours. Pour éviter la séparation de documents géographiquementliés, il est arrivé que l'on copiât un nouveau document dans les marges du codex 42. Maisdans l'ensemble, et au fur et à mesure que la place libre diminuait, on en vint à recopierles nouveaux textes n'importe où, sans se soucier de l'organisation générale. Il en résultaqu'une charte toulonnaise du XIe siècle fut insérée dans l'ensemble des chartes du diocèsed'Aix 43, et, qu’au tout début du cartulaire, devant les bulles papales et les diplômes, ontrouve trois chartes ordinaires de particuliers 44. On continuait à faire des ajouts jusqu’à lacomposition, au milieu du XIIIe siècle, du Petit cartulaire. À ce moment, la quantité dechartes dans le Grand cartulaire a atteint 816 ; par la suite une seule charte a été ajoutée 45.
L’étude des archives victorines permet également d’aborder le problème de la corrélationentre la documentation transcrite et non transcrite dans ses cartulaires.
On sait qu’en classifiant le matériel des actes selon tel ou tel principe, les créateurs descartulaires y ont reproduit, en règle générale, la structure des archives elles-mêmes 46. À Saint-Victor c’était le principe géographique, le plus utile du point de vue de la gestionseigneuriale, qui dominait. Le cadre de groupement a été choisi selon le nombre depossessions dans une région particulière reflétée de façon assez exacte dans la quantité dela documentation relative. Ici un classement par diocèse était de règle, pourtant les fondsdes quelques diocèses voisins n’étaient pas différenciés. À en juger par le cartulaire,
Igor FILIPPOV — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
8
39 Par exemple, CSVM, 109 : les biens transmis se trouvent dans les diocèses d’Arles et d’Aix.
40 CSVM, n° 446.
41 CSVM, vol. 1, p. 452.
42 CSVM, n° 79.
43 CSVM, n° 386.
44 CSVM, n° 2, 3, 4.
45 CSVM, n° 700 (a. 1318).
46 Voir D. WALKER, « The Organisation of Material in Medieval Cartularies », dans The Study of Medieval Records. Essaysin Honour of Kathleen Major, Oxford, 1971, p. 139-143 ; G. DECLERCQ, « Originals and cartularies ; the organisationof archival memory : ninth-eleventh centuries », dans Charters and the Use of the Written Word in Medieval Society, Éd.K. HEIDECKER, Turnhout, 2000, p. 147-70 ; C. B. BOUCHARD, « Monastic Cartularies : Organizing Eternity », dansCharters, Cartularies and Archives : the Preservation and Transmission of Documents in the Medieval West, éd. A. J. KOSTO
and A. WINROTH, Toronto, 2002, p. 22-32.
on conservait ensemble les chartes provenant d’Arles et d’Avignon 47, d’Apt et deCavaillon 48, des diocèses maritimes de l’archevêché d’Embrun : Nice, Antibes et Vence 49.Ce fait était probablement lié au nombre relativement peu considérable des documentsissus de ces diocèses. En revanche, on est informé - même si cette information vient desinventaires tardifs et des ouvrages des érudits des XVIIe-XVIIIe siècles - que ladocumentation conservée dans certains coffres “diocésains” a été très nombreuse 50. À cetteépoque, il y avait probablement des coffrets spéciaux pour les bulles des papes et lesdiplômes royaux, mais il n’y a pas de preuves que vers 1100 la situation était la même.
Malgré cet ordre assez transparent, un nombre considérable des chartes victorines nesont pas entrés dans le Grand cartulaire. La comparaison du cartulaire dans son étatd’origine, d’une part, avec l’ensemble des chartes d’avant 1097 qui y ont été inscrites auxXIIe-XIIIe siècles (20 chartes 51), celles conservées dans le corps du Petit cartulaire (27chartes 52), dans l’original ou dans des copies isolées (près de 200 chartes qui n’ont pasleurs analogues dans le Grand cartulaire), ainsi que celles connues seulement grâce à despublications et références des historiens de l’Ancien Régime, d’autre part, nous permet detirer les conclusions suivantes.
En premier lieu, presque toutes les chartes non provençales sont restées hors du Grandcartulaire, comme il en était au moment de sa composition. Les trois chartes des diocèsesde Nîmes et d’Uzès, situés sur la rive droite du Rhône, immiscées parmi les documentsd’Arles et d’Avignon, constituent la seule exception 53. Naturellement les chartesprovençales prédominaient parce que la plupart des possessions du monastère se trouvaienten Provence. Mais à la fin du XIe siècle Saint-Victor possédait de nombreux biens enLanguedoc, en Catalogne, en Sardaigne, ainsi qu’en Aragon, Castille, Gascogne, Guyenneet Dauphiné. Une partie des chartes prouvant les droits de l’abbaye sur ces biens a été aubout du compte incorporée dans le Grand cartulaire, mais le projet initial des copistes nele prévoyait pas. La base du temporel victorin hors de Provence était formée par les prieurésdépendants, par l’intermédiaire desquels étaient évidemment administrées les autresacquisitions qui, dans ces pays éloignés, étaient d’habitude hétéroclites et assez aléatoires.Il est possible qu’on ait voulu grouper la documentation de provenance non provençale,en conformité au schéma d’aménagement de ces possessions, et l’inscrire dans quelquesmini-cartulaires, correspondant au nombre des prieurés. En tout cas, on connaît un telcartulaire en rouleau où sont réunies 9 chartes liées d’une manière ou d’une autre aumonastère roussillonnais de Sant-Miguel-del-Fai 54. Mais il semble que ce plan n’a étéréalisé que partiellement. Le fait que le Petit cartulaire se compose, dans sa majeure partie,
— — — — — — — — — — — — — — — — — — La structure du Liber de honoribus de Saint-Julien de Brioude
9
47 CSVM, n° 151-220.
48 CSVM, n° 425-442.
49 CSVM, n° 787-801.
50 L.-A. RUFFI, Histoire de la ville de Marseille, Marseille, 1696, t. 1, p. 257 : Archiv. de S. Victor N 927 ; GalliaChristiana, Paris, 1715, t. 1. Instrumenta, p. 129 : « ex armario notato dioecesis Massiliensis, rotulo 981 ».
51 CSVM, n° 1, 2, 3, 4, 79, 150, 221, 222, 386, 686, 690, 697, 699, 701, 722, 733, 802, 812, 813, 815, 817.
52 CSVM, n° 818-821, 824-829, 832-837, 839-843, 859, 860, 919, 920, 1006, 1010.
53 CSVM, n° 168 (a. 1064-1076), 193 (XIe siècle), 198 (a. 1010).
54 P. AMARGIER, Chartes inédites (XIe siècle) du fonds de Saint-Victor de Marseille, thèse, Aix, 1967, fasc. 4-7, p. 14. Voyezaussi : A. PLADEVALL, « Sant-Miguel-del-Fai, prieuré victorin catalan », Provence historique, 1966, t. 16, p. 327-360.
de chartes prouvant la légitimité des prétentions de l’abbaye marseillaise sur les monastères“cadets”, par excellence non provençaux, l’aurait indiqué 55.
Deuxièmement, les auteurs du Grand cartulaire se sont montrés très sélectifs dans latranscription des documents de la chancellerie des papes. Initialement, seules 5 bulles ysont entrées 56, bien qu’au moins 13 autres se soient trouvées dans les archives dumonastère. À l’exception de la bulle particulièrement précieuse de Léon X, qui soustrayaitl’abbaye au contrôle des évêques de Marseille et la soumettait immédiatement au Saint-Siège 57, et de l’acte faux concernant la consécration de l’église majeure du monastère parBenoît IX 58, les scribes ont copié seulement les plus anciennes bulles (début du XIe siècle)parmi celles qui étaient disponibles et qui confirmaient les privilèges de l’abbaye, ainsi queses droits fonciers et qui en partie compensaient la perte d’un nombre de chartes originalesantérieures. Ce détail éclaire bien la nature seigneuriale de la documentation reflétée dansle cartulaire. On peut supposer qu’on voulait copier les actes et les lettres des papes dansun code spécial (bullarium) mais il semble que ce projet ait été réalisé seulement auXIVe siècle 59. Pour des raisons semblables on était réticent, au début du travail, à transcrireles confirmations épiscopales qui, elles aussi, ne concernaient pas des domaines ou revenusparticuliers 60.
Tertio, les copistes négligeaient quelques documents qui avaient perdu aux yeux desmoines leur importance pratique. Tout d’abord on peut remarquer qu’on trouve, dans lecartulaire, très peu de chartes composées avant la restauration de l’abbaye en 965-977.Certes, les événements bouleversants de l’époque antérieure ne favorisaient ni la création,ni la conservation des chartes. De plus, nombre d’entre elles ont probablement disparuavant la composition du Grand cartulaire. Cela dit, il faut admettre que les auteurs necopiaient pas toutes les chartes des VIIIe-Xe siècles à leur disposition. Ainsi ont-ils laissé sansattention la charte de 924 qui éclairait les opérations d’échange de l’église de Marseilledans le diocèse d’Uzès 61 - probablement parce que les biens dont il s’agissait étaient versla fin du XIe siècle perdus et l’abbaye ne cherchait plus à les recouvrer. L’incorporationdans le cartulaire des chartes isolées de l’époque carolingienne s’explique apparemmentpar le fait que les transpositions de la propriété foncière qu’elles fixaient restaient valables,surtout en cas de litige 62. On peut supposer que la valeur pratique de nombre des chartesanciennes est tombée après l’apparition dans les archives victorines des nouvelles chartesconcernant les mêmes possessions - il est connu que sous le titre de dons on confirmait
Igor FILIPPOV — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
10
55 Le cartulaire plus tardif assez souvent reproduit, dans les grandes lignes, le cartulaire plus précoce. De ce point devue le Petit Cartulaire de Saint-Victor de Marseille n’est pas typique ; seulement 13 de ses documents ont des analogiesavec le Grand cartulaire : 5, 6, 7, 31, 32, 73, 150, 221, 222, 483, 484, 785, 809.
56 CSVM, n° 5, 6, 7, 13, 14. Puis on a ajouté 15 autres bulles datées du XIIe siècle : CSVM, n° 636-644, 736, 808-811, 814.
57 CSVM, n° 7 (a. 1050).
58 CSVM, n° 14 (a. 1040). Voir : E.-H. DUPRAT, « La charte de 1040 relative à la consécration de l’église Saint-Victorà Marseille est-elle authentique ? », Mémoires de l’Institut historique de Provence, 1947, t. 22, p. 69-85.
59 A. VILLARD, M. VILLARD, Les fonds des Archives départementales des Bouches-du-Rhône, Marseille, 1937, p. 71.
60 M. Zerner, L’élaboration du grand cartulaire de Saint-Victor de Marseille, op. cit., p. 232-234.
61 CSVM, n° 1040 ; Gallia Christiana, t. 1, col. 642. D’ailleurs, il faut tenir compte du fait qu’il s’agit d’une chartelanguedocienne.
62 CSVM, n° 27 (ca. 1020) : au cours du débat judiciaire figure une charte de 840 (CSVM, n° 28). Comparez aussile n° 737 (a. 1048) et le n° 31 (a. 780).
parfois les donations des prédécesseurs 63. Pour les mêmes raisons les auteurs évitaient decopier les documents reflétant les cas d’aliénations de biens monastiques - fût-ce d’aprèsle contrat de bénéfice, de précaire ou de complant 64. Également, les copistes n’ont pasinséré dans le cartulaire les témoignages documentaires des litiges perdus et les actes dereconnaissance, de la part de Saint-Victor, de l’indépendance des autres monastères, parexemple de Psalmodi 65, ou de leur soumission à d’autres établissements religieux. Ainsi,ont-ils ignoré une charte de l’archevêque Léger de Vienne (1067) par laquelle, suite audécret du concile de Vienne, il annulait sa propre décision prise trente ans plus tôt desoumettre le monastère Saint-Ferréol de Vienne à l’abbaye marseillaise (qui évidemmenta négligé ses obligations vis-à-vis de l’établissement viennois) et l’a placé sous le contrôledu chapitre de Saint-Julien. Sans surprise, on la trouve dans le Grand cartulaire de Brioude66, mais il n’y en a aucune trace dans le Grand cartulaire de Saint-Victor ni dans ses archives.Il est peu probable qu’un exemplaire de cette charte n’ait pas existé à Saint-Victor, où ona conservé avec soin les originaux des deux chartes données en 1036 et en 1037 en safaveur par Léger et devenues obsolètes après 1067 67. Ce cas est particulièrement instructifcar, selon la charte de 1067, le “privilège”, c’est-à-dire les documents de 1036-1037 quel’abbé victorin Durand avait apporté au concile de Vienne, avaient été pris par le cardinalÉtienne alors présent et publiquement déchirés en petits morceaux et déclarés invalides 68.Évidemment, les victorins s’en procuraient des copies qu’ils gardaient soigneusement -juste au cas où… D’un autre côté, il faut noter que c’est la seule charte de ce type dans lecartulaire de Brioude. Par exemple on a laissé en dehors du cartulaire la charte de 1070concernant la soumission au chapitre du monastère de Pébrac qu’on connaît par lesarchives de ce dernier 69.
Des indications d’une autre nature renforcent l’impression que les victorins ont évité desurcharger le cartulaire par des informations inutiles. À la différence des moines de Clunyet de certains autres confrères 70, les moines marseillais copiaient les documents assezexactement et entièrement. Quand on peut comparer la copie avec l’original on ne relève,la plupart du temps, que des variantes peu considérables : un changement d’orthographe,une lacune ou l’addition d’un mot, très rarement d’une phrase 71. C’est pourquoi il faut
— — — — — — — — — — — — — — — — — — La structure du Liber de honoribus de Saint-Julien de Brioude
11
63 Cf. CSVM, n° 533, 234 et, conformément, P. Amargier, Chartes inédites… op. cit., n° 16, 22.
64 La seule exception : CSVM, n° 163 (a. 817).
65 P. Amargier, Chartes inédites… op. cit., n° 98 (a. 1096) : Saint-Victor de Marseille reconnaît l’indépendance del’abbaye de Psalmodi. Un autre exemplaire se trouvait dans les archives victorines encore au XVIIIe siècle. Voir :E. MARTÈNE, U. DURAND, Veterum scriptorum et monumentorum amplissima collectio, Paris, 1724, t. 1, col. 558.
66 CSJB, n° 238. Étude : L. GRIMALDI, Le Viennois du monde carolingien au début des temps féodaux (fin du IXe-XIe siècle),évolution institutionnelle et sociale, Thèse nouveau régime, Université de Clermont-Ferrand, 2002, t. 2, p. 483, 504.
67 AD. Bouches-du-Rhône, 1 H 15, 64 (a. 1036) et 1 H 17, 73 (a. 1037). Publications : E. Martène, U. Durand,Veterum scriptorum… op. cit., Paris, 1724, t. 1, col. 402-403, 404-405 ; P. Amargier, Chartes inédites… op. cit., n° 9 et 10.
68 CSJB, n° 238 : « privilegium sane quod praedictus abbas Durandus manu tenebat a cardinali susceptum et particulatimdisruptum est, omnibus videntibus et laudantibus ; haec ideo praelibavimus ut deinceps omnis contentio a quocumque exciteturomnimodo sapiatur, et privilegium quod tantorum virorum authoritate conficetur inconvulsum permaneat… »
69 Cartularium sive terrarium Piperacensis monasterii ordinis canonicorum sancti Augustini ex manuscripto et originalicodice, éd. par J.-B. PAYRARD, Le Puy-en-Velay, 1875, IV.
70 Voir : A. BRUEL, « Note sur la transcription des actes antérieures au XIIe siècle », Bibliothèque de l’École des Chartes,1875, t. 36, p. 447-456. Cf. les articles déjà cités de L. Morelle et de M. Hillebrandt.
71 Cf. E. Martène, U. Durand, Veterum scriptorum… op. cit., t. 1, col. 371-373, 400-402, 411-412, 473-475, 514-516et, conformément, CSVM, n° 486, 101, 691, 817, 150 ; P. Amargier, Chartes inédites… op. cit., 7 et CSVM, n° 555.
souligner que dans les chartes d’achat les copistes manquaient parfois de mentionner le prix(des motifs idéologiques pouvaient jouer un rôle certain, notamment le désir de présenterune transaction banale comme un don pieux) 72 ou, dans les chartes d’échange, ladescription des possessions aliénées 73.
Quarto, on n’avait pas trouvé de place dans le Grand cartulaire pour des chartes des“tierces personnes” concernant la “préhistoire” des biens acquis par l’abbaye. Il faut tenircompte du fait que dans l’Europe romane, on a conservé dans l'ensemble, la traditionremontant à l'Antiquité de l'acte juridique écrit, tradition qui exige l'enregistrement parun document de la plus insignifiante transaction portant sur une terre et des opérationsimportantes portant sur les biens meubles, la rédaction du document au minimum entrois exemplaires, et le respect des archives. Durant le haut Moyen Âge, en Italie, et dansune grande partie de la France et de l'Espagne, l'enregistrement écrit des transactions entrelaïcs (dans la curie de la civitas, au tribunal du comte ou de l'évêque) était un phénomènefréquent. De nombreux laïcs avaient leurs propres archives parfois assez importantes 74.Dans certaines régions d'Italie, le formulaire d'une charte de donation, d'achat oud'échange, comportait un point prévoyant la transmission, à l'acquéreur d'une terre, detous les actes antérieurs la concernant 75. En général, toute traditio entrant dans les archivesde cette partie de l'Europe, était suivie d’une série documentaire plus ou moinsconsidérable. Dans certaines archives françaises, notamment à Saint-André-le-Bas deVienne 76, à Saint-Sernin de Toulouse 77 ou à Saint-Sauveur de Redon, on a choisi de copier,au moins en partie, cette documentation supplémentaire dans le cartulaire ; il s’agit surtoutdes actes obtenus avant la fondation du monastère en question, qui sont entrés dans sesfonds en tant que preuves documentaires des droits du contractant sur les terres et lesrevenus aliénés en sa faveur 78. Mais ce n’était nullement la norme ! À Saint-Victor, lescartularistes ont totalement négligé cette espèce de documentation (les chartes des laïques,en faveur des monastères et des églises dépendants de l’abbaye marseillaise, ne doivent pasbien entendu, dans ce cas-là, être prises en considération). En définitive, seulementquelques documents originaux de ce type y sont préservés 79. Leur faible nombre ne doitpas nous étonner car il s'agit de documents conservés non seulement par hasard, maiscontre toute logique, car, n'étant pas destinés à entrer dans un cartulaire, ils étaient voués,en toute probabilité, au néant.
Quinto, au minimum quelques dizaines d’ordinaires traditiones provençales ne sont pasentrées dans le cartulaire, y compris celles de la fin du XIe siècle. Leur mauvais état pouvait
Igor FILIPPOV — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
12
72 Par exemple : CSVM, n° 502 (a. 1054).
73 Par exemple : CSVM, n° 187 (a. 1021).
74 Pierre Bonnassie a pu mettre en valeur, dans les archives du chapitre de Barcelone, près d'une centaine de chartes(pour l'essentiel pas les traditiones) qui éclairent les transactions d'une famille catalane de propriétaires terriens moyens :P. BONNASSIE, « Une famille de la campagne barcelonnaise et ses activités économiques aux alentours de l’an Mil »,Annales du Midi, 1964, t. 76, p. 261-303.
75 E. CASANOVA, Archivistica, Siena, 1928, p. 314.
76 Cartulaire de l’abbaye de Saint-André-le-Bas de Vienne, p. XXII.
77 Cartulaire de l’abbaye Saint-Sernin de Toulouse… op. cit., p. XV-XVI.
78 Cartulaire de l’abbaye de Redon en Bretagne, publ. par A. DE COURSON. Paris, 1863. Cf. W. DAVIES, « TheComposition of the Redon Cartulary », dans Francia, 1990, Bd. 17/1, S. 69-90.
79 Par exemple : P. Amargier, Chartes inédites… op. cit., n° 1 (a. 1005), 3 (a. 1008).
en être la cause 80, quoiqu’il eût semblé conséquent de copier en premier lieu justement leschartes vétustes ! On n’exclut pas aussi qu’on ne les ait pas trouvées à temps. Peut-être lechoix des copistes était-il fait sous l’influence de quelques particularités relatives au contenudes chartes qui, en règle générale, nous échappent 81.
Il est bien sûr impossible d’apprécier exactement la proportion relative entre ladocumentation incorporée et celle non incorporée dans le Grand cartulaire, mais il y ades raisons de penser que la dernière prédominait. Il est probable qu’elle ait absorbé unepartie considérable des traditiones faites en faveur de Saint-Victor de Marseille, en toutcas des traditiones provençales depuis la fin du Xe siècle. Les autres documents, surtoutceux qui fixaient les aliénations de toutes sortes de la part de l’abbaye ainsi que les chartesdes “tierces personnes”, n’étaient presque pas reflétés dans le cartulaire et dans leurmajorité ont péri.
En étudiant le Grand cartulaire de Saint-Julien de Brioude, l’historien ne peut s’armer dela même méthode pour ses recherches, parce qu’il ne dispose pas de la plupart des moyensaccessibles à l’historien de l’abbaye victorine. Or, certains aspects de cette méthode peuventnéanmoins lui être utiles. Je rappelle que c’est notamment parce que les complémentstardifs ont rompu le plan du Grand cartulaire, qu’ils sont précieux pour la reconstructionde l’état des archives de Saint-Victor pendant le haut Moyen Âge. Et même si, dans le casbrivadois, ces compléments ont été cachés pour la plupart au XVIIe siècle par les soins durédacteur du Ms. lat 9086, on peut tirer des conclusions de toutes sortes des irrégularitésde sa composition.
On a du mal à imaginer que les scribes brivadois aient transcrit leurs chartes sans aucunordre déterminé. Il est fort probable que le désordre apparent qu’on constate dans le Ms.lat. 9086 soit le résultat d’une combinaison de deux facteurs : 1°- des compléments auLiber de honoribus faits après sa constitution (surtout au XIe siècle et certainement avantla composition du Petit cartulaire) qui cachent et déforment sa structure initiale ; 2° desmutilations subies par le manuscrit au XVIIe siècle qui sont, elles aussi, masquées par lacopie dont nous disposons. Or, comme ni les savants de cette époque, ni l’exécuteurtechnique du Ms. lat. 9086 ne pouvaient avoir pour but de désorganiser la massedocumentaire présentée dans le cartulaire original disparu (un mathématicien confirmeraitqu’il n’y a rien de plus difficile que de créer un vrai chaos…), on peut espérer que sa logiqueprimordiale devienne perceptible malgré toutes les déformations tardives.
Depuis longtemps les chercheurs sont troublés par la chronologie incertaine de plusieursactes conservés dans le Grand cartulaire de Brioude. Ce problème a été traité un peurapidement par Henry Doniol, puis avec plus de soin par Alexandre Bruel 82, ensuite par A.-M. et M. Baudot dont les datations sont globalement acceptées par la communautésavante, et finalement, de nos jours par Jean Berger qui a tenté de dater selon les caractèresinternes et les formulaires les nombreuses chartes non datées du cartulaire. Il convient denoter que le problème n’est pas limité seulement au manque de dates précises (c’est tout de
— — — — — — — — — — — — — — — — — — La structure du Liber de honoribus de Saint-Julien de Brioude
13
80 Autrement il est difficile d’expliquer l’absence dans le cartulaire d’une charte sérieusement endommagée de l’évêqueWalcuade de Cavaillon, datée de 979 (CSVM, n° 1043).
81 Voir plus bas sur le rejet des serments de fidélité.
82 A. BRUEL, « Note sur la chronologie du cartulaire de Brioude », Bibliothèque de l’École des Chartes, 1866, t. II, fasc. 1,p. 444-504.
même un truisme quand on parle des documents de cette époque), mais aussi de larépartition très inégale des chartes non datées dans le Ms. lat. 9086.
Jusqu’à 1012 83 nous voyons, dans le cartulaire, un afflux assez régulier de chartes datéestandis que la seule charte postérieure à 1012 portant une date est de 1066 84. Est-ce uneconséquence de la manière de confectionner une charte comme telle ? Peut-être. Danscertaines régions de la France centrale, notamment à Vienne, le XIe siècle a été marqué parun déclin visible de l’exactitude dans la datation des actes 85. Or, la coïncidence de cephénomène avec le déclin du nombre des actes pousse à chercher d’autres explications.Ce fait peut indiquer que la manière d’enregistrer les dates a considérablement changé, cequ’il faudrait attribuer au changement de scribe ou au changement des circonstances detravail en général. À en juger par la répartition des chartes copiées dans le cartulaire, qu’ellessoient précisément datées ou non, au moment de la création du cartulaire le pic desacquisitions seigneuriales de Saint-Julien est déjà depuis longtemps passé : il se trouve à lafin du IXe - début du Xe siècle (138 chartes datées entre 876 et 925). Mais la quantitéimpressionnante des chartes données au milieu du Xe siècle (112 chartes entre 926 et 975)nous persuade qu’à cette époque, l’afflux des documents dans les archives du chapitrecontinuait à une échelle comparable. C’est seulement après 975 que leur nombre adiminué catastrophiquement (7 chartes admises entre 979 et 1000, et 4 chartes des années1011-1012). Fort probablement, ces chiffres reflètent, en premier lieu, les fluctuations dela fortune seigneuriale de Saint-Julien, voire les fluctuations de l’intérêt pour le chapitrede la part des donateurs potentiels 86, et la concurrence de la part des établissements voisinsde Cluny 87, de Sauxillanges, de La Chaise-Dieu… Mais elles nous informent aussi que dupoint de vue de la gestion des archives aucun changement radical ne s’est produit jusqu’àla fin du Xe siècle. C’est le brusque changement du nombre des chartes copiées qu’onobserve aux alentours de l’an mil qui doit attirer notre attention. En soi, il ne constitue pasune preuve que c’est à ce moment-là qu’il faut placer la création du Grand cartulaire -même si l’on sait que d’habitude le nombre des chartes insérées dans un cartulaire tombevisiblement immédiatement après sa composition 88 - car, en principe, on peut expliquerce fait, une fois encore, par les fluctuations de la fortune seigneuriale du chapitre. Ord’autres explications ne sont pas exclues. En se fondant sur les particularités codicologiqueset paléographiques du manuscrit original, E. Baluze et J. Mabillon l’ont daté de la fin duXIe siècle. Les deux trois épaves qui nous en restent semblent indiquer plutôt le milieu etla deuxième partie du XIe siècle sans exclure le début du XIIe siècle. La question n’est doncpas totalement résolue. En tout cas la coïncidence chronologique de la réduction de laquantité des chartes entrées dans les archives de Brioude (ou pour le moins transcrites
Igor FILIPPOV — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
14
83 CSJB, n° 91, 117.
84 CSJB, n° 238.
85 Cartulaire de l’abbaye de Saint-André-le-Bas de Vienne, p. XXV-XXVI.
86 Voir le commentaire de Christian LAURANSON-ROSAZ : L’Auvergne et ses marges (Velay, Gévaudan, du VIIIe au XIe siècle,Le Puy, 1987, p. 353-355.
87 Occasionnellement Brioude et Cluny ont attiré les mêmes bienfaiteurs. Cf. les donations du couple Stephanus etErmengardis : CSJB, n° 250 (a. 957) et Cluny, n° 872 (a. 954), n° 1164 (ca. 963). Or il faut admettre que toutes lesacquisitions de Cluny in comitatu Brivatense dont on a l’information datent du Xe siècle. Voir Cluny, n° 286 (a. 927),501 (a. 939), 872 (a. 954), 873 (a. 954), 876 (a. 954), 1048 (a. 958), 1060 (a. 959), 1164 (ca. 963), 1838 (ca. 990).
88 C’est le cas par exemple du Cartulaire de Saint-Victor de Marseille.
dans le cartulaire) avec l’accroissement considérable du nombre des chartes non datéessemble nous indiquer que quelque chose d’important est arrivé à ces archives.
Le fait qu’on connaisse le Liber de honoribus par une copie non seulement tardive maisaussi confectionnée à partir d’un original déjà considérablement déformé, constitue unobstacle sérieux à nos tentatives pour comprendre l’histoire de sa création et son état initial.Il est en effet tentant d’expliquer le manque d’ordre dans le ms. lat. 9086 par la mutilationdu cartulaire original entre les mains de Jean du Bouchet et par le travail consécutif, unpeu mécanique, du copiste inconnu qui, en 1677, a réalisé ce manuscrit. Ce travailreprographique a sans doute masqué les résultats de la mutilation. Mais rien nous autoriseà penser que l’ampleur des manipulations du texte médiéval par les “antiquaires” duXVIIe siècle et les pertes subies par ce texte ont été énormes ; en effet, il faut probablementparler d’une déformation plutôt que d’une mutilation.
On a également des raisons de supposer que la confusion dans l’ordre des chartes duGrand cartulaire de Brioude est le résultat, en premier lieu du “déguisement” des diversesinsertions réalisées au Moyen Âge après la composition du texte initial. On sait que lescartulaires présentaient l’œuvre de plusieurs scribes et ceux à leurs prédécesseurs essayaientde tenir compte des nouvelles acquisitions et des autres changements en copiant des actesrécents dans le vieux texte. Il en résulte que l’apparence définitive d’un manuscrit estsouvent très différente de son état primitif. Dans le cas du Liber de honoribus on est obligéde travailler avec une copie pas du tout exacte (ou plutôt, comme moi, avec sa publication)qui presque inévitablement cache la diversité des mains, de la taille de l’écriture, ainsi queles insertions de textes supplémentaires dans les espaces vides et sur les marges. Bienentendu, celà empêche la compréhension du texte et réduit les chances de reconstituer lemanuscrit dans son état primitif. Or, rien ne nous permet de penser que les insertionsmédiévales ont totalement défiguré le texte initial. On sait que d’habitude, les chartesinsérées postérieurement, ne constituent qu’une part modeste par rapport à la masse dedocuments transcrits dans le cartulaire au moment de sa création et qu’assez souvent ellessont concentrées dans quelques endroits particuliers. Il y a des raisons suffisantes de croireque malgré tout, le ms. lat. 9086 nous transmet les traits caractéristiques du texte initialet l’on est obligé de constater que, fort probablement, le manque d’ordre évidentdistinguait le Grand cartulaire de Brioude depuis le début.
La découverte de quelques pages d’index médiéval de ce cartulaire permet de penserqu’on avait des moyens pour l’utiliser de manière plus efficace 89. Il apparaît que cet indexqu’on date au plus tôt du deuxième quart du XIIe siècle, une génération au moins après lacomposition du cartulaire, est un moyen de corriger les incommodités typiques inhérentesà la mise en valeur de n’importe quel cartulaire médiéval et ne constitue pas la preuve del’état exceptionnellement embrouillé de ce cartulaire-là au moment de sa rédaction. Laconfection d’un gros registre contenant des copies de quelques 3 ou 400 chartes, sans planpréliminaire et sans ordre de travail est impossible à imaginer. Du moins n’en connaît-onpas d’analogue. Il existe d’autres cartulaires, même originaux, caractérisés par un manqued’ordre notoire mais compréhensible ; ainsi ceux de Marmoutier. Mais dans ce cas, lemanque d’ordre s’étend à de grands groupes de chartes appartenant à un pagus particulier
— — — — — — — — — — — — — — — — — — La structure du Liber de honoribus de Saint-Julien de Brioude
15
89 J. BERGER, « Indexation, memory, power and representations at the beginning of the 12 th century : the rediscoveryof pages from the tables to the “Liber de Honoribus”, the first Cartulary of the Collegiate Church of St Julian of Auvergne(Brioude) », The Indexer, 2006, vol. 25, n° 2, p. 95-100.
et réunis au sein d’un registre spécifique formant chacun un cartulaire : le Dunois, leVendômois. Le méta-cartulaire de Marmoutier a été organisé géographiquement 90. De cepoint de vue, le Grand cartulaire de Brioude présente une confusion plus profonde : onhésite à se prononcer sur l’ordre de ces chartes même au niveau des groupes de documents,sans parler de l’ensemble du registre.
En dépit de tout cela, que peut-on dire de cet ordre ? Sans aucun doute, on n’a pas classé les chartes du Liber de honoribus en fonction de leur
importance. Les diplômes, faux ou non, de Louis le Pieux, Pépin d’Aquitaine et Charlesle Chauve sont placés juste à la fin du cartulaire 91 et on est enclin à supposer que leurinsertion n’était pas prévue par le plan initial. D’habitude, on le sait, les diplômes sontcopiés au début d’un cartulaire et, comme l’exemple du Grand cartulaire de Saint-Victornous le montre, leur placement dans les autres parties du manuscrit est le résultatd’insertions ultérieures 92. On sait aussi que les victorins ont évité de surcharger le cartulairepar de l’information inutile. En ce qui concerne le cartulaire de Brioude, il faut ajouter queles chartes des autres princes puissants sont dispersées à travers le texte 93, tandis qu’à sondébut on trouve les chartes des gens non titrés. Les chartes des évêques sont dispersées, ellesaussi mais, une fois encore, on constate une certaine concentration de ces chartes vers lafin du manuscrit 94. Les transactions des simples clercs (très nombreuses) et des laïcs sontcopiées en alternance sans aucune prédilection pour les premières 95. En effet, on est frappéau premier abord par le nombre limité des chartes admises par les grands, notamment parles comtes, d’autant plus que l’on trouve assez régulièrement les mentions des comtes etdes vicomtes 96 et de leurs terres 97. Un nombre considérable de donateurs dont les chartesont été copiées dans le cartulaire semblent assez proches des seigneurs titrés, mais les actesde ces derniers n’y apparaissent que rarement. Or, on constate que le titre n’est pas toujoursmentionné dans les chartes dont on dispose 98, et l’analyse prosopographique montre queplusieurs personnes titrées figurent dans le cartulaire sans leur titre.
On est également sûr que le cartulaire n’a pas été organisé selon l’ordre chronologique.Ce que nous savons de ce manuscrit perdu suffit à convaincre qu’il n’a aucun des traitsd’une chronique. Notamment, il n’y a aucune trace d’une notice préliminaire concernantles buts et les circonstances de la création du cartulaire, que l’on trouve par exemple audébut des cartulaires un peu plus tardifs de Savigny, de Saint-Chaffre ou de Vabres 99. Il n’y
Igor FILIPPOV — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
16
90 D. BARTHÉLÉMY, « Note sur les cartulaires de Marmoutier (Touraine) au XIIe siècle », dans Les cartulaires, Paris, 1993,p. 252.
91 CSJB, n° 334, 338, 339, 340.
92 M. Zerner, « L’abbaye de Saint-Victor de Marseille et ses cartulaires… », op. cit., p. 179 sq.
93 CSJB, n° 28, 51, 66, 95, 124, 134, 172, 176, 286, 315, 341.
94 CSJB, n° 28, 144, 307, 312, 330, 331, 336.
95 CSJB, n° 6 : la première charte d’un clerc.
96 CSJB, n° 72 : « testibus istis Rotberto comite » ; n° 73 : « in villa Casellas quantum Rotbertus vicecomes visus est habereet possidere… signa Rotberti vicecomitis » ; n° 131 : « pro remedio animarum… Bernardi comitis ejusque conjugisInmengardis » ; n° 140 : « pro remedio… animae Roberti vicecomitis, et Stephani episcope, et Eustorgii sui avunculi, et suorum infantium » ; n° 190 : « vice versa dederunt domnus noster Bernardus comes et Adalgisus praepositus… »
97 CSJB, n° 51 : « habet fines de tribus partibus terram comitalem » ; n° 142 : « de aliis duobus lateribus guttulamdecurrentem et terram comitalem » ; n° 190 : « habet de duobus lateribus terram infantium Audeberti comitis… »
98 Voir CSJB, n° 118 et 124 où le titre du vicomte-donateur ne figure que dans le signum.
a pas non plus de tentatives de grouper les chartes par prévôts ; ce type de classement,combiné d’habitude avec un autre, par exemple géographique, est caractéristique deplusieurs cartulaires, y compris celui de Savigny. Bien sûr, dans quelques chartes deBrioude, il y a des allusions aux événements historiques, par exemple à l’assaut des sarrasins(qu’on place traditionnellement en 732) 100 ou aux privilèges et bienfaits de jadis 101.L’insertion des diplômes suspects des anciens rois carolingiens dont on a parlé un peu plustôt peut être aussi le signe d’une certaine préoccupation à l’égard du passé - bien que desstimuli pragmatiques aient joué dans ce cas un rôle plus substantiel. La mention de laguerre féodale, au début du XIe siècle, entre l’évêque clermontois Étienne le Blanc et lespartisans du roi Robert le Pieux, guerre dont a résulté, semble-t-il, l’incendie de Brioude,ne se trouve pas dans le ms. lat. 9086, mais on croit qu’elle faisait partie du manuscritoriginal perdu 102. On peut citer aussi quelques sentences de nature chronologique dans ledatum de certaines chartes, surtout concernant la déposition de Charles le Simple 103. Maisil s'agit de notices aléatoires, qu’on trouve ça et là, et qui sont en fait moins fréquentes parrapport à la plupart des cartulaires classiques y compris ceux qui, comme le Grandcartulaire de Saint-Victor, sont récemment devenus l’objet d’études intéressantes sur lamémoire historique des communautés religieuses 104. Une étude pareille fondée sur leGrand cartulaire de Brioude ne serait pas possible : il n’y a simplement pas assez de données.Il y a notamment très peu de données sur le culte de saint Julien. La quantitéimpressionnante des chartes non datées est aussi significative.
On est moins sûr que le Grand cartulaire n’avait pas été organisé selon un ordregéographique. Il y a sans doute des preuves d’un certain groupement des chartesconcernant les mêmes villæ et des autres biens 105, ce qui est d’ailleurs normal et mêmepresque inévitable : on a du mal à imaginer un cartulaire, quelle que soit son organisation
— — — — — — — — — — — — — — — — — — La structure du Liber de honoribus de Saint-Julien de Brioude
17
99 Cartulaire de l’abbaye de Savigny suivi du petit cartulaire de l’abbaye d’Ainay, publ. par A. BERNARD, Paris, 1853 ;Cartulaire de l’abbaye de Vabres au diocèse de Rodez, éd. par É. FOURNIAL, Rodez, Saint-Étienne, 1989 ; M.-Ch. MERLE-COMBY, « Le cartulaire de Saint-Chaffre du Monastier », dans Les bénédictins de Saint-Chaffre du Monastier. Histoire etarchéologie d’une congrégation, Le Monastier-sur-Gazeille, 1998, p. 421-431.100 CSJB, n° 339 (a. 825) : « quamdam ecclesiam ubi sanctus Julianus martyr corpore requiesvit quae est constructa in vicoBrivatensi non procul a castro Victoriaco, et a Sarracenis destructa et igne combusta erat… » Certains chercheurs, notammentÉ. Magnou-Nortier, mettent en doute l’authenticité de cette communication (et même de toute la charte), en laconsidérant comme une interpolation fausse plus tardive, due à l’esprit clunisien du XIe siècle. Voir É. MAGNOU-NORTIER, « Contribution à l’étude des documents falsifiés : le diplôme de Louis le Pieux pour Saint-Julien de Brioude(825) et l’acte de fondation du monastère de Sauxillanges par le duc Acfred (927) », Cahiers de civilisation médiévale,1978, vol. 21, p. 313-338. Cf. Ch. Lauranson-Rosaz, L’Auvergne et ses marges… op. cit., p. 47.101 CSJB, n° 337 (a. 936) : « Siquidem nostra congregation privilegium tale antiquitas a tempore videlicet Pipini Regis habetconcessum… »102 CSJB, n° CLXXX (a. 1053-1075) : « temporibus quibus Stephanus episcopus arvernensis arsit Brivatem propter guerramStephani Blanco… »103 Par exemple CSJB, n° 167 (a. 923) : « anno primo regnante Rodulpho rege et Carolo in custodia tenente » ; n° 39(a. 926) : « Actum XIV. Kal. Martii, anno tertio que Karolus rex per infideles Francos dehonestatus est » ; n° 315 (a. 926) :« anno quarto quo francidae inhonestaverunt regem suum Karolum et contra legem sibi Rodulfum in regem elegerunt » ;n° 327 (a. 926) : « Actum sexto idus decembrii, anno quarto quo infideles Franci principem suum Karolum propria sedeexturbaverunt et Rodulphum elegerunt Robero interfecto ».104 Cf. les ouvrages de P. Geary et de M. Zerner cités plus haut (n. 1 et 37) ainsi que : F. MAZEL, « L’invention d’unetradition. Les monastères Saint-Victor de Marseille et Saint-Gilles à la recherche du patronage de Pierre (XIe-XIIe siècles) », dans Écrire son histoire. Les communautés régulières face à leur passé, actes du 5e colloque international duCERCOR, Saint-Étienne, 2005, p. 337-367. Voir aussi P. Geary, Phantoms of Remembrance… op. cit.105 Par exemple, CSJB, n° 31 et 32 concernent la villa Casellas. Cf. n° 211 : Vinea de Severiago, et 212 : Altera vinea de Severiago.
interne, sans aucun rapprochement des chartes concernant les mêmes objets detransactions. Mais on peut donner maints exemples de la violation de ce principe 106, et entout cas on n’y voit pas de véritable groupement ni par comitatus et par aicis, ni pardomaine 107. L’étude de ce problème est compliquée par trois circonstances inhérentes à cecartulaire : 1°- la manière très irrégulière des scribes brivadois d’indiquer les unitésgéographiques 108 ; 2°- le nombre considérable des chartes qui fixent des transactions faitessimultanément dans plusieurs endroits, ce qui aurait rendu difficile aux compilateurs ducartulaire un classement strictement géographique ; 3°- la plupart des chartes enregistrentles acquisitions dans les comtés de Clermont et de Brioude, et même dans l’aice Brivatense,ce qui nous empêche de discerner les traces de ce type de classement s’il avait vraimentdéterminé l’organisation du cartulaire. Or, le chapitre a reçu plusieurs donations assez loinde Brioude, notamment en Gévaudan, Rouergue, Vivarais, et les chartes correspondantessont dispersées à travers le cartulaire d’une manière qu’on aurait du mal à considérercomme distinctement géographique. Pour l’instant, c’est le seul bilan qu’on soit capablede proposer sur ce sujet. Une connaissance beaucoup plus profonde que la mienne del’histoire et de la géographie du pays brivadois et de l’Auvergne en général, ainsi que desrecherches véritablement minutieuses sont nécessaires pour aller plus loin 109.
Quelle est donc la structure du Liber de honoribus ? En essayant de résoudre cette énigmeil est essentiel de garder en mémoire que l’organisation du cartulaire est, en somme, lereflet de l’organisation du chartrier, non pas un reflet exact, bien entendu, mais néanmoinsfidèle. Sans vouloir exagérer le degré de l’ordre des archives de cette époque, on est pourtantobligé d’exclure l’idée d’un plein désordre ou du classement des archives selon un principeabsurde, que le cartulariste, de plus, aurait voulu reproduire. Si les archives de Briouden’étaient organisées au XIe siècle ni en fonction de la géographie, ni de la chronologie, nide la typologie des actes préservés, il faut conclure que son classement était plus primitifet en quelque sens préliminaire par rapport aux classements plus élaborés qu’on a coutumede rencontrer dans les archives médiévales. L’hypothèse avancée par Jean Berger qu’ils’agisse d’un classement par lignages me paraît intéressante et acceptable. On sait que leschartes données par les membres d’un même lignage (ainsi que par ses fideles) concernaientpour la plupart un groupe assez homogène de terres et de droits correspondants quiconstituaient son patrimoine. C’est pourquoi on a pu choisir de les garder comme ungroupe à part dans un sac ou un coffre séparé, dans lequel il était plus aisé de retrouver,en cas de nécessité, un acte particulier. Ce classement n’est pas inconnu. On en trouve destraces, par exemple, dans le premier livre du cartulaire de Marcigny composé vers 1144 etdans la première partie du cartulaire de l’abbaye de Saint-Pierre-de-Préaux, en Normandie,terminée en 1227 110. Appliqué en combinaison avec le classement géographique (par prieuré ou par localité), il est assez caractéristique du Grand cartulaire de la Sauve
Igor FILIPPOV — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
18
106 Ainsi les chartes concernant la villa Severiacum (Sivérac, dans la commune du Broc, Puy-de-Dôme) se trouvent dansle CSJB sous les n° 13, 16, 40, 50, 108, 178, 211, 212, 232, 234, ainsi que CLXXXIV, CXCVI, CCI, CCCCXXXIII.
107 Il faut noter que le cartulaire de Sauxillanges présente un tableau assez semblable à cet égard.
108 Cf. les observations d’Antoine Houzé concernant l’écart de la réelle division administrative lors de la compilationd’un autre cartulaire auvergnat : Cartulaire de Sauxillanges, p. 660.
109 Beaucoup a déjà été fait à cet égard. Notamment voir : L. TIXIER, « La seigneurie du chapitre de Brioude au XIe siècle »,Cahiers de la Haute-Loire, 1971, p. 71-110, ainsi que L’Auvergne et ses marges… op. cit., de Christian Lauranson-Rosaz.
110 Le Cartulaire de Marcigny-sur-Loire (1045-1144). Essai de reconstitution d’un manuscrit disparu, par J. RICHARD,Dijon, 1957, p. V ; Le cartulaire de l’abbaye bénédictine de Saint-Pierre-de-Préaux… op. cit., p. LXVII.
Majeure confectionné aux environs de 1240 111. Il faut ajouter qu’un tel classement aprobablement été aux origines du classement géographique et même compatible, jusqu’àun certain degré, avec celui-ci. Par exemple, à Saint-Victor, on a évidemment gardéensemble les chartes de la famille des vicomtes de Marseille. On les trouve copiées en blocau début du Grand cartulaire victorin et on constate qu’au nom de la préservation de leurunité on a même accepté de violer un peu le classement des chartes par diocèse par ailleurssoigneusement respecté. Un bon exemple est fourni par une série d’actes qui concernentles possessions de Saint-Victor dans la vallée de Trets 112. À la fin du XIe siècle, la vallée setrouva de facto sous le contrôle direct des archevêques d’Aix, alors que les cartularistes seréféraient à une époque encore proche, au cours de laquelle la vallée faisait partie del’évêché de Marseille. L’argument décisif pour classifier ces documents en tant quemarseillais, a consisté probablement en ce que dans ce lieu était concentré l’essentiel despossessions domaniales des vicomtes de Marseille, principaux bienfaiteurs de l’abbaye 113.Visiblement, les copistes n’avaient pas voulu, en respectant les nouvelles limites du diocèse,rompre l’unité géographique des donations des vicomtes.
Si l’on accepte cette hypothèse, certaines particularités étonnantes du Grand cartulaire deBrioude trouvent une explication plausible. J’ai déjà mentionné le placement anormal desdiplômes royaux à la fin du cartulaire, placement effectué fort probablement bien après laconstitution du recueil initial. Il est clair que les diplômes ne sont pas incompatibles avecle classement géographique des actes (même si plusieurs cartulaires organisés de cette façon-là, par exemple celui de Conques, n’en contiennent point 114) ; il n’y a rien à dire sur leclassement chronologique ou typologique, mais le classement par patrimoine lignager auraitrendu l’insertion des diplômes royaux dans un cartulaire beaucoup moins logique. Plusieurscartulaires, surtout du Nord de la France (du chapitre d’Angers, des abbayes de Corbie,Montier-en-Der, Saint-Bertin, Saint-Germain, Saint-Vaast…), contiennent des copies dedonations des fiscs royaux. Dans le Midi où le fisc royal a été bien limité, on connaît descas où des diplômes sont entrés dans un cartulaire ecclésiastique en tant que documents despersonnes laïques parmi les autres actes d’une famille de bienfaiteurs 115. Pourtant ici lesdiplômes sont représentés plutôt par des privilèges généraux qui ne concernent pas unelocalité particulière ; ce sont donc des documents de nature très différente par rapport à ceuxqui caractérisaient les biens et les droits appartenant à un lignage.
— — — — — — — — — — — — — — — — — — La structure du Liber de honoribus de Saint-Julien de Brioude
19
111 Grand cartulaire de la Sauve Majeure, op. cit., p. 24-25. Cf. L. FALKENSTEIN, « Das Grand cartulaire der Abtei LaSauve Majeure und seine Pasturkunden », Francia, 1999, Bd. 26/1, S. 155-183.
112 CSVM, n° 108, 110-120, 122, aussi 19, 32, 44, 135, 138, 225-228, 288-290, 696.
113 M. CHAILLAN, Recherches archéologiques et historiques sur Trets et sa vallée, Marseille-Paris, 1893, p. 59-63, 79-80 ;H. de GERIN-RICARD, G. ARNAUD D’AGNEL, Les antiquités de la Vallée de l’Arc en Provence, Aix, 1907, p. 152.
114 Les diplômes de Louis le Pieux et de Pépin d’Aquitaine publiés par Gustave DESJARDINS sous les nos 580 et 581du Cartulaire de l’abbaye de Conques en Rouergue, Paris, 1879, ne font pas partie du cartulaire même mais proviennentdu chartrier de Conques.
115 On peut citer l’insertion des diplômes de Charlemagne et de Louis le Pieux en faveur du hispanus Jean dans lecartulaire disparu des archevêques de Narbonne ou les diplômes de Louis le Pieux et de Charles le Chauve en faveur decertains de ses vassaux qu’on connaît grâce aux copies faites par Baluze des cartulaires, également disparus, de l’églised’Elne et de l’abbaye de Canigou (Histoire générale de Languedoc, 3e éd. Toulouse, 1875, t. 2., Preuves, n° 12, 34, 84,86, 103, 132, 141, 144).
116 Situation semblable à Fontevraud. Voir Grand cartulaire de Fontevraud, T. 1, publ. par J.-M. BIENVENU, Poitiers,2000, p. VIII.
Plus indicative encore est l’absence totale de copies des bulles. Elle est d’autant plusfrappante qu’il n’y a aucune trace d’un bullaire 116. Or, on en trouve 18 dans le Liber viridis ;la plus ancienne, de Calixte II, est datée de 1119, ce qui laisse ouverte la question du sortdes bulles de l’époque précédente… Il faut noter aussi l’absence des confirmationsépiscopales. On sait que, même dans les cartulaires organisés distinctement selon leprincipe géographique, comme c’est le cas du Grand cartulaire de Saint-Victor, le projetinitial des compilateurs ne prévoyait pas toujours l’insertion des confirmations desévêques 117, lesquelles ne s’inscrivaient pas bien dans le classement purement géographiquedes actes et qui n’étaient copiées que bien plus tard. Dans le cas d’un classement des chartespar patrimoine lignager, l’exclusion de telles confirmations aurait même été plus logique.Par contre, on trouve dans le Liber de honoribus une trentaine d’actes de caractère féodalqui sont bien présents dans les recueils laïques, comme le cartulaire des Trencavel, mais quisont assez rares dans les cartulaires ecclésiastiques. À Saint-Victor, les moines ont négligéun certain nombre de serments de fidélité qui sans doute existaient dans leurs archives(certains nous sont parvenus en originaux), peut-être parce qu’en Provence à cette époque,l’institution du serment de fidélité demeurait encore assez étrangère à leur expériencesociale 118. Pour être précis, aucun serment de fidélité n’est inclus dans le Grand cartulairede Brioude 119 et, de plus, l’Auvergne n’est pas un pays où ils sont bien représentés. Or,Roland Viader a montré que plusieurs chartes brivadoises contiennent plusieurs clausulesde nature clairement féodale, assez proches de celles qu’on rencontre dans les sermentslanguedociens 120. Bien entendu, des clausules semblables, révélatrices des divers aspects duretrait lignager et des rapports entre les membres de l’élite féodale en général, se retrouventdans presque tous les cartulaires du Midi 121, quel que soit leur classement (qui est,d’ailleurs, surtout géographique), mais le Liber de honoribus donne l’impression d’un intérêtparticulier, ainsi que considérablement plus précoce (et donc indicatif peut être de lapersistance de traditions de l’époque pré-féodale…), pour les institutions respectives.
Un autre argument en faveur de l’hypothèse de la structure lignagère du Liber dehonoribus est l’absence de censiers, qui vraisemblablement existaient dans les archives deSaint-Julien comme dans les autres archives ecclésiastiques de la région. Par exemple, uncertain nombre de censiers sont conservés dans le cartulaire de Sauxillanges, très proche 122.On les trouve, bien qu’en quantité assez modeste, dans maints cartulaires français, y compris le cartulaire de Saint-Victor où - la situation se répète - ils ont été copiés bienaprès la constitution primordiale du cartulaire 123. On peut supposer que les compilateurs
Igor FILIPPOV — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
20
117 M. Zerner, « L’élaboration du grand cartulaire de Saint-Victor de Marseille », op. cit., p. 232-234.
118 Ibidem, p. 229-230, 237. Cf. J.-P. POLY, La Provence et la société féodale 879-1166, Paris, 1976, p. 166.
119 Cf. CSJB, 20 (sd) : serment de respecter les biens de l’abbaye.
120 Voir son article « Des formes de retrait lignager dans les donations à Saint-Julien de Brioude (IXe-Xe siècles) », dansce même volume d’actes.
121 Voir I.S. Filippov, La France méditerranéenne… op. cit., p. 653-690.
122 G. FOURNIER, « La seigneurie en Basse Auvergne aux XIe et XIIe siècles d’après les censiers du cartulaire deSauxillanges », dans Mélanges L. Halphen, Paris, 1951, p. 239-245 ; M. HILLEBRANDT, « Être soumis à Saint-Pierre.Formes de dépendances dans le cartulaire de Sauxillanges », dans Odilon de Mercœur, l’Auvergne et Cluny. La Paix de Dieuet l’Europe de l’An Mil, actes du colloque de Lavoûte-Chilhac des 10, 11 et 12 mai 2000, Nonette, 2002, p. 263-278.
123 CSVM, n° 96, 291, 397, 450, 542, 543.
124 CSVM, n° 291 (a. 835), cf. n° 31 (a. 780), la plus ancienne charte du cartulaire qui mentionne un polyptyque utilisécomme preuve documentaire lors d’un litige.
du cartulaire victorin envisageaient les censiers, du moins parfois, en tant que preuves desdroits de propriété, peut-être en l’absence des chartes correspondantes. Cela a sans douteété le cas d’un breve de villa Marciana de 835 qui vers la fin du XIe siècle a certainementperdu toute sa valeur gestionnaire proprement dite 124. Or, il est clair que les censiers, bien qu’ayant une identité clairement locale, sont des instruments de gestion seigneurialeplutôt que de défense des droits de propriété. Si les actes du Grand cartulaire de Brioudeont été vraiment classés par lignages, il serait logique d’exclure les censiers du nombre desactes à copier. Bien sûr, dans plusieurs chartes de donation, d’échange, etc., on trouve desclauses concernant les paiements et les services dus au chapitre de Brioude par les tenantsdes terres aliénées mais c’est une autre affaire.
J’espère que ces considérations seront utiles pour mieux comprendre la nature ducartulaire brivadois et sa composition.
— — — — — — — — — — — — — — — — — — La structure du Liber de honoribus de Saint-Julien de Brioude
21

































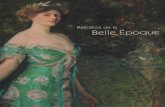






![Vivantes ou comme vivantes : l’animation miraculeuse d’images de la Vierge entre Moyen Age et époque moderne [2015]](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/6314492d3ed465f0570b131f/vivantes-ou-comme-vivantes-lanimation-miraculeuse-dimages-de-la-vierge-entre.jpg)

