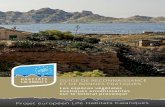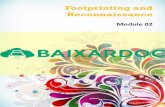La maladie de Minamata et le conflit pour la reconnaissance (Ebisu 2003)
Transcript of La maladie de Minamata et le conflit pour la reconnaissance (Ebisu 2003)
Paul Jobin
La maladie de Minamata et le conflit pour la reconnaissanceIn: Ebisu, N. 31, 2003. pp. 27-56.
Citer ce document / Cite this document :
Jobin Paul. La maladie de Minamata et le conflit pour la reconnaissance. In: Ebisu, N. 31, 2003. pp. 27-56.
doi : 10.3406/ebisu.2003.1356
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ebisu_1340-3656_2003_num_31_1_1356
RésuméMalgré le « règlement définitif» imposé par l'État aux associations de malades en 1995, la maladie deMinamata ne cesse de faire l'objet de réflexions croisées entre les acteurs du mouvement et un vastepublic (nombreuses publications, colloques, manifestations culturelles, etc). Cette persistance desenjeux de mémoire reflète la virulence qu'a connue le conflit entre les malades et la firme Chisso.Jusqu'à l'issue du premier procès contre la firme en 1973, l'attention portée au mouvement des maladess'est surtout concentrée sur la responsabilité de l'usine Chisso dans le déclenchement de la maladie.Parallèlement, dès 1971, une autre lutte était enclenchée contre les critères restrictifs du système dereconnaissance mis en place par l'Etat pour définir et dédommager les victimes. À Minamata, cettedouble quête de reconnaissance se caractérise par un souci de confrontation directe avec les autoritésde Chisso et de l'État pour sortir de la logique strictement économique du principe pollueur-payeur oud'une diabolisation de l'adversaire ; il se dessine maintenant une forme de pardon qui ne signifie pas unsolde de tout compte. Dans leur lutte, les malades ont également été soutenus par un des deuxsyndicats de l'usine Chisso, celui qui était resté fidèle à la ligne militante des années cinquante. Ce faitexceptionnel a marqué un tournant significatif dans l'histoire du mouvement ouvrier et continued'inspirer l'action des syndicats minoritaires qui, pour résister au coopérationnisme dominant sur le lieude travail, doivent eux aussi lutter pour leur reconnaissance.
AbstractDespite the "final settlement" imposed by the Japanese government in 1995 on victims groups, theMinamata disease is still a matter of debate amongst the various actors or the movement, producingmany publications, cultural events, symposiums, etc. Such persistency of the stakes of memory reflectsthe acrimonious nature of the conflict between the victims and Chisso Company. Up to the sentence ofthe first trial in 1973, attention paid to the victims' movement focused on their struggle to prove theresponsibility of Chisso in provoking the Minamata disease. As early as 1971, another battle forrecognition was started against the Japanese government's narrow compensation criteria around thequestions of entitlement. In the case of Minamata, this parallel search for recognition was marked by aconstant call for direct confrontations with Chisso and the government, with the joint objectives ofbypassing the narrow logic of the "polluter pays" principle, and avoiding the diabolisation of thoseresponsible for the tragedy. Some victims now express their wish to forgive but not forget. In theirstruggle, victims were also supported by one of the company's two unions, which had remained faithfulto the fighting spirit of the fifties. This exceptional engagement marked a turning point in the history ofthe labour movement. It still inspires minority unions in their own struggles for recognition and their fightagainst overwhelming cooperationism in workplaces.
Ebisu 31, Automne-hiver 2003, Maison Franco-Japonaise, Tôkyô, p. 27-56.
LA MALADIE DE MINAMATA ET LE CONFLIT POUR LA RECONNAISSANCE1
Paul JOBIN Université Bordeaux 3
Depuis son apparition en 1956, plus de 10 000 personnes ont été officiellement reconnues atteintes de la maladie de Minamata (Minamata-byô 7j<{^^), tandis que beaucoup d'autres sont restées dans l'ombre. La conciliation judiciaire conclue en 1995 a élaboré un compromis pour l'ensemble des personnes non reconnues jusqu'alors. Mais cet accord, unilatéralement qualifié de « règlement définitif» {saishû kaiketsu M^M'ïk) par les instances publiques, est loin d'avoir apaisé toutes les rancœurs, notamment parce qu'il a laissé en suspens la responsabilité de l'État.
Entre ce lever de rideau et cette chute officiels, l'épisode le plus intense du mouvement des malades se situe autour de la première plainte déposée contre l'usine Chisso f" y 7 par les malades (1969-1973), dans la foulée du procès intenté par les victimes de l'entreprise Shôwa Denkô HSfPiËX. Au côté des malades et de ceux qui les soutiennent, se joignit une partie des ouvriers de Chisso. L'engagement de ces derniers, qui rompait avec leur hostilité de dix ans plus tôt, constitue un phénomène exceptionnel dans l'histoire du Japon d'après-guerre, tant pour la sociologie du mouvement ouvrier que pour celle des mouvements antipollution. Il est en effet très rare de voir des employés d'entreprises polluantes témoigner une solidarité active envers leurs victimes directes ou indirectes. Cette rencontre relativement méconnue entre « pollueurs » et « pollués » rejoint la démarche de certains malades qui ont refusé de se soumettre à la stricte application financière du principe pollueur-payeur pour atteindre plus fondamentalement la dimension
1 Cet article reprend le fil conducteur de la partie centrale d'une thèse soutenue à l'École des Hautes Etudes en Sciences Sociales, à Paris, en novembre 2001 (Un nouvel esprit du syndicalisme ouvrier, conflit et reconnaissance autour des maladies industrielles dans le Japon contemporain) ; cette thèse, qui a obtenu le prix Paul Claudel-Shibusawa Eichi, est à paraître aux Éditions de l'EHESS courant 2004. Le titre du présent article fait référence à l'ouvrage d'Axel Honneth, La lutte pour la reconnaissance, Paris, Cerf, 2000 (traduction de Kampfum Anerkennung, 1992).
2 Maître de conférences à l'Université Bordeaux 3, chargé de cours à l'INALCO et chercheur au Centre de recherche sur les enjeux contemporains en santé publique (INSERM-EHESS) ; paul.jobin(g>noos.fr .
28 La maladie de Minamata et le conflit pour la reconnaissance
symbolique du mal causé. Par l'ampleur et la virulence de cette pollution, mais aussi par la forme
extraordinaire qu'a prise le conflit entre les malades, la firme Chisso et l'État, Minamata est devenu le symbole de la lutte contre la pollution industrielle au Japon. Au-delà des images parfois figées qui nous sont parvenues de cette tragédie, des œuvres de qualité continuent de marquer l'imaginaire contemporain et certaines pratiques sociales. Ainsi les écrits d'Ishimure Michiko G^^LjËïS qui mêlent dans une langue originale, reportage, poésie et trame romanesque ; ou encore ceux du médecin épidémiologiste Harada Masazumi I^EBIE/M ; les films de Tsuchimoto Noriaki ±^^B§ ; les photographies de Kuwabara Shisei HMïÈ^c, Miyamoto Shigemi H^$cli, Shiota Takeshi iËHJÊÇlè, Eugene Smith ; les recherches de Ui Jun ^#M, entre chimie, ingénierie et politologie ; les études historiques et anthropologiques notamment de Irokawa Daikichi fe/K^cf, Ishida Takeshi HEBÊt, Tsurumi Kazuko HJHft^, les réflexions philosophiques de Hidaka Rokurô Bi^71\êP, ou Kurihara Akira MMtffc, pour ne citer que les plus célèbres. Dans ces œuvres, « pollueurs » et « pollués » ont un nom, un visage. Ils ont une histoire qui s'insère dans des lieux particuliers où ils sont confrontés à des choix spécifiques. Sans réduire l'histoire collective à une somme de choix individuels, ce qu'on pourrait appeler « l'école de Minamata » recherche en permanence les aller-retours possibles entre le macro et le micro social, le libre et le déterminé. Leur critique de la modernité est fondée sur une expérience locale qui a bouleversé de nombreuses vies à commencer par la leur.
L'engagement des ouvriers de Chisso au côté des malades
En mars 1959, les médecins de l'Université de Kumamoto annoncent publiquement le résultat de leur enquête : la cause du « mal étrange » est très probablement le mercure déversé par l'usine Chisso dans la mer. La direction de l'usine conteste cette annonce en faisant appel à des chercheurs de l'Université de Tôkyô pour contredire ces résultats. Face à cette attitude de déni, les pêcheurs se sentent de plus en plus bafoués. Le 17 octobre 1959, soixante bateaux des coopératives de pêche de la préfecture de Kumamoto viennent manifester devant l'usine. Ils réclament l'arrêt de la pollution, le nettoyage de la baie, des compensations pour les pertes de poissons, et un soutien financier pour les victimes. La direction refuse de les recevoir. Furieux, 1 500 pêcheurs pénètrent dans l'usine où ils provoquent des dégâts jusqu'à ce que le directeur leur fasse des promesses. Lors d'une autre manifestation le 2 novembre, un millier de pêcheurs entrent à nouveau dans l'usine. Ils jettent les machines à écrire et les téléphones par les fenêtres ; ils s'en prennent également au laboratoire, à la centrale électrique, avant que n'arrivent des forces de police avec lesquelles ils se battent pendant près d'une heure. 30 ou 40 pêcheurs sont blessés, ainsi que 3 employés dont le directeur, et 64 policiers. Les dégâts sont estimés par l'usine à 8 000 000 000 yens. Le 4 novembre, le syndicat
PaulJobin 29
manifeste « contre la violence » des pêcheurs et se déclare prêt à défendre l'usine3. En avril 1962, la direction de l'usine Chisso annonce aux ouvriers un plan
de « salaires stabilisés et de rationalisation » [antei chinkin gôrika assen ifer/iiM^z 'aMifc^M) . Jusqu'alors, il n'y avait qu'un seul syndicat dans l'usine selon le modèle américain de l'union shop, et celui-ci était soumis à la direction. Mais certains membres du syndicat ont vu dans le plan de la direction des réductions salariales déguisées et une menace à terme de licenciements massifs. Après des essais infructueux de négociation, en juillet, le syndicat annonce une grève illimitée. Dès le lendemain, pour contrer les grévistes, la direction crée un deuxième syndicat. La grève prend fin huit mois plus tard, en février 1963. Toute la ville de Minamata est divisée en deux par le conflit, entre partisans du premier ou du second syndicat. Malgré l'échec de la grève, la moitié des 5 000 ouvriers que compte l'usine restent fidèles au premier. Pendant la grève, ils sont soutenus par environ 12 000 ouvriers membres de la fédération des syndicats de la chimie, la Gôka Rôren cWb^7?ll (rattachée à la confédération Sôhyô $&§¥) venus de tout le Japon, ainsi que des ouvriers du premier syndicat de la mine de charbon de Miike H'/É (qui se trouve à quelques heures de train de Minamata) . Ces derniers espéraient prendre une revanche sur la défaite qu'ils avaient subie deux ans plus tôt et qui a marqué la fin du syndicalisme militant des années 1950. Tout comme les ouvriers de Miike, les ouvriers de Chisso ont subi la décision du MITI de privilégier le pétrole comme énergie de l'industrie. Et, comme à Miike, la direction a remporté une victoire complète.
Pendant la grève, les revendications des ouvriers se limitent aux salaires. Comme la quasi-totalité de la population de Minamata, les ouvriers ne prêtent aucune attention à la détresse des malades et des pêcheurs. Mais après l'échec de leur lutte, les ouvriers restés au premier syndicat sont soumis à un tel harcèlement de la part de la direction qu'ils prennent progressivement conscience de la discrimination et de la situation profondément injuste à laquelle pêcheurs et malades ont été acculés par Chisso. Cela les amène, le 30 août 1968, à prononcer publiquement une « déclaration de honte » (haji sengen ïfàjËif) :
La maladie de Minamata a tué des dizaines de personnes, handicapé des dizaines d'autres, et déformé des dizaines d'enfants à leur naissance. Que les déchets de l'usine Chisso soient la cause de la maladie, cela a été dit depuis le début. Aujourd'hui tout le monde le sait, pas seulement à Minamata, mais dans tout le Japon. Et nous, qu 'avons-nous
3 GEORGE Timothy S., Minamata : Pollution and the Struggle for Democracy in Postwar Japan, p. 71-102, 2001, Cambridge, Harvard University Press (ce livre reprend une thèse de doctorat d'histoire soutenue à Harvard, en 1996). Voir compte rendu de lecture dans le prochain numéro de la revue Le Mouvement social ( Éditions de l'Atelier).
4 KlKUCHI Masanori fJrÈÈîR1, «Chisso rôdô kumiai to Minamata-byô » f- -y V îtfGSSfttô- i xRfëtâ (Le syndicat de Chisso et la maladie de Minamata), dans IROKAWA Daikichi Giill^ïT, Minamata no keiji, Shiranuikai sôgô chôsa hôkoku /J<{!4cd'$/Jn\ ^1fi\'X^èûMttWâ (La révélation de Minamata, rapport de l'enquête générale sur [la région de] la Mer Shiranui), Tôkyô, Chikuma shobô ïïLffîÏÏJ)}, 1995, p. 526-530.
30 La maladie de Minama ta et le conflit pour la reconnaissance
fait pour lutter contre cette maladie ? Nous n avons rien fait. Pendant six ans depuis la grève contre les salaires stabilisés, nous nous sommes battus avec ténacité contre les attaques de la société envers les ouvriers. Cette expérience nous a appris que la lutte ne se conclut pas à l'intérieur de l'entreprise ; elle se fait avec l'aide des ouvriers de tout le pays, et avec les citoyens. Mais en même temps, la lutte repose sur nos propres épaules. Pourquoi donc n 'avons-nous pas lutté contre la maladie de Minamata ? Nous qui avons connu la lutte physiquement, nous n'avons pourtant rien fait contre la maladie de Minamata. En tant qu'hommes, en tant qu'ouvriers, c'est vraiment une honte pour nous, et nous devons y réfléchir et le regretter du fond du cœur. La direction traite les ouvriers de la même façon qu 'elle traite la maladie de Minamata ; la lutte contre la maladie de Minamata est aussi notre lutte. Jusqu 'à aujourd'hui, la direction refuse toujours de reconnaître que les déchets de l'usine sont la cause de la maladie, et elle cache tous ses documents. Nous décidons de consacrer toute notre énergie à ce que la direction reconnaisse sa responsabilité, pour lutter contre la maladie de Minamata .
Près de 400 membres du premier syndicat sont présents lors de cet aveu sans précédent au Japon. La veille, le 29 août 1968, ils ont empêché la direction d'exporter en Corée du Sud 100 tonnes de déchets chargés de mercure. L'action du 29 et la déclaration du 30 août ont un retentissement national et produisent une forte impression sur les malades.
En avril 1969, l'association qui regroupe les malades se scinde en deux : ceux qui acceptent l'arbitrage du ministère de la Santé {ichininha —fëffî, ci-après le groupe pour l'arbitrage), et ceux qui refusent cet arbitrage pour affronter directement les dirigeants de la firme Chisso au tribunal. Le groupe du procès {soshôha MaàW) qui réunit 1 1 2 personnes et 28 familles dépose une plainte au tribunal de Kumamoto (ville de la préfecture de Minamata) en juin 1969. Le groupe du procès est soutenu par l'Association qui accuse (les responsables) de la maladie de Minamata (Kokuhatsn suru kai cf3fè"f<5âO, que viennent de constituer pour l'occasion des intellectuels proches des mouvements étudiants et de la Ligue contre la guerre du
5 Sairen £v>f!X (journal du premier syndicat), 31 août 1968 ; le principal rédacteur de cette déclaration est Okamoto Tatsuaki l^^il^], un diplômé de l'Université de Tôkyô, entré à Chisso comme cadre mais devenu délégué du premier syndicat par vocation après la grève de 1962 (entretiens avec Okamoto à Tôkyô en octobre-novembre 1998 et janvier 1999).
Le premier syndicat avait eu vent du projet de la direction et il a réussi à empêcher le chargement de fûts toxiques sur le bateau. Cette intervention inspirera six ans plus tard le mouvement contre l'exportation de la pollution sous l'impulsion de Ui Jun à l'Université de Tôkyô, contre Toyama Kagaku «Ulfti^ qui voulait exporter ses machines de fabrication de mercurochrome à Incheon (Corée du Sud), désormais interdites par la législation japonaise sur l'usage du mercure (février 1974), puis contre Nihon Kagaku n^-fk'r1 à Ulsan (Corée du Sud), en 1975 (entretiens avec Ui à Tôkyô, en mai 1997 et septembre 1998). Il y eut également à cette période une action lancée contre l'entreprise de sidérurgie Kawasaki Seitetsu Jllfêf Sïtfc qui transféra la part la plus polluante de sa production de l'usine de Chiba à Mindanao aux Philippines après le renforcement de la législation sur la pollution atmosphérique au Japon en 1971.
7 Ce recours au tribunal est inspiré des plaintes qui ont été déposées à Niigata en juin 1967 (deuxième cas de maladie de Minamata), à Yokkaichi en septembre 1967 (pollution atmosphérique), et à Toyama (maladie dite « itai itai ») en mars 1968.
PaulJobin 31
Vietnam (Beheiren ). Ils réunissent des universitaires et des juristes qui joueront un rôle décisif pour démontrer toute la responsabilité de la firme Chisso et de l'État, ainsi que l'ampleur du désastre. Le médecin Harada Masazumi et l'écrivain Ishimure Michiko qui soutiennent cette action en justice ne négligent toutefois pas d'apporter leur concours au groupe pour l'arbitrage . Le premier syndicat suit également cette attitude de soutien aux deux groupes de malades, alors que le deuxième syndicat, proche de la direction, ne se prononce que du bout des lèvres pour le groupe pour l'arbitrage.
Lorsque le 5 mars 1970, le ministère de la Santé annonce au groupe pour l'arbitrage le résultat de sa médiation avec Chisso, les malades et la presse sont scandalisés : 2 000 000 000 yens pour les familles de morts, et entre 140 000 et 200 000 yens pour les malades encore en vie. Le groupe du procès se joint même au groupe pour l'arbitrage afin d'adresser une pétition au ministère, protestant contre cette offre scandaleusement basse et contre l'absence de reconnaissance de la responsabilité de Chisso. Le 4 mai, les compensations sont relevées à 3 000 000 000 yens par mort, et entre 160 000 à 320 000 yens pour les malades encore en vie, ce qui est encore dérisoire comparé aux indemnisations attribuées le même jour aux victimes d'une explosion de gaz à Osaka (entre 8 000 000 000 et 19 000 000 000 yens pour les proches des morts)10. L'Association qui accuse et le groupe du procès craignent que ces compensations trop faibles ne créent un dangereux précédent pour le procès en cours. Ils décident alors d'effectuer une marche de protestation le 25 mai, à Tôkyô, devant le siège de Chisso. À Minamata, le premier syndicat appelle pour le lendemain à une journée de « grève contre la pollution » (kôgai suto ^Hx h). Environ 800 ouvriers (du premier syndicat) y participent,
Be Hei Ren ^<?:i!li : abréviation de Betonamu ni Heiwa o ! Shimin Rengè *<■ h i|j'RM51> (Ligue Citoyenne pour la Paix au Vietnam - maintenant ! -). À Kumamoto, les fondateurs de l'Association qui accuse sont Watanabe KyôjiiSiZii'C— et Honda Keikichi -*WIl'#i'i, tous deux alors déjà très impliqués dans le réseau de la Beheiren, ce qui leur permettra d'étendre le soutien moral et financier aux malades de Minamata à d'autres villes, dont Ôsaka et Tôkyô, et bientôt à tout le Japon. Ils recevront ainsi le soutien de Hidaka Rokurô I ! i'.'.j' Al'ilî, un sociologue réputé de l'Université de Kyoto, qui participera notamment à la protection au Japon et à la fuite vers la Suède de soldats déserteurs américains, et qui sera pour cette raison accusé d'avoir également protégé des militants de l'Armée rouge ; il recevra l'asile politique en France après l'élection de François Mitterrand en 1981 (entretien avec Hidaka Rokurô, à Paris en juillet 2000). Concernant la Beheiren, voir HAVENS Thomas, Fire Across the Sea; The Vietnam War and Japan 1965-1975, Princeton, Princeton University Press, 1987.
9 C'est à ce moment que paraît le livre diSHIMURE Michiko : Kngaijôdô, waga Minamata-byô ïïfàYi* lu tifrWAtâ (Mer de souffrance, terre de pureté, notre [version de la] maladie de Minamata), Tôkyô, Kôdansha n$,$fl:, 1969 (réédité en poche en 1997), 330 p. Ce livre fut un événement littéraire tant par ce qu'il relatait que par son écriture novatrice mélangeant la précision du reportage à la poésie et au dialecte de Minamata. Au milieu de l'effervescence du mouvement étudiant de 1968, parmi ceux que ce livre décidèrent à s'engager au côté des malades, plusieurs vinrent même s'installer à Minamata. Il existe une traduction anglaise : MONNET Livia, Paradise in the Sea of Sorrow, Our Minamata Disease, Tôkyô, Yamaguchi Publishing House, 1990, 379 p.
10 ISHIMURE Michiko, Asahigurafu T^hVy 7, 12 juin 1970, p. 23.
32 La maladie de Minama ta et le conflit pour la reconnaissance
soit deux fois plus que pour « la déclaration de honte » deux ans plus tôt. Bien que « la grève contre la pollution » ne dure qu'une journée, elle suscite l'intérêt des médias nationaux. Elle inspire les jeunes ouvriers de la raffinerie Zeneseki à Kawasaki dans leur action contre la pollution et pour la reconnaissance des maladies professionnelles. Onogi Yoshiyuki '-hSf^i LZ., un des délégués du syndicat des jeunes ouvriers de Zeneseki vient même jusqu'à Minamata. Il exprimera ensuite son admiration émue envers les vieux ouvriers du premier syndicat de Chisso .
Le numéro du 7 août 1970 de YAsahi gurafu, un hebdomadaire national illustré aujourd'hui disparu, fait paraître un article original qui retrace l'itinéraire du premier syndicat, à travers le portrait d'un de ses membres, Hanada Toshio ÎEBBfêif . Une photo prise par Shiota Takeshi est particulièrement émouvante par sa simplicité et sa symbolique ; elle montre Hanada, en compagnie de Sakamoto Shinobu WL^X, une jeune fille de seize ans, malade congénitale, membre du groupe du procès. Une autre photo le montre sur une colline surplombant l'usine dont les cheminées crachent massivement des fumées, nauséabondes, comme le précise le commentaire : « En plus du mercure, ces fumées font aussi de nombreuses victimes ». Le père d'Hanada travaillait aussi à l'usine Chisso de Minamata ; il y a perdu un pied. Puis Toshio et ses quatre frères entrèrent comme leur père à Chisso. L'aîné est mort de pneumoconiose (à cause des fumées toxiques dans l'usine). Le troisième est parti pour l'usine Chisso en Corée ; il a échappé à la mort de justesse et s'est fracturé le crâne en tombant de trente mètres de hauteur. Le quatrième devait quitter l'usine de Minamata pour rejoindre l'usine de Corée, mais il fut finalement emmené en URSS où il mourut de leucémie. Quant à Toshio lui-même, il est lui-même atteint de pneumoconiose, comme six des vingt-et-un ouvriers de la section dans laquelle il travaille.
Cette relation étroite entre le mépris des accidents de travail et des maladies professionnelles à l'intérieur de l'usine Chisso, et le mépris de l'environnement à l'extérieur de l'usine, sera exposée encore plus clairement par le témoignage de huit ouvriers du premier syndicat au tribunal de Kumamoto, deux ans plus tard, en mars 1972, lors du procès contre Chisso. En exposant les conditions de travail particulièrement difficiles, le contexte d'humiliation constante qui mena au conflit de 1962 puis la résistance du premier syndicat aux pressions et aux brimades de la direction, les ouvriers retracent toute l'histoire de Chisso1 . L'un d'eux qui était
11 Contraction de Zeneraru sekiyû Jd^- 7 >W7ftll (General Oil). 12 Sairen, 12 décembre 1970. 13 Asahi gurafu, « Kôgai kigyô no naibu zôhan » (ù\X!i^-M<O\Hî^yiàU. (La contestation au sein
des entreprises pollueuses), 7 août 1970, p. 18-30. Le même numéro comporte également un article d'OKAMOTO Tatsuaki, « Tachiagaru made no nagai kurushimi » iï.% i:A5'£ è. "CWMv j # L h- (De longues souffrances jusqu'au sursaut), p. 19-24.
' En ce qui concerne les brimades infligées aux ouvriers du premier syndicat après la grève de 1962, voir KlKUCHI Masanori, op. cit., et Anchin tôsô 'icîîU3?f, document de 466 pages publié à l'issue du procès en juin 1 973 par la Gôka Rôren et le premier syndicat de Chisso.
PaulJobin 33
contremaître dans l'usine que Chisso possédait en Corée jusqu'en 1945, évoque l'humiliation qu'il infligeait lui-même aux ouvriers coréens sur les conseils de la direction ; il était censé les frapper avec un bâton s'ils n'obéissaient pas assez vite. Le ton est celui de l'aveu mais serein et résolu, répondant avec précision à chaque question. Tout son témoignage montre comment le racisme était une politique volontaire de Chisso en Corée, et comment ce racisme s'est poursuivi après-guerre à Minamata. On pourrait le rapprocher de ces anciens soldats japonais qui, malgré les menaces constantes dont ils font encore l'objet, ont le courage de témoigner des exactions commises pendant la Seconde Guerre mondiale . Mus par une indignation plus radicale, les « pollueurs pollués » dépassent leur propre honte et atteignent ainsi le cœur du système, sa logique fondamentale .
Le témoignage de ces ouvriers contribue également à prouver l'ampleur de la faute : la direction de l'usine est allée jusqu'à fabriquer un filtre factice pour faire croire que la pollution était définitivement supprimée à sa source. En janvier I960 fut inaugurée au cours d'une cérémonie sous les auspices du préfet, une nouvelle installation pompeusement nommée par la direction saikuretâ 1M 9 Vf— , pour cyclator, comme s'il s'agissait d'un terme techno-scientifique anglais, suggérant un mouvement circulaire, censé filtrer l'eau contenant le mercure avant de la rejeter dans la mer. Le président de Shin Nichitsu venu de Tôkyô pour l'occasion, but devant tout le monde un verre d'eau extrait du prétendu filtre. Comme le confirmera plus tard le directeur de l'usine, ce subterfuge était destiné à atténuer la tempête sociale provoquée par la révolte des pêcheurs. Il fut suffisamment efficace pour abuser tout le monde, y compris les médecins de Kumamoto qui ne comprendront pas que malgré cette précaution, le nombre de malades ait continué à augmenter . Le « cyclator » représente le symbole achevé du cynisme de Chisso et de l'État qui a couvert cet odieux mensonge. Hormis ceux qui avaient été impliqués dans la
1 Ainsi en novembre 2000 à Tôkyô, lors du « tribunal international des crimes de guerre envers les femmes », deux de ces anciens soldats sont venus apporter leur témoignage {Asahi shinbun $] rilfiîr], 11 décembre 2000, p. 18). Pour un témoignage complet d'un de ces soldats, voir Shûkan Kin.yôbi j$[ii]-feWfl! 1. 8 septembre 2000, p. 54-56. En ce qui concerne le tribunal de décembre 2000, voir les articles parus dans les numéros de décembre 2000 et mars 2001 de la revue Sekai RtW-.
1 Gôka rôren shin nichitsu rôdô kumiai ùW)l"MW\\\itl3iWl%L[î\ (Fédération des syndicats de la chimie, syndicat de Shin Nihon Chisso [premier syndicat de Chisso]), « Témoignage de Kama Kanesaku ïÊ<fëf1; », Minamata-byô saiban ni okern Minamata kôjô daiichi kumiai rôdôsha no shôgen ; anchintôsô 10 shûnen /Kfétà$Wcfett £*fë T.4J® "Ilfr^d-fîWJiliK ; 'iilWA'l* l 0 Ml ^ (Témoignage des ouvriers du premier syndicat de l'usine de Minamata au procès de la maladie de Minamata ; 10e anniversaire de la grève de 1962), 1972, p. 19-32. Concernant l'histoire de l'usine Chisso en Corée, voir OKAMOTO Tatsuaki et MATSUZAKI Tsugio tôtëj^ifj, Kikigaki Minamata minshûshi liflftSt^kfë R^îAî ;Shoknminchi wa tengoku datta [îfl # {!? È /RfëR^cSfc, fiSKifili^O/f r> tz (Histoire orale et populaire de Minamata, vol. V ; Les colonies, c'était le paradis), Tôkyô, Sôfukan ?£MM, 1 990.
17 « Témoignage d'ONITSUKA Masato », dans Minamata-byô saiban..., op. cit., p. 96-100. Voir aussi GEORGE Timothy S., op. cit. , p. 114-11 5, et TSUCHIMOTO Noriaki, Minamata-byô sono 30 nen /J<f^fe:-?-co3O^-- (Trente années de la maladie de Minamata), Tôkyô, Seirinsha-Shiguro f/
, 1986.
34 IA MALADIE DE MlNAMA TA ET LE CONFLIT POUR LA RECONNAISSANCE
construction de ce filtre factice, la plupart des ouvriers furent également abusés par cette supercherie. L'usine continua ainsi à déverser le mercure dans la mer jusqu'en 1968, date à laquelle la direction renonça à son usage moins pour interrompre la pollution que parce que ce procédé n'était désormais plus rentable pour produire l'acétaldéhyde .
Ces révélations auront un impact décisif sur la sentence sévère prononcée contre Chisso un an plus tard en 1973. Parallèlement à leur contribution au groupe du procès pour prouver la faute de Chisso, le docteur Harada Masazumi et Yamashita Yoshihiro lilTîHi, un membre du premier syndicat, entreprennent discrètement une première enquête sur la maladie de Minamata auprès des ouvriers de Chisso, qu'ils soient du premier ou du deuxième syndicat. Nombre d'entre eux manifestent des symptômes de la maladie, mais qui se confondent avec les pathologies propres aux usines chimiques, provoquées par les émanations de gaz et la manipulation de produits toxiques. En 1976, le fait que 1 1 ouvriers du premier syndicat et 4 du deuxième obtiennent la reconnaissance au titre de la maladie de Minamata, donne à penser qu'un grand nombre d'ouvriers n'osent pas faire la demande de reconnaissance craignant d'être licenciés. En 1985, une enquête épidémiologique réalisée par l'équipe d'Harada auprès de 300 ouvriers révèle que 70 % des ouvriers en fonction et 90 % des ouvriers retraités présentent des symptômes sérieux de la
1 J- 19 maladie .
Harada Masazumi se rend aussi régulièrement à Miike pour y assister les victimes de l'explosion de 1963. Ces aller-retours entre Miike et Minamata ont fait de lui un médecin très attentif à la relation entre maladies professionnelles et maladies de la pollution . Cela lui permet d'apporter une contribution essentielle
L'acétaldéhyde (CH3CHO) est un liquide permettant à son tour de produire de l'acide acétique (CH3COOH) dont les applications industrielles sont multiples : chlorure de vinyle, buthanol, octanol, DOP, acétate d'éthyle, acide de vinyle et polyvinyle, fibres synthétiques de vinyle, etc. Les produits en plastique devinrent ainsi pour certains malades et certains auteurs de réflexions sur la tragédie de Minamata le symbole d'une société de consommation obnubilée par la technoscience et le confort matériel, au point de ne plus voir ce que cette aisance implique parfois. Voir infraïa. réflexion d'Ogata Masato Hf/jiEÀ.
KlKUCHI Masanori, Entretiens avec Yamashita à Minamata, octobre et décembre 1998, op. cit., p. 559.
KlNO Shigeru ~fcff&, Kankyô to ningen, kôgai ni manabu Jm41 t ÀRSk &•'#(;:'/:.<£ (L'homme et l'environnement : apprendre de la pollution), Tôkyô, Tôkyô kyôgakusha iftjj(|!c'r4h, 1995, p. 111.
HARADA Masazumi, « Chisso Minamata kôjô rôdôsha no kenkô chôsa, kôgaibyô to shokugyôbyô no setten >» -f -y V MXA V.VàOjWlfiVmiMMft., 'uk'tifà tUffliïcDfêti (Enquête sur l'état de santé des ouvriers de l'usine Chisso de Minamata, point de rencontre entre les pathologies environnementales et les maladies professionnelles), dans TAKAMATSU Makoto, Hataraku hitobito no mondai fil < Ktf t C9|!îJ!ffl (Problèmes des travailleurs), Tôkyô, Iryô tosho shuppansha Kftffel.'fi'iilifcfl:, 1990, p. 197-218.
Entretiens avec l'auteur à Kumamoto et Minamata en octobre 1998, et HARADA Masazumi, Yama no tomoshibi wa kiete mo ; Miikekô tanjin bakukatsu niyoru CO chûdoku no 33 nen )il$k<r)ï\ 'fàrfi À.X fc, \7l!iJy<l£UÂ/it!$!fê(c J; SCO'l'iijcDSS^I^Même si les lampes de la mine s'éteignent, les victimes de l'empoisonnement au monoxyde de carbone demeurent, trente-trois ans après l'explosion), Tôkyô,
PaulJobin 35
à la formation d'un réseau national pour la prévention et la reconnaissance des accidents du travail et maladies professionnelles, la Conférence nationale de liaison des centres d'hygiène et de sécurité au travail (Zenkoku rôdô anzen eisei sentâ renraku kaigi, ^m^ffi^c^ftf^-fe > 9— jÈft&ûM, plus connu au Japon sous son abréviation, Anzen sentâ, et à l'étranger sous ses initiales de JOSHRC21). Reconnu internationalement pour ses travaux épidémiologiques sur la maladie de Minamata, il est fréquemment sollicité à l'étranger lorsque surviennent des cas semblables : au Canada en 1975, en Chine en 1981 (où il se rend avec Yamashita), au Brésil, en Tanzanie . En 1984, à Bhopal en Inde, survient l'explosion de l'usine de la firme américaine Union Carbide . Là encore, la priorité donnée aux économies budgétaires a fait négliger la sécurité des ouvriers et des habitants. À travers Harada Masazumi et le JOSHRC, une solidarité va naître entre les victimes de Minamata et celles de Bhopal. Parallèlement à son action de soutien palliatif et de revendication, ce réseau provoque également une réflexion théorique cherchant des alternatives au schéma ultra-libéral d'exportation de la pollution et d'importation de travailleurs migrants.
Une critique de la modernité « à la dérive »
Malgré sa position excentrée et rurale, Minamata fut une zone de migration, et cette question occupe une place importante dans plusieurs ouvrages consacrés à l'histoire de la maladie. Ainsi l'écrivain Ishimure Michiko recourt fréquemment à la notion de ryûmin MEK dont il n'est pas aisé de trouver un équivalent satisfaisant en français ; Ishimure l'emploie pour désigner des migrants comme s'ils s'étaient échoués après avoir été livrés aux caprices des courants : on pourrait dire des
Nihon hyôronsha, I l^.ïflMI:, 1997. ' Pour : Japan Occupational Safety and Health Resource Center. Les bureaux de liaison de
Tôkyô et Osaka réalisent d'excellentes synthèses mensuelles des avancées en matière d'ergonomie et toxicologie préventives des pathologies professionnelles ; ils accomplissent également un intense travail d'analyse critique de la législation, et mènent au besoin des actions de lobbying pour la transformer. L'action engagée depuis sa création pour obtenir l'interdiction de l'amiante porte enfin ses fruits (depuis 2002). Un grand colloque international sur ce sujet est prévu à Tôkyô, en novembre 2004 (http://www.jca.apc.org/joshrc/). Le JOSHRC a également créé le prix Tajiri qui récompense chaque année des personnes engagées contre la pollution industrielle et pour la prévention des maladies professionnelles, en mémoire du fondateur du JOSCHR, Tajiri Muneaki IH//v,j;H#, figure attachante au parcours extraordinaire, qui avait commencé son combat contre la pollution lorsqu'il était garde-côte à Yokkaichi. Voir TAJIRI Muneaki, Kôgai tekihatsti saizensen te'.HMÏÏiluWiM (Le dernier front de lutte contre la pollution), Tôkyô, Iwanami shinsho Viî&fri'f, 1980.
22 HARADA Masazumi, Minamata ni manabu tabi, Minamata-byè no mae ni Minamata-byô tua nakkata MAl^'Y'&lifc, ski'ÀfâOùîîlc/kWiïlittfcitz (Le voyage d'étude à Minamata: avant la maladie de Minamata, il n'y avait pas de maladie de Minamata), Tôkyô, Nihon hyôronsha, 1985 ; Minamata ga utsusu sekai /KfAti^'S'fWfi- (Le monde que reflète Minamata), Tôkyô, Nihon hyôronsha, 1989.
23 Celle-ci fut par ailleurs une concurrente de Chisso pour la production de chlorure de vinyle polymère (rapport de Hoshino Yoshiro hlWfTJfN pour la Fédération de la chimie [Gôka Rôren] et le premier syndicat de Chisso, 23 octobre 1970, p. 8).
36 La maladie de Minamata et le confut pour la reconnaissance
« dérivants » ou des « dérivés ». Lors de la représentation du premier long-métrage que Tsuchimoto Noriaki consacra à Minamata en 1971 , Ishimure prononce un discours dans lequel cette notion émerge de son histoire personnelle :
Je suis née dans la petite île Amakusajima, au milieu de la Mer Shiranui, dans le département de Kumamoto ; c 'est là qu 'il y eut la révolte d'Amakusajima . Mes parents sont tous deux dAmakusajima. L 'île Amakusajima semble isolée du continent. Récemment on parle beaucoup de « zone frontière». Et bien c'est une sorte de zone frontière. Les gens qui sont nés sur cette île ont une sorte de destin. Comme la population est nombreuse et qu 'elle ne peut se subvenir à elle-même, on laisse la maison à l'aîné ou à quelqu'un qui fait office de, et tous les autres n 'ont plus qu 'à partir. Bien sûr ma mère et mon père portaient eux aussi ce destin, et environ trois mois après ma naissance, ils sont venus à Minamata. [...] Il y avait ainsi un nom pour chaque maison selon son origine : « cette maison-là dérive de Satsuma », « celle-là dérive d'Amakusajima » ou « celle-là dérive de l'Amérique » [...]. Et cela désignait les gens qui sont revenus (nagarete kita fàtiX ^.tz) parce qu 'ils n 'ont pu rester à Satsuma, ou ceux qui n 'ont pu rester à Amakusajima ; ou bien encore ceux qui depuis Amakusajima sont partis pour l'Amérique latine, les Philippines, etc. Mais ils n'ont pas pu y rester. Alors ils sont revenus, mais sans réussir tout à fait. Ils ont tourné autour de leur village natal, et puis ils se sont fixés ici. Ils ont formé ce village. Voilà ce que ces expressions désignent. [...] Autrefois à Minamata, on faisait du sel, des bougies à partir des arbres haze très nombreux. Il y avait des camélias tout le long de la mer, d'une luxuriance telle qu'on aurait dit une forêt primaire de camélias, et il y avait des maisons qui tiraient de l'huile du fruit de ces camélias. [. . .] Et c'est ici que vers 1907 s'est installée l'usine Chisso. A ce moment, dans les villages autour de Minamata, comme dans tout le sud de Kyûshû, mon père me disait souvent que les gens venus des îles Amakusajima à Minamata, s'ils n arrivaient pas à travailler dans « la firme » (de n 'importe quelle usine, on disait « la firme » — kaisha —), ils voulaient du moins vivre à côté. [...] Les habitants du sud de Kyûshû, et en particulier ceux d'Amakusajima, allaient travailler aux chantiers navals de Nagasaki, à la mine de Miike ou à celle de Chikuhô [...]. Mais y aller n 'était pas le tout. Le chantier naval de Nagasaki, [...] c'était complètement impossible d'y entrer pour des pêcheurs du peuple comme nous. [. . .] Pour ceux qui n 'étaient pas allés à l'école, c'était comme un rêve. Au mieux, ils entraient chez des sous-traitants de sous-traitants comme on dirait aujourd'hui.
2 Minamata kanjasan to sono sekai /.Kf>ôlil-ltï£^ h ^colLW (Minamata, les malades et leur monde), Higashi Purodakushon, 35 mm. /16 mm., noir et blanc, 2 h. 47 min. (il existe également une version de 2 h. sous-titrée en français ou en anglais), 1971. L'Athénée français de Tôkyô et le premier syndicat de Chisso apportèrent leur soutien à cette production.
25 Amakusa no ran ^oï'-^SL, ou Amakusa ikki MW -\% également appelée « émeute de Shimabara ». Entre 1637 et 1638, près de 27 000 paysans de Shimabara et d'Amakusa se soulevèrent contre les mesures anti-chrétiennes et des impôts outranciers de leur daimyô en occupant le château de Hara. Après trois mois de siège, ils y furent finalement tous massacrés mais après avoir infligé de lourdes pertes aux troupes du shogun et des fiefs de Kyûshû (près de 20 000 morts) mobilisées contre eux. Les paysans d'Amakusa avaient choisi un jeune chrétien de quinze ans, Masuda Shirô Tokisada tèlllkHfiP-îi'i comme chef spirituel {Dictionnaire historique du Japon ; cf également James White, Ikki, Social Conflict and Political Protest in Early Modem Japan, Ithaca, Cornell U. Press, 1995, p. 100 et 1 16). Sous l'influence d'Ishimure, cette notion de ikki a largement inspiré le mouvement de contestation des malades de Minamata à partir de 1970 ; Tsuchimoto Noriaki l'utilisera même pour le titre de son deuxième long métrage sur Minamata : Minamata ikki /Kfë 'fë, Seirinsha Ti^f?, 16 mm., noir et blanc, 1 h. 48 min., 1973 ; transcription dans TSUCHIMOTO Noriaki, Eiga wa ikimono no shigoto de rfn<lïftij{i'_Ë#^Of±(îfT&3(Le film est un travail d'êtres vivants), Tôkyô, Miraisha 'AïMï., 1974.
2 Satsuma nagare WMïï&fî-, Amakusa nagare XÇ'-Mtft, etc. : nagare MEti renvoie au ryû de ryiimin.
PaulJobin 37
Et celui qui trouvait un tel emploi en traversant Nagasaki en était même très heureux. [...] Pourtant tous ceux qui sont allés au chantier naval de Nagasaki sont revenus sourds. Comme la grande majorité d'entre eux ne pouvait devenir ouvrier, tout ce qu 'on leur donnait comme travail, c'était d'enlever avec une sorte de marteau la rouille et les coquillages sur la coque des bateaux qui venaient d'arriver à Nagasaki. Les coups de marteaux résonnaient tellement au 'ils en revenaient complètement sourds. Ils étaient désormais inutilisables. Quant à la mine, c'était là où allaient les petits criminels et les sortis de prison qui ne pouvaient plus rester vivre dans leur village [...]. Alors ceux qui ne voulaient ni la mine ni le chantier, ils devaient traverser la mer, jusqu 'en Chine, le Pacifique Sud, ou l'Amérique. Mais de ceux qui partaient dans ces pays étrangers [...], nous ne savions même pas si un seul reviendrait au village. A Amakusajima, lorsque quelqu 'un partait [...], au moment de quitter le village, toute la famille se rassemblait pour le pot d'adieu. Le dernier toast était porté à celui qui prendrait soin de la tombe et des tablettes mortuaires de sa famille. On ne savait pas s 'il reviendrait mais il confiait ce qu 'on appelle le champ de tablettes, en disant : « Garde ce toast jusqu'à mon retour ». Et lorsqu 'il reviendrait, on ferait un pot de retour. [...] Une nouvelle s'est mise à circider sur la mer : « Sur l'autre rive, à Minamata, il y a une société qui s'installe. [...] Plutôt que de traverser la mer pour aller dans un endroit lointain, mieux vaut aller sur l'autre rive, à Minamata d'où l'on pourra voir notre maison. »[...] Au fur et à mesure que grandissait l'usine Chisso, la ville florissait et devenait une « capitale » ; ils se disaient ainsi qu'il leur fallait devenir membre de cette capitale, [...] même s'ils ne pouvaient devenir ouvriers de l'usine. [...] La plupart des familles aujourd'hui affectées par la maladie de Minamata sont originaires des îles Amakusajima .
Ce discours d'Ishimure converge avec les témoignages recueillis par Okamoto Tatsuaki et Matsuzaki Tsugio dans Y Histoire orale et populaire de Minamata . Ceux-ci tendent à montrer qu'à la fin de l'ère Meiji, cette région du sud de Kyûshû (préfecture actuelle de Kumamoto) était une région relativement pauvre sur le plan agricole. Cela pourrait expliquer pourquoi la préfecture de Kumamoto représentait le deuxième groupe d'émigration vers le Pérou avant-guerre, le premier étant Okinawa . Il convient toutefois de se méfier d'une perception « misérabiliste » de la migration réduite à un pis-aller, un phénomène négatif parce qu'il n'y a presque pas de retour. Du point de vue des descendants des migrants partis pour l'Amérique, les Nikkei 3 t&À, cette histoire ne fut pas que négative ; même si elle a généré des frictions, elle a donné lieu à une contribution originale à l'histoire de l'Amérique et
7 Ce discours a été publié dans un ouvrage collectif sous la direction dlSHIMURE Michiko, Waga shimin, Minamata-byô tôsô hmiK, '/kfAtâtëA'I* (Notre peuple mourant, le combat de la maladie de Minamata), Tôkyô, Gendai hyôronsha flifyfjtai'l:, 1972, p. 15-18, puis dans un recueil d'articles d'ISHIMURE Michiko sous le titre précisément de Ryûmin no miyako IK^fl! (Capitale des dérivants), Tôkyô, Yamato shobô X%\él>jj, 1973 (réédition en 1978), p. 37-41. Ishimure a repris cette expression de « capitale des dérivants » en titre de chapitre d'un livre qui résume l'histoire de la domination de Chisso sur la région de Minamata depuis la création de l'usine jusqu'à la réaction des malades à partir de 1968 : Shiranuikai, Minamata, owarinaki takakai ^%\'XM, MA, ffët>i)/£%tz.tzfr\<i (La Mer Shiranui, Minamata, un combat sans fin), Tôkyô, Sôjusha fflfêtti:, 1973, photographies de SMITH Eugene, SHIOTA Takeshi et MIYAMOTO Shigemi.
28 OKAMOTO Tatsuaki, MATSUZAKI Tsugio, op. cit., I, Meiji no mura ŒfëwW (Le village de Meiji).
29 MORIMOTO Amelia, Poblaciôn de origen japonés en el Peru - Perfil actual (La population d'origine japonaise au Pérou : profil actuel), Lima, Centro Cultural Japones, 1991, p. 110-112.
38 La maladie de Minama ta et le conflit pour la reconnaissance
du Japon depuis 1991, puisqu'une partie de ces descendants est « revenue » au Japon . En revanche, ce qui mérite attention dans ces propos d'Ishimure, c'est sa critique embarrassée de la modernité : comme si elle oscillait entre, d'une part, les bienfaits possibles de l'industrialisation dans la mesure où elle permet d'éviter la migration dans le lointain, et, d'autre part l'écœurement devant ce que cette industrialisation a provoqué à Minamata. Elle se remémore la pénurie matérielle de cette région en décrivant avec réalisme le dilemme auquel étaient confrontés les jeunes, entre la mine ou le chantier naval. Elle ne fait pas mention d'une des conséquences les plus sombres de cette pénurie des zones rurales avant la révolution industrielle et qui fait l'objet de débats parmi les historiens : l'infanticide économique, appelé « l'éclaircissement des plans » mabiki Wï*j\1ê . Ishimure insiste plutôt sur une nostalgie de la communauté villageoise, de son cadre naturel (les camélias, etc.), et une rancœur contre Chisso qui a détruit l'une et l'autre.
Frappé par ce discours d'Ishimure, Watanabe Kyôji iïtEîÏTC—, un écrivain de Kumamoto membre de l'Association qui accuse, s'est efforcé d'appliquer la notion de ryûmin aux ouvriers en parlant de ryûmingata rôdôsha ^tKM^fiÔ^f, que l'on pourrait traduire par « ouvriers dérivés » :
Satô Takeharu est actuellement membre du premier syndicat de Chisso, mais auparavant il était pêcheur. En I960, il a été employé par Chisso au titre des compensations aux pêcheurs. Il dit qu 'à ce moment il était du côté de Chisso et qu 'il faisait beaucoup d'efforts pour calmer les inquiétudes de la coopérative des pêcheurs. Lui qui dix ans après est devenu un meneur de la lutte pour des négociations autonomes, on peut dire qu'il a subi une métamorphose. [...] On peut dire que sa vie représente un exemple classique de ces migrants de la région de la Mer Shiranui qui en une génération se sont transformés en ouvriers dérivés. Maintenant que s'est interrompu le cycle de retour d'ouvrier à pêcheur, on peut percevoir un changement très clair parmi les consciences entre la société de cette région et l'usine Chisso. Les ouvriers dérivés se sont formés sur cette base. C'est-à-dire qu 'entre l'usine Chisso et cette population flottant autour d'elle il y a désormais une relation d'égalité des consciences. Une expression concrète de cela, c'est la façon dont chacun des ouvriers de l'usine et des petits pêcheurs a grandi en humanité, comme une chenille se transforme en papillon. On peut dire qu'aujourd'hui cette mutation s'est complètement accomplie. Les ouvriers de l'usine se comportent comme s'ils ne s'étaient jamais vraiment séparés de la nature [...], comme s'ils étaient reliés à une conscience qui fait de la mer un principe originel, et si on se place du côté des ouvriers dérivés, comme si
3 JOBIN Paul, « Les dekaseguis nikkeis dix ans après ; le cas des ouvriers de l'aéroport de Tôkyô», dans PETRICH Perla, Histoire et mémoires des migrations en Amérique latine, Travaux et documents, n° 14, Université Paris 8, décembre 2001, p. 39-60.
31 Sur cette question, voir par exemple HAYAMI Akira jJj/KMÈ, Tokugawa shakai kara no tenbà ; hatten, kôzô, kokusai kankei Î$JII*1:£*> £ <DÏ&pd ■ %SL 1fêju> HBKIÎIH& (Panorama depuis la société des Tokugawa : développement, structure, relations internationales), Tôkyô, Dôbunkan FdJ^fifi, 1989.
32 Watanabe Kyôji s'est sans doute inspiré de l'expression dekasegigata rôdôsha li'i^M-È'M'Tj^fi sur laquelle Okochi Kazuo XMfà -'J) a construit une théorie devenue célèbre dans l'histoire et la sociologie du mouvement ouvrier au Japon. Pour une lecture critique et passionnante de cette théorie, voir NlMURA Kazuo '-H \k, The Ashio Riot of 1907 : a Social History of Mining in Japan, Duke University Press, 1997, p. 155-211 (préface d'A. Gordon).
PaulJobin 39
avait pris fin le monopole de l'usine sur toute la région de la Mer Shiranui .
Depuis les années 1940, c'est-à-dire avant l'apparition de la maladie en 1956, Chisso négociait déjà avec les coopératives de pêcheurs son « droit à polluer » la Mer de Shiranui. Comble du paradoxe, lors d'un de ces accords, le 25 octobre I960, 35 pêcheurs furent employés comme ouvriers salariés de Chisso et 9 comme salariés de l'un de ses 32 sous-traitants, la société Senkô Un.yu (SIPijMlii Senkô transports). Parmi ceux qui ne bénéficièrent pas de ce « privilège », certains devinrent ouvriers temporaires de Chisso ou de ses sous-traitants. Ces pêcheurs devenus ouvriers, comme les autres ouvriers de la sous-traitance recevaient bien sûr les tâches les plus dangereuses et les plus mal payées \ Les photographies que Kuwabara Shisei a prises à Minamata au début des années I960 montrent la misère à laquelle ces familles étaient acculées par Chisso .
Cette métamorphose des « ouvriers dérivés » récapitule un siècle de l'histoire de Minamata, depuis la fascination des habitants de la région pour l'industrie chimique et ses promesses de développement, jusqu'à la désillusion révoltée qui demande réparation. Watanabe inclut dans cette catégorie d'« ouvriers dérivés » tous ceux qui sont sortis de la torpeur du productivisme et de la « conscience d'entreprise ». Il rassemble en fait tous les ouvriers de la région de Minamata, qu'ils soient employés par Chisso au titre des compensations de I960, intérimaires, sous-traitants, ou membres du premier syndicat ; il évoque enfin ces ouvriers, très nombreux à Minamata, qui complètent leur salaire avec le fruit de la pêche ou le travail d'un lopin de terre. Mais l'appartenance géographique des « ouvriers dérivés » importe moins que la topographie de leurs consciences : la ligne de démarcation réside entre ceux qui se soumettent et ceux qui résistent à l'idéologie de la direction. En se libérant de ce que Kikuchi Masanori appelle le « nationalisme étroit » qui
33 WATANABE Kyôji, « Ryûmingata rôdôsha ko » tfUWJiWltiC (Réflexion sur les ouvriers dérivés). Cet article est d'abord paru en septembre 1972 dans la revue Getidai no me fliRcoHU (Les yeux d'aujourd'hui), avant d'être repris dans un recueil de textes sous la direction d'ISHIMURE Michiko, Ten noyamu J-iOfàù (La souffrance du ciel), Fukuoka, Ashi shobô ft.'fW, 1974, p. 41-58.
34 ISHIDA Takeshi -f iHIflÉ, dans IROKAWA Daikichi, Minamata no keiji, Shiranuikai sôgô chôsa hôkoku, op. cit., p. 59-61.
35 KUWABARA Shisei, Minamata-byô 1960-1970, Shashin kiroku M'Âtâ 1960-1970 ''/lï.idl* (La maladie de Minamata, 1960-1970, enregistrements photographiques), Tôkyô, Asahi shinbunsha •lilJI I OTJilll., 1970, et Minamata no hito bito WA<n ktf t (Les gens de Minamata), Tôkyô, Kusanone shuppansha 'V'-Wftlll'iliitfl:, 1998, en particulier p. 48-61, concernant la famille d'Uemura Yoshio h M $/!iJ, employé de Senkô Un.yû. Mais c'est surtout la photographie qu'Eugène Smith a prise de sa fille Tomoko f"V /■, qui est devenue mondialement célèbre. Publiée pour la première fois en juin 1972 dans Life, cette photographie représente Tomoko, une malade congénitale, portée par sa mère Yoshiko A-jf- dans le bain. Comparée à une Piéta, elle devint une sorte d'icône, une image symbole de la maladie de Minamata. Elle a été retenue parmi les « 100 photos du siècle » de la série diffusée par Arte en 1998. Depuis, à la demande de Yoshio et Yoshiko, cette photographie a été interdite de publication sur tout support médiatique. Pour la consulter, voir l'album d'Eugène et Aileen Smith, Minamata, New- York, Rhinehart & Winston, 1975.
40 La maladie de Minama ta et le conflit pour la reconnaissance
attribue la fortune de Minamata à Chisso, ils ont repris leurs droits pour affirmer que Chisso n'est rien sans Minamata, et que c'est à Chisso de leur rendre des comptes. Les « ouvriers dérivés » auraient ainsi retrouvé « l'harmonie avec la nature ». À travers ces propos d'Ishimure et de Watanabe, on voit comment « l'école de Minamata » concilie d'une part la critique de la modernité techniciste propre à la « nouvelle gauche » des années soixante-huit, et d'autre part, un esprit frondeur hérité du mouvement ouvrier des années cinquante et soixante.
Une quête de confrontation directe
À l'automne 1971, alors que toute l'attention se focalisait sur le procès ou l'arbitrage, deux malades jusqu'alors tenus dans l'ombre du groupe du procès, Kawamoto Teruo JU^)£sp^:, et Satô Takeharu décident de s'attaquer à la partie immergée de l'iceberg : de nombreux malades ne sont même pas reconnus comme tels en raison des critères extrêmement restrictifs imposés par le ministère de la Santé. Après avoir dénoncé cette situation pendant deux ans, ils réussissent à obtenir du préfet de Kumamoto la reconnaissance au titre de « malades de Minamata » (Minamata-byô kanja 7j<f^^M#) pour eux et 16 autres patients. Ce groupe de « nouveaux malades reconnus » (shin.nintei kanja ffiM'JË.M^Ê) entame aussitôt des négociations directes avec Chisso, sans médiation. Leurs exigences, apparemment démesurées, effraient le groupe pour l'arbitrage et une partie du groupe du procès, qui craignent qu'elles ne fassent échouer les efforts de chacun : Kawamoto et Satô réclament 3 000 000 000 yens par malade alors que le groupe du procès se contente de 1 800 000 000 yens. À l'exception d'Ishimure Michiko et de quelques membres du premier syndicat (dont Yamashita Yoshihiro et Hanada Toshio), le groupe de Kawamoto et Satô recevra son soutien de l'extérieur de Minamata : l'Association qui accuse, dont le réseau national recoupe celui de la Ligue contre la guerre du Vietnam, et des personnalités comme le médecin Harada Masazumi, le réalisateur Tsuchimoto Noriaki et le photographe Eugene Smith.
Après un premier sit-in devant l'usine à Minamata, en décembre 1971, et comme Chisso refuse de négocier, le groupe de Kawamoto et Satô monte à Tôkyô et s'installe devant le siège de la société. Ils y sont harcelés par un service d'ordre musclé composé d'employés et d'ouvriers de l'usine de Goi E#36. En janvier
À côté de Chiba, à environ une heure de train depuis la gare de Tôkyô près de laquelle se trouve le siège de la firme. Ce recours aux ouvriers de Goi est d'autant plus facile pour la direction que l'usine de Goi a été « façonnée maison » par la direction : il n'y a qu'un deuxième syndicat, comme au siège de Tôkyô ou à la branche d'Osaka. Cette usine pétrochimique était destinée à remplacer celle de Minamata qui était jugée obsolète parce qu'électrochimique et éloignée des grands conglomérats industriels (la logique du kombinâto pétrochimique permettant des économies d'échelle plus importantes). De nombreux ouvriers de Minamata y furent mutés. Après avoir pollué la région, la direction de Chisso entendait bien l'abandonner à son sort. Mais la résistance du premier syndicat déjouera ce projet, en obligeant le principal actionnaire de Chisso, la banque industrielle Kôgin, et l'État, d'assumer leur responsabilité à l'égard des malades de Minamata.
PaulJobin 41
1972, à l'invitation du secrétaire exécutif du deuxième syndicat, le groupe de Kawamoto et Satô se rend à l'usine de Goi pour expliquer la cause de son action. C'est un piège qui leur a été tendu et ils sont violemment battus par les ouvriers. Kawamoto a la figure en sang. Le photographe Eugene Smith qui était au côté de Kawamoto ne se remettra jamais de ses lésions à la main et à l'œil. Il ne dépose pas de plainte contre Chisso, estimant que cela risquerait de détourner l'attention des médias sur lui-même mais il saura user de sa célébrité contre la direction de Chisso pour soutenir le groupe de Kawamoto et Satô . La direction continuera néanmoins à disqualifier l'action du groupe de Kawamoto comme étant une action d'extrémistes attirés par l'appât du gain, et soutenus par des « gauchistes violents », cette interprétation étant relayée par les tracts et le journal du deuxième syndicat38. Les jours suivants, le premier syndicat de l'usine de Minamata adresse une lettre de protestation contre le syndicat de l'usine de Goi, mais sans que cela exprime de manière significative un ralliement à la cause de Kawamoto et Satô . La fédération des syndicats de la chimie, la Gôka Rôren réagit également très peu. Par la suite, lorsque le journal du premier syndicat mentionne l'action de Kawamoto et Satô, c'est toujours de façon brève. Pourquoi cette distance envers le groupe de Kawamoto et Satô alors que le premier syndicat s'est engagé de façon pourtant radicale au côté des partisans pour l'arbitrage et ceux du procès ?
Les revendications de Kawamoto et Satô ne cadrent pas avec la rhétorique traditionnelle de la lutte des classes utilisée par la Gôka Rôren et la Sôhyô. Malgré quelques participations communes de la Sôhyô avec la Beheiren lors des grandes manifestations annuelles contre la guerre du Vietnam, et malgré l'opposition très forte entre la Sôhyô et les centrales liées au PCJ, il existe une méfiance entre les cadres de la Sôhyô et la « nouvelle gauche » qui rassemble les jeunes ouvriers membres des « comités de jeunes contre la guerre » {hansen seinen iinkai W$M%r HMâO, les étudiants gauchistes, et ces intellectuels en quête d'une critique de la modernité. Des hommes tels que Kawamoto, Satô et les intellectuels qui les soutiennent n'ont toujours pas accepté que, pendant la grève contre « les salaires
Sur les événements de Goi : George Timothy S., op. cit., p. 233-234. iKEiMI Tetsuji îtoîilfT""], Minamata-byô tèsô no kiseki ; kurohata no motoni /JcfiifàlïH
"tC (Sur les traces du combat de la maladie de Minamata : sous les bannières noires), Tôkyô, Ryokufû shuppan tttfUI'.IK, 1996, p. 29-33.
ISHIMUREMichiko, Owarinaki tatakai, op. cit., p. 226-227. MlSHIMA Akio, Bitter Sea: The Human Cost of Minamata Disease, Tôkyô, Kosei, 1992,
p. 176-178. Sur l'engagement d'Eugène et Aileen Smith à Minamata : GEORGE Timothy S., op. cit.,
p. 212-214. Notamment dans le numéro de Shinrô W\'Ji, le périodique du deuxième syndicat, du 13
janvier. Kôgibun bu&SC, adressée au président de Chisso, Shimada Ken.ichi ftlH?f? ■, signée par
Okamoto Tatsuaki, datée du 13 janvier 1972 (archives de Sôshisha). Ui Jun, Ishimure Michiko, Watanabe Kyôji, Tsuchimoto Noriaki, Honda Keikichi, Hidaka
42 La maladie de Minama ta et le conflit pour la reconnaissance
stabilisés » de 1962-1963, nulle mention n'ait alors été faite des pêcheurs acculés à la ruine et à la dépendance de Chisso, ni même des malades réduits à un abandon quasi total après l'inique solution qui leur fut imposée en 1959 . Dans leur critique de la modernité, ces intellectuels expriment des réserves sur les revendications traditionnelles du mouvement ouvrier parce qu'elles excluent ou limitent les revendications des victimes de la pollution industrielle. Plus radicalement que ne le ferait la Sôhyô, ils remettent en cause le « compromis fordiste » ou « toyotiste » de la haute croissance : avec sa fameuse « offensive de printemps » {shuntô #13) inaugurée à ses débuts dans les années 1950, la Sôhyô se contentait finalement d'une « répartition des fruits de la croissance » par une hausse des salaires régulière décidée entre le patronat et les syndicats. Des accords se feront entre ces intellectuels et l'aile gauche de la Sôhyô, mais la majeure partie de celle-ci restera méfiante envers ceux qu'elle considère comme des extrémistes ou de doux rêveurs. Cette méfiance est d'autant plus forte que le contexte de la Guerre froide a généré une forte polémique entre les partis et les syndicats de la vieille gauche (Parti socialiste et Sôhyô, Parti communiste) et leurs principaux adversaires de droite que sont le PLD et la centrale syndicale Dômei |s]§Ë pilotée par le Keidanren. La méfiance de la « vieille gauche » envers la « nouvelle gauche » est une « querelle des anciens et des modernes », sauf qu'ici les anciens sont des « modernes » et les modernes sont des critiques de la modernité.
Lors de la sentence du « second procès de la maladie de Minamata » contre la firme Shôwa Denkô à Niigata le 29 septembre 1971, les avocats paradent d'une façon qui choque certains malades. La maladie de Minamata est une tragédie qui ne saurait avoir de « victoire » judiciaire ; le sourire béat des avocats satisfaits de leur plaidoirie manque de dignité et tranche avec les banderoles portant le caractère £5 {on ou urami) qui signifie la « rancœur » et qu'on peut entendre ici comme une colère qui ne s'éteint jamais, une colère par-delà la mort . À Minamata, cet épisode consomma la rupture entre une partie du groupe du procès et les avocats. Le conflit était déjà ouvert entre les avocats et les membres de l'Association qui accuse. Les avocats voyaient les supporters des malades comme des « extrémistes », des « gauchistes », des « idéalistes », ce qui ne les empêcha pas d'utiliser, sans les
Rokurô, etc. Cet « accord » ou « contrat » (keiyaku 33 $j) de décembre 1959 qui attribuait des sommes
ridicules aux familles des malades les plus touchés suivait les accords du même genre passés avec les coopératives de pêche. Refusant le terme de « compensation » {hôshô ^fi'î), Chisso imposa celui de « consolation » {mimaikin iiUKftjen spécifiant que « même si à l'avenir, il était prouvé que les résidus de l'usine sont à l'origine de la maladie de Minamata, les malades s'engagent à ne pas faire d'autre demande d'argent ». Cette clause fut condamnée par la sentence de 1973.
2 Cette interprétation est d'Aileen-Mioko Smith, la femme du photographe Eugene Smith qui a pris des photographies impressionnantes de ces banderoles. Avec le caractère chinois écrit en blanc sur noir, elles évoquent les défilés ouvriers des années 1960 ou bien les batailles épiques des films de Kurosawa. C'est Ishimure qui en eut l'idée. Voir l'album de SMITH Eugene et Aileen, op. cit. , ou bien ISHIMURE Michiko, Owarinaki tatakai, op. cit., p. 186-195.
PaulJobin 43
citer, toutes les recherches accomplies par l'Association qui accuse 3. En juillet 1970, Gotô Takanori, un avocat de Tôkyô proche de l'Association qui accuse, envisage d'acheter des actions de Chisso afin de permettre aux malades d'exprimer directement leur colère lors de l'assemblée annuelle des actionnaires. L'idée plaît aux supporters et au groupe du procès . Les avocats de Kumamoto par contre ne comprennent pas ce désir et s'opposent à cette action qui risque à leurs yeux de compromettre le bon déroulement du procès, seul à même selon eux d'apporter les indemnités souhaitables . Les avocats ne comprennent pas qu'à travers leur plainte et la demande de réparation financière, les malades veulent aussi une confrontation directe avec les dirigeants de Chisso, pour leur exprimer les souffrances physiques, l'humiliation et l'ostracisme qu'ils ont subis jusqu'alors. Or, petit à petit, les plaignants réalisent que le tribunal ne comble pas cette attente, puisque entre eux et Chisso s'interposent le rituel des juges et la plaidoirie de leurs propres avocats, ce qui réduit considérablement leur propre temps de parole ; ils sont aussi gênés par le cadre théâtral de la salle d'audience. Ils aspirent à une « négociation autonome » (Jishu kôshô ÉiZÈ^C?^), c'est-à-dire une confrontation libre et directe non négociée par un tiers, qu'il s'agisse des avocats ou des supporters. C'est pourquoi sitôt après la sentence, dès le 22 mars, 45 plaignants se rendent à Tôkyô avec le groupe de Kawamoto et Satô pour négocier directement avec les dirigeants de Chisso au siège de la société .
La sentence du tribunal de Kumamoto le 20 mars 1973 contre la firme Chisso confirme les arguments apportés par l'Accusation qui accuse et les différents témoignages, dont ceux des ouvriers du premier syndicat. La firme Chisso est explicitement condamnée pour l'absence patente de ce qui deviendra ensuite le « principe de précaution ». En conséquence, elle doit verser entre 16 000 000 000 et 18 000 000 000 yens par plaignant, soit un total de presque 1 000 000 000 000 yens, la plus forte somme jamais imposée par un tribunal au Japon. Les plaignants sont satisfaits de la condamnation morale de Chisso, mais ils pensent que ces sommes ne couvrent que les torts déjà subis sans apporter de soutien durable pour couvrir les frais médicaux à venir. Ils estiment également que Chisso devrait indemniser tous les malades reconnus et non les seuls plaignants. En apportant une première reconnaissance des torts subis, cette sentence donne surtout aux malades une entière légitimité pour négocier directement avec Chisso .
3 En particulier la publication de Minamata-byô kenkyûkai (Groupe de recherche sur la maladie de Minamata), Minamata-byô ni tai sum kigyô no sekinin — Chisso nofuhô kôi (La responsabilité de l'entreprise, envers la maladie de Minamata : les entraves de Chisso à la loi) ; Voir GEORGE Timothy S., op. cit., p. 241-249.
44 Voir la fin du film deTSUCHIMOTO Noriaki, Minamata kanjasan to sono sekai, op. cit. 45 GEORGE Timothy S., op. cit., p. 216. 46 ISHIMUREMichiko, op. cit., p. 126-127 et p. 136-143. 47 GEORGE Timothy S., op. cit., p. 241-249 ; TOGASHI Sadao 'tSWXVJl, Minamata-byô to hô ££• (La maladie de Minamata et la loi), Fukuoka, Sekifûsha, 1995.
44 La maladie de Minama ta et le conflit pour la reconnaissance
Ces négociations qui se termineront quatre mois plus tard sont enregistrées par la caméra attentive de Tsuchimoto Noriaki. Le film de deux heures qu'il en a retiré permet de suivre la fascinante progression de ce face-à-face. Si certains malades gardent une position déférente envers les dirigeants de Chisso, d'autres renversent l'ordre établi jusqu'alors : ce ne sont plus les malades vassaux qui s'adressent au seigneur de Chisso, mais ce sont maintenant les dirigeants de Chisso, et en particulier le président Shimada Ken.ichi, qui parlent avec déférence aux malades. Parmi les malades, Kawamoto Teruo parle lui aussi sans ménagement et va même jusqu'à s'asseoir en tailleur sur la table en surplombant le président Shimada Ken.ichi. C'est une révolution pour les gens de Minamata qui s'étaient jusqu'alors toujours représenté le patron de Chisso comme un demi-dieu vivant dans un monde inaccessible car proche de l'empereur . Cependant Kawamoto n'impose pas une revanche avec rancœur (urami) ; il semble plutôt chercher à parler d'égal à égal avec Shimada.
Dans la scène la plus fascinante du film, Kawamoto est assis en tailleur sur la table, juste au-dessus de Shimada. Alors que les négociations tournaient en rond, la nouvelle est parvenue qu'à Minamata, deux membres du groupe des malades nouvellement reconnus, Matsumoto et Osaki, viennent de mourir. Cette nouvelle crée une situation exceptionnelle : la discussion se poursuit jusque tard dans la nuit. Kawamoto est de nouveau assis en tailleur sur la table, cette fois moins par défi que par souci de parler à Shimada au plus près. Son ton est rude mais sans agressivité. Les yeux de Shimada sont fixés sur Kawamoto avec une crainte mêlée d'interrogation :
Kawamoto : « Est-ce que tu vas payer pour Matsumoto et Osaki, oui ou non, c'est tout ce au 'on te demande ! Pour cette nuit. . . On assez tergiversé comme ça, on a plus le temps de discutailler /»[...]
Kawamoto (sa voix a changé, elle est plus calme que tout à l'heure) : « Qu 'est-ce qu'on enseigne dans le zen ? Moi j'y connais rien au zen. . . Mmh ?. . . Qu'est-ce qu'on enseigne dans le zen. ?. . . Et ta femme, elle est Zen aussi ? »
Le patron : « Oui. . . Euh ah non, ma femme, elle est catholique. » Kawamoto : « Ah bon, elle est catholique. . . Et qu 'est-ce qu 'on enseigne dans la
religion catholique ? Est-ce qu 'il y a une différence avec le zen ?. . . Mmh ? Le zen et la religion catholique, est-ce qu'il y a une différence ?. . . On m'a dit que tu avais trois ou quatre enfants. . . Mmh. . . Osaki aussi il avait des enfants, Matsumoto aussi. . . Elle avait
48 À l'égal des plus grandes firmes japonaises (Mitsubishi, NKK, etc), le siège de la firme Chisso se trouve en effet dans le quartier des affaires de la gare de Tôkyô, juste à côté du palais impérial. Près de trente ans plus tard, en 1990, et comme un siècle plus tôt, Tanaka Shôzô fB'f'ilîiïï, leader du mouvement contre la pollution provoquée par la mine d'Ashio, Kawamoto adressera une requête au nouvel empereur Akihito (son père l'empereur Shôwa est mort en 1989), ce qui lui vaudra de nouveau les réprobations de nombreux habitants de Minamata. La question de la responsabilité de l'État par rapport à la maladie de Minamata est d'autant plus complexe et délicate qu'elle implique la famille impériale, touchant ainsi au symbole de la nation. La visite de l'empereur Shôwa à l'usine Chisso de Minamata en 1931 est parfois mise en parallèle avec sa responsabilité dans la Seconde Guerre mondiale Ainsi l'empereur apparaît tantôt comme l'ultime responsable, tantôt comme l'ultime recours pour que justice soit rendue.
PaulJobin 45
des enfants. . . Mmh, Osaki aussi. . . Comme toi, il était père. . . Pourquoi y a-t-il une différence pareille ?. . . Où que ce soit au Japon, ce sont pourtant tous des pères et des mères ? Hein, patron ? Est-ce que c'est normal une différence pareille ? Des pères et mères qui devraient être heureux. . . Est-ce que c'est normal, une différence pareille ? »
Seul Shimada garde les yeux ouverts. Kuga, Tsuchiya et les autres directeurs semblent partis en méditation.
Kawamoto : « Tu es beaucoup plus âgé que moi, mmh, tu as bien roulé ta bosse. Tu as employé du monde . . . des dizaines de milliers. Tu sais bien deviner ce que les autres pensent. Comment les hommes doivent vivre. . . Tu dois bien avoir quelque chose comme des préceptes familiaux ou moraux là-dessus ?. . . Quel est ton mot d'ordre pour les affaires ? Tu as bien quelque chose comme ça ?. . . Non, bon, alors qu 'est-ce que tu as comme passe-temps ? (c'est la voix de quelqu'un qui cherche des réponses) Les bonzai ? La musique ?. . . Qu 'est-ce que c 'est ? »
Le patron : « Les bonzai, la musique, la peinture, je n'ai rien de tout cela. » Kawamoto : « Tu as bien un passe-temps ? » Le patron : «Je lis des livres, c'est tout. » Kawamoto : « Ah, tu lis des livres. . . Tu lis des livres. . . Ah. . . Quel est le livre qui
t'a le plus ému ? Moi j'y connais pas grand-chose en littérature mais. . . Quel est le livre qui t'a laissé la plus forte impression ?. . . Mmh ? Ça t'a pas sermonné, ces livres ? Entre ces lectures et la mort d'Osaki, la mort de Matsumoto, y a pas un rapport ?. . . Est-ce que cela n 'a aucun lien (muen MM) ? Qu 'en penses-tu ? »
Le patron : « Cela n'est pas sans lien. » Kawamoto : « Ah, c'est pas sans lien ? » Le patron : « Oui, ce n'est pas sans lien. » Kawomoto : « Ah bon ? » Le patron : « Oui. »
Ce n'était pas la première fois que Kawamoto rencontrait Shimada. Lors d'un premier face-à-face au siège de Chisso, le 7 décembre 1971, Kawamoto lui avait demandé de sceller un accord par le sang. Souffrant d'hypertension, Shimada s'était évanoui. Alors qu'on attendait l'ambulance, Kawamoto était assis à genoux auprès de Shimada, étendu sur un divan50. Bien que celui-ci ne pût l'entendre, Kawamoto lui parlait de la mort de son père. Dans un montage associant une bande son enregistrée alors et les photographies prises par Miyamoto Shigemi, le récit que Kawamoto fait de la mort de son père se superpose d'une façon étourdissante au visage de Shimada évanoui, comme s'il était son père. Même si ses paroles exprimaient sa colère contre Chisso, Kawamoto lui parlait doucement, sa voix entrecoupée par les sanglots. Le visage de Shimada était certes pitoyable, mais son corps étendu évoquait la noblesse solennelle d'un gisant .
49 TSUCHIMOTO Noriaki, Eiga wa ikimono no shigoto de aru, op. cit., p. 350-354 (les hors-textes ne sont pas des voix-off mais des commentaires ajoutés par Tsuchimoto à la transcription).
50 ISHIMURE Michiko, Ryûmin no miyako, op. cit., p. 358-359. 51 ICHINOSE Seishi -^.î^iiF.ili, Shimin no michi ^EKOiÛ (La voie des morts-citoyens), 16 mm.,
40 min., noir et blanc, 1972 (Ichinose était membre de l'équipe de Tsuchimoto Noriaki). Des extraits sont repris dans TSUCHIMOTO Noriaki, Kawamoto Teruo kaisô JII"4dW-;fc[«lfè! (Souvenirs de Kawamoto Teruo), vidéo couleur, 60 min., 1999 (on peut la commander sur le site Internet http://www2.ocn.ne.jp/-tutimoto/). À la mort prématurée de Kawamoto en février 1999, Ishimure écrivit un hommage qui reprenait ses étranges paroles murmurées à Shimada cette nuit de décembre
46 La maladie de Minama ta et le conflit pour la reconnaissance
Le lendemain, Kawamoto et Satô vont rendre visite à Shimada à l'hôpital en lui apportant des friandises. Mais on leur refuse l'accès à sa chambre . Si Kuga et les autres directeurs sont encore de marbre, et ils le resteront jusqu'à la fin, quelque chose d'étrange s'est produit entre Shimada et Kawamoto. La démarche de ce dernier rejoint celle d'un petit groupe de malades qui se rendent, habillés en pèlerins bouddhistes, auprès du domicile des principaux dirigeants et actionnaires de Chisso en psalmodiant des prières pour les sensibiliser à la souffrance des malades de Minamata. L'équipe de Tsuchimoto a suivi cette étrange visite. La voix-off du film explique que ces pèlerins sont venus jusqu'à Tôkyô estimant que, puisque les dirigeants de Chisso sont des êtres humains, il n'y a pas de raison « qu'ils ne puissent pas changer leur cœur » (kokoro o kaenai hazu ga nai'ù^MÂ.ti: Vi(i"f #*&l>). Changer son cœur, c'est aussi ce que signifie le terme de kaishin 3&L\ que l'on pourrait traduire par un appel à convertir son regard .
Ni rancœur ni pardon, mais soif d'une véritable reconnaissance
Senkô Un.yu, l'entreprise sous-traitante de Chisso qui dut embaucher quelques-uns des pêcheurs victimes de la pollution, après l'accord conclu entre la coopérative de pêche et Chisso en I960, fut également convoquée en 1959 pour « défendre » l'usine contre la « violence » des mêmes pêcheurs. Chisso eut aussi recours à ses loyaux services pour briser la grande grève de 1962-1963 contre « le plan de salaires stabilisés ».
Hamamoto Tsuginori fê'fc—ffî,, un des plaignants les plus résolus du procès engagé en 1969, et ami d'enfance de Kawamoto Teruo, figurait parmi ces pêcheurs embauchés par Senkô Un.yu. Pendant le conflit de 1962-1963, il s'était ainsi retrouvé parmi les briseurs de grève, et ce bien malgré lui car il était, comme Kawamoto, partisan de la grève. Mais sous la pression de sa sœur aînée, il s'était résolu à travailler pour Senkô Un.yu car depuis la mort de leurs parents (au terme d'atroces souffrances ; ils furent parmi les premières victimes de la maladie de Minamata), Tsuginori et sa sœur étaient à bout de ressources et n'avaient pas
1971 : « Ore ga oni ka, seisui no yôna namida » ffà#\ 9&fr---lM/}<.<7) «J; •? &, &j (Est-ce que je suis un démon ? Comme des larmes sacrées), Asahi shinbun, 23 février 1999. Les funérailles se déroulèrent à Minamata, dans une relative intimité qui n'était pas désirée par la famille mais confirmait le relatif isolement de Kawamoto à Minamata. Loin d'être un leader charismatique entraînant les foules, il a toujours été contesté, même au sein du mouvement des malades non-reconnus. Présent aux obsèques, Tsuchimoto fut choqué par cette relative indifférence des malades, et en particulier des milliers de ceux à qui il avait permis d'obtenir une reconnaissance. C'est pour rétablir cette mémoire que Tsuchimoto réalisa en quelques mois un film, qui reprend des extraits de ses anciens films tout en y ajoutant quelques prises récentes au caméscope (entretien avec Tsuchimoto à Lussas, en août 1999).
52 TSUCHIMOTO Noriaki, Minamata eiga henreki ; kiroku nakereba jijitsu nashi /Nà®MÈ'MM., ,!iiîS<tit£'Jv'Jti& L (Pérégrinations cinématographiques à Minamata ; s'ils ne sont pas enregistrés les faits n'existent pas), Tôkyô, Shin.yôsha ffBfêM;, 1988, p. 126.
53 Ce petit film intitulé Kanjin W)M (propager la foi, ou faire l'aumône) a été réalisé à leurs propres frais par trois jeunes de la société de production Higashi Pro. Voir TSUCHIMOTO Noriaki,
PaulJobin 47
d'autres offres de travail. Durant les premiers mois, il profita d'un salaire plus élevé et d'autres avantages en nature offerts par la direction de l'usine aux ouvriers du deuxième syndicat et des sous-traitants qui, « assiégés » par le premier syndicat, devaient rester près d'une semaine entière dans l'usine. Souhaitant assurer son statut dans l'entreprise, il passa son permis de conduire pour devenir chauffeur. Mais malgré sa promesse, le patron de Senkô Un.yu refusa finalement de le nommer chauffeur craignant que ses jambes ne lui fassent défaut et provoquent un accident. Fou de rage, réalisant alors qu'il n'avait cessé d'être trompé par Chisso, qu'il en était réduit à travailler pour l'usine qui avait tué ses parents et détruit ses jambes, il fut sur le point de réaliser une action suicide : ouvrir les vannes de gaz à haute pression pour y mettre le feu, provoquant ainsi une gigantesque explosion qui détruirait toute l'usine et une partie de la ville .
Lors des entretiens que j'ai pu avoir avec Hamamoto, j'avais apporté les albums de photographies réalisés par le premier et le deuxième syndicat sur le conflit de 1962-1963. Il semblait les voir pour la première fois ; il commenta par exemple avec un égal enthousiasme les photos représentant les barques des « piquets de grève sur la mer » du premier syndicat, et la percée réussie par le deuxième syndicat à travers un tunnel que le premier syndicat avait négligé de surveiller de près . Malgré sa sympathie pour le premier syndicat, l'issue du conflit ne lui importait pas vraiment, comme si le fond du problème était ailleurs. Il ressentait encore l'ambiguïté de la position qui était la sienne lorsqu'il travaillait pour Chisso. Il résuma cette position par une formule : « Oui donc c'est vrai que je suis un pollué, mais je suis aussi un pollueur » '. Son propos ne reflétait pas une culpabilité diffuse ou non réglée. Il invitait plutôt à considérer l'histoire de Minamata dans toute sa complexité, pour dépasser une vision polémique.
Dans les premiers films de Tsuchimoto, la densité du regard d'Hamamoto frappe tant elle exprime la violence de sa rancoeur envers Chisso57. Mais les contacts qu'il a pu avoir avec les ouvriers du premier syndicat à partir de leur engagement auprès des malades en 1968 semblent avoir beaucoup contribué à apaiser cette amertume. Il conserve ainsi un souvenir impressionné de « la grève contre la pollution » de mai 1970. Comme il le dit, c'était sans doute la première fois de l'histoire qu'une grève était associée à une prière pour les morts. L'attitude des ouvriers du premier syndicat assis devant la porte de l'usine était en telle harmonie
Eiga wa ikimono no shigoto de am, op. cit. , p. 222. 54 Saishu Satoru iiiTitu, Detsuki shiki ; Hamamoto Tsuginori gatari iU/JfAjïi, ïftiî 'MM) 0
(Notes personnelles de Detsuki ; récit d'Hamamoto Tsuginori), Tôkyô, Shin.yôsha, 1989, p. 149-162. 55 Shin Nihon Chisso Minamata kôjô shin rôdô h\miàïï\\Y^MfoïÀS.)&Wfifflfà\'C\ (deuxième
syndicat) , Yappari, watashitachiwa tadashikatta -f» o (i° 0 , h tz L tz *> ti TE L à> r> tz (Evidemment, c'est nous qui avions raison), 1963, p. 42-43. Et Shin Nihon Chisso rôdô kumiai (premier syndicat), Anchïn tôsô, 183 hi no tatakai 'HViïïVf^ 183! I W|iijv> (album de photographies paru à l'occasion du trentième anniversaire de la fin du conflit de 1962-1963), 1993, p. 29-30.
Entretiens avec Hamamoto à Minamata les 3 et 6 janvier 1999.
48 La maladie de Minama ta et le conflit pour la reconnaissance
avec la dignité des malades que les policiers se tenaient respectueusement à bonne distance, et qu'à l'intérieur de l'usine, les membres du deuxième syndicat éteignirent les sirènes qui retentissaient d'ordinaire58. Hamamoto ressent encore également une forte gratitude à l'égard des huit membres du premier syndicat qui ont témoigné au tribunal en 1972, au risque pour deux d'entre eux d'être licenciés59. Il a d'ailleurs noué une profonde amitié avec Onitsuka Masato ^I^IEÀ, membre du premier syndicat et témoin au procès en mars 1972 (c'est lui notamment qui avait révélé l'odieux subterfuge du cyclator auquel il avait été affecté) . Une calligraphie qu'Onitsuka a offerte à Hamamoto et que celui-ci expose en évidence dans sa maison atteste cette amitié : Onitsuka a tracé d'un jet serein deux caractères -~'ù isshin, signifiant « avec ardeur », mais suggérant aussi hitotsu no kokoro « unis d'un même cœur ». On pourrait y voir une marque de réconciliation entre les victimes de la maladie et les ouvriers, comme si les ouvriers du premier syndicat, par leur engagement au côté des malades après 1968, s'étaient « lavés » de leur complicité avec la direction en 1959 contre les pêcheurs, et comme si, inversement, ceux qui parmi les pêcheurs avaient contribué à briser la grève de 1962 étaient pardonnes de cette « offense » envers le mouvement ouvrier. Mais la réconciliation est-elle allée plus loin que cette solidarité rétablie au sein des « classes opprimées » ?
En 1 996, Claude Lanzman, le réalisateur du film Shoah, s'est rendu à Minamata en compagnie, et sur l'invitation, deTsuchimoto Noriaki, visite qui fut filmée par la chaîne NHK. Alors qu'ils étaient reçus au domicile d'Ishimure Michiko pour un entretien, Lanzman conifa à ce dernier son indignation quant à l'accord conclu entre l'État et les malades en 1995, intitulé « règlement définitif» {saishû kaiketsiî) :
Comme dans le film Hiroshima mon amour, je pourrais dire que je n'ai rien vu à Minamata mais ce genre d'événement, d'une certaine façon, on pourrait appeler cela des événements fondateurs, des événements originaires. [...] L'affaire de Minamata ne pourra jamais être oubliée. Et d'ailleurs, cela n'est pas un hasard si Mme Ishimure parle de « l'origine de l'existence ». Moi j'ai toujours dit cela à propos de mon film, Shoah, que c'était un événement originaire, c'est-à-dire originaire au sens mythique. [...] Un mythe, cela ne s'oublie jamais. Et l'histoire de Minamata, c'est comme un mythe. [...] C'est à la fois présent et éternel [...]. C'est pourquoi quand le gouvernement parle de « solution totale », « réconciliez-vous », « c'est la fin du problème de Minamata », cela me fait penser à ce que les nazis appelaient « la solution finale » .
La maladie de Minamata est en effet fréquemment qualifiée de « point originaire de la pollution » (kôgai no genten Minamata-byô ^H^IH^^flc^), tandis
57 TSUCHIMOTO Noriaki, Minamata kanjasan to sono sekai, op. cit. 58 SAISHU Satoru, op. cit., p. 217-219. 59 Ibid., p. 226-229. 60 Entretiens avec ONITSUKA Masato et avec Hamamoto à Minamata, en décembre 1998 et
janvier 1999. « Kiroku suru koto no imi ; Tsuchimoto Noriaki to Kurôdo Ranzuman no kaiwa » \kl%k
■fSd t co.w;'M< : Ji^lWWt ?v— Vy>X~?y<D2;,\ti(Ce que signifie enregistrer ; un dialogue entre
PaulJobin 49
que l'expression de « crime originel » ou genzai W.W sert parfois à qualifier le mensonge odieux du cyclator et plus généralement, l'attitude de déni systématique longtemps adoptée par Chisso et l'Etat.
Il ressort surtout de cet entretien entre Lanzman et Ishimure que les victimes de Minamata porteraient une rancœur éternelle (urami) contre Chisso. Cependant, lorsque j'ai moi-même demandé à Ishimure si elle ne trouvait pas que l'expression qu'elle utilise parfois de « victimes innocentes » (nan no tsumi no nai hito {nJcDpCD &V>À) ne relevait pas d'une forme de théodicée distributive impliquant que s'il s'agissait de « victimes coupables », elles n'auraient reçu qu'un juste châtiment, sa réponse ouvrait sur une piste inattendue :
Oui peut-être ... D 'ailleurs aujourd'hui, les victimes ont besoin de pardonner, pas pour les responsables de Chisso, mais pour elles-mêmes. [Chisso no tame dewanaku, jibun no tame yurushite agetai -f -y V <D tz àb T f à & < g ft <D tz $> fF L T ± \ftz V >] 62
On peut trouver un tel écho dans la lutte menée par Ogata Masato. Il est issu d'une famille de pêcheurs de Meshima i£$h, un hameau situé à quelques kilomètres au nord de Minamata. Comme Kawamoto Teruo, ses parents sont morts eux aussi des conséquences du mercure dans des souffrances physiques terribles, un dénuement complet et qui plus est, frappés d'ostracisme par les autres habitants. Ogata quitte ce contexte dramatique et échoue à Kumamoto où il vivote de menus larcins avec la pègre, jusqu'à ce qu'un groupe d'extrême droite l'entraîne tabasser des manifestants pour Okinawa ; il est arrêté par la police et envoyé en maison de correction. Un éducateur lui fait prendre conscience qu'il s'en prenait à ceux-là mêmes qui défendent les victimes de Chisso, et lui recommande de rentrer dans son pays natal. Réalisant la contradiction intolérable dans laquelle il est tombé, il suit ce conseil et retourne à Meshima .
Rapidement il s'engage au côté de Kawamoto dans le combat pour les milliers de malades ignorés par Chisso et les organismes chargés par l'État de reconnaître la maladie. Forts des études épidémiologiques de l'équipe d'Harada Masazumi qui sont reconnues internationalement, ils réclament l'application de nouveaux critères de reconnaissance de la maladie, de telle sorte que l'ensemble des malades puisse être reconnu, et non une portion congrue destinée à faire croire que la maladie de Minamata a été résolue avec la sentence de 1973. Mais ils se heurtent constamment à des refus. Comme Kawamoto, Ogata recherche un dialogue d'égal
Tsuchimoto Noriaki et Claude Lanzman), NHK, vidéo couleur, 180 min., NHK, 1996. Entretien avec Ishimure Michiko à Minamata, le 1er janvier 1999. Elle a développé cette
idée juste un an après dans la préface qu'elle a rédigée pour le numéro de la revue Shisô !SM de janvier 2000.
63 OGATA Masato et TSUJI Shin.ichi iifff--, Tokoyo no fane o kogite - Minamata-byô shishi, îîîUtWS.r&flycf "T\ zKCi&jfMt (En ramant sur la barque du monde éternel : Histoire personnelle de la maladie de Minamata), Yokohama, Seori shobô I'tStiW, 1996, p. 1-65.
OGATA Masato, Chisso wa watashi de atta f- ■/ V iifLX'foitz (Chisso, c'était moi), Fukuoka,
50 La maladie de Minama ta et le conflit pour la reconnaissance
à égal avec les dirigeants de Chisso et les organismes publics. À ses débuts, il imitait même le comportement de son aîné, assis en tailleur sur la table, lors des discussions aux bureaux de la préfecture chargés de la reconnaissance des malades ou même lors de séances à l'Agence de l'environnement .
Ogata semble cependant en quête de quelque chose de plus. Son absence prolongée de la région le charge d'une culpabilité qui lui fait ressentir plus douloureusement encore la question de la mémoire : quelle est au fond la juste compensation des torts causés par Chisso ? L'argent peut-il vraiment régler le « paiement » de la « dette » envers les parents décédés dans des conditions aussi tragiques ? Ce qu'il nomme le « système » instauré par Chisso et l'État, distribue au compte-gouttes des compensations aux victimes de la maladie de Minamata. Ce système suscite la convoitise ou le mépris envers ceux qui font la demande de reconnaissance. L'argent constitue ainsi une barrière au dialogue qui permettrait une véritable réparation .
En 1985, il prend une décision apparemment insensée. Il se rend à l'organisme préfectoral pour retirer la demande de reconnaissance qu'il a déposée onze ans auparavant et qui a été constamment rejetée. Hormis quelques rares personnes extérieures qui devinent la dimension novatrice de ce geste provocateur, Ogata se heurte à l'incompréhension de ses proches. Sa femme ainsi que Kawamoto lui reprochent cet acte : si ce n'est de l'argent, que peut-on bien demander d'autre comme compensation ? Obsédé par cette question, Ogata tombe dans une grave dépression que son entourage interprète comme de la folie. Il réussit cependant à récupérer une certaine normalité sociale en reprenant un emploi. Puis il se fait fabriquer une petite embarcation à voile et tout en bois pour éviter le PVC produit par Chisso. Il annonce à ses proches son intention de se rendre jusqu'à l'usine Chisso de Minamata pour y entamer une nouvelle forme de contestation dont il n'a pas encore défini clairement le contenu. La présence d'Ishimure Michiko et Hamamoto Tsuginori au baptême du bateau en mai 1987 lui apportent un encouragement décisif pour sa première traversée jusqu'à Minamata en décembre .
Cette traversée se réalise sans encombre au début de décembre 1987. Une fois arrivé, à l'étonnement des employés et des cadres de Chisso ainsi que des rares passants, il s'installe devant l'entrée de l'usine et inscrit sur des banderoles ce qu'il ruminait depuis des mois : un appel au dialogue direct avec tout le personnel de Chisso sans autre objectif particulier que de rétablir l'humanité égarée par la polémique et enfermée dans une logique pécuniaire. Son ton également empreint d'humour efface pour un temps le tragique et la tension de l'adversité. Par la suite, il demande même à visiter l'usine avec sa famille, ce qu'aucun malade n'avait jamais fait. Il avait déjà eu l'occasion de pénétrer dans les bureaux pour négocier
Ashi shobôi^ïB, 2001, p. 11-32. 64 OGATA Masato et TSUJI Shin. ïàù, op. cit., p. 81, 100-101. ^ Ibid., p. 91-94, p. 165-166.
PaulJobin 51
mais ce n'est plus de négociation qu'il s'agit, il veut voir l'endroit d'où le mercure a coulé, l'intérieur de l'usine. Le cadre du personnel qui les accompagne leur fait visiter l'usine avec empressement et gentillesse. Peu après, ils sont invités à dîner, ce qu'Ogata refuse par peur que cela soit interprété comme une trahison, comme s'il se laissait maintenant acheter. Mais lorsque Chisso insiste une deuxième fois, Ogata accepte à condition que sa famille soit également présente. Peu de temps après, l'une de ses filles meurt dans un accident en mer. Ogata ne s'étend pas sur sa peine, mais déclare en revanche : « Je suis heureux que nous ayons pu faire cette visite de l'usine avant sa mort » .
Depuis 1985, Ogata semble chercher les moyens de dépasser la diabolisation de l'adversaire. Dans le face-à-face avec la préfecture ou Chisso, il aspire à une reconnaissance qui soit mutuelle. Cela l'oblige à une remise en cause des catégories figées de la faute et du criminel, à scruter l'ambiguïté de ses désirs en tant que victime, et à rechercher son identité personnelle (Jibun ê^") par-delà la catégorie de victime. Ogata en arrive à une formulation qui provoque un nouveau scandale parmi les malades :
Moi qui n 'ai cessé d'invoquer la responsabilité de Chisso, et de l'État, je me suis soudain demandé : si moi-même (jibun), j'avais été à l'intérieur de Chisso ou de l'administration, n'aurais-je pas agi de la même façon qu'eux ? Et pour trouver ce moi-même (jibun), il fallait aller tout au bout de cette question. Alors je me suis demandé si Chisso n 'était pas à l'intérieur de moi-même. Et finalement, moi, je n 'arrive pas à trouver de conclusion sur les responsables de la maladie de Minamata. Il s'agit d'un crime contre l'humanité dont la responsabilité fondamentale incombe à l'existence de l'humanité elle-même ; et ce qui en est la cause, c'est lorsque des hommes ont cessé de considérer d'autres hommes comme des hommes. Lorsqu'on interroge l'histoire de la maladie de Minamata, on finit par trouver ce « moi-même ». Au sein du mouvement des malades, nous avons sans cesse écarté cette question fondamentale" .
Cette formulation qui rejoint ce que Primo Lévi a nommé « les zones grises » à propos du Làger aurait dû rencontrer un écho favorable parmi les ouvriers de Chisso, et en particulier auprès de ceux du premier syndicat. En fait, ce propos dérange presque tout le monde. Ogata, qui n'a pas étudié à l'université, est un « philosophe » provocateur malgré lui. C'est moins son parcours chaotique, depuis ses « déviances » dans l'extrême droite jusqu'à son amitié avec les anciens « gauchistes », supporters des malades de Minamata, qui le rendent suspect, que le retrait de sa demande de reconnaissance et ce type de formulation. Lors de son séjour à Minamata, Claude Lanzman a également rencontré Ogata Masato. Lorsque Ogata, qui s'est rendu à Auschwitz avec Hamamoto Tsuginori, exprime ce point de vue à Lanzman, celui-ci avoue son étonnement : « C'est rare des gens qui
66 Ibid., p. 91-122, 172. 67 Ibid., p. 123-147. 8 Ibid., p. 167. Et interview d'Ogata dans Gonzui Zlb~f V (bulletin mensuel du centre de la
maladie de Minamata MAtë-t y ?-Sôshisha It UiLUI:), mars 1994, p. 12-14, cité par GEORGE Timothy
52 La maladie de Minamata et le conflit pour la reconnaissance
pensent comme vous. . . » .11 est effectivement plus fréquent de classer les justes et les coupables en catégories rigides.
Si le terme de pardon est inapproprié pour qualifier la quête d'Ogata, celui-ci cherche du moins, comme l'exprime Ishimure Michiko, à se réconcilier avec lui- même. Il s'agit de dépasser la rancœur qui le rongeait intérieurement, en passant par l'épreuve du miroir :
Dire qu'on ne peut définir clairement les responsables, c'est renoncer à faire une classification de la responsabilité. Alors vient la question : est-ce que cela ne revient pas à pardonner l'adversaire ? Et le doute : est-ce que c'est bien comme cela ? Bien sûr, pardonner, ce n 'est pas une chose facile. Quand on n 'existe plus que par rapport à un ennemi, lorsque cet ennemi disparaît, on ne sait plus vers où tourner ses pensées. On se retrouve perdu, seul, face à soi-même. Et cela fait peur .
Chercher une rencontre en vérité avec Chisso ne signifie cependant pas accepter n'importe quoi : lorsqu'en 1990, la municipalité, de concert avec Chisso, annonce la poldérisation de la baie de Minamata, Ogata se mobilise avec Kawamoto, Satô, Hamamoto et treize autres personnes contre ce projet. Ils ne peuvent empêcher sa réalisation, mais réussissent à éviter que ce lieu de mémoire de la tragédie devienne un complexe touristique. Ils obtiennent la création d'un jardin, d'un musée de la maladie de Minamata, et la permission de placer des statuettes de Bodhisattva tout le long de la promenade face à la mer71. Entre une amertume éternelle et l'illusion d'un pardon, au mieux un pardon éphémère, c'est en fait un retour lancinant sur l'identité et la mémoire dont il s'agit. Ogata se remémore malgré lui son père emporté par la « faute originelle » {genzaï) commise par Chisso. Comme de nombreux malades de la région de Minamata, il se souvient aussi de toutes les humiliations subies à cause de la maladie. Et comme Kawamoto, il considère le refus de reconnaissance du tort causé comme la pire de toutes les humiliations.
Le souci que témoigne Ogata pour dé-diaboliser l'adversaire ne vise pas à endormir la mémoire mais à reposer la question en son fondement : en quoi consiste la faute, la responsabilité ?
Quand bien même obtiendrions-nous enfin une sentence qui reconnaisse la responsabilité de l'État, nous n'aurions pas encore clarifié ce que c'est que l'État [...] Nous avons beau multiplier les excuses, les regrets, les compensations et les fonds de secours, tout cela laisse un sentiment de vanité .
S., op. cit., p. 273-274. Dans le documentaire de la NHK, 1996, Kiroku suru koto no imi (voir note supra).
70 OGATA Masato et TSUJI Shin.ichi, op. cit., p. 168, et son témoignage dans KURIHARA Akira, Shôgen Minamata-byô Hlpb-kfSJW (Témoignages sur la maladie de Minamata), Tôkyô, Iwanami shinsho, 2000, p. 182-202, en particulier p. 194-200.
71 George Timothy S., op. cit., p. 277-279.
PaulJobin 53
II refuse une responsabilité réduite à un rachat par l'argent au bout d'un procès ou à travers le système de compensations. Tout ce système n'a servi qu'à divertir l'attention pour faire oublier un ensemble de responsabilités au cœur du système politique depuis 1945. Ogata évoque ainsi la souffrance des « femmes de réconfort », les bombardements sur Hiroshima et Nagasaki, ou encore la persistance des pratiques discriminatoires envers les Burakumin .
La démarche et les paroles d'Ogata ont inspiré au sociologue Kurihara Akira une réflexion très fine sur l'histoire de la maladie de Minamata. Kurihara résume le raisonnement sous-jacent à l'instauration du système de compensations de la façon suivante : il est impossible de se développer sans polluer, mais compenser une partie des victimes revient moins cher que prévenir la pollution. Il faut donc accepter le sacrifice de quelques-uns pour le bénéfice du plus grand nombre. Cette logique a d'abord produit à partir de 1968 une identité de « malades de Minamata » quantifiée en monnaie, évacuant la vie, la liberté intérieure, l'âme (tamasbi^). Il s'agit d'une identité réduite à la catégorie de « malade » (kanja), et bientôt enfermée pieusement, même par les supporters, dans le panthéon des saints martyrs (seinaru kanja Ii&£l&^=0 de la pollution industrielle. La déclaration de la préfecture de Kumamoto à propos des « faux malades » inise kanja fè^#) révéla ce que le mépris général murmurait tout bas : les malades sont des quémandeurs, avides d'argent. Pour toutes ces humiliations, il n'y eut jamais de véritables excuses, aucune parole humaine mais seulement des mots institutionnels « sans âme ». Il y eut surtout une gêne continue, un empressement, pour « liquider » la question. C'est ainsi que fut décidée la poldérisation de la baie de Minamata comme pour effacer toute trace de la faute commise et la trace même des victimes. Et c'est ainsi que le gouvernement prétendit résoudre définitivement « le cas Minamata » par le
11 OGATAMasato et TSUJI Shin.ichi, op. cit., p. 170. 73 OGATAMasato et TSUJI Shin.ichi, op. cit., p. 179.
En août 1975, alors que l'Agence de l'environnement envisageait de réviser à la baisse les critères de reconnaissance, Sugimura Kunio féWli;l>^, un médecin, président de la Commission spéciale des mesures contre la pollution pour la préfecture de Kumamoto, déclara que le système d'indemnisation ne convenait plus, en arguant que « de plus en plus de faux malades effectuent une demande ; ils courent seulement après l'argent. Cela ne va pas du tout. Le préfet et les fonctionnaires de la préfecture n'osent pas le dire à l'Agence de l'environnement. Mais c'est pourtant la réalité, et la voix des habitants de la préfecture ». Cette déclaration provoqua la colère de tous les malades et une manifestation fut organisée à Kumamoto, devant la préfecture. Sommé de s'expliquer, Sugimura se contenta d'accuser les journaux d'avoir déformé son propos. Bien que protégé par la police, il aurait alors subi une agression physique provoquant quelques blessures. La police s'attendait visiblement à une réaction de colère de la pan des malades et recherchait une occasion de disqualifier leur mouvement de protestation. Ogata Masato et Sakamoto Noboru, un autre malade, ainsi que deux supporters furent arrêtés, maintenus en garde-à-vue une quinzaine de jours jusqu'à ce qu'une plainte soit constituée contre eux. Tout de suite après, les malades déposèrent à leur tour une plainte contre Sugimura pour sa déclaration. En mars 1980, le tribunal ordonna à ce dernier d'adresser publiquement des excuses aux malades. Quelques jours plus tôt, Ogata et Sakamoto avaient été condamnés à quatre mois de prison ferme et deux ans de sursis. IKEMI Tetsuji, op. cit., p. 238-242 ; OGATA Masato et TSUJI Shin.ichi, op. cit., p.76-79.
54 La maladie de Minama ta et le conflit pour la reconnaissance
« règlement final » de 1995 : « affaire classée ». La reconnaissance dont il est ici question est polysémique. En français le
terme de reconnaissance sert en effet à traduire le terme nintei fcJ/E qui renvoie au « système de reconnaissance des malades pollués » (kôgaibyô kanja nintei seido 4*H fâMMWfêMfë) ; H traduit également le terme de shônin T^M' , ainsi que celui de ninchi Mftl, comme lorsqu'un père reconnaît officiellement son enfant (le chi suggère ici la connaissance, intime ou objective). C'est ce dernier terme que privilégie Kurihara dans sa réflexion épistémologique sur les sciences sociales à partir de l'histoire de Minamata.
Épilogue
II serait paradoxal de « conclure » ce propos sur la maladie de Minamata, puisque précisément il s'agissait d'insister sur la marque qu'elle continue d'imprimer durablement dans la société et dans les sciences sociales. Aussi me contenterai-je ici de quelques remarques en forme de suspension.
Au risque de glisser sur la pente d'un jeu de métaphores, comparer les maladies industrielles à une sorte d'agression contre le corps social permet peut-être de mieux ressentir la profondeur de leurs blessures physiques et morales, et de comprendre pourquoi la maladie de Minamata fut parfois perçue comme une sorte de guerre. Ainsi dans ce poème, composé et lu avec une vive émotion par le poète dramaturge Sunada Akira SJ>E9^, au terme d'un pèlerinage de Tôkyô à Minamata pour collecter des fonds destinés aux malades :
Les malades de Minamata, tu connais ? Et parmi eux, les malades congénitaux. . . Moi, rien que de le dire, j 'ai le ventre en ebullition. Un cou qui ne tient pas droit, Des yeux qui ne voient pas, Des oreilles qui n'entendent pas, des bouches qui ne parlent pas, ne peuvent goûter, Des mains qui ne peuvent saisir, des jambes qui ne marchent pas . . . Engendrer de tels enfants, jeter dans la mer des colibacilles qui ne peuvent y vivre Qti 'est-ce que c 'est que cette « haute croissance » ?
KURIHARA Akira, « Shimin seiji no ajenda » ïfi'KiftJuOT'i^x y ^*(Un programme politique citoyen), Shisô, janvier 2000, p. 3-17.
KURIHARA Akira, Naiha sum chi, shintai, kotoba, kenryoku o aminaosu \HWc$"Z>%\^ fyfâs H" j+L tfiiJj %&&&•[().'?' (Le savoir qui détruit l'intérieur : revoir le corps, la parole et le pouvoir), Tôkyô, Tôkyô daigaku shuppankai 'MiïXWMZ, 2000, p. 1-81.
Voir également le dialogue étonnant entre Ogata et Kurihara, dans KURIHARA Akira, Ekkyô suru chi 2. Gatari : tsumugidasu !&îtt S ftl 2 „ &'} 0 : ofr È'tz't (Un savoir trans-frontières ; récits : tissages), Tôkyô, Tôkyô daigaku shuppankai, 2000, p. 277-317.
76 C'est le terme le plus courant et c'est celui-là qui a été retenu pour la traduction japonaise du livre d'A. Honneth (voir supra, note 1) : Shônin o meguru tôsôshakaiteki konfurikuto no dôtokuteki bunpô /FCi€i&*!)<*S|i3-/HI:£?(rV=i>7t; ? h coWËMXiii (Grammaire morale du conflit dans la lutte sociale pour la reconnaissance), Tôkyô, Hôsei daigaku shuppankyoku ïicJ&À''/:'iil!fc'itj, 2003.
PaulJobin 55
Qu 'est-ce que c 'est que cette « exposition universelle » r Qu 'est-ce que la pauvreté ? Hein ? Souviens-toi ! Apprends-le à ceux qui ne savent pas ! Toi qui viens d'une famille où l'on mangeait des épluchures de patate. Tu ne te souviens pas ? Si tu es un être humain, lève-toi ! Bats-toi ! Fais la guerre contre la pollution, la guerre de Minamata. Nous qui détestons la guerre, il nous faut faire cette guerre-là. La dernière guerre de l'humanité .
Un accord politique, même le moins imparfait possible, ne saurait en aucun cas signifier la fin de l'histoire : proclamer que la maladie de Minamata est finie revient à oblitérer le prix payé par toute une partie de la population pour une course effrénée au développement. Combien de temps dure une guerre lorsqu'elle est finie ? À cet égard, et malgré l'incongruité inhérente à toute comparaison lorsqu'on parle de tragédie collective et de souffrance individuelle, une sociologie de la mémoire ne peut esquiver les parallèles qui ont été esquissés entre Minamata et la Shoah, Hiroshima, Bhopal, Tchernobyl, ou encore la guerre du Vietnam. Par exemple, si les millions de litres d'herbicides qui furent répandus par les avions américains n'en finissent pas d'affecter le quotidien de trois générations de Vietnamiens, soit plus d'un million de personnes, en comparaison, il n'y a plus d'enfants qui naissent affectés par la maladie de Minamata, du moins au Japon79. Mais le trauma psychologique collectif est loin d'avoir disparu. Et même sur le plan épidémiologique, tout dépend des critères scientifiques pris en compte, comme Kawamoto Teruo l'a exprimé de manière très concrète, en réaction au « règlement final» de 1995:
On estime à environ 400 tonnes la quantité de mercure que Chisso a probablement déversé dans la mer. Sur ces 400 tonnes, si on calcule la quantité de mercure organique, ou mercure méthyle, qui a servi à la production d'acétaldéhyde, et qui a provoqué la maladie de Minamata, les estimations vont de 5 à 27 tonnes. Et bien même s 'il s 'agit de 5 tonnes, ce qu 'on peut dire c'est qu 'entre 20 et 25 milligrammes de mercure méthyle, les pieds et les mains commencent à trembler. Lorsqu'on atteint 100 milligrammes, le champ visuel se rétrécit. Et à 200 milligrammes, on atteint un seuil mortel. Un gramme, c'est 1 000 milligrammes. Donc 1 gramme de mercure méthyle, cela peut tuer 5 personnes, ou bien provoquer l'apparition de la maladie de Minamata sur 40 ou 50 personnes. Or au minimum, on parle de 5 tonnes. Donc, si on fait le calcul, la quantité de mercure méthyle déversée a pu provoquer 25 000 000 000 morts ou bien l'apparition de la
Allusion à l'exposition universelle d'Ôsaka. 78 TSUCHIMOTO Noriaki, Eiga wa ikimono no shigoto de aru, op. cit., p. 263-264. Sur ce
pèlerinage, voirlWASE Masao 'l'Mikk, Minamata junrei seishun gurafiti 1970-72 MAW.'Li-l&y 7 7 4 t i" 70~'72 (Pèlerinage à Minamara : quelques graffiti de jeunesse 1970-72), Gendai shokan flifÇ i*îfilt, 1 999 (préface de Kurihara Akira).
Concernant les différentes occurrences de la maladie de Minamata à travers le monde, voir HARADA Masazumi, Minamata-byô to sekai no suigin ôsen /M59wfc l'tW-cO/KIRf'j"^ (La maladie de Minamata et la pollution au mercure à travers le monde), Tôkyô, Jikkyô shuppan '^SiUliS, 1995.
56 La maladie de Minama ta et le conflit pour la reconnaissance
maladie surplus de 200 000 000 000 personnes™ .
Même si Kawamoto exagérait volontairement ce propos, le parcours extraordinaire de son auteur illustre à quel point il ne saurait y avoir de solution consensuelle et technicienne aux maladies industrielles. À défaut de leur prévention, leur reconnaissance passe par la confrontation directe, au risque du conflit. En même temps, ce qui retient l'attention dans la façon dont un Kawamoto ou un Ogata s'engagent dans le conflit, c'est qu'ils ne diabolisent jamais ceux qu'ils affrontent, comme si leur visée ultime était de dépasser la dichotomie entre la victime et le coupable, comme s'ils recherchaient un face-à-face en vérité pour obtenir une reconnaissance mutuelle. Il ne s'agit pas d'ériger en idéaux types ou en modèles les parcours de ces personnalités, et encore moins d'en tirer des principes moraux, mais de les voir comme des pointes représentatives d'un vaste mouvement social qui s'oppose à une certaine logique sacrificielle de l'économie, justifiée tantôt par la croissance tantôt par la récession. Cette forme de lutte pour la reconnaissance apparaît notamment presque trait pour trait dans les syndicats minoritaires qui résistent au coopérationnisme dominant depuis I960 : on y retrouve un mélange identique de radicalité dans les exigences, de non-violence, de véhémence humble, et une quête semblable de et en vérité par la confrontation directe81.
80 Dans KURIHARA Akira, Shôgen Minamata-byô, op. cit., p. 108. 1 À la pointe de ce « nouvel esprit du syndicalisme » japonais que j'ai tenté de décrire dans
ma thèse, on peut placer la lutte du syndicat des cheminots telle que l'ont magnifiquement représentée MATSUBARA Akira %àWM et SASAKI Yumi iktfciîZk dans leur film « Hito rashiku ikiyô, Kokurô fuyu monogatari » AÇ>L (*£% £î , JM^^-Wm D (Vivre comme des humains, l'hiver des cheminots japonais), 2001, 100 min. (vidéo), Video Press : http://www.h4.dion.ne.jp/-tomonigo/. Depuis sa sortie en novembre 2001, ce film fait l'objet d'un enthousiaste « mouvement de projection » (jôei undô \;WkWÊ)J), y compris parmi de nombreux jeunes jusqu'alors indifférents aux questions syndicales de « démocratie sur le lieu de travail » {shoknba no minshushugi