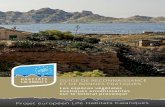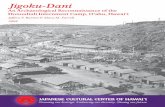Reconnaissance des voies d’accès à l’oppidum
-
Upload
uni-hamburg -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of Reconnaissance des voies d’accès à l’oppidum
Programme quadriennal de recherche 2013-2016
sur le Mont Beuvray
RappoRt inteRmédiaiRe 2013
Décembre 2013
Synthèse
Photo de couverture : Bibracte, Mont Beuvray. Sommet et versant oriental du Theurot de la Roche. Bec verseur, base cuivre, L. 3,8 cm (B2013.40.2055.1 ; cliché Bibracte/A. Maillier 2013)
Rapport 2013 : BIBRACTE, programme de recherches sur le Mont Beuvray. Rapport intermédiaire 2013. Glux-en-Glenne : BIBRACTE, 2013, publication numérique : http ://www.bibracte.fr, mot-clé rapport 2013.
Direction scientifique du programme de recherche Vincent Guichard (BiBracte)
Suivi éditorial Vincent Guichard, Pascal Paris (BiBracte)
Maquettage Sébastien Durost (BiBracte)
Traitement graphique Sébastien Durost, Antoine Maillier, Arnaud Meunier, Chloé Moreau (BiBracte)
Crédit iconographique Sauf mention contraire, les photos et dessins sont réalisées par les équipes de fouille ; les mises au net de certains plans et les normalisations sont réalisées par l’atelier graphique de Bibracte.
Ce rapport est publié uniquement sous forme numérique. Il rend compte des travaux effectués au cours de l’année 2013 dans le cadre du programme de recherche sur le Mont Beuvray sous la direction scientifique de Bibracte, Centre archéologique européen (Vincent Guichard, directeur scientifique).
Les comptes rendus à caractère scientifique qui y sont consignés sont provisoires et ne correspondent qu’à une étape de futures publications.
mot-clé : rapport 2013
5
rapport intermédiaire 2013 du programme quadriennal de recherche 2013-2016 sur le mont Beuvray
BIBRACTE Centre archéologique européen
SYNTHÈSE
1 DÉROULEMENT DE LA CAMPAGNE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
2 TRAVAUx DE TERRAIN SUR L’OPPIDUM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15 Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17 Reconnaissance des voies d’accès à l’oppidum (interv. 778) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21 Prospection des fortifications de l’oppidum de Bibracte par la technique de la tomographie de résistivité électrique (interv. 785) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35 Prospections géophysiques au Parc aux Chevaux, à la Côme Chaudron, à la Terrasse et au Porrey (interv. 756) . . . . . . . . . . . . . .43 Prospections géophysiques à la Pâture du Couvent et au Champlain (interv. 791) . . . . . . . . . . . . . . .57 Le quartier du Champlain (interv. 783) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .65 Le parc aux Chevaux - PC 14 (interv. 781) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .79 La partie occidentale des terrasses PC 14 et PC 15 (interv. 780) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .111 Le sommet et le versant oriental du Theurot de la Roche (interv. 779) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .155 La domus PC 1 (interv. 782) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .193 Compléments d’observation à la Pâture du Couvent (interv. 757, 784, 795) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .209
3 TRAVAUx DE TERRAIN ACHEVÉS EN COURS D’ExPLOITATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235
4 ÉTUDES SPÉCIALISÉES ET TRANSVERSALES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239 Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .241 La céramique (interv. 616) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .243 La céramique sigillée (interv. 800) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .245 Les amphores (interv. 705) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .247 Les monnaies (interv. 307) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .259 Le métal et l’instrumentum (interv. 761) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .261 Les fibules (interv. 767) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .265 Les intailles (interv. 595) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .267 Le petit mobilier de type italique (interv. 798) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .269 L’outillage en pierre (interv. 678) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .271 Analyse d’échantillons de verre (interv. 750) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .273 Les terres cuites architecturales (interv. 741) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .279 Les matériaux de construction de la romanisation (interv. 768) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .293 L’architecture en bois (interv. 799) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .319 Archéobotanique : carporestes (interv. 703) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .323 Archéobotanique : charbons de bois (interv. 787) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .329 une expérience nouvelle de publication : la nécropole de la Croix du Rebout (interv. 802) . . . . . . .337
5 OUTILS DE LA RECHERCHE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 339 Outils documentaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .341 Mobiliers et synthèse chronologique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .343 Synthèse spatiale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .347
6 PROGRAMMES DE RECHERCHE ASSOCIÉS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 353 L’occupation des territoires entre Morvan et Arroux de la préhistoire au Moyen-âge . . . . . . . . . . .355 Les carrières de meules de Bibracte et d’Autun . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .359 Étude des mines d’étain en alluvions et en roche protohistoriques et antiques du Sud du Morvan (Bibracte et Autun) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 365
7 PUbLICATIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 375
8 MANIfESTATIONS SCIENTIfIqUES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 383
9 bILAN SCIENTIfIqUE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 389
action 1.1 : reconnaissance des voies d’accès à l’oppidum – intervention 778
Reconnaissance des voies d’accès à l’oppidumpeter HAUPT1, ines KLENNER2, Franck NIKULKA3
1. Maître de conférences, Institut für Vor- und Frühgeschichte, université Johannes Gutenberg, Mayence 2. Assistante, institut d’Archéologie, université de Hambourg 3. Professeur, institut d’Archéologie, université de Hambourg
21BIBRACTE Centre archéologique européen
Cette synthèse s’appuie sur les données (catalogue des unités de prospection (2012-2013), catalogue des objets inventoriés à l’issue des campagnes 2012 et 2013, listing des objets prélevés (2012-2013)) présentées dans le référentiel analytique du rapport annuel 2013
du programme quadriennal de recherche 2013-2016 sur le Mont Beuvray.
Zone 5[833]
Zone 1[829]
Zone 6[834]
Zone 4[832]
Zone 3[831]
Zone 2[830]
Zone 9[837]
Zone 7[835]
Zone 8[836]
0 250 500 m
PorteA9 / B2
Remparts de l’oppidum
728000
728000
728500
728500
729000
729000
729500
729500
730000
730000
730500
730500
2135
00
2135
00
2140
00
2140
00
2145
00
2145
00
2150
00
2150
00
2155
00
2155
00
2160
00
2160
00
2165
00
2165
00
B1
B2
B3
B4 B5 B6
B7
A1 ?A2 A3
A4
A5
A6(A7)
A8
A9
1. Bibracte, Mont Beuvray. Reconnaissance des voies d’accès à l’oppidum. Localisation des neuf zones de prospection de 2012 et 2013 (fond LIDAR et IGN).
22
BiBracte
Centre archéologique européen
Rapport intermédiaire 2013 du programme quadriennal de recherche 2013-2016 sur le Mont Beuvray
INTERVENTION N° 778
PROSPECTION DES VOIES D’ACCÈS à L’OPPIDUM
Campagne de prospection du 18 au 30 mars 2013
Responsable Terrain
Peter HAUPT : Maître de conférences, Institut für Vor- und Frühgeschichte, université Johannes Gutenberg, MayenceInès KLENNER : Assistante, institut d’Archéologie, université de Hambourg
Franck NIKULKA : Professeur, institut d’Archéologie, université de Hambourg
Équipe de prospection
Helena BRINCKMANN, Thomas HEPFER, Ada HIRCHE, Florian KüHLE, Mareike NEUDECKERétudiants à l’université de Hambourg,
Judith UNGER, Hannah STREHLAU, Madlen ENGEL, Arno BRAUN, Mario DöRRBAUM, Wolfram NEy, Johanna RIEHLING - étudiants à l’université de Mayence
SIG et cartographie
Ines KLENNER,Arnaud MEUNIER, archéologue géomaticien, Bibracte
Rédaction du rapport
Peter HAUPT, Ines KLENNER, Frank NIKULKA
Traduction de l’anglais
Vincent GUICHARD
Titulaire de la décision de fouille programmée
Vincent GUICHARD : Directeur général, directeur scientifique, Bibracte
v
v
23
rapport intermédiaire 2013 du programme quadriennal de recherche 2013-2016 sur le mont Beuvray
2 - travaux de terrain sur l’oppidum – action 1.1 : reconnaissance des voies d’accès à l’oppidum
reconnaissance des voies d’accès à l’oppidum (intevention 778)
BIBRACTE Centre archéologique européen
RÉSULTATS
Sur le versant nord du Mont beuvray (ill. 1, 2, 3)
Pour compléter le travail effectué en 2012, trois tron-çons supplémentaires de cheminements bien marqués dans la topographie ont été prospectés (zones 5 [833] et 6 [834]). Cela confirme que le chemin actuel qui joint le col de l’Échenault à la Porte de l’Écluse (n° 1, emprunté par le GR13) ne présente aucun indice d’ancienneté : tous les objets qui lui sont associés sont modernes ou contemporains. Vu la grande longueur prospectée et l’absence de traces visibles d’érosion, nos résultats nous semblent montrer avec une bonne fiabilité que ce che-minement n’est pas ancien. La conclusion est la même pour le chemin n° 5, qui apparaît comme une simple voie d’exploitation forestière récente.
Cependant, dans les 200 m situés en amont de la lisière de la forêt, un réseau complexe de chemins plus anciens est bien visible dans la topographie, notamment à l’est du chemin actuel. Il s’agit notamment du chemin creux (n° 2, 3, 4) dont la datation ne précède pas l’époque moderne selon les résultats de 2012 et qui doit être mis en relation avec l’exploitation forestière du massif.
La prospection de la prairie située entre la lisière et la route départementale RD 18 (zone 5 [833]) a livré des concentrations élevées de déchets métalliques du xxe siècle, comme on en trouve habituellement dans les espaces cultivés proches des habitations. Le pro-longement n° 6 du chemin creux n° 3 est bien visible sur le relevé LIDAR, bien que partiellement comblé par les labours. L’analyse spatiale montre que ce chemin a été abandonné au profit du tracé n° 1, sans doute au cours de l’époque moderne (xviiie siècle ?). Au vu des résultats obtenus en 2012 sur un tronçon situé en amont (n° 3 bis) et de la topographie, on pense que ce tracé était déjà actif à l’époque de Bibracte, bien que le mobilier collecté en 2013 dans la prairie ne confirme pas cette hypothèse.
Sur le versant sud-ouest du Mont beuvray (ill. 1, 2, 4)
Dans le sud-ouest de l’oppidum, nous nous sommes intéressés à la voie issue des Grandes Portes (zone 7 [835]). La prospection s’est développée sur 1,8 km le long du chemin actuel qui, après avoir franchi le rem-part, emprunte la ligne de crête qui sépare le vallon de Malvaux et la vallée de la Roche. Ce chemin en pente forte mais assez régulière franchit une dénivelée de 300 m sur ce parcours.
PRObLÉMATIqUE ET CONDITIONS DE LA PROSPECTION
Cette action systématise les prospections menées à titre expérimental en 2012. Recourant simultanément à l’analyse microtopographique et à la prospection géophysique (repérage au détecteur à métaux et prélè-vement des artefacts métalliques enfouis), elle vise tout d’abord à préciser le tracé et les périodes de fonction-nement de la voirie ancienne liée à l’oppidum. Comme exposé dans le programme de recherche 2013-2016, on s’est prioritairement intéressé aux pentes du Mont Beu-vray (terrains sous maîtrise foncière de l’EPCC), sans s’interdire d’étendre les recherches dans un second temps, notamment en direction des Sources de l’Yonne (au-delà du col de l’Échenault) et du hameau du Rebout (au-delà du col du Rebout).
Dans son avis sur le rapport scientifique 2012 et sur le programme de recherche 2013-2026, la commission interrégionale de la recherche archéologique avait émis des réserves sur cette action qui nécessitaient selon elle « une définition plus précise des méthodes et objectifs ».
Dans le prolongement des résultats obtenus en 2012, les objectifs pour la campagne de 2013 étaient donc de mieux adapter les méthodes aux conditions locales, de compléter les prospections sur le flanc nord du Mont Beuvray et d’explorer le tracé de deux autres voies anciennes issues des portes de l’oppidum, au sud et à l’est (ill. 1, 2). Nous avons utilisé deux stations totales, un GPS (Leica SR 20) et quatre détecteurs de métaux (XP GOLDMAXX Power). L’équipe de prospec-tion était composée de cinq étudiants de l’université de Hambourg et six étudiants de l’université de Mayence. Les données obtenues ont été traitées avec les logiciels Excel et ArcGIS. Les points de collecte de 2012 et 2013 ont été divisés en neuf zones de prospection : six sur le versant nord du Mont Beuvray (UF [829-832] en 2012, [833-834] en 2013), deux sur le versant sud-ouest ([835-837]) et un sur le versant sud-est ([836]). Chaque zone de prospection, de forme polygonale, a été prospectée de façon systématique et uniforme. Leur géométrie a été définie de façon à déborder largement de part et d’autre des anciens axes de cheminement présumés.
Tous les artefacts métalliques détectés ont été pré-levés, leur position géoréférencée et leur profondeur d’enfouissement dûment notée dans un tableau Excel afin de permettre une exploitation statistique complète des données. Le protocole de traitement du mobilier est précisé dans le chapitre qui lui est consacré (cf. infra).
24
BiBracte
Centre archéologique européen
Rapport intermédiaire 2013 du programme quadriennal de recherche 2013-2016 sur le Mont Beuvray
0 250 500 m
Remparts de l’oppidum
Zone prospectée en 2012
Zone prospectée en 2013
728000
728000
728500
728500
729000
729000
729500
729500
730000
730000
730500
730500
2135
00
2135
00
2140
00
2140
00
2145
00
2145
00
2150
00
2150
00
2155
00
2155
00
2160
00
2160
00
2165
00
2165
00
2. Bibracte, Mont Beuvray. Reconnaissance des voies d’accès à l’oppidum. Localisation des zones prospectées en 2012 et 2013 sur fond Scan 25 ® © IGN.
25
rapport intermédiaire 2013 du programme quadriennal de recherche 2013-2016 sur le mont Beuvray
2 - travaux de terrain sur l’oppidum – action 1.1 : reconnaissance des voies d’accès à l’oppidum
reconnaissance des voies d’accès à l’oppidum (intevention 778)
BIBRACTE Centre archéologique européen
0 50 100 m
Epoque contemporaine
Epoque moderne
Antiquité
Datation
Zone 5[833]
Zone 1[829]
Zone 6[834]
729000
729000
729100
729100
729200
729200
729300
729300
2164
00
2164
00
2165
00
2165
00
2166
00
2166
00
1
2
3
4
5
6
4
3 bis
0 50 100 m
Epoque indeterminée
Epoque contemporaine
Epoque moderne
Antiquité
Datation
Zone 5[833]
Zone 1[829]
Zone 6[834]
Zone 3[831]
Vers la Portedu Rebout
Zone 3[831]
Vers la Portedu Rebout
Vers
la P
orte
de l’
Eclu
se
Vers
la P
orte
de l’
Eclu
se
Vers
le c
olde
l’Ec
hena
ult
Vers
le c
olde
l’Ec
hena
ult
729000
729000
729100
729100
729200
729200
729300
729300
2164
00
2164
00
2165
00
2165
00
2166
00
2166
00
3. Bibracte, Mont Beuvray. Reconnaissance des voies d’accès à l’oppidum. Cartographie des objets découverts au détecteur de métaux dans les zones 1 [829] (2012), 5 [833] et 6 [834] (2013) situées sur le versant nord du Mont Beuvray et proposition d’interprétation des résultats.
26
BiBracte
Centre archéologique européen
Rapport intermédiaire 2013 du programme quadriennal de recherche 2013-2016 sur le Mont Beuvray
GR 13
B4A8
Les GrandesPortes
Zone 7[835]
728500
728500
728600
728600
728700
728700
728800
728800
728900
728900
2145
00
2145
00
2146
00
2146
00
2147
00
2147
00
0 50 100 m
Chemin
Rempart intérieur B
Rempart extérieur A
Zone de traitement Lidar perturbéepar la présence de végétation basse dense
Epoque indeterminée
Epoque moderne
Epoque médiévale
Epoque contemporaineAntiquité
Age du Fer
Datation
Nécropole ?
4. Bibracte, Mont Beuvray. Reconnaissance des voies d’accès à l’oppidum. Cartographie des objets découverts au détecteur de métaux en 2013 sur le versant sud-ouest du Mont-Beuvray, aux abords des Grandes Portes et localisation possible d’une nécropole.
Sur les 200 premiers mètres de son parcours depuis la porte, pratiquement rectiligne, l’activité contem-poraine a épargné les surfaces de circulation plus anciennes, comme le montre l’abondance des objets datés de l’époque moderne, voire antiques, sur son tra-cé. À partir du premier coude, la situation est nettement plus défavorable : ici, le tracé a été perturbé par des travaux de drainage. Malgré cela, quelques objets anté-rieurs à l’époque contemporaine ont pu être collectés.
Encore plus en aval, deux tracés désaffectés proches de la voie actuelle ont été prospectés, ne livrant que quelques gros objets en fer pour l’un et aucun arte-fact pour l’autre. Deux coupes ont été effectuées dans l’axe de ces tracés pour préciser leur état de préser-vation (ill. 5). Cela a montré que la surface de la voie dépourvue de mobilier était recouverte d’une couche de colluvions épaisse de plusieurs décimètres, tandis qu’une dépression de la surface peut correspondre à une incision provoquée par le ruissellement de l’eau. La deuxième coupe montre une situation un peu plus complexe : la couche de colluvion qui occulte la sur-
face ancienne de roulement est bien présente, mais on observe aussi des ornières plus récentes incrustées dans cette couche.
Enfin, à environ 80 m de la porte, la prospection a été élargie sur un espace de 60 x 110 m en pente régu-lière afin de détecter d’éventuels indices de sépultures, comme on peut s’y attendre à l’approche des remparts (ill. 4). Le mobilier collecté comprend effectivement sept monnaies de l’époque de Bibracte, un tesson de céramique et deux fragments d’alliage de bronze fondu. L’ensemble est néanmoins insuffisant pour iden-tifier à coup sûr un espace funéraire.
Sur le versant sud (ill. 1, 2, 5)
Une autre zone de prospection située plus en aval (zone 9 [837]) a concerné le chemin taillé dans le rocher situé sur le flanc oriental du vallon de Malvaux (ill. 6). Cette voie surplombée par le pittoresque rocher dit « Clocher de Malvaux » a été décrite par J.-G. Bulliot et analysée en détail par R. Niaux (1994, p. 184-195).
27
rapport intermédiaire 2013 du programme quadriennal de recherche 2013-2016 sur le mont Beuvray
2 - travaux de terrain sur l’oppidum – action 1.1 : reconnaissance des voies d’accès à l’oppidum
reconnaissance des voies d’accès à l’oppidum (intevention 778)
BIBRACTE Centre archéologique européen
Profil 1Profil 2
Zone 7[835]
Zone 9[837]
727800
727800
727900
727900
728000
728000
728100
728100
728200
728200
728300
728300
2135
00
2135
00
2136
00
2136
00
2137
00
2137
00
2138
00
2138
00
2139
00
2139
00
Epoque moderne
Epoque indeterminée
Epoque contemporaine
Antiquité
Age du Fer
Datation
Couche arabletrès humique
Niveau de colluvions
Profil 2
Roche altérée Couche humique, riche en terreau
Ornière Ornière
0 0.25 0.5 m
Niveau de sol ancien
Niveau de colluvionsCouche arabletrès humique
Profil 1
0 0.25 0.5 m
0 50 100 m
5. Bibracte, Mont Beuvray. Reconnaissance des voies d’accès à l’oppidum. Cartographie des objets découverts sur le versant sud-ouest du Mont-Beuvray (fond Scan 25 ® © IGN) et profils stratigraphiques relevés sur des tracés anciens de chemins (P.Haupt).
28
BiBracte
Centre archéologique européen
Rapport intermédiaire 2013 du programme quadriennal de recherche 2013-2016 sur le Mont Beuvray
Le chemin de Malvaux s’inscrit donc dans un réseau de chemins (pas forcément tous anciens) des versants sud et sud-ouest de Bibracte. Les modifications appor-tées à ces chemins – du moins à la plupart d’entre eux – au cours du xxe siècle, par suite de travaux forestiers – rectifications de tracés, abandon de certaines portions, passages de gros engins, terrassements, nouvelles plan-tations – ne permettent plus de les identifier par leur seul aspect. Toutefois, le chemin de Malvaux a échappé à ces avatars. Ce n’est pas un chemin d’accès à l’oppidum de Bibracte. Le raccordement qu’il réalise entre le chemin de Montodué à Montvernot et le chemin latéral au ruis-seau de Malvaux ne présente plus, depuis longtemps, aucun intérêt. Personne ne l’utilisant, il était encore, il y a peu d’années, impraticable sur la plus grande partie de son parcours. Il a ainsi échappé à la destruction.
[…]Sa caractéristique essentielle est la réalisation d’un
parcours en terrain généralement rocheux, partant au niveau d’un ruisseau dans une vallée profonde et se maintenant à flanc de vallée suivant une pente très faible vers l’aval. Cette caractéristique est affirmée par des passages en force à travers les masses rocheuses lorsque celles-ci font obstacle au maintien d’un niveau
Nous empruntons à ce dernier des éléments de des-cription et d’interprétation :
« Selon la carte IGN au 1/25 000 2 825 ouest « Saint-Léger-sous-Beuvray », ce chemin se déroule de 727,775 - 212,97 au sud à 728,20 - 213,70 au nord, sur une distance mesurée au pas de 887,50 mètres. Situé entière-ment sur la commune de Larochemillay, il s’embranche au sud sur le chemin de Montodué à Montvernot. Ce tronçon Montodué / Montvernot paraît s’inscrire dans une suite de chemins qui joignent la Croix de Meux au Foudon (la Croix de Meux, Pierrefitte, les Praies, Monto-dué, Montvernot, le Charbonnet, le Foudon). La Croix de Meux est sur la voie sud de Bibracte à la Loire ; le Foudon est sur la voie ouest de Bibracte à Saint-Honoré.
Le chemin de Malvaux se termine vers le nord au ruisseau de Malvaux, qu’il traverse, pour se rattacher à un chemin latéral à ce ruisseau, sur sa rive droite. Ce chemin latéral s’embranche à l’ouest au chemin issu des « Grandes Portes » de Bibracte, tendant à la vallée de la Roche. À l’est, il remonte le ruisseau jusqu’à la cote 570, le traverse et repart vers le sud-ouest jusqu’au carrefour de « Pas de l’Âne », carrefour où aboutissent de multiples chemins vers la Place-aux-Laides, Montmoret, le Moy, Pierrefitte, Montodué.
6. Bibracte, Mont Beuvray. Reconnaissance des voies d’accès à l’oppidum. Vue du chemin taillé dans le rocher avec ornières dans le vallon de Malvaux (cliché F. Nikulka).
29
rapport intermédiaire 2013 du programme quadriennal de recherche 2013-2016 sur le mont Beuvray
2 - travaux de terrain sur l’oppidum – action 1.1 : reconnaissance des voies d’accès à l’oppidum
reconnaissance des voies d’accès à l’oppidum (intevention 778)
BIBRACTE Centre archéologique européen
déblais d’activités minières à l’endroit où il rencontre le ruisseau de Malvaux. Le long du chemin lui-même, nous avons aussi collecté du minerai de fer (repéré au détecteur à métaux et avec des aimants) en plusieurs emplacements. Il n’est donc pas impossible que l’en-semble des aménagements (conduit hydraulique et chemin taillé dans le rocher) soit en relation avec une activité minière moderne.
Sur le versant sud-est du Mont beuvray (ill. 1, 2, 7)
La prospection le long du chemin issu de la porte A5/B7 située en amont de la fontaine Saint-Martin (zone 8 [836]) a livré étonnamment peu d’objets antiques, malgré des conditions de conservation du chemine-ment ancien apparemment bonnes (pas d’érosion ni de colluvionnement, au moins localement, notamment à une centaine de mètres au-dessous de la source). Cela pourrait indiquer que cet accès à l’oppidum était peu fréquenté, à moins que les modifications du tracé
constant. À l’inverse, lorsque la défaillance du relief contraint à une légère descente, celle-ci est compensée par la taille d’une étroite banquette à flanc de rocher maintenant la constance du niveau au plus près du che-min. L’ensemble du tracé a été choisi avec suffisamment d’intelligence pour que ces deux catégories d’obstacles soient réduites au minimum. On peut donc penser que le chemin accompagne le parcours d’une voie d’eau, détournée du cours du ruisseau de Malvaux, un peu en amont du niveau 440. Les travaux éventuels de dériva-tion au niveau du captage sont invisibles, ce qui n’est pas surprenant si ces travaux sont anciens, étant donné la violence des crues dans cette vallée profonde et très pentue au nom évocateur (Malvaux = mauvaise vallée). Tout au plus devine-t-on un léger replat et un léger coude du ruisseau au point supposé de la dérivation ».
En complément des observations de R. Niaux, nous avons noté de nombreuses traces d’outils sur le front du rocher qui surplombe le chemin et des mou-vements de terrain que nous interprétons comme des
Zone de traitement Lidar perturbéepar la présence de végétation basse dense
B7
A5
FontaineSt Martin
Ruisseau de La Rèpe
Zone 8[836]
Chemin
Rempart intérieur B
Rempart extérieur A
0 20 40 m
Epoque moderne
Epoque indeterminée
Epoque contemporaine
Epoque médiévale
Antiquité
Datation
729600
729600
729700
729700
729800
729800
2148
00
2148
00
2149
00
2149
00
7. Bibracte, Mont Beuvray. Reconnaissance des voies d’accès à l’oppidum. Cartographie des objets découverts au détecteur de métaux en 2013 à l’est de la Fontaine Saint-Martin (zone 8 [836]).
30
BiBracte
Centre archéologique européen
Rapport intermédiaire 2013 du programme quadriennal de recherche 2013-2016 sur le Mont Beuvray
ou très récente (ill. 8a). La plupart correspondent à des fers de bœuf et de cheval (ill. 8b). On note aussi beau-coup d’outils.
Les objets datant en toute certitude de l’Antiquité se montent à seulement 4 %. Il s’agit principalement de monnaies contemporaines de l’oppidum (10 ex.), de clous de chaussure romains (4 ex.), de tessons d’amphores (4 ex.), de deux couteaux de typologie laténienne (B2013.2.835.1, B2013.2.835.2), de clavettes (9, dont une au moins de l’époque de Bibracte : B2013.2.835.11) et de quatre clous de murus gallicus (B2012.2.831.195, 200, 206 et B2012.2.832.114).
CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES
Aspects méthodologiques
L’objectif de notre recherche est la reconstitution du réseau routier ancien dans les environs de l’oppi-dum de Bibracte et de l’agglomération contemporaine des Source de l’Yonne mise en évidence ces dernières années. En plus de la datation des voies, notre ambition est d’effectuer un classement fonctionnel des voies et d’évaluer l’intensité du trafic qui les parcourait, tant il paraît probable que toutes n’avaient pas le même usage : les charrois les plus lourds devaient préférer les pentes les plus faibles, certaines portes pouvaient être réservées à certaines catégories de personnes, d’autres au bétail, etc. Des activités particulières comme l’accès aux espaces funéraires, le déplacement de troupes ou l’exploitation minière, ont aussi pu engendrer un trafic
et de la surface soient plus importantes qu’il n’y paraît. On note en revanche qu’une concentration de mon-naies autour de la source témoigne de sa fréquentation assidue à l’époque moderne.
MObILIERS
Comme en 2012, tous les objets prélevés ont été géoréférencés et l’on a documenté leur profondeur d’enfouissement ainsi que la nature du sédiment dans lesquels ils étaient enfouis. Au total, plus de 900 objets ont ainsi été traités au cours de la campagne 2013, qui s’ajoutent aux 416 objets de la campagne 2012 (la liste complète est fournie dans le référentiel). Un choix a été effectué en concertation avec l’équipe de Bibracte des objets qui méritaient une conservation durable. Les objets sélectionnés (et affectés d’un numéro d’enregis-trement individuel) sont au nombre de vingt-trois pour la campagne de 2012 et de cinquante-quatre pour celle de 2013 (leur catalogue est également fourni dans le référentiel accompagnant cette synthèse).
Les statistiques sur les profondeurs d’enfouisse-ment n’apportent pas d’informations supplémentaires par rapport à ce qui avait été constaté lors de la cam-pagne de 2012 (Haupt 2012, p. 311, fig. 3).
Environ un tiers des objets collectés en 2013 n’est pas datable, principalement en raison de leur mauvaise conservation, s’agissant en grande majorité d’objets en fer. Près de 40 % des objets sont liés à l’activité forestière moderne et 22 % datent de l’époque contemporaine
Age du Fer!1%!
AntiquitŽ !4%!
Epoque!mŽ dievale!
1%!
Epoque moderne!39%!
Epoque!contemporaine!
16%!Epoque!rŽ cente!
6%!
Epoque! indŽ terminŽ e!
33%!
Statistique chronologique (n=984)!
Accessoires Armement Vaisselle/cŽ ramique Fers (cheval ou bÏ uf) Harnachement Monnaies Clous de Murus Gallicus Accessoires de chevaux DŽ chets rŽ cents Clous de chaussures Clous Bijoux et parures ElŽ ments de charrette Outils
16! 24! 7!
385!
16! 36!5! 1!
58!24!
88!
16! 11!
114!
Statistique fonctionnelle (n=801)!
Acces
soire
s
Armem
ent
Vaiss
elle/c
éram
ique
Fers
(chev
al ou
bœuf)
Harnac
hemen
t
Monna
ies
Clous d
e Mur
us G
allicu
s
Acces
soire
s de c
heva
ux
Déche
ts ré
cents
Clous d
e cha
ussu
res
Clous
Bijou
x et p
arure
s
Elémen
ts de
charr
ette
Outi
ls
a b
8. Bibracte, Mont Beuvray. Reconnaissance des voies d’accès à l’oppidum. Statistique chronologique (a) et fonctionnelle (b) des objets découverts en 2012-2013 (I. Klenner).
31
rapport intermédiaire 2013 du programme quadriennal de recherche 2013-2016 sur le mont Beuvray
2 - travaux de terrain sur l’oppidum – action 1.1 : reconnaissance des voies d’accès à l’oppidum
reconnaissance des voies d’accès à l’oppidum (intevention 778)
BIBRACTE Centre archéologique européen
Il nous faut encore rappeler que nous avons la pré-occupation d’améliorer les méthodes de prospection et de communiquer notre expérience aux étudiants qui participent à nos travaux. En raison de la mauvaise utilisation fréquente des détecteurs de métaux par des personnes non autorisées, nous sommes également attentifs à ce que notre travail constitue une recherche archéologique à part entière. Le protocole est le sui-vant : une personne maniant un détecteur de métaux est accompagnée par une ou deux autres qui sont chargées d’exhumer les objets et de les placer dans des sacs en plastique laissés à l’emplacement de la décou-verte. Une seconde équipe intervient immédiatement après pour relever les coordonnées des sacs, prendre des notes sur le contexte sédimentaire des objets et les collecter.
Les zones prospectées sont généralement limi-tées aux abords immédiats des voies. La proposition effectuée par le conseil scientifique de Bibracte de prospecter des transects plus larges n’a pu être testée cette année qu’aux abords des Grandes Portes, des travaux forestiers nous ayant interdit d’en faire autant sur le flanc nord du Mont Beuvray. Le transect étudié, localisé dans une zone peu pentue, a donné des résul-tats qui suggèrent la présence d’une zone funéraire. L’élargissement des prospections doit répondre à des questions précises et les protocoles de prélèvement nous semblent devoir être adaptés au cas par cas (la réalisation de petits sondages manuels d’au moins 0,5 x 0,5 m nous semble envisageable dans certains cas).
Perspectives
Nous souhaitons poursuivre nos prospections aux abords immédiats de l’oppidum de Bibracte en nous intéressant à tous les types d’aménagements antiques que l’on peut rencontrer : tout d’abord les voies, mais aussi les zones d’habitat et de sépulture, voire les zones d’exploitations minières, en adaptant les outils mis en œuvre et les protocoles d’intervention au cas par cas avec le souci de privilégier les approches extensives et non destructrices. Un nouveau projet sera rédigé en ce sens durant l’hiver afin de solliciter un financement spécifique des institutions allemandes.
Nous avons ainsi identifié plusieurs zones d’in-tervention privilégiées, où nous nous proposons d’intervenir dès lors que l’équipe de Bibracte aura collecté les autorisations nécessaires, en privilégiant le secteur du col de l’Échenault, ainsi que l’a préconisé le conseil scientifique de Bibracte lors de sa réunion de septembre 2013 (ill. 9) :• Col de l’Échenault. Ce secteur est particulière-
ment intéressant pour plusieurs raisons. C’est tout
particulier. De ce point de vue, il est également impor-tant de connaître le statut des sites qui étaient reliés à Bibracte par le réseau routier. Nous nous appuyons pour cela sur les résultats des prospections conduites par d’autres (notamment P. Nouvel ), sans exclure la possibilité d’effectuer des sondages de vérification quand nécessaire.
L’accent est mis sur la reconstruction du réseau routier à partir des caractéristiques topographiques repé-rables dans le paysage (à ce titre, les relevés LIDAR sont une source d’information irremplaçable) et des éléments de datation disponibles. Ce dernier point a été et est encore souvent négligé : il ne suffit pas qu’une voie relie deux sites antiques pour qu’elle leur soit contemporaine. Surtout, l’activité forestière importante qu’ont connu les forêts du Morvan à l’époque moderne et contemporaine (exploitation de bois de chauffage acheminé à Paris par flottage, charbonnage…) a oblitéré beaucoup de voies anciennes et en a créé beaucoup d’autres qui peuvent parfois paraître anciennes à première vue. La datation précise de chaque itinéraire sur la base des objets qui y ont été perdus est au cœur de notre démarche. Des collègues suisses ont obtenu des résultats significatifs dans un grand projet couvrant l’espace alpin (Schneider 2003), à partir d’objets prélevés au détecteur à métaux dans des zones test. Dans des conditions de conservation optimales, la totalité de la plage d’utilisation de la voie peut être détectée de cette façon par des prospections limitées. C’est notamment le cas là où le sol rocheux a ralenti l’érosion et le colluvionnement. Dans les zones de moyenne montagne comme le Morvan, la mise en œuvre de cette méthode présente plus de difficultés. L’érosion a pu conduire à la formation de chemins creux de plu-sieurs mètres de profondeur, conduisant à la disparition des surfaces de circulation les plus anciennes, ce qu’ont bien montré nos résultats sur la voie issue des Grandes Portes, où ce n’est que sur les tronçons les moins pentus et donc les moins érodés que nous avons pu collecter des objets antiques. La mécanisation de l’exploitation forestière et, avec elle, l’utilisation d’engins de plus en plus larges et lourds, conduit également au recalibrage des chemins et à la destruction des vestiges de leur occu-pation ancienne. Par ailleurs, les surfaces de roulement des chemins abandonnés sont souvent occultées par une épaisse sédimentation qui masque les objets enfouis en relation avec leur période d’activité. En conséquence, la recherche des cheminements les plus anciens ne peut réussir que dans les zones en faible pente, ou l’érosion comme le colluvionnement n’ont qu’un impact limité. Dans l’avenir, il semble plus efficace de se concentrer dans de telles zones. Le fait que le relevé LIDAR ne couvre pas l’ensemble du Mont Beuvray est également pénalisant, car il est beaucoup plus difficile de repérer les voies désaffectées en dehors de la zone mesurée.
32
BiBracte
Centre archéologique européen
Rapport intermédiaire 2013 du programme quadriennal de recherche 2013-2016 sur le Mont Beuvray
2
1
Remparts de l’oppidum
Zone d’intervention 2014
Voie ancienne
0 250 500 m
728000
728000 728500
729000
729000 729500
730000
730000 730500
731000
731000
2150
00
2150
00
2160
00
2160
00
2170
00
2170
00
2180
00
2180
00
0 20 40 m
Voie
Bâtiment
9. Bibracte, Mont Beuvray. Reconnaissance des voies d’accès à l’oppidum. Zones d’intervention proposées pour 2014 : 1- col de l’Échenault, 2- colline à l’est du musée (fond Scan 25 ® © IGN) et vue d’une agglomération routière d’époque romaine repérée par photographie aérienne (Bd Ortho ® © IGN).
33
rapport intermédiaire 2013 du programme quadriennal de recherche 2013-2016 sur le mont Beuvray
2 - travaux de terrain sur l’oppidum – action 1.1 : reconnaissance des voies d’accès à l’oppidum
reconnaissance des voies d’accès à l’oppidum (intevention 778)
BIBRACTE Centre archéologique européen
• Colline à l’est du musée. Il s’agit ici de mieux caractériser l’occupation d’un espace privilé-gié en avant d’un des accès principaux à l’oppi-dum : tracé exact et datation des voies anciennes qui convergent vers le col du Rebout, limites de la nécropole de la Croix du Rebout, validation de l’hypothèse d’existence d’un cantonnement romain (telle que proposée par Flouest 2008, p. 137-139). Compte tenu de la couverture forestière de la zone, la prospection d’un transect d’environ 50 x 500 m au détecteur à métaux nous semble être l’approche la plus appropriée.
d’abord le lieu où se croisent de nombreuses voies anciennes importantes (dont certaines, for-tement encaissées, sont d’ailleurs à l’origine du toponyme). On présume également la présence d’un espace funéraire en ce lieu privilégié. On a enfin pu repérer par photographie aérienne le plan précis d’une petite agglomération routière d’époque romaine qui se développe à environ 500 m à l’est du col (Nouvel 2012, exploitant une mission photographique de l’IGN datée de juil-let 2011). Compte tenu du terrain dégagé (pâtures et terres cultivées), nous privilégierons la pros-pection géomagnétique (magnétomètre Ferex de marque Foerster à cinq capteurs et magnétomètre au césium). La zone d’étude s’inscrit dans un rec-tangle d’environ 550 x 1250 m.
BiBliographie
flouest 2008 : FLOuEST (J.-L.). — Indices d’une occupation militaire romaine sur la nécropole de la Croix du Rebout. In : Poux 2008, p. 137-139.
Haupt 2012 : hAuPT (P.), BRAun (A.), KLEnnER (I.). — Prospection des voies d’accès à l’oppidum. In : Rapport annuel 2012, p. 307-319.
Niaux 1994 : nIAux (R.). — histoire et nature de l’Autunois : Rapport d’activité 1994. In : Rapport annuel 1994, p. 181-204.
Nouvel 2012 : nOuvEL (P.). — Mise en évidence des occupations humaines anciennes aux alentours de Bibracte. In : Rapport annuel 2012, p. 409-414.
Poux 2008 : POux (M.) dir. — Sur les traces de César. Militaria tardo-républicains en contexte gaulois. Actes de la table ronde du 17 octobre 2002 (Glux-en-Glenne – F. 58). Glux-en-Glenne : Bibracte, 2008, 462 p., 248 ill. (Bibracte ; 14).
Rapport annuel 1994 : Rapport scientifique intermédiaire : activités 1994, prévisions 1995. Glux-en-Glenne : Centre archéologique européen du Mont Beuvray, 1994, 301 p.
Rapport annuel 2012 : BIBRACTE, programme de recherches sur le Mont Beuvray. Rapport annuel 2012. Glux-en-Glenne : BIBRACTE, 2012, publication numérique : http ://www.bibracte.fr, mot-clé rapport 2012.
Schneider 2003 : SChnEIDER (G.). — untersuchungen zum römischen Strassennetz in der Schweiz Geleisestrassen. Bonner Jahrbücher, 202/203 , 2002/2003 (2006), p. 267-334.
v