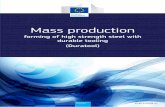La libéralisation des échanges est-elle une chance pour le développement durable
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of La libéralisation des échanges est-elle une chance pour le développement durable
Michel DamianBasudeb ChaudhuriPierre Berthaud
La libéralisation des échanges est-elle une chance pour ledéveloppement durable ?In: Tiers-Monde. 1997, tome 38 n°150. Vues du Sud (Le 150e numéro de la Revue Tiers Monde) pp. 427-446.
Citer ce document / Cite this document :
Damian Michel, Chaudhuri Basudeb, Berthaud Pierre. La libéralisation des échanges est-elle une chance pour ledéveloppement durable ?. In: Tiers-Monde. 1997, tome 38 n°150. Vues du Sud (Le 150e numéro de la Revue Tiers Monde) pp.427-446.
doi : 10.3406/tiers.1997.5183
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/tiers_1293-8882_1997_num_38_150_5183
LA LIBÉRALISATION DES ÉCHANGES
EST-ELLE UNE CHANCE
POUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE?
par Michel Damian*, Basudeb Chaudhuri** et Pierre Berthaud***
Après huit années de négociations officielles, l'Acte final du Cycle d'Uruguay a été signé à Marrakech, le 14 avril 1994, par 119 pays. La fin du Cycle d'Uruguay marque le passage du gatt à Гомс (Organisation mondiale du commerce), et ouvre une succession de dossiers de travail et de négociations [Messerlin, 1995]. Parmi les priorités du programme de l'après-Marrakech figure, sans ambiguïté, l'étude des relations entre commerce et environnement. Cette priorité est ainsi formulée: «Les Ministres [...] décident: de charger le Conseil général de Гомс [...] d'établir un Comité du commerce et de l'environnement ouvert à tous les membres de Гомс [...] en vue d'identifier les relations entre les mesures commerciales et les mesures environnementales de manière à promouvoir le développement durable» [gatt, 1994 b, p. 494]1.
* Chercheur à l'IEPE, maître de Conférences à l'Université Pierre Mendès-France, Grenoble. ♦* Chercheur au CREME, maître de Conférences à l'Université de Caen. **♦ Chercheur au GRREC et à l'IEPE, maître de Conférences à l'Université Pierre Mendès-France,
Grenoble. 1. Les premiers conflits liés à l'environnement sont en cours d'examen. L'OMC, qui devrait être le lieu
où les disciplines consenties seront appliquées, abrite une nouvelle institution visant au règlement des différends : l'ORD (Organisation de règlement des différends). En cas de conflit, l'ORD établit un « panel » (ou « groupe spécial », composé de trois personnes) chargé de rendre la décision. A la suite d'une plainte du Venezuela contre les États-Unis - les nouvelles normes américaines de protection de l'environnement applicables à l'essence établissant, selon le Venezuela, une discrimination contre les importations d'essence vénézuélienne -, l'ORD a mis en place, en avril 1995, un « groupe spécial » chargé d'examiner cette plainte. Il s'agissait du premier « groupe spécial » établi dans le cadre du nouveau mécanisme de règlement des différends de l'OMC. La plainte du Brésil, dont les exportations d'essence vers les États-Unis sont tombées de 8 millions de dollars à zéro pendant les deux premiers mois de 1995, toujours du fait des nouvelles normes
Revue Tiers Monde, t. XXXVIII, n° 150, avril-juin 1997
428 Michel Damian, Basudeb Chaudhuri et Pierre Berthaud
Le texte fondateur du GATT {Texte de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, signé en 1948) contenait déjà des dispositions permettant de mettre des barrières aux échanges lorsqu'un État (une partie contractante) souhaite sauvegarder certaines valeurs liées à la préservation des ressources naturelles et de la vie. Ce n'est cependant qu'à partir du début de la décennie 1970, lors de la préparation de la Conférence mondiale sur l'environnement, tenue à Stockholm en juin 1972, que le GATT prendra plus ou moins explicitement en compte la question environnementale, tout d'abord en créant en 1971 un Groupe de travail sur le commerce et l'environnement. Du GATT à Гомс, l'étude des relations entre ces deux termes remonte donc à un peu plus de deux décennies.
Les préoccupations initiales du gatt concernaient la question de l'environnement comme obstacle au commerce, ainsi que celle du risque de migration des industries polluantes [gatt, 1991]. Du fait de la récession des économies du Nord et de la structure très conflictuelle du commerce international, ces questions - maintenant du ressort de Гомс - sont de plus en plus présentes dans les débats relatifs au protectionnisme et aux barrières non tarifaires. Ces questions originelles ont cependant été récemment englobées dans un agenda plus vaste, celui de la protection de l'environnement et de la promotion du développement durable par le commerce international et la libéralisation des échanges.
L'objectif de ce texte est de présenter et discuter la thèse de la promotion du développement durable par le commerce1. Cette thèse a tout
de l'Agence pour la protection de l'environnement des États-Unis, a été également examinée par le « groupe spécial » établi à la demande du Venezuela. Fin 1995, le Groupe spécial de ГОМС a tranché en faveur du Venezuela et du Brésil (la réglementation américaine établissant une discrimination entre les normes applicables aux produits nationaux et aux produits importés). Les États-Unis ont alors refusé ces conclusions et ont saisi l'Organe d'appel de l'OMC (composé de trois membres). En mai 1996, l'instance d'appel de l'OMC a condamné les États-Unis pour l'adoption de normes plus exigeantes pour l'essence importée - notamment en ce qui concerne la teneur en métaux lourds - que pour celle produite aux États-Unis. En juin 1996, les États-Unis ont accepté de modifier leur législation.
1. Nous ne traitons donc pas ici des débats en cours sur la réglementation et l'organisation, sur la définition des règles du jeu en matière de commerce international et d'environnement. Pour l'essentiel, trois positions sont en présence. Un premier courant (des économistes mainstream mais aussi des ONG du Sud) refuse la définition de normes environnementales supranationales imposées au nom des valeurs des pays développés, et plaide donc pour que l'environnement ne soit pas utilisé comme un argument protectionniste [Bhagwati, 1993 ; Srinivasan et Bhagwati, 1995]. Un second courant (certains économistes mainstream plus ou moins hétérodoxes et/ou réceptifs aux questions environnementales) soutient qu'il n'y a pas vraiment incompatibilité entre libre-échange et développement durable, mais à la condition de réglementer certains domaines des échanges [Markandya, 1994] (le développement durable est cependant réduit chez cet auteur à la préservation de l'environnement sur le long terme, la question de la solidarité et de l'équité intragénéra- tionnelle est absente). Un troisième courant (les ecological economists) soutient qu'il y a une incompatibilité radicale entre libre-échange et développement durable, et mène donc une critique forte de la globalisation et du commerce déréglementé. Ce courant - proche des positions et revendications des ONG du Nord - milite pour une limitation et une réglementation stricte des échanges, pour un retour aux « communautés nationales », et pour l'intégration des coûts environnementaux et sociaux dans les prix internationaux [Daly, 1992 *, 1994, 1995 ; Daly et Goodland, 1994 ; Ekins, Folke et Costanza, 1994 ; Ekins, 1995 a ; Costanza et al., 1995].
La libéralisation des échanges 429
d'abord été formulée par le gatt. Elle a ensuite été reprise et adoptée à la Conférence mondiale sur l'environnement et le développement, tenue à Rio en juin 1992. Elle est aujourd'hui le cadre de référence des grandes organisations internationales, dont en particulier Гомс. Nous mettons tout d'abord en perspective ce nouvel agenda. Nous menons ensuite une étude critique de l'enchaînement « libéralisation du commerce - augmentation du revenu mondial - protection de l'environnement - développement durable ».
I - L'AGENDA DU DÉVELOPPEMENT DURABLE PAR LE COMMERCE : UNE MISE EN PERSPECTIVE
La littérature sur le commerce international et l'environnement, sur l'environnement et le développement, et sur la pollution et la croissance, remonte à la décennie 19701. En 1987, la publication par la Commission mondiale sur l'environnement et le développement (cmed) du rapport Notre avenir à tous, dit « Rapport Brundtland », a relancé ces différents thèmes, cette fois sur la scène publique et au plan international2. Cette publication a tout d'abord construit et popularisé le vocable de « développement durable » ou « soutenable ». Nous nous en tenons volontairement dans ce texte à la définition liminaire du rapport de la cmed : « La défense de l'environnement est [...] inhérente à l'idée de développement soutenable» [cmed, 1988, p. 47], « Le développement soutenable est un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs [...]. Même au sens le plus étroit du terme, le développement soutenable présuppose un souci d'équité sociale entre les générations, souci qui doit s'étendre, en toute logique, à l'intérieur d'une même génération» [cmed, 1988, p. 51, c'est nous qui soulignons]. Le Rapport Brundtland attirait aussi l'attention - un thème qui parcourt tout le texte de la cmed - sur les relations entre le niveau de revenu et la protection de l'environnement: «La diminution de la pauvreté est, par elle-même, une condition préalable
1 . Sur une bibliographie des travaux néo-classiques pour cette période, voir Selden et Song [1995, p. 163]. Sur les positions des pays en développement, voir la Déclaration de Cocoyoc, en octobre 1974 [PNUE, 1974]. Sur l'environnement et le développement - et plus précisément sur les « stratégies d'écodéve- loppement » -, voir les différents travaux de I. Sachs depuis la Conférence de Stockholm, dont [Sachs, 1974, 1980]. Le PNUE (Programme des Nations Unies pour l'environnement) s'était initialement référé à l'écodéveloppement, mais il cessa bientôt d'utiliser ce terme sous la pression américaine : le contenu donné à Fécodéveloppement par ses promoteurs était trop radical, le vocable de « développement durable » est, lui, plus consensuel [Godard, 1994, p. 311, n. 4].
2. Fin 1990, le Rapport Brundtland avait déjà été publié en 25 langues (la seule édition en français est québécoise), et 147 Working Partners (dont la Banque mondiale, qui a créé un Département Environnement en 1987) étaient alors associés, de par le monde, au Centre for Our Common Future de Genève.
430 Michel Damian, Basudeb Chaudhuri et Pierre Berthaud
d'un développement respectueux de l'environnement» [cmed, 1988, p. 82, c'est nous qui soulignons]1. Le Rapport Brundtland interpellait enfin les organisations intergouvemementales sur la question de l'étude des relations entre le commerce international et l'environnement : « Ces questions [les liens qui existent entre le commerce et l'environnement] n'ont pas été examinées par des organisations intergouvemementales. Les mandats de ces organisations - et surtout ceux du gatt et de la cnuced - devraient inclure la recherche d'un développement soute- nable. Leurs activités devraient refléter une préoccupation au sujet des impacts des structures commerciales sur l'environnement et de la nécessité de disposer d'instruments plus efficaces pour intégrer des considérations relatives à l'environnement et au développement dans les arrangements commerciaux internationaux» [cmed, 1988, p. 101]. Ce nouvel ordre du jour du commerce et de l'environnement - mais aussi de la croissance, du développement et de l'environnement -, avant d'être celui de Гомс, va progressivement devenir celui du GATT, puis de la Conférence de Rio.
Début 1992, le bulletin du gatt offrait une première version de la thèse de la protection de l'environnement par le commerce : « La croissance du commerce mondial entraîne une augmentation du revenu par habitant, qui, à son tour, offre aux pays la faculté de consacrer une part croissante du budget national à l'environnement et les incite à le faire » [gatt Focus, n° 88, mars 1992, p. 1]. Cette thèse était une des idées- forces de l'étude Le Commerce international 90-91, élaborée par le secrétariat du gatt, et publiée en avril 1992. Dans cette même étude, le GATT présentait une première version des travaux de 1991 de Grossman et Krueger [1993] sur les relations entre revenu et pollution: «A priori, croissance économique ne signifie pas nécessairement aggravation de la pollution [...] dans de nombreux cas, la croissance du revenu par habitant s'est accompagnée d'une réduction de la pollution» [gatt, 1992, p. 32]. La contribution issue des différents organismes des Nations Unies sur ces thèmes allait constituer quelques mois plus tard, en
1 . Thème déjà lancinant à la Conférence de Stockholm, en 1972, où le discours ďlndira Gandhi, premier ministre de l'Inde, témoignait particulièrement du clivage entre les pays développés et les autres : « La misère et le besoin ne sont-ils pas les plus grands polluants? [...] Comment parler à ceux qui vivent dans des villages et dans des taudis de la nécessité de ne pas polluer les mers, les fleuves et l'atmosphère, alors que leur propre existence est contaminée à la source? On ne peut pas améliorer l'environnement là ou règne la misère. Et l'on ne peut pas éliminer la misère sans le concours de la science et de la technique » [Nations Unies, 1972, p. 18]. Quant à R. McNamara, alors président du groupe de la Banque mondiale, il avait en 1972 bien mal compris le problème : « Si les pays pauvres se trouvent aux prises avec le problème consistant à concilier les impératifs de la croissance avec ceux de l'écologie, ce problème est bien plus grave dans le cas des pays riches [...] un siècle d'expansion économique rapide a progressivement fait naître une menace monstrueuse pour la qualité de la vie dans les pays développés [...] les pays du tiers monde peuvent à moindre frais et beaucoup plus facilement, incorporer à leur infrastructure industrielle les mesures préventives pratiques qui permettent d'éviter la dégradation de l'environnement » [McNamara, 1972, p. 3 et 10].
La libéralisation des échanges 431
juin 1992 à Rio, la pierre d'angle de Y Agenda pour le XXIe siècle. Pourquoi «pierre d'angle»! Parce que cette thèse de la protection de l'environnement et du développement durable par le commerce constitue le réfèrent théorique de Y Agenda 21, le réfèrent qui tient et surdétermine tout l'édifice (plus de 800 pages), et duquel devraient découler les différentes politiques à mettre en œuvre pour le siècle prochain.
La Conférence de Rio va ainsi remettre à l'honneur la vieille théorie du trade as engine of growth, successivement baptisée «développement extraverti» (outward-looking development), ou encore «croissance entraînée par l'exportation» (export-led growth). La formulation nouvelle est celle de la promotion de l'environnement et du développement durable par le commerce international et la libéralisation des échanges. Cette thèse est explicitement formulée dès les premières pages de Y Agenda 21, adopté par l'ensemble des États représentés à Rio (il s'agit du premier « Domaines de programme » de Y Agenda 21 : « Promouvoir le développement durable par le commerce» [Nations Unies, 1992, p. 8]). Le «Principe d'action 2.5 » fait référence à la nécessité d'un commerce ouvert et au caractère bénéfique des principes de l'avantage comparatif. Le «Principe d'action 2. 19 » fonde l'enchaînement qui va de la libéralisation des échanges au développement durable. Il constitue donc l'argumentation centrale de la thèse : « Les politiques commerciales et les politiques de l'environnement devraient s'étayer mutuellement. Un système d'échanges multilatéral, à caractère ouvert, permet d'allouer et utiliser plus efficacement les ressources, contribuant ainsi à accroître la production et les recettes et à alléger la pesée exercée sur l'environnement ; il permet donc de dégager les ressources supplémentaires nécessaires pour assurer la croissance économique et le développement et pour mieux protéger l'environnement. A son tour, un environnement sain génère les richesses écologiques et autres nécessaires à une croissance durable et à un développement soutenu des échanges. Un système d'échanges comme celui qui est préconisé ici aurait des incidences positives sur l'environnement et contribuerait à un développement durable» [Nations Unies, 1992, p. 13-14]. L'enchaînement «libéralisation du commerce - augmentation du revenu -protection de l'environnement -
développement durable » est ici tout à fait explicite. Il y aurait donc comme un «cercle vertueux» (un spiraling positive feed-back loop, écrivent Daly et Goodeland [1994, p. 74]).
Nous nommons cet enchaînement «carré naïf du développement durable par le libre-échange» (voir fig. 1). Nous nous proposons de mener une étude critique de cet enchaînement. Plus précisément, nous discutons et interrogeons les quatre angles du «carré naïf». «Naïf», parce que nous tenterons de montrer l'idéalisme et la faiblesse mais
432 Michel Damian, Basudeb Chaudhuri et Pierre Berthaud
aussi le caractère dangereux de l'enchaînement proposé. Nous traiterons successivement de la libéralisation des échanges dans le cadre du cycle d'Uruguay, de l'augmentation de la production et des revenus, du statut théorique de la liaison «libéralisation des échanges - augmentation du revenu mondial» et enfin de la protection de l'environnement et du développement durable.
II - QUESTIONS SUR LA LIBÉRALISATION DES ÉCHANGES DANS LE CADRE DU CYCLE D'URUGUAY
Depuis la signature de l'Acte final de Marrakech, 120 États se sont engagés à libéraliser progressivement leurs échanges (pour les produits industriels, abaissement par les pays développés de 40 % de leurs droits de douane ; pour les produits agricoles, réduction des tarifs douaniers, réduction de 36% des subventions à l'exportation et engagements en matière d'accès minimal aux marchés).
Le premier problème avéré concerne la libéralisation des échanges de produits agricoles. En matière agricole, les négociations d'Uruguay prévoient le remplacement des obstacles non tarifaires par des droits de douane. Dans les faits, les pays de l'OCDE ont retenu la période de référence 1986-1988 pour transformer les obstacles non tarifaires en équivalents tarifaires. Or, il s'agit d'une période ou le niveau de soutien interne était élevé dans les pays développés. Il en est nécessairement résulté que les pays développés ont établi de nouveaux droits de douane de base qui aboutissent à un niveau de protection encore plus élevé que celui des obstacles non tarifaires qu'ils ont remplacés. L'objectif du Cycle d'Uruguay risque évidemment de ne pas être atteint, sauf à conclure de nouveaux accords pour des réductions réelles et substantielles du protectionnisme agricole [Ingco, 1995].
De manière plus générale, il est déjà évident que la libéralisation n'aura pas lieu comme escomptée et ne se déroulera pas en terrain pacifié. Les années 1980 ont été marquées par une montée progressive des conflits commerciaux. Ces conflits ont principalement concerné les conditions d'exportation des automobiles et des produits d'électronique grand public japonais en Europe et aux États-Unis, les pratiques des constructeurs japonais de semi-conducteurs, et les subventions indues dont bénéficiaient - selon les autorités américaines - les fabricants aéronautiques et les agriculteurs européens. Au total, plus de 2 000 plaintes ont été déposées auprès du GATT au cours de la dernière décennie [Hatem, 1995, p. 81]. Dans ce contexte très conflictuel, on sait que la lit-
La libéralisation des échanges 433
Lihre-échange (Cycle d'Uruguay!
- Engagements de la plupart des participants (55 Etais) au 15 avril 1994: • Les pays développés abaissent leurs droits de douane sur les produits industriels de 40%. • Pour les produits agricoles, réduction de 36% des subventions à l'exportation et engagements en matière d'accès minimal aux marchés. • Engagements des pays les moins avancés seront présentés en 1995.
ï
Effet cumulatif (le "carré" s'auto-entretient) 'Croissance durable" (confondue avec "développement durable" ou "sou tenable"! - Hypothèse explicite : Equité tniergénérationnelle (solidarité avec les générations futures) comme résultat endogénéisé par le taux d'investissement en capital et le progrès technique (substitution capital naturel/capital artificiel toujours possible). - Hypothèse implicite : L'équité intragénérationnellc (solidarité au sein d'une même génération) ne peut résulter que du ruissellement de la croissance et de la richesse des pays développés vers ceux qui sont "moins avancés".
Augmentation de la production et des revenus
• Augmentation du volume du commerce mondial des marchandises de 9 à 24% dici 200S. - L'augmentation des exportations et des importations des économies en développement et en transition sera en 2005 supérieure de 50% à l'augmentation moyenne pour l'ensemble du monde. - Augmentation du revenu mondial de 109 à 5 10 milliards de dollars en 2005 (selon le С ATT, le second chiffre représente l'estimation la "plos plausible").
1
Effet positif Protection de l'environnement r - Hypothèse explicite : La libéralisation du commerce permet f augmentation du revenu mondial et donc la protection de l'environnement. • Hypothèse implicite : La protection de l'environnement ne peut résulter que ďune augmentation des revenus (hypothèse ďune "courbe environnementale de Kuznets" : la réduction des prélèvements et des rejets est positivement liée à l'augmentation du revenu par tête).
Fig. 1. — Le carré naïf du développement durable par le libre-échange. La thèse Conférence de Río-gatt-omc
térature théorique des armées 1980 a tenté de démontrer que les politiques commerciales dites stratégiques peuvent apporter des gains par rapport au libre-échange, lorsqu'il existe des marchés imparfaits et/ou des économies d'échelle. Ces travaux ont accompagné une intensification du protectionnisme non tarifaire, en particulier de la part des États-Unis (sur une analyse et une critique très argumentées du protectionnisme des États-Unis, avec les «Super 301» et «Special 301» de
434 Michel Damian, Basudeb Chaudhuri et Pierre Berthaud
l'us Trade Act de 1988, voir Dhar [1992]). L'histoire récente montre en fait que «Les obstacles non tarifaires se sont renforcés dans les années 1980 et restent aujourd'hui très importants, même si les accords clôturant l'Uruguay Round en suppriment certains. Si le discours est toujours aussi libre-échangiste, la politique commerciale demeure bien présente dans les faits» [Guillochon, 1994, p. 486] (également Javelot et Siroën [1994]). Rien ne permet alors d'affirmer que les résultats de l'Uruguay Round suffiront à contrecarrer cette évolution1. Le protectionnisme ne disparaîtra pas: il s'exprimera, notamment, par des normes sanitaires ou une utilisation détournée des normes environnementales [Fontagné et al, 1995]2.
Dans ce contexte, qui semble être durable, est-il bien réaliste d'escompter que la libéralisation générera une augmentation de la production, du commerce et du revenu mondial, telle que celle projetée par le GATT?
III - QUESTIONS SUR L'AUGMENTATION DE LA PRODUCTION, DU COMMERCE ET DU REVENU MONDIAL
La version grand public des résultats escomptés de la libéralisation, telle qu'elle est présentée par le gatt dans son bulletin d'information, ne s'embarrasse guère de précautions : « Le revenu mondial aura augmenté de 500 milliards de dollars en 2005 grâce à l'ouverture des marchés qui résultera du Cycle d'Uruguay» [gatt Focus, n° 111, octobre 1994, p. 1]. Ce chiffre, arrondi, est la fourchette haute d'estimations fondées sur un modèle d'équilibre général de l'économie mondiale, modèle élaboré et appliqué par le secrétariat du gatt [19946] (voir tableau 1). La production mondiale et le volume du commerce mondial vont augmenter (le volume du commerce mondial des marchandises augmenterait de 9 à 24 % d'ici 2005) de même que le revenu mondial.
1 . Le nombre de litiges (soumis, selon les dispositions de l'OMC, à des procédures de « consultations », puis de « conciliation », et enfin de « règlements des différends ») semble même aller croissant. Après à peine neuf mois d'existence de l'OMC, une vingtaine d'affaires avaient déjà été portées devant l'Organe de règlement des différends, « soit beaucoup plus qu'en une seule des quarante-sept années d'existence du GATT » [OMC Focus, n° 6, octobre-novembre 1995, p. 10].
2. Depuis le Tokyo Round, sous certaines conditions, chaque État à la possibilité d'édicter des règlements techniques ou normes qui doivent être notifiés auprès du GATT. Ces obstacles techniques au commerce (les Technical Barriers to Trade) concernent, entre autres, la protection de l'environnement. Sur la période 1980 -juillet 1994, le GATT a recensé 349 notifications d'obstacles techniques au commerce concernant l'environnement, soit 8,4% du total des notifications d'obstacles techniques [GATT, 1994 a. tableau 1, p. 1]. Ces chiffres ne concernent que les notifications explicitement d'origine environnementale. Ils sous-esti- ment peut-être le contenu pour partie environnementale (protection de la santé ou de la sécurité des personnes, de la vie ou de la santé des animaux, et de la préservation des végétaux) de certaines notifications.
La libéralisation des échanges 435
Pour estimer l'augmentation du revenu mondial, le gatt développe trois versions de son modèle (dans le tableau 1 nous n'avons retenu que la « Version basse » et la « Version haute »). La fourchette obtenue pour l'augmentation du revenu mondial en 2005 - entre 109 et 510 milliards de dollars - est bien sûr fonction des hypothèses retenues : « L'énorme écart entre les chiffres montre à quel point les résultats dépendent de l'hypothèse sur laquelle est fondée la version» [GATT, 1994 b, p. 35]. Le chiffre haut - 510 milliards de dollars - est considéré comme étant le « plus plausible ». Une analyse fouillée des différentes évaluations réalisées jusqu'à fin 1995 conduit cependant à douter très fortement de la rigueur et de la pertinence de celles-ci : « Les effets estimés de l'Uruguay Round dépendent de la spécification du modèle utilisé (regroupements sectoriels et régionaux et les principales hypothèses de modélisation) [...] toutes les études réalisées à ce jour ont tendance à surestimer les effets réels que produira l'Uruguay Round» [Degbelo et Dembinski, 1995, p. 490 et 491].
Premier problème : les inégalités de répartition de cette augmentation du revenu mondial (voir tableau 1) ne peuvent-elles pas conduire à manquer la cible de la protection de l'environnement? En 2005, à l'échelle mondiale, 13% de la population (les 24 pays les plus développés) se partageraient entre 71% (version «estimation haute» dans le modèle du gatt) et 95% (version «estimation basse») de l'augmentation estimative du revenu mondial. Le reste du monde (87% de la population, près de 6 milliards d'habitants en 2005) se contenterait au mieux de 29% (version «estimation haute») et au pire de moins de 5% (version «estimation basse») de l'augmentation estimative du revenu mondial. La répartition par habitant va évidemment dans le même sens, celui d'une répartition fort inégalitaire. Dans Г «estimation haute» du gatt, l'augmentation estimative du revenu par habitant irait de quelque 14 $ pour chacun des 1,3 milliard de Chinois à près de 1 000 $ pour chacun des 34 millions d'habitants des sept pays de I'aele (Association européenne de libre-échange). Dans Г «estimation basse» du GATT, pour 4,5 milliards d'habitants (Économies en développement et en transition), la libéralisation entraînerait même une diminution du revenu par tête. Avec une telle répartition de l'augmentation estimative du revenu mondial en 2005, la thèse du développement durable par la promotion du commerce mérite - à tout le moins - d'être relativisée. Dit autrement, ce n'est certainement pas l'augmentation des revenus promise par la libéralisation des échanges qui permettra aux « moins riches » de devenir « plus verts ». Ou alors, quel est l'horizon de temps pour qu'ils deviennent et « plus riches » et « plus verts » ?
Illustration non autorisée à la diffusion
436 Michel Damian, Basudeb Chaudhuri et Pierre Berthaud
Tableau 1. — Libéralisation du commerce des marchandises (Cycle d'Uruguay) et augmentation estimative des revenus annuels en 2005
Monde Canada États-Unis AELE Union européenne Australie et
Nouvelle-Zélande Japon Économies en
développement et en transition
Chine Taipei chinois
Pays développés Reste du monde
(Économies en développement et en transition, Chine et Taipei chinois)
Augmentation estimative des revenus
(en milliards de dollars EU de 1990)
Estimation Estimation basse
109 2,3
30,4 10,1 47,7
1,5 11,9
-1,9 4,1 2,6
103,9
5,1
haute
510 12,4
122,4 33,5
163,5
5,8 26,7
116,1 18,7 10,2
364,3
145,7
Population en 2005 (en milliers d'habitants)
6 688 127 32 293
285 931 34 627
357 297
24 675 129 816
4 438 341 1 338 526
23 300
864 639
5 823 488
Augmentation estimative des revenus
par habitant (en dollars EU de 1990)
Estimation Estimation basse
16,3 71,2
106,3 291,7 133,5
60,8 91,6
-0,43 3,1
111,6
120,2
0,9
haute
76,2 383,9 428 967,5 457,6
235 205,7
26,2 13,9
437,8
421,3
25
Commentaires : Le découpage pays-groupes de pays, l'estimation basse et l'estimation haute sont repris de l'étude GATT [1994]. L'estimation basse est celle de la version 1 (rendements d'échelle constants, pas d'économie d'échelle, et concurrence parfaite) du modèle avec hypothèse statique (l'incidence des augmentations des revenus sur le niveau de l'épargne et de l'investissement est ignorée). L'estimation haute correspond à la version 3 (rendements d'échelle croissants et concurrence monopolistique dans divers secteurs) du modèle avec hypothèse dynamique (une part des gains en revenus est épargnée et placée dans de nouveaux investissements en capital).
Les deux dernières colonnes et le regroupement des deux lignes du bas ont été établis par nous.
Sources : Pour les trois premières colonnes : gatt, Résultats des négociations commerciales multilatérales du Cycle d'Uruguay, gatt, Genève, 1994, tableau II . 14, p. 40. Pour la quatrième colonne : United Nations, World Population Prospects, The 1992 Revision, United Nations, New York, 1993, table A. 2, p. 152-159 ; et Monthly Bulletin of Statistics of the Republic of China, octobre 1994, p. 3.
La libéralisation des échanges 437
II y a une autre interrogation, fondamentale du point de vue des relations entre commerce international et croissance, soulevée par Kit- son et Michie [1995]. Pour les pays développés, la recherche de la croissance tirée par le commerce international pourrait peut être engendrer le cercle vertueux « exportations - économies d'échelle - croissance et meilleure intégration internationale », avec donc plus d'exportations et plus de croissance. Par contre, des nations faibles, contraintes d'importer pour pouvoir exporter, et n'arrivant pas à utiliser le facteur économies d'échelle pour leur spécialisation internationale, peuvent tomber dans des déficits de balances de paiements, et avoir ensuite besoin de politiques déflationnistes entraînant une forte diminution de la croissance [Kitson et Michie, 1995, p. 5]. C'est un vrai risque pour la majorité des pays en développement.
En ce qui concerne les pays en développement les plus pauvres - les pays les moins avancés (pma) -, Shafaeddin [1994, p. 7] montre que «la libéralisation n'a pas marché ». Leur problème est celui de leur capacité d'offre, de l'absence de base industrielle. Or « les forces du marché n'ont qu'un pouvoir limité pour la mise en place de cette capacité » [Shafaeddin, 1994, p. 7]. En quoi la libéralisation des échanges pourrait-elle alors aider ces pays à mieux préserver leur environnement, si tant est que cela soit ou puisse devenir leur problème ?
IV - SUR LE STATUT THÉORIQUE DE LA LIAISON « LIBÉRALISATION DES ÉCHANGES - AUGMENTATION DE LA CROISSANCE ET DU REVENU MONDIAL »
Sur le plan théorique, l'interrogation principale concerne la relation de causalité entre les deux premiers angles du « carré naïf». L'argument essentiel de la thèse Conférence de Río-gatt-omc repose en effet sur la relation entre commerce international et croissance : la libéralisation des échanges permettrait d'accroître la production et les revenus - au bénéfice des pays en développement plus encore que des pays développés. Même la théorie la plus mainstream ne permet cependant pas de valider cet argument. Robert Lucas [1988] a montré que, dans le modèle néoclassique, l'abolition (ou la réduction) des barrières au libre-échange dans les pvd permet d'augmenter le niveau des revenus et explique peut-être la croissance sur une courte durée, mais la libéralisation des échanges ne peut, par elle-même, expliquer sur le long terme un processus de croissance importante et soutenue. Pourquoi cela? La réponse se trouve dans les théories de la croissance
438 Michel Damian, Basudeb Chaudhuri et Pierre Berthaud
endogène. Lucas [1988, 1990], Romer [1990], Grossman et Helpman [1991] et d'autres, en intégrant la technologie, l'innovation et sa diffusion, le rôle du capital humain, les économies d'échelle et le rôle des marchés imparfaits, ont montré que l'intégration de ces facteurs permet de passer d'une théorie statique de l'avantage comparatif à une théorie dynamique de l'avantage comparatif des nations. Ce sont surtout ces facteurs explicatifs de la croissance endogène - l'importance relative des différents facteurs variant selon les pays - qui permettent d'expliquer la croissance dans le long terme.
Notamment, la capacité des pvd à innover, à attirer les technologies et les investissements étrangers et à les adapter à leurs besoins, dépend fortement d'un seuil critique de stock de capital physique et de capital humain (qui incorporent un stock de connaissance). Le commerce extérieur en soi ne suffit pas à construire ce stock de connaissance, comme on peut le déduire des travaux de Lucas et Romer précédemment cités. Lucas [1990] s'interroge également sur les raisons pour lesquelles il n'y a pas d'exportation massive des capitaux des pays riches vers les pays pauvres, conformément à la théorie du commerce international. Il arrive à nouveau à la conclusion que le niveau de développement du capital humain est trop faible pour que ces investissements soient rentables pour les investisseurs potentiels.
Au total, les enseignements à la fois de la théorie et de l'histoire amènent à la conclusion qu'il n'y a pas de relation linéaire et simple entre ouverture internationale et croissance. L'ouverture internationale peut conduire à la croissance si en même temps les pays concernés arrivent à augmenter leurs stocks de capital physique et humain, à innover et à construire un avantage comparatif dynamique pour des industries et des secteurs. L'histoire récente de l'Asie (mais aussi de l'Europe et des États-Unis au XIXe siècle) montre que l'avantage comparatif (statique et dynamique) a toujours été construit avec des régimes de protection différenciée, et des interventions stratégiques de l'Etat en matière de spécialisation industrielle (en plus du développement des infrastructures et du capital humain). Bref, même les enseignements de la théorie la plus «moderne» ne permettent pas de présenter la conclusion de l'Uruguay Round comme une source de croissance et d'augmentation du revenu mondial.
La libéralisation des échanges 439
V - QUESTIONS SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
Dans la thèse Conférence de Rio-GATT-омс, le système politique et réglementaire ne semble guère pouvoir jouer un rôle dans la réduction de la pollution et la préservation de l'environnement. Seule, à terme, l'augmentation des revenus peut permettre de protéger l'environnement. Un détour est nécessaire pour revenir sur ce point.
Dans un beau texte, Kuznets [1955] posait la question suivante : est- ce que l'inégalité dans la distribution des revenus augmente ou diminue avec le processus de croissance économique d'un pays? Sans que la réponse soit très claire, Kuznets suggérait, avec beaucoup de précautions, que la croissance semble bien réduire les inégalités. Il y aurait donc une relation inverse entre les inégalités de répartition du revenu et le développement économique. Plus précisément, les inégalités de répartition du revenu (mesurées par, le coefficient de Gini) augmenteraient dans les premiers stades du développement économique, pour arriver à un maximum et décroître ensuite. Quelle que soit la séduction que peut représenter cette courbe en U inversé, celle-ci n'a rien d'automatique. Park et Brat [1995] montrent en effet que la courbe de Kuznets n'est que «conditionnelle» (a conditional Kuznets curve). Ils analysent, d'une part, l'évolution de l'inégalité parmi les nations, et, d'autre part, les effets des investissements en recherche-développement et connaissances en tant que source des changements en matière d'inégalité. L'inégalité est décomposée en inégalité inter-groupes (chaque groupe étant composé de pays ayant un niveau de développement comparable), inégalité intragroupe, et en distance ou écart entre groupes de nations (fondant une stratification des groupes). En utilisant les coefficients de Gini pour faire ces comparaisons, ils montrent que l'inégalité globale a augmenté sur la période 1960-1988. Ils montrent également que la mobilité des nations a augmenté, et que l'effort respectif des nations en recherche et développement et en capital humain a un effet significatif sur l'évolution des inégalités. Ainsi, il y a bien une courbe de Kuznets, mais «conditionnelle», c'est-à-dire conditionnée par l'investissement, et spécialement par l'investissement en capital humain.
Cette thèse de Kuznets sur les inégalités et la croissance a été depuis peu transposée aux relations entre protection de l'environnement et croissance, d'où l'expression de « courbe environnementale de Kuznets » (pour une présentation et une discussion synthétiques, voir Griffiths [1994]). Le travail séminal est ici celui de Grossman et Krue- ger, présenté en 1991 dans le cadre des recherches préparatoires à l'ALENA [Grossman et Krueger, 1993, 1995 et Grossman, 1995] (ces
440 Michel Damian, Basudeb Chaudhuri et Pierre Berthaud
auteurs n'utilisent cependant pas la formulation «courbe environnementale de Kuznets»). Pour différents polluants, et en particulier le dioxyde de souffre, Grossman et Krueger montrent que la pollution augmente avec la croissance du pib par habitant, jusqu'à atteindre un maximum (aux alentours de 5000 $ 1985 de pib par habitant pour le SO2), pour ensuite diminuer à mesure que le pib par habitant continue à croître. Le pib par tête du Mexique n'étant pas très éloigné de 5000 $, Grossman et Krueger en concluent que l'accord de libre-échange (I'alena) pourrait permettre de renforcer la croissance du Mexique, générant ainsi un «dividende environnemental» (Ie Mexique ayant alors la capacité d'intensifier ses efforts pour protéger l'environnement).
La littérature récente est conséquente sur ce thème (voir l'excellente présentation et discussion de Pearson [1995], également Beghin et al [1994] et Stern, Common et Barbier [1996]). La conclusion qui s'en dégage est moins optimiste et moins déterministe que celle de Grossman et Krueger. Courbe en J et courbe en U inversé semblent en fait complètement emboîtées [Selden et Song, 1995]. Les données disponibles sont fragiles, avec une forte sensibilité des résultats aux sources utilisées [Ekins, 19956]). Enfin, pour nombre d'efïluents et rejets (dont COj et déchets), les concentrations et quantités augmentent de manière monotone avec le développement économique. La « courbe environnementale de Kuznets » n'a donc rien d'obligé et d'automatique. De toute façon, la diminution de la pollution, liée apparemment à l'augmentation du pib (la partie droite de la courbe en U inversé), ne peut seulement s'expliquer par un effet revenu : l'inversion est essentiellement due à la réglementation, à l'effet de composition (reflétant dans ce cas une spécialisation dans des activités plus propres), et à l'emploi de nouvelles technologies. Pour que la «courbe environnementale de Kuznets» devienne une réalité, et donc pour protéger l'environnement, il faut évidemment des politiques, des politiques publiques.
Grossman et Krueger [1996] ont d'ailleurs reconnu que l'existence d'une telle courbe en U inversé n'a rien d'automatique et ne renseigne de toute façon pas sur les mécanismes par lesquels la croissance affecte l'environnement. Ils reconnaissent également que la croissance seule ne peut se substituer aux politiques environnementales1.
1 . Grossman et Krueger [1996] soutiennent en même temps que toute tentative pour contenir la croissance ira à rencontre de la résolution des problèmes environnementaux. Selon eux, les investissements internationaux qui amènent la croissance, et accessoirement les connaissances technologiques dans les PVD, permettront éventuellement à ces pays d'adopter des technologies propres et de développer des politiques environnementales. Ce rôle accordé à l'investissement international ne peut ici être discuté.
La libéralisation des échanges 441
VI - QUESTIONS SUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE
La libéralisation des échanges va induire une augmentation des revenus, qui permettra de protéger l'environnement, et finalement - bouclage de la thèse Conférence de Río-gatt-omc - de promouvoir le développement durable.
Premier problème, le vocable «développement durable» est ici confondu avec la notion de « croissance durable » de la théorie économique (efficience parétienne intertemporelle et justice intergénération- nelle, la substitution capital naturel / capital artificiel étant toujours possible, sous condition du progrès technique et d'un taux d'investissement en capital adéquat). L'équité intragénérationnelle (au moins la «moitié » de la définition du développement durable dans le Rapport Brundt- land) est ici largement en dehors du cadre d'analyse. Implicitement, l'équité intragénérationnelle ne peut alors résulter que du «ruissellement » de la croissance et de la richesse des pays développés vers ceux qui le sont moins, l'augmentation de la consommation et l'ouverture des marchés au nord devant à terme bénéficier au sud (pour une critique de cette thèse et l'argumentation d'une thèse alternative, voir Goodland et Daly [1993]).
Autre problème : le bouclage de la thèse Conférence de Río-gatt- omc sur la croissance durable semble faire accroire que les questions de préservation de l'environnement et de limite de la capacité de charge des écosystèmes ont reçu la considération qu'ils méritent. Peut- on cependant complètement ignorer la question de la finitude du spaceship earth, et la nécessité de limiter le throughput [Boulding, 1966], tout comme les contraintes posées par la loi d'entropie (N. Georgescu Roegen)? Si ces questions sont prises en considération, la «croissance durable» est une impossibilité, et les politiques qui se fondent sur ce concept sont irréalistes, voire dangereuses [Daly, 1992 о]. Les thèmes et assertions précédents restent certes très controversés. Mais peut-on se satisfaire de la tranquille assurance selon laquelle il n'y aurait guère de conflit entre croissance et progrès écologique? Et l'affichage de l'objectif de la croissance ( « durable » ) ne réduit-il pas la réalisation des objectifs environnementaux à un problème d'appréciation discrétionnaire, secondaire par rapport à la croissance? De toute façon, la généralisation du mode de vie des pays les plus riches - et donc le rattrapage par l'immense majorité des populations de niveaux de pib par tête permettant de vérifier la «courbe environnementale de Kuz- nets» - n'apparaît-elle pas de plus en plus comme une impossibilité définitive?
442 Michel Damian, Basudeb Chaudhuri et Pierre Berthaud
Peut-on enfin se satisfaire de l'optimisme de ce bouclage sur la croissance durable ? N'y aurait-il pas quelque coût conséquent pour atteindre celle-ci ? Dans sa déclaration à la Conférence de Rio, M. Camdessus, le Directeur général du Fonds monétaire international, apportait, à tout le moins, des réserves à cet optimisme. Il rappelait tout d'abord que « Développement et protection de l'environnement, c'est tout un ». Il poursuivait ainsi : « L'ampleur des investissements nécessaires pour relever ces défis planétaires est telle qu'on ne pourra y faire face simplement par l'amélioration des techniques actuelles de formation et de distribution de l'épargne. Il y faudra pour nous tous une refonte en profondeur de nos politiques économiques nationales. J'ai dit pour nous tous : pays industrialisés et pays en développement, créanciers ou débiteurs ; c'est d'un ajustement universel qu'il s'agit [...] il faudra que tous - les gouvernements comme les simples citoyens - acceptent de reconsidérer sérieusement leur style de vie. Voilà ce que j'entends par ajustement universel ! » [Camdessus, 1992, p. 202 et 203, c'est nous qui soulignons]. Sous cette dernière formulation, faudrait-il entendre plus crûment « austérité universelle » ? Et quelles seraient les conditions économiques et sociales de réalisation d'un tel ajustement ? Celui-ci pourrait-il être mis en œuvre sans que les couches les plus pauvres de la population des pays industrialisés soient protégées ? Pour les autres pays (en développement, les différents Tiers Monde et l'Est), selon quelles modalités cet ajustement pourrait-il satisfaire les besoins de la majorité, et pas seulement ceux de la minorité qui dispose du pouvoir d'achat ? Ce scénario de croissance durable avec « ajustement universel » est de l'ordre du possible, c'est peut-être même le plus plausible, mais manifestement avec des conditions de répartition fort inégali- taires. D'un autre côté, le développement durable et la stabilisation écologique (en opposition à la croissance durable), avec une restriction significative des flux d'énergie-matière, est certainement tout à fait impossible sans une meilleure répartition [Steppacher, 1995, p. 107]. Les différents blocages à surmonter ne ruinent-ils pas alors par avance l'objectif d'un « développement durable pour tous » ? Sans trop jouer sur les mots, le thème de la croissance durable ne semble bien tracer qu'une seule perspective ; celle d'un « développement (inégal) durable », dont on ne voit trop comment il pourrait, sinon assurer, du moins introduire, tant à une solidarité et équité intergénérationnelles qu'à une solidarité et équité intragénérationnelles.
Pour que le xxie siècle soit à peu près « soutenable », il faudra donc nécessairement - pour fonder l'action et conduire les différentes politiques à mettre en œuvre - se détourner de la thèse naïve et dangereuse du développement durable comme «dividende environnemental» de la promotion du commerce et de la libéralisation des échanges.
La libéralisation des échanges 443
RÉFÉRENCES
Beghin J., Roland-Holst D. et van der Mensbrugghe D. (1994), Étude de la relation entre commerce et environnement : dimensions globales, Revue économique de I'ocde (23), p. 187-216.
Bhagwati J. (1993), Trade and the Environment, The American Enterprise, mai- juin, p. 43-49.
Boulding К. Е. (1966), The Economies of the Coming Spaceship Earth, in H. Jarret (éd.), Environmental Quality in Growing Economy, Baltimore, The Johns Hopkins Press, p. 3-14.
Camdessus M. (1992), «Respect de l'environnement et croissance vont de pair», Déclaration du directeur du Fonds monétaire international, Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement, Rio de Janeiro, 8 juin 1992, Bulletin du fmi, 21 (13), 29 juin, p. 193 et 200-203.
cmed (Commission mondiale sur l'environnement et le développement, présidée par G. H. Brundtland) (1988), Our Common Future, 1987, trad. fr. Notre avenir à tous, Montréal, Éditions du Fleuve.
Costanza R., Audley J., Borden R., Ekins P., Folke C, Funtowicz S. O. et Ha- ris J. (1995), Sustainable Trade : A New Paradigm for World Welfare, Environment, 37 (5), juin, p. 19-20 et 39-44.
Daly H. E. (1992 a), II n'y a pas de croissance durable, Forum du développement, repris in Transversales Sciences Culture (13), janvier-février, p. 10-11.
— (1992 b), Free Trade, Sustainable Development and Growth : Some Serious Contradictions, Network'92, Supplement, The Centre For Our Common Future and the ifc, Geneva (14), février, 2 p. ; repris et adapté in Ecodecision, juin 1992, p. 10-11.
— (1994), Fostering environmentally sustainable development: Four parting suggestions for the World Bank, Ecological Economics, 10 (3), p. 183-187.
— (1995), An open letter : Advice for a would-be reformer, Ceres (156), novembre-décembre, p. 10-12.
Daly H. E. et Goodland R. (1994), An ecological-economic assessment of deregulation of international commerce under gatt, Ecological Economics, 9 (1), p. 73-92.
Degbelo J. et Dembinski P. H. (1995), Effets de l'Uruguay Round sur les pays en développement : Analyse des évaluations réalisées à ce jour, Aussenwirt- schaft, 500 (3), septembre, p. 463-499.
Dhar B. (1992), The Decline of Free Trade and us Trade Policy Today, Journal of World Trade, 26 (6), p. 133-154.
Ekins P., Folke C. et Costanza S. (1994), Trade, environment and development : The issues in perspective, Ecological Economies, 9 (1), p. 1-2.
444 Michel Damian, Basudeb Chaudhuri et Pierre Berthaud
Ekins P. (1995 a\ Harnessing Trade to Sustainable Development, Green College Centre, Oxford, mars, 32 p.
— (1995 b), The Kuznets Curve for the Environment and Economic Growth : Examining the Evidence, Department of Economics, Keele University, décembre, 30 p.
Fontagné L., Fouquin M. et Pisani-Ferry J. (1995), Trois défis pour Гомс, La lettre du серп (131), janvier, 4 p.
GATT (1971), Lutte contre la pollution industrielle et commerce international, Étude sur le commerce international n° 1, gatt, juillet, Genève.
— (1992), Le Commerce international 90-91, vol. I, secrétariat du gatt, Genève.
— (1994 a), Environmental Technical Regulations and Standards Notified under the Agreement on Technical Barriers to Trade, Preparatory Committee for the World Trade Organization, pc/scte/w/i, Secrétariat du gatt, 28 juillet, Genève, 10 p.
— (1994 b), Résultat des négociations commerciales multilatérales du Cycle d'Uruguay, Textes juridiques, secrétariat du gatt, novembre, Genève.
Godard O. (1994), Le développement durable : paysage intellectuel, Natures- Sciences-Sociétés, 2 (4), p. 309-322.
Goodland R. et Daly H. (1993), Why Northern income growth is not the solution to Southern poverty, Ecological Economics, 8 (2), p. 85-101.
Griffiths C. (1994), The Environmental Kuznets Curve : Examining Economic Growth and Environmental Degradation, Dissemination Notes, Environment Department, World Bank (9), octobre, 2 p.
Grossman G. M. (1995), Pollution and growth what do we know ?, in I. Goldin et L. A. Winters (éd.), The economics of sustainable development, oecd Development Centre et Centre for Economic Policy Research, Cambridge, Cambridge University Press, p. 19-46.
Grossman G. M. et Krueger A. B. (1993), Environmental Impacts of a North American Free Trade, in P. M. Garber (éd.), The Mexico- us Free Trade Agreement, Cambridge, Massachusetts, The mit Press, p. 13-56.
— (1995), Economic Growth and the Environment, The Quarterly Journal of Economics, 110, p. 353-378.
— (1996), The inverted-U : What does it mean ?, Environment and Development Economics, vol. 1 (1), février.
Grossman G. M. et Helpman E. (1991), Innovation and Growth in the Global Economy, Cambridge, Massachusetts, The mit Press.
Guillochon B. (1994), Coopération et protection. Nouveaux enjeux, nouvelles approches, Revue économique, (3), mai, p. 475-486.
Hatem F. (1995), Quel cadre juridique pour l'activité des firmes multinationales ?, Économie internationale, (63), 3e trimestre, p. 71-98.
Ingco M. D. (1995), Agricultural Trade Liberalization in the Uruguay Round: One Step Forward, One step Back ?, Supplementary Paper for the Conference on the Uruguay Round and the Developing Countries, 26-27 janvier 1995, World Bank, Washington dc, 54 p.
La libéralisation des échanges 445
Javelot S. et Siroën J.-M. (1994), Les nouveaux instruments de politique commerciale, Revue économique, (3), mai, p. 487-500.
Kitson M. et Michie J. (1995), Trade and Growth : A Historical Perspective, in J. Michie et J. Grieve Smith (éd.), Managing the Global Economy, Oxford, Oxford University Press, p. 3-36.
Kuznets S. (1955), Economie Growth and Income Inequality, American Economie Review, 49, mars, p. 1-28.
Lucas R. Jr. (1988), On the mechanics of economic devlopment, Journal of Monetary Economics, 22, p. 3-42.
Lucas R. Jr. (1990), Why doesn't capital flow from rich to poor countries ?, AEA Papers and Proceedings, 80 (2), p. 92-96.
Markandya A. (1994), Is Free Trade Compatible with Sustainable Development ?, unctad Review, p. 9-22.
McNamara R. S. (président du groupe de la Banque mondiale) (1972), Discours prononcé devant la Conférence des Nations Unies sur l'environnement, Stockholm, 8 juin 1972, bird, Washington, 12 p.
Messerlin P. (1995), La nouvelle organisation mondiale du commerce, Paris, Dunod.
Nations Unies (1972), Conférence des Nations Unies sur l'environnement, Stockholm, 5-16 juin 1972, Déclaration, plan d'action, recommandations, résolutions, Centre de l'information économique et sociale à l'Office européen des Nations Unies, Genève, 24 p.
— (1992), Projets. Agenda 21, New York, Nations Unies. Park W. G. et Brat D. A. (1995), A Global Kuznets Curve ?, Kyklos, 48 (1),
p. 105-131. Pearson P. J. G. (1995), Energy Externalities and Environmental Quality : Will
Development Cure the Ills It Creates ?, Energy Studies Review, 6 (3), p. 199- 215.
Romer P. M. (1990), Endogenous Technological Change, Journal of Political Economy, 98 (5), p. S71-S102.
Sachs I. (1974), Environnement et styles de développement, Annales-Économies, Sociétés, Civilisations, (3), mai-juin, p. 553-570.
— (1980), Stratégies de VEcodéveloppement, Paris, Éd. Économie et humanisme et Les Éditions ouvrières.
Selden T. M. et Song D. (1995), Neoclassical Growth, the J Curve for Abatement and the Inverted U Curve for Pollution, Journal of Environmental Economics and Management, 29 (2), p. 162-168.
Shafaeddin S. M. (1994), L'impact de la libéralisation du commerce sur la croissance des exportations et du pib des pays les moins avancés, résumé de l'étude publiée sous le même titre par la cnuced, Discussion Papers, n° 85, cnuced Bulletin (27-28), juillet-octobre, p. 7-8.
Srinivasan T. N. et Bhagwati J. (1995), Trade and Environment : Does Environmental Diversity Detract from the Case for Free Trade ?, Yale University, Economic Growth Center, Center Discussion Paper n° 721, janvier, 100 p.
446 Michel Damian, Basudeb Chaudhuri et Pierre Berthaud
Steppacher R. (1995), L'ingérence écologique et la globalisation de l'économie de marché, in F. Sabelli (dir.), Écologie contre nature. Développement et politiques d'ingérence, Nouveaux cahiers de l'iUED-Genève, Paris, puf, p. 99- 114.
Stern D.I., Common M. S. et Barbier E. B. (1996), Economie Growth and Environmental Degradation : The Environmental Kuznets Curve and Sustainable Development, World Development, 24 (7), p. 1151-1160.
unep (United Nations Environmental Programme) (1974), The Cocoyoc Declaration adopted by the participants in the unep/unctad Symposium on « Patterns of Resource Use, Environment and Development Strategies », Mexico, Cocoyoc, 8-12 octobre 1974, А/С. 2/292, 1er novembre, New York, 10 p.