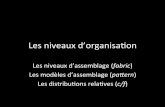Anthropologie et linguistique: influences, séparations et dialogues
LA GOUVERNANCEAPPROCHE THÉORIQUE ET ÉTUDE DE CASLES PROJET S URBAN I et II L'UNION...
Transcript of LA GOUVERNANCEAPPROCHE THÉORIQUE ET ÉTUDE DE CASLES PROJET S URBAN I et II L'UNION...
Université de Fribourg/SuisseFaculté des Lettres : Sciences des sociétés, des cultures et des religions
LA GOUVERNANCE
APPROCHE THÉORIQUE ET ÉTUDE DE CAS
LES PROJET S URBAN I et II
L'UNION EUROPÉENNE ET LES VILLES : UNE GOUVERNANCE
MULTI-NIVEAUX ?
Travail écrit pour le Master en Études européenne, dans le cadre du cours de M. Plomb Fabrice :
« Globalisation et sociétés plurielles » (SP 2013)
écrit par Fournier Yvan
Rue des Moulins 127, 1400 Yverdon-les-Bains079/5196587
1
Table des matières
1. Introduction 3-4
2. Approche théorique 4-12
2.1. Questions d'étymologie 4-5
2.2. La corporate governance :
du modèle d'entreprise au modèle de société 5-7
2.3. La « bonne gouvernance » : perspective normative 7-9
2.4. Globalisation, complexité et remise en cause de l'Etat :
la gouvernance comme réponse à une crise de gouvernabilité ? 9-11
2.5. Conclusions 11-12
3. Étude de cas 12-20
3.1. L'européanisation de la question urbaine :
une Commission en quête de compétences 13-15
3.2. Les projets URBAN :
la promotion d'un modèle de « bonne gouvernance » 15-17
3.3. Le paradigme du multilevel gatekeeping 17-19
3.4. L'échec de l'institutionnalisation d'une politique
urbaine européenne : du pouvoir au savoir 19-20
4. Conclusion 20-21
5. Bibliographie 22-23
5.1. Ouvrages 22
5.2. Articles de revue 22-23
5.3. Ressources internet 23
2
1. INTRODUCTION
La notion de gouvernance est désormais un terme indéniablement « à la mode »1 :
utilisée à la fois par les acteurs politiques et les disciplines universitaires, elle vise à
rendre compte de « processus orignaux dans les domaines économiques et politiques »2.
Elle a ainsi acquis une dimension de plus en plus importante depuis le milieu des années
1970, jusqu'à devenir un « outil heuristique central »3 des diverses branches de la
communauté scientifique, que ce soit l'économie, la science politique ou les relations
internationales, ainsi qu'un cadre normatif à travers la notion de « bonne
gouvernance » , diffusée par les grandes organisations internationales (OCDE –
Organisation de coopération et de développement économiques, ONU – Organisation
des Nations Unies, UE – Union Européenne, BM – Banque Mondiale, FMI – Fonds
monétaire international,...)4.
Censé donc à la fois rendre compte d'une certaine réalité dans le champ socio-politique
et économique et utilisé en vue de faire advenir cette même réalité par différentes
institutions, le concept de gouvernance est néanmoins souvent critiqué pour son
caractère imprécis, flou, polysémique. Si certains y voient une richesse, en ce qu'il
permettrait de favoriser « la rencontre entre les disciplines », du fait d'un regard faisant
appel aux « multiples facettes »5 du réel, d'autres au contraire mettent en avant le danger
d'une « logorrhée pseudo moderniste au service d'un discours incantatoire »6. Selon
Pitseys, la gouvernance ferait ainsi l'objet d'une « double confusion »7. La première
consisterait à l'identifier à tout un ensemble de « vertus », telles que « l'éthique, le
contrôle des représentants politiques, la réforme des institutions internationales, les
1 PITSEYS J., « Le concept de gouvernance », in : Revue interdisciplinaires d'études juridiques, Vol. 65,n°2, 2012, p. 207.
2 BARON C., « La gouvernance : débat autour d'un concept polysémique », in : Droit et société, n°54,2003, p. 330.
3 TOURNIER C., « Le concept de gouvernance en science politique », in : Papel Politico Bogota, Vol.12, n°1, 2007, p. 65.
4 SIMOULIN V., « La gouvernance et l'action publique : le succès d'une forme simmélienne », in : Droitet société, n°54, 2003, p. 314.
5 BARON C., op. cit., p. 330. 6 JOUMARD R., « Le concept de gouvernance », in : Rapport n°LTE 0910, Institut national de
recherche sur les transports et leur sécurité (INRETS), 2009, p. 7.http://hal.archives-ouvertes.fr/docs/00/48/92/37/PDF/rapport_gouvernance_RJ_LTE0910.pdf.(consulté le 6 juin 2013)
7 PITSEYS J., op. cit., p. 207.
3
accords publics-privés, la réforme du management des entreprises publiques, etc. »8. La
seconde, au contraire, lui imputerait tous les défauts, à travers son amalgame avec
« l'anti-étatisme néo-libéral (...), une pensée managériale insidieuse, (...) un capitalisme
techniciste »9.
En vue donc de sortir du manichéisme propre à une telle perspective, il est nécessaire de
tenter une clarification de cette notion polémique, ce que nous ferons en étudiant tout
d'abord son origine et les transformations qu'elle a subie, du fait de son appropriation
par différentes écoles ou courants. Nous conclurons cette partie par une synthèse des
caractéristiques principales du concept de gouvernance, en vue d'en formuler une
définition la plus « sobre » possible. Dans un deuxième temps, nous interrogerons la
pertinence du modèle de la gouvernance multi-niveaux dans le cadre d'une étude de cas
centrée sur la politique urbaine européenne et en nous focalisant sur les projets URBAN
I et II, de 1994 et 1999. Nous terminerons alors par quelques remarques critiques
mettant en évidence ce que la notion de gouvernance peut révéler, mais également ce
qu'elle peut cacher de la réalité qu'elle est censée décrire.
2. APPROCHE THÉORIQUE
2 .1. Questions d'étymologie
Comme le rappelle Tournier, c'est Platon qui le premier utilise le verbe kubernao dans
un sens politique, de gouvernement des hommes, alors qu'il tire son origine du monde
militaire, avec pour signification la conduite d'un char ou d'un navire10. Ainsi, la
direction de la cité nécessite qu'un « seul soit assis au gouvernail de l'Etat, gouvernant
tout, commandant tout et rendant tout profitable »11. Dans le Moyen-Âge latin, les
termes gubernatio (gouvernement) et gubernantia (gouvernance) apparaissent ainsi
comme synonymes. Avec ce que Jean-Pierre Gaudin appelle le deuxième âge de la
modernité, c'est-à-dire les Lumières, le concept de gouvernance se voit rattaché à « des
ajustements mutuels entre intérêts économiques et sociaux »12 et à une alternative au
8 IDEM. 9 IBID, pp. 207-208. 10 TOURNIER C., op. cit., p. 66. 11 Platon, Euthydème, 291 d, cité par TOURNIER C., IDEM.12 Cité par TOURNIER C., IBID, p. 67.
4
gouvernement de la monarchie absolue typique de l'Ancien Régime, à travers l'équilibre
entre pouvoirs royaux et parlementaires. Cependant, cette utilisation reste minoritaire et
sera abandonnée au cours du XIXème siècle, pour revenir au XXème, par
l'intermédiaire de l'économie.
2 .2. La corporate governance : du modèle d'entreprise au modèle de société
La remise à l'ordre du jour de la notion de gouvernance se fait à travers une conception
nouvelle de l'entreprise qui émerge aux États-Unis dans les années 193013, mais qui
s'affirme véritablement dans les années 70-8014 : la corporate governance. Dans un
contexte post-fordiste et de recherche d'une plus grande efficacité, la firme se doit de
revoir son organisation interne : elle devra être moins hiérarchique, impliquer de
manière plus importante les travailleurs par l'adhésion à un projet collectif, autrement
dit se construire sur la base de « conventions, de normes et d'accords ponctuels »15.
L'entreprise se conçoit alors comme un système de relations entre actionnaires,
dirigeants, salariés et investisseurs institutionnels, mais impliquant également
créanciers, clients, fournisseurs et pouvoirs publics16.
La question du pouvoir devient alors essentielle, la corporate governance consistant à
réguler « l'ensemble des mécanisme organisationnels », en vue de « délimiter les
pouvoirs »17, des dirigeants notamment, par un plus grand contrôle des actionnaires et
par de nouvelles « règles du jeu »18. Il n'est donc plus question ici de hiérarchie et de
13 Voir COASE R., The Nature of the firm, 1937 (cité par TOURNIER C., IBID, p. 68) et BERLE A. A. &MEANS G. C., The Modern Corporation and Private Property, 1932 (cité par BARON C., op. cit., p.336).
14 Ainsi, pour Baron, ce modèle repose surtout sur l'analyse de JENSEN M. & MECKLING W., « Theoryof the Firm : Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure », in : Journal ofFinancial Economics, n°3, 1976.
15 IDEM. Pitseys parle ainsi d'un véritable « modèle biologique » de l'entreprise, dont la condition desurvie est le développement permanent exigeant à la fois une grande cohérence interne et une« mobilité, une fluidité, une flexibilité maximale aux conditions de l'environnement extérieur ».PITSEYS J., op. cit., p. 215.
16 BARON C., op. cit., p. 336. La relation entre actionnaires et dirigeants sera ainsi reconsidérée durant lecourant des années 1990 : il s'agira de contrecarrer le pouvoir des seconds par plus grand contrôle despremiers. IDEM.
17 Cette conception rappelle éminemment la thèse de Montesquieu sur la séparation et l'équilibre despouvoirs (législatif, exécutif, judiciaire). Cependant, ce qui est en jeu ici ne concerne pas que lesinstitutions étatiques, mais un ensemble d'acteurs provenant à la fois du politique, de l'économique etde la société civile.
18 DEFARGES P. M., La gouvernance, Presses Universitaires de France, Paris, 2003, p. 14.
5
domination, mais de coordination et d'interactions, certes asymétriques, comme le
remarque Baron19.
Reprise par l'économie politique et le courant institutionnaliste20, la notion de corporate
governance ou de gouvernance d'entreprise va être tout simplement adaptée au cadre
plus global du « partage des tâches entre marché, structures sociales et structures
politiques »21, avec en arrière fond la subordination des deux dernières au premier. Cette
nouvelle configuration structurale aurait ainsi émergé dans le cadre du « nouveau
capitalisme financier» des années 1980, caractérisé par « une concurrence accrue et un
essor des marchés financiers »22. Ces-derniers en s'imposant au pouvoir politique,
auraient fait passer l'Etat d'un rôle central dans « les rapports capitalistiques à un
nouveau rapport actionnarial nécessitant une redéfinition de son rôle »23. Réduit à la
garantie de « la liberté des forces économiques et le respect des règles de concurrence »,
l'Etat se trouverait ainsi astreint à un rôle résiduel : c'est ce que Tournier appelle le
« paradigme économique néo-libéral »24, dont le courant néo-conservateur, représenté
par Thatcher et Reagan, ne serait que le volet politique. L’État, représentant par
excellence de la structure autoritaire, associée à la notion de gouvernement, serait donc
sommé de se résoudre à devenir un acteur parmi d'autres : la gouvernance se résumerait
ainsi, selon cette perspective, à une « régulation économique par la coopération »25,
19 Celui-ci fait ainsi, avec Foucault, la distinction entre la domination, « qui va de pair avec lasoumission » et implique un pouvoir « extérieur à l'acteur », alors que le pouvoir en tant que tel nerenverrait qu'à « des jeux stratégiques » entre individus, qui les amènent à agir les uns sur les autres,« à se gouverner les uns les autres ». Il nous semble cependant peu évident de distinguer ainsi cesdeux notions, puisque même dans cette conception relationnelle du pouvoir, il y a évidemment laplace pour des rapports de domination. C'est ce que souligne d'ailleurs le concept d'asymétrie...BARON C., op. cit., p. 335.
20 L'un de ses représentant les plus connus est Oliver E. Williamson. Voir WILLIAMSON O. E.,« Transaction Cost Economics : The Governance of Contractual Relations », in : Journal of Law andEconomics, Tome 22, n°2, 1979, p. 233-262 (cité par BARON C., op. cit., p. 341). Si Baron considère qu' « une étape a été franchie » avec l'économie institutionnaliste, en ce qu'elleconsidère les institutions comme des modes de coordination « alternatifs au marché », reste qu'ilnuance par la suite largement son propos. En effet, les institutionnalistes reprennent le modèle de lafirme telle que nous l'avons décrite ci-dessus et la considère comme une forme potentiellement plusefficace que le marché, lorsque celui-ci est défaillant, c'est-à-dire lorsqu'il y a des coûts de transactiondans les échanges. Les arrangements institutionnels ou « governance structures » ne sont donc qu'unpalliatif aux imperfections du marché, toujours en vue de favoriser l'échange économique, une plusgrande efficacité. Nous restons ainsi toujours ici dans une perspective purement économique etmarchande. IBID, pp. 341-42.
21 IDEM. 22 IBID, pp. 335-336. 23 IBID, p. 337. 24 TOURNIER C., op. cit., p. 68. 25 IBID, p. 69.
6
c'est-à-dire à une soumission à la fois de l'Etat et de la société civile à la logique du
marché, à l'efficacité économique.
A la fois fruit de l'histoire de l'évolution du capitalisme et nouvelle structure des
relations de pouvoir promues par certains courants de l'économie, la notion de
gouvernance possède une double dimension, à la fois descriptive et normative.
Cependant, cette dernière va très fortement s'affirmer à travers diverses institutions
internationales, dont la Banque Mondiale.
2 . 3 . La « bonne gouvernance » : perspective normative
Suite à l'échec des plans d'ajustements structurels dans les pays en voie de
développement, à une pauvreté croissante, à une succession de crises et à une stagnation
de la croissance26, la Banque Mondiale promeut un nouveau modèle de gouvernement à
travers deux rapports : De la crise à la croissance durable (1989) et Gouvernance et
développement (1992)27. La « bonne gouvernance » traduit alors un retour de l'Etat,
mais toujours dans le cadre de référence de l'efficacité économique et de la rationalité
instrumentale. Conformément à la théorie du Public Choice28, le but est à la fois une
plus grande efficacité de l'action publique et la garantie du fonctionnement du marché
par l'Etat29 : ce dernier est donc légitimité à intervenir dans la sphère économique, en
vue de renforcer l'action du marché, lorsque celui-ci connaît des défaillances30. Il s'agira
donc non seulement d' « améliorer la gestion des administrations »31 publiques en vue
d'une plus grande efficacité économique, mais également de le faire en respectant
certaines règles procédurales, telles que « la responsabilité, la transparence, l'absence de
corruption, un état de droit et la participation d'une pluralité d'acteurs »32. La « bonne
gouvernance » est donc conçue avant tout comme « une technique de gestion sociale »,
dont les résultats et la procédure fondent la légitimité ; nous pourrions même dire que la
procédure elle-même n'est justifiée que par l'efficacité qu'elle permet.
26 IBID, p. 338. 27 TOURNIER C., op. cit., p. 70. 28 Celle-ci renvoie à un courant de pensée apparu dans les années 1960 sous l'impulsion de James
Buchanan et de Gordon Tullock. BARON C., op. cit., p. 339. 29 TOURNIER C., op. cit., p. 70. 30 On retrouve ici le fameux « paradigme néo-libéral » tel que le défini Tournier. IDEM. 31 PITSEYS J., op. cit., p. 215. 32 BARON C., op. cit., p. 339.
7
Néanmoins, les « conditionnalités » de la Banque Mondiale ont peu à peu intégré des
dimensions supplémentaires, telles que « le respect de l'environnement, la prise en
compte de la société civile et des questions sociales »33, notamment à travers les
programmes de lutte contre la pauvreté. C'est d'ailleurs en ce sens que l'ONU, et plus
particulièrement le PNUD (Programme des Nations Unies pour le Développement), ont
lié la question de la « bonne gouvernance » à celle du « développement humain
durable », qui prend en compte la dimension environnementale et humaine (pauvreté,
sécurité alimentaire, problèmes urbains,...)34. De fait, la notion de « bonne
gouvernance » s'est répandue dans la plupart des grandes organisations internationales,
dont l'OCDE et l'Union Européenne. L'élément principal à retenir est que les définitions
qu'elles en donnent, aussi vagues soient-elles, insistent toutes sur « la pluralité des
acteurs en jeu » et « le caractère collectif des actions et négociations »35 : on retrouve
donc ici une conception s'appuyant sur la substitution de l'action unilatérale et
autoritaire de l'Etat par un mode « plus consensuel et pluraliste »36 de formulation de la
norme (celle-ci devenant un contrat ou une convention portant sur un projet).
C'est alors la place de la société civile qui est mise en avant, à travers les théories
délibératives ou participatives de la démocratie : la prise en compte du rôle des
associations de citoyens implique ainsi une revalorisation de la dimension locale de la
gouvernance. La gouvernance promue par les institutions internationales se veut ainsi à
la fois globale37, puisqu'elle tend à développer des projets et des procédures à l'échelle
de la planète (ONU, Banque Mondiale, FMI) ou du moins au niveau transnational
(OCDE, Union Européenne), mais aussi nationale et locale (régions, villes, quartiers...),
étant donné que ce nouveau modèle de gestion et de coordination de projets met en
avant la participation de tous les acteurs concernés38 (publics, privés et citoyens) et une
33 La notion de « conditionnalité » renvoie aux conditions auxquelles les prêts de la Banque Mondiale etdu FMI sont octroyés aux pays demandeurs. Ainsi, dans un premier temps, celles-ci étaient avant toutd'ordre purement économique : « la stabilisation macro-économique et financière, la libéralisation et la privatisation ». BARON C., op. cit., p. 340.
34 IDEM. 35 SIMOULIN V., op. cit., p. 314. 36 PITSEYS J., op. cit., p. 216. 37 Le temps fondateur de cette notion remonte à 1992, année de publication de l'ouvrage « Governance
without Government » de James Rosenau et Ernst-Otto Czempiel. La même année verra d'ailleurs lacréation de la Commission on global governance (ONU) par Willy Brandt et la fondation du Centerfor the Study of Global Governance à la London School of Economics. TOURNIER C., op. cit., p. 75.
38 La notion de stakeholders, au sens où l'entend Giddens, en est la traduction. En effet, pour lesociologue britannique, la société des « parties prenantes » est celle dans laquelle tous ceux qui ont
8
décentralisation des pouvoirs. Reste néanmoins que les objectifs fixés restent l'apanage
des organes internationaux, même si la mise en application de ceux-ci nécessite une
participation du niveau local, que la place accordée à l'Etat entraîne souvent une
instrumentalisation des initiatives populaires par celui-ci et que la centralité de
l'économique a pour conséquence une « implication croissante d'opérateurs privés
internationaux »39. Essentiellement normative, la « bonne gouvernance » est donc le
résultat d'une définition a-priori de la fin et des moyens de l'organisation sociale dans
son ensemble.
2 . 4. . Globalisation, complexité et remise en cause de l'Etat : la gouvernance comme
réponse à une crise de gouvernabilité ?
La notion de gouvernance, nous l'avons vu, s'est progressivement étoffée à partir des
années 1970-1980, dans une perspective avant tout économique, pour être reprise par les
institutions internationales à partir des années '90. Cependant, elle ne prendra
véritablement toute son ampleur, dans les études scientifiques, qu'à partir de 1994,
s'étendant ainsi au domaine des relations internationales, à travers le concept de
gouvernance globale, et à la question de la gouvernance locale, régionale ou urbaine :
elle en arrive alors à conquérir « l'ensemble du domaine de l'action publique »40. Son
utilisation dans le cadre académique mettrait donc en évidence la constatation d'une
rupture affectant la société, le politique et l'économique, dans leurs relations.
L'un des changements majeurs depuis les années 1970 aurait ainsi été la globalisation
ou mondialisation entendue comme « processus économique étendu à l'ensemble de la
planète, qui a pour effet de créer une convergence de l'ensemble des population, cultures
et sociétés »41. Ce processus économique serait caractérisé par « l'émergence d'une
société post-industrielle, post-fordiste et post-matérialiste », « l'apparition de
l'informatique » et « la dérégulation des échanges internationaux », mais également « la
privatisation des services publics, la contractualisation des gestions publiques, le succès
des agences de régulation »42 le tout entraînant une « remise en question d'un modèle
intérêt à agir doivent pouvoir participer à la prise de décision. JOUMARD R., op. cit., p. 17. 39 BARON C., op. cit., p. 341. 40 SIMOULIN V., op. cit., pp. 312-313. 41 TOURNIER C., op. cit., p. 74. 42 Cette liste est loin d'être exhaustive. Nous aurions pu citer de nombreux autres éléments provenant
9
étatique (...) dépassé par de nouvelles règles et stratégies »43 : la naissance du modèle de
la gouvernance serait donc née de l'incapacité des Etats à réguler la globalisation
économique dans un monde de plus en plus complexe44. Face à cette « crise de
gouvernabilité »45 de l'Etat, la gouvernance apparaît ainsi comme un remède « au déficit
de légitimité et d'efficacité »46 de l'action publique.
Néanmoins, face à cette remise en question du modèle gouvernemental, plusieurs thèses
émergent, dont trois nous paraissent emblématiques. Pour la première, les Etats
modernes connaîtraient un « processus d'évidemment »47 (doctrine de l'Etat-creux), la
gouvernance représentant alors « le triomphe d'une rationalité anti-étatiste » qui
« disqualifie l'Etat tout en privatisant la délibération politique »48. Pour la seconde, il ne
s'agirait que d'une « déterritorialisation/reterritorialisation du politique »49, à la fois au
niveau transnational et infra-national, impliquant un nouveau partage des compétences
entre ces deux éléments et l'Etat : c'est ce qu'on appelle la « gouvernance
multi-niveaux »50. Enfin, pour la troisième, soutenue par certains théoriciens du
management, la situation contemporaine apparaît au contraire comme étant celle d'un
renforcement de l'autorité publique, à travers une « planification douce et profonde du
d'auteurs différents, mais par souci de concision, nous nous en passerons. 43 IBID, p. 75. 44 Pour Jacquier, le paradigme de la globalisation et de la complexité ne sauraient en rien expliquer
l'apparition de la gouvernance locale, puisque si la première suppose une plus grande« homogénéisation des comportements », alors en quoi la réalité deviendrait plus complexe ? Pourlui, au contraire, la gouvernance locale ne serait qu'une pratique répondant au mieux à une complexitétoujours présente, mais qui aurait été tout simplement « négligée au fil du temps ». JACQUIER C.,Politiques intégrées de développement urbain durable et gouvernance urbaine en Europe. Quellesrelations mutuelles ?, 2003.
http://i.ville.gouv.fr/download_file/2071/2132/politiques-integrees-de-developpement-urbain-durable-et-gouvernance-urbaine-en-europe-quelles-relations-mutuelles. (consulté le 7 juin 2013).
45 JOUVE B., « La démocratie en métropoles : gouvernance, participation et citoyenneté », in : Revuefrançaise de science politique, Vol. 55, n°2, 2005, p. 322. Le concept de « sociétés (...)ingouvernables » reflète ainsi le thème de la complexité : du fait « de la différenciation et del'autonomisation de plus en plus poussée de sous-système dans la société, de la prolifération deréseaux de toutes sortes », l'Etat se verrait obligé d'engager un dialogue avec ces nouveaux acteursémergents, en vue de rendre possible l'action du gouvernement. LE GALÈS P., « Du gouvernement desvilles à la gouvernance urbaine », in : Revue française de science politique, n°1, 1995, p. 59.
46 SIMOULIN V., op. cit., pp. 317. 47 JOUVE B., « Gouvernance métropolitaine en Europe : essai de typologie », Communication au
XXXVIIIème Colloque annuel de l'Association de Science Régionale de Langue Française, 21-23Août 2002, p. 2.http://www.omd.uqam.ca/membres/pages-perso/Jean-Marc/cours/soc3760/recueil_web/T_Jouve.pdf . (consulté le 7 juin 2013).
48 PITSEYS J., op. cit., p. 220. 49 JOUVE B., op. cit., 2002, p. 2. 50 TOURNIER C., op. cit., p. 79.
10
social », alliant « principes directeurs et normes extrêmement détaillées »51. Face à son
déficit de légitimité et donc de confiance, l'Etat réagirait en substituant le modèle du
gouvernement autoritaire et punitif, imposant une « contrainte extérieure à l'individu »,
à celui d'une gouvernance qui entend « orienter de l'intérieur son comportement » : cette
dernière lui permettrait donc, derrière son « rétrécissement apparent », de « pénétrer la
complexité du champ social », d' « infiltrer plus finement de nouveaux domaines
d'action », par l'intermédiaire de « structures plus légères et/ou informelles »52. La
question de la légitimité s'associe alors évidemment à celle de la « confiance »53, que la
gouvernance cherche à reconstruire par la valorisation de l'efficacité des politiques
publiques et des procédures d'élaboration de celles-ci.
2 . 5 . Conclusions
Utilisé à la fois par de nombreuses disciplines universitaires (science politique,
sociologie, économie, géographie,...) et par différentes écoles de pensée, le concept de
gouvernance présente nécessairement un certain flou. Son origine liée à la théorie du
management d'entreprise et sa reprise par les grandes institutions financières n'a pas
aidé à sa bonne image. La rhétorique souvent idyllique et naïve dont la revêtent les
politiques n'a pas non plus pour vertu de lui donner une grande légitimité. L'usage très
important par le monde scientifique pourrait cependant témoigner d'une certaine
pertinence de ce concept à décrire une réalité nouvelle. Reste à savoir si elle ne
constitue pas qu'un paradigme, au sens que lui ont donné Raymond Boudon et François
Bourricaud, à savoir « un ensemble de propositions ou d'énoncés métathéoriques portant
moins sur la réalité sociale que sur le langage à employer pour traiter de cette réalité
sociale »54, autrement dit un nouveau mot pour décrire un phénomène qui ne l'est pas...
Même si l'on pourrait trouver une infinité de définition de la notion de gouvernance
dans la littérature scientifique, il nous paraît cependant important de tenter d'en
déterminer les caractéristiques principales, au vue de notre analyse. La gouvernance
51 PITSEYS J., op. cit., p. 221. Pitseys cite ainsi l'ouvrage de OSBORNE D. & GAEBLER T., Re-inventingGovernement : How the Entrepreunerial Spirit is Transforming the Public Sector, Reading,Massachussets, Addison-Weasley, 1992.
52 IBID, pp. 219-221. 53 IBID, p. 222. 54 BOUDON R. & BOURRICAUD F., Dictionnaire critique de la sociologie, P.U.F., Paris, 2000, p. 617, cité
par SIMOULIN V., op. cit., pp. 315.
11
pourrait se définir comme une antithèse de la conception hiérarchique et autoritaire du
gouvernement, au profit d'une coopération-coordination horizontale entre tous les
agents concernés, qu'ils soient publics ou privés, et ceci à toutes les étapes de la
procédure en question (co-décision et co-application), en vue d'une plus grande
efficacité dans le traitement de problèmes et la mise en œuvre de projets concernant
cette communauté d'agents.
Cette définition peut paraître très large, mais dans un autre sens elle montre bien en quoi
le concept de gouvernance participe, dans son essence-même, de l'idéal et de la norme, à
travers le rejet de tout rapport de domination. Il s'agira donc maintenant pour nous de
vérifier, dans une étude de cas, ce qu'elle nous révèle et ce qu'elle nous cache de la
réalité...
3. ÉTUDE DE CAS
Selon certains analystes, le phénomène de mondialisation aurait eu pour corrélat la
« montée en puissance des villes »55, processus qu'ils nomment alors
« métropolisation »56. Cependant, ce processus se serait également trouvé renforcé sur
notre continent par l'émergence d'un nouveau « système politique »57 : l'Union
Européenne. Le « desserement du verrou de l'Etat »58, qui se manifeste par la mise en
place de politiques de décentralisation, et l'émergence de ce nouvel acteur européen
aurait ainsi permis aux villes de s'affirmer en court-circuitant leur dépendance face à
l'Etat à travers un rapport direct avec les instances de l'UE. Ces « changements
verticaux »59 entre Etat et collectivités locales auraient ainsi donné naissance à de
« nouveaux modèles de gouvernance verticale » privilégiant « les relations de
partenariat »60 entre ces différents niveaux (UE, national, local) : la gouvernance
55 LE GALÈS P., op. cit., p. 64. 56 JOUVE B., 2002, op. cit., p. 1. Pour définir les métropoles, Jouve privilégie « une approche
économique et socio-politique », qui les qualifie ainsi de « territoires les plus directement affectés parles transformations économiques qui accompagnent la globalisation » : ces transformationscomprennent des « mécanismes d'exclusion soco-économiques » et des « nouvelles formes depauvreté ». Il ne s'agit cependant pas uniquement des « villes globales », telles que les comprendSaskia Sassen, mais également « des espaces moins « centraux », a priori, d'un point de vuestrictement démographique ». JOUVE B., 2005, op. cit., pp. 319-320.
57 TOURNIER C., op. cit., p. 77. 58 JOUVE B., 2002, op. cit., p. 2. 59 LE GALÈS P., op. cit., p. 63. 60 WOLFF S., Les villes et l'Union Européene. Perspective : le processus d'intégration européenne par
12
multi-niveaux. C'est cependant ce modèle que nous aimerions interroger maintenant, à
travers une analyse de l'évolution de la prise en compte des villes par l'Union
Européenne.
3.1. L'européanisation de la question urbaine : une C ommission en quête de
compétences
Nous pouvons distinguer cinq grandes étapes dans ce processus ; trois nous
intéresserons particulièrement ici, même si nous traiterons des deux suivantes plus loin.
Durant la première (de 1975, date de création du FEDER - Fonds Européen de
Développement Régional, à 1988), la question des villes est totalement absente des
politiques européennes, la Commission ne disposant pas de base légale dans les Traités
lui permettant d'agir en ce sens. Le FEDER, d'ailleurs faiblement doté (5 % du budget
de la communauté), ne reconnaît pas la spécificité des aires urbaines et s'oriente
uniquement vers les régions les plus pauvres.
La seconde, de 1988 à 1993, marque une action plus volontaire de la Commission qui,
sous l'égide de Jacques Delors, tente de court-circuiter les Etats-membres en
développant un dialogue avec les entités infra-nationales. Cela se traduit par la réforme
des Fonds structurels en 1988, le renforcement de leur budget, et le lancement de 33
Projets Pilotes Urbains (PPU), dont l'enveloppe est cependant relativement faible (101
millions d'euros), et qui ont pour objet l'expérimentation d'approches originales et
innovantes en matière de politique urbaine. Cet instrument permet à la Commission de
« financer de nombreux réseaux d'autorités locales, de quartiers et de villes qui
constituent autant de clientèles intéressées et mobilisables pour développer cette
politique »61 et « de mettre en forme, codifier, légitimer les expériences de
renouvellement urbain en Europe, ainsi qu'à diffuser des manières de faire »62.
le développement urbain, travail de mémoire, Université Robert Schuman, Institut d'Etudes politiquesde Strasbourg, 2008, p. 30. scd-theses.u-strasbg.fr/354/01/ WOLFF _Solène_2008.pdf. (consulté le 6 juin 2013).
61 HALPERN C. & LE GALÈS P., Grandeur et décadence de la politique urbaine de l'Union Européenne.Analyse longitudinale des instruments d'action publique entre 1972 et 2006, Working papers duProgrammes Villes & territoires, Sciences Po, Paris, 2013, p. 8.http://blogs.sciences-po.fr/recherche-villes/2013/05/01/halpern-et-le-gales-2013-grandeur-et-dec ade nce-de-la-politique-urbaine-de-lunion-europeenne/ . (consulté le 5 juin 2013).
62 IDEM.
13
Néanmoins, les aides étant attachées à certaines conditions et principes (concentration,
partenariat, programmation, additionnalité63), la Commission oblige ses partenaires à
adopter ses propres méthodes et tente de consolider sa position d'interlocutrice vis-à-vis
des entités sub-nationales, au détriment de l'Etat. Pour Cram, la Commission s'est ainsi
engagée dans un véritable « purposeful opportunism » en vue d'étendre ses
compétences64.
Une cellule de réflexion sur la ville est également créée au sein de la DG XVI de la
Commission (qui deviendra la DG Regio – Direction générale de la politique régionale),
de manière informelle tout d'abord, puis officielle à partir de 199365. Toutefois, cette
cellule sera fortement contrôlée et encadrée par la Direction Générale. Et pour cause, les
régions, dont l'autorité a été accrue suite aux mesures de décentralisation dans les pays
européens, ont été reconnues, par les Etats et par l'UE, comme niveau pertinent d'action
et destinataires exclusifs des programmes communautaires 66. Elles n'ont donc pas vus
d'un très bon œil la valorisation de la question urbaine dans le cadre européen67. Les
représentants de certains Etats membres ont également émis des réserves, puisqu'ils
craignaient que la politique urbaine ne soit qu'un prétexte pour détourner les fonds de
cohésion des régions en retard de développement (Espagne, Grèce, Irlande,...) au profit
des métropoles en crise, situées essentiellement dans le nord de l'Europe68.
La troisième période, de 1994 à 1999, est à nouveau marqué par un renforcement des
63 Le principe d'additionnalité implique la participation financière locale et nationale, en plus de celleeuropéenne. PASQUIER R. & PINSON G., op. cit., p. 45.
64 CRAM L., Policy-making in the European Union, Routledge, Londres, 1997, cité par FENET R.,Politiques urbaines dans l'Union Européenne : redéfinition des rôles dans un système degouvernance complexifié, travail de séminaire, Université de Lyon 2, Institut d'Etudes politiques deLyon, septembre 2007, p. 67. http://doc.sciencespo-lyon.fr/Ressources/Documents/Etudiants/Memoires/Cyberdocs/MFE2007/fenet_r/pdf/fenet_r.pdf. (consulté le 5 juin 2013).
65 HALPERN C. & LE GALÈS P, op. cit., p. 8. 66 Elles disposent ainsi de cinq canaux d'implication au niveau de l'UE : le Comité des Régions (institué
en 1994), le Conseil des Ministres, la Commission, les antennes régionales et les associationsinter-régionales. FENET R., op. cit., p. 52.
67 L'exemple du Comité des Régions illustre d'ailleurs bien les tensions qu'il peut y avoir entre les villeset les régions : de profondes divisions sont en effet patentes entre intérêts locaux et régionaux. Ainsi,alors que les régions s'intéresseraient davantage aux « grandes questions économiques et politiques »,les villes s'occuperaient de préférence de « la fourniture de services et de problèmes urbains ». Deplus, alors que la représentation est surtout régionale dans les pays fédéraux ou décentralisés(Autriche, Allemagne, Belgique, France, Espagne, Italie), elle est surtout locale dans les paysnationaux (Danemark, Finlande, Irlande, Grèce, Luxembourg, Pays-Bas, Royaume-Uni). IDEM.
68 HALPERN C. & LE GALÈS P., op. cit., p. 8.
14
Fonds structurels et le soutien à des réseaux de villes (Eurocités), la création du Forum
Urbain (1998) et de l'Audit Urbain (1997). Tous ces nouveaux instruments passent
toujours par ceux de la politique régionale de cohésion et visent avant tout à permettre
« la production et la comparaison de données », soit dans le cadre de réseaux d'échanges
d'expériences, soit par la production d'indicateurs systématiques, en vue de « rendre les
villes européennes plus lisibles »69. L'unité urbaine de la Commission s'affirme ainsi
comme un acteur majeur de centralisation des données et de légitimation de politiques
urbaines à travers le label européen. Néanmoins, l'événement principal est le lancement,
sous pression du Parlement, du Programme d'Initiative Communautaire (PIC) URBAN I
en 1994. Ce-dernier constitue en effet le premier programme de politique publique se
focalisant uniquement sur les villes et c'est pourquoi il peut paraître particulièrement
intéressant.
3.2. Les projets URBAN : la promotion d'un modèle de « bonne gouvernance »
S'inspirant des expériences françaises (Contrats de ville), anglaises (City Challenge et
Single Regeneration Budget), et de celle des PPU, le tout combiné avec les instruments
classiques de la politique régionale (zonage, additionnalité, partenariat, programmation
pluriannuelle), les PIC URBAN I (1994-1999) et II (2000-2006) ont pour objectif de
réintégrer dans la dynamique de la ville des quartiers en grandes difficultés, en prônant
une approche intégrée et durable du développement urbain, combinant mesures
sociales, environnementales et économiques70. La légitimité de cette nouvelle initiative
se trouve fondée en termes d'innovation, d’efficacité et de participation de la société
civile71. Ainsi, un modèle de gouvernance horizontale et verticale est promu, à travers la
mise en place de « réseaux latéraux, locaux, inter-organisationnels et interpersonnels »72,
donc dans une logique de partenariat entre acteurs locaux (privés et publics)73. On
69 IBID, p. 9. 70 PASQUIER R. & PINSON G., op. cit., p. 44. Pour Halpern et Le Galès, il ne s'agit en rien d'éléments
innovants. Si la notion de développement durable date des années '90, les questions concernant« l'environnement, la qualité de vie, la pollution et la consommation des ressources associées auxvilles », date des années 1970. HALPERN C. & LE GALÈS P., op. cit., p. 4.
71 IBID, p. 10. Halpern et Le Galès notent ainsi que toute une rhétorique de l'innovation est exigées de lapart des villes demandant ce label : il s'agit ainsi de « promouvoir des « actions innovantes » derénovation urbaine, des démarches « innovantes », des modes de gouvernance « innovants » ». IBID,p. 11.
72 PASQUIER R. & PINSON G., op. cit., p. 44.73 L'obtention des fonds pour les villes est ainsi conditionnée par le respect de conditions-cadres, de
règles du jeu définies au préalable par la Commission. Les PIC, dont URBAN ont ainsi été beaucoup
15
retrouve ainsi dans la rhétorique même de la Commission européenne, tous les éléments
correspondants à la notion de « bonne gouvernance » : « passer outre la
compartimentation des questions politiques, le paternalisme et la hiérarchie associés aux
mécanismes politiques traditionnelles », « favoriser le partage des risques et des
responsabilités », « construire collectivement des problèmes sur la base de
diagnostiques partagés », établir « des rapports de confiance entre les parties » en vue
d'une plus grande efficacité...74 La Commission considère ce nouveau paradigme comme
nécessaire, étant donné que la situation catastrophique de certains quartiers serait « le
signe de l'échec des politiques nationales et du modèle de l'Etat dirigiste »75. L'initiative
URBAN se veut donc un « modèle pour la politique nationale et un vecteur pour la
diffusion des meilleures pratiques », ce qui se concrétisera par la structuration du réseau
URBACT, espace d'expertise et d'échanges d'expériences entre les villes partenaires76.
Au niveau financier, le budget communautaire d'URBAN I se montait à 900 millions
d'euros, qui ont été réparti dans 118 zones urbaines, de 100'000 habitants au moins. Pour
URBAN II, l'UE a baissé ce seuil d'éligibilité à 20'000, privilégiant ainsi les petites
villes et celles moyennes, mais le budget a été réduit à 700 millions d'euros et s'est
réparti sur 70 zones urbaines. Celles-ci devaient satisfaire au moins trois critères sur
neufs établis par la Commission : taux de chômage, taux d'activité économique, taux de
pauvreté, nombre d'immigrés, taux de criminalité, etc. De plus, selon le principe
d'additionnalité des fonds, le projet devait contenir obligatoirement une participation
financière nationale ou locale et selon celui de subsidiarité, chaque Etat-membre
sélectionnait ses propres sites et assurait la répartition financières entre eux.
critiqué pour leur « caractère strict et bureaucratique ». On ne peut donc pas parler ici d'un modèle degouvernance, celle-ci étant justement caractérisée par un rejet de l'autoritarisme et de la bureaucratie.Ainsi, si l'UE a représenté pour les villes, dans un premier temps, une opportunité, elles ont duapprendre à composer avec les contraintes qui vont avec (normes communautaires, notamment dansle domaine de l'environnement, des services publics ou de l'aide aux entreprises). FENET R., op. cit.,pp. 52-53.
74 IDEM. 75 IDEM. 76 IBID, pp. 45-46. Dans le même sens, l'Audit Urbain, lancé en juin 1998 et aujourd'hui rattaché à
Eurostat, a pour but de regrouper des informations statistiques sur « la qualité de vie dans les villeseuropéennes et les progrès accomplis, ainsi que d'apporter des réponses aux questions de politiquesurbaines ». WOLFF S., op. cit., p. 28.
16
3.3. Le paradigme du multilevel g atekeeeping
La place de l'Etat est donc loin d'être marginal dans ce projet. Face à une Commission
essayant d'étendre ses compétences, celui-ci résiste à travers ce que Tofarides nomme le
gatekeeping77, autrement dit en défendant ses prérogatives à chaque étape du processus :
sélection des villes, négociations du cadre administratif, définition du contenu des
programmes, mise en œuvre78. Ainsi, dans le cas du gouvernement anglais, celui-ci a
pesé de tout son poids dans le déroulement des projets : élargissement du nombre
maximal de villes éligibles, contournement des critères définis par la Commission,
négociation d'une représentation plus importante des représentants de l'Etat au sein des
comités de pilotage, interprétation plus restrictive de la notion de partenariat, etc79. Les
Etats ont ainsi eu tendance à considérer URBAN comme un « business as usual »,
c'est-à-dire comme un des volets de leur politique nationale et non comme une politique
communautaire80.
Comme nous l'avons vu, pour la Commission, URBAN représentait un moyen d'étendre
ses compétences et de s'affirmer comme interlocuteur vis-à-vis des entités
infra-nationales. C'est elle qui a défini les conditions-cadres du projet et qui a imposé un
contrôle bureaucratique assez lourd de sa mise en œuvre. Nous pourrions même
considérer que l'Etat et la Commission ont participé à une monopolisation du processus
de décision en ce qui concerne « la direction, la structure des programmes et le
découpage des zones »81. De leur côté, les élus municipaux ont vu dans ce projet une
possibilité de se faire reconnaître au niveau européen, de soigner leur image et de
s'affirmer face à l'Etat, mais également de renforcer leur importance au niveau local82.
77 TOFARIDES M., Urban policy in the European Union : a multilevel gatekepper system, Ashgate,Aldershot, 2003, cité par FENET R., op. cit., p. 69. Cette notion a été conçue pour caractériser lesrelations entre Etats et Commission dans le cadre de l'UE. En distinguant les phases de définition decelle de mise en œuvre d'une politique, Tofarides montre ainsi l'impossibilité pour la Commission decourt-circuiter les Etats lors de cette dernière phase. Ces-derniers jouent alors le rôle de gatekeeper.FENET R., op. cit., p. 69.
78 FENET R., op. cit., p. 70. 79 IDEM. 80 IDEM. 81 ELANDER I., « Partenariats et gouvernance urbaine », in : Revue internationale des sciences sociales,
n°172, 2002, p. 222. 82 A Turin et à La Corogne, « les édiles et leurs équipes administratives » ont d'ailleurs joué « un rôle
déterminant dans la captation de cette initiative européenne ». Dans le cas de la ville espagnole,URBAN I a ainsi permis à la municipalité « de conforter sa domination politique » dans le cadre de lapolitique urbaine. PASQUIER R. ET PINSON G., « Politique européenne de la ville et gouvernement
17
Toutefois, les autorités locales ont également joué un rôle de gatekeeping vis-à-vis des
acteurs privés, notamment associatifs. En effet, de par les « formes de comptabilité et de
gestion » complexes requises « pour obtenir et conserver le financement extérieur » de
l'UE, les partenaires ont du se plier à « des systèmes de gestion, de prise de décision et
de représentation dans lesquels s'est dilué le rôle de la population »83. Le rôle « des
experts, des bureaucrates et des élites économiques et politiques locales » a donc été
prépondérant, au détriment d'une large partie du public84 : ce sont d'ailleurs des cabinets
d'études municipaux qui déterminent les problèmes et les solutions à apporter,
autrement dit qui définissent « ce qui est pensable et possible »85. Les villes ont
également engagé des « european officers » ou, le cas échéant, ont mis en place leur
propre service spécialisé dans les affaires européennes. Ces-derniers, disposant de
ressources plus conséquentes que le secteur associatif, ont ainsi eu un accès privilégié à
l'information, au détriment d'autres acteurs infra-nationaux86.
En conclusion, il semble donc bien qu'on puisse parler ici de « multilevel
gatekeeping »87, chaque niveau luttant à la fois pour garder ses prérogatives et les
augmenter. Cette notion, en mettant en évidence les rapports de domination et de
pouvoir, la dimension conflictuelle et les processus de blocage au sein du système
institutionnel européen, semble plus pertinente que celle de gouvernance multi-niveaux,
qui insiste, quant à elle, sur la coopération et le consensus entre les parties prenantes.
local en Espagne et en Italie », in : Politique européenne, n°12, 2004, pp. 46-47. 83 ATKINSON R., « Les aléas de la participation des habitants à la gouvernance urbaine en Europe », in :
Les Annales de la Recherche Urbaine, n°80, 1998, p. 80. 84 Pour Elander, « les expériences de partenariat menées jusqu'à présent par l'Union Européenne
amènent à s'interroger sérieusement sur la question du contrôle démocratique ». ELANDER I., op. cit.,p. 222. Ainsi, si « l'approche partenariale dans les politique urbaines possède une force rhétorique etun attrait mythique », « l'expérience nous enseigne que les partenariats se retranchent souvent derrièredes barrières qui les isolent de tous ceux qui n'appartiennent pas à l'élite de la société ». IBID, p. 227.
85 ATKINSON R., op. cit., p. 82. Outre la problématique du rapport entre expertise et démocratie, quiparaissent foncièrement antinomiques, une analyse critique du discours permet également de« comprendre de quelle façon la participation de la population peut être structurée et gérée par desreprésentants qui intériorisent les normes des organismes publics et privés ». En effet, le langagetechnique de l'expertise n'est pas neutre : il définit les limites du « pensable comme réalisable ».Forcée de se convertir à ce langage « étranger » qui apparaît comme le seul légitime, le pouvoir de lapopulation se trouve pour ainsi dire évidé. Dès lors, il faut toujours se méfier des initiatives visant àredonner la parole à la société civile : si participation il peut bien y avoir, reste à savoir commentcelle-ci s'opère et de quelle manière elle est encadrée par le politique. IBID, p. 81.
86 FENET R., op. cit., p. 70. Ainsi, lorsque l'on parle de partenariat, il ne faudrait pas tomber dans lepiège visant à les considérer comme « des accords constitués par des acteurs de valeur et de forceégale ». Dans la pratique, il reflètent au contraire des positions différenciées en terme de ressources,donc de pouvoir. ELANDER I., op. cit., p. 219.
87 IBID, p. 71.
18
3.3. L'échec de l'institutionnalisation d'une politique urbaine européenne : du pouvoir au
savoir
Si pour Pinson et Pasquier, on peut ainsi parler avec URBAN d'une « véritable politique
européenne de la ville », qui serait devenue un « champ prioritaire pour l'Union
européenne », ce n'est pas l'avis de Dominique Rivière, pour qui il faut « sans doute
nuancer » cette perspective, « compte tenu de la modestie des engagements financiers
en jeu », notamment si on les compare à l'importante contribution donnée aux régions88.
De plus, la diminution du budget entre URBAN I et II, la remise en question de la
reconduction du projet pour la deuxième période89, puis sa suppression pour la période
2007-201390, semblent appuyer la thèse de Rivière. La dimension privilégiée par l'Union
européenne, à partir de 2006, n'est donc plus la création de projets de développement
urbain, mais la formation d'un réseau d'échange de bonnes pratiques et d'expériences à
travers l’initiative URBACT91, qui vient s'additionner aux projets EUKN (European
Urban Knowledge Network), EUROCITIES ou encore INTERREG92.
En fait, il semble bien qu'URBAN, tout en étant le « programme phare »93 de la
politique urbaine de l'UE, n'en a représenté qu'une brève parenthèse. La Commission,
n'ayant pas réussi à s'imposer comme « un véritable manager »94 de la politique urbaine,
88 Le fonds de convergence inter-régional Objectif 1 comprenait ainsi une enveloppe de 235 milliardsd'euros pour la période 2000-2006, alors que le programme 2007-2013 sera doté de 308 milliardsd'euros. RIVIÈRE D., « Le renouvellement urbain et la politique européenne de cohésion, de Naples àSaint-Denis », in : Revues méditerranéennes, n°39, 2011, p. 107.
89 La Cour des Comptes de l'UE a en effet publié un rapport très critique sur URBAN I et il a fallul'intervention du Parlement européen pour prolonger l'initiative. FENET R., op. cit., p. 65.
90 La méthode de l'initiative ponctuelle des PIC est ainsi abandonnée au profit de celle dumainstreaming, autrement dit l'intégration de la politique urbaine dans les objectifs de convergenceinter-régionale. IDEM.
91 Ouvert tout d'abord aux 216 villes européennes ayant participé à URBAN I et II, le programme s'estensuite étendu à tous les Etats membres de l'Union européenne. WOLFF S., op. cit., p. 90.
92 RIVIÈRE D., op. cit., p. 118. Vion remarque d'ailleurs que les gouvernements urbains, à la différencede ceux des régions, sont moins mobilisés par « des logiques de captation et d'administration desressources financières » des politiques de redistribution de l'UE. Au contraire, ils sont d'avantageimpliqués dans une logique de construction des savoirs et des méthodes de management urbains.Cette logique de benchmarking se traduit ainsi par l'élaboration de multiples indicateurs communs(villes internationales, villes durables, indicateurs énergétiques, ...) et la formation de clubs fermésd'experts (Eurocités, Métropolis, Global City, Villes durables,...) : c'est bien à ce niveau que seconstitue une certaine « européanisation des problèmes urbains ». VION A., « L'affirmation desgouvernements urbains dans l'Union Européenne : une légitimation professionnelle diffuse », in :Politique européenne, n°19, 2006, p. 162.
93 HALPERN C. & LE GALÈS P., op. cit., p. 9. 94 FENET R., op. cit., p. 68.
19
du fait du gatekeeping provenant à la fois des autorités nationales et locales, s'est donc
repliée sur un statut beaucoup plus modeste de plate-forme d'échange du savoir urbain
européen, dont elle n'est cependant que la promotrice et non l'initiatrice95.
4. CONCLUSION
La notion de gouvernance multi-niveaux, comme nous l'avons vu, est un « modèle dans
lequel les compétences en matière de prise de décisions concernant les politiques
publiques sont partagées, sans que cela suppose de domination des Etats sur les acteurs
infra-nationaux et supra-nationaux »96. La relation de type verticale, autoritaire et
hiérarchique entre les différents niveaux serait donc remplacée par des « processus de
co-décision horizontaux »97 entre institutions. Néanmoins, pour pouvoir participer à
l'élaboration de la décision, encore faut-il en avoir la compétence. Or, comme nous
l'avons vu, la tentative faite par l'UE de s’ingérer dans la politique urbaine n'a pas été
chose facile : elle a trouvé l'opposition à la fois des régions et de certains Etats
européens et, faute de base légale, elle a du se replier sur la politique régionale en vue
de pouvoir intervenir dans le domaine urbain. Pour Halpern et Le Galès, « cette
politique a donc émergé de manière un peu clandestine, à partir d’exceptions négociées
à la règle »98, mais surtout à travers une logique conflictuelle entre acteurs.
De même, il faudrait questionner la place qu'on les régions et les villes dans le
processus de prise de décision au niveau européen. Ainsi, comme le rappelle Jeffrey, les
« canaux externes avec un accès direct des autorités infra-nationales aux institutions
européennes », tels que le Comité des Régions, les associations inter-régionales,
l'Assemblée des régions européennes, ... sont « souvent d'importance limitée », alors
que les « canaux internes », ceux passant par l'Etat, « sont indubitablement les plus
importants »99. Ainsi, si les régions participent avec les Etats et l'UE à la discussion
95 Ainsi, pour Vion, « considérer les réseaux de coopération interurbains comme un fait nouveauimpulsé par les institutions européennes serait faire trop de cas d'un discours officiel peu averti de lalongue durée de cette histoire ». Par exemple, si l'UE soutient et promeut un réseau d'échange telqu'Eurocités, celui-ci a été fondé en 1986 à l'initiative des maires de Rotterdam et Barcelone. VION
A., op. cit., p. 145 et 152. 96 TOURNIER C., op. cit., p. 79.97 IBID, p. 80. 98 HALPERN C. & LE GALÈS P., op. cit., p. 13. 99 Le Comité des Régions, ainsi que nous l'avons déjà noté, souffre du fait de l'hétérogénéité des
représentants infra-nationaux dont il est composé, d'où ses « pouvoirs faibles ». JEFFREY C.,
20
concernant l'allocation des fonds FEDER, les premiers sont les garants de la bonne
utilisation de ces fonds par leurs régions : ils dès lors mis en place une tutelle financière
contraignante, par le biais de cours des comptes, qui montre la persistante infériorité des
régions face aux Etats et à l'UE100.
Il faudrait également tenir compte des disparités dans le rapport villes-régions-Etat dans
les différents pays européens. Selon Jouve, « s'il est un domaine en Europe dans lequel
il convient de ne pas céder aux analyses mettant l'action sur le dépérissement de l'Etat,
c'est bien celui des réformes institutionnelles touchant les villes »101. La Grèce et la
Grande-Bretagne, gouvernements très centralisateurs, représentent d'ailleurs le
modèle-même d'intervention de l'Etat en matière de politique urbaine102. Il serait ainsi
beaucoup trop simpliste de parler d'un modèle de gouvernance multi-niveaux valable
dans le cadre de tous les pays européens. Il n'est pas question, bien entendu, de nier le
fait que l'intégration européenne aie entraîné un « mouvement de redistribution de
l'autorité »103, mais cela ne se fait pas de manière uniforme et met en jeu des rapports de
domination et de pouvoir, dans la détermination des compétences entre institutions, dans
le processus de prise de décision et dans la mise en œuvre elle-même, ainsi que nous
avons pu le constater pour le projet URBAN. L'arrivée d'un nouvel acteur sur la scène
politique, en l’occurrence l'UE, entraîne bien une nouvelle distribution des cartes, en
offrant la possibilité à des acteurs infra-nationaux de s'affirmer au niveau supra-national,
mais le rapport hiérarchique entre ces derniers et l'Etat n'en demeure pas moins. Il ne
s'agit donc pas d'un simple passage d'un mode de relation vertical à un mode
horizontal : c'est pourquoi le concept de gouvernance, s'il peut paraître apte à saisir une
certaine tendance ou exprimer un idéal, pêche par la trop grande simplification qu'il
impose au réel, en évacuant la question du pouvoir, de la domination et du conflit.
« L'émergence d'une gouvernance multi-niveaux dans l'Union Européenne : une approche despolitiques nationales », in : Politiques et management public, Vol. 15, n°3, 1997, pp. 220-221.
100 TOURNIER C., op. cit., p. 80. 101 JOUVE B., « La contribution des réformes institutionnelles des métropoles à la transformation de
l'Etat keynésien : un bilan des expériences ouest-européenne », in : Géographie, économie, société,Vol. 7, n°2, 2005, p. 180.
102 Cependant, Fenet constate également que « la tendance en Europe est celle d'une expansion despolitiques urbaines nationales ». Ainsi, des pays tels que « l'Allemagne, la Finlande, la Suède, leDanemark, l'Italie, le Portugal » ont montré un intérêt croissant pour la question des villes durant lesannées 1990. De plus, comme nous l'avons vu, il faut bien distinguer entre le discours des Etatsprônant la bonne gouvernance et la réalité des faits, c'est-à-dire leur pouvoir encore prépondérant ence qui concerne l'infra, comme le supra-national. FENET R., op. cit., p. 37.
103 WOLFF S., op. cit., p. 34.
21
5. Bibliographie
5.1. Ouvrages
DEFARGES P. M., La gouvernance, Presses Universitaires de France, Paris, 2003.
5.1. Articles de revues
ATKINSON R., « Les aléas de la participation des habitants à la gouvernance urbaine enEurope », in : Les Annales de la Recherche Urbaine, n°80, 1998, p. 75-83.
BARON C., « La gouvernance : débat autour d'un concept polysémique », in : Droit etsociété, n°54, 2003, pp. 329-349.
ELANDER I., « Partenariats et gouvernance urbaine », in : Revue internationale dessciences sociales, n°172, 2002, pp. 215-230.
JEFFREY C., « L'émergence d'une gouvernance multi-niveaux dans l'Union Européenne :une approche des politiques nationales », in : Politiques et management public, Vol. 15,n°3, 1997, pp. 211-231.
JOUVE B., - « La contribution des réformes institutionnelles des métropoles à latransformation de l'Etat keynésien : un bilan des expériences ouest-européenne », in :Géographie, économie, société, Vol. 7, n°2, 2005, pp. 177-192.
- « La démocratie en métropoles : gouvernance, participation etcitoyenneté », in : Revue française de science politique, Vol. 55, n°2, 2005, pp. 317-337.
LE GALÈS P., « Du gouvernement des villes à la gouvernance urbaine », in : Revuefrançaise de science politique, n°1, 1995, pp. 57-95.
PASQUIER R. ET PINSON G., « Politique européenne de la ville et gouvernement local enEspagne et en Italie », in : Politique européenne, n°12, 2004, pp. 42-65.
PITSEYS J., « Le concept de gouvernance », in : Revue interdisciplinaires d'étudesjuridiques, Vol. 65, n°2, 2012, pp. 207-228. RIVIÈRE D., « Le renouvellement urbain et la politique européenne de cohésion, deNaples à Saint-Denis », in : Revues méditerranéennes, n°39, 2011, pp. 103-123.
SIMOULIN V., « La gouvernance et l'action publique : le succès d'une formesimmélienne », in : Droit et société, n°54, 2003, pp. 307-326.
TOURNIER C., « Le concept de gouvernance en science politique », in : Papel PoliticoBogota, V, Trois-Rivières, août 2002.
22
VION A., « L'affirmation des gouvernements urbains dans l'Union Européenne : unelégitimation professionnelle diffuse », in : Politique européenne, n°19, 2006, pp.143-167.
5.3. Ressources internet
FENET R., Politiques urbaines dans l'Union Européenne : redéfinition des rôles dans unsystème de gouvernance complexifié, travail de séminaire, Université de Lyon 2, Institutd'Etudes politiques de Lyon, septembre 2007.http://doc.sciencespo-lyon.fr/Ressources/Documents/Etudiants/Memoires/Cyberdocs/MFE2007/fenet_r/pdf/fenet_r.pdf. (consulté le 5 juin 2013).
HALPERN C. & LE GALÈS P., Grandeur et décadence de la politique urbaine de l'UnionEuropéenne. Analyse longitudinale des instruments d'action publique entre 1972 et2006, Working papers du Programmes Villes & territoires, Sciences Po, Paris, 2013.http://blogs.sciences-po.fr/recherche-villes/2013/05/01/halpern-et-le-gales-2013-grandeur-et-decadence-de-la-politique-urbaine-de-lunion-europeenne/ . (consulté le 5 juin2013).
JACQUIER C., Politiques intégrées de développement urbain durable et gouvernanceurbaine en Europe. Quelles relations mutuelles ?, Délégation interministérielle à laville, CERAT – Institut d’Études politiques de Grenoble, novembre 2003. http://i.ville.gouv.fr/download_file/2071/2132/politiques-integrees-de-developpement-urbain-durable-et-gouvernance-urbaine-en-europe-quelles-relations-mutuelles. (consultéle 7 juin 2013).
JOUMARD R., Le concept de gouvernance, Rapport n°LTE 0910, Institut national derecherche sur les transports et leur sécurité (INRETS), 2009. http://hal.archives-ouvertes.fr/docs/00/48/92/37/PDF/rapport_gouvernance_RJ_LTE0910.pdf. (consulté le 6 juin 2013)
JOUVE B., Gouvernance métropolitaine en Europe : essai de typologie, Communicationau XXXVIIIème Colloque annuel de l'Association de Science Régionale de LangueFrançaise, Trois-Rivières, août 2002. http://www.omd.uqam.ca/membres/pages-perso/Jean-Marc/cours/soc3760/recueil_web/T_Jouve.pdf . (consulté le 7 juin 2013).
WOLFF S., Les villes et l'Union Européene. Perspective : le processus d'intégrationeuropéenne par le développement urbain, travail de mémoire, Université RobertSchuman, Institut d’Études politiques de Strasbourg, mai 2008. scd-theses.u-strasbg.fr/354/01/ WOLFF _Solène_2008.pdf. (consulté le 6 juin 2013).
23