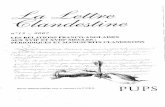La gobeleterie et le verre plat, in Giuliatto Gérard, Le ‘château de l’Avant-Garde’ à...
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of La gobeleterie et le verre plat, in Giuliatto Gérard, Le ‘château de l’Avant-Garde’ à...
212
Tout comme le verre plat, la gobeleterie du site de l’Avant-Garde a été prélevée hors stratifica-tion et sa localisation est inconnue. De ce fait, toute datation précise est impossible, et une datation rela-tive n’est possible que par comparaison avec d’autres sites lorrains contemporains, qui ont permis d’éta-blir une ébauche de typo-chronologie1.
1. Martine Berthier, « Le verre », dans Michel Bur (s.d.), Le château d’Épinal XIIIe-XVIIe siècle, 2002, Paris, p. 257-273 ; Alain Bressoud, Bruce Velde et Hubert Cabart, « Du verre au plomb avant le cristal (XIVe siècle) : une trouvaille lors des fouilles de la colline Sainte-Croix à Metz », Ca-hiers lorrains, 1, 2002, p. 21-32 ; Hubert Cabart, « étude de la verrerie », dans Philippe Kuchler, Frédéric Adam (s.d.), Fouilles d’archéologie préventive-Fouilles archéologiques 1999-Un ilôt médiéval et moderne, Épinal Vosges (88), pa-lais de justice 2e tranche (88160 12AH), non publié, 2001, p. 340-381 ; Hubert Cabart et Isabelle Bourger, « La céramique et le verre de deux ensembles clos des XIVe et XVIe siècles à Metz (Moselle) », Revue archéologique de l’Est et du Cen-tre Est, n°157, tome 41, 1990, p. 105-140 ; Hubert Cabart, « Fouille de quatre fosses (XVe-XVIIe siècle) situées dans le quartier Saint-Dominique à Châlons-sur-Marne (Marne) », Bulletin de la société archéologique champenoise, 1985, 4 ; Danièle Foy, à travers le verre, du Moyen Age à la Re-naissance, Nancy, 1989 ; Verrerie de l’Est de la France, XIIIe-XVIIIe siècle, Fabrication-Consommation, 9e supplé-ment de la Revue archéologique de l’Est et du Centre-Est, Dijon, 1990 ; Gilles Deboule, « Un ensemble de verres et de céramiques du XVIe siècle rejetté dans une latrine, rue du Palais de Justice à Troyes (Aube) », dans Fabienne Ravoire et Anne Dietrich, La cuisine de table dans la France de la fin du Moyen Âge, Caen, 2009, p. 401-409 ; Bruce Velde, « La composition des verres en France de la période antique au XVIIe siècle », ibidem, p. 167-173 ; James Motteau, « La
Certains éléments peuvent être datés des XIVe-XVe siècles, l’ensemble couvrant une période allant jusqu’en 1635-1636.
On dénombre un NMI de 562, pour un NR de 4993, dont 172 éléments identifiés (correspondant à 199 fragments). L’ensemble est en très mauvais état de conservation. Le recollage et la détermination de profils n’ont été possibles qu’en faible proportion, et un nombre conséquent de fragments n’a pu être attribué à une forme précise.
Cette mauvaise conservation est vraisembla-blement due aux conditions d’enfouissement, dans un sol peu propice à la conservation du verre, puis-que la couleur d’un certain nombre d’éléments n’a pas pu être déterminée, tant le verre était altéré, mais également au fait que, lors des fouilles, le verre n’a peut-être pas été récolté. Seuls les éléments les plus épais, heureusement les plus significatifs, nous sont parvenus.
verrerie de table en France du XIVe siècle au XVIe siècle », Ibidem, p. 177-186.2. Nombre minimum d’individus. Celui-ci est déterminé par le nombre de fragments présentant un élément de façonnage caractéristique, à savoir soit une pastille d’empontillage, soit la trace de la canne de pontillage, seul élément qui permet de ne pas tenir en compte les conditions d’altération du verre lors du comptage. Toutefois, lors de cette étude, certains ob-jets caractéristiques auxquels ne correpond aucun élément de pontillage seront aussi nommés individus.3. Nombre de restes.
Chapitre six
La gobeleterieAgnès Gelé
213
La gobeleterie
Description morphologique1.
Les formes ouvertes1.1.
Les gobelets (Fig. 1)1.1.1.
Un gobelet est un récipient à paroi verticale ou très faiblement évasée, généralement dépourvu de pied, et dont le corps est formé d’une seule pa-raison. Le décor le plus fréquent est un ensemble de côtes verticales, le plus souvent au nombre de neuf, mais pouvant aller jusqu’à quinze, et plus ou moins saillantes.
Connus dès le XIVe siècle, ces gobelets sont très répandus dans le Nord-Est de la France aux XVe et XVIe siècles4.
Ainsi les individus n°7003 et 7004 sont des gobelets à côtes saillantes de petit diamètre à la base, respectivement 4,6 et 3,6 cm. En verre de fougère, ils sont caractérisés par un décor de côtes verticales en fort relief obtenu par moulage puis étirement de
4. Danièle Foy, op. cit. ; Hubert Cabart et Isabelle Bourger, op. cit.
la pâte à l’aide d’une pince. Ils se rapprochent des formes et des dimensions d’individus des XIVe et XVe siècles.
Dans d’autres cas, seules des côtes ont ré-sisté à l’enfouissement (n°7002, 7050 à 7054, 7059, 7060, 7062 à 7064, 7068, 7069, 7082).
Certaines côtes, dans une proportion moin-dre, sont incolores et appartiennent vraisemblable-ment à des gobelets plus tardifs (n°7016, 7034, 7055, 7057, 7058, 7061, 7065 et 7066).
Des fonds de gobelets ont aussi été récoltés lors des fouilles, essentiellement en verre de fougère, d’un diamètre de 4 à 6,6 cm (n°7056, 7067, 7083, 7084, 7088 à 7090). Un seul fond incolore (n°54430-7056) a été retrouvé, tandis que le n°7087 est trop altéré pour que l’on puisse déterminer la couleur du verre.
Les verres1.1.2.
Un verre est un récipient ouvert muni d’un pied, à la paroi plus ou moins évasée, principalement destiné à la consommation des liquides.
Proportion des fragments en fonction de leur couleur
Couleur du verre Nombre de restes incolore 159
verre de fougère 114 indéterminé 193
bleu 11 rouge 1
Proportions des différentes formes de verres
Type d’objets ou de fragments Nombre de restesgobelets ou verres à tige à coupe côtelée 49
verres à pied / à boule 54bouteilles 125
objets déterminés divers 5objets indéterminés décorés 52
fragments indéterminés 193
214
Le château de l’Avant-Garde à Pompey
Verre à tige
Les fragments n°7000 et 7001 appartiennent sans doute au même objet (Fig. 2). De couleur vert clair, il s’agit d’un verre à tige creuse et à coupe côte-lée, le diamètre de base de cette dernière étant de 4,6 cm. Ce type de verre est formé de deux paraisons, l’une pour la tige et l’autre pour la coupe dont les côtes, saillantes et verticales, sont obtenues par mou-lage et retravaillées à la pince. Il est fréquemment employé en France au XIVe siècle et au début du XVe siècle.
À noter que parmi les côtes retrouvées indi-viduellement, outre celles citées précédemment, cer-taines pourraient appartenir à d’autres exemplaires de verres à tige et à coupe côtelée plutôt qu’à des gobelets (n°7002, 7051 et 7053) (Fig. 1).
Les verres à pied (Fig. 2)
Les verres à pied apparaissent à la fin du XVe
siècle et sont fréquents durant tout le XVIe siècle. Ils sont la plupart du temps incolores, les individus en verre de fougère correspondant à des productions de l’aire d’influence germanique. Plusieurs formes peuvent être déterminées, façonnées dans une seule paraison. Elles se distinguent par la proportion des pieds et des coupes, ainsi que par leurs décors, mou-lés, de résilles et de côtes principalement, ou de filets de verre blanc opaque5.
Un grand nombre de fragments correspond à des verres à pied (n°7005, 7006, 7007, 7032, 7107 à 7125, 7128 à 7135, 7137 et 7138). Six individus peuvent être identifiés grâce aux éléments de façon-nage que sont les éléments de pontillage (n°7005, 7008, 7107 à 7109 et 7111) pour trente-trois frag-ments. Vingt-trois de ces fragments sont en verre incolore, sept sont en verre de fougère et un est en verre rouge opaque. Les quatre derniers n’ont pu être déterminés du fait de leur altération. L’exemplaire assez rare de verre rouge opa-que (n°7005) comporte un pied assez court repoussé de 6,6 cm de diamètre à la base, où est encore pré-
5. Ibid., p. 257.
sente la pastille d’empontillage. Par sa morphologie et ses caractéristiques techniques, ce récipient rap-pelle un exemplaire trouvé à Châlons-en-Champa-gne et attribué au XVIe siècle6.
Le n°7008, en verre incolore et de 8,2 cm de diamètre à l’ouverture, est un verre bitronconique, caractérisé par sa morphologie particulière, le pied et la coupe, façonnés dans la même paraison, étant tous deux de forme tronconique.
Les seuls autres verres a avoir un pied en-tièrement conservé sont le n°7006, en verre de fou-gère, et un verre incolore, le n°7111. Leurs diamètres à la base sont respectivement de 7 et de 5,2 cm, avec la trace de la canne de pontillage.
Le n°7009 est un fragment de coupe moulée, en verre incolore, provenant sans doute d’un verre à pied du XVIIe ou du début du XVIIIe siècle, mais l’objet est trop incomplet pour être identifié avec certitude.
Les verres à boule (Fig. 3)
Les verres à boule sont des verres à pied qui apparaissent au XVIe siècle. Ils sont formés d’au moins trois paraisons, une pour la coupe, une pour la boule et une pour le pied. La jambe peut être plei-ne ou creuse, tout comme la boule.
Six individus ont été identifiés comme des verres à boules (n°7010, 7011, 7012, 7021, 7022 et 7040), car les boules se sont particulièrement bien conservées en raison de leur dureté.
Diverses variantes du verre à boule peuvent être observées : le n°7011 a une jambe pleine, ornée d’une boule surmontée d’une seconde plus petite ; le n°7010, une jambe creuse et une boule lisse ; les n°7021 et 7022 ont un profil identique, composé de trois paraisons, la première pour un pied discoïde, la seconde pour une boule centrale, pleine, entourée de deux anneaux de verre, l’anneau supérieur étant légèrement plus épais, le tout tenant lieu de jambe, et la troisième pour une coupe de forme conique dans
6. Ibid., p. 257
215
La gobeleterie
sa partie basse, l’élévation de ces individus n’ayant pu être reconstituée dans sa totalité ; le n°7040 est lui aussi composé de trois paraisons, la seule différence notable étant la forme de la boule, larme inversée et tronquée dans sa partie basse surmontée d’un an-neau.
Le n°7012 a une jambe creuse, faite de deux paraisons, auxquelles s’ajoute la paraison de la cou-pe, et est décorée d’une sorte de boule bulbeuse à petites côtes moulées, elle-même surmontée d’une boule plus petite.
Outre ces boules, une certain nombre d’autres fragments peuvent vraisemblablement être rattachés à ces formes. Il s’agit d’éléments de forme discoïde qui pourraient correspondre à des pieds de verre à boule (n°7023 à 7025).
Pour l’essentiel, ces formes sont en verre incolore très légèrement rosé (n°7021 à 7025), le n°7040, fortement altéré et à la surface totalement noire étant aussi sans doute incolore à l’origine. Par comparaison avec des verres à pied et à boules découverts sur d’autres sites français, ces objets peu-vent être attribués au XVIe et au début du XVIIe siècle.
« À la façon de Venise »
Le fragment n°7013, en verre incolore et bleu provient d’un verre à pied très décoré, dont le jambe, pleine, est ornée de nombreux filets rappor-tés. Ce type de verre à ailettes « à la façon de Venise » s’est largement diffusé dans la France du nord-est au cours du XVIIe siècle7.
Les formes fermées (Fig. 4)1.2.
Les bouteilles1.2.1.
Une bouteille est un récipient fermé dont l’ouverture a un diamètre inférieur au tiers de son diamètre maximal et surmonte un long col à parois
7. Erwin Baumgartner, Venise et façon de Venise, Verres Re-naissance du musée des Arts Décoratifs, Paris, 2003 ; Attilia Dorigato, Le verre de Murano, Vérone, 2003.
verticales ou faiblement convergentes (goulot). Elle est destinée au service ou à la conservation des liqui-des.
Les fragments de bouteilles sont assez nom-breux, en verre épais, parmi lesquels se distinguent des éléments caractéristiques, fonds et goulots, mais aussi des fragments de panse, conservés du fait de leur épaisseur. Ces derniers n’ont pu être remontés, en raison de leur altération et de leur grande friabili-té. Cependant, contrairement aux coupes des verres à boire, les éléments d’élévation des bouteilles sont conservés en nombre important.
Dix fonds de bouteilles ont été formellement identifiés, un en verre de fougère, deux en verre in-colore et sept dont la couleur d’origine n’est plus dé-terminable, dont six avec une trace de pontillage et un avec une pastille de pontillage.
Huit goulots sont également reconnaissa-bles, dont le n°7136, composé de deux fragments, présente une embouchure polylobée.
Le kuttrolf1.2.2.
Le kuttrolf est une bouteille à panse globu-laire et fond ombiliqué, utilisée dans le monde ger-manique. Sa caractéristique principale est un gou-lot subdivisé en deux ou quatre sections tubulaires étroites s’enroulant autour d’un axe vertical.
Ces bouteilles apparaissent dès le XIVe siè-cle, mais ne se diffusent qu’au cours du XVe siècle, avant d’être fréquemment employées dans le Nord-Est de la France et dans l’aire d’influence germa-nique au XVIe siècle. Seule une section du goulot, n°7015, est conservée.
Divers : la trompe1.3.
En verre bleu peigné de blanc, elle présente une couche d’altération conséquente qu’il conviendra de stabiliser si l’on veut pouvoir conserver le décor, qui risque de se déliter à la moindre manipulation. Incomplète, elle est tronquée aux deux extrémités.
216
Le château de l’Avant-Garde à Pompey
Cet objet (n°7017), encore appelé cornet, se présente sous la forme d’un petit cor de chasse. Il en a été retrouvé sur de nombreux sites lorrains, com-me Richardménil ou Épinal, ou encore en Thiérar-che française.
Produits en Lorraine dès le XVe siècle, ces objets ont pu être utilisés pour boire et, au XVIIe siècle, pour pétuner le tabac. Mais ils peuvent aussi être rapprochés de ce qui est nommé verroterie mu-sicale ou bien verroterie de pélerinage8. Le n°7018, en verre bleu et décoré de filets de verre blanc, pour-rait correspondre à un fragment de l’embouchure d’un autre cornet. Il est malheureusement trop petit pour que cela puisse être déterminé avec précision.
Les décors2.
Outre la couleur particulière de certains ver-res, déjà citée lors de l’étude des objets, bleu pour certains, rouge opaque (n°7005) pour d’autres et les éléments décoratifs inhérents à la morphologie de certains objets (boule, décor « façon de Venise », cô-tes) et dont il a déjà été question, un certains nombre d’éléments décoratifs ont été observés lors de l’étu-de de cette collection, sur des fragments ne permet-tant que rarement de déterminer la nature de l’objet auquel ils se rattachent.
Les décors émaillés2.1.
Deux fragments (n°7032 et 7039) présentent un motif émaillé caractéristique de verres biconiques du XVIe siècle, le n°7039 n’en présentant plus que des traces fugaces. Une série d’accolades en filets d’émail blanc opaque forme des lignes horizontales et verticales.
8. Jacqueline Bellanger, Verre d’usage et de prestige, France 1500-1800, Paris, 1988 ; Hubert Cabart, op. cit, 2001, p. 345 ; Pierre Degousée, Bruce Velde et Stéphane Palaude, « Analyses d’échantillons de Follemprise (nord de la Thié-rarche française, fin XVIe s.) », Bulletin de l’association française pour l’archéologie du verre, Paris, 2004, p. 34-37 ; Germaine Rose-Villequey, Verre et verriers de Lorraine au début des Temps Modernes (de la fin du XVe siècle au début du XVIIe siècle), Nancy, 1970.
Ce décor est aussi appelé décor « en plume d’oiseau » ou combed decoration et a été repris par les verriers vénitiens au XVIe siècle, après une longue période d’oubli pendant tout le Moyen Âge9.
L’émail est déposé sous forme de séries de fi-lets parallèles horizontaux puis, à l’aide d’une pointe, les filets sont coupés verticalement, alternativement dans un sens puis dans l’autre. D’après la forme du n°7032, fragment provenant vraisemblablement de l’intérieur du piédouche, les filets devaient être posés avant la mise en forme du verre. Ce genre de décor se retrouve sur un certain nombre de verres du quart nord-est de la France : à Châlons-en-Champagne10, où ont été découverts deux exemplaires, Nevers11, Besançon12, et Châtel-sur-Moselle13.
Les pastilles2.2.
Un seul fragment indique la présence d’objet à décor de pastilles de verre, décor d’influence ger-manique. Il s’agit du n°7049, pastille d’un diamètre de 2,1 cm, rappelant les décor des verres tels que les krautstrunk.
Les filets2.2.1. Quelques fragments présentent des décors de bandes blanches. Il peut s’agir d’une simple bande soulignant la lèvre d’un verre de forme indétermi-née (n°7045), motif que l’on retrouve sur un autre fragment dont la situation n’a pu être déterminée (n°7046).
D’autres bandes se retrouvent sur deux autres fragments. Il s’agit d’un émail surimposé à un décor de petites incisions diagonales formant une li-gne horizontale (n°7031), qui peut être soit en ligne simple, soit en double ligne. Ce procédé ornemental,
9. Ibidem, p. 27410. Danièle Foy, op.cit., p. 27411. Jorge Barrera, « Nevers, verrerie des XIVe-XVIIe siè-cles », dans Verrerie de l’Est de la France, XIIIe-XVIIIe s., (1990), p. 107-12012. Jean-Olivier Guilhot, Corinne Munier, « Besançon, rue de Vignier, verreries des XIVe-XVIe siècles », dans Verrerie de l’Est de la France, XIIIe-XVIIIe s., (1990), p. 149-15813. Non publié
217
La gobeleterie
que l’on retrouve sur les parois des verres à pied, apparaît à la fin du XVe siècle.14.
Une lèvre de cornet (n°7019) présente un décor de filets blancs, la trompe étant de verre bleu. Le décor de filet blanc apparaît aussi sur deux pe-tits fragments de verre incolore, les n°7126 et 7169, provenant peut-être du même objet. Ce même pro-cédé d’application de filets de verre est utilisé sur le fragment n°7170, filet incolore sur surface elle aussi incolore.
Le site de l’Avant-Garde a livré une collec-tion de verres creux caractéristique de formes du quart nord-est de la France, datant du XVe au début du XVIIe siècle. L’influence germanique se fait fai-blement ressentir, par la proportion de fragments de verres à pied en Waldglass, ou verre de fougère, ainsi que par la présence d’une pastille, procédé décoratif employé fréquemment en Allemangne et en Alsace pour ces périodes.
14. Danièle Foy, op. cit, p. 257
218
Chapitre sept
Le verre platAgnès Gelé
Le verre plat retrouvé sur le site de l’Avant-Garde présente un inconvénient majeur, celui de ne plus être en place et d’avoir été prélevé hors strati-fication. Il est donc difficile de connaître la localisa-tion et la datation d’ensemble vitrés. D’après l’étude de l’occupation du site, le verre plat pourrait être daté des XV-XVIIe siècles. Les épaisseurs variables des verres trouvés, ainsi que leurs qualités laissent supposer la présence de deux verrières au minimum. D’une couleur vert pâle, ne présentant pas d’éléments de décoration, ils peuvent être rattachés à la tradition du verre plat dit « de fougère » utilisé dans les habitats aristocratiques et bourgeois lorrains de façon de plus en plus fré-quente à partir du XVe siècle.
Le verre en table, appelé aussi verre « à man-chon », qu’il soit vert pâle ou de couleur, va assoir le renom du verre plat lorrain. Il tire son nom de la technique de fabrication employée, puisqu’elle consiste à souffler de longs cylindres, ou manchons, dont on excisait les deux extrémités, que l’on coupait ensuite dans la longueur, afin d’obtenir une feuille de verre, après qu’elle eut été étalée. Cette plaque, nom-mée table de verre, transportée telle quelle depuis les centres de production, était ensuite découpée au moyen de grugeoirs afin d’obtenir des éléments de verre à la taille et à la forme désirée lors de la créa-tion de verrières (carrés, rectangles, losanges, …).
Certains fragments de verres à vitre retrou-vés sur le site de Pompey présentent la particularité de provenir de l’extrémité de ces manchons de verre. Ils présentent un côté droit et net, non grugé, et de profil arrondi.
Quelques éléments particuliers1.
Un verre serti et quelques verres 1.1. triangulaires
Le verre n°7015 est le seul qui présente la particularité d’être encore dans son plomb. De for-me triangulaire, de dimension 3 x 3 x 4,5 cm, il est cassé en trois fragments, qui sont restés en place à l’intérieur du plomb. Le plomb est, en coupe, en for-me de H, avec des ailes de 3 à 5 mm de large et d’1 mm d’épaisseur. Le cœur fait aussi 3 mm (Fig. 1).
Fortement altérée et opacifiée, la surface du verre est noire. La pellicule d’hydratation, commen-çant à se déliter, révèle un verre originel de couleur vert pâle.
Trois autres individus, les n°7724, 7725 et 7726 sont les verres plats de forme triangulaire et de dimension quasi-identique au précédent. Cela pour-rait correspondre à des éléments de bordure exté-rieure de verrière.
219
La gobeleterie
Un verre de forme circulaire1.2.
D’un diamètre de 3,2 cm, l’individu n°7727 est un verre plat de forme circulaire, présentant en-core la trace de l’utilisation d’un grugeoir pour sa dé-coupe sur la totalité de la circonférence conservée.
À ces verres triangulaires et circulaires, il convient d’ajouter un fragment particulier. Il s’agit du n°7728, de forme indéterminée, qui présente un bourrelet formant une arête transversale.
Le verre plat de l’Avant-Garde2.
Le verre à vitre s’étudie en fonction de son altération et de sa forme. Aussi, en dehors des indi-vidus déjà observés, le reste de la collection peut être résumé sous forme de tableau, reprenant ces deux données (voir ci-dessou).
Comprenant 896 fragments, la collection est principalement composée de verre plat ne présen-tant pas de caractéristique particulière et fortement altéré. C’est pourquoi aucune étude plus complète n’a pu être menée.
54430-AG-7015 : verre plat triangulaireVerre vert clairHauteur : 2,1 cmLargeur : 3,4 cmEncore serti dans ses plombsDatation : XV-XVI siècles
54430-AG-7015
0 1 5 cm
Figure 1 : Verre plat.
FormePas ou peu d’altération
Surface altéréeSurface
totalement noireSurface se
délitantBordure
de manchon4 9 12 9
Losanges grugés (entiers ou partiels)
7 10 4 9
Forme grugée indéfinie 14 36 36 24
Aucun élément caractéristique 11 57 179 475
220
Le château de l’Avant-Garde à Pompey
54430-AG-7003
0 1 5 cm
54430-AG-7003 : gobelet(à côtes saillantes verticales)Verre vert clairMarque de pontillageDiamètre à la base : 4,6 cmDatation : fin XIV-XV siècle
54430-AG-7004
0 1 5 cm
54430-AG-7004 : gobelet(à côtes saillantes verticales)
Verre vert clairDiamètre à la base : 3,6 cm
Datation : fin XIV-XV siècle
54430-AG-7002
0 1 5 cm
54430-AG-7002 : gobelet ou verre(à côtes saillantes verticales)
Verre vert clairDatation : XIV-début XVI siècle
54430-AG-7005
0 1 5 cm
54430-AG-7005 : gobeletVerre rouge opaqueMarque de pontillageDiamètre à la base : 6,6 cmDatation : XVI siècle
Figure 1 : Gobelets.
221
La gobeleterie
54430-AG-7006
0 1 5 cm
54430-AG-7006 : verre à piedVerre vert clair
Diamètre à la base : 7,0 cmDatation : XVI siècle
54430-AG-7008
0 1 5 cm
54430-AG-7008 : verre bitronconiqueVerre incoloreDiamètre à la base : 8,2 cmDatation : XVI-début XVII siècle
54430-AG-7009
0 1 5 cm
54430-AG-7009 : verre à pied (?)à coupe moulée
Verre incoloreDatation : fin XVI-
début XVII siècle
54430-AG-7000 et 7001
0 1 5 cm
54459-CA-7000 et 7001 :verre à tige à coupe côtelée(côtes saillantes verticales)Verre vert clairDiamètre à la basede la coupe : 5,4 cmDatation : fin du XIV-début XV siècle
Figure 2 : Verres à pied et verres à tige.
222
Le château de l’Avant-Garde à Pompey
54430-AG-7011 : verre à pied à boule (?)Verre incoloreJambe pleineDatation : fin du XVI-début XVII siècle
54430-AG-7011
0 1 5 cm
54430-AG-7010
0 1 5 cm
54430-AG-7010 : verre à pied à bouleVerre incoloreJambe creuse
Datation : fin du XVI-début XVII siècle
54430-AG-7012
0 1 5 cm
54430-AG-7012 : verre à pied à bouleVerre incoloreJambe creuse, boule mouléeen forme de bulbe côteléDatation : fin du XVI-début du XVII siècle
54430-AG-7013
54430-AG-7013 : verre à piedVerre incolore et bleu
Jambe pleine,filets incolores et bleus rapportés
Datation : début XVII siècle0 1 5 cm
Figure 3 : Verre à boule.